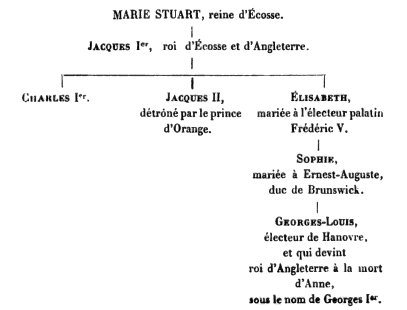L'EUROPE ET LES BOURBONS SOUS LOUIS XIV
AFFAIRES DE ROME. — UNE ÉLECTION EN POLOGNE. — CONFÉRENCES DE GERTRUTDENBERG. — PAIX D'UTRECHT
CHAPITRE XI.
|
L'abbé Gautier. — Cause de sa présence à Londres. — Ses relations. — Bolingbroke l'envoie en France porter les premières propositions de paix. — Voyage de l'abbé Gautier. — Offres du gouvernement britannique. — Louis XIV les accepte, mais refuse de s'adresser de nouveau aux Provinces-Unies. — Démarche spontanée faite par les Provinces-Unies auprès de Louis XIV. — Celui-ci la repousse fièrement et déclare qu'il veut traiter seulement par l'intermédiaire du cabinet de Londres. — Mort de Joseph Ier, empereur d'Allemagne. — Heureuse influence de cet événement sur les négociations. — Demandes de l'Angleterre. — Ménager va à Londres les discuter au nom de Louis XIV avec Bolingbroke. — Derniers obstacles suscités à Londres contre l'ouverture d'un congrès. — Menées du comte de Gallasch, ambassadeur de l'Empire. — Sourdes intrigues de Buys, ambassadeur des Provinces-Unies, et de Bothmar, envoyé de l'électeur de Hanovre. — Inutile voyage du prince Eugène en Angleterre. — Utrecht est choisi pour être le siège du congrès, et l'on nomme les plénipotentiaires chargés d'y représenter la France et la Grande-Bretagne. Il se trouvait alors à Londres un prêtre français, l'abbé Gautier, qui, après la paix de Riswick, avait suivi comme aumônier le maréchal de Tallard dans son ambassade en Angleterre. Il n'avait pas tardé à s'introduire chez le comte de Jersey, ambassadeur en France, et dont la femme, appartenant à la religion catholique, était demeurée à Londres. Accueilli dans cette opulente maison, il y fut présenté à Prior ainsi qu'à d'autres Anglais distingués avec lesquels il s'instruisit de la langue, des mœurs et des affaires de leur pays[1]. Aussi, au moment de rupture entre les deux nations, parut-il à Tallard apte à transmettre pendant la guerre au gouvernement français des renseignements utiles, et on le laissa en Angleterre dans une situation assez vague qui tenait à la fois de l'espion déguisé et du chargé d'affaires non reconnu. On lui recommanda d'observer les événements avec soin, de tâcher d'en pénétrer le secret d'une manière clairvoyante et d'en rendre compte avec discrétion, afin de ne pas éveiller de soupçons et de pouvoir continuer à habiter une ville où il semblait retenu par ses goûts et non par des intérêts politiques. C'est cet agent adroit et suffisamment sûr, capable d'inspirer à Torcy une certaine confiance et trop obscur néanmoins pour attirer l'attention des alliés, que Bolingbroke chargea, en janvier 1711, de faire les premières ouvertures au gouvernement français. Il ne lui donna aucune lettre, aucun signe qui pût le trahir, mais il lui confia quelques particularités auxquelles Torcy pourrait reconnaître que cette mission émanait véritablement du gouvernement britannique. Il était chargé de dire à Louis XIV que les nouveaux ministres d'Angleterre souhaitaient la paix, mais qu'il ne dépendait pas d'eux d'ouvrir immédiatement une négociation particulière avec la France ; qu'il était nécessaire que le roi fit encore proposer aux états-généraux de renouer les conférences pour la paix ; que, lorsqu'elles seraient ouvertes, les ambassadeurs, que l'Angleterre nommerait pour y assister, auraient des ordres si précis, qu'il ne serait plus permis aux Provinces-Unies d'en retarder la conclusion[2]. Bolingbroke, si habile à pénétrer les hommes, eut bien vite jugé l'aventureux abbé, et il n'hésita pas à lui exposer nettement les chances favorables et les chances contraires de son entreprise. Il s'agit, lui dit-il, d'avoir trente mille livres de rente ou d'être pendu. Divers hasards peuvent vous faire arrêter comme espion. Voilà le mauvais côté. Mais, si vous échappez à la corde, vous acquerrez la fortune et serez utile à ce pays-ci et au vôtre. Gautier, espérant qu'il le serait surtout à lui-même, et déterminé principalement[3] par cette considération toute personnelle, consentit à accepter une mission qui lui paraissait encore plus profitable que glorieuse, et ce hardi courtier de paix s'embarqua le 12 janvier 1711, emportant avec lui la nouvelle de la détermination la plus grave de l'époque et la plus surprenante pour toute l'Europe. Heureusement arrivé à Nieuport et bientôt à Paris, où il descendit, sous le nom de Delorme, à la maison des pères de l'oratoire de la rue Saint-Honoré, Gautier ne tarda pas à se rendre chez Torcy[4] et l'aborda par ces mots : Voulez-vous la paix, monseigneur ? Je viens vous apporter les moyens de la conclure. C'était, fait remarquer Torcy dans ses mémoires[5], demandez à un malade attaqué d'une longue et dangereuse maladie, s'il veut guérir. Si inattendue que fût une telle proposition, le cabinet de Versailles ne se départit pas de sa prudence, pas plus que les désastres essuyés jusqu'à ce jour n'avaient pu atteindre son inaltérable fierté. Louis XIV accepta avec reconnaissance l'offre de la paix ; mais, se souvenant des humiliations subies à Gertruydenberg, il refusa péremptoirement de s'adresser de nouveau à la Hollande, et déclara vouloir traiter avec le seul gouvernement britannique. Cette réponse donnée verbalement à Gautier, comme l'avait été l'offre apportée par celui-ci, fut accompagnée, selon la recommandation de Bolingbroke, d'une lettre de compliment sans signification apparente, mais destinée en réalité à faire connaître l'acceptation générale autrement que par la parole incertaine d'un obscur messager. La cour de Londres ayant ensuite proposé de transmettre elle-même à la Hollande les conditions du gouvernement français, Louis XIV, persistant dans sa résolution, refusa de s'adresser, même indirectement, aux états-généraux. Dès que ceux-ci furent instruits de l'ouverture d'une négociation entre l'Angleterre et la France, ils désirèrent vivement enlever au cabinet de Londres l'honneur et l'avantage de la diriger. Répudiant comme par enchantement les sentiments de haine qu'ils avaient affichés jusqu'à ce jour contre la France, et d'une hostilité passionnée et systématique passant tout à coup à une complaisante condescendance, les Hollandais s'adressèrent à Louis XIV et, après avoir tout refusé au roi vaincu et isolé, ils offrirent de satisfaire pleinement le souverain recherché par les Anglais. Tant il est vrai qu'on retrouve les mêmes passions dans les affaires les plus considérables comme dans les plus mesquines, et que la politique qui préside aux relations des États n'est pas différente de celle qui règle les rapports des hommes ! Louis XIV fit répondre[6] par Torcy à Petkun, ministre du grand pensionnaire, qu'il avait essuyé, de la part des Hollandais, trop de demandes extravagantes et souffert dans la personne de ses ambassadeurs des traitements trop indignes, pour qu'il pût reprendre avec cette république des conférences infructueuses. C'était une première et bien légitime revanche de Gertruydenberg ! Bolingbroke, comprenant cette fière conduite, et conservant ainsi, comme il était juste, la direction du mouvement pacifique dont il avait donné l'impulsion, sortit alors des généralités vagues, et il demanda un mémoire détaillé des offres du gouvernement français. C'est au moment même où 'Forey rédigeait ce mémoire que survenait cet événement imprévu et providentiel qui allait aider la France à soutenir ses droits incontestables, et puissamment faciliter l'œuvre entreprise par Bolingbroke. Joseph Ier, empereur d'Allemagne depuis six ans seulement, ayant à peine atteint sa trente-troisième année, encore plus vigoureusement constitué et bien mieux doué que Léopold son père, et paraissant devoir régner aussi longtemps que lui et avec plus de gloire, était emporté en trois jours par la petite vérole, ne laissant que deux filles et instituant pour son héritier[7] l'archiduc Charles, son frère. L'avènement de l'archiduc au trône impérial en aurait fait le premier potentat de l'Europe, si les alliés avaient continué à favoriser ses prétentions à la couronne d'Espagne, et, tandis que la France aurait été rabaissée bien au-dessous du rang qu'elle doit occuper dans le monde, la maison d'Autriche serait inopinément remontée au degré extraordinaire de puissance où, seul, Charles-Quint avait pu quelques années la maintenir. Ce changement de souverain[8] rendait donc plus indispensable encore, par la raison d'État européenne, un revirement de politique entrepris et jusque-là poursuivi pour la seule raison d'État britannique. La paix, que le nouveau ministère tory avait considérée et montrée comme une nécessité particulière pour l'Angleterre, devenait désormais une nécessité impérieuse pour toute l'Europe ; et à la vive impulsion déjà donnée par quelques hommes venait s'ajouter la force des événements pour assurer un dénouement naturel et nécessaire au repos universel. Joseph Ier était mort le 17 avril. Mais, à cette époque de lentes et difficiles communications, l'importante nouvelle n'était encore parvenue ni à Versailles, le 22 avril[9], quand Torcy envoya son mémoire, ni à Londres, le 30, lorsqu'il y fut reçu. Néanmoins les bases de la négociation étaient déjà bien différentes[10] de celles de Gertruydenberg, et même des préliminaires de la Haye. Tandis, en effet, que le point de départ des conférences avait été jusque-là l'exclusion perpétuelle de la maison de Bourbon du trône d'Espagne, son maintien était maintenant considéré comme certain par le cabinet de Versailles. Le dévouement persistant des Espagnols envers Philippe V, sa propre opiniâtreté, et tant de brillantes victoires obtenues sur l'archiduc, devaient d'ailleurs, autant que la mort de Joseph Ier, déterminer l'Angleterre à admettre ce point essentiel. Il ne restait donc qu'à débattre les satisfactions à accorder aux puissances confédérées. Parmi ces puissances, l'Angleterre était celle qui, tant à cause du rôle important joué par elle pendant la guerre, que pour l'initiative audacieuse qu'elle venait de prendre, avait le droit de se montrer la plus exigeante. En outre, la situation particulière des ministres tories, toujours en butte aux vives attaques de leurs adversaires, leur imposait l'obligation d'obtenir le plus d'avantages possible d'une paix que les whigs critiquaient amèrement avant même d'en connaître les conditions. Les demandes, que la couronne d'Angleterre présentait pour elle-même, furent donc exposées dans un mémoire[11] que fut chargé de porter à Versailles, en juillet 1711, l'habile Mathieu Prior, depuis longtemps façonné aux affaires, et élevé à l'école politique de Portland, de Jersey et de Bolingbroke. Ces demandes, dont la principale consistait à faire accorder aux Anglais, pour leur commerce, autant d'avantages qu'en posséderait la nation la plus favorisée, étaient en réalité trop considérables. Si on y eût accédé, le commerce français était à jamais ruiné, et l'Angleterre se serait assuré cette prépondérance universelle disputée avec raison à la France, enlevée naguère à la maison d'Autriche, et toujours si menaçante pour l'Europe, en même temps que souvent si dangereuse pour la puissance même qui la possède, qu'il est de l'intérêt de toutes les nations européennes qu'aucune ne s'en empare entièrement. Prior ayant reçu l'ordre d'écouter les objections sans les discuter, et de recueillir les réponses sans rien modifier sur les demandes[12], Louis XIV jugea convenable de transporter le siège de la négociation à Londres et d'y envoyer[13], avec Gautier, Ménager, député de la ville de Rouen au conseil de commerce, dont la grande expérience sur les matières qui allaient être traitées devait, autant que sa sage circonspection, être utile aux intérêts de son gouvernement. Grâce à la ferme volonté de Bolingbroke et à la loyauté pleine de noblesse qu'il sut y déployer, les conférences, commencées le 26 août, purent être terminées dans les premiers jours d'octobre[14]. A l'exception des questions relatives au commerce, qu'on décida devoir être réglées de la manière la plus juste et la plus raisonnable, et qui, après avoir été discutées, furent toutes comprises dans cette formule vague et générale, les points principaux furent débattus et admis tels à peu près qu'on allait les arrêter dans le traité définitif. L'examen des intérêts de quelques alliés fut renvoyé à la discussion générale. Mais on établit d'une manière incontestable[15] l'obligation, imposée à Louis XIV et à son petit-fils, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réunion sur la même tête des couronnes de France et d'Espagne. C'était là, en effet, le seul intérêt européen. Ne pas enlever à un prince français la possibilité, même la plus éventuelle, de réunir un jour sous un même sceptre ces deux grands États, eût été s'exposer, du côté des Bourbons, au même danger du cumul des couronnes dont on venait de se garantir contre les Habsbourg ; c'eût été tomber dans une étrange et aussi coupable inconséquence. Toutes les autres questions n'étaient que subsidiaires et particulières à divers gouvernements. Celle-là seule était capitale. On la posa à Londres, en se promettant de la résoudre à Utrecht. Le moment approche, en effet, où va se terminer cette longue contestation, qui a rempli de ses vicissitudes diverses la seconde moitié d'un siècle et le commencement de l'autre. A mesure qu'on marche vers l'acte final du drame, de nouveaux et redoutables obstacles sont suscités, qui semblent devoir en retarder le paisible et indispensable dénouement. Les nombreuses passions, engagées dans cette lutte acharnée, redoublent d'efforts pour l'emporter sur la raison calme et droite qui dirige un mouvement nécessaire et destiné à triompher. C'est en vain que le comte de Gallasch, ambassadeur de l'empire, s'unit aux whigs les plus exaltés, et, ne se contentant pas de jeter le ridicule sur les ministres tories, forme une cabale puissante[16], en vue de méconnaître à la reine le pouvoir absolu, que lui donne la constitution, de faire la guerre ou la paix. Anne le chasse de sa présence et lui interdit l'entrée de la cour. C'est en vain que Buys se fait charger par les états-généraux d'aller à Londres[17] combattre la nouvelle politique du cabinet anglais. Moins audacieux que l'ambassadeur de l'empire, mais plus dangereux, et aux attaques ouvertes préférant les sourdes menées, il essaye d'entraver la marche de la négociation, et, continuant la tactique de Gertruydenberg, il multiplie les objections et les obstacles, semblant d'abord tout accepter afin d'avoir le droit de tout réfuter[18]. Mais il ne parvient pas plus à ébranler la conviction de la souveraine qu'à accréditer l'accusation dirigée contre Bolingbroke d'avoir abandonné la Hollande, et celui-ci, lui renvoyant ce reproche, a le droit d'écrire fièrement : Quant à ce point, je ne vous dis que deux mots, mais significatifs : c'est que la reine ne fera jamais la paix avec la France comme les Hollandais l'ont faite à Nimègue ![19] C'est en vain encore que Bothmar, envoyé de l'électeur de Hanovre, héritier présomptif du trône d'Angleterre[20], escompte l'influence future de son maître et la met au service des ennemis de la France. La Chambre des communes, qui représente la plus récente opinion du pays, reste fidèle aux tories, qui l'ont conquise par leurs écrits, qui l'ont enthousiasmée par leurs actes, et qui la séduisent tous les jours par leurs discours entraînants. Mais la majorité de la Chambre haute se laisse gagner par les manœuvres des whigs, et vote, le 19 décembre, une adresse à la reine pour la détourner de la paix[21]. Anne crée brusquement douze nouveaux pairs qui lui rendent la majorité un moment perdue, et qui terminent dans l'intérêt de la cour un débat suscité par de rancuneuses haines ou par d'ambitieuses visées. C'est vainement enfin que le prince Eugène, voyant affaiblie l'influence du grand pensionnaire Heinsius, et détruite celle de Marlborough, accourt à Londres[22] pour ajouter ses propres forces aux forces chancelantes des deux hommes qui, avec lui, composaient le triumvirat si redoutable pour Louis XIV. Bolingbroke, auquel la reine, prétextant une maladie, l'a renvoyé, réfute[23] victorieusement ses arguments, et démontre avec éloquence l'inanité de ses plaintes. Se sentant impuissant à combattre ouvertement une politique si bien défendue, et à laquelle une éclatante manifestation de la Chambre des communes[24] vient de donner l'assentiment national, le prince Eugène recourt alors à l'intrigue, aux complots et aux plus basses menées[25]. Avec Devonshire et Nottingham, il essaye de renverser le gouvernement d'Anne et d'élever sur le trône l'électeur de Hanovre. A Godolphin et à Marlborough, il propose l'assassinat de Harley et de Bolingbroke[26]. Mais il ne parvient à soulever qu'une vile populace : La ferme attitude des ministres fait avorter les conspirations, comme leur courage sait affronter les plus odieuses attaques, et Eugène quitte Londres avec la honte de les avoir entreprises et l'amertume d'y avoir échoué. Aucun des adversaires de la paix n'a réussi, parce qu'ils sont venus briser leurs efforts, non-seulement contre des hommes intrépides et convaincus, mais surtout contre une idée juste et nécessaire. La Hollande fut bientôt obligée, contre son gré, et avec bien moins de sincérité que l'Angleterre, de suivre son exemple ; et la reine de la Grande-Bretagne fit signifier aux ministres des alliés que le congrès pour la paix se tiendrait à Utrecht[27], qu'il s'ouvrirait dans le mois de janvier, et qu'elle avait nommé, pour l'y représenter, le docteur Robinson, évêque de Bristol, et le comte de Strafford, son ambassadeur en Hollande, comme, de son côté, le roi de France avait désigné pour ses ambassadeurs : Ménager, Huxelles et l'abbé de Polignac. |