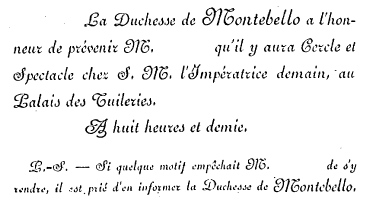L'IMPÉRATRICE MARIE-LOUISE
VII. — LA COUR, LES VOYAGES ET LES FÊTES.
L'Obligation de s'amuser. — Tradition dos Voyages royaux. — Voyage à Rambouillet. — Voyage à Cherbourg. — Caractère de ce Voyage. — But qu'y poursuit l'Empereur. — Retour à Saint-Cloud. — Baptême du Roi de Rome. — Fêtes à la Ville, aux Tuileries et à Saint-Cloud. —Tri a non. —Saint-Cloud. — Rambouillet. — La Saint-Napoléon. — Nouveautés d'Étiquette. — La Fête de l'Impératrice. — La Soirée de Trianon. — Voyage à Compiègne. — Le Voyage de Hollande. — L'Archiduchesse fêtée à Bruxelles. — Anvers. — Amsterdam. — La Contrebande. — Les Bords du Rhin. — Le Grand-Duché de Berg. — Retour à Saint-Cloud. — Rentrée à Paris. — L'Étiquette. — Les Cercles de l'Impératrice. — Les Chasses. — Le Voyage à Grosbois. — Le Jour de l'An. — Tristesse de Paris. — Bals par ordre. — Grand Bal paré aux Tuileries. — Quadrille des Heures. —Grand Bal masqué. — Costumes de l'Impératrice et de ses Dames. — Quadrille des Incas. — Séjour à l'Elysée. — Saint-Cloud. — Départ pour Dresde. — Le Moniteur du 9 mai 1812.Quelque volonté qu'ait l'Empereur de se rendre le meilleur des maris, quelque affection profonde et tendre qu'il éprouve pour sa femme, quelque soin qu'il porte à descendre la surprendre, à lui tenir des propos enjoués lorsqu'il la trouve sérieuse et à déconcerter sa réserve par de bonnes et franches embrassades, il ne peut, à la façon des empereurs de Lorraine-Autriche, se consacrer à ce point à l'épouse qu'il cesse d'être l'homme de son empire, de son armée et de son génie. Elle, habituée à un gouvernement qui marche tout seul, sous un souverain, nominalement absolu, prisonnier en fait d'une oligarchie qui lui enlève jusqu'à la peine de penser et jusqu'à la velléité de commander, peut-elle imaginer qu'il faille ce constant effort, cette perpétuelle surveillance, cette inquiète attention pour maintenir, en une apparente cohésion, ces morceaux rapportés d'Etats et de provinces, de monarchies et de républiques sur qui Napoléon a étendu son manteau impérial ? Lui entend en dissimuler le labeur, car, pense-t-il, sa femme en prendrait une moindre idée de sa puissance, apercevrait l'élévation hâtive, le présent .peu rassurant, l'avenir suspect, comparerait ce qui se passe ici à ce qu'elle a vu dans son pays, dans les palais de son père et l'en trouverait diminué. D'ailleurs, le somptueux de la vie souveraine plaît à son orgueil ; puis, cette vie est un engrenage. L'usage y fait loi ; sous peine d'accuser des troubles intérieurs, de marquer des inquiétudes extérieures, d'annoncer la ruine prochaine, on ne peut se dispenser à l'avenir des fêtes et des déplacements qui, une année, ont plu. On n'a pas la permission de négliger un précédent et de ne pas répéter aux mêmes époques des plaisirs qui deviennent une servitude. Peu importe le travail, l'Europe n'en doit rien savoir ; si les petits voyages étaient interrompus, elle en retentirait et prendrait l'alarme : si les grands voyages dès longtemps promis étaient ajournés, les royaumes récemment annexés en tressailleraient et songeraient à leur indépendance. L'Empereur aime, d'ailleurs, ces prises de possession où il apparaît en train impérial, suivi d'un cortège que lui seul peut réunir, entouré d'une pompe que n'ont pas même connue .les rois ses prédécesseurs. Il se plaît aussi à restaurer et à continuer ces habitudes de la royauté, toutes vivantes encore il y a un siècle, qui lui semblent inséparables de l'exercice de la souveraineté et qui s'accommodent au besoin qu'il a de changer de résidence. Des rois de jadis, des rois allant vivre avec leur cour et leur domesticité innombrable en chacun des châteaux de leur domaine pour y consommer sur place l'intransportable récolte, une tradition est passée aux descendants, même les plus lointains, qui les a rendus instables et perpétuellement mouvants, bien après que la cause avait disparu, que la monarchie semblait fixée à Versailles, et lorsque l'unique prétexte qu'on pût invoquer était la chasse. A peine si, à Versailles, Louis XV a dormi cent nuits par année. De château en château, dans un rayon qui n'excédait guère l'antique domaine des premiers Capétiens, il errait, toujours entouré des mêmes figures, et traînant après lui les mêmes gens. Sans qu'une telle agitation fut dans ses manières, Louis XVI n'a pas rompu avec les coutumes séculaires. Elles deviennent pour Napoléon une règle stricte, dès qu'elles sont royales. Le nombre des châteaux est encore plus restreint et le choix moindre ? le travail plus pressant ne permet que des absences plus courtes ; il convient — ce qui était inconnu de Louis XV et ne se présenta qu'une fois pour Louis XVI — d'aller inspecter soi-même les travaux ordonnés, provoquer, comme fit Louis XIV, la fidélité de provinces ou de royaumes nouvellement conquis ; mais cela ne fait que plus de raisons pour que l'Empereur perpétue cette vie errante et, en cette année 1811 où tant de liens — ne fût-ce que son fils nouveau-né — devraient le retenir à Saint-Cloud, où tant d'affaires — ne fût-ce que de la guerre prochaine — lui défendraient de s'en écarter, il précipite encore le mouvement, l'accélère au point de le rendre presque impossible à suivre, et l'entoure d'une constante splendeur qui éblouit et fatigue l'imagination. Du 14 au 22 mai, avec toute une suite de rois et de princes, il vient passer huit jours à Rambouillet ; l'on y est en babil de chasse à tir ; et Leurs Majestés, qui déjeunent tête à tête dans les fabriques du parc, agréent à leur dîner les princes et quelques dames. Les affaires sont instantes et graves ; le roi d'Espagne est arrivé pour réclamer des secours, la guerre avec la Russie est inévitable, mais l'Espagne et la Russie peuvent attendre : avant les couches, l'Empereur a dit qu'il irait à Cherbourg et, du 23 mai au 4 juin : on roule sur les chemins. C'est par Dreux, Laigle, Argentan, Caen, Isigny, à l'aller, par Saint-Lô, Caen, Alençon et Chartres au retour, le voyage le plus brillant, avec une suite où figurent le grand-duc-de Wurtzbourg et le vice-roi, trois ministres, dix-huit officiers de l'Empereur, cinq dames et six officiers de l'Impératrice, six pages et un menin et cent un gagistes de tous les services. Il y faut cinquante voilures, attelées de deux cent cinquante-neuf chevaux de poste, plus dix-sept bidets pour les piqueurs et, des écuries, six brigades de chevaux de selle, six berlines de ville, trois calèches en Daumont et cinquante chevaux de carrosse. Il y a pour les escortes cent cinquante Grenadiers, deux cent trente Chasseurs, autant de Dragons et quinze Gendarmes d'élite, sans compter, sur toute la route, à partir de Rambouillet, des piquets chacun de vingt-cinq Chevau-légers du 2e régiment, commandés parmi officier, un maréchal des logis et un vieux chasseur de la Garde. — Cela est une nouveauté : jamais, en aucun voyage, l'Empereur n'a pris d'autre escorte que quelques gendarmes coureurs. La gendarmerie, qui n'escorte pas, est réunie en patrouilles aux points de passage et, en chaque ville, des gardes d'honneur à cheval et à pied, rivalisant de luxe en leurs tenues, se sont habillées, équipées et montées à leurs frais — spontanément ou non — pour la-circonstance. Ce qui fait encore la différence de ce voyage à tous les autres, c'est qu'il n'y a de grâces, défaveurs, presque d'audiences que pour les nobles, les ci-devant, les émigrés rentrés : on déjeune à Tubœuf au château de M. le comte de Lillers, chambellan de la grande promotion ; à Caen où, pour établir le palais, on a joint sur la rue Guilbert les hôtels d'Aigrefeuille et du Fresne, M. de Mathan, ci-devant marquis, commandant de la garde à cheval, reçoit une tabatière à chiffre de 5.132 francs, M. de Courville, commandant la garde à pied, une de 2.110 francs, M. de Vandeuvre, président du collège électoral, une boite à portrait de 6.472 francs ; M. Lentaigue de Logivière, maire, une boite à chiffre de 3.471, sans parler d'une pension de 6.000 francs sur le domaine extraordinaire. Trente-sept dames de la ville sont présentées : presque toutes portent la particule ; au lever, le 25, il n'est admis que des gentilshommes. Et lorsqu'il s'agit de présents à des bourgeois, présidents de collèges électoraux, maires, commandants de gardes d'honneur, c'est assez de boîtes de 4.000, 2.000, 1.700, même 1.100 francs. Ce n'est pas que les libéralités aux peuples ne soient grandes ; elles passent en largesse tout ce qu'on a vu jusqu'alors : à Houdan, à Dreux, à Laigle, à Argentan, 3.000 francs pour l'hôpital, à Falaise 6.000, à Caen 20.000, plus 100.000 aux incendiés d'Évréchy, 700.000 pour le canal de Caen à la mer, 12.000 aux pétitionnaires ; à Ouistreham, 3.000 francs aux pauvres, à Bayeux 0.000, à Carentan 4,000, à Valognes 4.000, à Cherbourg 10.000, plus 4.000 aux canotiers de Leurs Majestés, 1.000 aux canotiers du port, quinze jours de solde aux canonniers et aux marins, 500 francs à chacun des officiers de la 5e légère rentrant des prisons d'Angleterre, 3.000 francs à la veuve d'un officier et quelque 10.000 francs distribués sur la route. Et, à Saint-Lô, les pauvres ont 6.000 francs, à Séez 2.500, à Alençon 10.000, à Mortagne 4.000, à Chartres 10.000. Et, dans les manufactures de Caen et d'Alençon, des commandes de dentelles et de blonde pour plus de 100.000 francs — dont une redingote et un manteau de cour de 40.000. — Pour chaque messe dominicale, à Caen et à Alençon, 3.000 francs aux prêtres ; à Chartres, un postillon se blesse, 1.000 francs tout de suite et u00 francs de pension. L'or ruisselle de ses mains inépuisablement, mais comme il gagnerait à passer par celles de Joséphine ! Ici, comme dans les deux premiers voyages — plus même — Marie-Louise apparaît hautaine, ennuyée, silencieuse — une tête de bois, dit la gausserie normande. Elle ne trouve pas un mot en réponse des compliments que lui adressent les autorités, pas un sourire en échange des fleurs que lui offrent les petites filles ; d'un air lassé, elle assiste aux réceptions, aux bals, aux promenades, tandis que, à la façon d'une aumône, d'un air méprisant et d'une voix sèche, la dame d'honneur distribue les bijoux obligatoires. L'Impératrice ne se déride qu'à Cherbourg, non pas aux représentations qu'est venue donner par ordre, la troupe de Feydeau, mais aux excursions avec l'Empereur, aux visites des vaisseaux, aux explorations sur la plage. Napoléon lui fait des farces qu'il trouve joyeuses, la prend dans ses bras, la porte près d'un sabord, lui dit : Veux-tu que je te jette à la mer ? — Si tu veux, répond-elle. Ou bien, à bord du Courageux où bat le pavillon du contre-amiral Troude, alors qu'elle se repose dans la salle du conseil, il ordonne, sans la prévenir, une décharge de tous les canons. Si elle parait inerte et si elle est encore plus incapable de se rendre aimable, ce n'est pas tant, celle fois, à sa timidité et à son caractère qu'il faut s'en prendre qu'à l'imprudence de ce voyage, où elle a voulu suivre son mari alors qu'elle est à peine remise de ses couches et qu'elle a des précautions à garder. La fatigue qu'elle éprouve et qu'atteste son amaigrissement est extrême, car, quelque précaution que l'on prenne et quelque attente que l'Empereur supporte à des jours, il faut partir plusieurs fois à quatre heures du matin ; le premier jour, sauf le temps du déjeuner, on marche dix-neuf heures, de quatre heures du matin à onze heures du soir ; deux fois, les étapes sont de douze heures. Ce n'est rien, certes, près du voyage de 1808 : point de fête le soir, lorsqu'on a couru toute la journée ; point de réception, ni d'audience ; mais encore faut-il accompagner l'Empereur dans ses promenades et ses inspections ; encore a-t-on les bals commandés, et l'empressement des foules, et l'enthousiasme des Normands qui défie la chaleur et l'exaltation des méridionaux. L'Empereur, habitué qu'il est à l'endurance de Joséphine, ignorant des ménagements qu'exige une femme aussi jeune, et. tout nouvellement accouchée, n'y porte pas son attention, tout occupé qu'il est d'ailleurs par la grandeur de son projet et la hardiesse de son plan aux trois quarts réalisé : à Cherbourg, il aura-creusé pour ses Hottes le port de refuge qui fit défaut à Villeneuve, son lac Mœris, comme il dit. Ici sera la tête d'attaque qui lui a manqué en 1805 ; il concentrera ici, dans celle position que Vauban appelait audacieuse, toutes ses forces maritimes, et, dans la presqu'île, il aura sous la main tout son corps d'expédition. D'ici, les deux nations se prendront corps à corps et termineront leur querelle par une bataille d'Actium. Cherbourg est donc un de ses quartiers généraux ; aussi, comme il a eu Pont de Brique près de Boulogne, il veut une habitation près de Cherbourg : il entre en marché pour le château de Querqueville, à M. de la Grimonière, où il trouve des écuries pour trente-deux chevaux. A son départ, l'a flaire est presque conclue, et il tiendra si fort à son idée que, en août 1813, lorsque Marie-Louise reviendra à Cherbourg, il lui donnera mission expresse de visiter les lieux pour lui en rendre compte. Le 4 juin, à une heure, l'Impératrice est de retour à Saint-Cloud, mais ce n'est point pour y vivre en tranquillité, car voici qu'arrivent, de tous les points du Grand empire, appelés pour le baptême du roi de Rome, quantité de rois et de princes, les députations d'Italie, Sénat, clergé, Donnes villes, les députations de France, un monde entier. Le 8, il y a les spectacles gratis, auxquels il faut assister ; l'on vient donc coucher aux Tuileries ; et, le 9, du matin jusqu'au soir, on est en grand gala : avant la messe, audience diplomatique, présentations, serments ; après la messe, audience aux députations ; à cinq heures et demie, départ pour Notre-Dame, où l'on arrive à sept heures. Toutes les cérémonies du baptême ne prennent qu'une heure ; et, à huit heures, on repart pour l'Hôtel de Ville, où l'on doit dîner. Un accident de voiture — les traits rompus par les chevaux entiers du grand carrosse — retarde d'une demi-heure. Enfin, on arrive, et l'Empereur, qui n'a pas eu un moment d'impatience, rayonne vraiment d'orgueil satisfait. Mais peu de gens le voient, car, sur l'expérience du bal Schwarzenberg, les constructions en bois ont été singulièrement réduites, par suite le nombre des invités. Au banquet impérial, le service est fait exclusivement par la Maison, de même qu'à Notre-Dame, la cérémonie a été faite par la Chapelle. Où qu'aille l'Empereur, et quoi qu'il fasse, la Cour seule parait. Après le banquet, concert et cantates, puis cercle dans la salle du Trône et visite au jardin suspendu, au fond duquel apparaît la statue du Tibre. A onze heures et demie, Leurs Majestés reparlent pour les Tuileries. A minuit et demi elles sont à Saint-Cloud. On prend presque une semaine de repos ; mais, le 16, après la messe, on revient à Paris ; à midi, l'Impératrice se rend en grand cortège au Corps législatif, où l'Empereur ouvre la session ; et, après, il y a banquet impérial dans la Salle des Maréchaux, où assistent, sur des gradins, les gens de la Cour, les membres des grands corps et les députés des Donnes villes ; ensuite, sur la terrasse, concert, que Leurs Majestés entendent de leur tribune, spectacle au théâtre de la Cour, cercle et jeu dans les Grands appartements, où toutes les dames présentées défilent en trois révérences. — Tout cela, malgré la chaleur étouffante, en deux heures et demie ; car, on commence à huit heures ; à dix heures et demie Leurs Majestés se retirent, et à onze heures, elles partent pour Saint-Cloud. Cette fête, on ne s'en douterait pas, est pour célébrer la naissance du roi de Rome : l'Empereur a songé, un instant, à y inviter des gens de la Ville, à leur rendre ainsi la fête qu'il en a acceptée et, comme en 1806, à en parquer deux mille en deux bals distincts, l'un dans la Salle des Maréchaux, l'autre dans la Salle de spectacle. Le projet a été dressé : pour chaque bal, il y aurait eu un souper, dans la Galerie de Diane et dans la Galerie du Musée ; le nombre des musiciens de l'orchestre était arrêté et les consignes étaient rédigées ; mais n'est-ce pas bien peuple et a-t-on si grand besoin de donner à danser aux Parisiens — surtout de livrer les Tuileries à leur invasion bourgeoise ? N'est-ce pas assez qu'on leur fasse signe pour la campagne et une fête champêtre ne sera-t-elle pas bien plus de saison, une fête dans le genre de celle donnée l'année passée par le prince Schwarzenberg ? On a donc, le 23, à Saint-Cloud, non pas une, mais trois fêtes, dont aucune pour les bourgeois de Paris : d'abord, fête pour l'armée : dans le bois de Boulogne, la Garde impériale, avec la 24e légère et la Garde de Paris, banquette à quarante sols par homme ; ensuite, fête pour le peuple : dans le grand parc de Saint-Cloud, les Parisiens — 800.000 dit-on — trouvent des buffets où sont acquittés les billets gagnants des loteries de comestibles tirées la veille dans les douze arrondissements, et, près des buffets, jaillissent des fontaines de vin ; grandes eaux, théâtres,- escamoteurs, chansonniers, saltimbanques, mais de cocagne, jeux divers et bals champêtres, toutes les joies ; à huit heures, sur la Seine, combat naval et pyrotechnique par six chaloupes canonnières ; a neuf heures, dans la plaine de Boulogne, feu d'artifice tiré par l'artillerie de la Garde, avec le palais du roi de Rome pour pièce principale et,-pour apothéose, un ballon lumineux, d'où Mme Blanchard lance dans les cieux d'ingénieux artifices. Enfin, fête pour la Cour, et les personnes présentées, les députés du Corps législatif, les députés des Bonnes villes et les Pères du Concile dans les Grands appartements. Selon les termes de l'invitation, il y a, d'abord, cercle à la Cour ; puis, le feu d'artifice, qui est pour les petites gens comme pour les seigneurs ; et enfin, fête dans les jardins. Le parc réservé est éclairé comme en plein jour ; quantité d'ingénieuses allégories y sont ménagées : boîtes d'optique montrant des vues de Vienne et des environs, danses de paysans autrichiens autour du buste de Marie-Louise, tous les spectacles de ce genre. Pour achever l'œuvre, les acteurs de Feydeau doivent, sur un théâtre forain, représenter un divertissement d'Etienne, la Fête du Village, sur qui Nicolo a mis de la musique et Gardel des danses. A peine la pièce commencée, un orage, qui a menacé tout le jour, éclate en déluge. Les spectateurs en plein air — en pleine eau — voudraient s'évader, mais l'Empereur tient bon sous son dais, les oblige à rester, préparant ainsi, comme il dit au maire de Lyon, de belles commandes pour les manufactures de l'Empire. Néanmoins, le spectacle est abrégé ; aussitôt après, Leurs Majestés se retirent, laissant les invités affamés, souper sous les tentes, où sont dressées les .tables lacustres. Heureusement, a-t-on permis aux dames de venir en robes rondes. Pour un temps — plus de quinze jours, l'on retombe dans une tranquillité relative : des chasses, des spectacles, beaucoup de conseils ; le soir, quand les entrées sont médiocres, loto ; le dimanche seulement, à Paris,, audience solennelle pour des remises de lettres de créance, audience diplomatique, grande parade, distribution d'aigles à dix régiments nouvellement formés, retour à Saint-Cloud pour dîner, vers les neuf heures ; mais en voilà assez de Saint-Cloud : le 10 juillet on vient pour treize jours à Trianon : tout petit comité, vingt et une personnes, dont Borghèse, le souffre-douleurs en titre. Il y a là la princesse de Neuchâtel, née princesse de Bavière, et le grand écuyer, avec lesquels l'Impératrice parle allemand, et cette vie presque à l'allemande, avec le dîner servi tour à tour dans les fabriques du Hameau, les promenades en calèche dans les jardins où jouent les grandes eaux, les courses à cheval dans les bois, les parties de billard avec la dame d'Atours, qui y est très forte ; le soir, les promenades en gondole sur les canaux, et, pour finir la soirée, le jeu de loto, c'est assez pour plaire à l'Impératrice, et l'on n'a pas besoin du spectacle, qu'on remet à cause de la chaleur. Le 23, l'on revient à Saint-Cloud, après avoir passé à Saint-Cyr, où les élèves ont joué devant l'Impératrice un petit opéra-comique : Fritz et Pauline ; l'on reprend les réceptions du dimanche ; parfois, on va dîner à Bagatelle ; des soirs, vers les dix heures, on pousse la promenade en calèche jusqu'à l'entrée de Paris. Une seule grande course, car la chaleur est accablante : le u août, on visite les Maisons-Napoléon de Saint-Denis et d'Ecouen. A Saint-Denis, l'Empereur passe à l'église pour voir les chapelles expiatoires, mais il en est si peu content qu'il ordonne de tout détruire et tout refaire. A Ecouen, devant ces petites filles, Marie-Louise se montre si timide que Mme Campan, attendu l'usage qu'elle a des cours, l'encourage et lui parle simplement comme si elle avait eu l'honneur de l'avoir vue. Les orphelines offrent un grand habit lamé qu'elles ont brodé pour l'Impératrice ; elle ne trouve pas un mot pour remercier. Mme Campan lui dit qu'elle a du lait, des fruits et du pain bis préparés, sachant qu'elle les aimait : Une autre fois, répond-elle, je viendrai goûter ici ; aujourd'hui, j'ai la migraine. Joséphine eût péri plutôt que de l'avouer. On est las de Saint-Cloud. On vient prendre, une semaine, l'air de Rambouillet. L'on y arrive le 6 août, après dîner, toujours avec Borghèse, et avec une suite bien plus nombreuse : quatorze dames et dix-huit hommes, pas une minute à soi : le matin, promenade à cheval, déjeuner dans les fabriques du parc, parties de pèche, chasses à courre, dîner où chaque soir quelques personnes sont admises à la table de l'Empereur ; après dîner, caries, loto, billard et musique italienne. Il pleut presque continuellement, mais on ne va pas moins : le 8 où le rendez-vous est à cinq lieues et où la bête qu'on attaque a déjà trois fois échappé aux veneurs, on suit jusqu'à six heures passées, sous une pluie torrentielle, et on revient en tel état que la plupart des femmes se couchent en arrivant. Cette vie semble plaire à l'Impératrice ; elle paraît s'amuser beaucoup ; mais, le 13, il faut retournera Saint-Cloud, d'où l'on viendra, le 14, coucher à Paris pour la Saint-Napoléon. Et, le 15, c'est de neuf heures du malin à onze heures du soir, où l'on retourne coucher à Saint-Cloud, le défilé des compliments et des félicitations ; toutefois, l'Empereur a trouvé l'occasion bonne pour ajouter un article aux anciennes étiquettes : nul n'entre plus de droit dans la Salle du Trône ; les grands dignitaires et les grands officiers, réunis dans les Grands appartements, y attendent que le grand maître des Cérémonies ait pris les ordres de Sa Majesté pour les introduire. Dans la soirée, pas de dîner de famille, aucun prince n'étant à Paris ; alors, l'Empereur s'échappe seul avec l'Impératrice, visite le Musée, court les illuminations. Ils vont bras à bras sur le boulevard et se donnent le plaisir, moyennant leur petite rétribution, de contempler dans les lanternes magiques Leurs Majestés l'Empereur et l'Impératrice des Français, toute leur Cour, etc., etc. Le souvenir de cette petite escapade l'amusait encore six années plus tard. On va encore une semaine à Saint-Cloud, du 16 au 24 ; chasses, dîners à Bagatelle, grande séance de la Société maternelle, où l'Impératrice, assistée de toutes les dignitaires, prend possession de la présidence ; le 24, après les félicitations pour la Saint-Louis, on part pour cinq jours à Trianon, où la fête de l'Impératrice doit être célébrée en grand appareil, et où l'Empereur a voulu, par des merveilles de son goût, effacer toutes les réjouissances champêtres qu'on a données jusque-là. ***Le lieu est bien choisi : Marie-Louise a pris Trianon en passion — le Grand et le Petit — non par souvenir de sa tante, comme on pourrait penser, mais qu'elle s'y croit presque en Autriche : C'est un très petit château de chasse, écrit-elle à son père, mais qui ressemble un peu au Laxenbourg, et vous pouvez facilement vous imaginer, mon cher papa, que tout ce qui me le rappelle me réjouit infiniment. Le 25 tombe un dimanche, et il y a la messe d'abord, mais uniquement pour le voyage et la liste n'est que de douze personnes. Dans la journée, on se promène en calèche dans le parc de Versailles, où jouent les grandes eaux ; on dîne dans la grande salle à manger, et, à huit heures et demie, heure militaire, par une chaleur étouffante et sous une pluie qui a duré presque toute la journée, arrivent les invités — toute la Cour et toutes les personnes présentées — les hommes en habit de soie à la mode, les dames eu robe ronde. A mesure qu'ils entrent par la cour du Grand Trianon, on les place dans les salons et dans la galerie du Grand appartement, où la chaleur est telle que des dames s'évanouissent. A neuf heures et demie seulement, l'Empereur et l'Impératrice sortent du Salon de famille et parcourent le cercle en distribuant les phrases d'usage : l'Impératrice n'en a qu'une, sur la température, mais elle est de circonstance. Après le cercle, on se met en marche vers les jardins : l'Empereur et l'Impératrice prennent la tête, puis les dames, toutes les dames, elles hommes ensuite. On part du Cabinet de l'Empereur par le chemin qui mène au pont de Réunion, mais, à cause de la pluie, l'illumination n'est pas terminée, et l'on se contente, d'abord, d'admirer la perspective des parterres, éclairés par des guirlandes et des lustres de verres de couleur, avec, au fond, le Pavillon français et le Petit Trianon, dont des lignes de feu dessinent les architectures. Sous une vaste tente de coutil, décorée de feuillages, sur un chemin garni de tapis, on va d'abord à la Salle de spectacle pour entendre les Projets de Mariage et un à-propos d'Alissan de Chazet, la Grande Famille, rare niaiserie où s'évertuent sérieusement les acteurs des Français, des Bouffons et de Feydeau, et qu'égaie un divertissement par les premiers sujets de l'Opéra. A la sortie du Théâtre, on reprend l'itinéraire : on suit les parterres, on jette un coup d'œil sur les avenues de tilleuls que décorent des verres de couleur, que bornent des ifs enflammés et où des lampions, disposés derrière les arbres, soutiennent la lumière et font une clarté générale ; on s'arrête un instant au Pavillon français pour une cantate qu'accompagne un nombreux orchestre ; on laisse à gauche le Petit Trianon, où un autre orchestre est placé sur le perron, du côté du Carrousel, tout illuminé, où courent la bague des enfants vêtus eu Chinois. A droite de la pelouse, on prend un chemin qu'éclairent des lampions cachés au bord de la rivière et dans les bosquets et de grands feux de fagots allumés dans les fossés du côté de la route extérieure. Au Temple de l'Amour, illuminé en verres de couleur, danses d'enfants autour de la statue de Vénus, aux sons d'une musique et d'un chœur cachés dans le feuillage. Puis, par la futaie, éclairée en reflets, où de hautes bornes avec des transparents au chiffre de l'Impératrice marquent la route, où un orchestre d'harmonie scande le pas, on arrive au Hameau, où est le plus rare de la fête. Toutes les maisons en sont illuminées : verres de couleur, lampions, transparents. Des villageois d'Opéra acclament l'Impératrice, d'autres dansent ou chantent devant elle ; d'autres font courir sur le lac des barquettes à lanternes de couleur. Voici une noce de campagne qui défile en dansant et qui offre des fleurs ; des acrobates traversent le lac sur la corde raide près de la Grande Chaumière, où Ton sert des rafraîchissements. L'horizon s'embrase de fagots allumés partout sur les hauteurs et, du balcon, Marie-Louise assiste à cette apothéose. Après, par le circuit du lac, en s'arrêtant devant la Tour de Marlborough, où paradent des grottesci, on se rend au Salon de musique — concert — et, enfin, l'on rentre au Grand Trianon, où le souper est servi, dans la Galerie, par petites tables. Après le souper, les invités ont permission de se retirer. Sans doute a-t-on déployé plus d'imagination à Neuilly et à l'hôtel Montesson ; mais Despréaux n'a point eu ses coudées franches : l'Empereur a revu chaque détail, l'a corrigé, approuvé ; il a voulu fêler sa femme à sa façon, et les courtisans s'empressent de dire qu'il Ta fêtée mieux qu'elle ne fut jamais par une véritable féerie. Quatre jours plus tard, de Trianon, départ en droiture
pour Compiègne, où il y a grand voyage, dix-huit hommes et trente-sept dames,
tous ou presque de la Maison, personne de la Famille. Du service seul du
grand maréchal, cent soixante-dix-sept gagistes ont été requis. Les jardins
ont été entièrement renouvelés par Berthaut ; dans les appartements, on a
placé quantité d'objets d'art rappelant le mariage ou le symbolisant. En ce
cadre, beaucoup de chasses à courre que Marie-Louise suit à cheval, un peu
moins de spectacles que d'ordinaire, et une étiquette de plus en plus sévère,
une société de plus en plus restreinte. A présent,
les grands officiers et les dames invités au jeu entrent seuls dans le second
salon où se tient l'Impératrice, de sorte qu'on ne voit point Leurs Majestés
le soir parce qu'elles n'entrent jamais dans le premier salon ; l'on s'y
assoit et l'on y joue et cause jusqu'à dix heures. Voilà la faveur du Voyage,
et c'est la Cour elle-même qu'on traite ainsi. Par contre, toutes les personnes nommées à des emplois civils et
militaires pour lesquels elles doivent prêter serment aux mains de
l'Empereur, arrivant à la Cour par congé ou remplacement, ou en partant pour
leur destination, doivent se faire présenter à l'Impératrice aux
cercles du dimanche. Les princes et princesses, quoique absents, ont aussi
leur règlement ; le fauteuil, réservé à l'Empereur et à l'Impératrice, est
concédé seulement à Madame, eu égard à son âge.
Dans les Appartements d'honneur et de représentation, il n'y aura plus que
des pliants ; les princesses perdent donc même la distinction de la chaise ; on n'en donnera qu'aux princesses de la Famille qui seront
enceintes. Plus d'escorte pour les princes et princesses, qui, même
couronnés et régnant, n'ont plus le droit d'aller dans l'Empire qu'à six
chevaux. Plus de sièges pour les princes, même pour les rois, toutes les fois
que l'Empereur et l'Impératrice seront placés sur le trône et sous le dais.
Chacun restera debout et à son rang. Ainsi, Napoléon arrivé au sommet n'y
admet plus même sa famille : c'est assez de lui et de sa femme ; mais, à
elle, il fait part de toutes ses prérogatives, et hors lui et elle, il n'y a
que néant. Marie-Louise n'en est pas mieux portante ni plus gaie. Ses cheveux
sont presque tombés : Je crois, écrit-elle, que cela tient au peu de ménagements dans mes couches.
Elle a de fréquents accès de lièvre, des mouvements de bile, des
étouffements, des froids nerveux aux extrémités, mais, comme elle ne veut pas
quitter son mari, elle n'avoue pas qu'elle souffre, n'en suit pas moins les
chasses à cheval et n'en va pas moins à la comédie. Dans l'isolement où elle
vil, sa pensée se reporte à la famille de là-bas, qu'elle comble de ses
attentions. A sa dame d'Atours, restée à Paris, elle écrit chaque jour des
commissions, et c'est toujours des envois à faire à Vienne : tout de suite,
il faut une robe de tulle blanc, garnie d'acacia, pour l'archiduchesse
Léopoldine ; le lendemain, pour la même, une robe de tulle rose avec une
guirlande de roses et de sureau ; il faut des graines pour son oncle ; il
faut des livres pour son père ; il faut, pour son autre, sœur, un bracelet de
ses cheveux, avec des pierres formant le nom de Louise
et, pour cadenas, le portrait du roi de Rome, avec de petites ailes, qu'on
commandera tout de suite à M. Isabey ; il faut une robe de tulle rose avec
une guirlande de roses roses courant autour de la robe ; les robes peuvent ne
pas convenir, il faut des pièces de tulle rose et blanc lamé ; et les
chapeaux, comment n'y a-t-on pas pensé ? Heureusement, Mme Despaux vient à
Compiègne : voilà cinq chapeaux pour les archiduchesses. Le prince
Schwarzenberg part pour Vienne : il emportera une pleine voiture de modes et,
par-dessus, des plantes et des arbustes nouveaux. C'est la joie, unique,
semble-t-il, comme si, par tous ces colifichets, elle se rapprochait de
là-bas, les y suivait de sa pensée et, de ses mains, en parait celles qui lui
sont chères. On est à Compiègne tout près d'un mois : cela est dans les
traditions royales, et il faut s'y conformer : mais l'Empereur ne tient plus
en place ; il prétend inspecter les côtes, prendre possession de la Hollande,
revenir par le grand-duché de Bcrg qu'il ne connaît pas. Pour se donner de
l'avance et ne pas exposer sa femme aux mauvaises fièvres, il part seul dans
la nuit du 18 au 19 septembre, à trois heures du matin. Mon époux, écrit Marie-Louise, part ce soir pour aller à l'île de Walcheren, le climat le
plus insalubre qu'on puisse imaginer, et comme c'est le premier voyage qu'il
fasse où je ne puis l'accompagner, cela me, fait beaucoup de peine. Sans
doute doit-elle, avant onze jours, le retrouver à Anvers, mais elle n'en
pleure pas moins, et toute la nuit, Mme de Luçay, appelée de Paris, reste
près de son lit pour la consoler. Cela suffit pour montrer le compte qu'il
faut tenir des bruits qui courent : qu'il y a de la
brouille dans le ménage, que l'Impératrice est très jalouse, et même qu'elle
a des torts non excusables vis-à-vis de l'Empereur, qui, devant ce manque d'égards,
est furieux, que Mme de Montebello est la maîtresse déclarée de l'Empereur...
Et c'est pourtant Catherine qui, sur des lettres de Fesch et de Madame, enregistre
ces nouvelles. De fait, Marie-Louise aime son mari plus qu'elle ne l'a aimé
jamais et, si la duchesse a pris quelques jours de congé, c'est pour se
préparer au voyage. Après deux journées tranquilles et qui, dans l'agitation subie, paraissent assez douces, le 22, à deux heures du matin, l'Impératrice part pour Bruxelles, avec un service complet, ordinaire et extraordinaire, plus le grand chambellan charge des détails du voyage, un préfet du Palais, deux maréchaux des logis, quatre pages et le duc de Trévise, colonel général, qui commandera la Garde et les escortes. Non sans encombre, — car, à la sortie de Compiègne, le vélocifère des Marions et des Lisettes s'est cassé ; à mi-route, on a laissé le fourgon d'argenterie, et l'on ne saurait compter les réparations qu'a exigées le fourgon des Atours, — on arrive à Lacken le 23, à deux heures du malin, ayant déjeuné à Péronne et dîné à Mons. Dès le lendemain, l'Impératrice, après avoir entendu la messe, reçoit les autorités de Bruxelles dans la belle rotonde et, le soir, les dames lui sont présentées. Les Bruxellois affectent l'enthousiasme : c'est, pour eux, manière d'opposition que de fêler ici, où elle se trouve seule, la petite-fille de Marie-Thérèse, Marie-Louise d'Autriche. Nulle des dames de la Croix étoilée et de la cour de la Gouvernante ne manque à l'audience, pas même celles qui, de crainte d'accident, n'ont bougé depuis dix ans de leur château ou de leur hôtel — si bien que pour apparier deux chevaux dont elle soit sûre, Mme de Mérode, pour venir à Lacken, fait teindre en noir un cheval bai. A celles-là, qui s'attendent à tous les égards, la princesse paraît timide et embarrassée, manquant d'aplomb et d'usage du monde ; mais, deux fois, devant le public du spectacle, l'Impératrice réussit à miracle avec ses trois révérences et le bouquet de tulipes qu'elle tient à la main. Des pétales en tombent sur le parterre, et l'on s'y bat pour les avoir. Aux cercles, la partie de loto, à laquelle on invite les dames présentées, fait événement, les Flamandes tenant le loto pour un jeu national. Au Vauxhall, où la ville donne une fête, spectacle et grand bal, on est tout heureux d'entrer seulement dans la salle où se trouve l'Impératrice et les mots qu'elle dit, quelle qu'en soit la banalité, semblent neufs et frappés au bon coin — le coin de la maison d'Autriche, celui de l'archiduchesse Marie-Christine. On se dit qu'elle a acheté des dentelles pour un gros chiffre, 144.030 francs, et comme les ouvriers chôment, c'est d'un bon effet. De ces dentelles, dont elle distribue un cinquième environ (45.518 francs) aux dames de sa Maison, le plus beau (une robe de point à l'aiguille, de 5.000 francs, et des aunages pour 3.890 francs) est pour Mme de Montebello. — Nouvelle preuve qu'elle ne croit pas un mol des histoires du grand aumônier. Le 30, après un séjour troublé par un ouragan et une pluie affreuse, qui n'ont permis que deux promenades, l'Impératrice part de Lacken, et, après quatre heures, elle arrive à Anvers, où elle occupe l'hôtel du maire. M. Cornelissen. L'Empereur y est depuis une heure du malin : Vous pouvez vous figurer aisément, écrit Marie-Louise, le plaisir que j'ai éprouvé. Aussi le quille-t-elle le moins qu'elle peut dans les visites à l'infini qu'il fait des chantiers, des digues, des ports, des bassins, des vingt et un vaisseaux en construction. La princesse Pauline est venue de Spa à Anvers pour offrir ses hommages, mais on ne lui fait pas grand accueil, car elle traîne à sa suite Montrond, que l'Empereur a exilé. Du reste, point de fête, une seule présentation : Mme d'Argenson, la femme du préfet. Le 4 octobre, à deux heures du malin, l'Empereur part en tournée sur les côtes ; l'Impératrice ne quitte Anvers qu'à dix heures, elle couche à Broda et arrive pour dîner à Gorcum, où Napoléon l'attend depuis deux heures. Le lendemain, les chevaux sont commandés pour huit heures, mais l'Impératrice n'est prêle qu'à dix heures, et l'on arrive à Utrecht à trois heures au lieu de midi. On loge au Palais impérial, — ci-devant royal, — celui que Louis fit installer pour ses deux mois de séjour. Trois jours de revues, de réceptions et d'audiences ; le 8, bal offert par la ville : Leurs Majestés, fatiguées, n'y vont pas. La Cour y va. A Utrecht, Marie-Louise a acheté quantité de joujoux, et c'est le souvenir qu'elle en garde. Le 9, à dix heures du malin, départ pour Amsterdam, où l'on doit faire l'entrée solennelle. Dans une maison hors des portes, l'on arrête les voilures de voyage et l'on prend les carrosses de gala. Ils ne serviront que pour l'Impératrice et la suite ; l'Empereur moule à cheval, et son cortège est tout militaire, comme à l'entrée dans une ville conquise : quatre régiments de Cuirassiers, toute la cavalerie de la Garde : Grenadiers, Chasseurs, Dragons, Chevau-légers hollandais et polonais, les fantassins, tout un corps d'armée, bordant la haie. Malgré les orchestres, les arcs de triomphe et les acclamations qui retentissent officiellement dans le Moniteur, le service militaire est monté au Palais comme devant l'ennemi, et la garde d'honneur, si péniblement formée à Amsterdam, n'est acceptée que pour la forme. Dans ce palais qui est l'hôtel de ville et que Louis transforma en résidence royale, on s'installe dans les meubles du frère découronné, mais certains objets déplaisent qui jadis furent les présents de l'Empereur lui-même. Sur le piano, dans le salon de l'Impératrice, il y a, se faisant pendants, les bustes de Napoléon et d'Alexandre, exécutés à Sèvres en 1808, au beau temps de l'alliance. Napoléon fait enlever le buste d'Alexandre. Chaque jour, comme en une Bonne ville, française de
vieille date, ce sont les divertissements d'étiquette, où le loyalisme des
peuples est invité à s'affirmer officiellement : réceptions, audiences,
messes et présentations, spectacles par les Comédiens français, qu'on a fait
venir à ce dessein, visites du port, des chantiers, des magasins et de
l'enceinte. Point de cercle où l'on invite les Hollandais, on n'y admet que
les personnes du voyage. Coupant le séjour par une excursion au Helder, où il
va inspecter la Hotte, l'Empereur s'absente du 15 au 18, et Marie-Louise
emploie ces trois jours en promenades autour de la ville, mais on y voit tant d'eau que l'on s'en dégoûte bientôt.
Ce qui lui plaît le mieux, c'est de courir les magasins. J'ai fait, écrit-elle, de
grandes emplettes de toile plus belle que la batiste pour faire des chemises
de nuit, et beaucoup d'autres marchandises dont le nom et le pays sont un
secret. Je vous rapporte des théières de Boucaron (pour Boukharah) et
du vieux laque de la Chine, dont j'ai fait moi-même l'emplette dans le plus
beau magasin d'Amsterdam. Quelle joie d'acheter soi-même ! C'est la
première fois depuis qu'elle est venue en France, et, au mépris du blocus
continental, elle n'hésite pas à faire la contrebande ; les voitures de ses
dames en sont toutes chargées, et les douaniers auraient beau jeu. Au retour de l'Empereur, on tire enfin le feu d'artifice de la ville, dérangé ci-devant par une tempête ; l'on a une fête avec grand étalage de fleurs et des quadrilles comme à la Cour ; on va même, le 23, au Théâtre hollandais, où Mme Wattier, la grande artiste nationale, régale Leurs Majestés d'une Phèdre néerlandaise. Cela lui vaut 2.000 francs de pension. Sa troupe reçoit 4.000 francs de gratification ; les quatre Français qui sont venus de Paris (Talma, Duchesnois, Bourgoin et Damas) en ont eu 12.000. Le 24, on part ; Leyde, la Haye, Delft, Rotterdam, Gouda, le Loo, servent de stations à l'Impératrice, tandis qu'à toute allure, l'Empereur, avec son service léger, court le pays. Marie-Louise n'a qu'une idée, c'est de sortir du mauvais climat de la Hollande. Quantité de gens de la domesticité ont eu des accès de lièvre, si bien qu'il a été fourni à tous du vin de quinquina. Sans Bourdier, que lui a envoyé l'Impératrice, Gourgaud, un des officiers d'ordonnance, serait mort. L'Empereur lui-même n'est pas fâché de s'en aller : malgré l'argent prodigué, les travaux ordonnés et même les sourires, l'enthousiasme est médiocre. Sauf Broek qui lui a plu, quoiqu'il se soit brûlé les doigts dans la cuisine du maire en levant le couvercle d'un pot qui était sur le feu, il n'a rien trouvé de son goût, pas même Saardam, où il a loué bien plutôt l'industrie et la propreté des habitants que la cabine habitée jadis par Pierre le Grand. Le 30, on est à Nimègue, et, après une couchée forcée au château d'Ottenberg, près de Rheinsberg, qui est à M. de Rhory, où il n'y a pas moyen de trouver de lits et de quoi manger, l'Impératrice arrive à Düsseldorf, où elle loge hors de la ville, au château de la Vénerie. Réceptions, présentations, le duc de Nassau-Weilbourg admis à faire sa cour, promenades au Grafenberg, au château de Benrath, fêtes où Beugnot et Rœderer se prodiguent et qu'ils proclament les plus jolies de tout le voyage, sans excepter Amsterdam ; mais l'Impératrice est fatiguée au delà de toute expression, à moitié morte de fatigue, et des chemins épouvantables qu'elle a trouvés depuis le Loo, et de la nuit affreuse qu'elle a passée à Ollenberg. Au jeu, elle ne répond à l'Empereur que par monosyllabes, et aux autres que par un geste de tôle assez monotone. Et elle n'est pas au bout. Le 4 novembre, sur des dépêches venues de Paris, l'Empereur décide le retour immédiat. A peine laisse-t-il l'Impératrice douze heures à Cologne pour vénérer les grandes reliques et voir le trésor ; en trois journées il faut avaler la route : encore, n'est-ce qu'à cause de Marie-Louise qu'on arrête pour déjeuner et coucher. De Cologne on va à Liège, de Liège à Givet : on doit en partir à sept heures du malin, mais la Meuse, débordée, a emporté le pont de bateaux ; ce n'est qu'à midi qu'on passe sur un pont volatil construit par les prisonniers anglais du dépôt ; il faut coucher à Mézières ; on en part le 10 à six heures du matin, on déjeune à Rethel, on traverse Reims sans arrêter, et, à dix heures et demie du soir, on est à Compiègne ; le lendemain, à sept heures du soir, on arrive à Saint-Cloud, où, au bas du grand escalier, attendent les princes, les dignitaires, les grands officiers, les ministres et la Maison ; à l'entrée du grand vestibule, le roi de Rome, dans les bras de sa gouvernante. Vous avez eu raison, écrit Marie-Louise, de croire que j'aurai bien de la joie à retrouver mon fils après un voyage de deux mois. L'émotion que j'éprouvais peut être sentie, mais pas exprimée. ***Deux mois, en effet, — du 19 septembre au 11 novembre, — où, presque sans arrêter, on a couru les chemins, mais ce n'est pas pour mener une vie tranquille et calme qu'on est rentré à Saint-Cloud. L'étiquette qui, sauf à Amsterdam, pendant les trois, jours où l'Empereur s'est absenté, n'a cessé de s'imposer à tous les actes et à tous les pas de Marie-Louise, s'établit plus stricte encore et reçoit chaque jour des prescriptions nouvelles : ainsi, le soir de l'arrivée, les princesses de la Famille, convoquées expressément par lettres du grand maréchal pour attendre Leurs Majestés au perron, n'ont été reçues qu'après le dîner, où elles n'ont pas été appelées à s'asseoir. Ainsi, l'ordre pour les cercles du dimanche est changé ; on n'y invite plus que trente dames et cinquante hommes, tout compris, et, vu Saint-Cloud, les dames sont en robe ronde et les hommes ne doivent pas porter le cordon sur l'habit. Ainsi, les entrées particulières sont restreintes à moins de cinquante personnes qui, le soir, sont admises dans le Salon de famille, sauf les derniers jours, où, l'Empereur ayant été indisposé, l'Impératrice reçoit dans le salon de son appartement. Il gèle à pierre fendre, le théâtre n'est pas chauffé ; il y a .spectacle pourtant : le Méchant ou le Cid, ce qui n'élève pas la température. Diverses fois, l'Empereur chasse à tir à Saint-Germain, à Marly et dans le Grand parc de Versailles ; toussante et glacée, l'Impératrice suit ; n'est-ce pas assez qu'elle soit séparée de lui par les conseils si multipliés et ce qu'il appelle les affaires ? À Paris, ce sera pis encore, et l'air lui en est mauvais, aussi prolonge-t-elle le plus qu'elle peut. Pour l'anniversaire du Couronnement, il faut bien à la fin rentrer aux Tuileries : on a cercle diplomatique, messe solennelle, grande audience par l'Empereur, audience des dames par l'Impératrice ; le soir, dîner de famille, spectacle où l'on donne Mérope, opera-seria, et grand cercle avec la cérémonie des révérences à l'Impératrice, tenant son jeu et ayant sa Maison entière derrière elle. Toutefois, comme on a trouvé peu congruant qu'on s'en allât après les révérences, personne ne doit plus sortir avant que Leurs Majestés se soient retirées, et les chambellans rangent les dames dans les divers salons, à mesure qu'elles ont traversé le Salon de l'Empereur. Aux Tuileries, il n'y a plus à badiner avec l'étiquette : l'Empereur a trouvé qu'à Saint-Cloud elle s'était relâchée, — et pourtant ! Aussi règle-t-il à la minute, avec une régularité d'horloge, dans une pompe continuelle, et, il faut l'avouer, une insupportable précision, l'existence extérieure de l'Impératrice. Le dimanche, messe où les dames présentées sont invitées à assister avec l'autorisation de faire ensuite leur cour, grande audience, serments, présentations, grandes parades — celles-ci devenues rares — pour terminer, dîner de famille ; tous les quinze jours, grand cercle et spectacle au Théâtre du Palais. Les jours ordinaires, après le dîner, les entrées particulières, — cinquante personnes environ, — reçues dans le Salon de l'Impératrice. Trois fois par semaine, puis deux, les dimanche, mardi et jeudi d'abord, ensuite les lundi et jeudi, cercle et spectacle dans l'appartement de l'Impératrice. Pour ces cercles, deux listes, une dite ordinaire, qui, en dehors des princesses, comprend les six grands officiers, deux colonels généraux, six aides de camp, un préfet du Palais, huit chambellans, quatre écuyers et onze dames, les trois en titre d'office, les quatre du service ordinaire et les quatre de l'extraordinaire. Avec le chevalier d'honneur et le premier écuyer, c'est quarante-six noms tout compris — à peu près les entrées particulières. Ceux-là sont invités pour tous les cercles. La liste extraordinaire, soumise chaque fois à l'appréciation de l'Empereur, va de trente à quarante hommes, de vingt à trente dames. Les hommes sont pris parmi les grands dignitaires, les ministres, les sénateurs, les conseillers d'Etat, les chambellans et les écuyers, mais il arrive que l'Empereur y ajoute quelques généraux, parfois un colonel ou un capitaine de vaisseau, avec qui il désire causer ou auquel il fait une faveur d'exception. Les femmes sont ou de la Cour ou du Gouvernement ; toutefois, on voit paraître la duchesse de Courlande, la comtesse Tyszkiewicz, sœur de Poniatowski, Mme de Crillon, qui est née Mortemart, la maréchale de Mailly, née Narbonne-Pelet, qui, à partir du 1er janvier, a été appelée à jouir du rang et des prérogatives des femmes des grands officiers de l'Empire. Chaque personne reçoit un billet ainsi conçu :
Le P.-S. est nouveau et fait supposer à tort que des invités se dispensent de paraître ; mais l'Empereur n'admet pas d'excuse et ne tolère pas les défections. On arrive un peu avant huit heures et demie. On entre dans le salon qui précède celui de l'Impératrice. Les femmes y sont assises ; les hommes debout. Les lumières, les tuyaux de chaleur, la quantité de monde contribuent tellement à échauffer la pièce que l'on court risque de s'y trouver mal. Vers neuf heures, on fait entrer les dames seulement chez l'Impératrice. Peu d'instants après, la porte de son salon s'ouvre. Un huissier crie : l'Empereur ! Devant lui marchent le grand chambellan, le grand écuyer et le grand maréchal. L'Impératrice suit l'Empereur, et après elle viennent la dame d'honneur, les dames du Palais et les dames invitées. Toutes les dames passées, les hommes se mettent à suivre. On s'arrête dans une galerie au bout de laquelle s'élève un petit théâtre. Là, tout le monde a la permission de s'asseoir. Les hommes en profitent lorsqu'ils peuvent y parvenir, les sièges et les banquettes n'étant pas proportionnés au nombre des invités. L'Empereur, assis dans son fauteuil, occupe le milieu du carré ; l'Impératrice à sa gauche, également assise sur un fauteuil. A droite et à gauche, les princesses assises sur des chaises et selon leur rang. On joue quelque petite comédie ou un opéra-comique à peu de personnages. Le spectacle terminé, on retourne dans le même ordre. Dans le premier salon, on a mis une table ronde pour le loto dauphin et une table de jeu : dans le Salon de l'Impératrice, trois tables de jeu, une pour elle, les deux autres pour les princesses. Les personnes qui doivent jouer ont été prévenues par les chambellans. Autour de la table ronde se placent les dames qui jouent pour la forme, car il n'y a point de mise. Pendant ce temps, les hommes se tiennent debout, les uns serrés contre les autres. Ils sont passés en revue par l'Empereur. Il marche en se dandinant et en agitant sa tabatière entre ses doigts. Il dit à l'un son nom, à l'autre quelques paroles et à plusieurs rien. Il lie une conversation quand il en trouve la possibilité. Il l'interrompt par des bâillements. A dix heures et demie, il rentre dans ses appartements. C'est le signal de la retraite. Hommes et femmes se pressent pour avoir leur voilure. On dirait une troupe d'écoliers qui vient d'obtenir un congé. On va peu au spectacle au dehors, bien moins que l'année précédente, deux fois seulement durant le mois de décembre : une fois aux Français, où l'on donne Œdipe pour la rentrée de Talma ; une fois à l'Opéra, où c'est la première représentation de : Les Amazones ou la Fondation de Thèbes. Même a-t-on une surprise : au moment où l'action est si embrouillée qu'un dieu seul peut en dénouer le fil, un coup de tonnerre annonce le dieu attendu : Jupiter va paraître. La Gloire parait en effet, mais le trône est vide. Où est Jupiter ? Cygne amoureux, taureau superbe ou pluie féconde, le dieu trompe-t-il les sens d'une faible mortelle ? Sans attendre l'arrêt du destin, Mme Branchu entonne l'hymne de la reconnaissance, et le dénouement n'en paraît pas plus obscur. Dans la journée, l'Impératrice est livrée à elle-même : une fois la semaine, mais sans jour réglé, il y a chasse à courre, soit au bois de Boulogne, soit à Saint-Germain. On fait bruit de quelque visite qu'elle rend à des manufactures ; mais cela est d'exception. Le plus souvent, quand il fait beau, elle va, le malin, à Mousseaux, pour monter à cheval. Pour ses promenades à pied, elle n'a toujours que la terrasse du Bord de l'Eau, qu'on lui réserve de dix heures à quatre heures, mais, si elle en profite, c'est escortée de son service complet, de l'officier de piquet et de deux pages. Un jour pourtant, afin de se conformer à l'usage, on part dès le matin pour Grosbois. On arrive à une heure et demie, on chasse jusqu'à trois, et à cinq heures et demie, spectacle ; des farceurs, comme d'ordinaire : cette fois, les Deux Edmond et la Danse interrompue, par les acteurs du Vaudeville ; après, dîner où, à la table de Leurs Majestés, des dames sont admises tant qu'il en peut tenir, — car, outre le service, il y a une soixantaine d'invités, tant hommes que dames, — bal où l'Impératrice daigne danser. Vers dix heures, on reprend les voitures pour rentrer à Paris. ***Au 1er janvier de 1812, même cérémonial presque qu'en 1811. La veille, l'Empereur et l'Impératrice ont fait leurs cadeaux d'habitude, mais lorsqu'on a montré à l'Empereur les porcelaines de Sèvres, il les a trouvées fort laides et il a donné ses ordres pour qu'on exécutât au moins deux déjeuners, l'un décoré des portraits de l'Impératrice et des princesses, l'autre des portraits des dames du Palais. Pour les compliments de bonne année, on a encore raffiné sur l'étiquette, formé des catégories nouvelles, indiqué pour chaque corps une salle ou une galerie particulière, établi des distinctions à l'infini, compliqué, comme en un quadrille, les allées et venues de l'Impératrice chez l'Empereur, des princesses chez l'Impératrice, le départ pour la messe et le retour, les places à prendre dans le cortège, les pas à donner et à recevoir. On réserve la Galerie de Diane pour le Sénat, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le corps de ville de Paris ; on parque les officiers de la Garde dans la salle des Maréchaux ; on attribue aux généraux de division et au clergé le Salon de la Paix ; on permet aux grands officiers la Salle du Trône ; enfin, on ouvre aux officiers et aux dames de l'Impératrice le Cabinet de l'Empereur. Chacun va et vient, en grand costume complet, selon un ordre inflexible que maintiennent les portiers d'appartement, les huissiers, un peuple de chambellans, de maîtres et d'aides des Cérémonies. Jamais on n'a poussé si loin la méticuleuse organisation des cortèges et l'exigence d'assiduité : car, toutes les dames pour accompagner les princesses, toutes les duchesses, toutes les dames présentées doivent se faire voir. Et ce n'est pas tout : le 5 janvier, la cérémonie recommence pour la Cour des Comptes, le Conseil de l'Université, la Cour Impériale et l'Institut, et l'on fait revenir le clergé, les généraux et les officiers que l'Impératrice n'a pas vus le jour de l'An. Pour cette occasion, la Cour ne met pas le grand costume, et c'est encore une distinction qu'on établit. Malgré ces fêtes, dédiées, il est vrai, à si peu d'élus, l'hiver s'annonce triste. On ne voit aucun de ces événements qui occupent toute une société. Il y a les dîners d'obligation, dîners de représentation où l'ennui est le premier invité. Une sorte de mélancolie pèse sur Paris, sur la France, sur l'Europe : l'attente d'événements formidables et prochains, la certitude d'une guerre nouvelle, le désappointement de l'espérance de la paix encore une fois déçue ; la crainte d'une famine qui suscitera les émeutes, exigera les répressions sanglantes. Si ce temps continue, écrit Marie-Louise, nous aurons de nouveau une année stérile. Et chez elle, mal remise de ses couches, surmenée par celle vie où elle s'épuise moralement et physiquement à suivre son mari, la santé atteinte agit sur le moral, le moral à son tour agit sur le physique. Comment voulez-vous, mon cher papa, écrit-elle, que le corps se porte bien alors que l'âme est malade, et peut-il en être autrement avec toutes les affaires qui se passent depuis deux mois ? J'avoue franchement que je ne me porte pas bien du tout... On m'enlève la plume de la main de crainte que je ne me fatigue... Pour secouer ces idées noires qui ne sont pas propres uniquement à Marie-Louise, distraire les esprits et contenter le commerce, l'Empereur décrète qu'on va s'amuser ; chaque semaine, bal chez les princesses : au carnaval, bal chez le ministre des Relations extérieures, chez le ministre secrétaire d'Etat, chez le maréchal Ney, chez le maréchal Mortier, chez le maréchal Davout, chez l'archichancelier, chez le prince de Neuchâtel, et pas d'excuse admise, ni d'absence du mari, ni d'indisposition, ni même de deuil. On dansera, c'est l'ordre. Les ministres étrangers, s'ils veulent plaire, recevront aussi, lis lancent donc leurs invitations ; le prince Kourakin d'abord, et pour le 21 janvier ; mais la Cour est si bien royalisée, que les lettres d'excuse arrivent par liasses et que l'ambassadeur de Russie doit changer son jour et perdre le bénéfice de son zèle. L'Empereur, par de frappants exemples, entend donner le ton, et il multiplie, par politique, les grandes fêtes inusitées. D'abord, le 6 février, grand bal paré dans la Salle de spectacle des Tuileries, disposée, comme le jour du mariage, avec la décoration mobile qui s'adapte sur la scène. L'Empereur, les princes et les princesses s'y tiendront sur une estrade : au parterre, quatre rangées de banquettes serviront aux danseuses, qui seront en nombre, car, outre la Cour entière et les personnes présentées, il y a d'invitées, avec leurs filles, les douze dames qui ont reçu l'Impératrice à la Ville, puis un certain nombre de demoiselles, filles et sœurs de personnes présentées, et, comme danseurs, on aura des auditeurs, des aides de camp et des officiers de la Garde ; mais ils seront en habit habillé ; on n'est admis en uniforme qu'à partir du grade de colonel. Ces listes à établir prennent beaucoup de temps ; l'Empereur les revoit plusieurs, fois, et, n'ayant pu se mettre d'accord sur les noms avec le grand chambellan, il finit par décider que toutes les demoiselles dont les mères ou les tantes sont invitées peuvent venir. Il serait inconvenant, remarque-t-il, d'inviter les demoiselles dont les mères ne seraient pas priées. Quant aux jeunes gens, tous auditeurs et aides de camp, et fils, neveux ou frères de personnes présentées, peuvent également venir. Le tout fait quinze cents invitations. De plus, huit à neuf cents personnes, dont plus de la moitié de femmes choisies dans les premières classes de la Ville, sont admises au bal sans cependant en faire partie ; c'est-à-dire qu'entrant par le vestibule du Conseil d'État et sans avoir aucune communication avec le bal, elles seront placées dans les trois rangées de loges. On leur portera quelques rafraîchissements pendant le bal, et, comme elles n'en auront pas moins fait toilette, le commerce en tirera bénéfice sans que l'étiquette ait souffert. A dix heures, tous les invités sont arrivés ; à dix heures et demie, les princes, les princesses, les dames du Palais.et les ministres vont, dans les Grands appartements, attendre Leurs Majestés, à qui, sur les onze heures, ils font cortège. A l'entrée de l'Empereur, qui est en uniforme, mais avec le cordon par-dessus l'habit, les orchestres, placés en amphithéâtre dans les deux loges d'avant-scène, commencent à jouer et le bal s'ouvre par une contredanse où l'Impératrice est menée par le prince de Neuchâtel, la reine Hortense par Duroc, la princesse d'Eckmühl par le prince Aldobrandini et la comtesse de Croix par le comte Nansouly. Après diverses contredanses par les personnes de la Cour, un morceau symphonique annonce le quadrille ou plutôt le ballet, pour qui la Cour presque entière travaille depuis un mois sur le petit théâtre des Appartements. Le livret en est de M. Emmanuel Dupaty, qui a pris soin de le rédiger en vers, et il faut en suivre avec soin les péripéties pour prendre intérêt aux entrées qui se produisent. Le poète s'est endormi au bord de la fontaine Egérie, il voit ..... Du ciel qui s'entr'ouvre Vers le sol paternel redescendre les dieux Que les anciens Romains ont placés dans les cieux. Ces constellations, Rambuteau et Montguyon, chambellans ; Lenneps, Saluces et Lamberty, écuyers ; d'Hautpoul, Mortemart et Chabrillan, officiers d'ordonnance ; des officiers de la princesse Pauline, Clermont-Tonnerre et Montbreton ; un maître des cérémonies, M. du Hamel, et un auditeur, M. Palaviccini, ne sont pas d'égale grandeur et ne portent pas avec la même grâce le maillot de rigueur. Certains sont effroyables, pourtant riches, car l'Empereur donne à chacun six mille francs de gratification. Mais j'aperçois Iris..... Elle parcourt ces lieux d'une course légère, Et, pour en écarter les profanes mortels, Autour du bois sacré suspend son arc-en-ciel. Iris, c'est Mlle Schérer, la fille du général, tout nouvellement mariée au général comte Legrand, de trente ans son aîné ; mais sa jeunesse ne l'embarrasse point. Elle a dix-sept ans, les plus beaux cheveux du monde, fort jolie d'ensemble, sans aucun trait à remarquer. — Tondez-moi ça, disait Augereau, et vous verrez ce qui en restera. En attendant, par sa gaieté, sa naïveté et ses airs d'enfant, elle plaît à tous les jeunes gens, qui en ont la tête tournée. Elle figure seule, avec grâce et aplomb, et, son pas dansé, S'échappant aussitôt de leurs grottes humides, Les Nymphes vont cueillir les odorantes fleurs... Le Zéphir les poursuit, presse leurs pas timides, Les atteint, les enlace en leurs propres festons, Forme autour de leurs bras une amoureuse chaîne... Pour les Nymphes, on a choisi la comtesse Duchâtel, la nouvelle duchesse de Castiglione, la duchesse Dalberg, Mmes de Colbert, Brignole, de Laître et de Montmorency, — et pour Zéphir, M. de Galz-Malvirade, l'ancien premier page, lieutenant à Austerlitz, capitaine à Wagram, officier d'ordonnance deux ans plus tard. Il passé pour joli homme, mais est-ce assez pour Zéphir ? Les Nymphes, avec leurs robes de laine blanche brodées en or en plein et plus richement à la bordure faite d'une guirlande de feuilles de chêne vert et or sur deux rangs de franges d'or, sont plus agréables, quoique, certaines, un peu mûres. Leur robe, à chacune, coûte 800 francs, mais au compte des princesses. En voici justement une qui parait : Dans ces lieux consacrés au silence, au mystère, Rome porte ses pas ! C'est la princesse Pauline : sur la tête elle porte un casque d'or bruni, que couronnent quelques légères têtes de plumes d'autruche blanches ; sa tunique, de mousseline de l'Inde à. lames d'or, est brodée à la poitrine d'une petite égide à écailles d'or, que charge au centre le plus beau des camées Borghèse ; camées sur les bracelets d'or qui, très haut, cerclent l'avant-bras ; camées à chaque croisement des bandelettes de pourpre lamées d'or qui attachent les brodequins ; et elle est toute suave, toute sylphide, ses mouvements sont doux et moelleux ; tout en elle est exquis, jusqu'à sa nonchalance, et la demi-pique d'or qu'elle tient en main semble volée au carquois de l'Amour. A sa voix, l'onde écume, et, des flots entr'ouverts, Sort bientôt Egérie..... la comtesse Just de Noailles, qui y est fort bien. Elle présente à Rome Le miroir prophétique où se peint l'avenir. Joie de Rome, qui se rassure sur son avenir. D'ailleurs, L'air est frappé par des sons belliqueux, les Génies apparaissent, Promettant à la fois l'abondance et la gloire... Génie de la Victoire, le comte de Montmorency ; du Commerce, le baron de Prié ; de l'Agriculture, M. de Taintignies ; des Arts, le comte de Montaigu ; Ils annoncent la France !... Et c'est elle, sous les traits de la reine de Naples, en robe longue, manteau de pourpre brodé d'or, casque d'or violemment empanaché de tricolore. La tête, charmante, fraîche, bien gracieusement jolie, pose sur un corps à taille courte et qui commence à s'épaissir. Puis, pour la pantomime noble, il faut une pratique que n'a pas Caroline, et, dans le pas de deux que Despréaux a composé pour les princesses, Pauline seule est à ravir. Cependant la France, que les Nymphes ont parée de leurs guirlandes, commande aux Génies De franchir de l'Éther les plaines infinies. Sa touchante prière a monté jusqu'aux dieux : De la Terre on entend le doux concert des Cieux. Apollon a paru !... Pour le suivre, les Heures Quittent d'un pas égal leurs semblables demeures... Apollon, c'est Charles de la Grange, un des freluquets de Berthier : en tenue, il est admirable, belle tournure, air martial, belle figure quoiqu'il louche, mais, en maillot chair, la lyre en main, les lauriers en tête, avec son œil de travers, il est unique. Pour les Heures, comme il en faut vingt-quatre, il en est de belles, de jolies, de médiocres et de pires. Les Heures du jour sont les mieux partagées avec Mmes de Bouillé, de Bassano, de Braancam, Andréossy, Curial, Mouton, Regnaud, Daru, de Chabrillan, Walther, Lambert et de Montaigu ; mais, dans celles du soir, Mmes de Crillon, d'Aunay, de Beauharnais, Lepic, de Broc, de Croüy, de Ligneris, Foy, A. de Montesquiou, de Chastenet, de Laubépin, de la Vieuville, — toutes drapées en crêpe noir semé d'étoiles d'argent, il en est, comme Mme de Croüy, qui ne furent jamais jolies et qui sont à présent fort bourgeonnées. Elle fait Minuit, c'est Minuit passé, dit-on. Ces Heures, blanches et noires, dansent autour d'Apollon, qui chante sur sa lyre. ... tant de gloire et tant de nobles veilles, Que tout mortel eût dit qu'il chantait les merveilles De vingt siècles de guerre..... Séduites par ces récits, les Heures ralentissent d'abord leurs pas, puis peu à peu s'arrêtent, Arrêtez-vous surtout pour prolonger sa vie ! Zéphir, qui s'empresse, offre des fleurs à Rome, mais elle les dédaigne. Elle a bien mieux : ... Déjà revenus du céleste séjour, Les messagers divins offrent à leur retour Le manteau triomphal et l'armure sacrée Dont Rome, par la France, est aussitôt parée. Elle reçoit encor l'image d'un enfant... Et c'est à genoux, au milieu d'un ballabile général où les Heures, les Nymphes, les Génies et les Etoiles font de leur mieux. Cinquante-trois personnages, costumés la plupart aux frais des princesses, — Caroline en paie pour 19.891 francs, Pauline pour 16.000, — mais l'Empereur est si content qu'il octroie aux danseurs 108.000 francs de gratifications. Dans le public, on s'étonne des dames dansant seules comme à l'Opéra, on trouve le quadrille de mauvais goût, on critique les costumes, on s'amuse des contrastes, mais il n'y a de mécontents que ceux qui n'ont pas figuré. Le bal, d'ailleurs, n'a pas que ce divertissement : il a l'habit tout doré de Cambacérès, il a la tournure de la comtesse Tyszkiewicz, avec son cordon noir pardessus une robe très brillante, et sa figure de l'autre monde ; il a la danse visible d'une grande perche de cinq pieds huit pouces, faisant à l'anglaise le pot à deux anses. Puis, il y a eu pêle-mêle pour les places dans la salle de bal, sauf toutefois pour la première banquette du côté de l'Impératrice, réservée aux dames qui ont accompagné Sa Majesté, et pour la première banquette du côté de l'Empereur, réservée à l'ambassadrice d'Autriche et à quelques dames étrangères de distinction ; et comme il n'y a eu de réglé que le nombre des contredanses et leur ordre, les places des hommes et des dames, et qu'on a pu prendre des rafraîchissements dans le grand foyer, on s'est amusé quelque peu, mais, aux Cérémonies, on se plaint que la liberté dégénère en licence et que l'étiquette se relâche. A une heure et demie, Leurs Majestés se rendent au souper qui est servi par petites tables dans la Galerie de Diane, les premières pièces de l'Appartement d'honneur et au pavillon de Flore. L'Impératrice a sa table de dix couverts dans la Galerie et elle y invite, outre les quatre dames de service, l'ambassadrice d'Autriche, la duchesse de Courlande, la princesse d'Essling, la princesse d'Eckmühl, la duchesse de Bassano et la duchesse de Massa. Après souper, Leurs Majestés se retirent et chacun a pu s'en aller. Quant aux gens de la Ville qu'on n'a pas fait manger, ils sont partis à une heure et demie par leurs petites portes, et ont cherché leurs voitures hors des cours des Tuileries. ***Ce n'est pas assez d'un bai paré, il en faut un masqué, ce qui sera d'un bien meilleur rapport pour le commerce. Donc, c'est pour le mardi gras où, dans la journée, les Bouchers ont amené le Bœuf gras dans la cour du Palais, — ce qui leur a valu 600 francs de l'Empereur, 4.000 de l'Impératrice et 600 du roi de Rome ; — à neuf heures et demie, dans la même salle, avec le même appareil et le même personnel que le 6, grande fête. Cette fois plus d'estrade ni de fauteuils pour Leurs Majestés. Les hommes doivent venir masqués, en domino de couleur, le noir excepté, et les dames, masquées aussi, en habit de caractère. En passant par le vestibule du Conseil d'Etat, chaque invité se fait reconnaître par deux chambellans qu'assistent un fourrier du Palais, des huissiers et des valets de chambre. Sur les dix heures et demie, la mascarade de l'Impératrice fait son entrée. Marie-Louise, qui s'est souvenue du bal de Rouen, est costumée en Cauchoise ; grand bonnet en velours raz rouge garni d'organdi et d'argent ; corset de velours bleu à boutonnade d'or, avec le fichu et les manches de mousseline et de malines ; jupe en velours raz rouge, tablier en mousseline lamée d'or, garni de malines. Au cou, un collier en gros jaseron avec plaque fermant croix et poire, aux bras des bracelets en or émaillé, aux oreilles des pendants à poire, aux souliers des boucles en pierres. Prix du costume, chez Leroy, 1.764 francs, plus la parure cauchoise, chez Nitot, 731 francs. Caroline est en costume dalmate de 1.800 francs : robe de mousseline rayée d'or, pantalon de satin blanc rayé en vert, écharpe de satin lilas, les cheveux tressés de ruban rouge et argent sous un voile de mousseline lamée en or ; la duchesse a un costume de Corfou — tel que l'Impératrice tout à l'heure quand elle aura quitté celui de Cauchoise ; mais le costume de l'Impératrice coûte 2.800 francs, celui de la duchesse 1.500. — C'est, sur une robe de dessous en satin blanc, une robe de mousseline brodée, à colonne, d'or fin, à riche bordure en lames de couleur ; chemise à manches longues sortant d'une tunique de satin vert à chef d'or, sur une autre tunique de satin blanc ; ceinture en gaze d'or traversée d'une écharpe de satin violet brodé d'or ; toque de satin violet et or sous un voile de mousseline brodé d'or. Pour l'Impératrice, le violet est remplacé parle ponceau. Mme de Montebello a encore un costume de femme de Rome qui ne va qu'à 650 francs. C'est le prix moyen : de 782 à 400 francs : costume corse pour Mme de Mortemart, polonais pour la duchesse de Castiglione, breton pour Mme de Luçay, tyrolien pour la duchesse de Rassano, landais pour la duchesse de Rovigo et la princesse d'Eckmühl, basque pour Mme Duchâtel, bordelais pour Mme de Mercy, maçonnais pour Mme de Talhouët, strasbourgeois pour Mme Philippe de Ségur, hollandais pour Mme Brignole, vosgien pour Mme Daru, milanais pour Mme de Lauriston, piémontais pour Mme de Bouillé, béarnais pour Mme de Mesgrigny, lorrain pour Mme de Beauharnais, flamand pour Mme de Beauvau, génois pour Mme de Marinier, napolitain pour la princesse Aldobrandini, provençal pour Mme de Lobau, savoyard pour Mme de Montaigu, dantzikois pour Mme de Croix, hambourgeois pour Mme de Montmorency, neuchâtelois pour la duchesse Dalberg, peu importe, c'est toujours la même couleur locale de couturier, à juger par la comtesse Walther habillée, dit-on, à la mode des environs de Paris : robe de gros de Naples rouge, tablier de taffetas glacé et fichu de mousseline. Garneray qui, pour 408 francs, a dessiné dix-sept de ces costumes, a subi les avis de Leroy à qui l'on paye 2o.487 francs, compris les petits bijoux accessoires. Là devant disparaît la mascarade italienne de la princesse Pauline où les frais sont médiocres, mais le grand succès est pour le quadrille de la reine Hortense. Hortense a mis à profit l'expérience du bal précédent, elle s'est interdit presque les allusions et, pour la danse, point de solo. La scène est censée se passer au Pérou, dans une île sauvage au moment de la conquête, en 1525. D'abord, entrent en dansant des Péruviens et des
Péruviennes. Les Péruviens — MM. de Montesquiou, de Bongars, Germain,
Perregaux, de Flahaut, de Canouville, de Bellissen, de Marmier, de Villeneuve
et de Sainte-Aulaire — ont une tunique de gaze blanche rayée d'or, garnie de
plumes blanches, rouges ou bleues, une ceinture en paillon, un soleil d'or
sur la poitrine, sur la tête un diadème en paillon et plumes ; maillot et
tricot blanc, bottines rouges ou bleues : coût 300 francs. Les Péruviennes — Mesdames
de Montesquiou, Mollien, de Grammont, Lefort, de Fezensac, de Graville, de
Villeneuve, de Maillé, de Rochefort, de Menou — sont habillées de même, avec
des jupes un peu allongées. Le divertissement achevé, parait Alonze, officier castillan, séparé de l'armée de Pizarre,
qui cherche son fils égaré comme lui dans l'île. Il se trouve au milieu de
ces sauvages. La vue d'un ennemi les irrite. Ils l'entourent, le désarment,
annoncent le projet de le faire périr et sortent pour aller prendre leurs
arcs et leurs flèches. Ils laissent Alonze (le comte d'Arjuzon) sous la garde de
leurs femmes, après l'avoir enchaîné. Ils menacent leurs femmes de toute leur
colère si le prisonnier s'échappe. Alonze conjure les femmes de lui rendre la
liberté, mais elles n'osent céder à ses prières et dansent autour de lui. Le
fils d'Alonze (c'est un page) arrive. Terreur et douleur du jeune Castillan en voyant
son père chargé de liens. Il se précipite dans ses bras, il essaie
d'attendrir les Péruviennes. Dans ce moment reparaissent les Péruviens armés.
Leurs femmes essaient de les fléchir, maison vain : déjà les arcs sont
tendus. On entend une musique annonçant l'arrivée de la reine de l'île,
grande prêtresse du Soleil. Elle entre suivie de jeunes Péruviennes qui
forment sa cour et de prêtresses portant l'image du Soleil. Les
Péruviennes de la cour — Mmes de Broc, de Bellissen, d'Ambrugeac et
Gantheaume, Mlles Cochelet et de Bourgoing — ont le même costume que celles
de la ville. Quant aux prêtresses du Soleil — Mmes Dulauloy, de Bellune, de
Laborde, Rampon, Harel, Wattier, Molé, Octave de Ségur, de Bréan et
Montalivet —, elles portent, sur une robe de satin blanc, une robe de
mousseline garnie de frange effilée d'or, avec une ceinture croisée en chef
et un soleil d'or sur la poitrine ; sur la robe, étole de satin broché d'or,
avec soleil et frange d'or ; pour coiffure, un diadème de paillon et de
pointes dorées d'où tombe un grand voile de mousseline. Prix de chaque
costume : 450 francs. La reine — car, bien sûr, la reine de l'île c'est la
reine Hortense — a un costume plus riche, mais de même goût et ne passant pas
un millier de francs, qui la laisse singulièrement leste et fait valoir son
élégante tournure et son joli pied. La Reine donc fait son entrée. Le
jeune Alonze tombe à ses pieds pour obtenir la vie de son père. La Reine
l'accorde à condition que le père et le fils rendront hommage à l'objet de
son culte. Alonze et son fils se prosternent devant l'image du Soleil, sous
laquelle on lit : Le Soleil, roi des Cieux, de splendeur couronne, Gouverne en l'éclairant l'Univers étonné. De son vaste regard embrasse toute chose, Ne s'égare jamais, jamais ne se repose. Il est l'image et le rival des Dieux. Ici nous l'adorons, il doit l'être en tous lieux. Pas de la Reine avec sa suite. — Danse générale. Faut-il aux vers voir une allusion ? En tout cas, elle est relativement discrète et ne messied pas dans la salle où dansait le Roi-Soleil. L'Empereur, en domino, est entré, sans qu'on l'ait aperçu, durant qu'on exécutait le quadrille. On danse donc avec une certaine liberté, car tout le monde est masqué, jusqu'à une heure du malin, où le souper est servi en buffet et par petites tables, dans les salles du Conseil d'Etat. Vers deux heures, l'Impératrice se relire avec les dames de sa mascarade et va souper dans la salle à manger de son Appartement d'honneur. Quatorze hommes sont invités, mais, tandis que les dames gardent les costumes qu'elles avaient au bal et se démasquent seulement, eux ont du se mettre en habit habillé. L'Empereur ne s'est montré officiellement nulle part et, comme il a dit que le bal se prolongerait aussi longtemps qu'il y aurait du monde, c'est seulement vers trois heures que l'on se relire. Il régnait moins d'ordre à ce bal qu'au bal paré, remarquent les Cérémonies ; cela tient peut-être à ce qu'on s'est presque amusé — au moins la Cour. Quant aux gens de la Ville — plus d'un millier — qu'on a parqués dans les loges, on leur a seulement passé quelques glaces ; au départ, il pleut à verse ; il faut chercher les voitures hors des cours, tout le monde est trempé et les toilettes sont perdues. Autant de gagné pour le commerce, mais les bourgeoises grognent. Voici pourtant près de deux mois aux Tuileries sans qu'on en ait bougé, et l'Empereur, qui s'y est toujours déplu, a hâte d'en sortir. Le 10 février, la veille du bal, il a échangé à Joséphine l'Elysée Napoléon contre le château de Laeken. Tout de suite il a donné ordre qu'on mit le palais en état et le 14, lorsque les ouvriers y sont à peine, il arrive à l'heure du déjeuner et prétend s'installer. Loger l'Empereur, l'Impératrice, l'indispensable de la Cour, cela se peut encore, mais où placer le roi de Rome et son service ? On se décide à lui donner un appartement de quatre pièces au second étage, sur le jardin, mais encore faut-il que la maison, qui n'a pas été habitée depuis deux ans et où l'Empereur a pris tout de suite un gros rhume, soit un peu échauffée. Le roi de Rome ne quittera donc les Tuileries que le 22. A l'Elysée, où l'Empereur occupe le rez-de-chaussée et l'Impératrice le premier étage, fort étroit pour son service, la vie, sauf l'agrément du jardin, est telle qu'aux Tuileries. Le soir, les entrées particulières, puis, aux mêmes jours, le dîner de famille, les conseils et les petits spectacles. Pour ceux-ci, on a arrangé la Galerie ; on y dresse le théâtre et la Comédie y donne le Sourd, le Distrait, le Conteur, la Fausse Agnès, le Joueur, etc. Les dimanches, on retourne aux Tuileries pour la messe, la grande audience, les présentations et les serments. Une fois, dans tout le mois de mars, il y a, au Théâtre, représentation d'Andromaque et grand cercle. Une autre fois, au Carrousel, pour les régiments de la Vistule, grande parade à laquelle l'Impératrice assiste du balcon, mais, sauf à ces rares exceptions, on ne rentre pas dans Paris, on se tient uniquement à l'Elysée d'où l'on peut, pour la chasse, gagner sans façon le bois de Boulogne. C'est à l'Elysée qu'on célèbre la Semaine sainte, pendant laquelle les spectacles sont suspendus. On les remplace le 26 par un concert spirituel où les musiciens de la Chapelle sont accompagnés d'un orgue de nouvelle invention. C'est le moment le plus actif de la préparation de la guerre contre la Russie. De tous les points de l'Europe les troupes sont en marche ; et, dans son cerveau, Napoléon suit — mieux il accomplit — chaque étape ; chaque pas y retentit de cette promenade sans pareille que font cinq cent mille hommes de Cadix et de Reggio à Varsovie. Aux cercles et aux spectacles, il paraît absorbé, parle à très peu de monde. D'ailleurs, il semble indisposé et presque chaque fois il se retire après le spectacle en chantonnant, comme cela l'arrivé quelquefois, écrit à son mari une femme de général, lorsque tu veux en imposer aux autres sur ce qui t'occupe. A peine, dans le mois, trouve-t-on une journée pour Trianon. La guerre est si bien décidée que Marie-Louise, quelque prudence qu'elle porte à ses lettres, en écrit à son père ; même elle s'en réjouit. L'Empereur, dit-elle, me charge de vous dire beaucoup de belles choses et de vous assurer que si jamais, un jour, il y aura la guerre, il me prendra avec lui à Dresde où je resterais un mois ou deux, et où il espère aussi vous voir. Vous ne pouvez pas vous représenter, mon très cher papa, la joie que cette espérance me donne. Je suis persuadée que vous ne repousserez pas ma demande et que vous me donnerez aussi le plaisir d'amener avec vous la maman et mes frères et sœurs pour que j'aie aussi la consolation de les voir. Je vous prie, mon très cher papa, de ne rien dire de ce projet, parce que rien n'est encore décidé. Tout l'est si bien que, le 30 au soir, en vue de trouver des facilités plus grandes pour s'entraîner et se préparer physiquement, l'Empereur part pour Saint-Cloud avec l'Impératrice, bien qu'il doive laisser à l'Elysée le roi de Rome assez sérieusement indisposé. A Saint-Cloud où, dès le 1er avril, la reine de Naples vient s'établir au pavillon d'Italie, la vie extérieure est des plus calmes : vu le départ de la majeure partie de la Garde, le service militaire est fort réduit ; le nombre des entrées particulières a été restreint et, le soir, l'Impératrice reçoit dans le Salon de famille où il y a un peu de musique ; plus de grands spectacles ; seulement, le lundi et le jeudi, le petit théâtre dressé dans la Galerie et des invitations au plus à soixante-dix personnes. Le dimanche, avant la messe, audience diplomatique, mais plus de cercle le soir. Après le travail, quelquefois malgré le travail, dès que le temps s'éclaircit, c'est, de l'Empereur, des courses folles à crever ces chevaux de Perse, d'Espagne, de l'Amérique du Sud, qu'il choisit pourtant pour leur endurance, c'est des chasses menées à la diable où il bat des lieues sans se douter presque qu'il y a une bêle à prendre. Quelquefois, à l'aube, il éveille l'Impératrice pour faire une promenade, soit dans le bois de Saint-Cloud, soit à Paris où il visite les travaux en cours. Un écuyer de service et l'aide de camp forment seuls la cavalcade avec deux ou trois piqueurs. Jamais l'Impératrice n'est accompagnée par aucune de ses dames qui viennent seulement au-devant d'elle au retour ou l'attendent dans son appartement. Si elle est fatiguée, Marie-Louise monte dans une voiture qui suit, mais cela arrive rarement. Officiellement, l'Empereur ne vient qu'une fois à Paris, le 16 avril, où il passe une grande revue des troupes de la Garde revenues d'Espagne. Ce soir-là, par exception, il y a, à Saint-Cloud, spectacle sur le grand théâtre, où l'on donne Lodoïska, opera-seria. C'est une avance aux Polonais. Par contre, on chasse à Rambouillet, à Saint-Germain, au Raincy, nouvellement conquis sur Ouvrard, et jamais aussi vile, jamais d'un tel train, jamais avec une telle volonté de s'éprouver pour les fatigues à venir. ***Et le 9 mai, sans revenir à Paris, sans prévenir la nation par aucune proclamation, sans avertir le Sénat par aucun message, sans exposer par aucun document les griefs que l'Empire a formés contre, la Russie, l'Empereur part de Saint-Cloud, sous prétexte d'aller faire l'inspection de la Grande Armée rassemblée sur la Vistule. En l'an VIII, en l'an XIII, en 1806, en 1808, en 1809, à chaque reprise de cette guerre que mène la France contre la coalition dont l'Angleterre est l'âme, il a jusqu'ici donné ses raisons, publié les pièces diplomatiques, exposé les mobiles qui le conduisent et le forcent d'agir. A présent, rien. Et cette guerre, la plus terrible qu'il ait affrontée, dont il doit, s'il se souvient d'Eylau, connaître les périls, cette guerre où il mène toute l'Europe à sa suite, qu'il sait donc formidable ; qu'il affronte avec une santé alanguie par trois années d'inaction, devenue sensible aux intempéries et rebelle aux fatigues, avec un tempérament éprouvé par les secondes noces ; où il veut à présent, pour la commodité et l'agrément de sa vie, lui qui n'a connu de tente qu'en 1808, les asiatiques splendeurs de son Camp impérial, il y donne comme préliminaires des fêtes de Cour, des banquets et des spectacles et, à Dresde, où il conduit l'Impératrice, il invite les empereurs et les rois à venir d'abord lui renouveler l'hommage de leur vassalité. Jamais départ pour l'armée, a-t-on dit, ne ressembla davantage à un voyage d'agrément. Est-ce pourtant un présage ? Le Moniteur, qui paraît le 9, jour du départ, publie le premier article d'une étude intitulée : RECHERCHES SUR LES LIEUX OÙ PÉRIT VARUS AVEC SES LÉGIONS. |