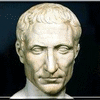JULES CÉSAR EN GAULE
DEUXIÈME ÉPOQUE (SUITE).
CHAPITRE SIXIÈME. — BLOCUS D'ALÉSIA. - CATASTROPHE. - DÉVOUEMENT SUBLIME DE VERCINGÉTORIX. - INDICES D'UNE TRAHISON DE QUELQUES PRINCES GAULOIS EN FAVEUR DES ROMAINS.
|
§ V. — Arrivée tardive de l'armée auxiliaire. - Combat de cavalerie dans la plaine basse située devant l’oppidum. - Attaque nocturne des lignes de blocus dans cette même plaine basse. Interea, Commius et reliqui duces... Sur ces entrefaites, Commius et les autres chefs à qui les Gaulois avaient déféré le commandement, arrivent avec toutes leurs troupes auprès d'Alésia, et prennent position sur une colline extérieure, à tout au plus mille pas (1.481m) des lignes romaines. Le lendemain, ils font sortir du camp leur cavalerie ; ils en couvrent toute cette plaine que nous avons montrée s'étendant sur trois mille pas de longueur ; et ils rangent un peu à l’écart leurs troupes d’infanterie, qu'ils cachent dans des te lieux supérieurs. De l’oppidum d’Alésia la vue dominait la plaine. Dès que les Gaulois bloqués dans l'oppidum aperçoivent ces auxiliaires, ils accourent en foule, ils se félicitent entre eux, la joie les ranime tous. En conséquence, ils font sortir leurs troupes et prennent position devant l’oppidum ; ils recouvrent de fascines ou comblent d'un remblai le fossé le plus rapproché ; ils se tiennent prêts à pousser une attaque et à exécuter tout ce que les circonstances pourraient exiger d'eux. César dispose d'abord toute l'armée sur les retranchements pour faire face à l’ennemi de part et d'autre, afin que, dans le cas où cela deviendrait nécessaire, chacun connût son poste et s'y tînt. Puis, il ordonne de faire sortir la cavalerie et d'engager le combat. De tous les camps placés à l’entour sur les crêtes des collines, la vue dominait, et tous les soldats, l'esprit en suspens, attendaient quelle serait l'issue du combat. Les Gaulois avaient entremêlé parmi leurs cavaliers un certain nombre d'archers et de soldats armés à la légère, qui pussent accourir pour leur prêter secours sur les points où ils se trouveraient forcés de céder, et pour arrêter l'élan de notre cavalerie. Nombre de nos cavaliers, blessés à l'improviste par ces archers, sortaient de la mêlée. Comptant que les leurs remporteraient la victoire, et voyant les nôtres accablés par le nombre, les Gaulois, de toutes parts, et ceux qui étaient bloqués dans l’oppidum, et ceux qui étaient arrivés à leur secours, encourageaient les leurs par des clameurs a et des hurlements. Comme le combat avait lieu sous les regards de tous, et qu'aucun acte de courage ou de lâcheté ne pouvait être caché ni d'un côté ni de l'autre, et l'amour de la louange, et la crainte de l'ignominie excitaient au courage tous les combattants. Déjà l’on se battait depuis midi, et le soleil allait bientôt se coucher, sans que la victoire fût décidée, quand sur un point les Germains, formés en masses compactes, chargèrent les ennemis et les poussèrent devant eux. La cavalerie gauloise ayant pris la fuite, les archers furent entourés et tués. Pareillement de tous les autres côtés, les ennemis abandonnèrent le terrain et les nôtres les poursuivirent jusqu'à leur camp sans leur laisser la faculté de se rallier. Quant a ceux qui étaient sortis d’Alésia, tristes et désespérant presque de la victoire, ils rentrèrent dans l’oppidum. Voici donc enfin l'armée auxiliaire qui arrive, avec Commius à sa tête ; et ce nom placé là dans le récit montre, selon nous, toute la perfection et l'habileté de ce récit, quelque minime que paraisse la remarque. En effet, César vient de nous faire connaître avec quelle ardeur Commius a pris part à la formation de cette armée auxiliaire ; par conséquent, il doit avoir mis encore plus d'empressement à se rendre auprès d'Alésia ; et le lecteur, qui le voit arriver à la tête de cette armée auxiliaire et qui sait de plus qu'un autre chef de cette armée, Vergasillaune, est cousin de Vercingétorix, n'ira pas s'imaginer que les quatre chefs n'aient pas tous montré le même empressement : de sorte que toute idée d'un retard coupable se trouve tacitement repoussée. En eût-il été de même si le lecteur, qui sent bien dans sa conscience que cette armée arrive trop tard, l'eût vue arriver sous la conduite d'Eporedorix et de Virdumare, ces deux anciens affidés de César et traîtres à leur patrie ? Examinons les détails du terrain d'Izernore, en regard de l'arrivée de cette armée auxiliaire et du récit de ce combat de cavalerie, récit dont nous avons souligné divers traits caractéristiques ; et même examinons ce terrain d'une manière assez complète pour n'avoir plus besoin de nous y arrêter de nouveau. La colline extérieure sur laquelle l'armée auxiliaire vient de se placer, — et colle exteriore occupato, — est la seule qui soit restée libre sur le bord de la plaine ; c'est la colline de Mulliat située au nord de la plaine, où elle fait face à l'éperon nord de l'oppidum. Les Romains se font également face réciproquement, de l'est à l'ouest, sur les collines de l’entourage, lesquelles dépassent l'éperon nord de la colline de l'oppidum et se prolongent de part et d'autre le long de la plaine. Ainsi, lorsque les lignes romaines, après avoir longé les flancs de l'oppidum par les versants accidentés des collines de son entourage, arrivent sur la plaine de l'un et de l'autre côté de son éperon nord, ces lignes s'infléchissent en convergeant de part et d'autre, et traversent la région méridionale de la plaine basse pour se réunir devant l'éperon nord de la colline centrale. Dans cette traversée de la plaine ces lignes doivent d'après leur description, occuper une zone d'au moins quatre cents mètres environ de largeur, tout compris, et la contrevallation et l'intervalle nécessaire entre les lignes et la circonvallation ; largeur à mesurer depuis le pied de la colline centrale de l'oppidum. A l'est de la plaine, les collines de l’entourage se prolongent du côté du nord le long de l'Anconnans (rive droite), puis le long de l'Ognin. Toute cette partie des collines orientales présente des versants abrupts. A l'ouest de la plaine, les collines de l'entourage se prolongent du côté du nord le long de l'Ognin (rive gauche) en une grande colline notablement plus élevée que toutes les autres ; c'est le mont de Changeat, dont le pied est baigné, du côté de l’ouest, par l'Ain, et du coté de l’est, par l’Ognin, qui longe la plaine basse de trois mille pas environ de longueur, située devant l'oppidum d'Alésia-Izernore. A mi-côte de ce mont du côté de cette plaine, le terrain se relève sur plusieurs points tout le long du versant en une crête rocheuse très-étroite, parallèle à la ligne de faîte du mont et au cours de l’Ognin. Trois petits cols subdivisent cette longue crête du versant en quatre parties distinctes qui se suivent, et qui sont appelées du nord au sud : la crête de Jon (ou du bois de Jon), la crête de Gimon, la crête de Bozon, et le Turle. La crête de Jon, qui est la première, du côté du nord, et règne à l'occident de la plaine, se prolonge du côté du nord jusqu'au versant de la vallée de l'Ain, où elle est coupée à pic et se termine en précipice. Nous trouverons plus loin dans le récit un passage qui nous a paru désigner ces diverses crêtes étroites. La crête plus large et plus élevée qui forme le sommet du mont de Changeat est située au septentrion du point central de l'oppidum d’Izernore. Il en sera bientôt question, sous la désignation d'une grande colline qui était au septentrion d'Alésia. Aujourd'hui on y voit un signal trigonométrique. Un col très-prononcé, où passe la route et où l’on voit aujourd'hui le village de Matafelon, sépare le mont de Changeât de la colline de Mulliat, c'est-à-dire pour nous dans l'application du texte, sépare la grande colline du septentrion de la colline extérieure occupée par l'armée gauloise auxiliaire, que nous venons de voir arriver du pays des Éduens et prendre position sur cette colline extérieure. A partir du col de Matafelon, la colline de Mulliat se prolonge le long de l’Ognin (rive gauche) jusqu'à l'endroit où cette petite rivière se jette dans l'Ain ; et là, cette colline est terminée en éperon à la jonction même des deux cours d'eau, où l'on voit un village appelé Coyselet. La colline de Mulliat est allongée en forme de fuseau, du sud-sud-ouest au nord-nord-est, du col de Matafelon à Coyselet. On a vu que l'Ognin et l'Ain en baignent le pied de part et d'autre. Au sommet, cette colline est rocheuse, accidentée : au versant du côté de la plaine, elle présente plusieurs petits vallons étroits, résultant de crêtes rocheuses qui se relèvent en divers points : lieux dits les Gambettes. La colline de Mulliat constitue donc une position très-vaste, très-forte, abondamment pourvue d'eau, adjacente à la plaine, et ainsi, parfaitement, située en vue et à portée soit de l'oppidum d'Alésia, soit des lignes de blocus. L'infanterie de l'armée auxiliaire s'y trouve établie dans une position forte qui est naturellement indiquée, et dont on suivrait le périmètre de cette manière : A partir de Matafelon, descendre dans la direction du nord par la petite vallée où passe la route, jusqu'à ce qu'on arrive au bord de l'Ain ; de là, remonter le long de cette rivière jusqu'à Coyselet ; de là, remonter le long de l'Ognin (rive gauche) par le chemin qui conduit au hameau de Mulliat, et de ce hameau, revenir presque tout droit à Matafelon. La cavalerie gauloise dut être placée tout le long des bords de l’Ain, depuis Coyselet jusqu'en aval de Thoirette, sur les deux rives, le gué étant facile. De cette place, la cavalerie gauloise pouvait se rendre par deux voies dans la plaine basse située devant l’oppidum, d’un côté, par le chemin de Coyselet qui vient déboucher à Mulliat, et d'un autre côté, par la route traditionnelle qui monte de Thoirette à Matafelon. On connaît, dans l’intervalle des lignes romaines, ces lieux convenables où durent être établis les vingt-trois camps flanqués de redoutes et en particulier les camps de la cavalerie. Cette cavalerie étant de deux sortes, la cavalerie légionnaire et la cavalerie germaine, César a dû les placer chacune séparément. On a déjà pu, en effet, remarquer dans le récit que ces deux sortes de cavalerie paraissent entrer en action comme si elles partaient de deux points séparés. Enfin, pour compléter la reconnaissance des lieux, admettons que César en personne soit actuellement placé, par exemple, à l'est de la plaine, au contour même de ses lignes, sur le terre-plein de la redoute numéro 23 de notre carte. De ce point, son regard domine dans toutes les directions, il a tout sous les yeux : il peut voir tout ce qui se passe et dans la plaine basse, et sur l'éperon nord de la colline de l'oppidum, et sur le front du camp de l'armée auxiliaire, et dans ses propres lignes, de part et d'autre. Rien ne peut donc échapper à sa vue et il a sous la main sa cavalerie germaine — laquelle à partir du Voërle a pu s'avancer jusque proche de lui, par un petit plateau intermédiaire, et se tenir là, sous le couvert des bois —, pour être lancée au moment opportun. Maintenant qu'on a pu se former une idée claire de la configuration générale et de quelques détails du terrain d'Izernore, faisons l'application précise de toutes les particularités du combat dont il vient d'être question dans le récit des Commentaires. Les Gaulois auxiliaires, ayant
fait sortir du camp leur cavalerie, en couvrent toute la plaine (LXXIX). — C'est-à-dire que la cavalerie
gauloise débouche dans la plaine par Mulliat et par Matafelon, sur l'heure de midi, conformément au texte. — Il
lui a fallu en effet, franchir d'assez longs défilés, pour arriver là à
partir du camp placé sur les bords de l'Ain. — Cette
cavalerie couvre toute cette plaine. — La cavalerie des Gaulois
comptait 8.000 hommes ; or, notre plaine d'environ trois mille pas ( De l'oppidum d'Alésia la vue dominait la plaine (LXXIX). — C'est le fait manifeste sur ce terrain, aussi exactement que de la butte Montmartre la vue domine Paris. De tous les camps placés à l'entour sur les crêtes des collines la vue dominait, et tous les soldats, l'esprit en suspens, attendaient quelle serait l'issue du combat (LXXX). — Sur notre terrain, ce passage du récit de César est saisissant. En effet, l'ensemble des lieux forme un véritable cirque, allongé du nord au sud, immense, et néanmoins où l’on peut tout voir dans la plaine, qui en représente l'arène. Cela résulte de la pente rapide des collines qui représentent des gradins latéraux, et sur lesquelles se trouvaient placés ces soldats romains, du côté de Test et du côté de l'ouest, aux deux extrémités de la partie de leurs lignes qui traversait cette région méridionale de la plaine. Il en était de même devant l'oppidum, où le terrain est encore notablement incliné sur la plaine. Les Gaulois, comptant que les leurs remporteraient la victoire, et voyant les nôtres accablés par le nombre, de toutes parts, et ceux qui étaient bloqués dans l’oppidum, et ceux qui étaient arrivés à leur secours, encourageaient chacun les leurs par des clameurs et des hurlements. César nous montre ici les spectateurs gaulois placés aux deux extrémités du cirque, au sud et au nord de la plaine ; ces spectateurs gaulois, aussi bien que les spectateurs romains des gradins latéraux, voient tout ce qui se passe dans l'arène, et, du milieu de cette arène, on peut parfaitement entendre leurs clameurs d'encouragement. Voici le dernier trait du tableau, l'aspect général du spectacle qu'on a sous les yeux : — Comme le combat avait lieu sous les regards de tous, et qu'aucun acte de bravoure ou de lâcheté ne pouvait être caché ni d'un côté ni de l'autre, et l'amour de la louange et la crainte de l'ignominie excitaient au courage tous les combattants. — On le voit, ce texte comprend tous les spectateurs et tous les combattants : tous sont témoins de tous les actes de tous ; le combat dont il s'agit a donc bien lieu comme dans un cirque, comme dans la plaine basse qui est devant l’oppidum d'Izernore. Nous le répétons, ce récit de César, lu sur ce terrain d'Izernore, est saisissant. On ne peut, ce nous semble, ni rencontrer dans un récit plus d'exigences particulières de la part du texte, ni rencontrer, dans un lieu mis en regard de ce texte, une concordance plus complète, plus parfaite de tous points. Il est important de remarquer, au sujet de ce premier combat livré par l'armée auxiliaire, que le récit de César nous a signalé, au début de l'action, l’infanterie de cette armée auxiliaire se cachant dans les lieux supérieurs et voisins de la plaine, comme dans une embuscade, mais qu'elle n'a nullement combattu, qu'elle ne s'est même point du tout montrée durant le combat. Or, si cette infanterie ne se plaçait pas là en embuscade, pourquoi en parler ? Et s'y elle s'y plaçait en embuscade, pourquoi ne point avoir dit quelle cause l'empêcha d'exécuter le coup ainsi préparé ? ou même simplement d'accourir au secours de la cavalerie gauloise si vivement ramenée jusqu'au camp de l'armée auxiliaire, camp dont cette infanterie cachée était si proche ? On voit donc que tout cela est un peu arrangé par le narrateur pour produire l'effet qu'il désirait obtenir sur l'esprit du lecteur. Comparons du reste ce combat de la cavalerie auxiliaire avec celui de la cavalerie de Vercingétorix qui a eu lieu précédemment dans cette même plaine. — Au sujet de la cavalerie de Vercingétorix, César emploie des expressions qui montrent avec quel acharnement elle combattit : On se charge des deux côtés avec la plus grande vigueur... Il se fait un grand carnage... Les Romains faiblissant, César envoie les Germains à leur secours. Tandis que, au sujet de la cavalerie auxiliaire, les expressions de César indiquent, sinon la lâcheté, du moins beaucoup de mollesse : Les Germains les chargèrent et les poussèrent devant eux... Les cavaliers gaulois abandonnant le terrain, les nôtres les poursuivirent jusqu'à a leur camp, sans leur laisser la faculté de se rallier. Il est donc constaté que la cavalerie auxiliaire n'apporta que bien peu d'ardeur à combattre devant Alésia. Ceci est important à remarquer pour l'appréciation du concours fourni par cette armée à Vercingétorix : question qui devra être posée dans l'examen historique de ces événements. Mais ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est que :
même si la cavalerie auxiliaire eût ramené vigoureusement la cavalerie des Romains
jusqu'à leurs lignes, qu'en fût-il résulté pour Vercingétorix et son armée
bloqués dans l'oppidum ? Évidemment la cavalerie gauloise ne pouvait pas
forcer les lignes du blocus. L'armée de Vercingétorix n'en fût donc pas moins
demeurée sans vivres, et entourée par l'armée romaine approvisionnée d'une
réserve de vivres pour trente jours. II faut donc bien le répéter ici : le
retard funeste de l'armée auxiliaire — en opposition aux ordres formels du
chef suprême de Suivons. Uno die intermisso, Galli...
Après avoir laissé écouler un jour, les Gaulois, qui
dans cet intervalle de temps avaient préparé un grand nombre de fascines,
d'échelles et de grappins, sortent de leur camp au milieu de
la nuit, en silence, et s'approchent des lignes de la plaine[1]. Tout à coup, poussant une clameur, afin de signaler leur
arrivée à ceux qui sont bloqués dans l'oppidum, ils jettent bas les fascines,
et à coups de frondes, de flèches, de pierres, ils
tâchent de chasser les nôtres des retranchements, et ils emploient tous les
autres moyens d'attaque. En même temps, la clameur ayant été entendue,
Vercingétorix donne le signal aux siens à son de trompe, et les fait sortir
de l'oppidum. Les nôtres se portent aux
retranchements, chacun au poste qui lui avait été assigné les jours
précédents, et là, à coups de frondes, à coups de fléaux-projectiles
et de gros traits, qu'ils avaient disposés dans les ouvrages, et à
coups de balles de plomb, ils jettent l'épouvante parmi les Gaulois[2]. Les ténèbres empêchant de voir à distance, beaucoup de
blessures sont reçues à l'improviste de part et d'autre. Nombre de traits
sont lancés par les machines. Mais les lieutenants Marc-Antoine et
Trebonius, à qui était dévolue la défense de cette partie des lignes, partout
où ils s'apercevaient que les nôtres étaient accablés, y envoyaient en
renfort des troupes tirées des redoutes situées par derrière eux[3]. Tant que les Gaulois étaient à
une certaine distance des retranchements, ils avaient l’avantage par le
nombre des projectiles ; mais, quand ils s'approchaient plus près, ou bien
ils se perçaient eux-mêmes aux aiguillons, qu'ils ne s'attendaient pas
à trouver là sous leurs pieds ; ou bien, tombant dans les trous, ils y
étaient transpercés par les pieux des lis ; ou bien, se trouvant à portée du vallum
et des tours, ils y étaient atteints et tués du coup par les traits
des machines de remparts. Après que de toutes parts beaucoup d'hommes eurent
été blessés ; et aucun point des lignes n'ayant été entamé, comme le jour
arrivait, les Gaulois craignirent d'être coupés, si, des postes supérieurs (si, de la colline de Changeat), on a exécutait une sortie sur leur flanc découvert ; et
ils se a retirèrent auprès des leurs. Quant à ceux qui étaient bloqués dans l’oppidum, pendant qu'ils apportaient au dehors tout ce que Vercingétorix avait fait préparer pour l’attaque, et qu'ils comblaient les premiers fossés, trop de temps s'était écoulé ; de sorte qu’ils s’aperçurent de la retraite des leurs avant d'avoir pu eux-mêmes s'approcher des retranchements des ennemis. Ainsi, n'ayant rien pu faire, ils rentrèrent dans l’oppidum. Cette attaque nocturne n'introduit aucun élément topographique nouveau ; mais elle nous paraît intéressante à examiner en détail, par la raison qu'elle fut en réalité (selon nous, et d'après le fond même du récit de César) bien moins importante qu'elle ne semblerait l'avoir été de fait, au premier aspect de ce même récit. En effet, du côté de l'intérieur il n'y a pas eu le
moindre engagement de troupes : la résistance inerte des ouvrages avancés de
la contrevallation a suffi pour arrêter les Gaulois : César l'explique
très-clairement. Du côté de l'extérieur, le récit nous montre bien les
Gaulois s'approchant de la ligne de circonvallation avec
un grand nombre de fascines, d'échelles, de grappins — magno cratium, scalarum, harpagonum numéro effecto
(comme pour se porter à l'assaut des ouvrages de la plaine) ; mais ces
Gaulois, en arrivant aux premiers obstacles, jettent
bas leurs fascines, et lancent des traits, des pierres. Puis, voulant s'approcher
davantage, ils se percent les pieds aux aiguillons qu'ils ne soupçonnaient pas
être cachés là, ou bien ils tombent dans les trous des lis dont les pieux
leur transpercent le corps. Mais il n'est parlé ni de la ligne des
ceps, forêt de pals solidement enchevêtrés et plantés en terre, ni des deux
fossés qui sont au pied du retranchement, ni du retranchement avec ses
défenses propres. Ainsi, les Gaulois de l'extérieur n'ont pu avancer jusqu'au
pied des retranchements, qui couvraient les soldats romains ; et ils n'ont
employé ni échelles, ni grappins, bien que le récit de César nous les montre
d'avance munis de ces engins d'assaut. On voit donc bien que le combat
rapporté ici avec assez d'éclat se borna simplement, de la part de l'armée auxiliaire,
à lancer de loin de faibles projectiles ; et que la perfection des lignes
romaines, ou le retard de l'armée auxiliaire qui permit le perfectionnement
de ces lignes, est encore la véritable cause de l'insuccès de cette attaque
nocturne, comme de tout le reste. Un mot qui termine le récit du combat : ils se retirèrent auprès des leurs, constate qu'une partie seulement de l’armée auxiliaire prit part à cette attaque nocturne des lignes de la plaine. Fût-ce la moitié, le quart ? Il n'en est rien dît. Pourquoi n'a-t-on pas attaqué les lignes sur tous les points à la fois et avec toute l'armée auxiliaire ? Il manque donc ici des explications importantes. Les légionnaires qui avaient été présents, qui avaient vu les troupes gauloises se retirer au point du jour, pouvaient apprécier les expressions du récit à leur juste valeur. Ils savaient environ quelle part proportionnelle de l'armée auxiliaire avait attaqué les lignes de la plaine ; à quelle distance du retranchement l'ennemi avait été arrêté par la zone des pièges ; ils savaient que toutes ces échelles et tous ces grappins, dont il est fait mention dans le récit, — magno cratium, scalarum, harpagonum numero effecto, — avaient été inutiles ; que ces pieux, — sudibus, — étaient de gros traits lancés par les machines contre l'ennemi lointain, non des pieux maniés pour en percer de près l'ennemi montante l'assaut ; ils savaient qu'eux-mêmes, en effet, avaient été accablés de fatigue, — premi, — non pas d'ennemis qu'ils eussent sur leurs bras, mais de flèches qui leur avaient été lancées de loin, et que, pour résister à cette grêle de flèches lancées dans les ténèbres, ils avaient eu besoin de renforts qui vinssent les aider à faire jouer une multitude de machines, et non pas les aider à résister i l'ennemi en nombre et attaquant avec fureur, corps à corps. Mais, pour un lecteur étranger à l'événement, le récit n'est-il point tel, que, si l’on n'y apporte pas une certaine attention, on peut fort bien être induit en erreur par son aspect superficiel, et croire à une grande lutte nocturne, à un véritable assaut des retranchements de César ? On est, ce nous semble, d'autant plus exposé à tomber dans cette erreur, que César a soin de nous informer que les retranchements ne furent point entamés, — nulla munitione perrupta ; — ce qui porterait à croire qu'ils ont été abordés par les Gaulois, mais bien défendus par les Romains. Enfin, César partage avec ses lieutenants, Marc-Antoine et Trebonius, la gloire de la résistance à cette attaque nocturne : ce qui paraîtrait impliquer l'idée que cette gloire fut très-grande, et, par suite, que le danger lui-même fut aussi très-grand. Voilà donc dans ce récit beaucoup de mise en scène, pour une attaque sans importance, contre des retranchements qu’on avait eu le temps de rendre inabordables. |