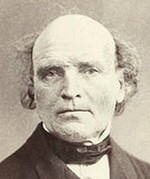LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
ET LE MINISTÈRE ODILON BARROT
VIII. — LA DÉFAITE DES PARTIS ET DU PARLEMENT.
Rentrée de la Chambre. — Berryer et la monarchie. — Le prince Napoléon contre les décrets de bannissement et le président de la République. — Le douaire de la duchesse d'Orléans. — La question sociale remplacée par la politique des affaires. — Considérations financières. — Protestations des commerçants, boutiquiers et petits propriétaires. — Système financier de l'État. — La dette. — Article de Laurent de l'Ardèche. — Opinion de Proudhon sur 1789 et 1848. — La petite bourgeoisie et le prolétariat. — Le procès du 13 juin à la Haute Cour de Versailles. — L'accusation ne saurait admettre un parti démocratique et social. — Girardin dépose en faveur des accusés. — Déposition du colonel de Goyon. — Le président Baroche. — Observations de Guinard. — Le lieutenant de gendarmerie mobile Petit. — Partialité de la Cour. — Le procès de Strasbourg. — Michel de Bourges. — Condamnation des sept accusés dont Guinard. — Même partialité de la justice à Lyon. — Protestation inutile de Pierre Leroux. — Impuissance de la démocratie républicaine. — Louis-Napoléon rendu inévitable par la guerre civile des partis abandonnés à eux-mêmes et incapables de se mettre d'accord. — Chute du ministère. — Barrot, malade, refuse le grand cordon de la Légion d'honneur. — Le message. — D'Hautpoul et le prince-président dans les jardins de l'Elysée. — La déclaration ministérielle. — Ce qu'est le nouveau ministère. — Résultats de la constitution de 1848. — Le parlementarisme. — Louis-Napoléon, au lieu de représenter la révolution comme en décembre 1848, représente maintenant l'Église. — Diminution de la France et de la position française.L'Assemblée avait repris ses travaux le 8 octobre. Les députés étaient revenus de leurs départements, renseignés sur l'état d'esprit des électeurs, un peu plus imprégnés, malgré eux, de leurs désirs et de leurs inquiétudes ; les uns voulaient en finir avec la République[1] ; les autres, sentant le mouvement de réaction, avertis, plus ou moins, sur les velléités monarchiques assez nombreuses et sur les préparations qui en résultaient, entendaient défendre la République ou, du moins, l'idée républicaine. La force numérique des deux partis était restée la même. Sur 479 votants, M. Dupin réunit 339 suffrages, tandis que M. Grévy n'en obtenait que 105 ; la proportion était toujours d'un tiers aux deux tiers[2]. Cette rentrée qui ne permit, d'ailleurs, de compter que 486 membres présents, fut morne[3]. Beaucoup de curieux s'attendaient cependant à mieux, car il y avait foule autour de la Chambre[4]. Le premier débat sérieux avait eu trait à la proposition Creton, réclamant l'abrogation de la loi qui interdisait aux membres des deux branches de la famille des Bourbons tout séjour en France. Cette proposition était évidemment faite dans un esprit hostile au régime et pour favoriser l'action plus ou moins prochaine de la droite. Les ministres eux-mêmes, malgré leur hostilité contre le président, le sentirent et résolurent de combattre le projet. Les députés, voyant le cabinet marcher avec ensemble sur ce terrain, l'y suivirent ; mais les amis de Creton essayèrent vainement de lui faire comprendre que son insistance serait inutile. Son discours, rempli de lieux communs, révéla un homme sans perspicacité, convaincu, et qui avait dû être remonté en sous-main discrètement. Après avoir souligné l'injustice des ostracismes politiques, il rappelait la conduite désintéressée des princes d'Orléans en 1848, et cet appel à une aristocratie précédemment orléaniste qui rêvait de devenir républicaine, ou plus justement, sans doute, de le paraître afin de pouvoir se faire passer pour telle, parut dangereux aux légitimistes qui voyaient tout à coup surgir cette tactique au travers de la route qu'ils pensaient seuls posséder ; l'alliance ne se maintenait que s'il s'agissait d'arrêter la démocratie sociale, sans préparation suffisante, ou le prince-président, dont la diplomatie napoléonienne risquait de s'adapter à nouveau la poussée démocratique refoulée afin de s'en faire un autre marchepied plus solide encore et plus immédiat que celui de 1848. Berryer vint à la tribune. Allons au fond de la question ; les propositions qui semblent faites en faveur des deux branches de la maison de Bourbon seront sans résultat et ne sont pas sérieuses. Dans toutes les sociétés humaines, il y a deux principes : le principe héréditaire et le principe électif, qui s'excluent d'une façon absolue ; quand l'un des deux règne dans un État, c'est lui qui proscrit nécessairement l'autre, et non la loi. Y-a-t-il personne dans cette assemblée qui pense que, sous l'empire d'un principe électif qui régit la France, aucun membre de la maison de Bourbon consente à rentrer en France et à y exercer ses droits simples de citoyen ? — Plusieurs voix : Ils l'ont demandé eux-mêmes. — Peut-on décrier ou disputer aux princes descendus du trône ce qui leur reste loin de la France, ce qui les distingue et les honore ? Quand les héritiers des rois sont éloignés du trône, quand ils sont proscrits et exilés de la patrie, ils n'en sont pas moins, pour le reste du monde, autre chose que de simples citoyens. Si un seul d'entre eux acceptait la loi proposée et, oublieux de ses propres aïeux, venait dire : Je suis citoyen comme tout autre. Ah ! Messieurs, je ne vous demande pas ce que vous penseriez de lui... La thèse était claire, Berryer voulait confondre les deux branches comme si elles ne représentaient qu'un seul et même principe, et il escomptait d'imposer une solidarité absolue aux d'Orléans. Croyant servir la cause monarchiste, il la tuait dans ses deux branches ; dévoyant l'une et l'autre, il accélérait la possibilité démocratique, et, la démocratie n'ayant pas su se mettre d'accord pour posséder la puissance de se revendiquer par elle-même, l'idée napoléonienne. La conséquence du raisonnement de Berryer était même de dénaturer le caractère de la mesure qui tenait les princes d'Orléans éloignés de leur patrie et de substituer pour eux à cet ostracisme momentané, et que les circonstances pouvaient faire cesser d'un moment à l'autre, une expatriation absolue qui ne pouvait cesser que le jour où le comte de Paris remonterait sur le trône. Après avoir si activement contribué, dans la journée funeste du 24 février 1848, à renverser le gouvernement de Juillet, il ne restait au parti légitimiste qu'à enlever à ce gouvernement son caractère, son origine, sa raison d'être, et sa seule signification politique dans le pays, et c'est ce qu'il s'efforçait de faire par l'organe du plus puissant de ses orateurs. En cela, ce parti jouait son jeu ; le parti orléaniste, en ne répondant pas à Berryer jouait-il le sien ? J'en doute[5]. Dufaure, qui rendit justice au mérite des princes d'Orléans, ne pouvait répondre, ministre républicain. Nous avons, disait-il aussi, par des lois suffisantes, réussi à réprimer las désordres qui mettaient en question l'avenir de la société. Nous avons obtenu de sérieux résultats, et c'est dans ce moment que vous iriez tout ébranler, tout compromettre par une proposition juste au fond, mais prématurée !... L'histoire, en général, ne cesse de paraître singulière.
Le seul qui défendit les princes fut le fils de Jérôme ; il relut même la
lettre qu'ils avaient adressé en 1848 pour protester contre le projet de
décret qui leur interdisait le séjour en France. Sa proposition comportait
l'abrogation de tous les décrets de bannissement, visant les princes des deux
branches et les condamnés de Juin. Elle fut défendue par lui avec une âpreté
particulière et une éclatante hostilité contre son cousin : En 1836, rappelait-il, un
procès célèbre s'est ouvert devant les assises du Bas-Rhin ; une insurrection
avait eu lieu à main armée ; le chef de cette insurrection avait été
considéré comme un ennemi politique ; on l'avait saisi, séparé de ses amis,
enlevé à la justice de son pays et transporté... Odilon Barrot s'écria
: Un peu moins de haine et un peu plus de pudeur ![6] L'Assemblée
paraissait révoltée. On peut se demander toutefois si la défense des insurgés
de Juin, éloquemment faite par Jérôme, en même temps que l'incapacité de
l'Assemblée à comprendre un sentiment généreux et à ne pas tout ramener à une
question personnelle, ainsi, en dernier lieu, que le souvenir de l'affaire
romaine, n'étaient pas les plus fortes causes de son indignation ; elle se
montra tout spécialement hostile lorsque l'orateur attaqua le décret de la
Constituante sur la déportation des insurgés. Mais
vous l'avez voté ! s'écria un des dévots de la majorité, M. Dahirel. Non. — Si. Les
démentis s'échangèrent avec violence. Le prince Napoléon alla vérifier le
Moniteur dont la lecture lui donna raison, et accusa son interrupteur d'avoir
sciemment porté une accusation fausse. Celui-ci, loin d'en convenir, soutint
qu'il l'avait vu voter pour le décret ; il ajouta même : Il y a cinquante de mes amis qui sont prêts à l'attester.
Et des voix de droite d'appuyer : Oui ! Oui ! nous
l'avons vu ! Exaspéré, Napoléon répondit : Ce
que vous dites est faux, vous voulez m'accabler à coups de majorité. M.
Dahirel, sans grand honneur, répliqua : Il n'y a pas
à vous accabler ; nous avons parfaitement vu M. Napoléon Bonaparte voter ce
décret, comme il a voté avec nous pendant presque toute l'année, jusqu'au
moment de son retour de Madrid. La droite riait plus grossièrement. Une telle personnalité est indigne, s'écria le
prince ; il est des arguments qu'on ne réfute pas à
la tribune ! Sur le terrain où les témoins s'interposèrent et
arrangèrent l'affaire, le député Dahirel déclara que, dans le vote par assis
et levé, il avait pu prendre un mouvement involontaire du prince pour un vote
affirmatif. La proposition avait été rejetée par 419 voix contre 183. Le crédit demandé pour le douaire de la duchesse d'Orléans ne fut pas très discuté. Le gouvernement provisoire avait fait mettre le séquestre sur les biens de toute nature ayant appartenu à la famille d'Orléans, séquestre qui semblait avoir eu pour but, soit de conserver aux créanciers leurs gages, soit de préjuger leurs biens de telle sorte qu'un jour ils retournent à la nation ; le gouvernement provisoire avait, en tout cas, refusé de consentir le séquestre en confiscation et, en octobre 1848, sur un rapport de Berryer, un décret avait été voté qui, après constatation que toutes les garanties étaient assurées aux créanciers de la famille d'Orléans pour le paiement de leurs créances ordonnait de restituer aux exilés leurs biens dotaux, douaires et toutes valeurs mobilières, immobilières leur appartenant en propre. Il semblait donc qu'il n'y eût même pas à discuter. Mais le douaire de la duchesse ayant été placé sous le séquestre avec tous les autres biens de la famille royale, le ministre des Finances n'avait pas cru devoir le faire figurer dans les charges du trésor et, en conséquence, ne l'avait pas compris dans son budget des dépenses de 1848. Le liquidateur n'avait pas réclamé, mais dès que la restitution des dots et douaires avait été ordonnée par décret, la duchesse d'Orléans avait écrit à son mandataire en France de se présenter au Trésor pour réclamer les arrérages de son douaire avec mission, si on les lui payait, de les distribuer aux ouvriers pauvres. Le Trésor, en l'absence de tout crédit législatif, ne s'était pas cru autorisé à payer. Le ministère se trouvait donc obligé de demander le crédit au Parlement. Quelques députés de gauche, dont Crémieux et Mauguin, estimèrent que la duchesse d'Orléans, adoptée par la France et rejetée par elle dans les circonstances les plus pénibles, veuve après si peu d'années de mariage avait droit à son douaire ; M. Passy, sur leur instance, leur ayant communiqué le contrat de mariage de la duchesse, ils avaient vu qu'au moment de son mariage, elle avait dû renoncer à tous ses droits successifs et avait reçu en échange une dot de 100.000 francs, mais qu'en même temps un domaine de 300.000 francs lui avait été garanti pour le cas où elle survivrait à son mari ; Louis-Philippe avait contracté l'engagement, si ce douaire n'était pas voté par les Chambres, de l'acquitter sur ses propres biens. Le contrat de mariage présentait donc deux obligations : l'une privée, du père de famille, qui devait s'exécuter, l'autre purement politique, celle de l'État qui, contractée par une situation politique donnée, s'était évanouie avec cette situation. Quelques députés répondaient que le douaire était devenu une dette de la nation et que la garantie éventuelle de Louis-Philippe s'était évanouie ; la dette demeurait donc formelle, les révolutions n'affranchissant pas les peuples sur ce point, de leur débit. 423 voix se prononcèrent pour le crédit demandé et 184 contre. La question sociale apparut une fois encore à la Chambre, avec modération. — La ligne descendante, suivie depuis les premiers jours de la révolution, ne pouvait que continuer, mais sans habileté, et suscita les mêmes clameurs. Les revendications présentées assuraient un esprit en somme pacifique, néanmoins peut-être, trop inspiré de la centralisation socialiste gouvernementale qui n'avait pas réussi aux Ateliers nationaux, et un pareil langage semblait, à une pareille Chambre surtout, devoir contribuer à la destruction de l'ordre public. Auteur d'un projet pour l'extinction de la misère et l'abolition du prolétariat, le député Pelletier suscitait de nombreuses et énergiques réclamations en disant : J'ai voulu seconder, favoriser les travailleurs sans bouleverser la société ; je me suis appuyé sur l'article 13 de la Constitution, et j'ai conclu à l'organisation du crédit et du travail ; cela devait être ; le crédit et le travail sont essentiellement inséparables. C'est parce qu'ils ont toujours été en lutte, et qu'ils le sont encore, que nous avons eu tant de misères et de révolutions. On a demandé jusqu'à ce jour aux canons et aux baïonnettes l'ordre social, on s'est mal adressé, le canon et les baïonnettes ne font que des veuves et des orphelins. L'ordre ne peut exister que par l'alliance du travail et du capital... Le crédit doit s'étendre à tous. Pelletier avait proposé que, pour se mettre en mesure de faire les fonds d'un vaste système de banque, l'État s'emparât des assurances et des biens communaux. Il y avait à présenter, certes, des objections ; mais Charles Dupin, en qualité de rapporteur, avait répondu avec une emphase assez boursouflée, en mettant en avant les mots de spoliation et de communisme. Mon impression, disait-il notamment, s'est manifestée à la fin de la séance qui vous portait au rejet sans examen, tant la proposition a paru monstrueuse ; mais en appréciant l'esprit, les motifs et les menaces, vous avez fait comme votre commission, qui a pensé qu'il fallait combattre ce qu'il y avait de dangereux au fond de la proposition qui appelle l'indignation du pays contre tout un parti. Le socialisme était, à ses yeux, la ruine de la société. Selon lui, la société actuelle était arrivée à son apogée et ne laissait plus rien à désirer. Nous ne permettrons pas, dit-il en terminant sa péroraison, qu'on appelle cette société barbare quand elle est l'honneur de la civilisation ! Pelletier avait dit au contraire : Pour nous le socialisme est le berceau des idées d'économie politique destinées à améliorer physiquement et intellectuellement le sort du peuple. Le socialisme rencontrera même opposition que la philosophie a rencontrée autrefois... Le socialisme peut se résumer tout entier dans cet axiome : Une société bien organisée doit donner à tous les citoyens la possibilité d'assurer leur existence et doit permettre à chacun d'eux de raffiner son intelligence... (Rires et bruits.) La question sociale était d'ailleurs remplacée par la politique des affaires[7], et nul n'était là pour démontrer avec autorité qu'elles devaient influer l'une sur l'autre, de manière à se résoudre l'une par l'autre, et cela parce que sur beaucoup de points elles se confondaient. Un peu partout, de plus en plus, les affaires devenaient la préoccupation principale, unique du pays. Les chemins de fer, les mines et les primes fin courant étaient à l'ordre du jour. Vainement les républicains conscients, même modérés, réclamaient-ils, pour ces affaires, une sorte de base conforme aux institutions démocratiques et qui pût permettre de les placer sur un terrain où elles fussent, autant que possible, honorables et fécondes pour tous, moins abandonnées sans contrôle à de trop habiles capitaines de l'argent ; vainement rappelaient-ils que le règne de Louis-Philippe, si propice à ces affaires, avait mal tourné[8] ; vainement évoquaient-ils les hauts tenanciers des grandes compagnies, comtes ou barons du royalisme et de l'Empire, qui exploitaient à l'envi l'actionnaire... et toute cette époque où, sous prétexte de travaux d'utilité publique, l'agiotage faisait, dans ses saturnales éhontées, mais légales, couler des flots incessants d'or et de faveurs pour les coupe-jarrets patentés de la Bourse et de la finance, en même temps qu'il inoculait à la masse bourgeoise la passion du jeu et, avec elle, le poison de la cupidité égoïste et de la corruption[9]. L'exagération de ces revendications, le manque de connaissances économiques qui ne permettait pas toujours de formuler sur un terrain pratique, selon des données exactes, ce qu'elles comportaient, cependant, de légitime prudence, les empêchaient de porter ; faute de connaître les multiples nécessités de la prospérité nationale et des affaires mêmes, elles ne comptaient pas, car toute lutte consiste à accumuler les éléments d'une supériorité afin de les imposer, en les rendant irréfutables, au moment opportun. Ici encore se faisait une fois de plus sentir la nécessité de l'éducation économique du prolétariat et de la classe moyenne. La crise financière et économique ouverte, pourrait-on dire, au lendemain même de juillet et peut-être plus encore par suite de la situation laissée par la monarchie que par la révolution même, s'était continuellement maintenue, au moins par la peur, depuis le 6 mars, signal de la débâcle ; les actions avaient eu beau remonter, la peur continuait, chez beaucoup, d'ailleurs, affectée. La possibilité d'agir économiquement demeurait, en dépit de tous les efforts, mal orientés, dans les mains des plus renseignés, et la question sociale étant économique, avant tout, sur le terrain matériel, il n'y avait même pas de lutte possible. On s'en était aperçu bien clairement en mars et avril 1848 où la crise financière, par sa violence croissante, empêcha les réformes sociales et, de ce fait, aida, entraîna la réaction[10]. La politique réactionnaire triomphait ainsi sur tous les terrains. Elle favorisait le libre échange, contre lequel beaucoup de républicains protestaient avec une certaine raison, au lendemain de Février, dans l'état où se trouvaient les industries nationales épuisées par un long chômage et menacées de voir s'arrêter leur travail, dans la peine où se débattaient les classes laborieuses, au salaire diminué. La libre entrée des marchandises en France, des marchandises anglaises surtout, irritait. On faisait ressortir que, dans l'état du monde tel qu'il était, le libre échange consacrait l'anarchie industrielle, le monopole écrasant du fort contre le faible, et, même, une sorte d'esclavage. Un changement avait eu lieu dans l'organisation financière de la France, qui ne portait pas les fruits qu'on en avait attendu[11]. Le décret du 16 mars 1848, prescrivant la fusion de la Banque de France et de plusieurs banques des départements, fut cependant approuvé au début ; l'unité apparaissait, en administration comme en politique, un élément de force, et la réunion de la Banque de France aux établissements particuliers situés dans les principales villes industrielles, fut salué par tous ceux qui attendaient la reprise des affaires et le rétablissement du crédit. Mais il fallait pour cela des hommes décidés à rompre avec les traditions vieillies, à encourager le travail, à stimuler la production et à favoriser le mouvement industriel ; ces hommes manquèrent et le système du statu quo prévalut, comme sous la monarchie. Les effets de la concentration apparurent même assez rapidement désastreux, au point que le renversement des escomptes et les entraves continuelles apportées à la circulation des capitaux arrêtèrent sur plusieurs points l'activité industrielle, rendant ainsi chaque jour plus difficile la situation des grands centres manufacturiers, par exemple Lyon, où un assez grand nombre de commerçants étaient menacés de ruine, la banque — comme à Bordeaux, d'ailleurs, — n'offrant point à l'industrie locale des ressources suffisantes. Les faits accusaient donc, semblait-il, un vice capital dans la constitution des banques françaises. On leur opposait les six cent soixante-dix-sept banques libres réparties dans les États de l'Union et dont l'émulation s'entretenait par la lutte. La France ne possédait que dix établissements du même genre, produits d'un privilège, et qui n'exerçaient qu'une influence extrêmement restreinte. On leur opposait encore la Belgique où une Société Générale avait établi des agences dans les villes importantes afin de faire des prêts et des escomptes à tous les négociants qui offraient des garanties ; elle avait fondé, de plus, sous le nom de Société du Commerce, un autre rouage, dépendant d'elle, et qui commanditait l'industrie. La Banque générale de Belgique avait, d'autre part, complété son institution en s'affiliant à la Banque foncière, caisse hypothécaire ; elle embrassait aussi tout le mouvement financier du pays, la circulation des capitaux, leur distribution à l'industrie, les prêts hypothécaires. Les observations précédemment adressées à la Banque de France par J.-B. Say restaient d'actualité : L'utilité d'une compagnie qui prête de l'argent sur des effets n'est pas autant de venir au secours des gens riches, de ceux qui ont de gros capitaux, beaucoup de moyens de les accroître et de vastes ressources pour parer à des besoins momentanés, que de venir au secours des négociants embarrassés qui présentent dans leur probité, leurs précédents ou la nature de leurs affaires des garanties raisonnables. De quelle utilité serait pour le commerce maritime une compagnie d'assurances qui ne voudrait jamais assurer que des bâtiments qui ne courent point de danger ? C'est par les pertes que fait une telle compagnie qu'elle se rend utile, pourvu, toutefois, que ces pertes soient surpassées par ses bénéfices ; et j'avoue que j'aurais une bien plus haute idée des services que la Banque de France aurait rendus au commerce si j'avais vu que sur les réserves énormes qu'elle a distribuées à ses actionnaires et sur celles qu'elle peut leur distribuer encore, elle avait eu quelques pertes à supporter. On ne peut pas exiger, dit-on, d'une compagnie financière qu'elle s'expose à des pertes qu'elle peut éviter. Qu'elle n'ait donc pas un privilège exclusif et qu'elle soit exposée à la concurrence d'un ou de plusieurs établissements du même genre. On reprochait à la Banque de France de disposer d'une quantité de valeurs effectives trop supérieure à la somme de son papier de crédit. Chaque semaine sa réserve métallique augmentait sans qu'un emploi fût donné à sa surabondance de numéraire, et le fait semblait d'autant plus incompréhensible que sa fusion avec les banques départementales lui avait justement fourni l'occasion d'agir. Le décret avait prescrit que les billets de banque de Lyon, Rouen, Bordeaux, Nantes, Lille, Marseille, le Havre, Toulon et Orléans seraient reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers ; les mêmes établissements étaient dispensés de l'obligation de rembourser leurs billets avec des espèces. Le devoir de l'autorité centrale était de se bien pénétrer des besoins de chaque localité ; ne le faisant pas, l'autorité centrale comprimait l'essor des grandes cités françaises auxquelles manquait le crédit. Singulière situation, à la suite de ces fautes, que celle des républicains[12] qui avaient demandé la centralisation des banques pour offrir au travail des garanties plus solides et qui voyaient leur œuvre économique, comme leur œuvre politique, le suffrage universel, se retourner contre eux. On a fait, disaient-ils, de cette centralisation, un instrument d'oppression et de tyrannie. Le but qu'on se propose, c'est de discréditer la République. Les partisans du privilège se réjouissent hautement des ruines qui s'accumulent autour d'eux. Ils osent imputer au socialisme les maux que leur égoïsme seul a causés. C'était exact. La protestation des commerçants boutiquiers et des petits propriétaires venait encore compliquer la situation[13]. Une réunion préparée pour le 3 octobre ayant été empêchée par la police, ils avaient signé — au nombre de 500 — une protestation destinée à la Chambre, qui contient des indications intéressantes pour l'histoire économique de l'époque, l'état d'esprit des classes moyennes, et vaut d'être citée : Citoyens représentants, disaient-ils, les soussignés, considérant que la France n'a pas fait une révolution pour anéantir le commerce et tuer la petite propriété au profit de la grande, ainsi qu'il est arrivé depuis février 1848, considérant que les commerçants, boutiquiers et petits propriétaires ont eu l'honneur d'adresser, à cet effet, aux représentants de la nation une pétition dont les exemplaires, revêtus de nombreuses signatures de presque toutes les villes et communes de la République, ont été déposés par plusieurs représentants sur le bureau de l'Assemblée législative ; que, par cette pétition, ils vous exposent qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de payer leurs impôts, comme il ne l'est que trop clairement démontré par les nombreuses saisies de mobiliers et les expropriations, pour dû d'impositions et de loyers ; que le déficit du budget va toujours croissant et que l'État marche à grands pas vers la banqueroute qui compléterait la ruine du commerce et de la petite propriété ; que tous ces désastres résultent de la mauvaise répartition des impôts et de ce que les capitalistes resserrent de plus en plus leurs capitaux ; que les intentions bienveillantes d'un grand nombre de représentants et de plusieurs ministres du pouvoir exécutif restent stériles, en présence de passions et d'influences hostiles au gouvernement issu du suffrage universel ; Par ces motifs : Les pétitionnaires soussignés vous supplient, dans l'intérêt de l'ordre et des finances de l'État : 1° De respecter le décret de l'Assemblée Constituante du 18 mai, qui abolit l'impôt sur la boisson ; 2° De voter, avant le 1er janvier 1850, un impôt sur la rente hypothécaire, les rentes sur l'État et les achats d'actions, et non pas un impôt de 1 % sur le revenu, ainsi que le propose M. Passy ; ce serait là, en effet, une demi-mesure, une mesure purement illusoire ou un remède qui, par l'extension qu'on ne manquerait pas de lui donner, deviendrait pire que le mal et ne tarderait pas à soulever de légitimes résistances de la part des contribuables. — Un impôt pesant uniquement sur le capital, au contraire, reposerait sur les plus justes bases et n'atteindrait pas la seule richesse inaliénable et indestructible, la seule néanmoins, qui soit restée jusqu'à ce jour à l'abri des impôts, la seule qui, une fois imposée, assurerait toujours les revenus de l'État. N'est-il pas naturel et logique que celui qui possède des rentes ou des capitaux paye dès impôts proportionnels au taux de son bénéfice légal ? Ne serait-il pas éminemment juste d'imposer une propriété dont le revenu est toujours assuré, tandis que les propriétés foncières et mobilières sont à la merci des mauvais temps, des non-valeurs, du feu et du fléau des révolutions, filles des abus et de la mauvaise répartition des charges publiques ? N'est-il pas juste d'imposer ces milliers d'industriels qui s'enrichissent par l'agiotage et les marchés de bourse, protégés qu'ils sont par les gouvernements qui les exemptent de tout droit d'enregistrement, tandis que le commerçant qui cède son établissement, le propriétaire qui vend sa propriété sont obligés de payer au moins, 8 % ? Est-ce que les rentes ne constituent pas une propriété ; la plus avantageuse des propriétés ? Pourquoi donc ne seraient-elles pas imposées ? Ils demandaient une patente proportionnelle pour les huissiers, notaires, agents d'affaires, avocats, médecins, pour tous ces industriels privilégiés de la fortune que l'État protège encore, en les mettant à l'abri de cette contribution qui pèse indirectement sur les autres branches du commerce et de l'industrie. Ils réclamaient la diminution des hauts traitements. Les salariés par l'État, disaient-ils, n'éprouvent jamais de pertes ; ils passent d'un gouvernement à l'autre, et si, parfois, ils se trouvent suspendus de leurs fonctions, ils ne reçoivent pas moins leurs traitements. Les revendications se terminaient ainsi : Il est temps qu'une bonne loi, tout en sauvegardant les intérêts légitimes du capital et de la grande propriété, défende le commerce et le travail. Sur le terrain financier, en dépit de ce qui les divisait ailleurs, des hommes comme Thiers et Berryer tombaient d'accord, unis, presque, dans une pensée commune. La commission chargée de la surveillance de l'amortissement rédigea un plaidoyer dithyrambique. Son auteur n'avait paru préoccupé que de mettre en relief les vertus économiques de la Restauration et, surtout, de discréditer davantage encore la révolution de février par une critique sans pitié qui s'opposait à ses éloges[14] ; à ses yeux, la Révolution était coupable surtout d'avoir changé l'état de la question en abandonnant la politique pour revêtir un caractère social. — Les adversaires de l'amortissement ou, du moins, de la manière dont il avait été mené, voyaient dans son secours la cause de l'extension exagérée de la dette et des impôts. Ils rappelaient que libérer l'État, réduire successivement sa dette de manière à l'éteindre au bout d'un certain temps, tel était le but de toute création d'amortissement ; ils répétaient les paroles du baron Louis, ministre, pourtant, de la Restauration : La caisse d'amortissement a été créée pour réduire la dette publique ; elle n'a servi qu'à l'accroître... Pour que l'amortissement ne soit pas un vain mot, il faut qu'il ait pour base immuable un surplus de recette, un revenu libre, constant et assuré, pendant un grand nombre d'années. Ils racontaient les mesures prises alors, la liquidation de la caisse d'amortissement et sa reconstitution sur des bases plus larges. La loi du 28 avril 1826 avait porté à vingt millions le chiffre du fonds d'amortissement ; les arrérages de rentes rachetées, versés en outre à la caisse, avaient été employés en achats de rentes, et ces rentes devraient être immobilisées ; elles ne pouvaient, sous aucun prétexte et dans aucun cas, être vendues ni mises en circulation à peine de faux. En 1817, le chiffre de la dotation avait été doublé, porté ainsi à quarante millions ; de plus, le législateur avait affecté à la caisse d'amortissement tous les bois de l'État et décrété aussi, à partir de 1818, que la caisse pourrait aliéner 150.000 hectares de bois. En moins de cinq ans, dès 1821, le chiffre des sommes remises à la disposition de la caisse d'amortissement dépassa 79 millions. Ainsi, malgré la loi du 1er mai 1825 qui, pour favoriser la création du 3 %, ordonnait l'annulation immédiate de toute rente de 5 % rachetée et privait ainsi le fonds amortissant d'une de ses principales ressources, le chiffre des fonds versés à la caisse dépassait 1.100 millions en moins de quatorze ans. Il aurait été facile, avec d'aussi puissantes ressources, d'opérer sur la dette de manière à libérer le pays dans une large mesure ; mais le pouvoir chargeait surtout le grand livre de nouvelles inscriptions de rentes ; il s'y occupait davantage qu'à opérer par voie de rachat. — M. Laffitte disait en 1833 : Depuis le 25 mars 1817, jusqu'au 8 août 1832, l'Etat a émis deux fois plus de rentes que l'amortissement n'en a racheté. La dette s'est donc accrue en raison des efforts qu'on a faits pour la réduire. Il parlait exactement comme le baron Louis dix-huit ans auparavant. Les chiffres le prouvaient. Au 1er avril 1814, les inscriptions de rentes n'excédaient guère 63 millions. Au 1er janvier 1816, où il s'agit de reconstituer l'amortissement, le chiffre des inscriptions s'élève successivement à 80.527.240 francs, somme qui représente au pair capital d'environ 1.600 millions. La liquidation de l'arriéré antérieur au 1er avril 1814, et qui fut définitivement fixé à 503 millions, entre pour quelque chose dans ce chiffre. Le surplus de cet arriéré n'excédait guère 400 millions ; il suit de là qu'au moment où le fonds d'amortissement est reconstitué, puissamment doté, comme il vient d'être dit, la dette véritable de la France n'excède guère, en principal, deux milliards, soit 100 millions de rentes. Tel est donc, en 1816, le point de départ des financiers de la monarchie, armés d'une puissante machine pour éteindre la dette et libérer le pays. L'amortissement fonctionne, d'ailleurs ; il opère par voie de rachat et fait incessamment usage des immenses ressources mises à sa disposition. Le rapporteur pouvait dire que l'on était parvenu à racheter, durant une période d'environ trente années, 80 millions de rentes sans parler des secours que la caisse payait au trésor en lui livrant une grande partie de sa réserve. Mais pendant que l'État payait 504, il en empruntait 100. Il ressortait donc bien que la manœuvre appelée l'extinction de la dette était un leurre, puisque la réduction même aboutissait à une rénovation abusive de la dette dont le titre, incessamment rajeuni, devenait plus lourd. — En juillet 1830, quand la légitimité tombe, ce n'est plus une dette en inscriptions de rentes de 80 millions, mais de 207 millions qui pèse sur le pays. Au lieu des 2 milliards de 1816, il s'agit d'une dette de 5.318.581.192 francs, après quatorze années d'amortissement continu, de largesses et de sacrifices pour arriver à libérer l'État et soulager, par suite, le contribuable. Sous la Restauration, on rachetait donc la rente, mais pour opérer par voie de nouvelles et plus fortes émissions, de manière à élargir de plus en plus et à creuser le lit de la dette — excellent moyen de satisfaire tous les appétits qui se réclament sans cesse du prince. L'avènement d'un autre système politique ne pouvait rien changer à ce système financier. Il s'accrut. M. Thiers disait en 1831 : Le but de l'amortissement, son but vrai, c'est d'opérer par voie de rachat, d'éteindre la dette et de libérer l'État. Et M. Gonin — celui même qui présidait aujourd'hui la commission du budget — disait en 1833 : La nécessité d'un amortissement avec une dette aussi forte que la nôtre nous a paru incontestable. Mais c'est surtout sous le rapport d'un remboursement d'une portion de cette dette que nous avons reconnu cette nécessité. L'avantage que peut en retirer le crédit n'eût été qu'une question secondaire. Le principe auquel nous sommes surtout attachés est celui qui doit porter un État à empêcher l'accroissement progressif de sa dette. Or le chiffre des inscriptions de rentes, qui était de 207 millions en 1830, avait pris, en moins de dix-huit ans, de nouveaux développements. Le 23 février 1848, la dette, sous l'action bienfaisante d'un amortissement dirigé et surveillé par Thiers, Humann, Lacave-Laplagne, etc., s'était accrue de 1.500 millions de capital, malgré des recettes croissantes. Il s'agit cette fois de 7 milliards environ. — La réponse était que sans le secours puissant d'un fonds amortissant, le résultat eût été à peu près le même. Il n'en demeurait pas moins vrai que c'était à l'amortissement que l'on devait ces budgets toujours ivres qui, nourrissant et sollicitant l'emprunt, forçaient l'État à répondre par de nouvelles émissions de rentes aux rachats de la veille. L'abus nourrissait l'abus. Il en aurait été autrement si la réduction de la Dette avait été sérieusement poursuivie à l'aide des excédents de dépense et non en ajoutant aux charges du budget. L'intérêt du contribuable est d'ailleurs en opposition avec celui de ceux qui entretiennent l'exploitation abusive de l'impôt par l'emprunt continu. On revenait d'autant plus naturellement aux affaires
telles que les avait comprises le règne de Louis-Philippe que la République,
petit à petit, s'était remise davantage entre les mains, le roi, Guizot, et
quelques ministres exceptés, des mêmes directeurs. Dieu,
disait encore le journal que nous avons cité précédemment[15], leur avait réservé cette dernière épreuve. Il voulait que
leur impuissance organique fût démontrée avec éclat sous toutes les formes de
gouvernement. La France des censitaires leur avait livré les chambres
électives de la monarchie ; la France des prolétaires les a maintenus en majorité
dans les assemblées souveraines de la République, et ils n'ont su profiter de
cette omnipotence accidentelle que pour suivre, sous le régime du suffrage
universel, les tendances aristocratiques de la diplomatie et de
l'administration françaises sous le règne du privilège électoral. C'est la
vieille Europe reconnue mourante, il y a trente ans, par de Maistre, qui leur
a paru vivace et dont ils ont redouté l'humeur sénile et désiré l'alliance ;
c'est l'ancienne France des absolutistes et le pays légal des doctrinaires
dont ils ont prisé par-dessus tout le concours et les sympathies. Ce sont les
hautes classes, sentinelles désarmées et compagnes inséparables de la royauté
abattue en 1830, et les classes moyennes ; patronnes malheureuses de la
monarchie renversée en 1848 ; ce sont des aristocraties grandes et petites
que M. Guizot lui-même déclarait inhabiles, en 1821, à discipliner et à
organiser la révolution et dont l'inaptitude a été rendue depuis plus
manifeste encore par deux terribles épreuves ; ce sont les supériorités de la
naissance et de la fortune, les influences altérées sous la pression du
mouvement philosophique et compromises par leur solidarité avec les dynasties
déchues, c'est la notabilité ébranlée, la force chancelante, le monde incliné
vers la tomber les grandes ombres du passé qu'ils ont invoqués comme les
indispensables soutiens et les éternels appuis de toute société humaine sans
distinctions du règne[16]. Laurent, de
l'Ardèche, auteur de cet article, si fréquemment remarquable, surtout pour
son temps, semblait oublier — oubli peut-être volontaire à cette heure — que
le retour des aristocraties grandes ou petites
avait été amené surtout parce que la démocratie ne s'était pas montrée
capable de gérer les affaires, en remplaçant par ses hommes à elle les places
que la révolution avait laissées momentanément vacantes ; cela étant, la
faute ne venait-elle pas de ces aristocraties même qui, loin de prendre en
main la cause de ceux qui ne savaient encore que revendiquer verbalement,
revenaient au plus vite vers le passé ? Laurent, de l'Ardèche, signalait
ainsi aux conservateurs l'erreur grave qu'ils étaient en train de consommer :
En cherchant à perpétuer la prédominance des classes
favorisées par la naissance et la fortune, ils peuvent, par cette
obstination, témoigner de leur inintelligence de l'état actuel de la société
française et creuser sous leurs pas de nouveaux abîmes ; mais ils sont dans
les conditions de leur rôle essentiellement aristocratique et monarchique...
Ce qui est moins naturel, ce que l'on ne pouvait guère prévoir, c'est que les
aristocraties, languissantes autour du trône et tombées avec lui, rongées par
une vermine séculaire, soient parvenues, le lendemain d'une chute évidemment
mortelle, à faire partager l'opinion exagérée qu'elles gardaient de leur
vitalité et de leur importance par tous les pouvoirs qui ont régi
successivement la République après le triomphe populaire du 24 février. Il
est certain, en effet, que la majorité du gouvernement provisoire, la presque
unanimité de la commission exécutive, le général Cavaignac et le président
Louis-Napoléon Bonaparte, à travers les différences et les contrastes que
peuvent présenter la plupart de leurs manifestes et de leurs actes, ont tous
laissé entrevoir qu'ils étaient plus ou moins dominés par cette pensée
commune que la France n'était pas républicaine, parce que les classes hautes
et moyennes ne l'étaient pas. Cette manière d'apprécier l'état du pays jeta
le gouvernement provisoire et la commission exécutive dans l'irrésolution et
livra leurs successeurs à l'influence de la réaction. Une fois persuadés que
la bourgeoisie, incontestablement imbue de l'esprit monarchique, conservait
le gouvernement de l'opinion et la suprématie réelle de la société, les
pouvoirs républicains devaient être bientôt entraînés à lui rendre la
prépondérance politique ; aussi leur préoccupation la plus constante et la
plus vive fut-elle d'abord de se faire accepter et ensuite de se faire
appuyer par elle. Semble-t-il cependant que la France, à part une minorité,
ait été républicaine avant Février ? Nous avons indiqué ailleurs, quant à
nous, notre sentiment. Sans doute, dit le
député de gauche, si l'on ne considérait comme
républicains que ceux qui portaient ce titre la veille du 24 février, et qui
étaient arrivés par l'étude ou par la réflexion à désirer et à espérer
l'abolition de la monarchie en France, on aurait eu raison de dire que le
républicanisme n'avait pas pour lui l'avantage du nombre. Mais, derrière la
minorité pensante et militante, il fallait voir les masses, profondément
imbues de l'esprit démocratique, impatientes de la domination des
supériorités factices et toujours empressées jusque-là de prendre part ou
d'applaudir aux mouvements insurrectionnels qui avaient tant de fois emporté
les races royales. Il fallait voir le gros de la nation qui n'avait pas
encore eu l'occasion de se prononcer entre les diverses formes de
gouvernement[17] et que
l'intelligence instinctive de ses intérêts, à défaut des indications
rationnelles de la science, devait faire pencher certainement du côté des
institutions populaires. Oui, si les républicains connus et classés étaient en minorité, les républicains inconnus,
c'est-à-dire tous les démocrates qui étaient restés étrangers aux luttes
préparatoires de la presse et des affiliations, leur apportaient un appui
immense pour former une imposante majorité. C'était aux dépositaires de la
puissance exécutive, aux régulateurs de la politique républicaine qu'il
appartenait d'apprécier la valeur de cet appoint et l'importance de cet
inconnu. C'était à eux d'ajouter aux républicains arrivés ceux qui l'étaient
virtuellement sans le savoir et sans le dire et qui allaient bientôt le
devenir expressément et activement. C'était à eux de comprendre que les
forces respectives de la république et de la monarchie ne devaient pas être
calculées sur le seul contingent des classes riches et aisées. Les hommes
d'État de la République honnête et modérée auraient dû se rappeler que le
petit peuple n'avait pas plus accepté l'insolent congé des doctrinaires qu'il
n'avait ratifié l'annonce de la démission portée à la tribune par les
absolutistes et qu'il avait donné depuis deux éclatants témoignages de sa
participation intelligente et active à la vie politique... S'ils s'étaient
demandé à leur tour qui avait détruit le droit d'aînesse, aboli la censure,
lacéré les lois dont s'offusquait la bourgeoisie et renversé les
gouvernements qui avaient établi toutes ces choses, ils auraient trouvé
peut-être que le petit peuple n'avait pas montré pour les affaires et les
libertés publiques toute l'insouciance que s'étaient trop pressés de lui
supposer les amis de M. Guizot comme ceux de M. de Labourdonnais, et
rencontrant devant eux une puissance nouvelle, fièrement assise sur les
débris des anciennes puissances, ils auraient reconnu qu'il était aussi
difficile et aussi dangereux, en 1848, d'annuler ou d'amoindrir le
prolétariat dans les calculs de la politique, qu'il aurait été impossible, en
1789, d'empêcher le tiers état d'entrer à titre d'égal avec les premiers
ordres dans la formation de l'unité nationale. Pour quelle raison,
toutefois, l'auteur n'a-t-il pu se servir de l'adjectif impossible dès la
première fois et a-t-il dû, même, lui substituer celui de dangereux ? Par sa
force et par sa préparation progressives, le prolétariat devait rendre son
avènement fatal ; à son tour, comme le tiers de 89, il devait être assez
puissant pour passer. La bourgeoisie de 1848, à part les exceptions connues,
célèbres, fut moins généreuse que la noblesse de 89 ; mais ne faudrait-il pas
se demander, en dépit de ce que cette question comporte de gênant et de
pénible, si sa situation même de classe, placée au centre, en tant que filtre
des deux autres, le prolétariat n'étant pas prêt manifestement,
l'aristocratie n'étant pas tout à fait morte, n'influa pas sur elle, ne lui
valut pas, en tout cas, un facteur d'arrêt
que la noblesse de 89, intéressée aussi à la révolte, parce qu'elle n'était
plus rien auprès du roi, ne connut point ? Cette bourgeoisie était non
seulement le centre, mais semble-t-il, la majorité du pays et, principalement
éduquée, en dépit de ses nombreuses lacunes, elle avait la conscience de
représenter le pays essentiellement, de demeurer sa garantie momentanée. Laurent, de l'Ardèche, s'écriait encore : La France n'est pas républicaine ? Mais que serait-elle donc après qu'elle a éprouvé si souvent si longuement, si cruellement, qu'elle ne pouvait plus être monarchique ! La France n'est pas républicaine ! Mais alors, pourquoi, depuis soixante ans, ne peut-elle plus supporter la royauté ? Et il concluait : C'est ainsi que les conservateurs de la république honnête et modérée, en se mettant à la recherche de l'ordre et de la stabilité sur les traces des conservateurs de la monarchie, n'ont fait que rénover les anciens éléments de discordes et de troubles ; c'est ainsi qu'ils sont arrivés à relever les espérances dynastiques... Proudhon avait résumé 1789 et 1848 par deux questions : Qu'est-ce donc, après tout, que la révolution de 89 ? Une
assurance générale des propriétés du tiers état contre les avanies du
privilège féodal. Qu'était-ce que la révolution de 48 ? Une assurance
générale du travail contre les abus de la propriété[18]. Et il ajoutait
: La question, pour ceux qui ont étudié la matière,
n'est plus de savoir comment on peut accorder la propriété, telle qu'elle
est, avec l'extinction du prolétariat, mais comment il est possible d'abolir
le prolétariat et, par suite, de transformer la propriété sans faire tort aux
propriétaires, sans désorganiser la société[19]. Il voulait, il
avait voulu avec ses amis, que le socialisme se réalisât par la légalité, le respect des droits acquis et la
constitution[20] ; il entendait
qu'il évitât la politique. Un des premiers, peu de temps après la révolution,
il avait fait observer que la nation française ne reposait plus, comme en 89,
sur la propriété, mais sur la circulation, sur le crédit et que, par suite de
la séparation des industries qui, tout en augmentant la richesse, a détruit
l'indépendance des fortunes, le pays ne pourrait pas supporter la révolution
comme en 89, où la vente des biens nationaux avait sauvé la mise ; deux
années de chômage suffiraient à l'ébranler. Il fallait donc que le socialisme
eût tout le monde pour complice à peine de créer une
confusion babélienne, une tyrannie ; une misère épouvantable[21]. Il avait eu
tout le monde, progressivement, contre lui, alors qu'il était la donnée même,
ou tout au moins principale, de 1848. Rendu responsable de tout, ses défenseurs supprimés, il ne pouvait plus se défendre. Vainement Benoit et Greppo avaient-ils essayé de dégager les ouvriers en face du patronat. M. Vatimesnil, à la faveur d'une équivoque, avait empêché toute possibilité de coalition ouvrière par l'argument suivant : N'est-il pas certain que, lorsque les détenteurs d'une même marchandise viennent à se coaliser, le prix de cette marchandise subit une hausse injuste et abusive et que, par conséquent, le fait seul de cette coalition, qui a permis cette hausse, est punissable ? On admet que des marchands ne peuvent pas licitement se coaliser au préjudice des acheteurs. Pourquoi donc les chefs d'atelier pourraient-ils se coaliser contre les ouvriers et ceux-ci contre les chefs d'atelier ? Or les coalitions formées entre les détenteurs d'une même marchandise étaient constantes, échappaient à la loi, avec la même certitude que les coalitions formées entre les chefs d'industrie pour amener injustement et abusivement l'abaissement des salaires. L'article 419 disait en effet : Il y a coalition quand on se réunit dans le but d'opérer la hausse ou la baisse des denrées ou marchandises au-dessous ou au-dessus du prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce. Il était évidemment impossible au législateur de déterminer quand une marchandise portée sur le marché se trouvait cotée au-dessus ou au-dessous du prix amené par la concurrence naturelle et libre du commerce. Comment le législateur entrerait-il dans les mille détails de la production et du transport des marchandises ? Comment décomposerait-il le produit en ses parties intégrantes ? Mesurerait-il les qualités de travail entrées dans chacune d'elles ? Pourrait-il tenir compte de ces accidents inappréciables qui font monter ou descendre une denrée sur l'échelle de la mercuriale ? Enfin résoudrait-il le fameux et inextricable problème de la valeur ? Les marchands se coalisant pour vendre cher, les consommateurs ne se coaliseraient-ils pas à leur tour afin d'acheter bon marché ? Les consommateurs étaient, en effet, victimes du mauvais vouloir du commerce, comme les travailleurs l'étaient de la réaction capitaliste, et tous s'accusaient les uns les autres. La loi des coalitions, en ne profitant qu'au patronat, au lieu d'établir l'égalité entre lui et le prolétariat, constituait dans ses mains un instrument de domination et d'écrasement. Comme le petit commerce, la moyenne et la petite propriété se plaignaient aussi, placées dans une situation déplorable à cause de l'intérêt élevé prélevé par le créancier hypothécaire ; et les statistiques enregistraient l'absorption assez rapide de la petite propriété. De toutes parts on recherchait, en effet, l'abaissement de l'intérêt et l'établissement du crédit foncier. De nombreux socialistes déclaraient se rallier à un crédit foncier ouvert à tous, tentation incessante qui entraînerait l'emprunteur à accélérer sa chute. D'autres réclamaient la suppression de l'usure. La réduire, disaient-ils, c'est ne rien changer ; il faut invinciblement pousser la logique jusqu'au bout, arriver à la négation même de l'intérêt du capital et au crédit gratuit. Osez donc appliquer le remède non pas seulement au propriétaire, mais au commerçant, au locataire, au fermier, au travailleur, en un mot. La situation économique, comme la situation politique, paraissaient sans issue. La Révolution de 1848, en blessant tous les intérêts, en menaçant trop constamment les fortunes, avait écarté d'elle. Garnier-Pagès l'avait bien constaté quand il avait fait appel (9 mars) à la générosité des citoyens pour un emprunt national. Sans doute Garnier-Pagès avait pu rêver d'un élan patriotique semblable à celui des engagés de 92 et d'estrades où se presseraient à l'envi, pour souscrire, les volontaires nationaux de l'emprunt ; mais c'est une vieille constatation que le sacrifice de la fortune est plus malaisé à obtenir que celui de la vie. Il n'en est guère qu'un exemple historique, c'est la nuit du 4 août, et encore sait-on que le lendemain plus d'un regrettait sa griserie. L'enthousiasme ne manquait pas en 1848, mais c'était plutôt un enthousiasme intellectuel et sentimental pour de nobles idées que cet élan passionné, presque farouche, qui avait soulevé la nation entière de 92 à 93 et avait vraiment fait taire, pour un temps, les égoïsmes au profit du salut de tous[22]. La petite bourgeoisie libérale et les ouvriers nourris de souvenirs révolutionnaires, qui avaient fait 1848, avaient voulu réformer plutôt que détruire, et pour la première fois, sans s'en douter peut-être, ils avaient pesé la nécessité de résoudre le problème difficile indiqué plus haut par Proudhon. Ces deux classes, qui se mêlent souvent, à la frontière flottante, avaient mis face à face la puissance financière et la volonté démocratique, sans que la lutte fût égale. Elles ne comprirent pas que la société moderne, reposant comme nous le disions encore plus haut, sur le crédit, la vie sociale se trouve nécessairement paralysée si le crédit est attaqué. Pour résister à la manière habile dont les dirigeants de la vie financière exploitèrent la situation en l'aggravant, il aurait fallu à la classe ouvrière une organisation de combat, celle qu'elle se forge aujourd'hui par ses coopératives, ses syndicats et ses caisses de chômages. Les moyens révolutionnaires les plus victorieux eussent échoué fatalement au lendemain du jour même de leur victoire. L'impuissance gouvernementale, — car la réalisation et la défense ne pouvaient venir que du gouvernement, — avait fait le reste. Fatigué, désorienté, sans plus d'idéal et voulant la paix à tout prix, le pays admettait naturellement sur le terrain financier ce qui paraissait la lui promettre, la lui apporter le plus sûrement, ce retour au passé qu'il avait admis déjà sur le terrain politique. Pressé par le besoin de voir renaître la prospérité nationale par n'importe quels moyens, effrayé, d'autre part, il souscrivait d'avance à ceux-ci, quels qu'ils fussent. * * *Le procès du 13 juin, qui se déroulait devant la Haute Cour de Versailles, soulignait encore au moment de sa chute l'état d'esprit du ministère[23], du Parlement et de la majorité conservatrice du pays. Le ministère se terminait ainsi, comme il avait commencé, entre le procès de juin 1848 et celui de juin 1849. Dès le début, les accusés[24] avaient
protesté. Amenés sur les bancs par un pouvoir qui,
ayant perdu toute sanction légitime, cherche à y suppléer par l'abus de la
force, nous devons au respect de la souveraineté du peuple et à notre dignité
personnelle de formuler, avant tout acte de la Cour, la déclaration suivante
: La Constitution a été violée. Tout pouvoir violateur du pacte fondamental
encourt déchéance. En dehors de ce principe, il n'y a qu'arbitraire et
usurpation. La constitution de la Haute Cour n'a pu être, ni régulièrement
proposée par le pouvoir exécutif, ni régulièrement votée par l'Assemblée
législative. Au nom du droit, la Haute Cour, ici présente, n'a pas pour nous
d'existence constitutionnelle. Les actes qui vont être accomplis par elle,
quels qu'ils soient, et quelque loyauté qui y préside, n'ont à nos yeux, pour
base, que la force et non la justice. Cela dit pour constater le droit, nous
réservons, pour ceux d'entre nous qui le jugent utile, la faculté de parler
au pays qui nous écoute, afin d'éclairer l'opinion publique et de porter une
seconde fois encore devant ce juge souverain le grand débat soulevé en juin
et non encore vidé. Madier de Montjau faisait ressortir, de son côté,
que les membres des conseils généraux, en tant que jurés, étaient les
produits d'une élection un peu spéciale. L'exception ne se faisait-elle pas
voir aussi dans le fait que les magistrats n'étaient pas ceux de la Cour d'Appel,
mais de la Cour de Cassation ? Afin de répondre, le procureur général
commençait par rappeler qu'à Bourges la juridiction avait été récusée.
Michel, en lui répliquant, s'écriait : Est-ce que je
n'avais pas le droit de discuter l'incapacité politique des hommes qui
m'écoutaient ? — Le réquisitoire débutait, au surplus, d'une manière qui
ne laissait pas de doute : La République, fondée en
1848, n'a pas tardé à rencontrer comme adversaires ces prétendus démocrates
qui, méconnaissant les règles éternelles de la vie sociale, se constituent
partout et dans tous les temps les implacables ennemis de l'ordre et des
lois... Dans cet accord de toutes les mauvaises passions, dans ce centre
commun d'insurrection et de révolte, figurent, à des titres divers, les doctrines
socialistes, la partie de la presse périodique qui leur prête son concours ;
etc. Le procureur s'efforçait de démontrer qu'il y avait complot et que celui-ci
remontait à quelques mois déjà[25]. Il pensait même
le prouver par un document : Le 4 novembre,
disait-il, le jour même du vote de la constitution,
l'association de la Solidarité républicaine, poursuivie depuis comme société
secrète, arrêtait et signait ses statuts à Paris. Le préambule et l'article 1
de ce programme, qui devait être rendu public, étaient ainsi conçus : — Considérant
que les partis contre-révolutionnaires conspirent ouvertement et s'efforcent
de ramener la monarchie, que, dans presque tous les départements, en même
temps que la République est systématiquement condamnée, les démocrates ne
peuvent, le plus souvent, trouver dans les administrations locales la
protection qui leur est due, qu'en présence d'une position aussi périlleuse,
il est du devoir et de l'intérêt de tous les républicains de former entre eux
une alliance étroite pour se protéger mutuellement et surtout pour opposer
une action unitaire à des manœuvres qui, si elles réussissaient, auraient
pour effet d'enlever à la France le bénéfice de la victoire de février et de
retarder l'émancipation générale des peuples : Art. 1er. Une association est
formée entre les républicains des départements et des possessions françaises
d'outre-mer sous le titre de la Solidarité républicaine, pour assurer, par
tous les moyens légaux, le maintien du gouvernement républicain et le
développement pacifique et régulier des formes sociales, qui doivent être le
but et la conséquence des institutions démocratiques. Ce programme si
constitutionnel et doux présentait, à en croire l'accusateur, tous les
dangers : Quels que soient ici les termes et les
restrictions apparentes, les faits ont prouvé que le but réel de
l'association était d'organiser ce qu'on est convenu d'appeler de parti
démocratique et social et de lui préparer partout des moyens d'action et de
triomphe pour le jour où la lutte deviendrait possible[26]... Défendre
l'idée républicaine en essayant de la réaliser était inadmissible. Qui,
d'ailleurs, pouvait mettre en doute l'issue du procès ? Le Parlement en
posait lui-même les prémisses ; Thiers, au moment où la Haute Cour se
constituait, déposait un rapport sur les affaires d'Italie. Quant aux accusés,
ils étaient sans illusion. Pour se débarrasser de la
République, disait l'un, on commence d'abord
par se débarrasser des républicains. Baune observait ensuite : Si l'accusation sait quelque chose, infiniment peu de
chose, c'est surtout à la franchise de nos déclarations qu'elle le doit. Si
l'on retranchait de l'acte d'accusation tout ce que nous avons dit, ou ce
qu'on nous a fait dire dans l'instruction, il serait réduit à un très petit
nombre de pages. Parmi les témoins appelés à déposer et qui reconnurent que la constitution avait bien été violée, Girardin eut des paroles énergiques. Le président Baroche voulut s'opposer à cette éloquence exacte et menaça : Requérez donc contre moi, dit le directeur de la Presse, car moi aussi, appelé par vous-même à dire la vérité, toute la vérité, je suis décidé à ne pas laisser étouffer ma parole et la vérité... Si d'autres se sont contentés de dire qu'ils croyaient la constitution violée, moi je déclare que j'en suis sûr. Appelé dans le cabinet du juge d'instruction, il y avait trouvé un substitut qui dirigeait l'instruction à sa guise, de telle sorte que le juge apparaissait bien nettement sous la haute surveillance de ce membre du parquet. Il disait aussi son rôle à la veille du mouvement, ses intentions : Je n'avais qu'une pensée, celle que j'ai eue pendant toute ma vie de publiciste. Il s'était justement entretenu la veille de la question de savoir comment les hommes d'ordre et de liberté, au nombre desquels il aimait à se compter, pouvaient faire un pont, dans des circonstances aussi difficiles, pour passer un torrent aussi impétueux que le torrent démocratique, donner à la liberté assez de garantie pour qu'il n'arrivât pas le lendemain qu'il fussent — comme ils l'avaient été au 25 février — forcés de soutenir vigoureusement la cause de l'ordre. Je me suis jeté comme on jette un roc au travers d'un fleuve. Voilà le sentiment qui m'a amené à cette réunion. Je voulais peser comme homme de liberté, comme homme d'ordre, tel que j'ai été de tout temps. Lui aussi démontrait l'absence du complot. Dans la séance du 17 octobre, le colonel de Goyon, toujours aussi mousquetaire et parfumé, parlait avec un certain orgueil de la part qu'il avait prise à la réunion de ses bons dragons, et de deux de ses prisonniers, du nom d'Hérard, l'un clerc de notaire, l'autre étudiant qui avaient, en souliers vernis, essayé d'entraîner le peuple[27]. — Guinard faisait remarquer et vérifier, d'après les dépositions mêmes des témoins, que les sommations n'avaient pas été accomplies en temps voulu. La déposition du lieutenant de gendarmerie mobile Petit précisait d'ailleurs l'état d'esprit de l'armée : ... Ces individus, qui étaient en tête de la colonne, appelaient mes soldats pour qu'ils allassent avec eux ; ils leur disaient : Nous sommes vos frères, vous ne voudrez pas vous souiller de notre sang. Pendant toutes ces simagrées, la colonne avançait. Ne voulant pas avoir le désavantage de recevoir en place cette charge, je fis les commandements nécessaires pour porter mes hommes contre la colonne au pas de charge. Nous avons passé littéralement sur le ventre de quarante ou cinquante individus qui étaient à genoux en avant. Nous avons abordé le gros de la colonne à coups de canon de fusil ; ils se sont jetés à droite et à gauche en poussant des cris : Aux armes ! Aux barricades ! On assassine nos frères ! On ne les assassinait pas, car s'ils ont reçu des blessures, c'est par derrière et avec nos bottes, que nous le leurs avons faites. Guinard, après avoir protesté contre ces paroles, indignes, disait-il, d'un officier, racontait qu'un jeune homme, à genoux, offrant sa poitrine aux baïonnettes des soldats, avait été frappé d'un coup de sabre à travers la figure, quand le témoin revendiqua hautement son acte : C'est moi, jeta-t-il fièrement, qui l'ai frappé ! Guinard s'écriait en vain : Nous avons fait la révolution de Février ; nous avons proclamé la République ; j'ai eu l'honneur d'être à la tête de la force publique et jusqu'au moment où s'est réunie l'Assemblée nationale, quand le peuple était tout-puissant, quand nous n'avions pas une force armée pour nous défendre, je défie qu'on cite un seul fait de violence contre des citoyens. Le témoin Petit se tournait vers les accusés et leurs défenseurs et leur disait : Vous êtes tous des jean foutres. Et, en dépit d'un blâme léger, infiniment discret, le procureur général ne requérait pas contre lui, mais contre les accusés. Un commissaire de police spécial racontait ainsi
l'arrestation du capitaine Laffond, de la garde nationale : Je le dirai franchement, j'étais animé. Quand je suis
entré, j'ai vu le lieutenant qui cherchait, je crois, à se cacher ; il avait
une main dans sa poche ; un instant j'ai pu penser qu'il avait un pistolet.
Je le saisis de la main gauche, retenant la main dans la poche, et comme il
fit un mouvement, sa petite épaulette se détacha. Les militaires, qui se
trouvaient ensuite dans l'escalier et qui le recevaient, voulaient le frapper
; nous le protégeâmes autant que cela fut possible ; et, enfin, il courut des
dangers quand il fut en présence de la garde nationale qui parlait de le
fusiller. Changarnier, en effet, à cause d'un simple coup de feu tiré
rue Vivienne, avait donné l'ordre d'amener cet officier qui se trouvait
passage Jouffroy, mort ou vif. — Le témoin, Alphonse Gent, résumait au mieux
la véritable tendance de la manifestation, telle qu'elle avait été voulue et
rêvée par la plupart, et soulignait ainsi encore le parti pris presque
continuel de l'accusation : Je savais personnellement
que la Chambre ne se réunissait pas ce jour-là... Je ne voulais pas voir se
renouveler cette déplorable, cette abominable journée du 15 mai. Je ne
voulais, moi, qu'une chose, que la population de Paris, en dehors de l'époque
des élections, avant 1852, pût voter son véto, exprimer au gouvernement qui
nous dirige l'opinion qu'elle avait sur la malheureuse expédition romaine ;
je voulais qu'elle pût venir dire que la constitution avait été violée,
qu'elle pût dire : Moi qui suis la population de Paris, qui ai donné tant de
gages à la liberté, qui suis la population du 24 février, je vous avertis
qu'il y a violation de la constitution. — La déposition du secrétaire
de la réunion de la Montagne rappelait le caractère des républicains de
gauche : Parmi les hommes qui composaient la
Montagne, quelques-uns avaient plus positivement peut-être la science des
idées sociales, mais tous en avaient au même degré le sentiment. Tous étaient
étroitement liés par un même amour de la République, tous marchaient unis
autour d'un même drapeau : le programme dans lequel ils avaient exposé leurs
principes. La Montagne avait pour la forme républicaine un dévouement, une
sollicitude inouïs. Aussi, toutes les fois que les événements pouvaient
inspirer des craintes pour la République, la réunion était on ne peut plus
émue. — Guinard disait, avec un accent inimitable de vérité : Permettez, monsieur le procureur général, n'équivoquez pas
avec moi ! Si j'avais voulu faire une insurrection, je vous le dirais. L'un
de MM. les magistrats qui siègent devant moi et avec qui j'ai eu affaire dans
ma jeunesse, peut déclarer que jamais je n'ai dissimulé aucune de mes
intentions. Si j'avais voulu engager la bataille, cette fois aussi bien que
dans d'autres circonstances, je vous le dirais aussi franchement que je
l'aurais fait. Et comme l'avocat général déclarait ne pas comprendre
que les artilleurs et Guinard se fussent donné la main[28], il répondait : C'est que, quand je rencontrais les artilleurs, nous nous
serrions fraternellement la main. Nous nous aimions tous dans l'artillerie.
Je ne suis pas arrivé froidement au milieu d'eux, parce que toutes les fois
qu'une occasion nous réunissait, nous nous abordions avec autant de
fraternité que peuvent le faire des amis. Je n'ai rien fait, ce jour-là, que
je n'eusse fait dans d'autres circonstances. Cette fraternité, de par les événements n'était plus de
mise aux yeux du tribunal, qui l'estimait suspecte ; aussi toute la
déposition de Guinard, qui prouvait non seulement sa bonne foi, mais encore
surabondamment l'absence du complot[29], se trouvait-elle,
d'avance en quelque sorte, récusée. L'effort de la Cour contre les accusés
s'affirmait de plus en plus au long des débats. Les juges cherchèrent même à
tourner en ridicule Ledru-Rollin et ses amis au sujet de leur fuite des
Arts-et-Métiers, à un tel point que Michel de Bourges répondit au sentiment
général de l'assistance quand il s'inscrivit contre un procédé aussi
inadmissible[30].
A ce procès politique, l'inévitable agent destiné à charger les accusés ne
manquait naturellement pas. On l'avait déjà vu à Bourges. Il arborait le nom
de Grégoire[31]
et la qualité de médecin. D'après une déposition[32], il semblait
même avoir joué au 13 juin, dans une certaine mesure, le rôle d'agent
provocateur[33].
Le témoin qui accusait les accusés se répétait dans la personne d'un nommé
Goubeau. Il y avait encore l'officier-mouchard, le capitaine Thénon, auteur
de rapports sur ses chefs, ses subordonnés, —
ou même ses amis. Pendant le procès de Versailles s'était terminé celui de Strasbourg, sur la même affaire, mais par un acquittement que ratifia le jury de Metz. La défense le fit observer, puis toucha une question palpitante : Je présente des conclusions formelles, dit Michel de Bourges, pour que la Cour me permette de plaider devant elle ce principe conforme à la raison, à la tradition, à la science, à la civilisation et, ce qui vaut mieux, à la Constitution : à savoir que quiconque, en France, président de la République ou garde champêtre, magistrat ou huissier, se permet de porter la main sur la constitution, de la violer, dans son esprit et dans sa lettre, est un criminel de lèse-majesté populaire et qu'à l'instant même le droit d'insurrection, le droit de protestation et le droit de résistance sont ouverts. Bien peu furent libérés. Guinard et seize des accusés présents étaient condamnés à la déportation, ainsi que les accusés contumaces. — On se demande par suite de quelle surprenante lacune morale et intellectuelle Barrot a pu écrire dans ses Mémoires[34] : Il faut relire les débats pour bien connaître les mœurs et les habitudes d'esprit et de langage de ce parti. On y retrouve ce mépris de toute justice, même de celle qui offre le plus de garanties aux accusés, cette haine sauvage contre tout devoir, ce mépris de toute convenance... A Lyon se poursuivait, d'autre part, l'instruction de la
révolte qui y avait suivi le 13 juin. Les magistrats de l'ordre judiciaire
dirigeaient la procédure, et le conseil de guerre ne semblait là que pour
ratifier ou alourdir même la condamnation. Ici encore, la justice se montrait
acharnée à vouloir découvrir un complot ; et les ramifications, d'ailleurs
bien moins profondes qu'il n'était dit, de l'insurrection lyonnaise avec les
départements voisins, servaient à étayer, tant bien que mal, l'accusation.
Boussac, centre de socialisme, par l'œuvre et l'influence de Pierre Leroux,
était spécialement visé, des lettres ayant été saisies dans lesquelles les
militants de Boussac assuraient ceux de Lyon qu'ils étaient prêts à se
joindre à eux. La complicité était évidente,
conclut à ce sujet encore Odilon Barrot, et
cependant le juge de Lyon n'avait envoyé à son collègue qu'un mandat
facultatif et dont ce dernier n'aurait à faire usage que si l'interrogatoire
qu'il ferait subir aux prévenus ne détruisait pas la charge de complicité qui
pesait sur eux, ce qui se réalisa, car ce juge délégué fit exécuter le mandat
d'amener[35].
Pierre Leroux protesta au Parlement et, appuyé dans cette façon de voir par
plusieurs avocats du barreau de Paris, taxa d'illégalité la procédure suivie,
à raison de l'incompétence du conseil de guerre, pour juger des citoyens
domiciliés dans une ville qui ne se trouvait pas dans la circonscription de
la 19e division militaire, mise en état de siège, et sur ce que la prévention
reposait uniquement sur des lettres qui n'avaient pu être interprétées qu'en
violation du secret des lettres. Pierre Leroux faisait appel au respect de la
loi et des garanties individuelles bien inutilement. Il n'était même pas
écouté ; les protestations couvraient sa voix et
les députés lui tournaient le dos. Ils s'étonnaient même que le président du
conseil prît la peine de lui répondre. La France pouvait se demander déjà s'il existait encore un Parlement. Le soin le plus constant de ses membres semblait d'y gaspiller le temps. Au lieu d'entrer résolument dans la discussion sérieuse des affaires, ils s'éparpillaient dans les bureaux le long de longs discours, de telle sorte que les grandes questions politiques, avant d'arriver au public, subissaient un tamisage la plupart du temps excessif. D'ailleurs on ne s'étonnait pas de la faiblesse de l'Assemblée, parce qu'on en savait les causes, l'Assemblée ayant été élue à une époque où l'on espérait la voir recueillir le dernier souffle de la République ; déçue, sa majorité poussée, de plus, par les événements de Juin à une violence qui lui plaisait, elle avait espéré de nouveau ; puis, déçue encore, retournant dans les départements où pendant deux mois elle put étudier le mouvement des esprits, elle y avait constate un certain calme et elle s'était même demandé si une nouvelle classification des partis n'allait pas se faire. Aussi hésitait-elle, et cette hésitation ajoutait encore à la confusion du mouvement qu'elle était impuissante à arrêter comme à conduire. Certains prétendaient constater un progrès de l'idée socialiste et ce sentiment, plus répandu d'ailleurs à cette date qu'on ne l'a dit, changeait la tactique réactionnaire ; les uns, les plus prudents, cherchaient à reculer l'heure des concessions ; les autres, persuadés que le suffrage universel amènerait aux prochaines élections le triomphe du parti populaire, rêvaient de supprimer le suffrage universel. — Pour conduire jusqu'aux élections générales les éléments compromis du gouvernement actuel en franchissant sans accident les trois années qui restaient à courir jusque-là, le ministère devait s'appuyer sur la gauche, et, jouant du découragement de la partie la plus modérée de la droite, inaugurer une politique de transaction ; mais cette seule chance de salut était impraticable ; d'abord, il ne la voulait pas, redoutant jusqu'au mot de socialisme. La gauche ne comptait plus, ce qui en restait refuserait, et la partie la plus modérée de la droite rêvait, elle aussi, l'impossible. — La démocratie républicaine en était réduite à des vœux platoniques. Quant à nous, disait-elle dans un de ses organes encore admis, qui connaissons la force de nos doctrines et qui savons que le temps combat en notre faveur, nous faisons des vœux sincères pour que les révolutions extrêmes soient évitées au pays, pour que les Thiers et les Molé ne s'engagent pas en 1850 dans les voies déplorables suivies en 1830 par M. de Polignac, en 1848 par M. Guizot, et qui, aujourd'hui, conduiraient ce pays ruiné jusque dans ses profondeurs à des résultats bien autrement formidables[36]. Cette crainte explique déjà justement l'adhésion soit enthousiaste, soit muette, soit résignée, de la France réactionnaire, ou simplement bourgeoise, au 2 décembre, de même que la lutte de juin explique celle du prolétariat. La liquidation était générale. La volonté réactionnaire était déjà telle que l'on arrêtait des marchands de journaux parce qu'ils portaient sous leurs bras leurs paquets de journaux au lieu de les tenir cachés, ainsi que l'ordonnait le préfet Rébillot. — Le National — mais faut-il le croire ? — prétendait que des hommes de police guettaient au passage le citoyen sortant du bureau d'un journal afin de s'assurer, en le fouillant, qu'il n'avait pas dans sa poche un ou plusieurs exemplaires de tel ou tel écrit périodique ; ils lui demandaient ensuite, s'il en avait, ce qu'il en voulait faire et l'arrêtaient même sous prétexte qu'il ne pouvait avoir d'autre intention que celle de les vendre. La loi portait simplement que nul ne pourrait vendre des journaux sur la voie publique s'il n'était porteur d'une autorisation préalable. — Moins que tout autre, parce qu'il repose essentiellement sur le droit et la vérité, parce qu'il est là pour représenter et manifester les nécessités sociales de la nation, ainsi que pour en remettre la force aux mains de ceux qui savent les reconnaître et les satisfaire, le gouvernement représentatif ne peut être faussé dans son principe ; il a besoin d'exactitude ; faute de cette réalité constante, il tourne à vide. Il ne peut, en effet, alors former sans cesse,— en le renouvelant s'il le faut, — le gouvernement qui convient au pays ; le ministère, composé par une Chambre qui n'est pas l'émanation vraie du pays, ne puise dans celle-ci ni énergie, ni habileté, ni raison d'être. Si, en face de cette diminution parlementaire, un homme est là, qui comprenne bien les nécessités nationales, comment ne viendrait-il pas à bout d'une Assemblée dévoyée ? Comment, au contraire, ne serait-il pas soutenu par une Assemblée sincère ? Un tel homme devient alors inéluctable, au point que, s'il ne se mettait pas en avant de lui-même, c'est le Parlement qui le chercherait, qui le créerait au besoin. — D'un côté ou de l'autre, Louis-Napoléon, moyen de transaction, s'imposait par suite des fautes commises. * * *Nous avons vu comment les débats sur l'affaire romaine avaient précipité la crise. Le ministère, à force d'avoir exécuté la besogne réactionnaire de la majorité, était usé par elle comme ne répondant plus suffisamment aux vœux croissants qu'elle affirmait nécessaire de réaliser. Sur ce point, il y avait accord, quoique pour des raisons différentes, entre le président et la majorité législative : l'un et l'autre, gênés par le ministère, le voulaient voir disparaître[37]. La majorité se montrait d'autant plus implacable qu'elle avait obtenu davantage. Ses chefs attaquaient sourdement Barrot dans les couloirs et à mots couverts dans leurs journaux. Et l'aveu suivant, venu de Barrot même, n'est pas sans saveur : On nous reprochait d'avoir trop de ménagements pour le parti républicain ; c'était là le grand grief. M. Dufaure ne destituait pas tous les préfets et sous-préfets qu'on lui signalait comme étant restés fidèles à leurs opinions républicaines, et moi-même je conservais quelques magistrats du parquet entachés de cette opinion[38]. Agacé par d'innombrables coups d'épingle, désireux d'en avoir le cœur net, Barrot pria Louis-Napoléon d'appeler Thiers et Molé à une conférence à laquelle il assisterait. Louis-Napoléon consentit. Barrot, loyalement, dit alors à Thiers et à Mole qu'il n'ignorait pas ce qui se disait dans des conciliabules et que, s'ils étaient parfaitement libres d'approuver ou non la politique suivie, ils avaient du moins le devoir de remplacer le ministère qu'ils voulaient détruire ; il ajoutait qu'il les savait trop pénétrés des principes du gouvernement parlementaire pour admettre qu'ils ne fussent pas prêts à prendre eux-mêmes le pouvoir. Un peu surpris, les deux routiers se défendirent de toute idée d'opposition et, après avoir protesté de leur bonne foi contre les attaques qui venaient de leur être imputées, assuraient-ils, à tort, ils déclarèrent qu'ils n'étaient nullement disposés à revenir aux affaires. Louis-Napoléon se taisait. Lorsque Thiers et Molé furent partis, il dit à son ministre : Croyez-vous que si M. Thiers vous eût pris au mot et avait consenti à devenir ministre, j'aurais consenti, moi, à lui confier un portefeuille ?... Si vous l'avez cru, vous vous seriez étrangement trompé !... Thiers n'avait plus envie, maintenant, de devenir ministre d'un président de la République qu'il pensait ébranlé au point d'escompter même sa chute prochaine ; il se voulait son successeur. Si l'on en croit Barrot : il ne se rendait peut-être pas bien compte de ses propres sentiments, mais il eût été satisfait de diriger le ministère et de posséder la réalité du pouvoir sans en avoir les responsabilités[39]. Peut-être Molé, en tout cas, plus modeste, eût sans doute accepté un portefeuille. Barrot, quant à lui, ne voulait pas passer auprès de l'opinion publique pour être l'instrument de Thiers, risquant, en ce cas, de perdre, à l'instant même, non seulement toute force morale et politique, mais toute considération[40]. Il connaissait cette situation presque impossible, qui consiste à soutenir un ministère qu'on ne dirige pas, l'ayant vécue sous Louis-Philippe, en 1840, lorsque Thiers, justement, présidait le conseil. Pour l'instant, il lui apparaissait qu'il s'était trompé de voie en recherchant cette explication avec les deux chefs du parti conservateur, et il estimait qu'il eût été plus politique de s'adresser au Parlement même, en provoquant un débat dans lequel il aurait invité les adversaires de sa gestion à détailler leurs griefs ; vis-à-vis du prince, il se sentait diminué, battu. Comme il jouait un double jeu qui, du reste, lui a réussi, en même temps qu'il cherchait un conflit avec la majorité, qu'il me reprochait mes ménagements pour elle, il accueillait, il encourageait peut-être ses plaintes, ses griefs contre nous ; et il est bien certain que ce sont les dispositions des chefs de cette majorité qui le décidèrent à frapper le coup qu'il n'aurait jamais osé frapper s'il n'eût su d'avance qu'il trouverait des approbateurs, sinon dans la généralité des membres de l'Assemblée, du moins dans quelques-uns de ses principaux meneurs[41]. Il ne semble pas que le président du conseil ait compris, dans son examen de la question, le sens pourtant si clair du départ de Falloux. Il ne paraît pas davantage qu'à ce moment il se soit souvenu des griefs nombreux que son attitude avec le président aurait pu faire naître chez lui. Il oubliait enfin le chemin parcouru depuis le début du ministère. Jamais Louis-Napoléon n'aurait osé ce que, depuis deux mois, il était décidé à se permettre. Barrot le vit bien, le 12 octobre, quand Louis-Napoléon, sous prétexte que les finances ne lui permettaient pas de nourrir autant d'officiers de garde, renvoya la garde nationale de l'Elysée et réduisit à cent les trois cents hommes de la ligne. Barrot, soutenu par le prince Murat, protesta ; mais le prince ne céda que sur la garde nationale, et on put pressentir qu'il le faisait momentanément[42]. Les temps étaient bien changés. Persigny, revenu de Prusse depuis peu, disait sans ambages chez le comte Molé qu'il n'y avait de salut pour la France que dans la restauration de l'Empire ; un sénat, un conseil d'État, des fonctionnaires largement rétribués étaient indispensables. Persigny entreprenait même un légitimiste, M. d'Havrincourt, pour lui prouver la nécessité de sauver le pays en faisant le prince empereur. La gloire de César, disait-il entre autres choses, a fait régner ses descendants quatre cents ans. Le secrétaire de la Chambre, Heeckeren, déclarait dans la même soirée qu'il fallait chasser la Chambre. — Les événements semblaient leur donner raison. En allant inaugurer le chemin de fer de Paris à Sens, le
prince-président avait continué de recueillir les encouragements les plus
enthousiastes. A Brunoy, il avait passé la revue des gardes nationaux au
milieu des acclamations, dans une prairie ornée
d'oriflammes, de banderoles tricolores et d'immenses jardinières chargées de
fleurs[43].
Il apparaissait le prince charmant[44], l'aboutissant
même, et prouvé indispensable désormais, du romantisme politique. A Melun, il
avait répondu au curé : C'est avec confiance que je
place mon gouvernement sous la protection de Dieu. A Montereau, à
Fontainebleau, nouvelles revues de la garde nationale qui l'acclame avec
frénésie. A Sens, l'évêque s'était écrié : Bénissez,
mon Dieu, celui qui, par vous, a obtenu six millions de suffrages librement
exprimés. Lemaire, au banquet, l'avait également encensé : Voyez, sa seule présence ici a déjà réveillé dans nos
patriotiques populations toutes les idées de gloire, tous les nobles
sentiments d'un passé dont l'immortelle tradition doit faire à tout jamais
l'orgueil des fiers enfants de la France... Et le prince avait répondu
: Il y a un an, à pareille époque, j'étais exilé,
proscrit... Aujourd'hui, je suis le chef reconnu de la grande nation... Qui a
produit ce changement dans ma destinée ? C'est le département de l'Yonne...
Vous vous êtes dit que, étranger à tous les partis, je n'étais hostile à
aucun et qu'en réunissant sous le même drapeau tous les hommes dévoués à
notre patrie, je pourrais servir de point de ralliement dans un moment où les
partis semblaient acharnés les uns contre les autres. Les Débats
avaient dit mélancoliquement au sujet de nombreux cris de : Vive l'Empereur ! — Après
les excès de l'anarchie, le peuple se jette dans les excès contraires et,
quand on l'a saturé de désordre, il finit par demander plus que l'ordre. A
qui la faute ? Partout Louis-Napoléon avait été accueilli avec le même
enthousiasme : à la revue de l'infanterie de Paris, passée au Champ-de-Mars
au début d'octobre, comme au régiment de dragons du quai d'Orsay, inspecté le
10 du même mois, en compagnie de Fleury et de Laity ; puis dans les ateliers
du faubourg Saint-Antoine, chez un opticien, chez Durenne, fabricant de
machines, chez Masson fabricant de faïences, chez Krieger, fabricant,
d'ébénisterie, enfin, le 19, à la cité ouvrière du IIe arrondissement,
organisée sous son patronage. Odilon Barrot, se faisait-il encore réellement
illusion ? Physiquement, le président du conseil était à bout. Une rechute l'avait forcé de garder le lit dans sa propriété de Bougival. Le médecin l'avait seulement autorisé à se lever pour le 30 novembre, date de l'installation de la magistrature, cérémonie pour laquelle il aurait même fait faire une simarre toute neuve ; son discours était prêt[45]. Il ignorait à peu près les événements, renseigné seulement par une lettre de Tocqueville, et ne pouvait agir[46]. Sa maladie servait à merveille l'intrigue du président qui, sans scrupule, et aidé à ce sentiment par l'intéressé, utilisa le propre frère de Barrot, qui occupait à l'Elysée le poste de secrétaire général de la présidence[47]. Ferdinand Barrot joua le rôle d'intermédiaire entre le président et les chefs de la majorité ; ce serait même lui qui aurait recruté dans les rangs obscurs de la majorité de l'Assemblée les ministres convenant au rôle du nouveau ministère- ; il devait, pour sa part, recevoir le portefeuille de l'Intérieur et succéder à Dufaure. Barrot, comme le pays, fatigué, s'en remettait au destin quand il vit un jour entrer chez lui Edgar Ney, que le président aimait à charger de ses missions importantes[48]. En même temps qu'il remettait au malade une lettre de son maître, il déposait sur le lit une grande boîte, dont il retirait les insignes du grand cordon de la Légion d'honneur. Louis-Napoléon, peut-être avec une vague sincérité[49], s'expliquait ainsi : Vous connaissez depuis si longtemps les sentiments de haute estime que je vous porte qu'il vous sera facile de comprendre combien je suis peiné de penser qu'il faut que je vous demande votre démission, comme je l'ai demandée ce matin à vos collègues. J'aurais bien désiré que vous voulussiez rester dans une nouvelle combinaison, car je ne pourrai jamais retrouver un talent aussi élevé que le vôtre, joint à un dévouement aussi pur ; mais je sais que vous ne voulez pas vous séparer de vos collègues et, dans les circonstances actuelles, je crois qu'il faut absolument que je domine tous les partis en prenant des ministres qui n'en représentent aucun. Je regrette d'autant plus d'être conduit par la force des choses à cette décision que j'aurais voulu que vous pussiez présider à la cérémonie du 3 novembre ; car là, comme partout ailleurs, on vous succède sans vous remplacer. Mais, d'après l'inquiétude qui se manifeste, il faut faire cesser tous les bruits qui se répandent, et ce soir je : compte faire connaître à l'Assemblée, par un message, la liste du nouveau ministère. Je sais, mon cher Monsieur, que la meilleure récompense à vos yeux, pour les services éminents que vous avez rendus au pays, consiste dans l'estime et la reconnaissance générale ; mais je veux y joindre la mienne propre, en vous envoyant ce grand cordon de la Légion d'honneur... Le malade répondit de suite en remerciant le président de le délivrer d'un fardeau qu'il avait si souvent voulu déposer et en l'assurant de sa reconnaissance pour les témoignages d'estime dont il l'assurait en y ajoutant un gage éclatant ; néanmoins, pour toute faveur, il demandait la permission de le refuser en restant jusqu'au bout fidèle à lui-même comme au pays[50]. Il désirait plus que personne, ajoutait-il, voir le président dominer tous les partis. Il quittait peut-être le pouvoir, sinon sans regret, du moins avec le sentiment du repos prochain. Sa mère et sa belle-mère, en revanche, ne partageaient pas sa sérénité[51]. Une pareille réponse était attendue, sauf le refus du cordon : tous les décrets étaient prêts à figurer dans le Moniteur du lendemain. Le prince avait sans doute escompté que Barrot ne remarquerait pas, d'abord, qu'en acceptant la Légion d'honneur il se séparait avec éclat de ses collègues et donnait une sorte d'adhésion directe à la nouvelle politique du président. Le doute n'était pas permis à l'égard de celle-ci. Dufaure et Tocqueville abandonnèrent leurs dernières réticences quand on leur apporta le message envoyé par le prince-président à l'Assemblée et par lequel le successeur de Napoléon déchirait un nouveau rideau. Il s'avançait sur la scène. Le Parlement saurait désormais que l'Elysée entendait exercer le pouvoir sans intermédiaires gênants. Le gouvernement personnel dépassait aussi le jeu constitutionnel et créait dans la constitution un danger et une impossibilité de plus[52]. Gouvernez, avait dit le pays en décembre 1848 et au début de 1849 ; Louis-Napoléon répondait : Me voici ; cette fois l'expérience est faite ; il paraît bien prouvé que je suis nécessaire. Le message était une porte ouverte sur le coup d'État, une réponse à l'opinion publique qui, en majorité, se déclarait favorable à celui-ci ; réactionnaire, et pour faire réussir cette réaction, éduquée sur ce point par son manque de scrupules et par la révolution récente, cette opinion publique ne reculait devant aucun moyen afin de s'assurer la prééminence ; elle était emportée par sa passion brutale et sans intelligence, au point qu'elle ne s'apercevait pas qu'elle servait une autre cause que la sienne. Cependant on discuta beaucoup sur la crise, à la recherche du sens exact qu'il fallait lui donner. On parlait, avec de plus en plus de vraisemblance, semblait-il, de coup d'État. Dans certains milieux politiques, c'étaient des exclamations, des menaces, des cris de guerre, qui trahissaient des frayeurs qu'on ne savait pas cacher[53]. Monsieur le Président, disait Louis-Napoléon, dans
les circonstances graves où nous nous trouvons, l'accord qui doit régner
entre les différents pouvoirs de l'État ne peut se maintenir que si, animés
d'une confiance mutuelle, ils s'expliquent franchement vis-à-vis l'un de
l'autre. Afin de donner l'exemple de cette sincérité, je vais faire connaître
à l'Assemblée quelles sont les raisons qui m'ont déterminé à changer le
ministère et à me séparer d'hommes dont je me plais à proclamer les services
éminents, et auxquels j'ai voué amitié et reconnaissance. Pour raffermir la
République menacée de tant de côtés, par l'anarchie, pour maintenir à
l'extérieur le nom de la France à la hauteur de sa renommée, il faut des
hommes qui, animés d'un dévouement patriotique à toute épreuve, comprennent
la nécessité d'une direction unique et ferme et d'une politique nettement
formulée, qui ne compromettent le pouvoir par aucune irrésolution, qui soient
aussi préoccupés de ma propre responsabilité que de la leur, et de l'action
que de la parole. Depuis bientôt un an, j'ai donné assez de preuves
d'abnégation pour qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions véritables.
Sans rancune contre aucune individualité, contre aucun parti, j'ai laissé
arriver aux affaires les hommes d'opinions les plus diverses, mais sans
obtenir les heureux résultats que j'attendais de ce rapprochement : au lieu
d'opérer une fusion de nuances, je n'ai obtenu qu'une neutralisation de
forces. L'unité de vues et d'intentions a été entravée, l'esprit de
conciliation pris pour de la faiblesse. A peine les dangers de la rue
étaient-ils passés, qu'on a vu les anciens partis relever leurs drapeaux,
réveiller leurs rivalités, et alarmer le pays en semant l'inquiétude. Au
milieu de cette confusion, la France, inquiète parce qu'elle ne voit pas de
direction, cherche la main, la volonté de l'élu du 10 décembre. Or cette
volonté ne peut être sentie que s'il y a communauté d'idées, de vues, de
convictions entre le président et ses ministres, et si l'Assemblée elle-même
s'associe à la pensée nationale dont l'élection du pouvoir exécutif a été
l'expression. Tout un système a triomphé au 10 décembre, car le nom de
Napoléon est a lui seul un programme ; il veut dire, à l'intérieur, ordre,
autorité, religion, bien-être du peuple ; à l'extérieur, dignité nationale ;
c'est cette politique inaugurée par mon
élection, que je veux faire triompher, avec l'appui de l'Assemblée nationale
et du peuple. Je veux être digne de la confiance de la nation, en maintenant
la constitution que j'ai jurée. Je veux inspirer au pays, par ma loyauté, une
confiance telle que les affaires reprennent et qu'on ait foi dans l'avenir.
La lettre d'une constitution a sans doute une grande influence sur les
destinées d'un pays ; mais la manière dont elle est exécutée en exerce
peut-être une plus grande encore. Le plus ou moins de durée du pouvoir
contribue puissamment à la stabilité des choses : mais c'est aussi par les
idées et les principes que le gouvernement sait faire prévaloir que la
société se rassure. Relevons donc l'autorité sans inquiéter la vraie liberté
; calmons les craintes en domptant hardiment les mauvaises passions et en
donnant à tous les nobles instincts une direction utile ; affermissons le
principe religieux sans rien abandonner des conquêtes de la religion, et nous
sauverons le pays, malgré les partis et même les imperfections que nos
institutions pourraient renfermer. — Louis-Napoléon. Y avait-il même une sorte de secrète entente entre l'Élysée et le président de la Chambre ? — Le message fut apporté, à la fin de la séance, par un aide de camp qui le remit lui-même à M. Dupin. On était en train de discuter un projet sans grande importance, et, à la vue de l'envoyé, le silence fut immédiat. On avait déjà compris. — Aussitôt la dernière phrase, la séance fut levée, comme afin de parer à l'émotion parlementaire. Celle-ci fut d'ailleurs vive, de l'aveu même du Moniteur[54]. En somme, il ne s'agissait plus seulement de maintenir l'ordre, mais de barrer la route à certaines tentatives monarchiques, plus ou moins dessinées ; de là venait la nécessité d'hommes nouveaux, sans passé politique marquant. Le prince, en agissant ainsi, faisait sienne, aux yeux de la nation, ce qui était alors la donnée nationale, et comme il le faisait un peu contre la Chambre, à nouveau, il se mettait à dos la Législative qu'il avait d'abord servie, comme il s'était mis à dos la Constituante. — Le message était une lettre à Edgar Ney à l'intérieur, bien autrement sérieuse par les conséquences qu'elle comportait comme par les prétentions qu'elle voilait encore tout en les laissant pressentir[55]. Le ministère renversé avouait son mécontentement. Il
entendait demander des explications sur les passages qui renfermaient, en
effet, des critiques assez vives à son égard. — Barrot a rapporté ainsi les
griefs de ses collègues : Quoi, disaient-ils
avec une certaine amertume, c'est pour raffermir la
République menacée par les partis et par l'anarchie, pour assurer l'ordre
plus efficacement, pour maintenir le nom de la France à la hauteur de sa
renommée que le président déclare qu'il nous a donné des remplaçants ; il
nous impute donc d'avoir livré la République aux intrigues des partis et à l'anarchie,
de n'avoir pas suffisamment défendu la cause de l'ordre et d'avoir abaissé le
nom et l'honneur de la France ! Qu'après cela il veuille bien proclamer que
nous avons rendu des services éminents, ce n'est qu'une contradiction de
plus, mais qui laisse subsister le reproche dans toute sa force. Nous lui
demanderons à notre tour qui a fermé les clubs, refréné par une législation
vigoureuse les violences de la presse démagogique, qui a triomphé de
l'insurrection du 13 juin ? Vous prétendez que nous ne sommes pas parvenus à
rendre la sécurité à la société, mais voyez le taux des rentes, la reprise
générale des affaires, l'affluence des étrangers dans nos cités, la brillante
exposition dans laquelle vous signaliez naguère et avec raison, un symptôme
éclatant du retour de la confiance ; voyez le calme parfait dans lequel se
sont écoulés les deux mois de prorogation de l'Assemblée. Mais en voulez-vous
un témoignage plus éclatant encore ? C'est vous qui nous le fournirez par.
l'acte même que nous discutons. Auriez-vous eu, il y a dix mois, le courage
et la confiance de signifier à l'Assemblée que désormais il ne doit plus y
avoir qu'une seule direction et une volonté à laquelle ministres et
représentants doivent se soumettre ? Mais ce qui nous blesse plus encore,
c'est le reproche plus directement formulé dans le message d'avoir compromis
le pouvoir par nos irrésolutions, de nous être plus préoccupés de la parole
que de l'action et d'avoir plus songé à notre responsabilité propre qu'à
celle du président. Dans quelle circonstance avons-nous donc hésité à armer
le pouvoir, citez-en une seule ? Depuis l'état de siège jusqu'à la répression
la plus sévère et la plus prompte de toute violence, soit par acte, soit par
parole, nous n'avons marchandé à la société aucune mesure capable de la
défendre et de la rassurer. Ne sont-ce donc que de vaines et stériles paroles
? Oui, sans doute, nous avons beaucoup parlé, mais la tribune n'était-elle
pas aussi un champ de bataille sur lequel se disputaient les destinées de la
société ? Et lorsque vous écriviez à notre président que le discours avait
sauvé l'ordre, ne reconnaissiez-vous pas que, dans la situation donnée,
parler c'était agir ? Et quant à votre responsabilité, l'avons-nous négligée,
quand nous vous couvrions contre les irritations de l'Assemblée Constituante
que provoquaient vos défis imprudents, lorsque nous vous défendions contre
les accusations et les outrages de la Montagne ; lorsque nous revendiquions
hardiment votre autorité dans les empiétements d'une Assemblée souveraine ?
Dans tous les cas, nous vous laissons aujourd'hui un pouvoir bien autrement
affermi et respecté qu'il ne l'était avant votre ministère ; et puis, qui
est-ce qui a pu vous autoriser à nous adresser cette accusation d'avoir
abaissé le nom et l'honneur de la France ? Est-ce lorsque nous avons signifié
à l'Autriche, enivrée de sa victoire de Novare, d'avoir à s'arrêter dans sa
course victorieuse et de ne retenir ni même occuper un seul pouce du
territoire piémontais ? Est-ce qu'en nous interposant entre Rome et cette
même puissance, nous lui avons interdit de se mêler des affaires de la
papauté ?... — La querelle remontait plus haut, au principe même de
l'élection du 10 décembre, à l'attitude du ministère au début, puis de suite,
à cette journée du 13 juin qui avait exagéré l'antagonisme latent. A partir
de cette date, la Chambre n'avait guère cessé de prendre de plus en plus
ombrage du président de la République, de cette force et de cette popularité
qui s'affermissaient. Barrot ajoutait : Mes amis étaient
très animés et très résolus, et pour moi je partageais trop leurs sentiments
pour les dissuader ; je ne pouvais que regretter de ne pouvoir me trouver à
leurs côtés dans cette discussion qui n'eût pas manqué d'être intéressante et
surtout instructive, car il eût été bien difficile que la question
constitutionnelle ne se posât pas ; et, sur cette question, l'opinion de MM.
Dufaure et de Tocqueville, qui avaient mis tant de soin à faire ressortir,
lors de la rédaction et de la discussion de la Constitution, le rôle
important et décisif qu'était appelé à jouer un cabinet sérieusement
responsable pour l'accord et la garantie mutuelle des deux grands pouvoirs de
l'État, ne pouvait qu'avoir une grande autorité[56]. Ce débat, qui semblait inévitable, n'eut pourtant pas lieu. Le lendemain du message, la liste des nouveaux ministres apparaissait au Moniteur. Chaque nom répondait à merveille à la pensée du message. Les ministres ne représentaient aucun parti ; ils représentaient même si peu de chose que, sans Louis-Napoléon, ils n'eussent rien signifié. Le prince-président consentait les ministres qu'il lui fallait avoir, mais ne voulait pas avoir un ministère. Il n'y avait même pas de président du conseil. D'Hautpoul, nouveau ministre de la Guerre, qui devait prendre la parole à l'Assemblée le 4 novembre, afin de présenter le programme de ses collègues, se trouvait prêt, en somme, au rôle nécessaire ; ses campagnes variées, mais unanimement déférentes aux régimes divers auxquels il les avait vouées, portaient garants de sa soumission et de sa souplesse. Désigné pour aller à Rome afin d'y remplacer le général Rostolan et M. de Corcelles, il était venu à Bougival, la veille de sa nomination, recevoir les dernières instructions de Barrot et, pendant la longue conférence qu'il avait eue avec lui, il ne dit pas un mot qui révélât le plan de l'Elysée. C'est le 28 octobre au soir que le prince-président avait dépêché vers le député de l'Aude, au moment où il rentrait du Parlement, un de ses aides de camp pour le prier de se rendre sur-le-champ à l'Élysée. D'Hautpoul avait demandé le motif de cette prière si pressante ; l'aide de camp, après l'aveu de son ignorance, appuya celle-ci en ajoutant qu'il avait une voiture à la porte. A l'Élysée, le prince-président avait fait entrer d'Hautpoul dans un cabinet et, à brûle pour point, lui déclara qu'il avait l'intention formelle de changer son ministère : Je vous ai fait appeler parce que je veux composer avec vous un nouveau cabinet. D'Hautpoul avait protesté : Vous n'y pensez pas, Monseigneur, je ne suis pas un homme politique, il m'est tout à fait impossible de remplir une pareille tâche. Le prince le prit alors par le bras et l'emmena dans le jardin de l'Élysée. Longtemps les deux hommes discutèrent et il était nuit close quand il leur fallut rentrer. La lutte aurait duré : encore. D'Hautpoul était désolé de ne pas remplir sa mission à Rome. Il céda néanmoins. Louis-Napoléon cita plusieurs noms en ajoutant qu'il ne tenait qu'à deux et que pour les autres le choix était libre ; puis il ajouta, comme son interlocuteur lui nommait à son tour quelques personnes : Assurez-vous de leur acceptation et demain matin, à neuf heures, vous viendrez me rendre réponse. Il était près de neuf heures. D'Hautpoul traversa les salons où plus de trois cents personnes invitées à dîner s'impatientaient et rentra vite écrire à différents hommes politiques en les priant de se rendre chez lui le lendemain matin à huit heures. Tous furent exacts. Tous consentirent à ce qui leur fut demandé. A l'Élysée, à neuf heures, d'Hautpoul remit au président la liste des acceptations avec l'indication de chaque ministère. Tout fut agréé. Puis Louis-Napoléon se demanda : Comment vais-je faire pour prévenir l'ancien cabinet ? Je pense que je vais leur écrire. — Je lui répondis, a raconté d'Hautpoul, que puisqu'il devait y avoir conseil le jour même à midi, il me paraissait plus convenable de laisser arriver les ministres et que là, après les avoir remerciés de leurs services, il leur ferait part de sa résolution. La chose se passa ainsi. Les anciens membres du cabinet se retirèrent immédiatement. A deux heures, j'arrivais avec les nouveaux ministres. Il fut convenu qu'un nouveau décret allait paraître immédiatement dans un Moniteur extraordinaire et serait envoyé à l'Assemblée[57]. Les autres ministres étaient M. de Rayneval, aux Affaires étrangères, qui n'accepta pas et fut remplacé par le général Ducos de la Hitte, M. Rouher à la Justice, Bineau aux Travaux publics, M. de Parieu à l'Instruction publique, M. Dumas au Commerce, M. Fould aux Finances, enfin Ferdinand Barrot à l'Intérieur. La déclaration du général d'Hautpoul fut aussi modérée, aussi humble et soumise que le message avait été éclatant et hautain. Il ne sortait pas des lieux communs ni des plus vagues généralités[58]. Pas un mot n'était dit, bien entendu, sur les causes du changement de ministère, et le général prenait même soin, afin de décliner toute responsabilité, de déclarer que ce n'était qu'après et non avant la résolution constitutionnelle du président qu'il avait été appelé à faire partie du nouveau ministère. Le nouveau cabinet cherchera, disait-il aussi, dans celui auquel il succède, plus d'un exemple glorieux du dévouement au pays et d'une intelligence élevée de ses intérêts. Il assurait encore la majorité — mais non sans soulever de légères rumeurs — que le ministère n'était pas formé contre elle, et qu'il développerait avec énergie ses principes ; les antécédents de ses membres en étaient un sûr garant. D'Hautpoul se faisait personnellement de la politique et des besoins de la France une idée assez simpliste : Le principe d'autorité détruit, toute idée d'ordre et de hiérarchie disparue, les démagogues de la gauche, qui personnifiaient en eux tout ce que le socialisme, le communisme et les passions antireligieuses avaient de plus exalté, constituaient une opposition d'autant plus violente que tous les membres du nouveau cabinet lui étaient ouvertement opposés. Quant à la majorité, elle se composait d'éléments divers : les légitimistes, les orléanistes, les hommes nouveaux amis de l'ordre et quelques rares bonapartistes avoués. Tel était le noyau sur lequel le ministère devait s'appuyer. Il fallait donc, pour le maintenir uni, éviter avec soin de soulever les passions dynastiques, qui eussent aussitôt eu pour résultat la division de cette majorité. Le terrain neutre d'une république honnête, voulant Tordre et le respect des lois au dedans et la dignité du nom français au dehors, était tout naturellement celui sur lequel je devais me tenir[59]. Il entendait aussi réorganiser le ministère de la Guerre, où les abus étaient intolérables, de manière à devenir le pivot auquel tout devait aboutir[60]. D'Hautpoul, sur ce point encore, avait-il été conseillé par Louis-Napoléon dans ce long entretien du jardin de l'Élysée sur lequel il n'a rien dit ? * * *Un nouveau chemin se dessinait, et qui semblait se préciser, vers l'Empire. — La Constitution avait placé la principale et même la seule garantie de l'accord équilibré des deux grands pouvoirs de l'État dans un conseil des ministres sans lequel le président ne pouvait faire aucun acte quelque peu considérable de gouvernement ; le ministère était aussi un pouvoir intermédiaire destiné à empêcher les chocs des deux autres ou à les faire s'absorber mutuellement ; il répondait du président de la République au Parlement et du Parlement au président. Afin de parvenir à cet équilibre, il fallait non seulement que le cabinet fût constitué d'une façon réelle, mais encore qu'il eût sa vie propre et sa responsabilité indépendante de celle du président ; or cette première condition se rencontrait-elle dans une réunion de ministres qui n'avait pas même son président ?[61] La seconde condition était que les membres du cabinet eussent la confiance entretenue par le sentiment d'une force nécessaire à respecter, de façon à ce que les ministres pussent acquérir une action efficace sur le Parlement et sur le président, sur celui-ci pour le contenir s'il était tenté d'user trop de son pouvoir, sur le Parlement pour lui résister si, comme toute assemblée politique, il était porté aux empiètements, sur tous les deux afin de prévenir des conflits. Ce programme, expliqué par Barrot et rêvé par d'autres, aboutissait, — nous l'avons vu, — peut-être par suite d'une société encore insuffisante au point de vue moral, à une annihilation réciproque au seul profit du parti le plus organisé, puisque lui seul, en face de ces diverses balances à équilibrer, agissait réellement par le poids de sa majorité électorale. Cette majorité ayant fait œuvre mauvaise[62], comment la nécessité d'un gouvernement central, même insuffisamment compréhensif et mauvais, gouvernant avec vigueur et suite, ne se serait-elle pas imposée cette fois d'une manière absolue, au milieu du flottement général, assez désemparé, sans plus d'atermoiement possible, surtout si nous nous souvenons que le pays la réclamait depuis 1848. Le pays applaudissait au changement de ministère et comptait que le nouveau ne gênerait plus le neveu de l'empereur. L'Assemblée surtout était atteinte, non la volonté, sinon la compréhension politique, de la France. Qui s'intéressait au Parlement ? Les seuls parlementaires actifs et sincères, capables de défendre efficacement l'idée républicaine, étaient éliminés. Le centre et la droite, qui dominaient en soutenant après coup l'idéal parlementaire qui ne représentait plus que la réaction, n'étaient pas assez sûrs de leur ligne de conduite pour résister longtemps avec succès. L'esprit politique manquait d'ailleurs à ces députés obstinés, mal renseignés et même un peu simples. Le Parlement protesta bien par un de ses membres, M. Desmousseaux de Givré, qui demanda à interpeller sur les causes qui avaient amené la dissolution de l'ancien cabinet, sur la formation du nouveau et sur la ligne politique qu'il entendait suivre, mais des voix nombreuses parties du centre s'écrièrent aussitôt que le général d'Hautpoul avait déjà répondu à toutes ces questions. On m'a assuré, raconta Barrot[63], que, pendant ce temps, quelques chefs de la majorité, en parcourant les bancs, disaient à leurs amis que ce qui se passait avait été convenu et que tout s'arrangerait à la plus grande convenance de cette majorité. Le ministère, qui s'interposait entre les deux grands
pouvoirs, une fois tombé, il ne restait bien que Louis-Napoléon. La
constitution de 1848 aboutissait même, une seconde fois, à sa dangereuse
nécessité. Elle apparaissait définitivement l'œuvre d'hommes trop honnêtes
qui avaient tablé sur une conscience humaine idéale, indispensable sans
doute, pour que l'humanité ne s'en retourne pas vers une sorte de nouvelle
barbarie raffinée ; mais si rare et si difficile, sans révolution profonde et
foncière dans les conditions économiques, qu'elle n'existe pas encore de nos
jours. La théorie, parfaite sur le terrain théorique, leur avait paru
suffisante et la réalité ne cessait de leur rappeler sévèrement ses exigences
immédiates. Qui, et au nom de quel principe, aurait pu empêcher le président
de choisir, puis de conserver le ministère neutre, souple, propice, devenu
peut-être nécessaire, qu'il venait de se donner ? De plus, le droit de mettre
en accusation le président ou un coup d'État contre le Parlement
n'étaient-ils pas les seuls moyens de vider les conflits inévitables qui
s'élevaient entre les deux pouvoirs rivaux ? Barrot le reconnaissait[64]. Le prince était
peut-être le seul à se refuser de le penser, Barrot avait cru, ainsi que
Dufaure, pouvoir continuer ses tendances parlementaires libérales, affirmées
sous la monarchie orléaniste, en devenant, et avec sincérité, un républicain
constitutionnel, mais, sans doute, subissaient-ils l'un et l'autre à leur
insu la domination de leurs aptitudes. Tous deux
étaient hommes de talent, hommes de tribune rompus aux pratiques du
parlementarisme et, s'ils réunissaient aussi les mérites qui permettent de
dominer les assemblées, ils ne possédaient peut-être pas, au même degré les
qualités, également rares qu'exige un chef de pouvoir plus spécialement
subordonné au chef de l'État[65]. Et M. de
Maupas, évidemment partial, mais non sans une certaine vérité, logique : Pour eux le parlementarisme était en quelque sorte la
panacée universelle. En pensant ainsi, ils commettaient une erreur et ne
faisaient point la part des temps[66]. Il aurait fallu
un homme assez grand pour sauver le parlementarisme, malgré lui, par une
dictature dont il aurait été le premier, une fois la besogne accomplie, à
abdiquer la puissance, mais il ne semblait pas que le pays demandât cela, et
Louis-Napoléon, en dehors même du fait qu'à cette heure les questions
dynastiques et les préoccupations personnelles tenaient peut-être la première
place dans sa pensée, ne séparait pas sa cause, nous l'avons dit déjà, de
celle du pays, ne savait ni ne voulait en tout cas la lui subordonner, par
suite de sa conception même et de son intérêt personnel. — Les lignes
suivantes de Maupas, encore qu'elles soient toujours partiales, répétons-le,
contiennent, elles aussi, une certaine part de vérité : Le prince s'inspirait avant tout, dans la direction qu'il
donnait à sa politique, de la préférence et de l'intérêt de la nation ;
possédant à un rare degré l'instinct, la prescience des vœux du pays, il
s'attachait à leur donner les satisfactions qui étaient à ses yeux
compatibles avec le sien. Or, pour lui, le régime parlementaire était
inacceptable en France comme principe de gouvernement, et s'il eut conservé
la moindre hésitation à cet égard, pour des temps calmes et réguliers, il
regardait au moins que, pour sortir la France des agitations de l'heure
présente, le régime parlementaire était celui qu'on devait avant tout
écarter. Si, à titre général, il y avait dans son esprit, sur cette doctrine,
des partis pris qui le dominèrent trop exclusivement et qui furent plus tard
la cause de fautes considérables, il était au moins dans la vérité pour
l'époque de transition dans laquelle il avait à se mouvoir... Sans doute il
était le premier à profiter de l'application de ce système, puisqu'il était
constitutionnellement la plus haute représentation de ce principe d'autorité.
Mais si l'ambition, ambition permise là ou sa naissance et la libre volonté
du pays l'avaient placé, entrait dans ses calculs, le patriotisme était
incontestablement son mobile dominant. En observant attentivement la
situation, il ne voyait que lui qui fût, à l'heure présente, indiqué pour le
rang suprême[67]... Tout ne lui
conseillait-il pas d'aller de l'avant ? La démocratie en 1848, avait été dégagée et armée de pleins pouvoirs par l'insurrection. Parce que de semblables pouvoirs sont toujours dangereux, au lieu de s'organiser en s'orientant vers les réalisations permises, elle s'était laissée entraîner vers le passé, vers le désir de plaire à la réaction par des concessions croissantes. La faute commise au lendemain de 1830 recommençait, plus redoutable encore. La république démocratique et sociale condamnée par suite de l'effort des conservateurs qui, en plein jour, avaient barré à droite et, en sous main, avaient fait accélérer la marche à gauche vers la démagogie, une autre possibilité gouvernementale se glissait peu à peu. Elle plaisait naturellement à la droite et, d'autre part, paraissait fournir une apparence de revanche aux gauches que le centre avait écrasées. L'élimination dessinée quelques mois après février, consacrée en juin, continuée depuis, s'achevait dans ce sens. Après avoir décimé le parti révolutionnaire, elle travaillait l'élément conservateur, tant il est vrai que les révolutions qui ne se réalisent point aboutissent presque invinciblement à un homme. Et cet homme seul doit, pour se maintenir, même malgré lui, s'appuyer en partie sur les forces qui ont survécu, au moins pour un temps, jusqu'à ce qu'il soit devenu assez fort à son tour pour recommencer la lutte. Aussi l'Église dominait-elle le champ dévasté. La politique de la France, liée à elle, impuissante à se séparer d'elle, accentuait l'équivoque, augmentait les éléments de cette contradiction, entre l'idée révolutionnaire sociale et l'idée catholique ; l'idée napoléonienne devait s'efforcer de trancher entre elle deux, et ne pouvait solutionner la difficulté à cette date, semble-t-il, après toutes les fautes faites, qu'en les mettant d'accord coûte que coûte, au détriment de la plus faible. Il eut fallu, au contraire, qu'elle écrasât la plus forte, peu à peu, par la plus faible en fournissant à celle-ci tous les moyens de développement. Prisonnière de la réaction qui l'avait permise, l'idée napoléonienne, ne gardant presque plus rien de napoléonien, marchait en quelque sorte contre elle-même. Elle ne se reprendrait qu'au moment de la guerre d'Italie et, aussitôt, serait combattue par l'Église qui retournerait peu à peu tout le pays contre elle, — alors qu'ici l'Église l'utilisait à son bénéfice exclusif, contre la nation. La politique napoléonienne n'était représentée que par son héritier, dépourvu de parti réellement napoléonien. Il ne restait bien encore que lui, mais allié de l'Église, cette fois, et de l'opinion publique façonnée par celle-ci. Tout était donc renversé. Tout était perdu. Alors qu'en 1848 il se tenait à la fois en face de l'Europe et de la France, alors que, maintenant, il semblait grandi en France, il avait déjà ébranlé cette situation européenne, si singulière et si forte, que lui avaient faite l'élection de décembre et la révolution de Février. Et sans que personne s'en doutât, la France aussi, déjà, se trouvait atteinte, car un peuple se prépare à une période de décadence quand il ne réalise pas une révolution ou, du moins, l'étouffant tout entière, contre son intérêt, se refuse même d'étudier les indications nécessaires qu'elle contenait et qu'elle lègue impérieusement à ceux qui lui succèdent. FIN DE L'OUVRAGE |