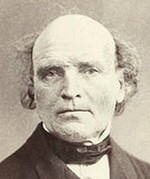LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
ET LE MINISTÈRE ODILON BARROT
V. — LE 13 JUIN.
Indécision. — Premiers groupes autour du Château d'Eau. — Promenade du ministre des Travaux Publics. — La colonne insurrectionnelle. — Etienne Arago. — La Montagne rue du Hasard. — L'insurrection sans chef. — Indifférence de Paris. — Conseil du matin à l'Elysée. — Changarnier. — Surexcitation des troupes. — Le coup de pistolet au coin de la Chaussée-d'Antin. — Place de la Bourse. — Le Conservatoire des arts et métiers. — Psychologie des sociétés secrètes et des groupes révolutionnaires. — Le jardin du Palais-National. — Le colonel Guinard. — La marche vers les Arts-et-Métiers. — La population reste froide. — M. Pouillet. — L'équivoque continue. — Impossibilité de se défendre. — Discours et premiers coups de feu. — Forestier. — La lutte autour du Conservatoire. — Fuite de Ledru-Rollin, de Guinard, de Martin Bernard et de Considérant. — Le directeur de la prison des Madelonnettes. — Changarnier, héros de la situation. — Différence de la scène politique au lendemain du 13 juin. — Séance chez M. de Kératry. — Au Palais-Bourbon. — Lagrange remet les choses au point. — Arguments judicieux de Pierre Leroux. — Cavaignac et la République. — Protestation du prince Napoléon. — Falloux, à la fin de la séance du soir, vient déclarer que la révolte n'est pas éteinte. — Le bénéficiaire du combat. — Promenade de Louis-Napoléon. — État de siège et proclamation. — La suspension de six journaux. — Scène sauvage et ridicule dans les bureaux du Peuple. — Les insurrections locales. — L'insurrection lyonnaise. — Lyon, ses 230 clubs, ses sociétés secrètes. — Le 14 à l'Assemblée. — La situation d'après Tocqueville. — M. Dufaure. — Les anciens conservateurs et la majorité. — Proposition de coup d'État. — Tocqueville et Louis-Napoléon.Le matin du 13, la République, le Peuple, la Révolution démocratique et sociale, la Réforme, la Démocratie pacifique et la Tribune des peuples, publiaient en gros caractères les proclamations attendues qui se ressemblaient toutes. La première émanait de la Montagne ; signée de 122 noms, elle rappelait la violation de la Constitution par la majorité de l'Assemblée et invoquait l'article qui confie le dépôt de la Constitution au patriotisme des Français[1] ; mais, si les députés de gauche s'écriaient : Peuple, le moment est suprême ! ils n'ajoutaient rien à cette affirmative sommaire, et le double cri de : Vive la Constitution ! Vive la République ! dont ils faisaient un signe de ralliement, encore qu'explicite, n'était pas un programme ; aucun plan, même élastique, capable de s'adapter aux circonstances, n'existait par ailleurs ; et l'indécision nocturne se prolongeait dès le début de la journée. Les déclarations des comités démocratiques socialistes de la presse, des écoles et des délégués du Luxembourg, un peu plus précis, n'indiquaient cependant pas de prendre les armes, par un sentiment de prudence qui se justifiait mal au point d'impliquer un manque de confiance, un mystérieux instinct d'insuccès. Les seules paroles significatives étaient celles-ci : La garde nationale se lève, les ateliers se ferment. Que le peuple entier soit debout ! C'était aussi l'article 110 qu'invoquaient, d'assez loin, les Amis de la Constitution[2]. La commission exécutive permanente des délégués de la 5me légion engageait, au nom de la patrie en danger, toutes les légions de la Seine à se réunir sans aucune arme au Château-d'Eau, en face de la mairie du Ve arrondissement, pour aller à l'Assemblée législative lui rappeler le respect dû à la constitution, comme si, pour avoir réussi le 23 février 1848, la même scène devait recueillir le même succès à un an d'intervalle, pendant lequel tout avait changé. — D'autres protestations suivaient ces quatre pièces, sans importance effective non plus. Un des conseils que donnait la Démocratie pacifique était surprenant par sa naïveté : S'il y a des prises d'armes, nul garde national républicain ne doit manquer ; que les légions ne se laissent pas enfermer dans des postes et des grilles... Il ne semble pas qu'en parcourant ces lignes les inquiétudes d'un pouvoir déjà très renseigné, et depuis longtemps sur ses gardes, — ce qui différenciait encore de la situation de février 1848, — aient été très sérieuses. Les premiers groupes se formèrent vers neuf heures et demie du matin aux environs du Château-d'Eau[3]. Des propos révolutionnaires se tinrent le long du boulevard, chez les marchands de vin... Les gardes nationaux arrivaient en petit nombre, lentement, sans armes[4] ; les curieux et les agitateurs se groupaient plus rapidement[5]. On criait : Vive la Constitution ! Vive la République romaine ! Vive la Montagne ! A bas les traîtres ! Le drapeau rouge apparut bientôt, porté par deux hommes en blouse. Quelques officiers se trouvaient là, entre autres le lieutenant-colonel Perrier et le capitaine d'artillerie Schmitz[6]. Le ministre des Travaux publics, par curiosité, sans doute aussi afin de renseigner le président avec exactitude, ce qui, dans un pareil moment, était la meilleure manière de lui faire sa cour, partit à cheval suivi d'un lancier[7]. Au boulevard Montmartre, il remarqua les premiers signes d'agitation. La foule grondait boulevards Poissonnière et Bonne-Nouvelle. A la porte Saint-Denis, un chef d'escadron, un capitaine de la garde nationale et un garde républicain qui le reconnurent désirèrent l'accompagner ; mais quand le ministre atteignit la porte Saint-Martin, près de la grille du théâtre, sa petite suite était demeurée en arrière. Il avançait seul, lentement, péniblement, devant l'Ambigu-Comique. La foule le serrait de près. L'ayant à son tour reconnu, elle lui intima l'ordre d'acclamer la République et la Constitution, ce qu'il exécuta. Certains ne furent pas satisfaits et, sûrs que le ministre ne pouvait pas les suivre sur ce terrain, lui demandèrent d'acclamer la République romaine. Vive la République française ! dit l'interpellé. A bas le président ! reprit-on. Lacrosse souleva son chapeau et jeta : Vive le président ![8] Le lancier Villemot essayait, mais en vain, d'atteindre le ministre enveloppé. On cherchait à le jeter à bas de son cheval. Un émeutier, sauté en croupe derrière lui, le serrait à la gorge[9]. Un autre lui dit : Vous êtes M. Lacrosse ; vous venez voir si c'est une émeute, mais c'est une révolution. Votre président et vous, vous êtes f... Vous irez à Vincennes. Lacrosse protesta encore : Nous irons au Père-Lachaise mais pas à Vincennes. Il aperçut un ancien montagnard de la Constituante, Gent, auquel il cria : Me laisserez-vous aux mains de ces hommes ? Leurs souvenirs parlementaires réunissaient les deux députés ; Gent ne pensait pas avec amertume, à ce moment, aux discours de son ancien collègue et se jeta au plus épais de la mêlée. Il se faufila, non sans peine, renversé deux fois, les vêtements en lambeaux, jusqu'au ministre et parvint à le défendre d'un côté, aidé par un sous-officier de la garde nationale. Le lancier se rapprochait à coups de hampe de lance et élargit le passage de manière à ce que le représentant des Travaux publics pût gagner, par une rue voisine, la mairie du VIe arrondissement. De là il se rendit à l'Elysée, où il était attendu[10]. Deux officiers d'état-major de la garde nationale avaient été également assaillis et insultés, le commandant Chabrier et le capitaine de Benneville qui, pour sa part, n'avait pu se dégager qu'avec l'aide des acteurs de l'Ambigu[11]. La colonne insurrectionnelle rêvait de recommencer la
manœuvre décisive de février. Etienne Arago, en uniforme de chef de bataillon
de la garde nationale, arriva, au milieu des applaudissements, pour en
prendre la direction ; il parcourut la foule et aurait dit[12] : Allons, mes amis, du courage, on nous appelle au combat.
D'autres officiers vinrent également. Vers onze heures et demie, deux
représentants, qui paraissaient attendus, seraient descendus de cabriolet,
l'un demeuré inconnu, l'autre Victor Considérant[13]. On peut se
demander aussi si des gens d'un ordre spécial, relevant de la rue de
Jérusalem, ne se mêlèrent pas à la foule, notamment ceux dont on a rapporté
ce langage : Ce soir, nous dépouillerons le
président ; il sera avec ses ministres à Vincennes ; demain ce sera le tour
de Changarnier et de Cavaignac ; après-demain nous dépouillerons les aristos[14]. Un tel langage
n'a rien de révolutionnaire. A midi[15] — ou midi et
demi[16] — la colonne
partit, en assez bon ordre. Elle présentait cinq hommes de front, occupait
presque toute la largeur du boulevard, la garde nationale en tête, le peuple
en queue, par file de six. Elle comprenait environ 6.000 personnes à la porte
Saint-Martin[17].
Les chefs de la démocratie n'étaient pas là. Depuis
neuf heures du matin, la Montagne délibérait rue du Hasard. Guinard et les
officiers de l'artillerie de la garde nationale ne quittèrent pas
l'état-major au Palais-National. Les Amis de la Constitution
attendaient les manifestants, accoudés sans impatience au balcon de leur
cercle, au-dessus du passage Jouffroy. Le principe de la manifestation était
sans doute une chose absurde et périlleuse, mais, la manifestation admise, il
fallait que les représentants du peuple, revêtus de leurs insignes, que les
chefs supérieurs de la garde nationale, les Amis de la Constitution,
tous les maîtres, tous les hommes vieillis dans les affaires publiques
prissent la tête du mouvement pour lui donner plus d'autorité. En
s'abstenant, ils avaient l'air d'attendre la manifestation même, ou d'en fuir
le péril et le ridicule. Hypothèses d'autant plus saisissantes que la
Chambre, n'ayant pas ce jour-là de séance publique, la manifestation semblait
ne se diriger que vers un but fictif ou manqué d'avance[18]. Etienne Arago et Périer marchaient en tête, en se donnant le bras. Derrière eux plusieurs anciens constituants, entre autres Gent, qui avait sauvé Lacrosse et Rayneval. Les délégués des comités des écoles se tenaient au deuxième rang. Il y avait aussi quelques individus portant des blouses sur leurs habits, des invalides et d'anciens soldats. Les gamins de quatorze ou quinze ans couraient sur les côtés. La colonne avançait, le pas confus, sourdement, d'une manière violente et comme inquiète qui n'était pas sans hésitation. Les cris poussés retombaient sans échos. Paris, surmené par la guerre civile, blasé sur son inefficacité actuelle, ne rendait plus, désertait les principes auxquels il ne lui avait servi en rien de croire et raillait tout bas cet appel doctrinaire à la Constitution contre laquelle il avait voté en décembre 1848. La réalité brutale de la vie, la nécessité de l'argent le préoccupaient seules après tant de jours perdus. Il ne faisait plus de doute que la révolution était manquée, et la ville, qui avait été l'initiatrice même de la révolution l'année précédente, s'étonnait qu'on la voulût recommencer[19]. L'effort entrepris se trouvait condamné d'avance. La colonne insurrectionnelle ne formait plus, ainsi qu'en février, la mouvante cellule expansive animatrice de ce qui l'entourait ; loin de s'étendre en cours de route, elle concentrait de plus en plus son enthousiasme au fur et à mesure qu'elle s'éloignait des quartiers de l'est. Elle somma vainement le poste du boulevard Bonne-Nouvelle de rendre les armes[20]. Elle appelait inutilement le peuple qui la regardait en silence, tristement ou ironiquement tour à tour. Les marchands fermaient leurs boutiques. Sur un seul point, à la terrasse des Amis de la Constitution, en face le passage Jouffroy, des encouragements, platoniques d'ailleurs, se firent entendre, durant tout le passage de la colonne dont la tête plongeait déjà dans les boulevards élégants où l'apparence indifférente devenait peu à peu de l'hostilité. Il ne fallait pas compter sur le concours de ces riches quartiers où l'exaltation politique ne se produit qu'en faveur de l'ordre. Il ne fallait pas compter sur le prolétariat repu des antichambres et des cuisines. La misère arme le bras du pauvre. Malgré l'inutilité de sa promenade, la colonne continua d'avancer dans le Paris de l'ouest, entre ses hautes maisons pareilles à des palais, suivie du haut des balcons et des fenêtres par les dédaigneux lorgnons d'un peuple ganté[21]. Elle avait dépassé la rue de la Paix et persévérait sans rencontrer d'obstacles quand, par la rue de la Paix, justement, survint Changarnier. Un conseil s'était tenu chez le président de la République pendant la matinée. Louis-Napoléon, en uniforme, demeurait prêt à monter à cheval dès qu'on lui annoncerait le début de la bataille. Il n'en paraissait pas ému. C'était précisément, dit Tocqueville, le même homme que la veille, le même aspect un peu morne, la parole aussi lente et aussi embarrassée, l'œil aussi terne. Rien de cette sorte d'agitation guerrière et de gaieté un peu fébrile que donne souvent l'approche du danger, attitude, qui, peut-être, après tout, n'est que la marque d'une âme ébranlée[22]. Changarnier[23], interrogé, exposa son plan, se dit sûr de la victoire. Il avait appelé dans la capitale, dès la veille, en prévision des troubles, les garnisons de la banlieue ; parmi ces régiments, il en avait caserné soit dans la capitale, soit à Villejuif, soit à Bondy[24]. Le matin même du 13, il en avait massé dans la cour du Carrousel et dans le jardin des Tuileries. Sa certitude était si complète que le préfet Berger, lui faisant remettre un projet de proclamation au peuple, il répondit : Faites placarder si vous le voulez, mais l'émeute sera battue avant[25]. Il ne demandait qu'à jouer un rôle, surtout depuis la chute de Cavaignac[26]. N'était-ce pas à lui que s'était adressé Kératry, le 28 mai, afin de protéger la Chambre, soi-disant en danger[27] ? Cette fois il avait si bien pris ses précautions dans la ville, et dans toute la banlieue d'alentour, que la capitale se trouvait entièrement investie[28]. Il les développa devant le prince président comme devant Dufaure dont les rapports, reçus récemment, annonçaient une insurrection formidable. Tout décidé, Dufaure se retira dans son ministère de l'Intérieur. Vers midi, Tocqueville se rendit à l'Assemblée, qui fut assez longue à se réunir. Il était une heure. Le général, suivi d'un nombreux état-major, parmi lesquels les badauds remarquaient Castellane, que Changarnier avait appelé et qui était venu le retrouver aux Tuileries[29], amenait, pour l'opposer à la malheureuse petite colonne civile, une triple colonne militaire, les 2e et 3e régiments de dragons, le bataillon de gendarmerie mobile, les 6e, 7e et 10e bataillons de chasseurs à pied. La gendarmerie mobile occupait le trottoir de droite, commandée par le chef d'escadron Tisserand ; les chasseurs, conduits par le capitaine Landry de Saint-Aubin et les chefs de bataillon de Saint-Pol et de l'Abadie-Daydies, allaient à gauche ; les colonels de Goyon et Gastu au centre de la chaussée. Enchanté de son rôle et que l'occasion fût si favorable, Changarnier jeta ses troupes sur le boulevard, coupa la manifestation en deux et fit faire face à ses hommes à droite comme à gauche, après que les chasseurs à pied eurent ouvert leurs rangs pour laisser passer deux escadrons de dragons. Les roulements de tambours furent exécutés ; les commissaires Bertoglio, Bellangé et Primorin firent les sommations et la charge commença, dans toutes les directions. Une partie de la cavalerie et le 6e bataillon de chasseurs à pied déblaya facilement jusqu'à la Madeleine. Le bruit se répandit qu'Etienne Arago était tombé, puis s'était enfui. Cependant, du côté du boulevard des Italiens, la foule semblait résister. Les troupes s'avancèrent en ordre, le bataillon de gendarmerie mobile sur la contre-allée de droite, le 10e bataillon de chasseurs sur la contre-allée qui longe la rue Basse-du-Rempart. La première compagnie de chasseurs s'étendit d'abord sur la chaussée, puis ce fut le tour de la seconde, et les deux compagnies s'appuyèrent l'une contre l'autre de manière à tenir toute la largeur du boulevard, à ouvrir la foule et à protéger les tambours précédant les commissaires de police. Presque aussitôt après, les deux compagnies se replièrent dans les contre-allées sur leurs bataillons respectifs et laissèrent la place à la cavalerie. Changarnier, à sa tête, chargea à pied jusqu'à la porte Saint-Denis les bandes désarmées. — Beaucoup de monde regardait aux fenêtres en silence. Des marches de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Changarnier fut violemment injurié, et le général s'approcha aussitôt avec un peloton de gendarmerie, qui fit feu. A cet endroit toutes les fenêtres étaient garnies de femmes[30]. Près de la rue Grange-Batelière, un émeutier menacé et arrêté aurait fini par sortir un pistolet et menacer le général[31]. Les troupes, très surexcitées, ne voulaient pas de quartier[32] et acclamèrent leur chef. Des représentants, avec leurs écharpes, reformèrent un peu plus loin les groupes rompus et s'avancèrent encore. Des chaises furent jetées au travers du boulevard, à la hauteur de la rue Grange-Batelière ; un tombereau fut renversé au coin de la rue Laffite, le tout sans résultat. Quelques citoyens, saisis d'un enthousiasme peut-être hors de saison, se mirent brusquement à genoux devant la troupe et découvrirent leur poitrine en criant à ces soldats trop progressivement renseignés sur les émeutes et trop préparés par leurs chefs pour s'émouvoir : Vous-baignerez-vous dans le sang de vos frères ?[33] La troupe évita de tirer, mais accentua son offensive, sans prendre garde et sans aucune pitié. Bientôt le sang coula. La manifestation se mit à reculer, lentement d'abord, puis s'enfuit de toutes parts en criant : Aux armes ! Aux armes ! On tire sur nos frères ! — La répétition de février se précisait, même par les mots, qui avaient bien vieilli. Le coup de pistolet ne fit pas défaut : il fut tiré à peu près au coin de la rue de la Chaussée-d'Antin, par un nommé Duprat qui avait blessé en même temps à la main, d'un coup de poignard, le chasseur Estaquin, qui épaula vers son agresseur en fuite et le tua. Il est à remarquer que ce fut la troupe qui tua. Elle était animée du plus mauvais esprit militariste. On se jeta, mais sans parvenir à y entrer, sur la boutique de l'armurier Devisme, 3, rue du Helder. On s'efforçait cependant d'enlever les volets de la devanture. Mais la colonne, vite dispersée, se répandait à travers les rues, essayant encore de provoquer un mouvement en sa faveur. Ceux qui repassèrent devant le passage Jouffroy furent salués par les Amis de la Constitution aux cris de A bas les traîtres ! A bas les bourreaux ! La troupe qui serrait les manifestants monta dans le cercle et en chassa les membres qui se joignirent aux fuyards. La vue des bourgeois maltraités fit alors juger le moment favorable par les hommes d'action qui semblaient oublier, dans leur violent désir d'agir, que la commission des Droits de l'homme, et celle des Vingt-Cinq ou, du moins, la fraction qui en usurpait la qualification[34], restaient à conférer depuis le matin, 6, rue du Hasard, sans s'être montrées[35]. — Le général revint aux Tuileries par la rue Vivienne, la rue Neuve-des-Petits-Champs et la rue Richelieu. Il fut acclamé place de la Bourse[36]. Les montagnards devaient-ils se transporter au Conservatoire des Arts-et-Métiers afin d'y proclamer, sous la garde des sectionnaires de la société des Droits de l'homme, de l'artillerie, de la garde nationale et du peuple, le gouvernement révolutionnaire ? On en parlait sans cesse et aucune décision n'avait été prise ; il eût été facile de comprendre le danger qu'il y avait à se placer dans une souricière, mais sur ce point, comme sur tant d'autres, on imitait. Forestier, peintre d'histoire[37] et colonel de la 6e légion, avait offert à Marrast, le 29 janvier, dans le cas où l'Assemblée eût été sérieusement menacée, le refuge du Conservatoire des Arts-et-Métiers. Les intéressés s'en souvinrent, ainsi que Forestier même, qui avait fait de la prison, et dont la légion contenait des démocrates sincères ; ils comptèrent même sur lui, sans se rendre compte, ni des sentiments assez peu révolutionnaires du peintre, ni du mauvais point stratégique conseillé par lui. Le VIe arrondissement avait bien fourni des votes nombreux en faveur des idées républicaines avancées ainsi que des bons combattants, mais l'esprit du prolétariat y avait été travaillé sans relâche depuis deux mois, afin d'empêcher toute manifestation armée. Son représentant au comité des Vingt-Cinq en avait été écarté pour son attitude et n'avait pas été convoqué aujourd'hui ; aussi, pendant l'émeute, assisté de ses délégués, n'avait-il pas cessé de déconseiller aux ouvriers qui venaient lui demander un avis de se mêler à la lutte. — On mesure ici l'illusion des chefs qui pensaient réellement réussir, encore qu'il y ait toujours une part de chimère, au moins par rapport au temps où ils parlent, chez ceux qui s'occupent de politique avancée d'une manière plus ou moins occulte, chimère utile, qui favorise par ses rêves l'action incessante mais, en même temps, souvent, par son manque de réalisme vraiment actif, les plus folles espérances. La fatuité des sociétés secrètes et de tout corps démocratique, l'orgueil même de ces chefs facultatifs qui croient diriger des milliers d'hommes prêts à leur obéir, entretiennent dans le parti républicain de grossières erreurs. Les mirages de la vanité naïve, ces visions fanfaronnes sont de permanentes sources de mécomptes ; ils nuisent déplorablement à l'étude des situations[38]. Les sociétés secrètes, ou simplement fermées, ont tendance à n'agir, petit à petit, que chez elles, dans les limites de leurs cadres ; elles ne filtrent pas assez leurs troupes, et par le désir de grossir celles-ci, y laissent pénétrer trop de curieux ou trop de ces enthousiastes d'autant plus débordants que le danger reste lointain ; elles ignorent la discipline ou, jalouses, barrent la route aux bonnes volontés qu'elles lassent en leur préférant des médiocrités auxquelles, bien entendu, ne coûtent aucune affirmation exagérée, aucune bassesse ; un flottement vague résulte de ces fautes successives, qui masque le but, égare sur la route et fait oublier les principes initiaux autour desquels tant d'hommes étaient venus, souvent des points les plus différents, avec une foi réelle, et dont ils se font eux-mêmes, peu à peu, les destructeurs. Elles se contentent trop de discuter l'action, de la préparer, de la décider selon telle ou telle forme, puis, le premier élan donné, de reprendre une autre face du même sujet, à date fixe, avec la même facilité, avec la même anarchie dans la discussion ; elles oublient de réaliser cette action dans la vie ordinaire et véritable, sur le terrain mouvementé, divers, difficile, de la majorité où il serait nécessaire de tenter coûte que coûte, pour être sûr d'avoir raison, une expérience ; elles ressemblent un peu, en cela, au suffrage universel qui, le vote donné, retombe ; le discours fini, le congrès clos, l'ordre du jour accepté, tous reprennent la vie habituelle, en omettant, souvent par nécessité, que tout leur précédent effort n'a plus de sens s'ils ne tentent même pas de répandre, au dehors, les conceptions reconnues nécessaires. N'y avait-il pas un peu de cette habitude chez bien des montagnards et n'ajoutait-elle pas à leurs pressentiments d'insuccès ? — Toute la journée ils discutent. Ils n'agiront que dans la fuite, contraints à celle-ci par la nécessité pressante, car il n'y eut pas d'action réelle dans le fait d'aller s'enfermer aux Arts-et-Métiers. C'est vers neuf heures que les représentants s'étaient réunis le matin, rue du Hasard. Un mouvement incessant d'artilleurs, de gardes nationaux et d'hommes en blouse à longue barbe y avait été remarqué. Dès que le cri de : Aux armes ! eut été jeté par ceux que les troupes refoulaient, soit qu'ils sentissent qu'il n'y avait plus moyen, cette fois, de ne pas faire quelque chose, soit ; ainsi que l'accusation l'insinua, que ce fût un signal, soit enfin, et ceci semble plus plausible, qu'ils aient redouté de nouvelles journées de Juin et voulu les empêcher[39], une trentaine de députés montagnards sortit. Ledru-Rollin menait le premier groupe accompagné de Gambon, des sergents Boichot, Commissaire et Rattier. Ils étaient suivis d'une petite quantité de peuple. Par le passage Hulot, ils gagnèrent le jardin du Palais-National où plusieurs batteries de la garde nationale étaient rassemblées. La plupart des soldats n'avaient pas d'armes et ceux qui en portaient ne possédaient pas de munitions[40]. Pourtant l'acte d'accusation avance qu'à la vue d'un artilleur à la figure ensanglantée les carabines avaient été ostensiblement chargées ; il dit encore que des armes avaient été remises par l'état-major à ceux qui n'en détenaient pas et en demandaient. L'arrivée des députés coïncidait avec les nouvelles sur la manifestation[41] en déroute, et une foule turbulente se jetait dans le jardin en risquant encore l'inutile appel de Aux armes ! on égorge nos frères ! On acclamait aussi la République romaine, la constitution, la Montagne, Ledru-Rollin ; on ajoutait : A bas Changarnier ! Les représentants ne firent d'ailleurs guère que traverser le jardin pour arriver rue de Valois, à l'état-major. Ledru-Rollin fut introduit dans le cabinet du colonel Guinard, celui qui s'émut, en juin 1848, près de Cavaignac, au moment de marcher contre les barricades prolétariennes, et il est loisible de se demander si une partie du remords qui devait de plus en plus être sien n'achevait pas de le décider à cette minute suprême[42]. Il n'entendait pas agir comme colonel, mais en tant que député, et n'avait pas encore endossé son uniforme ; décidé à ne pas abandonner le chef de la Montagne, il ne voulait cependant pas user de l'influence de son grade pour forcer la main à ses soldats ou influencer leurs décisions. Que se confièrent les deux hommes ? Au bout d'un assez court entretien[43], Guinard descendit en colonel, cette fois, l'air soucieux, fortement ému. Il avait reçu du général Perrot l'ordre d'assembler sa légion dans le jardin du palais, puis deux heures plus tard, du même officier, celui de renvoyer ses batteries chacune dans son arrondissement. Pour mieux comprendre encore les sentiments qui devaient agiter le colonel Guinard à cette marque directe de défiance, il faut ajouter que, le matin même, un poste d'artillerie de la garde nationale, chargé de garder quatre pièces de canon confiées à la légion par la ville de Paris, avait été expulsé avec des procédés insultants. Deux artilleurs blessés étaient venus dans le cabinet du colonel lui raconter les massacres du boulevard. Il savait, en outre, parle commandant Farina, que le général Changarnier avait menacé de mettre le feu à la ville de Paris. L'arrivée de Ledru-Rollin et d'un groupe notable de représentants du peuple venant, en de telles circonstances, se confier, pour ainsi dire, à la garde de la légion, acheva de convaincre M. Guinard qu'une telle journée pouvait décider du sort de la République elle-même[44]. Guinard entra dans le jardin, fit former le cercle aux artilleurs, au nombre d'une centaine environ, et leur aurait tenu cette courte allocution : Mes amis, nous touchons à un moment grave, suprême... à un de ces moments qui décident du sort d'une nation. Il n'y a plus à hésiter, il faut prendre un parti. Pour moi, je vous déclare, dans ma conscience d'honnête homme, de républicain, la constitution a été audacieusement violée, les représentants de la Montagne ont juré de la défendre... Je marche avec la Montagne. Ce n'est pas comme votre colonel que je vous parle en ce moment, comme homme politique ; j'obéis à mes convictions. Vous êtes donc tous libres de faire ce que bon vous semblera. Que ceux qui partagent mes opinions me suivent, que ceux qui ne les partagent pas, se retirent[45]. Il ajouta que les représentants de la Montagne venaient leur demander appui et interrogea : Voulez-vous défendre la Montagne ? Les acclamations furent passionnées. Les sabres et les shakos s'agitèrent. Un petit nombre seulement s'écarta. Ledru-Rollin, accompagné des députés, apparut à cet instant. La Montagne, dit-il, se confie à la légion d'artillerie et se rend aux Arts-et-Métiers. Il était environ deux heures[46]. Guinard et Ledru-Rollin prirent la tête de la colonne, et l'on se mit en marche quatre par quatre à travers la cour des Fontaines aux cris de Vive la Constitution ! Vive la République ! On appela bientôt aussi aux armes. A la rue Montesquieu, un artilleur s'écarta encore en disant : C'est une révolution. Les autres paraissaient animés et résolus[47]. On a dit que des agents provocateurs avaient indiqué le Conservatoire des Arts-et-Métiers[48]. La petite troupe comprenait vingt-cinq à trente représentants et environ cent cinquante artilleurs, dont soixante[49] armés ; les premiers faisaient la haie de chaque côté des députés ; une escorte d'hommes en blouse et de bourgeois grossissait le long du trajet. Elle traversa les rues du Bouloi, Coq-Héron, de la Jussienne, Mandar, Beaurepaire, du Renard, Saint-Sauveur, Saint-Denis, Grenétat et Saint-Martin. De temps en temps Ledru-Rollin et Considérant agitaient leur chapeau en appelant à la Constitution et à la République, mais sans éveiller d'enthousiasme ; la population demeurait froide. Les artilleurs renchérissaient en vain[50]. L'âme de Février s'était décidément évanouie. Le dernier noyau révolutionnaire ne semblait d'ailleurs pas lui-même aussi entraînant qu'il eût été indispensable ; sa décision sentait l'effort. Comme l'élan prolétarien, et purement insurrectionnel, du boulevard, celui-ci, militaire et parlementaire, surtout, marchait sans espérance. Rue du Bouloi, un poste de seize gardes nationaux demeura muet, immobile, sous les armes, en dépit des invites. Rue Saint-Martin, des bandes de fuyards débouchèrent qui appelaient aux armes ! Par ici, quelque chose d'obscur et de lointain donnait quand même l'illusion de la vie. Le désarmement des maisons par les hommes du peuple avait déjà commencé. On allait vite. La grille du Conservatoire se profila, fermée. Un poste de quinze voltigeurs du 18e léger commandé par un sergent du nom de Trouche, occupait le corps de garde. Il ouvrit sur l'ordre des représentants ; mais Boichot et Rattier ne décidèrent ni le sergent ni ses hommes ; peu impressionnés par l'écharpe tricolore, ils refusèrent toute explication et, contraints de céder, gardèrent du moins leurs armes et leurs cartouches[51]. — Une seconde grille barrait la route après la première cour. M. Pouillet, directeur, ancien député, demanda : Que venez-vous faire ici ? — On charge sur les boulevards, répondit Ledru-Rollin, nous venons vous demander asile. M. Pouillet, fort désireux d'éluder la requête, s'efforça de persuader qu'un autre refuge serait préférable. Il était ému par ce groupe de représentants en grande tenue et de voir derrière lui, remplissant la première cour, les panaches rouges de l'artillerie de la garde nationale, des chapeaux et des casquettes portant, comme insignes, la carte à niveau de la société des Droits de l'homme et, au-dessus de tout cela, une forêt de baïonnettes en désordre et très agitée[52]. Voulez-vous donc nous faire massacrer dans la rue ? dit encore Ledru-Rollin. Le Conservatoire ne vous sauvera pas[53], affirma le conservateur, qui essaya de résister. Il ne le put et fit entrer ses hôtes dans l'ancien amphithéâtre, en promettant de faire ouvrir une salle pour que l'on délibérât[54]. Les artilleurs s'étaient répandus de toutes parts et inspectaient d'un œil peu satisfait les murs et les dépendances de l'établissement. D'autres gens s'étaient mêlés à eux, tous armés, les uns portant la carabine, d'autres le fusil de guerre ou un fusil de chasse. Quelques hommes sans armes apparentes circulaient d'un groupe à l'autre, c'étaient les chefs de la société des Droits de l'homme[55]. Certains cherchèrent à élever une barricade dans un des couloirs d'entrée où plusieurs d'entre eux avaient déjà un tonneau de porteur d'eau. Cependant, dans la rue, sur l'ordre même de leur colonel, ils s'opposaient à toute tentative de barricade, au point de dégager deux omnibus que quelques-uns, pressés d'agir et secondés par des agents provocateurs[56], avaient dételé. Ainsi voulaient-ils à la fois éviter à leur action tout caractère insurrectionnel et se fortifiaient-ils, néanmoins, à l'intérieur en vue d'une attaque. L'équivoque signalée se poursuivait. Tous s'attendaient à la bataille et la plupart se rendaient maintenant compte de la mauvaise situation du Conservatoire ; ils s'y jugeaient pris d'avance, comme en une souricière. Ils revinrent alors à leur première idée de barricade et en essayèrent trois, l'une à la petite porte donnant rue Saint-Martin, l'autre à la brèche d'une muraille en démolition, la troisième au fond de la cour des Laboratoires. A chacune se tenait un homme en blouse, le fusil à la main ; des artilleurs gardaient les grilles ; tous avaient ordre de ne laisser passer personne. Kersausie se présentant, il fallut une permission spéciale pour qu'il entrât. On se méfiait au surplus des agents provocateurs[57]. Des membres de la société des Droits de l'homme et du comité des Vingt-Cinq parcouraient l'édifice sans découvrir davantage un meilleur moyen de le défendre ; c'étaient Napoléon Lebon, Chipron, Cantagrel, Villain. Guinard, inquiet, attristé, regardait faire, mesurant sans doute, une fois de plus, la distance qui sépare la révolution du rêve et celui-ci de la réalité. Pouillet qui ne l'avait pas rencontré depuis août 1830, vint lui dire : Vous avez tort d'établir ici votre quartier général ; vous vous y ferez massacrer ; vous n'y tiendrez pas un quart d'heure. Et il lui désignait tour à tour le mur de la rue Saint-Martin, si peu solide qu'il tomberait aux premiers coups, et la grille, d'une largeur extrême, qui ne pouvait être défendue par une poignée d'hommes. Guinard avoua que la position n'était pas tenable. Heureux de l'avoir persuadé, dans l'intérêt de ses collections, le conservateur le quitta pour Ledru-Rollin qui s'était installé dans la salle de dessin, dite des filatures. Lui aussi se rendait compte et déplorait que le choix se fût orienté ainsi. Il fut discuté[58] s'il ne valait pas mieux se retirer ; mais, avant qu'aucune décision eût été prise, ce devait être bientôt, au loin, des coups de feu. A ce moment, les montagnards regrettèrent peut-être de n'avoir pas laissé entrer les rares défenseurs qu'ils s'étaient suscités comme d'avoir empêché les barricades qui auraient quelque temps protégé les leurs. Quelques groupes des Droits de l'homme avaient essayé, commandés par Villain, d'élever des abris d'où le tir serait plus facile. Un membre de la commission des Vingt-Cinq avait aussi tenté d'emporter à la baïonnette le poste de la rue Bourg-l'Abbé, mais le poste avait résisté ; et la troupe avertie était déjà en marche. Chaque instant précipitait le dénouement de cette journée si mal conçue, si impolitique, dans laquelle une poignée d'hommes obscurs, pressés de saisir le pouvoir dans le trouble d'un lendemain révolutionnaire, entraînèrent les chefs de la démocratie et amenèrent ce qu'on a justement appelé le suicide de la Montagne[59]. — Les artilleurs ne croyaient plus du tout au succès ; ils laissaient voir leur inquiétude. Le conservateur démontrait de nouveau l'inutilité de toute tentative aux montagnards et reprochait avec vivacité à Considérant de s'être fourvoyé, lui, homme de science, dans cette mêlée[60]. En dépit des coups de fusils, la discussion avait continué dans la salle des filatures. Elle dura trois quarts d'heure. M. Pouillet avait raison dans ses conseils. On ne savait pas encore, même à ce moment, s'il fallait agir, et le concierge entendit Ledru-Rollin s'écrier : Forestier n'arrive pas ! Faut-il sortir pour haranguer le peuple ou renoncer à notre projet ?[61] Forestier eût été là que la question se fût posée, semblable. On cherchait l'action ou, à son défaut, à s'en donner l'allure. A la fin, on s'en rendit compte tout haut : Nous perdons notre temps d'une manière fâcheuse ; les instants sont précieux ; il faut en finir[62]... Puis on se remettait à écrire, utilisant avec une certaine fébrilité les plumes et le papier que le concierge avait apportés. Des billets étaient remis à des émissaires pour des destinations sans doute problématiques. Tous sentaient la fausseté de leur position et, par là même, malgré leurs efforts, restaient de plus en plus paralysés. En révolte contre l'exécutif et le législatif au nom du droit, ces hommes n'avaient d'autre appui qu'un texte de loi aux yeux du pays, et le pays n'était pas assez éduqué politiquement pour les comprendre. Tout prouvait la résistance impossible à l'heure même où il ne subsistait plus que le combat le plus désespéré ; il ne restait à celui-ci qu'à s'éclairer, par ce fait même, d'une majesté si parfaitement héroïque, si cruelle, que le pays, non pas réveillé, — il était trop tard, — mais averti, se souviendrait un jour de la manière dont son gouvernement l'avait trompé. Tel demeurait le véritable et seul débat que la minute actuelle autorisait encore, et tous y pensaient, sans doute, tout en ne paraissant pas vouloir qu'il fût soulevé. Peut-être, sur ce point aussi, la foi faisait-elle défaut. Les derniers représentants de la cause républicaine se demandaient qui viendrait utiliser le mouvement créé par leur héroïsme. Se trouverait-il même encore, à cette heure-là, de véritables montagnards ? Et l'ensemble de ces doutes permet de saisir combien, à l'instar du peuple, ils avaient été lassés, eux aussi, par la révolution. Cette grosse échauffourée ne devait même pas avoir l'honneur de succomber les armes à la main. Elle n'eut pas de quoi livrer bataille, et pour avoir voulu vaincre pacifiquement, une fois la partie engagée contre un adversaire armé, il ne pouvait lui rester que la fuite[63]. Il semble, par le mot de Ledru-Rollin, rapporté plus haut, que les montagnards eussent compté sur Forestier. Il ne devait pas venir, et la compréhension de tout son caractère aurait suffi pour persuader de son abstention. Il n'avait d'ailleurs pas été prévenu. Interrogé la veille sur l'attitude qu'il comptait tenir le lendemain, il avait répondu qu'il se conformerait à la conduite de sa légion, décidé à la suivre sur le terrain qu'elle voudrait, mais aussi à ne l'influencer ou la conseiller d'aucune manière, et les causes fictives sur lesquelles reposait l'institution ressortaient précieusement de ce calcul si simple d'un chef de légion[64]. Renseigné déjà par l'aventure du 29 janvier qu'il avait eu le loisir de méditer en prison, Forestier désapprouvait la manifestation et l'aurait empêchée volontiers. Il comprenait que, dans un pays pointilleux de légalité, comme celui-ci, dans toute insurrection venue d'en bas, il fallait commencer, sous le régime parlementaire, par avoir la majorité, ou du moins, la contrebalancer et la rendre douteuse[65]. — Les représentants s'étant plaint plusieurs fois de ne pas le voir, l'un d'eux, Suchet, offrit d'aller le chercher à la mairie du VIe arrondissement. Un trompette, Delarue, entrant pour annoncer qu'on élevait une barricade, reçut l'ordre d'accompagner le messager. En route, celui-ci remarqua que la foule augmentait et se montrait plus exaltée. A la mairie du VIe, il trouva deux chefs de bataillon et leur dit : Dans la situation où nous sommes, il est indispensable que la garde nationale arrive pour se placer entre la population et l'armée. Personne ne se montra de son avis. Il fut averti que Forestier était absent. Il voulut parler au maire, qui le fit arrêter. Forestier n'était effectivement pas là. En sortant de l'état-major, il avait craint d'être enlevé par le peuple et entraîné. Sa matinée s'était passée à recevoir des visites qui l'avaient vraisemblablement fortifié dans sa volonté d'abstention. Sur le boulevard, l'après-midi, des hommes en blouse l'avaient suivi longtemps au cri de Vive Forestier ! Vive la Constitution ! Il avait aussi parcouru les rues des Gravilliers, Transnonain, Aumaire, Frépillon, de la Croix, du Pont-aux-Biches ; il était revenu par la rue Notre-Dame-de-Nazareth. Son cortège ne fut dispersé que rue Vendôme par le poste de la VIe légion agissant sur son impulsion personnelle[66]. Arrêté rue Meslay, devant le front d'un bataillon, il reçut du général Perrot l'ordre de se mettre en rapport avec l'oncle du dictateur de juin, le général de brigade de Cavaignac. La discussion ne pouvait plus durer. — La recherche était superflue ; le combat écarté, il ne restait bien que la fuite. Plusieurs se décidèrent à quitter le Conservatoire afin de propager l'insurrection[67]. Pensaient-ils réellement y parvenir ? Un député, suivi d'un élève de l'école d'Alfort et d'une trentaine d'hommes en blouse, se rendit rue Saint-Denis au poste des Bains-Saint-Sauveur, afin de l'entraîner ; mais le même refus que précédemment, doublé de menaces, fit reculer le montagnard. A la mairie de Belleville, même scène, même refus formel. La Montagne était suffisamment compromise et des gens obscurs, inconnus de l'émeute, commençaient d'afficher sur les murs un placard rouge ainsi rédigé : Au peuple, à la garde nationale, à l'armée. — La constitution est violée ! Le peuple se lève pour la défendre... La Montagne est à son poste. Aux armes ! Aux armes ! Vive la République ! Vive la Constitution ! Daté : Au Conservatoire des Arts-et-Métiers, le 13 juin, à deux heures[68]. Cent vingt et une signatures suivaient cette proclamation tardive et qui paraissait répondre à une manœuvre de police. Elle n'avait, en tout cas, pu être imprimée aux Arts-et-Métiers, où il ne se trouvait ni caractères d'imprimerie, ni encre grasse. Elle avait été apposée fort loin du Conservatoire, rue de la Jussienne, à une heure où la cause révolutionnaire apparaissait nettement perdue. La lutte se précisait autour du Conservatoire. Des gardes nationaux étaient accourus par le passage du Cheval-Rouge contre la barricade élevée rue Saint-Martin, et les capitaines qui les commandaient, apercevant des artilleurs également de la garde nationale derrière la barricade, les sommèrent de la détruire. Les artilleurs, avertis par leur colonel d'éviter tout ce qui pourrait ressembler à une insurrection, mirent la crosse en l'air, au moment même où les hommes en blouse tiraient du côté de la rue Grenétat. Le capitaine Goubeau fut blessé et une nouvelle décharge atteignit deux soldats. Les artilleurs se replièrent dans le Conservatoire. Les gardes nationaux de la 6e légion repartirent et s'élancèrent baïonnette au canon. Le tambour rythmait le pas de charge. Le général de Cavaignac, arrivé le matin même de Versailles, et qui se tenait à la porte Saint-Martin, écoutait la fusillade quand un garde national vint lui demander du renfort. Il conduisit aussitôt le 62e de ligne dans la rue Saint-Martin en se faisant précéder par quatre compagnies au pas de course. Le commandant Gelly de Montcla, qui les menait, se heurta bientôt à la barricade, peu redoutable, composée de deux voitures, d'un tas de fumier et de roues réunies avec des chaînes. A cinquante pas d'elle, le commandant vit plusieurs représentants et une soixantaine d'artilleurs ; ceux-ci levaient la crosse en l'air. Cavaignac cria de loin, très vite : Ne parlementez pas ! Marchez ! Marchez ! Refoulez ces gens-là, désarmez-les et arrêtez-les ! La barricade fut vite détruite et franchie. Les soldats avancèrent jusqu'à la grille du Conservatoire. Pilhes, Boch, Deville, Vauthier et Fargin-Fayolle, députés, furent arrêtés dans le corps de garde, dont le poste n'hésita pas. Les artilleurs, qui se trouvaient dans la première cour, se contentèrent de vouloir maintenir la grille qui fut enfoncée ; ils se replièrent, la compagnie entrant baïonnette en avant, dans l'intérieur du Conservatoire, et cherchèrent à fuir. On criait : Les représentants en avant ! ou : Tenez encore un instant ! — La première des deux compagnies du 62e de ligne, après avoir franchi la première cour, se divisa en deux sections et parcourut l'établissement dans la pensée de prévenir les évasions et de ramener les fuyards vers la grille où ils seraient pris. La première découvrit des artilleurs derrière la voiture de porteur d'eau, mais ils s'enfuirent à l'approche de la troupe le long d'un couloir qui leur fut indiqué par une femme. La seconde pénétra dans la salle des filatures et les grenadiers couchèrent en joue les représentants ; le lieutenant Castelbon dut les empêcher de tirer ; les députés et les artilleurs se précipitaient d'ailleurs dans le jardin par les fenêtres, soit par les vasistas ouverts, soit en brisant les carreaux. La compagnie, restée dans la première cour, entourait et injuriait les prisonniers désarmés. Elle les aligna même le long du mur et les couchait en joue en s'écriant : Il est temps que cela finisse, il n'en sortira pas un vivant[69]. Le commandant de Montcla les arrêta et une baïonnette ayant été dirigée contre la poitrine de Rattier : Ne tuez pas cet homme ! s'écria-t-il encore. Tel était l'esprit de la troupe en 1849[70]. Tous les officiers ne ressemblaient d'ailleurs pas à ceux qui avaient ici retenu leurs hommes, et le colonel d'Alphonse, à la barricade de la rue Saint-Martin, vint menacer un ivrogne de le faire fusiller, s'il continuait à crier : Vive la République ! Vive la Constitution ! Lorsque le colonel entra dans la première cour où se trouvaient à ce moment Ledru-Rollin, Guinard et un groupe d'artilleurs, Guinard, très calme, s'avança vers lui : Monsieur, dit-il, nous espérons que vous nous ferez respecter. La fuite pouvait être heureuse grâce aux nombreuses rues sur lesquelles donnait, très vaste, le Conservatoire des Arts-et-Métiers. Ledru-Rollin et Considérant durent y songer à leur tour : on leur avait barré le passage quand ils se présentèrent à la grille. Ils ne voulaient pas sortir avant que leurs compagnons fussent en sûreté. Les artilleurs entraient dans des appartements, au hasard de leurs chemins, changeaient de vêtements, puis ils reprenaient leur course. Ils rencontrèrent souvent alors des gens du peuple, armés, qui semblaient de nouveau prêts à la lutte et qui, à la nouvelle que la troupe était aux Arts-et-Métiers, persévéraient dans leur résolution. Ils pensaient que de cette bataille devait quand même sortir quelque chose ; ils ne comprenaient pas que cet effort eût pu être tenté sans aucune pensée de réussite ; aussi se plaignaient-ils qu'on les eût empêchés d'élever des barricades. Ils cherchaient à toutes ces contradictions des motifs mystérieux, et, fidèles à leur instinct, à leur colère, à leur devoir, la vie comptant moins pour eux que pour les gens fortunés, ils recommencèrent leurs barricades. Elles s'élevèrent rue Transnonain, rue Frépillon, rue Jean-Robert, rue Aumaire, et ne furent enlevées qu'après une résistance tenace. Rue de la Croix, les insurgés laissèrent trois morts[71]. La bataille se livra aussi rue du Pont-aux-Biches, rue Phélipeaux, rue de Breteuil, rue Chapon, rue du Temple ; vis-à-vis de la rue Meslay, la troupe arriva juste pour empêcher d'élever la barricade[72]. Le Conservatoire était maintenant évacué. Certains avaient fui par le toit d'une maison de la rue de Breteuil portant le n° 7, en appuyant une échelle contre le mur de la cour des Brevets puis en se laissant glisser dans la rue le long d'une corde attachée à un support de réverbère. D'autres étaient partis par la rue Vaucauson et la rue du Vert-Bois, d'autres, enfin, par la porte qui donnait sur le marché Saint-Martin. Ledru-Rollin, revenant sur ses pas, fut seul dans la salle des filatures en face de M. Pouillet auquel il demanda par où il pourrait se retirer. Celui-ci lui indiqua la porte située dans le fond du jardin à gauche. Afin de pénétrer dans le jardin, dont le sol était de niveau avec celui de la salle, le député fut obligé de franchir un de ces vasistas qui sont pratiqués dans les fenêtres monumentales, incident qui devait plus tard servir de thème facile aux caricaturistes de la réaction[73]. Guinard, quant à lui, ne consentit pas à s'échapper et se rendit dans l'appartement du conservateur où celui-ci lui avait conseillé, puisqu'il refusait de partir, d'accepter un refuge. Sur de nouvelles instances il consentit enfin, une demi-heure après environ, à s'enfuir dans une voiture qu'on avait été vite chercher. Dans le jardin, Ledru-Rollin fut rejoint par Martin Bernard et Considérant. Tout le monde, maintenant, avait fui[74]. Le domestique de M. Pouillet s'approcha : Vous trouverez la porte au fond du jardin ouverte. Ils étaient à peine sortis que les soldats entraient. Prenez garde aux massifs, disait l'un deux, il y a des cartouches. Cartouches bien inutiles que l'on retrouva presque toutes dans les fusils brisés des artilleurs. En déclarant le 12 qu'il défendrait la constitution, même par les armes, Ledru-Rollin fit une inconséquence. Il en commit une seconde le lendemain, aux Arts-et-Métiers, en enjoignant au peuple de rester pacifique quand même. La situation était mal choisie pour un combat ; mais il n'y a rien de pis qu'une défaite sans coup férir[75]. — Ils avaient à peine fait soixante pas qu'ils étaient reconnus et entourés. Un cortège de patriotes les escorta. Or ces fuyards étaient tous trois hommes de cœur ; ils souffraient doublement ; ils ne savaient de quel côté diriger leurs pas. Trois fois, ils durent rétrograder en apercevant les troupes[76]. Ils s'arrêtèrent au coin de la rue du Temple. Un groupe se forma et quelques hommes se détachèrent pour explorer la rue des Fontaines. Il faut nous jeter dans des maisons, dit Ledru-Rollin[77] ; avant cinq minutes, nos pérégrinations aboutiront dans une patrouille quelconque et notre arrestation, en sus, pourrait provoquer un conflit inutile. Ils s'engagèrent dans la rue des Fontaines. Devant la prison des Madelonnettes, Ledru-Rollin vit le directeur, un nommé Petet, qui lui devait sa position. Il lui tendit la main : Sauvez-nous ! Le protégé se récusa : il était le plus fort. Un assistant lui dit : Faites entrer M. Ledru-Rollin. Il s'y refusa de nouveau, absolument. — Les fugitifs arrivèrent au coin de la rue Borda, devant une porte dont ils demandèrent vainement l'entrée. Considérant proposa d'écouter et de suivre un bel enfant qui lui avait pris la main : Ayez confiance, assurait-il, ayez confiance en moi et venez. — Ledru-Rollin finit par sortir de Paris, se réfugia dans la banlieue où il apprit que l'Assemblée, sur le réquisitoire du procureur général Baroche, autorisait les poursuites et l'accusation décrétées contre lui. Il quitta la France le 6 juillet avec quelques amis. Après un séjour rapide en Belgique, il gagna la Grande-Bretagne. Il y retrouva non seulement Louis Blanc et Caussidière, mais Etienne Arago, Martin Bernard, Landolphe, Rattier et d'autres. La tentative insurrectionnelle se prolongea cependant. Les
troupes se tenaient l'arme chargée, baïonnette au canon, sous les ordres du
colonel d'Alphonse, autour du Conservatoire. Un bataillon du 62e barrait
l'entrée de la rue Royale-Saint-Martin. Les boutiques fermées, et une voiture
placée en travers de la petite rue, les monceaux d'armes brisées disaient les
efforts inutiles, et restreints en même temps, de la révolution. Quelques
postes de gardes nationaux ayant inquiété le colonel par leurs allures et
leurs protestations, il les fit arrêter ; ses soldats poussaient les
prisonniers devant eux à coups de crosse et à coups de pied dans les reins. Le peuple regardait, et dans ce peuple, bon nombre, en
voyant ce spectacle, commencèrent à trouver le pain moins amer et à reprendre
goût à l'existence ; il se souvenait de la garde nationale de juin 1848[78]. Juin 1848
était, en effet, une des causes initiales de l'échec de juin 1849. Le peuple,
à son tour, ne faisait plus guère de projets, et encore dans sa minorité. Ceux qui n'avaient pas pris part à la journée se
flattaient d'avoir bien jugé la situation et repoussaient énergiquement toute
nouvelle tentative. L'ambiguïté qui avait présidé au début et dans la
perpétration de cette affaire touchait au dénouement. La ville était pleine
de troupes. Cent mille hommes campaient dans les rues. Tout ce qui avait le
moins du monde trempé dans cette déplorable échauffourée, ceux mêmes que leur
seule notoriété démocratique désignait à la police se hâtèrent de quitter
Paris à la faveur des ténèbres ou d'y chercher dans ses profondeurs quelque
asile sûr. Durant une partie de la nuit, des gardes nationaux des environs,
que le prolétariat parisien a surnommé les Bédouins de la banlieue,
arrivèrent, la lutte finie, par bandes avinées en croyant, comme sous le
faible pouvoir du général Cavaignac, recommencer les sanglantes saturnales de
1848. Mais, cette fois, on ne leur fit pas le même accueil. Paris dormait. On
leur conseilla d'aller en faire autant[79]. Changarnier devenait le héros de la situation[80]. Il masquait ainsi le prince-président, pour la plus grande joie des partis monarchiques, qui ne comprenaient pas sur ce point leur mauvais calcul. La bourgeoisie, quoique satisfaite du côté matériel, ressentait une satisfaction quelque peu inquiète et ne regardait pas ce nouveau sauveur comme elle avait contemplé Cavaignac, quelques jours, en juin. Changarnier n'était d'ailleurs pas assez intelligent pour se rendre compte des nuances ; il était persuadé de son rôle considérable et certain, aussi, de ce fait, d'être appelé, bientôt, à en jouer un plus important[81]. Son imagination, un peu éventée, lui découvrait tous les horizons : musqué, tranchant, vantard, faisant l'ordre en rondomont, présomptueux jusqu'à l'impertinence, exagérant contre les Parisiens les axiomes bourrus du général Bugeaud, diplomate borné, malgré ses prétentions à la finesse, peu perspicace, manquant surtout de sens commun, il ne sut ni se juger, ni juger la situation. Il eut la faiblesse de se surfaire à ses propres yeux et prit pour argent comptant le gros encens que les réactions ne manquent jamais de jeter au visage du gendarme qui les tire de danger. Il se retrancha dans une formule un peu usée déjà, la politique de l'ordre, affectant d'une manière très ostensible de s'envelopper dans cette formule comme dans un nuage. Sans dévouement réel à une cause quelconque, sans opinion comme sans parti, mais prêt à embrasser la cause du succès, il ne servait que des intérêts secondaires et immédiats. De cette nullité même, il espérait tirer un grand avantage, la curiosité. Cet entreprenant militaire voulait arriver à tout à travers les circonstances. Impropre au choix du public ou des événements, au demeurant, homme nul en affaires et destiné à une mauvaise fin, M. Changarnier allait devenir un des personnages du dernier acte de la révolution[82]. La scène allait donc bien changer après le 13 juin. Au seul point de vue de l'enseignement, notamment, la suite en était le 18 juin où commençaient de s'établir les bases de la loi Falloux. * * *Pendant l'émeute, l'Assemblée avait tenu séance. Par une
erreur de son président, elle ne devait pas se réunir. Il fallait donc
avertir les députés. La plupart des chefs de la majorité s'étaient,
d'eux-mêmes, réunis chez M. de Kératry. Il régnait
là sur tous les visages, beaucoup d'animation et d'anxiété ; la bataille
était tout à la fois redoutée et appelée. On commença par fort accuser le
ministère de mollesse. Thiers, plongé dans un grand fauteuil, les jambes
étendues, se frottait le ventre — car il ressentait quelques atteintes de la
maladie régnante — et s'écriait avec hauteur et humeur, de sa voix de fausset
la plus grêle, qu'il était bien singulier qu'on ne songeât pas à mettre Paris
en état de siège[83]. Tout ce monde
auquel l'habitude aurait dû, peut-être, conférer d'avantage l'expérience des
révolutions, gagna la Chambre. Les députés y arrivaient de toutes parts. A
deux heures, ils entraient en séance. Les bancs de la majorité seule — droite
et centre — étaient remplis au grand complet ; la Montagne restait presque
déserte ; on y remarquait d'autant plus, parmi les cinq ou six députés qui
apprenaient à supporter les regards ironiques de leurs collègues, Lagrange et
Pierre Leroux. Le silence morne qui régnait dans
cette partie de l'Assemblée était plus effrayant que les cris qui en
partaient d'ordinaire. Il annonçait que la discussion avait cessé et que la
guerre civile commençait[84]. — A cette
heure, sa première tentative était déjà dispersée. Odilon Barrot nota qu'il aurait pu profiter des
circonstances pour constater que les représentants absents étaient
précisément les mêmes dont les noms s'alignaient sur les manifestes insurrectionnels[85] ; pourtant il
annonça que nul n'aurait à répondre que de sa participation directe et
personnelle à l'attentat. Bien des motifs de nature
diverse, a-t-il expliqué, me portaient à
rester ainsi dans les voies d'une grande modération. Je savais trop bien que
les facilités, dans les moments de crise, sont offertes au gouvernement pour
des mesures extrêmes, mais aussi je n'ignorais pas comment les premières
impressions passées, la réaction vient vite. J'avais fait, de ces revirements
d'opinion, lors de la fameuse enquête de 1848, une expérience trop récente
encore pour l'avoir oubliée[86]. Il n'y
paraissait guère. — Après avoir rendu compte des mesures prises, et demandé
que l'Assemblée se constituât en permanence, ce qui fut adopté aussitôt par
acclamation, il exposait la nécessité d'armer le pouvoir si la révolte
s'organisait et prenait un caractère général, quand un huissier lui remit un
billet de Dufaure ainsi rédigé : J'ai attendu autant
que j'ai pu. Je crois le moment venu de déclarer Paris en état de siège.
Le hasard s'affirmait, une fois de plus, un grand maître et la scène n'aurait
pu être mieux préparée. La conclusion du discours
que j'adressais à l'Assemblée vient de m'être transmise par M. Dufaure,
dit le président du Conseil et, prenant en même temps des mains de M.
Lacrosse le projet de la mise en état de siège qui
avait été préparé d'avance[87], il proposa de
le voter d'urgence. Encore une fois des approbations enthousiastes
ratifièrent. — Le projet était ainsi conçu : Considérant
qu'une insurrection armée, dirigée contre les pouvoirs constitutionnels de la
République, a éclaté dans Paris et qu'elle peut s'étendre à d'autres villes
de France, qu'il importe d'armer le pouvoir de tous les moyens nécessaires
pour assurer la répression prompte et efficace de cette insurrection, de
rendre force à la loi et de maintenir la Constitution : Art 1 : La ville de
Paris et toute la circonscription comprise dans la première division
militaire sont mises en état de siège. — Art. 2 : Cette mesure pourra être
étendue aux villes dans lesquelles de semblables menaces éclateraient et
lorsque les préfets auront constaté, par un arrêté, le fait de la révolte
contre les lois. En racontant la scène qui suivit, Barrot s'est contenté de dire que les montagnards déploraient l'absence de leurs amis[88]. La scène fut différente. Lagrange demanda la parole afin de protester contre la façon d'agir du gouvernement. Il rappela que la Chambre avait été convoquée au dernier moment ; ne fallait-il pas laisser le temps de venir aux montagnards ? Beaucoup d'entre eux, dit-il, et il s'en est fallu de très peu que je ne fusse dans ce cas, étaient absents depuis ce matin et ne sont pas encore rentrés à leur domicile jusqu'à présent. On ne me contestera donc pas le droit de demander pourquoi, en présence de la gravité d'événements dont la probabilité ne menace pas depuis deux heures seulement, on n'a pas fixé de séance hier pour aujourd'hui ; je demanderai pourquoi, au contraire, on a décidé, sans nous consulter, qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de séance, ce qui nous prive ici de pouvoir, à haute voix, plaider la cause des absents, surtout ailleurs que devant des auditeurs qui se sont déjà déclarés, non pas encore leurs ennemis, peut-être, mais certainement, au moins, leurs adversaires. Qui sait si ce n'était pas afin d'agir loin du peuple, sans être vu de lui, que les ministres avaient ordonné ou fait ordonner qu'il n'y aurait pas de séance ? Vous prévoyiez que les actes, que vos actes coupables qui avaient déjà provoqué de légitimes émotions populaires, et qui ont justement amené la proposition de mise en accusation, étaient de nature à impressionner le pays dans ses entrailles les plus profondes. Vous le prévoyiez bien, vous dis-je, et, en prévision de ce qui arrive, en prévoyance des mesures de sévère brutalité que vous ne craignez pas d'appeler sur vos collègues absents, vous avez voulu agir seuls et que le pays ne vous vît pas. Il ajoutait même : Je vous crois encore coupables aujourd'hui de vous réunir à huis clos tout exprès pour improviser des mesures qui doivent ensanglanter Paris et en faire, j'en ai bien peur, le tombeau de la République. Je suis presque seul ici, du moins suis-je heureux de protester contre les mesures sanguinaires que je vous crois capables de prendre après avoir porté une main sacrilège sur la Constitution. Et Barrot — qui oublia de consigner dans ses mémoires combien il s'était trompé — lui répondit : Je ne répondrai qu'à peine à l'honorable M. Lagrange... Assurément il est parfaitement consciencieux, mais il verra jusqu'à quel point la passion politique peut égarer un homme de bien. Il accusait ensuite les montagnards de perdre la République et demandait à l'Assemblée de se retirer dans ses bureaux ainsi que de déclarer sa permanence, jusqu'à ce que la loi ait triomphé de la révolte. Charras faisait observer que le président demandait l'état de siège sans avoir été renseigné sur l'état de l'émeute. Interrompu par les vociférations du centre et de la droite, il gardait la parole à force de ténacité : Je rappelle à M. le président du Conseil que cette décision est extrêmement grave, la plus grave qu'il soit donné à l'Assemblée de prendre dans une position bien moins critique, à coup sûr, que celle où se trouvèrent Paris et le pays au mois de juin 1848 ; je rappelle encore que M. Barrot n'a pas voulu alors s'associer, sans doute parce qu'il ne se trouvait pas assez éclairé, au vote de l'Assemblée qui déclarait l'état de siège. Dufaure l'appuyait en invoquant les provocations insérées dans les journaux du matin, provocations, disait-il, qui n'ont pas d'exemple dans toute l'histoire de notre longue révolution. Et l'Assemblée, l'urgence une fois prise en considération, se retirait dans ses bureaux afin de nommer une commission. Pendant l'attente, les bancs de la gauche se garnirent peu
à peu. Chaque apparition nouvelle d'un montagnard
excitait les sourires, alors qu'on voyait tel d'entre eux qui, la veille, se
perdait dans une barbe luxuriante, reparaître le menton et le visage
complètement rasés. La majorité exigea que les noms des vingt-cinq
représentants, inscrits au bas du manifeste de l'insurrection, fussent lus à
haute voix, et lorsque commença cette longue procession de montagnards,
montant l'un après l'autre à la tribune pour y porter leurs désaveux, les uns
avec une indignation affectée, les autres avec un embarras mal dissimulé,
elle les accueillait par des lazzis et des sarcasmes ; elle renonçait bien à
les poursuivre, mais elle ne renonçait pas à les humilier. Ce fut une faute,
car, en politique, il vaut mieux souvent frapper qu'humilier ses adversaires
; les partis pardonnent plutôt une sévérité, même excessive, que le mépris.
Il eût été plus politique de mettre hors de l'Assemblée cent vingt
signataires qui avaient mis l'Assemblée hors la loi, que de les blesser
ainsi, tout en leur laissant les moyens d'assouvir leurs ressentiments : au
jour du conflit entre le Parlement et le président de la République, une
grande partie des cent vingt voix donnèrent la majorité et la dictature à ce
dernier[89].
Dans un des bureaux, se rencontrèrent Cavaignac, P. Leroux, Quentin-Beauchart
et Victor Hugo, qui se déclarait, quant à lui, pour l'état de siège[90]. Le rapporteur, Gustave de Beaumont, connu par son manque de sens politique et par sa docilité, concluait naturellement à la nécessité pressante de l'état de siège. Il énonçait les circonstances solennelles, la violence démagogique, les horreurs de la guerre civile, l'anarchie déchaînée. Messieurs, il est des moments où toutes les menaces des partis et où toute dissidence d'opinion s'effacent. Nous sommes arrivés à ce moment suprême[91] où la société, menacée par les partis anarchiques, ne peut être sauvée que par l'union intime de tous les amis de l'ordre, étroitement unis sous le drapeau de la Constitution et de la République. — Pierre Leroux demanda la parole. Le président rappela qu'il y avait deux propositions distinctes, une concernant l'urgence, l'autre le vote du décret. La proposition d'urgence doit être votée d'abord et distinctement ; aucune discussion ne peut s'établir, quant à présent, que sur l'urgence même. Ainsi, si c'est sur le fond que M. Pierre Leroux veut parler et non sur l'urgence, il faut avant tout qu'il laisse statuer sur l'urgence. Leroux répondait, sans convaincre de cette évidence peu discutable, que l'urgence et le fonds étaient une seule et même chose, mais céda, pour avoir la parole. — L'urgence était aussitôt votée. Pierre Leroux excita de suite les rumeurs : Il n'y a rien de si abominable que l'état de siège ; une
année tout entière de calamités nous l'a prouvé, et si, aujourd'hui, en juin,
la guerre civile éclate, c'est à l'état de siège que vous avez eu en juin
dernier que ce résultat est dû. Il relevait les interruptions en
s'illusionnant sur ce que ses adversaires entendaient par le mot de
conscience : Je crois que votre conscience vous
commandera d'écouter tranquillement mes observations. Nous sommes presque
seuls ici, trois ou quatre de nos amis, pour représenter l'opinion que je
défends ; vous êtes 500... Vous faites des coups de majorité, vous déclarez à
coups de majorité que la constitution n'est pas violée quand elle l'est
ouvertement... Et revenant à l'état de siège de juin 48 qui avait
déchaîné tant de réaction : Oui, tous les malheurs
qui nous menacent et que nous éprouvons viennent précisément de cette mise en
état de siège du mois de juin de l'année dernière. J'étais ici, et j'ai vu...
comment se sont enchaînées toutes les mesures les plus désastreuses et
comment le despotisme a continué à sortir de là pour attaquer l'humanité...
Ainsi que je le disais à la Constituante, il n'y a pas de justice sans
clémence, il n'y a pas de justice sans miséricorde... Ceux que vous aviez
investis, en juin dernier, de ce pouvoir arbitraire, que leur est-il arrivé ?
Il leur est arrivé qu'ils n'ont pas su en profiter, qu'ils se sont perdus
eux-mêmes ; aucune clémence, aucune grandeur, toujours la peur...
Cavaignac demandait d'une voix sèche la parole, mais le socialiste continuait
en rappelant qu'il n'avait même pas été possible de parler de l'amnistie. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus que des partis
acharnés, des partis qui sont menacés. Voulez-vous donc établir un pareil
état de choses, au lieu de terminer le combat par la clémence, par les lois
ordinaires ; voulez-vous sortir des lois, voulez vous, puisqu'on vous accuse
de violer la Constitution, la violer complètement ? L'état de siège, c'est la
violation la plus flagrante de tous les droits que donne la Constitution...
Quand vous aurez abdiqué tous les droits en établissant l'état de siège,
croyez-vous que vous serez vous-mêmes à même de rentrer dans le régime des
lois ? La Constituante l'avait cru, et elle a été longtemps sans pouvoir y
rentrer, et quand elle y est rentrée, elle était elle-même détruite dans son
esprit par le régime qu'elle avait enduré. Il défendait ses amis en demandant
à partager leur sort s'ils étaient condamnés, demeurant de cœur avec eux,
encore qu'il n'eût pas approuvé leur tactique. Il légitimait l'insurrection
en face de la Constitution. C'est une
imperfection de l'esprit humain, mais au fond de ces constitutions, — tous
ceux qui connaissent l'histoire politique le savent, — se trouve la cause de
cette imperfection, le principe même de la réclamation que nos ancêtres
avaient consacrée, c'est-à-dire ce droit d'insurrection... Lorsque le texte
de la constitution paraît manifestement violé, l'individualité, cet être que
Dieu a revêtu de sentiment, d'intelligence et de conscience, proteste. De là,
ce droit d'insurrection que vous n'avez pas écrit dans la Constitution, que
nos pères avaient écrit et qui a été implicitement convenu dans les
discussions mêmes de la Constituante... En répondant, Cavaignac allait, toujours sans s'en douter, faire le jeu de la réaction. La droite et le centre l'applaudissaient. Cavaignac rappela que, trois jours après la victoire de juin, il était monté à la tribune pour demander la clémence. Il protestait sur le mot : Tombé du pouvoir, et c'est dans le crépitement des applaudissements, après avoir déjà dit : Nous sommes descendus du pouvoir qu'il reprenait : Je le répète et je le répète à dessein, nous sommes descendus du pouvoir. La volonté nationale ne renverse pas, elle ordonne, on lui obéit. — Oui, renchérissait un membre de la droite, vous êtes dignement descendu du pouvoir. — Cavaignac appuyait ainsi la demande de mise en état de siège de toute son autorité, de toute son expérience, par une de ces allocutions brèves, comme il en faisait quelquefois et dans lesquelles son esprit, naturellement médiocre et obscur, gagnant les hauteurs de son âme, approchait le sublime. Dans ces circonstances, il devenait, pour un moment, l'homme le plus véritablement éloquent que j'aie entendu, dit Tocqueville, dans nos assemblées[92]. Le ton même du général et cette éloquence, encore qu'un peu simple, dont s'anime en plus sa défense, donnent, en effet, la mesure de cette sincérité insuffisamment défiante des circonstances contre lesquelles elle se donnait cours. Vous êtes républicain de la veille, et si je le disais de moi-même, peut-être me contesteriez-vous ce titre. Cela est vrai, je n'ai pas travaillé pour la République avant sa fondation, je n'ai pas souffert pour elle, je le regrette, je m'en ferais aujourd'hui un honneur. Mais, quand la République est venue, je l'ai saluée de mon respect et de mon dévouement, je l'ai servie, je ne servirai pas autre chose, entendez-vous. Et, nerveux, à travers de nouveaux bravos, indiquant du doigt le sténographe du Moniteur : Ecrivez-le mot à mot, que cela reste gravé dans les annales de nos délibérations : je ne servirai pas autre chose. J'ai fait plus que servir la République, je l'ai gouvernée ; c'est un dépôt d'honneur que j'ai conservé, non pas comme un titre, mais comme une obligation ; c'est un devoir, et que je livrerai pur et sans faiblesse au jugement de la postérité. (Nouveaux applaudissements.) Mais ce que je vous dis là, c'est un droit que je me donne à votre égard... et c'est pour cela que je vous le dis, vous m'inspirez une douleur profonde. Entre vous et nous, c'est à qui sert le mieux la République, n'est-ce pas ? Eh bien, ma douleur, c'est que vous la serviez bien mal. J'espère, pour le bonheur du pays, qu'elle n'est pas destinée à périr. Si nous étions condamnés à une pareille douleur, rappelez-vous bien que nous accuserions vos exagérations et vos fureurs. L'Assemblée faisait ensuite poursuivre les représentants
arrêtés en délit d'insurrection. Vainement le fils de Jérôme demandait la
question préalable. — La séance continua le soir. De beaux discours faciles
sur la Constitution violée légitimaient pour la majorité les rigueurs
parlementaires. L'Assemblée qui avait violé, quant à elle, la Constitution en
faisant attaquer la République romaine, était hors de cause, justement, par
ses poursuites, contre ceux qu'elle avait acculés à la révolte. Elle leva sa
permanence à onze heures et demie du soir, satisfaite de son œuvre. Leroux
faisait appel à la clémence et à un moment d'autant plus opportun que peu de temps après que la mise en état de siège eut été
prononcée, on apprit que l'insurrection était étouffée[93]. Falloux était
réapparu sur la fin de la séance pour venir assurer que révolte n'était pas
éteinte et qu'il subsistait ici et là encore quelque agitation. Mais
Cavaignac, persuadé d'avoir sauvé la République en in, pensait la sauver ici
en appuyant Barrot. Le président du Conseil en était convaincu davantage
encore, et l'aimable penchant qui le poussait à faire le jeu d'autrui comme à
transformer des fautes en vertus, se donnait, une fois de plus, toute
carrière[94]
: Les démagogies, dit-il, ont été et resteront éternellement les mêmes : elles
invoquent toujours le droit en le violant et se couvriront du principe de la
souveraineté nationale tout en l'outrageant... Se croyant en possession de la
vérité absolue, elles sont bientôt conduites à cette conviction que la
violence qu'elles font à la majorité dans l'intérêt de cette prétendue vérité
est légitime. C'est alors qu'elles adoptent et pratiquent cette maxime des
jésuites : la fin justifie les moyens, et qu'elles se permettent les plus
horribles cruautés en entonnant des hymnes à la vertu et à l'humanité.
Inutile de raisonner avec de tels gens ; la force militaire peut seule les
arrêter et les contenir, et c'est seulement lorsqu'elles sont parvenues à
créer le despotisme que, devant lui, elles s'inclinent et se taisent[95]. C'est au nom
d'un raisonnement à peu près similaire, quoique appliqué contre ceux qui le
tenaient au 13 juin 1849 comme au 13 juin 1848, que Louis-Napoléon justifiera
le 2 décembre. Mais Barrot ne se doutait pas qu'en terminant son chapitre sur
la réflexion suivante, il consignait lui-même le mouvement de réaction qui
n'avait cessé depuis mars 1848 et qu'il avait tant servi comme président du
Conseil : Telle fut cette journée du 13 juin, assez
misérable parodie des cruelles journées de juin de l'année précédente. Dans
l'une comme dans l'autre de ces insurrections, le fanatisme politique avait
fait alliance avec le socialisme : avec une différence, toutefois, qu'en 1849
l'élément politique dominait, tandis qu'en 1848 c'était l'élément socialiste[96]. Ce n'était pas
le ministère qui profitait de la victoire, ni le général qui l'avait
remportée : l'un et l'autre étaient, au contraire, perdus par elle ; l'élu de
tant de milliers de suffrages enthousiastes en tirait seul, sans le paraître,
le bénéfice. Il semblait n'avoir pas pris part à la
lutte, dont un autre s'était chargé si spontanément[97]. Il en recueillit le résultat l'après-midi. De chaleureuses acclamations le saluèrent, au point qu'il en fut assez orgueilleusement ému. Il était sorti de l'Elysée accompagné de sept ou huit généraux et d'un piquet de lanciers ; de plus, faubourg Saint-Honoré, le général Changarnier, flanqué de Castellane, vint au-devant de lui[98]. Dès la place de la Concorde, la foule se pressa, tellement compacte, que le cortège ne pouvait avancer qu'au petit pas, au milieu d'acclamations frénétiques. Après avoir parcouru ainsi toute la ligne des boulevards et le faubourg Saint-Antoine, où les dispositions populaires devenaient de moins en moins bienveillantes, au point que, boulevard du Temple, place de la Bastille, le silence fut total, visiblement hostile[99], Louis-Napoléon rentra vers six heures du soir par les quais, le Carrousel, la rue de Rivoli, la place de la Concorde et les Champs-Elysées, à travers l'enthousiasme des troupes[100]. — Comme le général Changarnier, auquel il n'avait pas adressé la parole de la journée, pendant les quatre heures qu'avait duré leur promenade[101], le félicitait, il répondit moitié sérieusement, moitié riant[102] : Oui, général, la journée a été bonne, très bonne ; mais vous m'avez fait passer bien rapidement devant les Tuileries[103]. — Ce mot singulier, s'il est véridique — et il doit l'être — indique la voie où s'engageait de plus en plus le président[104] : dans sa malice gênante et petite, il y a déjà un peu de l'esprit facile, nigaud, quelquefois, du second Empire[105]. En dehors de l'état de siège, comme pour l'étayer
davantage et le mieux expliquer, paraissaient deux proclamations au peuple,
une de l'Assemblée, une du président, suivies d'un décret qui dissolvait la
légion d'artillerie de la garde nationale de la Seine. La première
proclamation, après avoir invoqué la souveraineté du peuple, odieusement méconnue par une minorité factieuse,
faisant appel à la force pour compromettre de
nouveau, par une guerre impie, la paix publique et la prospérité du pays prêtes
à renaître, certifiait que l'Assemblée
législative, issue de la volonté nationale, gardienne de la République et de
la Constitution, remplirait son devoir et défendrait jusqu'à la mort la République. Le président disait
: Quelques factieux osent soulever l'étendard de la
révolte contre un gouvernement légitime, puisqu'il est le produit du suffrage
universel. Ils m'accusent d'avoir violé la Constitution, moi qui ai supporté
depuis six mois, sans en être ému, leurs injures, leurs calomnies, leurs
provocations. La majorité de l'Assemblée elle-même est le but de leurs
outrages. L'accusation dont je suis l'objet n'est qu'un prétexte, et la
preuve c'est que ceux qui m'attaquent me poursuivaient déjà avec la même
haine, la même injustice, alors que le peuple de Paris me nommait
représentant et le peuple de la France président de la République. Ce système
d'agitation entretient dans le pays le malaise et la défiance qui engendrent
la misère ; il faut qu'il cesse. Il est temps que les bons se rassurent et
que les méchants tremblent. La République n'a pas d'ennemis plus implacables
que ces hommes qui, perpétuant le désordre, nous forcent à changer la France
en un camp, nos projets d'amélioration et de progrès en des préparatifs de
lutte et de défense. Élu par la nation, la cause que je défends est la vôtre,
celle de vos familles comme celle de vos propriétés, celle du pauvre comme
celle du riche, celle de la civilisation tout entière. Je ne reculerai devant
rien pour la faire triompher. — Lui aussi était amené peu à peu, par
le bloc des intérêts réactionnaires, toujours si rapidement constitué à
travers les partis, à diminuer son idéal personnel en même temps que la
promesse d'avenir dont il aurait pu demeurer, et demeurait encore, quand
même, quoique à peine désormais, en partie, le représentant. Le gouvernement avait enfin suspendu six journaux : le Peuple, la République démocratique et sociale, la Vraie République, la Démocratie pacifique, la Réforme, la Tribune des peuples ; et les gardes nationaux, trop satisfaits de la besogne qui leur était confiée, pour l'accomplir simplement, dévastèrent les imprimeries et les bureaux. Rue du Coq-Héron, surtout, la brutalité se manifesta avec plus de violence, sans que rien ne la justifiât ; et les faits relevés se précisaient si gênants ensuite qu'on essaya de les dénaturer en avançant que le mal était venu de la résistance opposée par les ouvriers. Il n'en était rien[106] ; les ouvriers se tenaient sans plus à leur travail quand les gardes nationaux, auxquels s'étaient joints quelques chasseurs de Vincennes, se précipitèrent dans les ateliers, renversant les cases, dispersant les caractères, brisant à coups de baïonnette et de crosse de fusil tout ce qui leur tombait sous les mains[107]. Darimon vit l'irruption dans les bureaux du Peuple. Elle est presque comique. La porte céda sous des coups furieux, et un homme affolé, tenant deux pistolets, se précipita en criant : A la première résistance, je vous brûle la cervelle. Il trouva devant lui deux hommes sans défense, tranquillement assis. Derrière lui des gardes nationaux, des chasseurs de Vincennes, déchaînés, détruisirent tout, systématiquement, à coups de pieds, de sabre et de crosse de fusil, tout, jusqu'aux chaises et aux portes-plumes, et comme les deux personnes présentes finissaient par protester, elles furent mises en état d'arrestation. Parmi les gardes nationaux se trouvaient, paraît-il[108], les banquiers Bellet, Mellez, Béjot, le comte et le vicomte de Tournon, le prince de Monaco, le prince de Craon, le vicomte de la Ferronays, le baron Debaye. Le 1er bataillon et la 1re légion, à qui avait été confié l'exécution de ce mandat, avaient pour capitaine M. Vieyrat, dont le nom figure sur le tableau des agents de change de la ville de Paris[109]. — La littérature de la rue de Poitiers portait ses fruits. Deux de ses thuriféraires désavouèrent cependant leurs complices exagérés : Victor Hugo, qui dénonça l'abus à la tribune, Dufaure, qui dut le flétrir ; Les faits n'étaient qu'une sorte de prélude au 2 décembre, une sorte d'exercice préparatoire, — mais exécuté, cette fois encore, par l'ordre du Parlement, qui ne voyait pas que cette victoire lui portait un coup décisif[110]. Nous aurions été plus forts, dira Tocqueville[111] en se plaçant au point de vue ministériel spécial qui était le sien, si nous avions moins réussi. * * *Ce qui donnait quelque importance
à cette tentative, dans laquelle nos montagnards venaient d'échouer si
misérablement, c'est qu'elle était loin d'être isolée. Non seulement elle se
reliait à des mouvements semblables, depuis longtemps préparés dans plusieurs
départements de la France, mais elle était également attendue en Hongrie, en
Italie, et à notre frontière même, à Bade, par toutes-ces révolutions
vaincues qui se débattaient alors dans l'agonie et qui n'espéraient leur
salut que du succès de l'insurrection de Paris[112]. Barrot
ajoutait que ces rapports intimes et solidaires de
la démagogie française avec toutes les démagogies de l'Europe[113] lui furent
confirmés par les proclamations que le gouvernement révolutionnaire de Baden
faisait afficher, le 14 juin 1849, à Carlsruhe : Nous
recevons à l'instant par voie extraordinaire, une dépêche télégraphique du 13
juin : trois heures et demie : Le peuple se rassemble sur les boulevards,
la force armée approche. — Six heures du
soir : Le mouvement devient plus menaçant. — Huit heures et demie : Paris est en état de siège ; la
cause de la liberté[114]... — Il est
certain que les nationalités expirantes continuaient de tourner les regards
vers la capitale : des idées européennes et, comptant sur un dernier effort
du Paris révolutionnaire, espéraient ; mais les rapports suivis du
prolétariat européen n'existaient pour ainsi dire pas ; tout l'avait déjà
prouvé avant février, tout l'avait encore mieux démontré en juin. Il existait plus d'entente en France même, moins suivie, toutefois qu'on ne cherchait à le faire croire et que certains ne l'imaginaient de bonne foi. L'un des correspondants des divers partis socialistes, ou simplement républicains révolutionnaires de Paris et de la province, mis en avant par l'accusation, Paya , semble plutôt un besogneux, convaincu, mais faisant fort honnêtement servir ses convictions aux nécessités de la vie. Ayant remarqué que les journaux démocratiques manquaient d'agence qui leur permît de faire correspondre régulièrement et facilement Paris avec la province, il avait installé, 108 ; rue de l'Université, un bureau de correspondance conçu dans cet esprit. Aucun fait de complot n'était relevé contre lui. Les lettres citées sont d'une naïveté qui eût désarmé n'importe quels autres juges. Néanmoins l'accusation dira : On voit que Paya a été l'un des agents les plus actifs et les plus initiés du complot. — Au surplus, l'insurrection anéantie à Paris si complètement et si vite, il était évident que tout allait manquer d'autre part, même si la révolte avait été plus sérieuse. Le ton des journaux comme la Patrie était volontairement exagéré : Il paraît certain que le complot devait éclater dans les principales villes de France le même jour ; les agitateurs connus s'étaient installés en permanence, attendant les nouvelles de Paris. A Bordeaux, le 13, les sections des sociétés secrètes étaient en permanence, les clubs convoqués pour le 14 au matin. A Reims, le président du club s'est rendu, le 13, à la sous-préfecture et a signifié au sous-préfet que son mandat était terminé, le triomphe de l'insurrection étant assuré à Paris. D'autres meneurs se rendaient chez le maire pour lui annoncer le renversement du gouvernement. A Toulouse, même tentative et même insuccès. La nouvelle de la compression instantanée de l'insurrection à Paris a maintenu partout la même tranquillité... La même naïveté semblait répandue partout aussi, et chez les révolutionnaires qui venaient avec force et simplicité annoncer aux préfets et aux maires la nécessité de leur démission, et chez les journalistes qui, soldés pour mettre sous les yeux des lecteurs les dangers courus, établissaient si visiblement l'exagération de ceux-ci. — A quoi se réduisaient, en réalité, ces insurrections locales si vite réprimées ? A Reims, il ne se passa rien : avant que le mouvement ait pu se grouper, les autorités, prévenues par Paris, avaient pris toutes les dispositions. Elles sentaient si bien l'exagération de leurs mesures qu'elles s'en excusaient auprès des habitants : Citoyens, vos magistrats ont dû prendre des dispositions pendant que le gouvernement se montrait en mesure de faire respecter, à Paris, le gouvernement et les lois[115]. Et le 15, les journaux locaux relataient l'extrême tranquillité de la ville. — A Châlons, des curieux s'étaient simplement réunis sur la place de l'Hôtel-de-Ville sans faire entendre de cris et le préfet télégraphiait : Aucune apparence, aucune crainte de désordre ne s'est manifestée sur aucun point. Le travail des ateliers n'a pas souffert de l'inquiétude des esprits. Jamais notre population n'a donné de plus grande preuve de sagesse et d'amour du calme. A Dijon, même repos. Seul un article du Citoyen[116], journal démocratique de la Côte-d'Or, pouvait surprendre, mais la presse n'était-elle donc déjà plus libre ? Le maréchal Bugeaud n'est plus, annonçait le rédacteur. Le peuple tardait trop à décréter d'accusation cet instrument brutal de toutes les tyrannies. Dieu s'est impatienté et il a appelé à sa barre le héros de la rue Transnonain. Oui, Dieu l'a jugé cet homme farouche, aussi farouche que l'insulaire de l'archipel de la Sonde, qui cloue une tête de mort au mât de son canot. A Toulouse, l'agitation ne présente aucun caractère dangereux. Un commencement de trouble menace le 11 et le 12, à la nouvelle de l'attaque de Rome. Les déplorables nouvelles de Rome, disait l'Émancipation du 12 juin, ne pouvaient qu'émouvoir profondément notre population. Dès la matinée d'avant-hier, l'indignation publique s'exhalait en propos des plus significatifs. Les militaires comme les ouvriers, comme les citoyens qui n'attendent pas des cosaques la satisfaction de leurs instincts anti-français, manifestaient hautement, dans les lieux publics, sur les places, leur réprobation pour cet article inouï, exécrable, qui fait égorger une république par une république et avilit la Constitution et le vœu d'une assemblée souveraine devant la volonté coupable d'un homme arrivé hier de l'étranger. — Le dimanche, place du Capitole, une foule assez considérable avait chanté la Marseillaise et le Chant du départ. Aussi les journaux conservateurs de l'endroit parlaient-ils de sinistres rumeurs[117]. Dès le lundi, le maire, inquiet des attroupements, les faisait dissoudre comme nuisant au retour de la confiance, paralysant l'industrie et le travail[118]. Les groupes trouvaient cette fois la troupe devant eux et, aux premières sommations, ils se dispersèrent ; quelques arrestations complétèrent la scène, qui avait duré de dix heures à onze heures du matin. A Perpignan, on correspondait avec les montagnards, on se passait leurs lettres ; mais, malgré un certain désir révolutionnaire, on n'arrivait pas à la cohésion. — Le 13 au soir, l'autorité fit afficher la première dépêche qui renseignait sur l'affaire des boulevards et des citoyens vinrent demander à la préfecture que le texte même des dépêches leur fût communiqué ; d'autres voulaient que les postes de la ligne fussent relevés parla garde nationale. Le préfet refusa de supporter des réclamations de ce genre et y répondit par un bataillon d'infanterie. Tout rentra dans l'ordre. A Bordeaux, aux cris de Vive Ledru-Rollin ! et au chant de la Marseillaise, un rassemblement s'étendait sur la place de la Préfecture. La garde nationale et la ligne unies le dispersèrent, sans rencontrer de résistance suivie. A minuit, après une charge de lanciers, la place était vide. Le lendemain, on ne parvint à arrêter qu'un seul individu qui avait voulu faire crier : Vive la Sociale ! à un officier supérieur[119]. A Castres, dans le Tarn-et-Garonne, les désordres, minimes, survenaient par la faute de l'élément militaire. — A Toulon, où certains avaient annoncé des catastrophes, il ne se passa rien. — A Angoulême, parce que des ouvriers tailleurs, fort jeunes, se promenaient en chantant un air montagnard dont le refrain était Aux armes ! les royalistes terrorisés se demandaient si cet appel ne répondait pas à un mot d'ordre parti de Paris. — A Lons-le-Saunier, à Mâcon, à Nantes, l'impossible était tenté afin de relever quelque trace de complot ; on ne découvrait — paraît-il — que de mystérieux conciliabules. A Périgueux, le bruit courait que les Lyonnais marchaient sur Paris. — A Rouen, une sourde fermentation travaillait la ville ; cependant aucune manifestation contraire à l'ordre public[120] n'était relevée. — A Elbeuf, afin de justifier des mesures exagérées, on racontait que des conclaves se tenaient dans les campagnes, toujours, d'ailleurs, sans qu'ils aboutissent. — A Evreux, on cria : A bas Napoléon ! Vive la Montagne ! Vive la République démocratique et sociale ! Certains journaux affirmaient qu'on avait crié même : Vive le sang ![121] Les lecteurs le croyaient. — A Amiens, des précautions extraordinaires furent prises inutilement[122]. Dans le Bas et le Haut-Rhin, l'indignation contre la
politique de l'Assemblée était sérieuse. A Colmar, à Strasbourg, on ne
comprenait pas la politique de Louis-Napoléon, surtout après avoir espéré en
lui. Ainsi, disait le Rhin, encore d'un côté les républicains, de l'autre les
royalistes ; d'une part, une majorité qui s'adjuge un bill d'indemnité par la
violation la plus audacieuse de la Constitution, d'autre part, les républicains
qui en veulent le respect et qui, pour l'assurer, sont forcés de se
constituer en dehors de la majorité factieuse. Des rassemblements se
formaient à Strasbourg sur la place de Broglie ; le club de la rue des Juifs
ayant été fermé par l'autorité, les protestataires tenaient leur réunion en
plein vent. Leurs attaques contre l'autorité se réduisirent à des projets
ainsi qu'à huer le général de division Bougenel et le général d'artillerie
Thouvenin. Le journal de droite ne manquait cependant pas à son inévitable
consigne : Quand nous vous demandions, hier, si le
pouvoir occulte avait l'intention de déposséder les autorités, nous avions
des données trop vagues pour affirmer le fait. Aujourd'hui, il paraît certain
qu'il y avait, tout prêts à entrer en fonctions' un préfet, un maire et un
directeur de la poste aux lettres ; on ne nous a pas désigné le général. Il
paraît qu'il existe des ramifications du comité démocratique dans beaucoup de
localités du département ; au commencement de la démonstration, on a
immédiatement expédié la communication suivante aux sous-comités : Les
rouges sont maîtres de la ville, tenez-vous prêts. — L'accusation
relèvera dans la suite des placards appelant aux armes, à cause de la
violation de la Constitution[123], et dira, sans
détailler ses sources : Il semble résulter de
nombreux documents que le complot étendait sur les divers points de la France
ses intelligences et ses ramifications[124]. Dans l'Allier, il y eut une petite tentative. Alors qu'à Moulins la population révolutionnaire demeurait très calme, dans les campagnes environnantes, la nuit du 14 au 15, plusieurs villages sonnèrent le tocsin et les paysans se réunirent. Ils formaient une bande différemment armée — faulx et fusils — d'environ sept cents personnes, hommes et femmes. Le frère du député du département, Fargin-Fayolle, dit Sommerat, les conduisait. La bande tint conseil, groupée en un lieu appelé Brande-des-Mothes, mangea et attendit le courrier de Paris. Les nouvelles reçues étant mauvaises, elle se sépara d'elle-même[125]. Rien de véritable ne fut donc tenté et le plus grand nombre de ces émeutes locales s'apaisèrent elles-mêmes. — Une seule fut une guerre civile plus sérieuse que l'aventure parisienne, celle de Lyon. Le règne de Louis-Philippe avait achevé la célébrité révolutionnaire de la vieille cité par les luttes auxquelles la prédisposent à la fois les éléments dont elle se compose et sa configuration. Ses habitants se partagent en deux classes bien distinctes, les ouvriers, qui forment la majorité, et ceux qui les emploient, entre lesquels les conflits sont presque journaliers. Les premiers occupent les quartiers montueux, repaires assez faciles à préparer de la révolte ; les seconds conservent jalousement, non sans quelque dureté orgueilleuse, trop visible, la petite vallée resserrée entre le Rhône et la Saône, si bien à découvert entre les deux blocs d'habitations ouvrières destinées à la destruction en cas de combat[126]. Lyon, de plus, avait presque constamment été, au XIXe siècle, un des plus importants champs de bataille des partis. Tous y avaient donné, et leurs intrigues avaient redoublé, travaillant toute la population à la faveur de la révolution de 1848. Les autorités, sous le roi des Français, n'avaient pu, en dépit de leurs efforts, recruter une garde nationale, et les résultats obtenus, minimes, partiels, incertains, ne permettaient pas la sécurité ; deux tristes expériences en avaient établi la preuve. Le gouvernement provisoire, à son tour, avait eu du mal à réprimer une insurrection ; il n'y était même parvenu qu'au prix de quelques concessions, dont la conséquence forcée, au dire d'O. Barrot, avait été de fournir de nouvelles forces à ce foyer permanent des guerres civiles[127]. Bien des grandes cités manufacturières où les conditions du travail et du capital ne se trouvaient pas équilibrées présentaient la même fermentation contre l'injustice. Sur ce terrain fertile germait facilement la graine des cent trente-deux clubs dont parlait Louis Faucher[128], — et qui étaient peut-être plus nombreux encore[129], — des quatre grandes associations, surtout, qui réunissaient le mieux alors l'élite agissante de la classe ouvrière, les Carbonari, les Droits de l'homme, les Mutuellistes, les Voraces. — Les Mutuellistes dataient de 1834. En 1848, ils avaient fait de nombreux prosélytes, et, élargissant les sociétés de compagnonnage, attiré à eux des hommes des différents corps de métier. Les Droits de l'homme avaient compris Caussidière et Lagrange parmi leurs chefs en 1834. Février 1848 avait trouvé ses membres parfaitement organisés. Jusqu'en juin, les Droits de l'homme comprenaient cinquante sections. Les Carbonari enrôlaient deux mille cinq cents militants fraternels, les plus résolus, les plus conscients, les plus capables sur le terrain politique. Martin Bernard avait été leur chef dans la Loire. Ils s'étaient organisés, après la défaite de 1834, par la loge Les Amis de la Vérité. Plus tard, ce fut également sous le couvert d'une loge maçonnique de Calluire, Les Amis des hommes, que la propagande socialiste fut tentée, active, adroite, par la parole et l'écrit[130]. Les Amis des hommes fournirent plusieurs combattants à l'effort de juin 1849, dont quatre furent condamnés[131]. Ils trouvaient, au surplus, parmi certains des leurs, le souvenir de sociétés similaires ou même d'anciens charbonniers ; il n'est pas improbable que, justement, des charbonniers de 1830, français[132], et quelques initiés venus d'Italie, aient aidé à cette éclosion. A la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle, quelques francs-maçons seraient entrés dans l'association des Bons-Cousins[133]. En 1832, il y avait des charbonniers à Besançon[134], et actifs, depuis quelques années déjà, vraisemblablement. Les Carbonari coopérèrent à l'œuvre d'émancipation entreprise par les autres groupes qu'animait un même esprit et qui réussit surtout par la qualité de son recrutement. Au mois de février, la charbonnerie commandait partout[135]. Les Voraces, une des plus actives sociétés secrètes, elle aussi, et des plus dangereuses, avait des ramifications dans tout le département, ainsi que dans l'Ain et l'Isère. Son recrutement demeurait ordinaire et comprenait beaucoup de gens sans aveu[136]. — Les Mutuellistes avaient pour reconnaissance l'immortelle, pour insignes un ruban rouge et bleu ; les Droits de l'homme l'œillet, un ruban rouge et vert ; les Carbonari un chardon, un ruban rouge, bleu et noir ; les Voraces, la violette, un brassard rouge, une ceinture rouge. Toutes ces sociétés correspondaient plus ou moins entre elles, avaient un sens pratique étendu, et le rapport d'un agent au garde des sceaux[137] soulignait ce côté constructeur comme autrement dangereux que les phrases de rhéteur ou la tyrannie turbulente et anarchique des ateliers nationaux. Il détaillait les tentatives des sociétés, leurs efforts, leur volonté de suppléer à l'essai manqué de février[138]. L'acte des statuts de l'Association fraternelle de l'industrie française, qui indiquait cette tendance, porte la date du 21 janvier 1849. Les statuts de l'Association générale des tailleurs de pierre du Rhône, de l'Association fraternelle des ouvriers menuisiers de la ville de Lyon, de l'Association démocratique des industries réunies et de bien d'autres groupes montrent bien la force socialiste qui animait les volontés des travailleurs lyonnais. Un élan remarquable se poursuivait, qui fait songer un peu à celui de la coopération socialiste actuelle, et le procureur général réclamait instamment une règle particulière à l'usage de ces sociétés[139]. — Ce rapide aperçu permet de saisir pourquoi le terrain de l'émeute était mieux préparé, plus actif à Lyon qu'à Paris, et pourquoi le combat y fut si acharné. La présence du maréchal Bugeaud n'avait profité que peu de temps à la politique dite de l'ordre ; la ligne de conduite suivie à Rome avait, de plus, tout changé. Les élections de la Législative, la correspondance avec la Montagne, l'essai de celle-ci dans la capitale avaient déterminé le reste. La consigne sévère qui pesait sur la ville, les vexations nombreuses, les perquisitions, les malveillances, n'avaient pas arrêté l'action secrète, souterrainement répartie sur tant de points, partant de tant de groupements. L'influence s'éparpillait à travers l'armée, notamment dans le 2e léger prêt, sur le rapport de ses chefs, à être éloigné au premier moment critique. L'émeute possédait ainsi de quoi devenir terrible, et elle eût été plus vaste en même temps qu'elle eût résisté davantage si celle de Paris avait répondu à son attente ; de même, celle de la capitale se fût mieux développée sans doute, précédée par celle de la vieille cité. De Lyon partit, le 13 juin, dans le Peuple souverain, cet appel impérieux aux députés de la Montagne : En acceptant votre mandat, citoyens représentants, vous avez juré de faire respecter nos droits et notre liberté. Le moment est venu de prouver au monde entier que vous portez dignement ce nom de montagnard que vos pères ont rendu si grand sous la première révolution. La trahison nous enlace de toutes parts ; les ennemis du dedans ont ouvert les portes de la France aux ennemis du dehors... C'est à vous de prendre garde qu'il ne soit fait aucun dommage à la République. Vous avez derrière vous douze millions de citoyens ardents et dévoués, toujours prêts à mourir pour vous défendre[140]... Un autre article du Censeur, basé sur une nouvelle tirée d'un journal mazzinien de Turin, la Comédia, racontant que les troupes françaises auraient éprouvé un nouvel échec devant Rome, motiva, le 12 au soir, un rassemblement sur divers points de la ville. Le préfet, personnage à poigne cher à Léon Faucher, démentit aussitôt le bruit qui circulait avec persistance sur la foi des intentions, apparemment plus authentiques, assurait-on, venues par Marseille ; le 14, l'agitation grandissait. A la nouvelle que la Montagne défendait la Constitution, les démocrates lyonnais juraient de la venger. Apprenant que les régiments dévoués au peuple allaient être éloignés, les Voraces se soulevaient. Les dépêches n'étant pas parvenues par suite de l'état de l'atmosphère, l'indécision sur ce qui s'était passé à Paris entretenait bien des espérances, et le prolétariat les suivait toutes. La préfecture fut occupée par de forts détachements de troupes de la ligne. — Le soir du 14, l'arrivée des dépêches était connue et une députation de journalistes, conduite par un nommé Juif, vint demander à les voir. Le préfet répondit : Je ne dois compte à personne des dépêches que je reçois ; je puis, suivant mon appréciation, les publier ou les retenir, cependant mon droit une fois établi, je ne fais pas de difficulté de vous déclarer que je n'ai reçu aucune nouvelle. Les délégués se retirèrent. Juif murmurait : Nous savons maintenant ce qui nous reste à faire. Une bande, pendant ce temps, s'était détachée pour essayer de rejoindre le régiment qu'on avait écarté de la ville et auquel l'autorité militaire avait fait franchir déjà une forte étape, de façon qu'il ne pût être rattrapé. A neuf heures et demie, tandis que la foule s'épaississait
sans relâche devant la préfecture, un bulletin était distribué dans la rue
Centrale, en supplément au journal le Républicain, et affiché sur tous les
murs : Nous donnons comme positives les nouvelles
télégraphiques suivantes jusqu'à présent cachées au public : Paris, 14 juin.
La Montagne s'est constituée en Convention Nationale. Le peuple de Paris
répond à l'appel de nos représentants. L'arrestation du président de la
République et de ses ministres est décrétée. Des exemplaires
nombreux furent vite distribués en quelques instants. Aux bureaux du Peuple
souverain, la proclamation fut refusée par le bureau de rédaction à ceux qui
la réclamaient. Une bande de trois cents jeunes gens partit alors de la place
de la Préfecture et proclama la dépêche dans le quartier, au chant d'hymnes
patriotiques. D'autres bandes s'organisaient place des Terreaux. Une forte
patrouille, précédée d'agents de police, s'ébranla bientôt et traversa la
foule, d'où partirent les cris de Vive la Convention
! Vive la ligne ! Vive Ledru-Rollin ! Vive la République romaine ! Mort aux
Blancs ! A dix heures et demie, un bataillon du 56e, arrivé récemment,
se rangea en bataille devant la grille de la préfecture, puis envoya un
détachement, serré de près par la foule, vers l'hôtel de ville où, sur la
place du même nom, il chargea et balaya les manifestants. — Les clubs
restaient en permanence. Tout allait se décider le lendemain. Le 15 au matin, le rappel battait à la Croix-Rousse et le ralliement commençait autour d'un drapeau rouge. Deux ou trois cents hommes se dirigèrent au roulement du tambour vers la campagne à la recherche du 2e léger parti et déjà cherché la veille. Ne trouvant pas le régiment, ils se dirigèrent sur l'école vétérinaire. L'établissement, une fois entouré, fut assailli par un piquet du 17e léger, fort de cent cinquante hommes, et fut désarmé sans avoir eu le temps de se mettre en état de défense. Certains militaires suivirent les émeutiers ; la plus grande partie se retira dans les forts ; des élèves de l'école, nombreux, se joignirent aussi aux émeutiers. La colonne, forte d'environ douze cents personnes suivant les uns, de moins de cinq cents suivant les autres, revint à la Croix-Rousse où elle fut accueillie avec enthousiasme.— Magnan et le général Gémeau faisaient prévenir, pendant ce temps, tous les corps de troupes d'avoir à gagner les emplacements qui leur étaient assignés. Le général Montréal devait descendre les forts de la rive droite de la Saône avec tout ce qu'il pouvait mobiliser du 17e léger qui les occupait et gagner l'école vétérinaire vers laquelle, d'autre part, s'acheminaient aussi deux bataillons du 19e de ligne, un bataillon du 49e et la 10e batterie du 1er d'artillerie. Les troupes de Calluire et de Montessuy allaient prendre la position de la Croix-Rousse à revers, de concert avec la 7e batterie d'artillerie cantonnée à Fontaine. Magnan, qui se réservait le commandement supérieur, se préparait aussi à monter à la Croix-Rousse. Les insurgés avaient essayé de forcer la porte des Bernardines, défendue par la caserne crénelée du même nom, qui permettait la communication avec Lyon[141]. Ils s'étaient avancés en criant : Vive la ligne ! L'armée est pour nous ! L'officier avait commandé le feu et quinze hommes avaient été mortellement atteints. — La lutte commença, sérieuse aussitôt. Le tocsin appela aux armes. Les barricades s'élevèrent, d'ailleurs peu solides, dans la Grande-Rue ; l'une d'elles fut mieux construite, à la hauteur de l'église Saint-Denis. La fusillade crépitait sans arrêt devant la caserne. — Il était deux heures. Magnan commença d'exécuter son mouvement offensif, par les quais de la Saône. Lorsque ses hommes furent sur le plateau, avant de les lancer au feu, il les fit se serrer en masse, puis, en quelques mots énergiques[142], il leur expliqua qu'ils avaient à venger l'honneur de leur drapeau compromis le matin. Ils acclamèrent la République et jurèrent de le laver dans leur sang. Ce n'était même plus la tristesse résignée de quelques officiers en juin 1848 ; on était sûr maintenant d'accomplir son devoir, un devoir indiscutable, parfait. Magnan s'applaudissait de l'exécuter. Il ne pouvait qu'être prêt au coup d'Etat. L'artillerie se mit en batterie à 120 mètres des deux principales barricades et commença son tir sous le feu vif qui partait des maisons L'attaque s'avança, appuyée par des salves de mousqueterie. Peu à peu les barricades échelonnées le long de la Grande-Rue et des rues adjacentes, démolies à coups de canon, furent enlevées après une résistance assez faible. De part et d'autre, les morts et les blessés commençaient à se compter. La barricade principale de la Grande-Rue, dressée à l'endroit où la place de la Croix-Rousse mène sur la campagne, fut, au contraire, défendue avec acharnement. Elle subit la canonnade pendant plus de trois heures, sans cesser la riposte, et fut emportée d'assaut au prix de sacrifices répétés. Les compagnies de sapeurs et de mineurs ; qui arrivaient sur le lieu de l'engagement, cheminèrent le long de la Grande-Rue et se jetèrent contre les maisons occupées par les insurgés rue du Mail. Elles étaient soutenues par un bataillon du 6e léger suivi de six pièces d'artillerie. Les insurgés, pris entre deux feux, ne pouvant plus gagner la campagne, se précipitèrent le long de la rampe gravie précédemment par les soldats de Magnan et tombèrent entre les mains d'un escadron des guides qu'y avait dissimulé le général. Sept cents d'entre eux furent ainsi fait prisonniers. D'autres, réfugiés dans un autre quartier, essayèrent vainement une nouvelle résistance. — Le combat avait duré jusqu'à cinq heures. Tout ce temps, le général Gémeau, qui n'avait pas quitté l'hôtel de la préfecture, maintint la tranquillité du reste de la ville[143]. Le lendemain, le calme était rétabli. On évaluait à plus de cent cinquante le nombre des morts et des blessés du côté des insurgés, à plus de soixante du côté militaire. On procéda, en comptant celles qui suivirent à ce sujet, à mille quatre cent quatre-vingt-sept arrestations. Dans les localités voisines, à Vienne, à Rive-de-Gier et en quelques autres lieux, les affidés s'étaient tenus sous les armes, dans une attente passionnée. L'insuccès dissipa toute cette arrière-garde obscure de la cause populaire. — A Lyon, sur le lieu du combat le plus acharné, à la Croix-Rousse ; une foule curieuse, recueillie, assez mêlée, examinait les traces de la veille. Les dégâts étaient importants ; les demeures présentaient un aspect funèbre, méthodique et glacé. Une maison avait été particulièrement éventrée ; elle formait l'angle de la rue du Chapeau-Rouge : c'était la Mère des Voraces. * * *Le 14, à l'Assemblée, le président, après avoir donné communication d'un réquisitoire du procureur général de la Cour d'appel de Paris, contre Ledru-Rollin, Considérant, Boichot et Rattier, lut, sur la réquisition du député Grandin, prêt volontiers aux besognes accusatrices, l'affiche incendiaire[144], datée soi-disant des Arts-et-Métiers. Plusieurs montagnards protestèrent, et peut-être, s'ils n'avaient pas été sérieusement prévenus, d'une façon légitime. Peut-être aussi cette protestation était-elle nécessaire, afin que. la Montagne, décimée, continuât d'être représentée au Parlement, la tactique évidente de la droite et du centre s'efforçant sans discontinuer à la réduction de la gauche ; elle ne pouvait, en tout cas, que prêter aux sourires faciles et même à des accusations peu honorables puisqu'elle n'aurait évidemment pas eu lieu en cas de réussite : les journaux blancs et même azurés représentèrent à l'envi les pénitents rouges prompts à demander l'absolution. Anthony Thouret protestait contre un faux matériel. Laurent de l'Ardèche voyait là une infamie et s'expliquait : Il y avait des journaux, il y avait des signataires sur lesquels le procureur général pouvait formuler une enquête ; on a mieux aimé prendre une pièce apocryphe, sans nom d'imprimeur, qu'on a trouvée, dit-on, dans une rue de Paris, et sur laquelle se trouvaient, à point nommé, les noms de tous les membres qui ont signé l'acte d'accusation. Pascal Duprat déclarait n'avoir pas voulu sortir de la légalité. Bancel protestait contre les insultes ironiques de la droite ; il n'avait jamais été de ceux qui croient les révolutions faites avec de l'audace, mais avec beaucoup de modération et d'amour. Le défilé continuait. M. Tamisier ne parvenait pas à défendre Considérant. Théodore Bac s'effrayait inutilement de voir les partis se proscrire les uns les autres et demandait que la justice ne fît pas connaître à l'avance, avant d'avoir jugé, les noms des coupables. Ne croyez pas qu'il dépend de quelques paroles pour soulever une grande ville comme Paris ; ne croyez pas qu'il dépend de quelques agitateurs de causer cette longue commotion qui s'étend depuis si longtemps dans tout le pays ; ce sont des faits, ce sont des événements, ce sont des causes plus profondes, plus sérieuses que les agitations de quelques hommes qui produisent de si grands et si durables résultats. Attaquez-vous aux causes, attaquez-vous aux faits ; faites cesser ces causes et ces divisions qui nous séparent ; faites cesser les causes de la misère qui dévore le peuple et qui le tient toujours prêt à l'insoumission. Des protestations et des rumeurs accueillirent ces conseils. Odilon Barrot aurait déclaré, — un député le certifia, — posséder l'original de l'affiche aux multiples signatures. Le président du conseil, mis ainsi en demeure de fournir une preuve formelle, se déroba, mais personne de la majorité ne s'en inquiéta, ni ne lui en tint mauvais gré. Est-ce que je suis juge d'instruction ? se contenta-t-il de répondre ; est-ce que j'ai de tels documents entre les mains ? L'interpellateur put lui jeter impunément : Il est fort extraordinaire qu'on ne veuille pas reproduire à la tribune les déclarations faites au sein du bureau. (Rumeurs.) Le fait a une gravité immense. Si l'on possède l'original avec les signatures, de quel droit vient-on nous sommer de faire ici des déclarations ? Barrot continuant à n'opposer que son silence, un autre député s'employa pour le sauver, par une explication embarrassée. Cette triste séance fournissait l'avant-goût de celles qui devaient la suivre. La réaction, sans presque d'obstacles, se donnait libre carrière et Tien ne l'arrêtait, ni le bon sens, ni l'honneur. Après des remerciements à l'armée, à la garde nationale, au général en chef, elle vota vite une loi d'urgence, qui concédait au pouvoir la faculté d'interdire non seulement les clubs qu'il estimait dangereux, mais encore toute réunion non autorisée[145], en réalité une loi de fermeture de tous les clubs qui ne parlaient pas selon la thèse gouvernementale[146]. On suspendit l'application de l'article 67 de la loi de 1831, qui proscrivait la réunion sur la même tête du commandement des troupes et de la garde nationale, ce qui consacrait légalement le pouvoir extraordinaire de Changarnier. Dufaure obtint l'autorisation de proroger au delà du délai légal la dissolution des gardes nationales suspectes de ne pas partager les vues du pouvoir ; le ministère avait, d'ailleurs, déjà décrété de lui-même la dissolution de la légion d'artillerie et d'une compagnie de la 3e légion de la garde nationale de Paris, ainsi que de l'école d'Alfort. Les poursuites furent autorisées contre les représentants qui avaient pris part à la réunion des Arts-et-Métiers. L'état de siège persista à Paris, à Lyon ainsi que dans les départements environnants ; et le gouvernement, assez soutenu par la Législative, qui semblait tout lui permettre, lâcha ses agents. La valeur scientifique estimée de M. Pouillet n'entra pas en ligne de compte. Il fut révoqué pour n'avoir pas livré les députés montagnards. Le 22 juin, par une circulaire du garde des sceaux, Barrot invita les procureurs généraux à poursuivre comme séditieux le cri de : Vive la République sociale ! Les socialistes, les colporteurs de brochures dans les campagnes étaient recommandés à la surveillance vindicative des agents préfectoraux, si préparés à ce rôle brutal. Enfin le ministre de l'Intérieur renforçait l'ordonnance sur les clubs en ordonnant aux préfets de l'appliquer sans faiblesse. Barrot pouvait constater chaque jour, avec joie, le recul de l'idéal révolutionnaire ou même simplement réformateur. L'idée républicaine, à peine représentée par l'Assemblée législative, n'existe plus qu'à l'état de vaine protestation. La place est libre à quiconque, en vue de 1852, veut risquer le dé de son avenir sur ce numéro chanceux. Les débutants emploient à l'aise l'envergure de leur jeune éloquence. Les monarchistes aventureux et ambitieux, qui croient à l'avenir de la République, peuvent opérer leur conversion sans crainte qu'on leur rappelle le passé ou qu'on leur demande compte d'une tactique en apparence généreuse, puisqu'on n'en aperçoit pas le profit immédiat. Ils peuvent prendre date d'une démocratie débonnaire qui se colle aux phrases comme le petit oiseau à la glu. Libres sont aussi les troisièmes rôles de la presse et de la tribune dans le parti républicain de s'essayer aux premiers. Les stalles sont vides, s'y mettra qui veut. C'est l'heure des doublures, des douteux, des néophytes et des intrigants tardifs et timides. Mais l'histoire n'a pas mission de lever tant de masques dignes, au plus, de son dédain, il suffit que la jeunesse actuelle, elle qui a déjà brisé, nous l'espérons, les vieilles idoles, soit mise en garde contre les nouveaux fétiches de race inférieure, qui voudraient grimper sur l'autel[147]. La situation du cabinet, des divers partis parlementaires et du prince-président, à la suite du 13 juin, a été sentie assez justement par Tocqueville. Malgré les lacunes si regrettables[148] signalées dans cette perspicace intelligence, malgré le parti pris de quelques-uns de ses jugements, parti pris involontaire et qui semble un arrêt[149] dans le raisonnement, à travers ces vacillations mêmes, la vérité se fait jour, ici et là. Une partie de ses railleries semble naître de son impossibilité à comprendre divers faits, certaines pensées, d'une sécheresse souvent foncière aussi, trop réelle, trop initiale pour être heureuse, car seule vaut celle qui est voulue, par prudence, dans l'être que le contraire de cette sécheresse pourrait conduire quelquefois trop loin et trop vite. Que n'aurait-il acquis à croire davantage, sinon à cette démocratie, trop imaginaire, qu'il subissait tout en disant l'accepter, du moins à sa promesse voilée, à l'effort de construction qui se développe à travers son histoire, soit que ses chefs connus ou inconnus l'alimentent, soit qu'elle se décide d'elle-même par-dessus la minorité qui la guide ou la soutient en temps de calme, aux heures troubles, où elle sait devenir sublime en dépit de toutes ses défaillances. Etait-ce un long atavisme, la dure leçon constante de la réalité dont une force intérieure incomplète ne lui permettait pas de dépasser, pour le plus grand bien de la réalité prochaine, la désillusion momentanée, était-ce encore sa santé atteinte qui le retenait sur le bord de cet avenir, auquel plus libre, plus fort, plus sûr de lui-même et dédaigneux d'autrui, plus réaliste et idéaliste à la fois, il eut posément fourni un appui si sûr ?... A cette heure grise, en tout cas, il semble le contemporain le plus lucide, et sa situation de psychologue au cœur du ministère en fait le premier chroniqueur. La majorité, dit-il, était formée principalement, alors, de trois partis — le parti du président était encore trop peu nombreux et trop mal famé pour devoir être compté dans le Parlement —. Soixante à quatre-vingt membres, au plus, essayaient sincèrement, comme nous, de fonder la République modérée, c'était le seul point d'appui solide dans cette immense assemblée. Le reste de la majorité se composait de légitimistes, au nombre d'environ cent soixante, et d'anciens amis et partisans de la monarchie de Juillet, représentants pour la plupart de ces classes moyennes qui avaient gouverné et, surtout, exploité la France pendant dix-huit ans. Les légitimistes avaient été exclus du pouvoir sous le dernier gouvernement, ils n'avaient donc pas de places, de traitements à regretter. Grands propriétaires pour la plupart, ils n'avaient d'ailleurs pas le même besoin des fonctions publiques que les bourgeois ; ou, du moins, l'usage ne leur en avait pas autant enseigné la douceur. Quoique plus irréconciliables que d'autres, par leurs principes, avec la République, ils s'accordaient mieux que la plupart de la durée de celle-ci, car elle avait détruit leur destructeur et leur avait ouvert le pouvoir ; elle avait servi, tout à la fois, leur ambition et leur vengeance ; elle n'excitait contre elle que leur peur, qui était, à la vérité, fort grande. Les anciens conservateurs, qui formaient le gros de la majorité, étaient bien plus pressés de sortir de la République ; mais, comme la haine furieuse qu'ils portaient à celle-ci était fortement tenue en bride par la crainte des brocards auquel on l'exposerait en cherchant prématurément à l'abolir, que d'ailleurs ils avaient la longue habitude de marcher derrière le pouvoir, il nous eût été facile de les conduire si nous avions pu obtenir l'appui ou, seulement, la neutralité de leurs chefs, dont les principaux étaient alors, comme on sait, MM. Thiers et Molé. Cette situation bien aperçue, je compris qu'il fallait subordonner tous les buts secondaires au principal, qui était d'empêcher le renversement de la République et, surtout, de prévenir l'établissement de la monarchie bâtarde de Louis-Napoléon ; c'était, pour lors, le péril prochain[150]. Il redoutait surtout les amis du ministère. Lamoricière, entre autres, qui l'inquiétait par sa pétulance, ses propos imprudents et par son oisiveté, fut expédié comme ambassadeur en Russie où, seuls, les généraux et, de préférence, ceux qui sont célèbres, réussissent. Le prince-président avait commencé par s'y opposer[151], puis céda, grâce à l'intervention de Falloux, alors le seul homme du ministère en qui le président eût confiance[152], paraît-il. Tocqueville s'efforçait aussi de gagner, puis de retenir, les alliés nécessaires, tâche difficile à qui ne pouvait agir hors de son département sans l'assentiment du cabinet composé des esprits les plus honnêtes, mais si raides et si bornés, d'autre part, en politique, que le ministre se prenait à regretter quelquefois de n'avoir pas affaire à des coquins intelligents. Il voulait laisser aux légitimistes une grande influence dans la direction de l'instruction publique, parti qui présentait des inconvénients, mais grâce auquel des appuis seraient procurés au ministère lorsqu'il s'agirait de contenir le président et de l'empêcher de renverser la Constitution. Ainsi en arrivait-on à donner à la droite un gage des plus importants, des plus durables, — l'avenir même du pays par ses générations prochaines, — au nom de la nécessité républicaine. Le plan fut suivi non sans une certaine innocence politique. On laissa Falloux libre de ses mouvements dans son département, et le conseil lui permit de présenter à l'Assemblée le projet sur l'Instruction publique qui est devenu la loi du 15 mars 1850[153]. Tocqueville recommandait à tous les plus grands égards vis-à-vis de ces légitimistes si précieux, auprès desquels il servit de plus en plus d'intermédiaire, ce à quoi le prédisposaient son origine comme le monde dans lequel il avait été élevé, car, si la noblesse française a cessé d'être une classe, elle est restée une sorte de franc-maçonnerie dont tous les membres continuent à se reconnaître entre eux par je ne sais quels signes invisibles, quelles que soient les opinions qui les rendent étrangers les uns aux autres, ou même adversaires[154]. Cette même affinité aida son entente avec Falloux, qui se heurtait constamment, d'autre part, à la rudesse de Dufaure[155], au point que le cabinet fut plusieurs fois sur le point de rompre à cause de l'animosité des deux ministres, notamment au sujet d'un préfet[156]. Dufaure intriguait d'ailleurs, un peu, de son côté, et justement avec l'aide de Lamoricière dont se méfiait Tocqueville. Il était le grand maître occulte d'un Cercle de la Constitution, qui siégeait place Vendôme, et qui était, en réalité, une sorte de groupement du tiers parti que Dufaure voulait grossir afin de conserver de l'influence au Parlement une fois qu'il n'y serait plus[157]. Dufaure, en effet, ne cessait de rester le même, celui qui avait servi la pensée personnelle de Louis-Philippe et s'en était imprégné au point qu'il l'avait continuée ensuite, la monarchie et le monarque en moins, quand il avait choisi Cavaignac ; il entendait se servir dans le même esprit de Louis-Napoléon. Il ne voyait pas, comme Grévy, les défauts de la constitution de 1848, il ne se rendait pas compte, comme le pays, que le régime parlementaire, mal compris, lassait les meilleures volontés agissantes. Il ne pouvait donc que défendre la Constitution contre le prince-président, et le Parlement contre le peuple ; mais n'ayant plus ce Parlement pour lui, il ne lui restait que le cercle dans lequel il espérait — encore qu'on s'étonne de cet orgueil chez lui — reconstruire une sorte de rue de Poitiers à son usage. Il est vrai que son point de vue personnel et la certitude qu'il avait de l'excellence de celui-ci, de sa droiture, d'ailleurs incontestable, et de sa nécessité, l'empêchaient de distinguer une partie de ce qui vivait si intensément hors de sa sphère. Les anciens conservateurs, qui formaient le gros de la majorité, embarrassaient surtout le ministère. Ils avaient tout à la fois des opinions générales à faire prévaloir et beaucoup de passions particulières à satisfaire ; s'ils voulaient, comme le cabinet, que l'on rétablît l'ordre avec énergie, ils entendaient en plus que l'on profitât de la victoire pour faire des lois répressives et préventives exagérées, d'autant plus que, sur ce point encore, le cabinet entrait un peu dans leurs vues. Tocqueville, quant à lui, pensait que le seul moyen de sauver la liberté était encore de la restreindre. Dufaure n'avait-il pas dit à la Chambre, lorsqu'il avait été accusé de dictaturat : Oui, mais c'est une dictature parlementaire. Contre le droit imprescriptible qu'a une société de se sauvegarder, il n'y a point de droits individuels qui puissent prévaloir. Il est des nécessités impérieuses qui sont les mêmes pour tous les gouvernements, monarchies ou républiques, ce sont les nécessités qui les ont fait naître. De qui nous vient une cruelle expérience que nous ont donnés dix-huit mois d'agitation violente, des complots incessants, de formidables insurrections ?... Les conservateurs entendaient reprendre au plus vite les places pour leurs partisans ou leurs proches ; ils faisaient à nouveau preuve des passions qui avaient amené la chute de la monarchie de Juillet, et que la révolution n'avait pas détruites, mais affamées[158]. Tocqueville voyait d'un assez mauvais œil la majorité des fonctionnaires républicains ; il était annihilé dans ses intentions à ce sujet par Dufaure, détesté des conservateurs et pris par eux en cachette et de loin, car ils le redoutaient à la tribune, comme cible perpétuelle. Son collègue savait le raisonner plus finement : Qu'avons-nous entrepris ? Est-ce de sauver la République avec les républicains ? Non, car la plupart de ceux qui portent ce nom nous tueraient assurément avec elle, et ceux qui méritent de le porter ne s'élèvent pas à cent dans l'Assemblée. Nous avons entrepris de sauver la République avec des partis qui ne l'aiment point. Nous ne pouvons donc gouverner qu'avec l'aide de concessions ; seulement il ne faut jamais céder rien de substantiel. En cette matière, tout est dans la mesure. La meilleure garantie, et peut-être la seule qu'ait, en ce moment, la République, est notre maintien aux affaires. Il faut donc prendre tous les moyens honorables de nous y maintenir[159]. Il était sincère, mais ce passage — entre autres — dévoile encore son inexpérience des questions économiques et les côtés restreints de son intelligence. Dufaure, d'autre part, répondait qu'il suffisait de lutter chaque jour avec la plus grande énergie contre le socialisme, comme si l'on pouvait jamais satisfaire les hommes en ne s'occupant que de leur bien général sans tenir compte de leur vanité et de leurs intérêts particuliers[160]. Tocqueville respectait son caractère ; mais, au fond, le méprisait un peu, et cette absence d'entente permettait beaucoup à ces conservateurs patients, tenaces, qui ne voulaient ni prendre le gouvernement, ni laisser gouverner personne avec indépendance, qui n'admettaient pas non plus aux affaires des ministres qui ne fussent leurs créatures ou leurs instruments. Leurs embûches étaient journalières[161] ; répugnant à l'action franche, ils travaillaient secrètement la majorité, blâmaient le ministère, interprétaient défavorablement les moindres paroles des ministres et s'arrangeaient toujours de manière à ce que, trouvant le cabinet sans point d'appui, ils pussent, du moindre coup, le mettre par terre, car ils comptaient bien éconduire les ministres actuels après s'en être servi pour obtenir des lois draconiennes. Ils agissaient ainsi, à la fois, au Parlement, afin que l'influence du cabinet ne pût y durer, et sur l'esprit de Louis Bonaparte qui feignait d'ignorer leurs vues. Ils étaient encore dans cette illusion que Louis-Napoléon se trouvait toujours heureux de subir : leur tutelle. Ils l'obsédaient donc. Nous étions instruits par nos agents que la plupart d'entre eux, mais surtout MM. Thiers et Molé, le voyaient sans cesse en particulier et de poussaient de tout leur pouvoir à renverser, d'accord avec eux, et à frais et profits communs, la République. Ils formaient comme un ministère secret à côté du cabinet responsable[162]. La suite est plus curieuse encore, et nous permet de supputer la sincérité de Thiers lorsque l'impossibilité de créer autre chose le rabattit vers la République : A partir du 13 juin, je vécus dans des alarmes continuelles, craignant tous les jours qu'ils ne profitassent de notre victoire pour pousser Louis-Napoléon à quelque usurpation violente et qu'un beau matin, comme je le disais à Barrot, l'Empire ne vînt à lui passer entre les jambes. J'ai su, depuis, que nos craintes étaient plus fondées encore que je ne le croyais. Depuis ma sortie du ministère, j'ai appris, de source certaine, que, vers le mois de juillet 1849, un complot fut fait pour changer de vive force là constitution par l'entremise combinée du président et de l'Assemblée. Les chefs de la majorité et Louis-Napoléon étaient d'accord ; et le coup ne manqua que parce que Berryer qui, sans doute, craignit de faire un marché de dupe, refusa son concours et celui de son parti ; on ne renonça pas à la chose, pourtant, mais on ajourna, et quand je songe qu'au moment où j'écris ces lignes, c'est-à-dire deux ans seulement après l'époque dont je parle, la plupart de ces mêmes hommes s'indignent de voir le peuple violer la constitution en faisant pour Louis-Napoléon précisément ce qu'ils lui proposaient de faire alors eux-mêmes, je trouve qu'il est difficile de rencontrer un plus notable exemple de la versatilité des hommes et de la vanité des grands mots de patriotisme et de droit dont les petites passions se couvrent[163]. — On s'étonne, toutefois, que Thiers et Molé, qui comptaient en 48 sur la succession du prince, lui aient conseillé l'empire et l'on peut se demander si leurs avis ne tendaient pas à une révision constitutionnelle d'un autre ordre[164]. Cela est probable ; s'ils conseillèrent réellement l'Empire, leur changement permet de supposer une opinion publique de plus en plus napoléonienne[165], et leur attitude au deux décembre prouve qu'à part quelques-uns, dont le malheureux Baudin, ceux qui avaient réellement le droit de protester n'étaient plus là[166]. Comme ses collègues, le ministre des Affaires étrangères faisait sa cour au prince afin de capter sa confiance ou, tout au moins, de l'influencer ; dernier mot de la situation troublée issue de 1848, Louis-Napoléon se précisait si bien de plus en plus le point central du mouvement accompli que tous les hommes politiques, sauf de rares intransigeants, avaient été à lui, ne fût-ce qu'un jour. Tocqueville, en dépit de ses nombreuses réticences, avait subi le charme de son humeur bienveillante et facile, de son caractère humain, de son âme douce et même assez tendre ; il avait éprouvé sa sûreté dans les rapports, sa simplicité parfaite[167]. Il ne désespérait pas de s'établir dans son esprit et même, pour un certain temps, d'une manière assez solide. Il avait distingué que le prince, tout en admettant sans cesse près de lui les chefs de la majorité, supportait plutôt impatiemment leur joug et voyait là une prise possible sur son âme en même temps qu'un point de contact, décidé qu'il était à maintenir le pouvoir exécutif hors de toute atteinte. Il voulait donc entrer en partie dans les desseins de Louis-Napoléon sans sortir des siens. Il avait aussi cru remarquer la nécessité de nourrir l'esprit du prince d'une espérance quelconque afin de le tenir en repos. Ne pensant pas qu'un tel homme, après avoir été au pouvoir quatre ans, pût être replacé ensuite dans la vie privée, il voulait parer au plus pressé, qui consistait à l'empêcher de se jeter dans quelque entreprise dangereuse, et c'est à cette fin qu'il cherchait pour son ambition un point de vue qui le pût contenir. Je ne vous servirai jamais à renverser la République, lui disait-il, mais je travaillerai volontiers à vous y assurer une grande place, et je crois que tous mes amis finiront par entrer dans le même dessein. La constitution peut être révisée ; l'article 45 qui prohibe la réélection peut être changé. C'est là un but que nous vous aiderons volontiers à atteindre. Il lui laissait entrevoir que, s'il gouvernait la France tranquillement, bornant ses visées à n'être que le premier magistrat de la nation[168], il se pourrait qu'il fût élu d'un consentement presque unanime, les partis monarchiques ne voyant pas dans la prolongation illimitée de son pouvoir la ruine de leurs espérances, et le parti républicain envisageant le gouvernement tel que le sien comme le meilleur moyen d'habituer le pays à la République et de la lui faire goûter. Le prince se gardait de demander à son ministre dans quelle espérance particulière, du haut de quelle morale il prenait la raison de cet accent paternel, protecteur, et qui pouvait paraître comique s'il n'eût été sincère et très exact ; il écoutait, sans laisser voir son sentiment, selon son habitude[169]. Tocqueville espérait encore parce qu'il avait remarqué, à côté du fataliste qui se croyait appelé à être le maître de la France et, par elle, à dominer l'Europe, une sorte d'épicurien qui savait apprécier les plaisirs faciles de sa nouvelle position. Il était d'ailleurs mal entouré et recommandait souvent des gens de sac et de corde qui s'étaient jetés autrefois en désespérés dans son parti, ne sachant où aller, ou, ce qu'il appelait des gens à lui, c'est-à-dire, le plus souvent, des intrigants ou des fripons[170] ; tous ses amis étaient d'une ardeur égale à la curée. Le prince cédait-il, parce qu'il n'apercevait au travers des refus de son ancien ministre aucune vue particulière[171] ou aucun désir systématique de lui résister[172], eux revenaient sans pudeur à la charge. Dufaure, lui-même, avait été à demi gagné par la simplicité de manières du président. Passy seul semblait se plaire à lui demeurer désagréable, comme s'il avait cru s'abaisser en devenant le ministre d'un homme qu'il considérait comme un aventurier et cherchait à reprendre son niveau par l'impertinence[173]. Falloux, qui ne cherchait au travers de nos révolutions qu'un chemin pour ramener la religion catholique au pouvoir[174], demeurait toujours le premier en place. Le moment ne devait pas tarder cependant où l'accord cesserait et où l'auteur de la loi de l'enseignement, devenu tout à coup plein de méfiance devant la tradition napoléonienne, finirait par déclarer (le 14 juillet 1851) que la politique bonapartiste était l'avant-coureur général du socialisme. Ainsi, de quelque côté qu'il soit saisi par l'examen, à quelque moment, à travers le fait brutal, les journaux, les mémoires ou les récits contemporains, vu de l'extérieur ou de l'intérieur, quels que soient les matériaux dont se compose et s'étaye l'analyse essayée, le ministère apparaît condamné par ses tendances, par l'inutilité à laquelle il se voue volontairement, par la politique stérile qui résulte des capitulations individuelles et successives de ses membres dont aucun n'est d'accord. Un seul suit toujours sa ligne de conduite, un seul demeure, Louis-Napoléon. Et, en face de lui, maintenant que la coalition des légitimistes, des orléanistes et des conservateurs de toutes nuances a tué non seulement le parti socialiste, mais le parti républicain, un seul parti réellement fort se maintient également toujours, sur les ruines entassées pour son plus grand bien par ses adversaires mêmes, l'Eglise, l'Eglise retrempée par la révolution avortée, victorieuse à la fois, du même coup, de la monarchie orléaniste, de la République française et de la République romaine, et d'une façon qui demeurait, en apparence, pour la plus grande majorité, si mystérieuse en même temps que si naturelle, que sa victoire, discrète aussi et comme en dehors de la lutte des partis et de la politique, n'était que mieux assise. Casée définitivement, elle ne prenait même plus part au combat qui se livrait surtout entre la Législative et Louis-Napoléon, le ministère, entre les deux et le pays, livrant une bataille perdue d'avance et sur le terrain de laquelle il ne se maintenait que par la plus lente stratégie de retraite, en mécontentant tout le monde. Les événements ne sont quelque chose que par leurs conséquences, disait le maréchal de Castellane, représentant ici la façon de penser d'une grande partie de la société ; nous n'avons pas un ministère de taille à en profiter. Tous les triomphes de l'ordre depuis février, et cela est remarquable, ont été marqués par des concessions au profit du désordre... Ce que veulent avant tout MM. Odilon Barrot et Dufaure, c'est se maintenir au pouvoir et ne pas prendre trop fortement le parti de l'ordre, nager entre deux eaux, user de ménagements dans la crainte de n'être plus trouvés suffisants... La majorité de la Chambre est très disposée à faire les réparations ; c'est le ministère qui veut l'arrêter, sous prétexte de ne pas faire de réaction. MM. Odilon Barrot, Dufaure, Passy, Tracy, jaloux de la puissance du général Changarnier, voudraient bien s'en débarrasser ; mais comme ce n'est pas avec des discours qu'on contient un peuple en révolution, ils auront le dessous, et je ne suppose pas au ministère actuel une longue durée[175]. Le 24 juin, il écrivait : La victoire du 13 juin restera stérile ; le parti de l'ordre triomphe et n'agit pas. Le lendemain du 13, le général Changarnier aurait dû être maréchal de France. L'armée elle-même s'impatiente de ce que depuis le 13 on n'a rien fait, et chacun s'écrie : Dans trois mois, ce sera à recommencer[176]. Au sujet de ce maréchalat, il racontait aussi, — doit-on le croire ? — une singulière histoire. Changarnier devait être déclaré maréchal de France le 22, jour de l'enterrement de la mère de Cavaignac, morte du choléra. En même temps, grâce aux intrigues de Dufaure, Cavaignac devait l'être également. Il avait écrit au prince-président pour l'avertir de la mort de sa mère[177] et à Changarnier pour le prier d'assister à l'enterrement. En y allant, celui-ci envoya son aide de camp Valazé dire au prince qu'il savait que sa nomination au maréchalat devait être agitée au conseil, mais qu'il lui demandait d'agréer son refus. Les raisons que donnait le tiers parti pour faire Cavaignac maréchal de France, si on accordait cette dignité à Changarnier, ne pouvaient être plausibles pour l'élever seul à cette dignité, en opposition à l'opinion de la majorité de la Chambre. Le bâton de maréchal de M. Cavaignac tomba dans l'eau[178]. Lorsque Changarnier arriva pour la cérémonie funéraire, les amis de Cavaignac l'entourèrent afin de le féliciter. Il fit connaître qu'il ne serait pas maréchal. Le général Cavaignac semblait occupé de tout autre chose que de l'enterrement de sa mère ; quoiqu'il l'aimât beaucoup, sa figure s'allongea ainsi que celle de ses intimes[179]. Si les faits sont exacts, ils consacrent la décadence progressive du parti républicain, en même temps, semble-t-il, que l'existence perpétuelle d'une sorte de loi morale, et prennent une consécration symbolique autour du cercueil, où allait se perdre celle qui avait été la mère vigilante, mais trop catholique, de Godefroy. Un simple petit fait suffisait, d'ailleurs, à un point de vue plus ordinaire, à faire toucher à tous la différence des deux années de 1848 et 1849 et qui peut servir d'épilogue au 13 juin. Il y avait environ un an, pas plus, un préfet avait reçu la dépêche suivante : Arrêtez par tous les moyens possibles le citoyen Louis-Napoléon s'il se présente dans votre département. Signé : Ledru-Rollin. Ce préfet, ou son remplaçant, venait de recevoir celle-ci : Arrêtez par tous les moyens possibles le citoyen Ledru-Rollin s'il se présente dans votre département. Signé : Dufaure, ministre de Louis-Napoléon. |