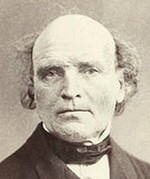LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
ET LE MINISTÈRE ODILON BARROT
IV. — LA RECONSTITUTION DU MINISTÈRE, LA SUITE DES AFFAIRES ROMAINES ET LES DÉBUTS DE LA LÉGISLATIVE.
La situation nouvelle. — Démission du ministère. — Thiers, Molé, Changarnier et Bugeaud. — Odilon Barrot et le maréchal. — Réflexions de Tocqueville. — Dufaure. — Considérations de Louis Bonaparte. — Difficultés de constituer le nouveau ministère. — Falloux et Tocqueville. — Falloux et Dufaure. — Falloux et Berryer. — Victor Hugo. — Le ministère Barrot, Passy, Rulhières, Tracy, Lacrosse, Falloux, Dufaure, Lanjuinais, Tocqueville. — Le 22 mai, première séance de la Législative. — Vive la République sociale ! — Discussion sur l'incident Forey. — Les deux partis face à face. — Message du président de la République. — Les journaux. — Lesseps demande au gouvernement s'il est bien d'accord avec lui. — L'Assemblée romaine et Mazzini. — Lesseps et Oudinot. — Difficultés croissantes pour le plénipotentiaire. — Solidarité contre lui au camp français. — D'Harcourt conseille l'attaque à Oudinot. — Tentative d'assassinat contre Lesseps. — Rôle singulier de Mazzini. — Le projet Canino. — Le général Vaillant. — Lesseps au camp français. — M. Leduc. — Le prince de Canino et le message. — Bon résultat des négociations. — Oudinot somme Lesseps de s'expliquer devant un conseil d'officiers. — Double jeu de Mazzini. — Lesseps et Rayneval. — Dernières propositions. — La nuit du 29 au 30. — Rôle odieux du général en chef. — Influence des élections. — Les conseillers d'Oudinot. — Rappel de Lesseps. — La légende du dérangement mental. — D'Harcourt et Rayneval. — Les critiques à Paris. — Lesseps seul défenseur de la politique française. — Dernier effort du plénipotentiaire, le 30 ; colère et menace d'Oudinot. — Le père Vaure. — Départ de Lesseps. — L'attaque. — Lesseps à Paris. — La majorité. — Emmanuel Arago et Bac. — Ledru-Rollin. — Dernières tactiques du parti démocratique. — Vers le 13 juin. — Ses raisons. — Le Comité central, les Vingt-cinq et les Huit. — L'interrogatoire de Girardin. — Jean Macé. — L'action révolutionnaire par suite de l'inutilité reconnue de l'action électorale. — La réunion du 11 juin. — La signification du 13 juin.L'avènement de l'Assemblée législative, dit O. Barrot,
apportait un changement radical dans la situation intérieure. Le pouvoir était déplacé : il passait décidément de gauche
à droite. Ce n'était plus désormais le parti républicain qu'il fallait
modérer, c'était la réaction monarchique qu'il fallait contenir dans ses
impatiences ; dès la constitution des partis, il apparut clairement que tout
équilibre entre les forces des partis était rompu. Les présidents ou
secrétaires appartenaient tous indistinctement au parti dit conservateur, à
l'exception d'Arago, à qui son illustration scientifique fit pardonner son
républicanisme. C'étaient MM. Molé, le maréchal Bugeaud, Baroche, Dupuis,
Rémusat, de Broglie, Thiers... tous noms très significatifs[1]. Le président du
Conseil oubliait, et sans doute naturellement, qu'il avait favorisé, soutenu,
aidé, — encore que sans le vouloir, — l'avènement de cette réaction ; les
noms qu'il citait n'avaient pas cessé d'être significatifs, et ils ne lui
devenaient tels, cependant, que de ce jour. Celui de Molé n'avait jamais pu
tromper personne. Le maréchal n'avait-il pas proposé tout récemment de
marcher sur Paris ? Ceux qui croyaient aux sentiments généreusement
réformistes de Thiers devenaient déjà rares. Si l'orléanisme de Dupin lui
était encore une garantie d'opportunisme, si Rémusat prêtait à l'illusion, la
personnalité de M. de Broglie ne pouvait égarer. Cette
situation nouvelle, ajoute Barrot, imposait à
ceux qui seraient appelés à tenir les rênes du gouvernement des devoirs
nouveaux et exigeait d'eux des aptitudes que je ne me reconnaissais pas. Je
résolus, en conséquence, de me retirer. D'ailleurs, il avait toujours été
entendu, entre mes amis et moi, qu'une fois l'Assemblée constituante
dissoute, ma mission serait terminée, et que je recouvrerais ma liberté[2]. Ses collègues
reconnurent comme lui les différences de la situation et qu'il fallait
laisser à Louis-Napoléon toute facilité d'approprier son gouvernement aux
conditions nouvelles[3]. Ils étaient trop
divisés pour ne pas tomber d'accord sur la nécessité qui s'imposait à eux ;
néanmoins la discussion entre eux aurait été vive et se serait prolongée
jusqu'à une heure assez avancée de la nuit[4]. A la démission
collective, Barrot joignit une lettre confidentielle destinée à expliquer au
président de la République la nature des dangers qu'il prévoyait, si
différents de ceux qui avaient été conjurés jusqu'alors ; il insistait sur le
péril de droite, le parti conservateur n'était plus contenu
et discipliné, en quelque sorte, par la menace incessante du triomphe des
rouges[5]
; il allait céder trop facilement à ses tendances réactionnaires, disposé à se passer ses fantaisies[6]. Le prince-président accepta la démission. Il s'y attendait. Peut-être même l'avait-il, sinon préparée, du moins aménagée. Prisonnier de son ministère, il le voyait se dissoudre sans regret ; mais, de même qu'il l'avait composé sous la pression des partis plus que par celle des circonstances, forcé de répondre aux premiers plus qu'aux secondes, qui commandaient cependant, au point de vue français, davantage, afin de répondre à la Constituante comme aux alliés contraints qui avaient soutenu sa candidature, de même il devait choisir ses nouveaux ministres d'après les élections et la Législative, de telle sorte qu'il devenait dépendant de l'Assemblée nouvelle, comme il l'était demeuré de l'ancienne ; par suite de la retraite de Barrot, il risquait d'être bien plus que précédemment le captif de la droite, car il était impossible de constituer, sans le vouer d'avance à une chute, un ministère qui eût reflété à la fois les deux tendances électorales si nettement découpées en face l'une de l'autre par le suffrage universel. Louis-Napoléon pouvait-il espérer les départager ? Il ne le voulait vraisemblablement pas d'ailleurs, à cette date, étant donnée la marche des événements et bien que ce fût son rôle. La force était avec lui, — à condition qu'il répondît à ce qui faisait cette force même, toute fruste, incompréhensive souvent et dangereuse qu'elle fût 3. La situation fausse dans laquelle il évoluait depuis décembre s'accentuait. En réalité, la majorité réactionnaire de la Législative, si l'on considérait le suffrage universel comme l'expression des besoins nationaux, n'avait pas de sens ; un mensonge l'avait produite — la crainte propagée d'une anarchie prochaine ; on voulait détruire non seulement les rares pousses qui subsistaient dans la plaine dévastée de 1848, mais la République ; et tandis que les électeurs de décembre avaient entendu cette destruction dans le sens d'un gouvernement populaire et du peuple, certains même, nombreux aussi, d'une amélioration républicaine plutôt que d'une destruction, il s'agissait désormais du pouvoir monarchique et même pas aux mains du roi, mais dans celles, toutes puissantes, de l'aristocratie conservatrice de toute nuance qui s'estimait seule capable de régner[7]. Une Assemblée de ce genre ne confirmait donc pas le vote de décembre ou n'y répondait que par l'aspiration à l'ordre, mais par des sources, sur des chemins et vers des aboutissants bien différents, dont l'électeur, dans sa grande masse mal éduqué, cédant à des influences de clocher ou de considération, terrorisé par la propagande faite contre les rouges, ne prenait pas conscience ; il avait souvent espéré étayer son vote plébiscitaire et, en croyant envoyer au neveu de l'empereur des soutiens, il groupait ses adversaires. La majorité de la Législative, créée facticement par l'effroi d'une émeute qui n'existait pas alors et que l'attente que l'on avait d'elle contribua, dans une certaine part, à faire éclore, présentait, au fur et à mesure qu'elle était discutée, moins de signification. Elle ne pouvait aborder ni les questions sociales ni les questions constitutionnelles. C'était indéfiniment le provisoire, et le plus immobilisateur. Thiers et Molé circonvenaient toujours leur jeune homme, quoique avec moins d'illusions. Thiers avait pressenti Changarnier, nous l'avons vu, pour la présidence du conseil ; son refus le fit se retourner vers Bugeaud[8]. Dans quelles conditions et dans quelles vues d'avenir se formait cette alliance ? On ne peut, à ce sujet, former que des conjectures[9]. Il semble que Barrot mis de côté, le prince ait continué de plus en plus une partie de sa confiance à Falloux, qu'il pressait d'accepter le portefeuille des Affaires étrangères, peut-être pour s'en débarrasser à l'Instruction publique en escomptant la possibilité d'y placer Victor Hugo. Bugeaud aurait eu à la fois le ministère de la Guerre et la présidence du conseil. Falloux refusa, pour quelque combinaison que ce fût[10] de quitter l'Instruction publique, mais ne demandait qu'à entrer en relations avec le maréchal. Le président aurait avancé, selon Falloux, le nom de Mathieu de La Redorte pour l'Intérieur. Quant au maréchal, il tenait à Piscatory pour la Marine[11]. Les autres noms présentés étaient tous très prononcés dans la nuance qu'on appelait alors réactionnaire[12]. Lorsqu'il en fut certain, Falloux pria le président de peser les objections suivantes : L'énergie du général Changarnier et la rapide arrestation de quelques meneurs ont fait avorter le complot du 29 janvier ; mais les éléments subsistent et la revanche des journées de Juin, par un assaut désespéré contre la société toute entière, demeure le rêve permanent des divers groupes socialistes. On avait voulu faire coïncider l'appel aux armes avec les dernières convulsions de l'Assemblée constituante ; on allait prendre maintenant pour mot d'ordre la composition monarchique de l'Assemblée législative. Si l'entrée de M. Dufaure et de ses amis au ministère avait l'inconvénient de faire pencher la balance beaucoup trop à gauche, nous courrions un risque fort différent, mais fort dangereux aussi, en donnant tout à la droite sans aucune compensation pour la gauche[13]. Il redoutait qu'en cas d'émeute l'armée, très républicaine dans l'artillerie, ne se divisât ; il comptait bien, pour la maintenir, sur l'ascendant de Changarnier et de Bugeaud, mais au cas que leur intervention fût inutile, le ministère porterait devant le pays la responsabilité de la défaite du parti conservateur. Dans le cas plus probable d'une nouvelle victoire sur la révolution, où cette victoire même s'arrêterait-elle ? La maison royale n'était pas réconciliée, la monarchie n'était prête ni dans les esprits, ni dans les faits. Le maréchal Bugeaud, le général Changarnier, naguère frères d'armes des princes d'Orléans, leur refuseraient-ils une part dans le combat et, surtout, le lendemain du combat ? De son côté, le président, qui ne semblait nullement effrayé d'une lutte dans la rue, me livrait-il toute sa pensée ? Ne retournait-il pas à Persigny, en apparence délaissé, et ne prenait-il pas, dans son impénétrable discrétion, ses mesures à tout événement ?[14] Falloux, qui semble vouloir laisser entendre qu'il n'aimait pas agir de lui-même, sans soumettre ses cas de conscience à quelqu'un de son parti, s'ouvrit à Berryer. Tous deux tombèrent d'accord que, selon Bossuet, ils ne devaient rien laisser à la fortune de ce qu'on peut lui ôter par conseil et prévoyance. Une démarche fut décidée auprès de Bugeaud afin de le dissuader d'accepter le ministère, en même temps que près de Barrot pour lui conseiller de reprendre ses fonctions. Il semblerait donc bien que Falloux, ici encore, ait joué un rôle important. Ce fut lui qui alla voir Bugeaud, et le maréchal, très vieilli[15], ne put que céder. Sans croire à une jalousie bien vive entre les deux officiers d'Afrique, Falloux redoutait la difficulté qu'il aurait à mettre d'accord ces deux sommités militaires, égales en renommée, mais pas en grade ; dans la confusion fatale du combat, l'unité du commandement risquait de ne plus exister. Des nuances politiques les divisaient aussi. Dès le lendemain de février, Bugeaud s'était prononcé pour le retour à la monarchie légitime et était entré en relations avec le comte de Chambord. Changarnier s'était montré plus circonspect. Il rêvait l'entente entre les deux branches, mais n'aurait pas consenti à entrer en lutte avec les princes d'Orléans, pour lesquels il professait, comme toute l'armée, la plus cordiale estime[16]. Enfin comment concilier le maréchal et Dufaure ? Il fallait donc que les deux grands chefs militaires fissent place à un ministère Barrot renouvelé. L'ancien centre-gauche attendait son successeur à la chancellerie, quand il vit entrer un matin le maréchal. Celui-ci lui annonça qu'il avait dû renoncer au mandat que lui avait confié Louis Bonaparte et les raisons qu'il faisait valoir étaient celles que Falloux lui avait suggérées. Au moment de mettre au Moniteur, dit-il, la liste du nouveau cabinet, j'ai éprouvé un scrupule : une grande fermentation règne dans le parti républicain, et tout porte à craindre de sa part une nouvelle prise d'armes. J'ai réuni chez moi les commandants du corps d'armée concentré à Paris, et je leur ai posé nettement la question : Que croyez-vous qu'il arriverait si l'armée avait à être engagée dans un nouveau conflit avec le peuple ? La réponse à peu près unanime a été que la conduite de l'armée pourrait dépendre de la manière dont le ministère serait composé, que s'il offrait toute garantie pour le maintien des institutions républicaines, l'armée ferait son devoir avec énergie, sans aucune hésitation ; que si, au contraire, le ministère annonçait dans son personnel la pensée d'une réaction monarchique, il pourrait bien y avoir hésitation et même division dans les rangs. Vous pensez bien qu'après cette consultation je n'ai pas hésité à rendre au président son mandat, et je viens en son nom vous prier, en conséquence, de vous charger de la reconstitution du ministère. Il ne s'en retirait pas complètement : Je me mets à votre disposition pour le portefeuille de la Guerre[17]. Barrot estima que le motif d'abdication formulé par le maréchal ne lui permettait pas de persévérer dans la sienne et qu'il avait le droit de présenter ses conditions du moment qu'on revenait à lui[18]. Il gardait avec plaisir au ministère son caractère conservateur, disposé même à le renforcer dans le sens de la majorité parlementaire, mais il exigeait que l'élément libéral y fût représenté afin de pouvoir rassurer les républicains contre les tendances trop manifestes de cette majorité. Le cabinet devant avoir à s'interposer entre l'Elysée et le Palais Bourbon, il le voulait assez fort pour le faire respecter par les deux. Dans la note sur la situation qu'il remit à Louis-Napoléon, il remarquait qu'en dépit de certaines manœuvres, la majorité de la Législative serait plus dévouée à l'ordre en éprouvant plus résolument le besoin de fortifier l'autorité, que la précédente, dépitée par un pouvoir exécutif qui n'était pas sorti de son sein, à la naissance duquel elle se savait le tort d'avoir contribué, et qui devait lui survivre ; cette sécurité forcerait, en quelque sorte, le gouvernement à une grande retenue, capable qu'il serait de combattre tout danger par le seul jeu des institutions. Il faut plus que jamais, disait-il, laisser à ceux qui veulent transformer cette société des torts et les risques de l'initiative par la violence et, jusque-là, reconquérir sur le socialisme, par la discussion libre, par des améliorations sérieuses et pratiques et par de bonnes lois, le terrain qu'il a gagné par ses promesses menteuses et par de déplorables accidents[19]. Il voulait une politique nette contre le socialisme, et une phrase laissait même entendre qu'il n'admettait pas qu'il y fût découvert quelque indication à utiliser : Il n'y aurait rien de plus dangereux qu'une politique mixte et bâtarde qui aurait tous les dangers de deux systèmes sans en avoir les avantages[20]. Il conseillait de prendre des hommes sûrs, qui, par leurs antécédents et leur caractère, puissent éloigner des esprits toute défiance ainsi que toute idée de coup d'État. Il proposait, en conséquence, Bugeaud pour la Guerre, et Rémusat pour les Affaires étrangères ; il insistait en même temps pour faire entrer Dufaure et Tocqueville dans le cabinet, rêvant de mêler dans une même pensée de conservation les monarchistes et les républicains. Il s'agissait, en effet, de rassurer les républicains sur le maintien de la République, de modérer la majorité sans la blesser, et de retenir le président dans le cadre parlementaire sans l'amoindrir ni l'humilier[21]. Excellentes intentions. La difficulté devait venir une fois de plus de Dufaure, que le comité de la rue de Poitiers suspectait au point d'avoir refusé son nom précédemment sur ses listes électorales ; toutefois, comme la situation était changée, il paraissait à beaucoup l'intermédiaire le moins coloré, le départageur le plus neutre. On se rappelait son rôle dans le ministère Cavaignac, alors qu'un grand nombre de ceux qui le jugeaient maintenant un homme de gauche s'en étaient réjouis presque comme d'un conservateur ; aussi lui et ses amis étaient-ils adjurés de la manière la plus pathétique de sauver la société en prenant le pouvoir[22]. Barrot n'aurait cependant pas de suite songé à eux. Thiers et Molé qui, peu soucieux, à cette heure, de responsabilité, entendaient rester les maîtres sans devenir ministres, sollicités, avaient refusé de se charger de rien[23]. Le choix forcé de Dufaure indiquait bien cette permanence du provisoire, précédemment signalée, et que rien de durable ne pouvait s'édifier parmi la bataille sur les exigences toujours déchaînées des partis. L'opinion publique nous appelait, dit Tocqueville, mais il eût été bien imprudent de compter sur elle ; la peur poussait le pays vers nous, mais ses souvenirs, ses secrets instincts, ses passions ne pouvaient guère manquer de le retirer bientôt de nos mains, dès que la peur aurait disparu. Notre but était de fonder, si c'était possible, la république ou, du moins, de la maintenir quelque temps en la gouvernant d'une façon régulière, modérée, conservatrice et toute constitutionnelle, ce qui ne pouvait nous laisser longtemps populaires, car tout le monde voulait sortir de la constitution. Le parti montagnard voulait plus qu'elle et les partis monarchiques voulaient bien moins. Dans l'Assemblée, c'était bien pire encore. Les mêmes causes général es s'aggravaient par mille accidents naissant des intérêts et des vanités des chefs de parti. Ceux-ci pouvaient bien consentir à nous laisser prendre le pouvoir, mais, quant à nous laisser gouverner, il ne fallait pas s'y attendre. La crise passée, on devait prévoir de leur part toutes sortes d'embûches. Quant au président, je ne le connaissais point encore, mais il était clair que nous ne pouvions compter pour nous maintenir dans son conseil que sur les jalousies et les haines que lui inspiraient nos communs adversaires. Ses sympathies devaient toujours être ailleurs, car nos visées étaient non seulement différentes, mais naturellement contraires. Nous voulions faire vivre la République[24] ; il en voulait hériter. Nous ne lui fournissions que des ministres, quand il avait besoin de complices[25]. Lorsque Barrot parla au prince de Dufaure pour l'Intérieur, le président se récria. Il consentait à l'accepter dans le cabinet, mais le récusait au poste le plus important : Je crois que la première nécessité du gouvernement, écrivait-il à Barrot, est d'imprimer aux affaires une direction précise, énergique. Je crois qu'à l'Intérieur il faut aussi réorganiser et tout préparer pour soutenir avec avantage une lutte si elle se présente ; il faut choisir des hommes dévoués à ma personne même, depuis les préfets jusqu'aux commissaires de police ; il faut surveiller les actions de chacun, afin de les empêcher de nuire en cas d'insurrection ; il faut surveiller tous ceux avec lesquels M. Dufaure a été au pouvoir, depuis Cavaignac jusqu'à Ducoux, depuis Marrast jusqu'à Gervais (de Caen) ; il faut destituer la plupart des agents que M. Dufaure a nommés ; il faut réorganiser partout la garde nationale dans un but militaire ; il faut enfin réveiller partout non le souvenir de l'Empire, mais celui de l'Empereur, car c'est le seul sentiment au moyen duquel on peut lutter contre les idées subversives[26]. Le point de vue, en dépit de l'intérêt personnel, qui s'y attachait évidemment, était, dans une certaine mesure, plus juste que Barrot ne le pensait, la donnée napoléonienne à cette date, parvenant seule, au milieu des partis, face à une réaction qui, chaque jour, se révélait plus puissante, plus exigeante, à concilier l'évolution et la révolution, l'autorité et la liberté, sorte de transaction, frisant peut-être le compromis, résultat, à coup sûr, des confusions agglomérées, instrument puissant, de premier ordre, dans une main habile, susceptible de bonne ou de mauvaise besogne selon l'orientation vers laquelle il travaillerait. Il y a malheureusement des heures, en effet, dans la vie des peuples où les excès des partis, qu'ils soient conduits par des individualités de second ordre, qu'ils soient entraînés trop loin par l'insuffisance d'éducation de leur majorité, soit enfin, qu'ils ne sachent pas distinguer leurs tâches, finissent par compromettre la nation ; le danger grandissant devenant imminent, le pays s'affole et ne sait plus que penser à son existence : Primum vivere. Pour remplir ce but, disait le prince, je ne crois pas que M. Dufaure soit l'homme approprié à la situation ; cependant je reconnais son ascendant sur l'Assemblée et son mérite ; je serais heureux de le voir entrer au ministère, mais non à l'Intérieur. A l'Intérieur, je veux un homme énergique et dévoué, qui voie les dangers réels de la situation et non les dangers chimériques, un homme qui voie un danger réel dans la conspiration des ennemis de la société, et non dans le plus ou moins de pouvoir qu'on donne à ceux qui commandent la force armée. Ainsi donc, si M. Dufaure consent à entrer à un ministère quelconque, je serai très reconnaissant ; mais sinon, non ! J'étais opposé à l'adjonction de M. Dufaure ; vos raisons m'ont convaincu ; mais je n'ai consenti à son entrée au ministère qu'autant qu'il ne serait pas à l'Intérieur. J'ai exprimé cette idée bien arrêtée devant MM. Thiers et Molé, il y a cinq jours, et c'est dans ce but que nous avons imaginé de vous prier d'accepter un ministère sans portefeuille[27]. Je n'ai fait aucune objection à cette combinaison, quoiqu'elle amoindrisse un peu ma position, mais cela m'est complètement égal. Aussi vous vous souvenez que MM. Thiers et Molé me disaient devant vous que c'était moi qui vous faisait tous les sacrifices[28]. Barrot répondit que Dufaure, homme du devoir, défendrait le prince comme il avait défendu Cavaignac et qu'il s'opposerait avec énergie à tout désordre anarchique ; il ajoutait que, d'ailleurs, il avait mis l'entrée de Dufaure au ministère de l'Intérieur comme une condition à la sienne. Le lendemain, Louis Bonaparte céda. — D'autres difficultés subsistaient. Dufaure demandait que le général Changarnier se désistât de son double commandement ; il redoutait en république la prépondérance d'un élément militaire, que la situation très en vue du général et la présence de Bugeaud au ministère rendaient effectivement considérable. Changarnier annonçait, de son côté, qu'il donnerait sa démission de tout commandement le jour où Bugeaud serait ministre de la Guerre. Sous un tel ministère, disait-il, je ne serais plus qu'un agent secondaire et subordonné. Il ne pouvait y consentir d'autant moins qu'il se savait soutenu par le président de la République. On avait d'abord offert à Dufaure de rentrer seul, en se contentant des Travaux publics, et c'est à la suite de son refus qu'on lui avait promis l'Intérieur. Rémusat retirait sa parole, alléguant que l'entrée de Dufaure et de ses amis le dégageait. Barrot invoquait vainement la gravité de la situation, la nécessité de faire taire toutes les susceptibilités pour réunir toutes les forces ; il allait même jusqu'à enfermer M. Dufaure, le maréchal Bugeaud et le général Changarnier dans son cabinet comme dans une sorte de conclave, les sommant de se concilier avant d'en sortir[29] ; il fallait sacrifier Bugeaud à Changarnier et accepter la retraite de Rémusat. — Tocqueville hésitait, inquiet de l'agitation révolutionnaire dont lui aussi s'exagérait l'importance ; il redoutait l'esprit et les habitudes d'exclusion répandus et déjà enracinés dans l'administration publique ; l'expédition de Rome si mal conçue et si mal conduite qu'il était désormais aussi difficile de la mener à bout que d'en sortir, tout l'héritage, enfin, des fautes commises par ceux qui nous avaient précédés[30] ; cependant il avait décidé d'accepter, sûr de ne faire que passer dans le gouvernement, et, comptant, quand même, y rester assez longtemps pour y rendre service ; il entendait simplement n'entrer au ministère qu'avec ses principaux amis, de manière à ce qu'ils fussent les maîtres du cabinet, et se conduire, une fois à son poste, comme s'il devait le quitter le lendemain. Il assista dans cet état d'esprit, en y prenant part, aux efforts compliqués d'où devait surgir le second cabinet Barrot. Le problème était difficile à résoudre dans les conditions qu'on lui donnait. Le président voulait bien modifier en apparence son ministère, mais il entendait conserver les hommes qu'il considérait comme ses principaux amis. Les chefs des partis monarchiques refusaient de se charger eux-mêmes du gouvernement, mais ils ne voulaient pas non plus qu'on le remît tout entier à des hommes sur lesquels ils n'auraient aucune prise... On nous considérait comme un remède, nécessaire mais désagréable à prendre, qu'on désirait ne s'administrer qu'à petites doses[31]. Le portefeuille des Affaires étrangères, offert à Tocqueville, avait été d'abord accepté justement par Rémusat sur les insistances de Tocqueville même, qui aurait tenu à lui comme collègue parce qu'il était à la fois ami de M. Thiers et galant homme, chose assez rare[32] ; tel, lui seul pouvait assurer la neutralité de Thiers sans nous infester de son esprit[33]. Or c'était sur le conseil de Thiers, que Rémusat s'était écarté, comme il s'en expliquait à son remplaçant : J'ai bien vu que de devenir votre collègue, ce ne serait pas vous donner le concours de Thiers, mais seulement m'exposer à être moi-même bientôt en guerre avec lui. En dernier lieu, Tocqueville, malgré ses résolutions antérieures, hésitait devant ce portefeuille des Affaires étrangères qu'il n'avait d'abord pas escompté comme le sien ; il l'accepta, mais en posant la condition que Lanjuinais serait aussi son collègue. Il lui servirait à retenir Dufaure dans la ligne qu'il voulait suivre. Dufaure y consentait d'avance, sans se douter du calcul de son ami, car, au moment de la retraite de Bugeaud, il avait spécifié la retraite de Tocqueville et de Lanjuinais[34]. Personne ne faisait donc d'objections à Lanjuinais, homme méthodique, réservé, lent, paresseux, très prudent, n'acceptant une entreprise qu'avec difficulté, mais aussi avec une sincérité complète, dépourvu de faux-fuyant, d'égoïsme et de particularités intéressées[35]. La seule complication était de lui trouver un portefeuille. Tocqueville le désignait pour celui de l'Agriculture, mais il était entre les mains d'un ami de Falloux, Buffet. L'ultramontain nourrissait envers Tocqueville une sympathie ancienne et profonde[36] ; il ne
redoutait que ses sentiments américains au sujet de
la question romaine[37]. L'intérêt religieux était sa seule raison d'être
ministre[38]
; il avait donc le devoir particulier de se renseigner à ce sujet, Buffet
venant tout à fait en second. Tocqueville était au lit quand il l'alla voir,
et lui dit : Si j'avais fait partie du cabinet au
commencement de l'expédition, je me serais opposé à son départ jusqu'à ce que
le peuple romain se fût prononcé de lui-même sur le pouvoir temporel. Mais,
engagés comme nous le sommes aujourd'hui et l'armée française pouvant seule,
par l'occupation de Rome, en interdire l'entrée aux troupes napolitaines,
espagnoles et autrichiennes, vous pouvez compter sur mon appui[39]. Après des
discussions au sujet de l'Intérieur, Falloux alla ensuite voir Dufaure, dans
le petit appartement qu'habitait auprès de l'Opéra cet homme austère, voué aux plus graves études[40]. Il était
également couché, bien qu'il fût à peine neuf heures et demie, et il fallut
sonner longtemps. Dufaure apparut en pantoufles et en chemise, avec un madras
noué d'un gros nœud au-dessus de la tête. Il ne répondit rien aux excuses de
son visiteur, le fit entrer dans sa chambre, et se coucha, en le priant de
s'expliquer. Falloux lui reprocha de se placer dans une situation fausse
vis-à-vis de ses amis politiques ; Buffet écarté, il serait absolument seul
et refusait une combinaison qui, au surplus, affaiblissait le ministère.
Dufaure lui retournait ses propres arguments, faisait valoir les préventions
du président contre lui, si évidentes qu'il ne pouvait lutter sans amis
éprouvés. Falloux mettait en avant ce qu'il devait mener à bonne fin, la loi
de l'enseignement et toutes les solutions romaines[41] ; il assurait
que ses amis étaient aussi sûrs que ceux qui leur étaient préférés, du moment
qu'il s'agissait de la lutte contre le président. L'un et l'autre ne cédaient
point. Dufaure avança que Falloux n'avait pas d'équivalent qui pût permettre
de le remplacer : Vous avez la possession d'état ;
vous avez la confiance intime des chefs de la majorité. Ma situation sans
vous ne serait point tenable et je ne m'y exposerais pas... Ce n'est pas moi
qui exige cela, c'est la force des choses[42]. Falloux, fort
de cette parole, insista encore, puis déclara renoncer au ministère. Le
lendemain — ces décisions en comportaient toujours — il conta son aventure à
Berryer qui lui donna tort : Le président comptait
probablement là-dessus et vous avez joué son jeu. Vous voilà personnellement
et dignement dégagé. Mais quel sera le dénouement de tout ceci ? Le
président, livré à lui-même, va se jeter dans tous les hasards. Qu'avez-vous
à lui opposer ? Une maison royale divisée contre elle-même, une armée
indécise, les chefs partagés. La France s'est prononcée deux fois, en moins
d'un an, contre la République par l'élection du 10 décembre et par
l'Assemblée législative ; mais elle prendra aveuglément ce qu'on lui
présentera sous les apparences de l'ordre et du repos. Quand vous avez
accepté le ministère pour éviter Jules Favre, vous avez fait acte d'utile
dévouement. Vous en ferez un plus utile encore, en déjouant une équipée,
suite inévitable d'une émeute que chacun pressent et que quelques-uns
recherchent. Non, non, restez là où vous êtes ; faites durer ce régime
provisoire qui maintient la sécurité du dedans et du dehors en attendant que
plus et mieux deviennent possibles[43]. L'intérêt
religieux commandait que Falloux se laissât convaincre : Barrot, qui ne
l'aurait pas regretté, tenait un remplaçant tout prêt, M. Benoît. Il avait
même été question un moment de Victor Hugo[44]. Le prince lui
était personnellement favorable ; il l'avait été en décembre déjà et n'avait
cédé qu'à la répugnance de ses ministres[45]. Hugo, qui le
savait, avait continué de croire que le président qui lui avait témoigné la
plus grande bienveillance reviendrait à lui. Invité le 14 décembre 1848, et
le poète arrivant en retard, Louis-Napoléon s'était levé de table pour aller
au-devant de lui ; il avait laissé entendre ensuite qu'il était contrarié de
sentir dans ses ministres des instruments de Thiers. Hugo était au mieux avec
le ministère même. Il dînait chez Falloux avec Louis-Napoléon, le 18 janvier,
et le rencontrait encore chez Léon Faucher. Il avait défendu la proposition
Rateau et faisait partie de la rue de Poitiers. Son napoléonisme[46] étonnait Barbes[47]. Ayant enfin, en
général, voté avec la droite, le prochain auteur des Châtiments avait
certaines chances. L'Événement dirigeait ses efforts vers la constitution
d'un tiers parti destiné à seconder la politique de Louis-Napoléon et le Charivari
du 27 mai disait même : Tout nous porte à croire que
Victor Hugo sera le chef du nouveau cabinet. Une des dernières tentatives de Falloux fut de faire renoncer Tocqueville à Lanjuinais, mais la même opposition que celle de Dufaure le convainquit qu'il lui restait seulement à céder. Dépité — en apparence[48] — mais toujours maître de lui-même, il se leva... Vous le voulez, me dit-il, en me tendant la main avec cette bonne grâce aristocratique dont il savait si naturellement recouvrir tous ses sentiments, même les plus amers, vous le voulez, c'est à moi de céder. Il ne sera pas dit qu'une considération particulière m'aura fait rompre dans des temps si difficiles et si critiques une combinaison si nécessaire ; je resterai seul au milieu de vous. Mais vous n'oublierez pas, je l'espère, que je ne suis pas seulement votre collègue, mais votre prisonnier[49]. Il écrivit à Barrot pour le prier d'annoncer à Dufaure sa soumission aux exigences repoussées la veille[50]. Revoyant Dufaure ensuite, il réédite la phrase du prisonnier, sans, d'ailleurs, lui tendre la main[51]. — Le ministère était fait, par suite de la situation et grâce à Barrot, pénétré par le sentiment du bien public comme par celui de sa valeur personnelle, plus intimement et plus étroitement entrelacée dans son honnêteté qu'on aurait pu le croire[52]. Il était ainsi composé : Barrot président du conseil, à la Justice ; Passy, aux Finances ; Rulhières, à la Guerre ; Tracy, à la Marine ; Lacrosse, aux Travaux publics ; Falloux, à l'Instruction publique ; Dufaure, à l'Intérieur ; Lanjuinais, à l'Agriculture ; Tocqueville, aux Affaires étrangères. Dufaure, Tocqueville et Lanjuinais étaient donc les seuls nouveaux, mais leur bloc changeait l'orientation. Falloux appelait le cabinet un ministère de gauche, — alors que la gauche voyait dans ces nominations récentes une hypocrisie et une menace, — et les partis de droite pensaient comme lui. Ce n'est pas dans l'ancienne Chambre que M. Barrot aime à se recruter exclusivement, soupirait le maréchal de Castellane... Cette nomination du ministère, pour être inattendue, n'en est pas moins absurde... Le prince Louis-Napoléon a trouvé dans la majorité des obstacles pour faire un ministère de droite. M. Molé ne se refusait pas à y entrer, mais il voulait M. Thiers avec lui, car il le regarde, en dehors du ministère, comme un terrible dissolvant. M. Thiers n'y a pas consenti ; on dit qu'il est effrayé et que Mme Dosne, sa belle-mère, l'est encore plus[53]. Le ministère, si difficile à constituer, différait, — Falloux à part, — de la majorité de droite en ce sens que, tout en luttant, comme elle, contre la révolution, il ne le faisait pas au nom d'une réaction monarchique, cléricale ou même républicainement réactionnaire, bien qu'il y eût un peu du dernier point, mais d'une sorte de scepticisme expérimental qui s'affirmait quand même, et de bonne foi, ami de la liberté telle qu'il la comprenait. Passy, paradoxal et honnête, se consolait du sombre tableau qu'il esquissait de l'avenir ainsi que du présent en donnant les motifs de ses prévisions désolantes ; il ne paraissait reprendre de la certitude qu'au sujet de Thiers, qu'il détestait. — Rulhières, pour sa part, n'aimait pas Changarnier, et, s'il eût appartenu à un parti[54], il se fût rallié au clan monarchique, ultra-conservateur. — Tracy, embarrassé par le cadre idéologique dans lequel, dès son enfance, son père l'avait circonvenu et dont il avait eu beaucoup de peine à adoucir les angles rigides, conduisait un peu au hasard des événements son cœur et son intelligence flottante. — L'honneur d'être ministre, considérable aux yeux de Lacrosse, ne le lassait pas ; il se montrait aux petits soins pour le président ; c'était un pauvre diable assez dérangé dans sa fortune et qui, du plus épais de l'ancienne opposition dynastique, avait été poussé par les hasards de la révolution à la direction des affaires[55]. — Tocqueville, dans son sérieux et sa droiture, avec une certaine incompréhension, malgré sa grande valeur psychologique, était le plus sceptique de tous, d'autant mieux qu'il était arrivé là par les plus nobles chemins ; aristocrate résigné, il examinait et servait les événements, les réprouvait, en reconnaissait la fatalité et combattait au nom de cet examen impartial ceux qui leur barraient la route ou les accéléraient. Nous avons trop pratiqué Barrot pour ne pas savoir comme ce groupement lui convenait. Falloux y était évidemment étranger ; pourtant, si l'on considère que le catholicisme romain au XIXe siècle est surtout, au fond, une sorte de scepticisme fanatique tempéré, malgré lui et lui aussi, par le possibilisme, les points d'entente — comme dans la réponse que fit Tocqueville au sujet de Rome — apparaîtront. C'est par là que le ministère devait, quand même, s'entendre, à certains moments, avec la droite. Seul, Falloux représentait dans le Conseil les chefs de la majorité, ou, plutôt, il semblait les représenter, car, en réalité, il ne représentait, là comme ailleurs, que l'Église. Cette situation isolée, autant que les visées secrètes de sa politique, le portaient à chercher son point d'appui hors de nous ; il s'efforçait de le placer dans l'Assemblée et chez le président, mais discrètement et habilement, comme il faisait toutes choses[56]. Néanmoins le ministère demeurait faible, condamné qu'il était à gouverner avec le concours d'une majorité coalisée, sans être lui-même un ministère de coalition[57]. Et Tocqueville ajoute : Mais il possédait, d'une autre part, la force très grande que donnent à des ministres une origine semblable, des instincts identiques, d'anciens liens d'amitié, une confiance mutuelle et une visée commune. Le ministère n'était d'aucun parti, mais, d'une autre manière que Louis-Napoléon, il avait sur lui le désavantage de n'avoir pas de programme, de ne pas suivre une donnée profonde. Comme le dernier cabinet de Cavaignac, comme la première combinaison Barrot, et aussi, quoique différemment, comme tous les ministères qui s'étaient succédé depuis les débuts de la seconde République, il ne répondait à la situation que d'une manière essentiellement provisoire, et s'il est entendu que tout ministère est, de nécessité, passager, il existe des nuances dans ce transitoire même ; celui-ci appelait, dès les premiers jours, un remplaçant. Rien de plus lassant, pour un pays dont l'éducation politique n'est pas faite surtout, qu'une instabilité aussi continuelle, principalement après une révolution, quand aucun contrepoids légal suffisant ne la modère ou ne la règle et, d'avance, n'y pare, en réduisant son danger à la crise pressentie fatale et attendue comme presque immédiate. On me demandera, sans doute, quelle était cette visée, continue l'analyste, où nous allions, ce que nous voulions. Nous vivons dans des temps si incertains, si obscurs, qu'il me paraîtrait téméraire de répondre à cette question au nom de mes collègues, mais j'y répondrai volontiers au mien. Je ne croyais pas plus alors que je ne crois aujourd'hui que le gouvernement républicain fût le mieux approprié aux besoins de la France ; ce que j'entends, à proprement parler, par le gouvernement républicain, c'est le pouvoir exécutif électif. Chez un peuple où les habitudes, les traditions, les mœurs ont assuré au pouvoir exécutif un pouvoir si vaste, son instabilité sera toujours, en temps agité, une cause de révolution, en temps calme, de grand malaise. J'ai toujours considéré, d'ailleurs, que la république était un gouvernement sans contrepoids qui promettait toujours plus, mais donnait toujours moins de liberté que la monarchie constitutionnelle. Et, pourtant, je voulais sincèrement maintenir la république ; et bien qu'il n'y eût pour ainsi dire pas de républicains en France, je considérais l'entreprise de la maintenir comme n'étant pas absolument impossible[58]. Nous trouvons ensuite la note de lassitude un peu triste de Thiers après 1871 : Je voulais la maintenir parce que je ne voyais rien de prêt ni de bon à mettre à la place. L'ancienne dynastie était profondément antipathique à la majorité du pays. Au milieu de cet alanguissement de toutes les passions politiques que la fatigue des révolutions et nos vaines promesses ont produit, une seule passion reste vraie en France, c'est la haine de l'ancien régime et la défiance contre les anciennes classes privilégiées qui le représentent aux yeux du peuple. Le ressentiment passe à travers les révolutions sans s'y dissoudre, comme l'eau de ces fontaines merveilleuses qui, suivant les anciens, passait au travers des flots de la mer sans s'y mêler et sans y disparaître. Quant à la dynastie d'Orléans, l'expérience qu'on en avait faite ne donnait pas beaucoup de goût pour revenir sitôt vers elle. Elle ne pouvait manquer de rejeter de nouveau dans l'opposition toutes les classes supérieures et le clergé, et de se séparer, comme elle l'avait déjà fait, du peuple, laissant le soin et les profits du gouvernement à ces mêmes classes moyennes que j'avais vues pendant dix-huit ans si insuffisantes à gouverner la France. D'ailleurs, rien n'était prêt pour son triomphe. Louis-Napoléon seul était préparé à prendre la place de la république, parce qu'il tenait déjà le pouvoir. Mais que pouvait-il sortir de son succès, sinon une monarchie bâtarde, méprisée des classes éclairées, ennemie de la liberté et gouvernée par des intrigants, des aventuriers et des valets. La république était sans doute très difficile à maintenir, car ceux qui l'aimaient étaient, la plupart, incapables ou indignes de la diriger, et ceux qui étaient en état de la conduire la détestaient. Mais elle était aussi assez difficile à abattre. La haine qu'on lui portait était une haine molle, comme toutes les passions que ressentait alors le pays. D'ailleurs, on repoussait son gouvernement sans en aimer aucun autre... Je pensais donc que le gouvernement de la république, ayant pour lui le fait et n'ayant jamais pour adversaires que des minorités difficiles à coaliser, pourrait se maintenir au milieu de l'inertie de la masse, s'il était conduit avec modération et sagesse... Presque tous les membres du conseil avaient la même pensée[59]. C'est dans ces sentiments que Dufaure s'apprêtait à servir son troisième gouvernement, toujours avec la même abnégation[60] ; et c'est grâce à sa présence, sans doute, qu'Emmanuel Arago donna sa confiance au gouvernement. — Cabinet de transition[61], disaient quelques-uns. La Législative tint sa première séance le lundi 28 mai, sous la présidence du doyen d'âge Kératry. Il faisait assez froid pour la saison ; quelques rares groupes, peu fournis, animaient, ici et là, la place de la Concorde. Ils furent chargés par les lanciers, tandis qu'ils se rapprochaient du Palais-Bourbon et se réfugiaient sur la terrasse du jardin des Tuileries. Les temps étaient changés ; un an auparavant, le 4 mai, la Constituante, sur la proposition de M. Babaud-Laribière[62], était venue acclamer la République à là face du soleil devant un peuple qui avait répondu à ce cri. — Dans la salle, on ne voyait ni Lamartine, ni Marrast, ni bien d'autres. On remarquait, sur les bancs de la Montagne, de chaque côté de Ledru-Rollin, deux sous-officiers, dont l'un, fort joli garçon ; c'étaient les députés Boichot et Rattier ; on regardait aussi un sergent de chasseurs de Vincennes, Sébastien Commissaire. Tout se passa tranquillement ce premier jour, et il semblait que la Législative ne ressemblait pas du tout à la Constituante. On n'y cria même pas : Vive la République ! Le lendemain, le député Landolphe protesta contre cet oubli, appuyé par la gauche qui jeta l'acclamation désirée. La droite demeurant silencieuse, la gauche réitéra. Ce fut le même silence ; mais, comme il ne pouvait cependant rester sans explication, un des nouveaux membres de la majorité vint protester, avec une adresse si naturelle qu'il semblait mettre le bon droit de son côté. Un autre montagnard ajouta au mot de république les qualificatifs de démocratique et sociale, et l'équivoque, qui n'existait que pour les naïfs, se dessina. Au nom de cette Assemblée qui représente le peuple français ; dit le président, je rappelle à l'ordre celai qui a dit la République sociale. Alors l'extrême-gauche, debout, glorifia encore, d'une seule voix, le gouvernement pour lequel elle combattait. M. de Ségur d'Aguesseau utilisa cet enthousiasme pour légitimer le silence de ses amis ; ils entendaient, quant à eux, l'universalité des citoyens par le mot de république, — et il voulait dire la majorité conservatrice au nom de laquelle il avait pris la parole ; au nom de cette majorité et avec elle, en entendant le mot république comme il fallait l'entendre, les députés consentiraient volontiers à l'acclamation que l'on réclamait d'eux ; ils allaient même s'exécuter de suite. Ainsi promis, ainsi fait : Le signal avait été donné par un royaliste[63]. — Un autre représentant de gauche, Beaune, voulut répondre, mais la droite, avec la complicité du doyen d'âge qui viola le règlement, l'en empêcha. — Ainsi, dès le début, les deux camps s'affirmaient. La Chambre, qui se disait la représentation nationale et l'était, en effet, au strict point de vue légal, gouvernait contre les intérêts véritables de la nation. — Le danger de cette représentation, abandonnée à elle-même lorsque la majorité électorale n'est pas réellement consciente en politique, se précisait ici encore. Dans une situation d'infériorité aussi claire que la sienne, avec le sentiment de ce qu'elle représentait de nécessaire et la certitude qu'elle devait être vaincue sous peu, tout à fait, comment la gauche aurait-elle pu ne pas protester, exaspérée dès le premier jour par l'hypocrisie d'une réponse qui ne pouvait lui laisser aucune illusion ? Barrot l'accuse de démagogie ; il n'y avait là, pourtant, qu'une revendication nécessaire, et ce qu'elle présentait, à la rigueur, d'exagéré, au moins pour l'époque, diminuait en face de l'implacable bloc de droite contre lequel on l'avait dressée. La tactique suivie par la gauche quant à la vérification des pouvoirs qu'elle voulait prolonger en accumulant sur les élections tous les griefs, afin de pouvoir mieux dénoncer le Parlement au pays, le jour où tout serait perdu, est bien celle de désespérés qui n'escomptent même pas une revanche. Tout était perdu, mais il fallait sauver l'idée républicaine, faussée, anéantie par la droite. Enfin, la plupart des montagnards, grands théoriciens, manquaient d'expérience sur le terrain pratique, dans le maniement des affaires et celui des hommes ; et, comme si ces lacunes, toujours maintenues, n'étaient pas une raison suffisante d'insuccès, les écrivains de la presse socialiste se déchirèrent à l'infini. — Le parti républicain était épuisé. Dès la troisième séance, la Législative dépassait la Constituante. Dans les jours les plus tumultueux de la Constituante, nous n'avons jamais vu pareil excès. Quel début ! Quelles promesses ! Si cela continue, nous ne savons pas trop à quelles formes de discussion et de persuasion en arrivera l'Assemblée nationale de la France... Les milliers d'électeurs qui viennent de nommer cette Assemblée la regardent. Croyez-vous que ce soit la liberté qui grandisse au milieu de pareils orages ? Hélas ! nous le disons avec douleur : si les Assemblées doivent périr, ce ne sera pas par l'invasion des baïonnettes, par la révolte de la rue ; mais un jour viendra où le pays, découragé et désespéré, finira par se dire : A quoi me servent des assemblées délibérantes, puisqu'elles ne peuvent même pas délibérer ![64] Les Débats oubliaient de prévenir que la majorité était pour beaucoup dans cette impossibilité, par son obstination systématique. — Après des incidents divers, le remplacement, sur l'ordre du général Changarnier, du colonel commandant au Palais-Bourbon, par le général Forey qui avait précédemment refusé d'obéir aux réquisitions de Marrast, fut l'occasion attendue. Le précédent à l'actif de Forey la rendait légitime, la ruse employée par Changarnier plus encore : n'osant pas destituer le général Lebreton, il révoqua le colonel Cauvin du Bourget, commandant militaire de l'Assemblée. Lebreton, investi du commandement des forces destinées à protéger le Parlement, ayant déjà rencontré de la difficulté à remplir tout son devoir et, même, une certaine hostilité contre lui, comprit que son rôle serait chaque jour plus difficile. Il remit donc sa démission. Le commandement, expliqua-t-il devant la Chambre, je ne pourrais pas le laisser avilir dans mes mains. Forey avait aussitôt été mis en avant, et la gauche demandait qui l'avait nommé. Voilà la question, disait-elle. Changarnier était le metteur en scène évident, mais on évita de répondre directement. La droite réclamait l'ordre du jour ; comme la veille, elle voulait empêcher la gauche de parler. Malgré une suspension de séance, Ledru-Rollin s'empara de la tribune et fit le résumé de l'affaire. Le président lui répliqua : Ce sont vos anciens amis, vos commissaires, qui, le 15 mai, ont violé l'enceinte de l'Assemblée. La partialité n'était pas discutable, mais le Parlement ne l'admettait pas. Ledru-Rollin s'écria : Puisque le président trouve bon d'outrager mon parti et ma personne, je me retire de la tribune, car elle n'est pas libre ! Le ministère, commençant son rôle, devait, ne fût-ce que pour revenir au calme, reconnaître les torts du président, et une partie de la majorité ne pouvait que ratifier. Barrot ayant donc engagé Kératry à retirer ses paroles, il y consentit. Le débat se prolongea, néanmoins, au sujet des secrétaires, d'une façon presque comique, à laquelle l'intervention de Bugeaud, par ses paroles restées célèbres : Les majorités sont tenues à plus de modération que les minorités... mit à peu près fin. L'ordre du jour fut voté. — Le 31 mai, le bureau définitif se constitua. Dupin aîné était élu par trois cent quarante-cinq suffrages sur six cent vingt-trois votants. Lamoricière, que Barrot eût préféré, n'avait eu que soixante-seize voix ; Ledru-Rollin en avait réuni cent quatre-vingt-deux. Toujours la même majorité. On voit que le parti conservateur dominait assez dans l'Assemblée pour n'avoir plus besoin d'obtenir par des concessions précédentes l'appoint des républicains modérés réduits à un chiffre insignifiant, tandis que la Montagne, désespérant de ressaisir le pouvoir dans le Parlement, et se croyant désormais dispensée de tous ménagements ; se faisait représenter par ses extrêmes ; aussi, pour les vice-présidents, tandis que M. Baroche réunissait quatre cent cinq voix formant le parti conservateur de toute nuance, Félix Pyat groupait sur son nom toutes les voix de l'extrême gauche, au nombre de cent cinquante-trois. Nous le répétons, les partis intermédiaires avaient disparu. Ainsi tout se préparait pour une lutte à outrance[65]. Dupin faisait partie de la rue de Poitiers. Les vice-présidents étaient Baroche, le général Bedeau, Jules de Lasteyrie, Denis Benoist, de Sèze. Tel qu'il est dans son ensemble, disaient les Débats[66], le résultat de ces opérations est excellent pour les amis de l'ordre et de la vraie liberté. Le 2, Dupin prononçait son discours d'installation. Tandis qu'il conseillait : Constitués en république, n'oublions pas que l'union dès grands pouvoirs de l'Etat est une des premières garanties du repos public... Une voix de gauche, assez maladroitement dans le cas actuel, demanda : Qu'appelez-vous les grands pouvoirs ? Il n'y en à qu'un, celui de l'Assemblée qui représente le peuple... Dupin répondit : J'appelle ainsi les pouvoirs élus par le suffrage universel et qui émanent de la souveraineté du peuple. — Le 7 juin, le président de la République transmettait à l'Assemblée le message qu'il devait lui adresser aux termes mêmes de l'article 52 de la constitution. Le message, dont l'auteur prenait soin d'indiquer, au
début, le côté protocolaire, apportait d'une manière calme, extrêmement
réservée, presque de loin, semblait-il, le tableau de la situation générale.
Cette neutralité était nécessaire ; elle répondait à la situation et au
ministère ; elle n'apparaissait plus vivante que sur deux points, au sujet de
l'Italie et de la classe ouvrière. Une phrase du début, néanmoins, pouvait prêter
à l'interprétation, encore qu'elle eût plusieurs sens : Mon élection à la première magistrature de la République a
fait naître des espérances qui n'ont point encore pu toutes se réaliser
; et, quelques lignes plus bas : Le temps et les
circonstances ne m'ont point encore permis d'accomplir tous ces engagements ;
cependant de grands pas ont été faits : dans cette voie. Ces
engagements consistaient à : Défendre la société
audacieusement attaquée ; affermir une république sage, grande, honnête ;
protéger la famille, la religion, la propriété ; provoquer toutes les
améliorations et toutes les économies possibles ; protéger la presse contre
l'arbitraire et la licence ; diminuer les abus de la centralisation ; effacer
les traces de nos discordes civiles ; adopter à l'extérieur une politique
sans arrogance, comme sans faiblesse. — Ces deux phrases n'avaient
d'ailleurs pas, sans doute, le sens que plusieurs contemporains ne manquèrent
pas de leur découvrir, car la fin du manifeste était : d'une orthodoxie constitutionnelle et même républicaine à
laquelle il n'y avait rien à reprendre[67]. Il disait : Ce qui précède suffit, Messieurs, je l'espère, à vous
prouver que mes intentions sont conformes aux vôtres. Vous voulez, comme moi,
travailler au bien-être de ce peuple qui nous a élus, à la gloire, à la
prospérité de la patrie ; comme moi, vous pensez que les meilleurs moyens d'y
parvenir ne sont pas la violence et la ruse, mais la fermeté et la justice...
J'appelle sous le drapeau de la République et sur le terrain de la
constitution tous les hommes dévoués au salut du pays ; je compte sur leur
concours et sur leurs lumières pour m'éclairer, sur ma conscience pour me
conduire, sur la protection de Dieu pour accomplir ma mission. — Il
laissait entendre qu'il était personnellement pour l'amnistie, mais n'avait
pu l'accorder à cause de l'opinion publique ; les prisons s'étaient déjà
ouvertes, néanmoins, à quinze cent soixante-dix transportés de Juin. Les
affaires commerciales et industrielles avaient repris, mais l'état des
finances était loin d'être satisfaisant. La
dette publique était forte. — L'armée recevait des louanges ; le manifeste
signalait la progression des colonies agricoles. Des compliments et des
avances étaient adressés à l'agriculture, cette
source de toutes les richesses ; le désir du gouvernement était de trouver le moyen le plus efficace de venir au
secours des classes laborieuses en ramenant les ouvriers des villes aux
travaux de la campagne... Le commerce, compromis en 1848, s'était
amélioré et prenait une marche ascendante. Le président passait en revue les
chemins de fer exécutés par l'État, puis proposait d'achever le palais du
Louvre ; une commission s'était mise au travail. Le passage relatif à
l'instruction publique montre bien comme l'emprise du clergé sur la jeunesse
semblait non seulement naturelle ; mais indispensable : La rénovation des facultés de théologie catholique,
conformément au vœu de l'Assemblée nationale, a également excité les
préoccupations du gouvernement. Une commission a élaboré un projet sur cette
délicate question qui touche aux intérêts les plus élevés de la religion et,
à ce titre, ne peut être utilement résolue sans la participation du pouvoir
spirituel. Le pouvoir tenait à ce qu'on connût sa ferme volonté de répondre aux besoins religieux et
intellectuels des populations. Louis-Napoléon donnait raison aux
hommes de Février qui n'avaient pas lancé la France dans une guerre dont on
ne pouvait prévoir le terme. L'état de civilisation
en Europe ne permet de livrer son pays aux hasards d'une collision générale
qu'autant qu'on a pour soi, d'une manière évidente, le droit et la nécessité.
Une influence secondaire, une raison plus ou moins spécieuse d'influence
politique ne suffisent pas ; il faut qu'une nation comme la nôtre, si elle
s'engage dans une lutte colossale, puisse justifier, à la face du monde, ou
la grandeur de ses succès, ou la grandeur de ses revers. A son avis,
l'influence et l'intérêt de la France une fois sauvegardés, il n'y avait pas
lieu d'agir davantage. Il rappelait le rôle modérateur et équitable de la
France entre l'Autriche et le Piémont ; le pays avait entendu — et entendait
toujours — exercer simplement une action directe et indépendante. Il
rappelait ce qu'avait rêvé notre intervention : Nous
pouvions espérer que notre drapeau, arboré sans contestation au centre de
l'Italie, aurait étendu son influence protectrice sur la péninsule tout
entière, dont aucune des douleurs ne peut nous trouver indifférents. Ce
passage était curieux pour l'avenir : ... Le reste
de l'Allemagne est agité par de graves perturbations. Les efforts faits par
l'Assemblée de Francfort en faveur de l'unité allemande ont provoqué la
résistance de plusieurs des Etats fédérés et amené un conflit qui, se
rapprochant de nos frontières, doit attirer notre surveillance. L'empire
d'Autriche, engagé dans une lutte acharnée avec la Hongrie, s'est cru
autorisé à appeler le secours de la Russie. L'intervention de cette
puissance, la marche de ses armées vers l'occident, ne pouvaient qu'exciter à
un haut degré la sollicitude du gouvernement, qui a déjà échangé à ce sujet
des notes diplomatiques. Il se résumait en indiquant la nécessité
d'une marche nette précise. Cette marche consiste,
d'un côté, à prendre hardiment l'initiative de toutes les améliorations, de
toutes les réformes qui peuvent contribuer au bien-être de tous, et, de
l'autre, à réprimer par la sévérité des lois devenues nécessaires, les
tentatives de désordre et d'anarchie qui prolongent le malaise général. Je ne
bercerai pas le peuple d'illusions et d'utopies qui n'exaltent les
imaginations que pour aboutir à la déception et à la misère. Partout où
j'apercevrai une idée féconde en résultats pratiques, je la ferai étudier et,
si elle est applicable, je vous proposerai de l'appliquer. La principale mission
du gouvernement républicain, c'est d'éclairer le peuple par la manifestation
de la vérité, de dissiper l'éclat trompeur que l'intérêt personnel des partis
fait briller à ses yeux. Un fait malheureux se retrouve à chaque page de
l'histoire, c'est que plus les maux d'une société sont réels et patents, plus
la minorité se lance dans le mysticisme des théories... Encore aujourd'hui,
ce n'est pas pour l'application des théories inapplicables ou d'avantages
imaginaires que la révolution s'est accomplie, mais pour avoir un
gouvernement qui, résultat de la volonté de tous, soit plus intelligent des
besoins du peuple et puisse conduire, sans préoccupations dynastiques, les
destinées du pays. Notre devoir est donc de faire la part entre les idées
fausses et les idées vraies qui jaillissent d'une révolution, puis, cette
séparation faite, il faut se mettre à la tête des unes et combattre
courageusement les autres. La vérité se trouvera en faisant appel à toutes
les intelligences, en ne repoussant rien avant de l'avoir approfondi, en
adoptant tout ce qui aura été soumis à l'examen des hommes compétents et qui
aura subi l'épreuve de la discussion. D'après ce que je viens d'exposer, deux
sortes de lois seront présentées à votre approbation, les unes pour rassurer
la société et réprimer les excès, les autres pour introduire partout les
améliorations réelles. Parmi celles-ci, Louis-Napoléon indiquait : Loi sur les institutions de secours et de prévoyance, afin
d'assurer aux classes laborieuses un refuge contre les conséquences de la
suppression des travaux, des infirmités et de la vieillesse. Loi sur la
réforme du régime hypothécaire : il faut qu'une institution nouvelle vienne
féconder l'agriculture ; en lui apportant d'utiles ressources, en facilitant
ses emprunts, elle préludera à la formation d'établissements de crédit, à
l'instar de ceux qui existent dans les divers États de l'Europe. Loi sur
l'abolition de la prestation en nature. Loi sur la subvention en faveur des
associations ouvrières et des comices agricoles. Loi sur la défense gratuite
des indigents, qui n'est pas suffisamment assurée dans notre législation. La
justice, qui est une dette de l'État, et qui, par conséquent, est gratuite,
se trouve environnée de formalités onéreuses qui en rendent l'accès difficile
aux citoyens pauvres et ignorants. Leurs droits et leurs intérêts ne sont pas
assez protégés ; sous l'empire de notre constitution démocratique, cette
anomalie doit disparaître. — Loi ayant pour but d'améliorer la pension de
retraite des sous-officiers et soldats et d'introduire dans la loi sur le
recrutement de l'armée des modifications dont l'expérience a démontré
l'utilité. Le manifeste fut jugé assez généralement incolore et la majorité des journaux se montra hostile au président. Ceux de son parti ne l'approuvaient même pas tous, et la Liberté lui disait : Qu'avez-vous fait depuis le 10 décembre ? Vous avez dormi... en abandonnant la direction des affaires à ces mêmes hommes que vous appeliez justement dans vos écrits les traîtres de 1815 et les bourreaux du maréchal Ney... Quel homme êtes-vous donc si des adversaires politiques à qui vous avez fait la guerre pendant dix-huit ans, non seulement par des écrits, mais par des conspirations, vous ont si facilement et si promptement retourné ? Les Débats l'approuvaient : Le mérite essentiel du document est d'être... ce qu'il doit être. Le National ne désarmait pas : La France n'éprouvera qu'une immense déception ; elle s'étonnera de tant d'insuffisance devant une tâche si haute... Point d'idée mère, point de pensée d'ensemble, point de plan d'avenir... Rien... En somme un programme d'impuissance. Le Siècle estimait que le message était destiné à redoubler l'inquiétude qui pesait sur les esprits. La République, le Peuple, formulent de sévères critiques. La Révolution démocratique et sociale voit une déclaration de guerre à la révolution de Février, une menace pour la République, le désaveu de tous les principes démocratiques. La Réforme accuse le prince d'avoir livré la République à ses plus implacables ennemis. La Presse parle aussi de la nullité du texte. Dans le Conseiller du peuple, Lamartine, au contraire, trouve au message, cette sagesse calme, ferme et patriotique, qui caractérise les messages de la présidence américaine. Et il parle de l'approbation unanime que la conscience publique a donnée à cette loyale ouverture de sa pensée et de ses intentions. — Dans son journal, le maréchal de Castellane écrit[68] : Le manifeste du président n'a aucun succès et est sans couleur. Il remarque qu'à la soirée de l'Elysée il y a très peu de monde — sans doute du faubourg Saint-Germain, et il ajoute : On est fort mécontent de son ministère[69]. Personne, parmi les journalistes ou les hommes politiques, ne semble avoir fait remarquer que, justement, l'auteur du message avait pris soin d'éviter tout ce qui pouvait engager l'avenir, afin même de déjouer le désir national qui était de pénétrer toute la pensée présidentielle. Une fois constitué, le ministère s'était rendu à l'Elysée. Louis-Napoléon le reçut poliment[70]. Il ne pouvait faire plus : Tocqueville et Lanjuinais avaient voté avec ostentation pour Cavaignac ; Dufaure avait parlé presque outrageusement de sa candidature. Il ne semblait guère que l'entente pût s'établir entre les grands pouvoirs publics. Et ce désaccord faisait la force du président. Le journal de Ledru-Rollin ne pardonnait pas à Proudhon d'avoir dit — ce qui était, à cette date, faire preuve d'une singulière pénétration — que la cause véritable de la classe ouvrière était mise de côté par les politiciens, quelle que fût leur couleur. Il n'y a plus, à l'heure qu'il est, de constitution. Ce qui existe, ce sont deux partis rangés en bataille, l'un qui comprend les deux tiers du peuple, qui a la majorité dans l'Assemblée nationale, qui dispose de l'administration, du budget, de l'armée, et qui ne veut de la constitution que pour opprimer, l'autre qui forme environ le tiers de la nation, qui se compose généralement des citoyens les plus pauvres, qui n'a ni police ni finances, ni soldats, ni armes, et qui n'accepte la constitution que pour conspirer. Et reprenant ce qu'il disait en 1848 à la tribune : Nous avons parlé quelquefois de la dissolution' de la société, la voilà faite. La presse démocratique et socialiste vient de le dénoncer. Il n'y a plus de constitution. Nous sommes acculés à la première des lois supérieures et antérieures, à la force. C'est la force qui nous régit ; c'est au plus fort à gouverner. Donc, que Louis Bonaparte n'hésite plus. La déclaration de la presse démocratique et socialiste vient de lui créer de nouveaux droits et de nouveaux devoirs. Il a la force, et la constitution n'est rien, c'est à lui d'aviser. Dictature ou despotisme, nous ne donnerions pas un cheveu pour le choix. Lui seul pouvait départager les deux partis que la révolution, en achevant de mourir, avait mis face à face, par le jeu du suffrage universel ; lui seul ; en les dominant, pouvait empêcher non pas une nouvelle guerre civile, — les forces révolutionnaires étaient trop diminuées pour que cette lutte fût réelle, — mais une réaction sans mesure. On en était malheureusement arrivé là, et la mauvaise éducation politique ou, plutôt, la mauvaise qualité de l'éducation politique de plusieurs chefs de la classe ouvrière comme d'une partie de la classe ouvrière elle-même y avait un peu aidé. L'avenir restait, par une sorte de fatalité dont il prenait, jusqu'à un certain point, le visage actuel, à Louis-Napoléon, très supérieur à ce que sa vie antérieure et ses folles entreprises avaient pu faire penser, à bon droit, de lui[71] ; et cet avenir semblait se cacher derrière ses yeux ternes et opaques, comme les verres épais destinés à éclairer la chambre des vaisseaux qui laissent passer la lumière, mais à travers lesquels on ne voit rien[72]. * * *Les premières tentatives d'entente essayées par Lesseps lui avaient montré que certaines propositions ne seraient pas admises, et il semble qu'il ait alors compris assez vite la difficulté de sa situation[73]. Le 22, il conseillait au ministre d'augmenter l'effectif de l'armée, afin qu'elle fût puissante vis-à-vis celle de l'Autriche, mais aussi de ne pas envoyer de nouveau matériel de siège, afin que nous ne paraissions pas décidés à nous emparer de Rome par bombardement, ce à quoi, disait-il, dans aucune circonstance, je ne prêterai les mains. Il spécifiait : Si les intentions du gouvernement n'étaient pas telles que je me crois autorisé à les interpréter, je n'hésite pas à vous prier de me rappeler, car si je ne devais pas continuer à avoir ma liberté d'action et à m'inspirer des circonstances, au milieu de la crise la plus compliquée, ma position ne serait plus tenable[74]. Le 19, Mazzini avait écrit à Lesseps que les conditions étaient inacceptables : elles se contentaient, assurait-il, de répéter autrement les proclamations d'Oudinot. Par M. Accursi, porteur du message, que Lesseps avait rencontré dans les salons de Drouyn de Lhuys, le négociateur était prié d'aller s'entendre à nouveau avec les triumvirs. Et le lendemain matin, il se rendait au quartier général. Une conférence eut lieu. M. d'Harcourt protesta contre l'inaction de l'armée. Lesseps et lui, encore que d'une opinion tout à fait différente, restèrent dans les meilleurs termes de cordialité sincère et d'entente cordiale[75]. Le projet, tel qu'il avait été convenu le 16, était ainsi rédigé : Art. 1 : Aucune entrave ne sera plus apportée par l'armée française à la liberté des communications de Rome avec le reste des États romains. — Art. 2 : Rome accueillera l'armée française comme une armée amie. — Art. 3 : Le pouvoir exécutif actuel conserve ses fonctions. Il sera remplacé par un gouvernement provisoire composé de citoyens romains et désigné par l'Assemblée nationale romaine jusqu'au moment où les populations appelées à faire connaître leurs vœux, le Sénat se prononcera sur la forme de gouvernement qui devra les régir et sur les garanties à consacrer en faveur du catholicisme et de la papauté[76]. — On décida de capituler sur le dernier article. Lesseps fit ressortir que la clause proposée ne ressortait ni de ses instructions, ni des discours de Drouyn de Lhuys qui, le 7, au Parlement, avait défié l'opposition de trouver la preuve d'une sommation quelconque faite au gouvernement afin qu'il se dessaisît de son pouvoir. La première proclamation d'Oudinot, rédigée par le ministre, contenait ceci : Nous nous concerterons avec les autorités existantes pour que notre occupation momentanée ne vous impose aucune gêne. Lesseps pensait plus prudent de réserver encore tout ce qui avait trait au pape. — Une nouvelle rédaction fut composée, et les trois commissaires se chargèrent de la soumettre à l'Assemblée : Art. 1 : Les États romains réclament la protection fraternelle de la République française. — Art. 2 : Les populations romaines ont le droit de se prononcer librement sur la forme de leur gouvernement. — Art. 3 : Rome accueillera l'armée française comme une armée amie. Les troupes françaises feront conjointement le service de la ville. Les autorités romaines fonctionneront suivant leurs attributions légales. L'article 2 avait été conservé grâce à l'insistance de Lesseps, malgré d'Harcourt et Oudinot ; il laissait aux Romains, à la rigueur, la liberté de repousser le pape. Par l'article 3 deux écueils étaient évités, celui de reconnaître la République romaine, et celui de ne pas éveiller les susceptibilités de Gaëte. Lesseps regrettait d'avoir dû, contraint par d'Harcourt et Oudinot, spécifier l'occupation de Rome par l'armée française, alors que dans le premier projet il n'en était pas fait mention ; il fut amené ainsi à proposer que le service de la capitale fût fait par nos troupes, conjointement avec les soldats romains, alors que l'exemple de Civita-Vecchia détaillait les difficultés du système. Il avait demandé une réponse immédiate, qu'il attendrait jusqu'à minuit, en grand uniforme, un drapeau français à son balcon, un piquet d'honneur à sa porte[77]. L'Assemblée, réunie en séance secrète, fut très déçue en écoutant le projet de convention. Persuadée que la politique française était changée à Paris, elle s'irrita en apprenant, pendant la délibération même, qu'un groupe de soldats français, après avoir franchi le Tibre près de San-Paolo, s'était installé sur la rive gauche, rétrécissant ainsi le cercle d'investissement. De nombreux députés voyaient dans le fait, non seulement une violation de la trêve, mais un indice de mauvaise foi chez le plénipotentiaire. Les propositions ne furent donc pas acceptées, et on annonça l'envoi prochain d'une contre-proposition. — L'échec de Lesseps ne pouvait être dissimulé. — Mazzini, qui gardait toute son autorité, lui avait écrit à l'issue de la séance : C'est avec une tristesse profonde, comme il convient à des hommes qui aiment et respectent la France et ont encore foi en elle, que nous remplissons cette mission auprès de vous. Lorsque nous apprîmes votre arrivée, le cœur nous battit de joie. Nous crûmes à la conciliation immédiate en un seul principe, proclamé par vous et par nous, entre deux pays auxquels sympathies, souvenirs, intérêts communs et situation politique commandent l'estime et l'amour. Après s'être plaint que le terme République romaine fût évité, il disait encore : Rome n'a pas besoin de protection, on n'y combat pas. Là aussi, dans votre troisième article, l'Assemblée a cru entrevoir l'influence d'une pensée politique à laquelle elle peut acquiescer d'autant moins que le décret de l'Assemblée nationale française lui semble décidément contraire à une occupation non provoquée, non réclamée par les circonstances. Dans la nuit, Lesseps se rendit au camp français. Oudinot voulait reprendre la lutte et rédigea, d'accord avec Lesseps, une déclaration de rupture des négociations ; toutefois il fut décidé qu'il n'en serait fait usage qu'après examen des contre-propositions. A sept heures du matin, le négociateur rentrait dans la Ville Éternelle, accompagné du commandant Espivent. Cette même matinée, Mazzini lui écrivait encore : 2 mai. Nous serons toujours heureux d'avoir une entrevue personnelle avec vous toutes les fois que vous jugerez à propos. Toute heure est bonne. Car l'un d'entre nous se trouvera toujours ici. Lesseps répondit : Je ne dois pas aller voir les triumvirs. Mais, comme homme, je vous recevrai en particulier ce soir. — Faites-moi désigner une heure par le retour du dragon. — Je serai seul pour causer avec vous. Le dragon ne rapporta point de réponse. Et, l'après-midi, la population romaine, surexcitée par l'attente, commettait toutes sortes d'excès, pénétrant dans les églises d'où elle extrayait les confessionnaux, saccageant les jardins du pape. A la tribune des clubs, l'ambassadeur de la France, injurié, déclaré traître, fut désigné comme un nouveau Rossi. On vint sous ses fenêtres chanter la Carmagnole. Cette fureur, qui ne l'émut point, le fortifia dans le sentiment que nos troupes ne devaient pas entrer de force dans Rome. Plus fidèle au programme du gouvernement que le gouvernement lui-même[78], il plaça son espoir dans le parti modéré. Mais Mamiani, avec lequel il s'entretint, se montra très découragé ; les amis de la France, sans crédit, demandaient quelque gage de l'alliance française, susceptible d'être mise en valeur près du peuple. Lesseps décida Oudinot à fournir aux médecins une des voitures perfectionnées. C'était mince, et pourtant le cadeau fit effet. Ce même après-midi, Lesseps réunit ses compatriotes à l'ambassade et leur présenta la gravité de la situation ; il les convoqua pour le lendemain afin de leur donner un avis plus formel. La réponse de Mazzini ne le toucha qu'à minuit ; elle s'efforçait de ne rien dire : Je reçois votre billet à l'instant. Il m'est impossible de venir cette nuit, surtout après le billet que vous m'avez adressé ce matin ; je ne puis pas m'expliquer la première ligne de votre lettre. Mais je compte sur votre loyauté pour m'apprendre tout changement vital qui surviendrait dans notre politique réciproque. Lesseps était pris entre deux intransigeances, celle d'Oudinot qui entendait conquérir Rome par la force, celle de Mazzini qui ne voulait rien céder. Il répondit : ... Je regrette pour vous qu'il vous soit impossible de venir me voir, cette nuit surtout. Il ne pouvait user de la déclaration signée le matin même avec Oudinot : c'eût été décider la guerre qu'il était chargé d'éviter, qui allait contre les intérêts de la France et dont l'Assemblée ne voulait pas. Le dictateur cherchait à gagner du temps afin de connaître mieux l'état des esprits en France et de régler ses demandes d'après lui ; mais les renseignements dont il usait ne donnaient pas la note juste ; les élections de juin furent même interprétées à rebours. La satisfaction si momentanée de la Montagne avait fait croire aux Romains que leurs amis de Paris gagnaient la bataille ; leur Moniteur du 21 disait : Nous augurons bien des élections de France ; la majorité sera faite de républicains ardents et ennemis de la politique extérieure imposée à la France par la coalition des despotes. — Le même 21, dans la journée, afin de faire patienter Oudinot, Mazzini lui envoyait M. Cass, ambassadeur des États-Unis, auquel il remettait un projet de traité écrit par la main même du vice-président, prince de Canino. Cass exprima son désir de contribuer à l'aplanissement des difficultés dans des conditions non officielles. Appuyé sur la bonne volonté française, il espérait faire comprendre, peu à peu, au triumvirat la nécessité urgente de clore le conflit. Mais Oudinot, déjà très monté contre Lesseps et d'autant plus qu'il l'avait détesté avant même qu'il n'eût agi, dès son arrivée[79], sentit augmenter sa colère en face de ce diplomate officieux et étranger. Depuis la veille au matin, il attendait d'heure en heure un résultat, en même temps qu'il l'escomptait selon ses vues. Il répondait qu'il voulait une solution immédiate et que, tout en désirant la paix, il n'y avait aucun doute sur le succès final de son attaque au cas qu'il y fût acculé. Et il évita de lire le papier de Charles Bonaparte. Plus tard, quand Lesseps, étonné de n'avoir pas été averti immédiatement de cette demande, lui fera part de sa surprise, il n'en parlera pas davantage : Je n'ai point, d'ailleurs, dira-t-il[80], confié à M. l'ambassadeur des États-Unis le soin de faire des propositions en mon nom. Tout le monde, dans l'entourage du général, entretenait son exaspération, et notamment contre le nouveau négociateur. Une même incompréhension hostile à tout essai d'entente ou d'explication animait généraux et diplomates ; les premiers considéraient que ne point combattre entachait leur honneur ; les seconds, élevés dans le culte de l'idée temporelle, même au nom du scepticisme bien compris, ne comprenaient pas le rôle de Lesseps. Oudinot, qui le saisissait moins encore, jusqu'à le juger sévèrement en petit comité, prompt à découvrir une odeur de trahison dans le fait de ménager des révolutionnaires, répétait sans cesse à tout venant qu'il entrerait dans la ville de gré ou de force. Auprès d'un auxiliaire aussi disposé, d'Harcourt et Rayneval soutenaient facilement la cause du Saint-Siège[81]. D'Harcourt l'invitait même, en quelque sorte, à la désobéissance lorsqu'il lui remettait une note ainsi conçue (22 mai 1849), encore qu'il le vît tous les jours : Je regrette la ligne politique que l'on suit en ce moment, les lenteurs de l'expédition, les négociations avec les meneurs républicains. Si pareil état de choses se prolongeait, nous serions l'objet de la risée et de l'animadversion de l'Europe. Nous n'avons pas amené une armée de 20.000 hommes en Italie pour la mettre à la merci de M. Mazzini et consorts. Et, puisque nous avons voulu nous constituer les seuls arbitres du sort des États pontificaux, nous ne pouvons y jouer ce rôle qu'en étant les maîtres de la ville de Rome. Il faut faire suivre immédiatement la négociation du canon pour donner du poids aux paroles... Il règne bien des incertitudes autour de nous, et, à la vérité, on nous trace peu la ligne de conduite à suivre, mais il est impossible de ne pas prendre un parti. Puisque c'est vous qui avez la force en main, c'est aussi à vous qu'il appartient d'en prendre un, si on ne le fait pas ailleurs[82]. Oudinot avait déjà écrit, le 21, au ministre pour se plaindre des lenteurs de Lesseps. Je crains, disait-il notamment, que tant de condescendance pour nos adversaires ne soit pas appréciée comme elle devrait l'être. Il se hâta d'envoyer à Paris la note de d'Harcourt, en y joignant celle de Rayneval, et en recommandant leur lecture. Quant à ma situation personnelle, expliquait-il, elle s'est, à mon avis, fort simplifiée. Je n'ai de responsabilité qu'en ce qui touche les conditions militaires. C'était quelque peu mentir sur son action qui ne cessait d'exister en dehors de la question purement militaire. Il sentait néanmoins la responsabilité formidable qu'il assumerait s'il allait de l'avant, et cette gravité, en augmentant son honneur, le retenait encore, malgré l'entourage qui lui reprochait de plus en plus son inaction. Le 21 mai, à midi, tandis que M. Cass s'acheminait vers le quartier général, Lesseps écrivait à Mazzini qu'indisposé il ne pouvait aller à lui. Mazzini répondit en promettant de faire tout son possible pour l'aller voir et en regrettant de ne pouvoir le faire tout de suite. Je regrette que votre santé vous force à garder la chambre, mais j'espère que cela ne vous empêchera pas de déployer l'activité qui vous est propre, vers le but commun, l'accord entre les deux nations. Lesseps vit là un succès. Il pouvait, dès lors, calmer Oudinot, qui venait de lui envoyer une lettre pressante. Il faut partir du principe, lui indiquait-il, que je n'ai fait aucune concession, et ce qui le prouve, c'est que Mazzini m'a écrit le 19 que nos propositions ne contenaient rien de plus au fond que les premières proclamations du général Oudinot. Or, ces propositions, auxquelles vous avez bien voulu vous associer, je les ai données comme ultimatum. J'avais fixé jusqu'au 20, à minuit, pour qu'on acceptât ou rejetât. La Chambre romaine a rejeté, priant le triumvirat de renouer. J'ai résisté à toutes les invitations qui m'ont été faites d'aller au-devant d'eux. Décidé à maintenir jusqu'au bout ma résolution de ne rien proposer de nouveau, mais de ne pas broncher, j'ai amené les chefs au point qu'on me sollicite et qu'il faudra bien que l'on vienne tout à fait à moi. Rien ne me semble plus convaincant que ma correspondance avec Mazzini pour montrer que je n'ai fait et ne ferai aucune reculade. Soyez certain que notre gouvernement serait aujourd'hui sur le bord du précipice si je n'avais pas fait ce que j'ai fait. L'avenir et les résultats le prouveront. Attendez-les. Cette attente ne peut pas être longue. Songez aux luttes que je soutiens nuit et jour ici. Je reste sur la brèche : que vos canons n'en ouvrent pas d'autre. Cependant, à ce moment même, un singulier événement se passait, qui reporte à ce côté mélodramatique et mystérieux dont le romantisme, mal compris, fut, trop souvent, l'expression et dont l'ombre se prolongea sur le second Empire. Mazzini ne s'était pas contenté de gagner du temps par l'envoi de M. Cass. Constatant que Lesseps ne voulait pas se départir de sa ligne de conduite, il eut aussi, vraisemblablement, l'idée d'agir sur l'esprit du général en chef et d'opposer davantage l'un à l'autre des deux acteurs de la France, dont il savait, vraisemblablement, le désaccord. Pour qui a étudié la diplomatie mazzinienne, on se demande s'il ne faut pas entrevoir un peu de son action, ou, tout au moins, de sa lointaine influence dans l'incident suivant, simultané, sinon associé, avec l'essai dont l'ambassadeur des États-Unis fut un moyen, révélateur, en tout cas, des intrigues dont Lesseps était entouré, des entraves apportées à son œuvre conciliatrice. Il est admissible également, et avec équivalence, que la tentative d'assassinat ne vint pas seulement du parti révolutionnaire, dans lequel les agents de la droite ont si souvent introduit des leurs chargés d'amener la catastrophe irréparable. Enfin l'incident aurait-il été grossi, ou même, presque inventé pour contraindre le seul obstacle à la guerre, à la retraite ? Le nom de Rossi, en tout cas, n'avait pas été mis en avant sans raison : ce qu'il y avait de pire dans les deux armées opposées semblait aboutir à la même intransigeance criminelle. Voici l'aventure telle que Lesseps l'a rapportée[83]. En quittant ses compatriotes qu'il avait réunis, Lesseps descendit un escalier. Plusieurs personnes s'approchèrent alors de lui et lui serrèrent la main en le félicitant. Ayant convoqué la même assistance pour le lendemain, le 21, il se disposait à aller la retrouver à l'ambassade quand le révolutionnaire qui lui avait sauvé la vie et l'avait introduit de nuit au palais de la Consulta, survint à pas de course, les cheveux en désordre : Hier, lui dit-il[84], trois hommes se sont approchés de vous. Vous avez cru, naturellement, qu'ils faisaient partie de votre réunion, que c'étaient des compatriotes, et l'un d'eux vous a présenté la main. Vous avez répondu, vous vous êtes tourné... Eh bien, celui qui vous a pris la main doit vous la prendre aujourd'hui, en partant ; puis celui qui était à côté de lui a regardé vos vêtements et il vous assassinera en vous coupant la carotide, comme on l'a fait à Rossi dans la même situation. Il n'était pas nécessaire que Lesseps exposât inutilement sa vie : Jurez-moi que la personne qui ira à ma place ne courra aucun danger. Le serment fut accordé. Lesseps envoya Latour d'Auvergne, second secrétaire d'ambassade. Comme il tardait à revenir et que l'inquiétude commençait, le prince Wolkonsky, chargé d'affaires de Russie, fit à son collègue une déclaration qui confirmait la précédente : Hier, quand vous avez réuni les Français — je vous en demande pardon, mais, dans notre métier, nous sommes obligés de rendre compte à nos gouvernements de tout ce qui se passe d'important —, voici ce que j'ai fait. Comme j'étais très lié avec le duc d'Harcourt, votre prédécesseur, je connaissais un petit escalier dont le palier donne sur les salons où vous avez reçu. Je me suis mis l'oreille à la porte et j'ai écouté tout ce que vous avez dit. J'en ai informé mon gouvernement. Aujourd'hui, je me préparais à faire la même chose. J'étais dans l'encoignure, derrière la porte du salon, lorsque j'entendis trois hommes qui parlaient en français dire très bas : Ah ! ce gredin n'est pas venu aujourd'hui. Sans cela l'affaire était finie à l'arme blanche. A son retour, le second attaché raconta qu'un groupe d'assistants avait fait entendre les récriminations les plus violentes en apprenant que Lesseps ne paraîtrait pas ; au moment du départ, des hommes se jetèrent sur la voiture et tentèrent d'arrêter les chevaux. Un poste militaire romain du voisinage avait refusé son concours. Lesseps demanda des explications à Mazzini. Il possédait le nom des trois hommes, dont l'un, Colin, avait été déjà condamné en France. Il faisait savoir au dictateur que si les trois assassins n'étaient pas immédiatement emprisonnés au fort Saint-Ange, il donnerait à Oudinot l'ordre d'attaquer la ville. Et Mazzini — ce qui permet le soupçon — répondit qu'il n'était pas en son pouvoir d'obtenir cette arrestation. Lesseps s'adressa derechef à son sauveur pour lui demander un conseil. Il indiqua un nommé Ciceronaccio, un des organisateurs de la révolution, comme ayant conservé sur le peuple une grande influence. Lesseps avertit encore une fois Mazzini, mais autrement : s'il ne rétablissait pas le calme, et au plus vite, il allait en charger Ciceronaccio. Tout fut bientôt rentré dans l'ordre[85]. Lesseps avait encore dit à Mazzini : La responsabilité des malheurs qu'amènerait une guerre
fratricide ne retombera pas sur nous... Il nous reste maintenant à aviser. Le
général en chef et l'envoyé de la République française ne failliront pas aux
devoirs qui leur sont imposés. Ils auront soin de notifier huit jours à
l'avance la cessation, on ne peut pas dire de l'armistice, puisque les
Français n'ont pas été et ne seront jamais volontairement les ennemis des
Romains, mais de l'état de rupture imminente qui existait au moment où j'ai
été assez heureux pour suspendre les hostilités. Et il lui faisait
entendre qu'à force de conspirer avec une sorte de manie, il finissait par
conspirer contre lui-même. Dans sa réponse, Mazzini manifesta de la surprise,
invoquant un peu comme une excuse préparée les communications avec Oudinot.
Lesseps, qui les ignorait, fit prendre des informations auprès du général et
apprit la démarche de M. Cass. Le général, après avoir regretté de comprendre
que cette entrevue, à laquelle il n'attachait pas d'importance, avait aidé
autant la tactique des triumvirs, envoya le projet Canino ainsi rédigé : Art. 1 : La République romaine, acceptant les
délibérations de l'Assemblée française qui autorisent des troupes en Italie
pour empêcher l'intervention étrangère, sera reconnaissante de l'appui
qu'elle recevra. — Art. 2 : Les populations romaines ont eu le droit de se
prononcer librement sur la forme de leur gouvernement, et la République
française, qui ne l'a jamais mis en doute, se plaira à le reconnaître
solennellement lorsque la constitution, votée par l'Assemblée nationale, sera
sanctionnée par le vote général. — Art. 3 : Rome accueillera les soldats
français comme des frères, mais les troupes ne l'occuperont que lorsque,
menacé de près, le gouvernement de la République leur en adressera la
demande. Les autorités civiles et militaires de la République romaine
fonctionneront suivant leurs attributions légales. La République française
garantit plus spécialement le droit qu'elle reconnaît à l'Assemblée
constituante de terminer et de mettre à exécution la constitution de la
République. Étant données ses instructions, Lesseps ne pouvait
discuter des articles où il était question de la République romaine. Il fut
convaincu que Mazzini l'avait joué. Et c'est dans ce sentiment qu'il le reçut
à midi, à l'hôtel d'Allemagne. La scène fut très violente. Le plénipotentiaire
traita même son interlocuteur d'ambitieux vulgaire, qui
avait continué, étant maître du pouvoir, à ourdir des trames ténébreuses et
infernales qui l'avaient occupé toute sa vie et qui voulait régénérer
l'humanité en passant sur les ruines et les cadavres[86]. Il lui offrit
néanmoins une entente raisonnable. Pendant ce temps, il avait continué de subir les
réclamations d'Oudinot qui voulait en finir, bien que l'attente eût été
décidée entre eux jusqu'à l'arrivée de nouveaux ordres. Le général prétendait
que, selon Vaillant, le statu quo portait atteinte à la dignité, aux
intérêts, à la qualité de l'armée. L'envoyé se rendit auprès du militaire
afin de le rallier, malgré lui, à sa façon de voir, et y réussit. Mais,
aussitôt son départ, Oudinot se reprocha sa faiblesse et dépêcha Vaillant,
heureux de cette mission, formellement opposé qu'il était à toute thèse
conservatrice. Déguisé en bourgeois, dans la voiture du Dr Finot, médecin en
chef de l'armée qui gardait ses entrées libres, il rejoignit Lesseps. Celui-ci
fut encore une fois persuasif. Le général retourna dans la même nuit au camp,
mais non sans s'être permis une petite promenade du côté des fortifications[87]. Quand les deux
généraux se retrouvèrent, ils s'en voulurent immédiatement l'un à l'autre
d'une faiblesse dans laquelle ils avaient
chacun leur part, et Oudinot protesta par une lettre immédiate : Vous êtes, Monsieur, très séduisant, personne ne le sait
mieux que moi. Le général Vaillant a été, lui aussi, sous le charme en vous
écoutant. Mais, à la réflexion, il reste très convaincu que le statu quo
auquel nous nous condamnons est funeste et porte la plus grave atteinte à la
dignité et aux intérêts de la France, non moins qu'à l'honneur militaire...
Nous vous supplions de ne pas enchaîner plus longtemps notre liberté
d'action... Ma confiance en vous est grande, vous le savez ; toutefois je ne
dois pas vous dissimuler que personne, absolument personne, ne s'associe à
vos espérances ; on les prend pour des illusions... Lesseps remit les
choses au point : ... Le général Vaillant ne m'a pas
fait plus d'objections que vous-même lorsqu'il est venu conférer avec moi de
votre part, et vraiment je ne comprendrais pas qu'il y eût, d'hier à
aujourd'hui, un changement de front aussi complet que celui que m'annoncent
vos lettres successives. Ma conduite a été invariable jusqu'à présent et
comme, d'accord avec vous, je viens de faire partir M. de La Tour-d'Auvergne
pour Paris, avec mon rapport qui réserve toute l'initiative du gouvernement
jusqu'à l'arrivée de sa réponse, il m'est impossible de changer d'avis sans
un motif puissant. Cependant, comme ma mission ne peut s'exercer si je suis
tiraillé de tous côtés, je suis tout disposé à déclarer aux autorités de Rome
que je me retirerai du quartier général si, d'ici à huit jours, une solution
ne nous est pas présentée, soit par l'acceptation de nos premières
propositions, soit par un contre-projet qui en changerait la forme sans en
dénaturer l'esprit. Quant à des illusions, je n'en ai d'aucune espèce. Je
m'attends à tout de la part de tout le monde et je sais parfaitement résister
à toutes les insinuations officieuses qui auraient pour but de me faire
dévier de la ligne que j'ai adoptée. L'honneur militaire m'est aussi cher
qu'à vous-même, Monsieur le général, mais je tiens aussi grand compte des
instructions écrites et verbales de mon gouvernement et de l'opinion publique
de la France. Voulez-vous, oui ou non, entrer dans Rome par la force et
commencer l'attaque sans y être provoqué et sans ordre formel ? Une fois aux
portes de Rome, dont vous aurez détruit les murailles à coups de canon,
comment occuperez-vous la ville ?... Pour moins abandonner l'officier
aux influences qu'il subissait, il alla même s'établir au quartier général.
Son départ aurait le résultat probable de donner à penser aux triumvirs,
surtout à Mazzini, vis-à-vis duquel la récente tentative d'assassinat, dont
il ne le disculpait pas entièrement dans son esprit, le mettait véritablement
à l'aise. Il ne s'éloigna d'ailleurs pas sans s'expliquer par une lettre
assez dure[88]. Au camp, Lesseps ne dissimula pas la vérité. Oudinot,
transformé, se montra très aimable. Il offrit à son nouvel hôte un
appartement à la villa Santucci, où il logeait lui-même, sur une hauteur d'où
l'on dominait Rome. La Ville Éternelle avait pavoisé ses monuments de
drapeaux tricolores rouges ou noirs, surmontés de bonnets phrygiens. Lesseps,
inspectant toute la vieille cité, s'attendait à un mouvement populaire. Il ne
remarqua rien d'anormal. Sa lettre aurait-elle donc eu un bon résultat ? Il
en risqua une seconde, adressée plus spécialement à l'Assemblée constituante
afin de renouer, autant que possible, avec le parti modéré, de plus en plus
hostile au pouvoir mazzinien. Il affirmait la pleine intention de la France de ne pas contester aux populations romaines la libre
discussion et la libre décision de tous les intérêts qui se rattachent au
gouvernement du pays. Il ajoutait cet article aux précédents : La République française garantit contre toute invasion
étrangère les territoires des États romains occupés par nos troupes[89]. Le difficile
était de faire parvenir un message, le porteur risquant d'être mis en pièce
par la population. Le commandant Espivent se proposa. Oudinot craignit qu'un
officier courût un péril plus grand qu'un particulier et redouta ainsi de
compromettre l'uniforme. C'était fort sage. Pour la même raison, le docteur
Finot fut écarté, et l'on choisit le secrétaire particulier de Lesseps, M.
Leduc, personnage modeste dont on ne pouvait prendre ombrage et qui se borna,
non sans héroïsme, à recommander simplement sa famille en cas de malheur.
Plus inquiet qu'il ne l'avouait, Lesseps monta au belvédère de la villa
Santucci et prit sa longue vue. * * *Le vice-président de l'Assemblée romaine reçut bien le
message ; toutefois, en même temps qu'il redouta d'agiter trop les esprits,
il ne comprit sans doute pas exactement de quoi il s'agissait, et il se
réserva, se contentant de dire, au cours de la séance, qu'il avait reçu un
mémoire de M. de Lesseps, à l'adresse du Parlement, il est vrai, mais qu'il
convenait mieux de remettre d'abord aux triumvirs. — Les députés approuvèrent
sans discussion. Ils se séparaient lorsque M. Leduc survint avec le second
message. Cette fois le prince de Canino en prit connaissance et pensa
nécessaire d'en donner lecture ; il n'était question ni de la retraite de
Lesseps, ni de Mazzini ; un nouvel article était proposé. — Ce texte fit
impression, fut presque approuvé, et les députés décidèrent de l'envoyer au
triumvirat en le chargeant de conclure un arrangement que chaque jour rendait
plus facile et plus désiré. Une réponse fat confiée à M. Leduc. — En somme,
Lesseps n'avait pas suscité le mouvement qu'il espérait contre Mazzini. Mais des indiscrétions furent commises ; une copie du
message avait été envoyée aux trois commissaires ; peut-être les trois
triumvirs eux-mêmes, au lieu de le dissimuler ou de le faire disparaître, le
communiquèrent-ils ? Aussitôt le résultat escompté se produisit ; les
partisans des triumvirs s'indignèrent contre l'ambassadeur et le parti modéré
se déclara ouvertement contre Mazzini. La ville se partagea en deux camps
bien tranchés[90]. Le lendemain,
Lesseps envoyait, à deux heures de l'après-midi, le télégramme suivant à
Drouyn de Lhuys : Je confirme de la manière la plus
absolue les dépêches dont M. de la Tour-d'Auvergne est porteur. Nos affaires
marchent au delà de toute espérance. Il disait encore : Je compte que nous pourrons bientôt faire chanter le Te
Deum à Rome le 1er juin. Quel beau jour pour la France ! Pourvu quelles dévastateurs
de Rome ne fassent pas quelque folie ! Lesseps s'exagérait pourtant ce demi-succès tout immédiat. Mazzini demeurait très puissant, et les avantages récemment remportés par Garibaldi sur les Napolitains donnaient raison, au moins dans l'heure, à sa politique. L'effet s'imagine sur ce peuple entouré, menacé, assiégé même, de la nouvelle qu'une partie des troupes révolutionnaires avait franchi les frontières napolitaines. Parallèlement, le bruit d'une insurrection parisienne heureuse avait été répandu ; le dictateur y. croyait. Tous semblaient d'accord avec lui et quand on avait parlé de son arrestation, les journaux avaient protesté non sans énergie. Pour l'arrêter ; disaient-ils, il faudrait arrêter les ministres, les représentants du peuple, la garde nationale. A Paris, la Démocratie pacifique de Considérant publiait la lettre d'un officier romain qui spécifiait : Il existe l'accord le plus admirable entre Mazzini, l'Assemblée et le peuple roi. C'est ce qui déplaît fort au jésuite que votre ministère nous a envoyé. On voit bien son intention de rompre l'accord existant entre les pouvoirs constitués. Mais le renard fut trompé dans son espoir. La lutte dura trois ou quatre jours et, malgré la résistance, une partie de l'influence mazzinienne décroissait quand le général Oudinot, dont le succès pacifique ne faisait pas les affaires, pressé de plus par son entourage, pria Lesseps de s'expliquer devant un conseil composé d'officiers généraux. Ce furent Vaillant, Rostolan, Regnault de Saint-Jean-d'Angély, Gueswiller, le Vaillant, Mollière et deux autres, dont un était le colonel de Tinan, ainsi que l'intendant en chef de l'armée, le colonel de Thirion. Lesseps fit connaître ses dépêches au ministre, ainsi qu'une partie des documents qui les accompagnaient, et déclara qu'il était décidé à s'opposer formellement à toute reprise d'hostilités contre Rome avant l'arrivée des ordres du gouvernement ; il se fondait, afin de maintenir ce point de vue, sur la dépêche du ministère datée du 10 mai et qui concluait : Tâchez d'entrer à Rome d'accord avec les habitants ou, si vous êtes contraint d'attaquer, que ce soit avec les chances du succès les plus positives. Plusieurs généraux ne voulaient l'entendre que dans son dernier sens ; ils prétendaient qu'une simple attaque suffirait pour faire ouvrir les portes de la ville, qu'il s'agirait, tout au plus, d'abattre un peu de muraille et qu'il n'y aurait pas de résistance sérieuse[91]. Lesseps expliquait leur erreur, la démontrait ; il fallait un siège véritable, et une fois les hostilités commencées, on serait entraîné à répandre beaucoup de sang comme à détruire les édifices ; enfin la résistance serait assez longue. Il rappelait, en dernier lieu, qu'Oudinot n'avait aucune instruction qui l'autorisât à assumer lui-même pareille responsabilité. Le général soumit alors à la délibération du conseil cette question : Est-il convenable d'abandonner les négociations et de recommencer l'attaque de Rome sans s'arrêter aux conclusions de M. de Lesseps et sans attendre de nouvelles instructions ? La majorité répondait oui, dévoilant une fois de plus le véritable sentiment de l'armée. Pourtant, le général Mollière, qui n'avait pas encore parlé, peut-être parce que le plus jeune, avoua qu'il regrettait — appelé à donner son avis, — de ne pouvoir pas se prononcer pour l'action, ainsi que ses collègues, et que son opinion, quelque timide qu'elle put paraître, était conforme à celle du plénipotentiaire : il lui paraissait difficile de ne pas accorder à celui-ci les huit jours qu'il demandait en attendant les ordres de Paris. L'opinion des officiers changea aussitôt. Ce langage ferme et décidé porta la conviction dans tous les esprits. Il fut décidé que le statu quo serait maintenu[92]. — Lesseps continua d'entretenir des rapports avec la ville par M. Leduc. Il faisait conseiller à ses compatriotes la réserve, la confiance et la prudence. Le pavillon bleu, blanc, rouge continuait de flotter sur son hôtel ainsi que sur les établissements publics français[93]. Le 25 au soir, le triumvirat donnait sa réponse. Elle
achevait celle faite précédemment et, dans son ensemble, présentait une
réelle modération. Il nous faut vous parler
aujourd'hui de la question actuelle, telle qu'elle est posée de fait, sinon
de droit, entre le gouvernement français et le nôtre. Vous nous permettrez de
le faire avec toute la franchise que réclament l'urgence de la situation et
les sympathies internationales qui doivent dominer entre la France et
l'Italie[94].
Et après avoir résumé la question comme le sens que la France avait dit vouloir
donner à son intervention. il n'en est pas moins
vrai que, sous la forme despotique et constitutionnelle, sans ou avec des
garanties libérales aux populations romaines, la pensée dominante dans toutes
les négociations auxquelles nous faisons allusion, a été un retour quelconque
vers le passé, une transaction entre le peuple romain et Pie IX, considéré
comme souverain temporel. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que ce fut sous
l'inspiration de cette pensée que fut conçue et exécutée l'expédition française.
Elle a eu pour but, d'un côté, de jeter l'épée de la France dans la balance
des négociations qui devaient s'ouvrir à Rome, de garantir, de l'autre, la
population romaine de tout excès rétrograde, imposant, toutefois, pour
condition la reconstitution d'une monarchie constitutionnelle en faveur du
Saint-Père[95]. Les triumvirs
concluaient qu'en face d'une pareille situation, sous
la menace d'une transaction inadmissible et de négociations que l'état de nos
populations ne provoque nullement, le rôle de Rome était de résister :
Nous le devions à notre pays, à la France et à
l'Europe entière... Nous devions conquérir le temps nécessaire pour en
appeler de la France mal informée à la France mieux informée, pour éviter à
la République sœur la tâche qui lui serait échue si, précipitamment entraînée
par des suggestions étrangères, elle était presque, à son insu, complice
d'une violence à laquelle nous ne saurions trouver d'égale, si ce n'est en
remontant à 1772, au premier partage de l'Europe. Nous devions à l'Europe de
maintenir autant qu'il était en nous le principe fondamental de toute vie
internationale, l'indépendance de chaque peuple en tout ce qui concerne son
administration intérieure... Ce n'est qu'avec une profonde douleur que nous
nous voyons contraints de résister aux armes françaises. Ici la
rédaction ajoutait que, sans la présence des troupes d'Oudinot, la lutte eût
été plus forte et plus poussée contre l'Autriche comme contre Naples.
L'erreur était évidente ; était-elle sincère ? C'est peu probable, le reste
du mémoire indiquant une grande adresse[96]. La thèse se
soutenait ainsi : Contre les soldats du roi de
Naples et les Autrichiens, nous pouvons nous battre et Dieu protège les
bonnes causes. Nous ne voulons pas nous battre contre les Français. Nous
sommes, envers eux, en état, non de guerre, mais de simple défense. Mais
cette position, la seule que nous voulions avoir, partout où nous rencontrons
la France, a pour nous tous les inconvénients, sans en avoir les chances
favorables, de la guerre. L'expédition française nous a dès l'abord forcé
d'opérer un mouvement de concentration de nos troupes qui a laissé notre
frontière ouverte à l'invasion autrichienne et Bologne et les villes de la
Romagne désarmées. Les Autrichiens, en ont profité. Après huit jours d'une
lutte héroïque soutenue par la population, Bologne a dû succomber. Nous
avions acheté, en France, des armes pour nous défendre ; ces armes, au nombre
de dix mille fusils au moins, ont été séquestrés entre Civita-Vecchia et
Marseille ; elles sont entre vos mains[97]. Que répondre
encore à ceci : Vos forces sont sous nos murs à une
portée de fusil, disposées comme pour un siège. Elles y restent sans but,
sans programme avoué. Elles nous ont forcé d'entretenir la ville dans un état
de défense qui obère nos finances. Elles nous forcent de garder un chiffre
proportionné de troupes qui pourraient sauver nos villes de l'occupation et
des dévastations autrichiennes. Elles entravent notre circulation, nos
approvisionnements. Elles tiennent les esprits dans un état de surexcitation
qui pourrait, si notre population était moins bonne et moins dévouée,
entraîner des conséquences nuisibles... Nous sommes assiégés par la France au
nom d'une mission de protection... Au sujet de la proposition ajoutée
: Vous devez sentir qu'il n'y a rien là qui change
notre position. Les parties occupées par vos troupes sont, de fait,
protégées, mais si c'est pour le présent, à quoi se réduisent-elles, si c'est
pour l'avenir, n'avons-nous pas d'autres voies ouvertes à la protection de
notre territoire qu'en vous le livrant tout entier ? Le nœud de la question
n'est pas là : il est dans l'occupation de Rome. Cette demande forme,
jusqu'ici, la condition première de toutes les propositions présentées. Or
cela est impossible ; jamais le peuple n'y consentira. Si l'occupation de
Rome n'a pour but que de la protéger, le peuple vous exprimera sa
reconnaissance, mais il vous dira que, capable de protéger Rome par ses
propres forces, il croirait se déshonorer à vos yeux et faire acte
d'impuissance en déclarant qu'il lui faut pour se défendre quelques régiments
de soldats français. Si l'occupation n'a pour but, ce qu'à Dieu ne plaise,
qu'une pensée politique, le peuple, qui s'est donné librement des
institutions, ne peut se résoudre à la subir... Il se méfie de toute
insistance. Il prévoit, une fois les troupes admises, des changements dans
les hommes et dans les institutions qui seraient funestes à sa liberté... Sur
ce point-là, sa volonté est irrévocable. Il se fera massacrer de barricade en
barricade plutôt que de se soumettre. Il n'y a pour la France que trois rôles
à jouer dans les États romains. La France doit se déclarer pour nous, contre
nous ou neutre. Se déclarer pour nous, c'est déclarer formellement notre
République et combattre côte à côte, avec nos troupes, contre les
Autrichiens. La France ne peut pas faire cela. Elle ne veut pas risquer une
guerre européenne pour nous défendre comme alliée. Qu'elle reste donc neutre
dans la contestation qui se vide entre nous et nos ennemis. Hier, encore, nous
espérions plus d'elle, aujourd'hui nous ne lui demandons que cela.
L'occupation de Civita-Vecchia est un fait accompli, soit. La France croit
que, dans l'état actuel des choses, il ne lui sied pas de se tenir éloignée
du champ de bataille... Nous ne pensons pas comme elle, mais nous n'entendons
pas réagir contre elle. Qu'elle garde Civita-Vecchia. Qu'elle étende même ses
cantonnements, si le nombre de ses troupes vient à le réclamer, aux localités
salubres qui se trouvent sur le rayon de Civita-Vecchia à Viterbe. Qu'elle
attende là l'issue des combats qui vont se livrer. Toutes les facilités lui
seront offertes, tous les témoignages de franche et cordiale sympathie lui
seront donnés ; ses officiers visiteront Rome ; ses soldats auront tous les
soulagements possibles. Mais que sa neutralité soit sincère et sans
arrière-pensée... Lesseps faisait observer que toutes les garanties
précédentes répondaient aux objections de la note qui avait été remise ; il
la louait et disait être certain de l'entente qui devait se faire. Justement,
le même jour que la réponse, une députation romaine était venue apporter un
cadeau de cinquante mille cigares et de deux cents livres de tabac pour les
soldats, et Oudinot avait chaleureusement remercié. On a dit que les ballots
et les cigares contenaient des proclamations contre le gouvernement français[98]. Le fait est
très possible ; cependant, d'après Lesseps, le coup aurait été paré par
lui-même, tandis qu'il habitait encore Rome[99]. Quoi qu'il en
soit, l'intention seule suffit à prouver que Mazzini persévérait dans son
double jeu. Ces petits billets étaient conçus dans ce style : Un gouvernement de traîtres et de lâches renégats de tous
les régimes déshonore la France, trahit la liberté. Dans leurs projets
criminels contre l'indépendance des peuples, ils ont cru, les misérables,
trouver en vous les instruments serviles d'une politique indigne... Se
méfiant à juste titre de la France, Mazzini avait répondu, d'autre part, à sa
manière, aux sollicitations anglaises. Il pensait qu'elles pourraient lui
servir afin de créer une sorte de schisme religieux. Ses écrits expliquent,
par le penchant qu'ils détaillent, le sens particulier qu'il comptait donner
à celui-ci. Il avait de fréquentes conférences avec les voyageurs de la
Grande-Bretagne et, surtout, avec des missionnaires protestants de toutes les
nations. Lesseps, qui ne l'ignorait pas, s'efforçait de neutraliser ces
influences et dans une intention qui montre que sur ce point, comme sur
d'autres, non seulement il ne dépassait pas ses instructions, mais encore que
les ultramontains, en le combattant, s'ils avaient raison, — et ce serait à
discuter, — au point de vue papal strict, allaient contre l'intérêt du
catholicisme en France, bien en dehors même de toute idée gallicane. Chercher, notait-il, à
persuader Mazzini que la France, dont il se défie, doit être le seul espoir
des libertés italiennes ; le détourner de ses idées de schisme et, au besoin,
dénoncer ses tendances à des patriotes de l'Assemblée en les faisant
considérer comme une trahison à la cause de la liberté italienne qui ne doit
pas se séparer du catholicisme. C'était un peu le point de vue
primordial de d'Azeglio. Les deux partis opposés se mesurèrent au Parlement le 26.
Il fut délibéré sur le maintien du triumvirat et Mazzini vit sa situation
diminuer. Par malheur, les hommes qui agissaient sans cesse sur l'esprit
d'Oudinot, de plus en plus effrayés de l'entente possible, avaient réussi à
exagérer les désirs belliqueux du général. Lesseps voyait renaître autour de
lui le mécontentement que l'entente du 24 avril avait paru atténuer. — Au
point de vue des affaires romaines, la mauvaise foi des accusations portées
contre Lesseps ne fait aucun doute. Dans son livre tendancieux, L. de
Gaillard lui reprochait de n'avoir pas compris que le point de vue français
consistait à s'appuyer sur l'élément modéré et l'accusait même d'avoir
combattu ce qui avait été tenté précédemment dans ce sens. La conduite du
négociateur dément cette allégation. Le parti modéré ne conservant que très
peu de force, ne possédant pas le pouvoir, il fallait même, afin de le lui
préparer, s'entendre d'abord, ou du moins, négocier avec l'autre. Rien ne
sert alors de dire : M. Mercier, envoyé aux
constitutionnels romains quelques jours avant notre descente à Civita-Vecchia,
était parvenu à s'entendre avec eux sur tout un programme de gouvernement
pontifical restauré, sauf deux articles qui lui avaient paru inacceptables :
le jury en matière de délit de presse et l'alliance offensive et défensive de
la papauté avec tous les États de la péninsule[100]. On mit en avant l'approche des fièvres ; on repoussa les arguments logiques de Lesseps, qui se refusait à voir dans la proximité de cette date un motif suffisant d'engager les hostilités. Il indiquait en vain Frascati ou Albano pour la retraite des troupes. Nul ne l'écouta ; l'état-major résistait invinciblement. Le danger devenait tel que le plénipotentiaire avertit son ministre. Ce ne serait pas une reculade, lui expliquait-il, le 25 mai, car nous serons toujours à portée d'entrer à Rome quand nous y serons appelés par le vœu bien exprimé des populations, vœu qui sera d'autant plus général et plus empressé que nous témoignerons moins d'impatience et que nous respecterons la juste susceptibilité des habitants d'une ville qui ne veulent pas être embrassés par force. La lettre au ministre semblait un appel désespéré. Au fond, il poursuivait sa pensée d'envelopper Rome, de la protéger au dehors sans y entrer autrement qu'avec le consentement des Romains[101]. — Le général en chef ne voulait rien entendre et l'approche de l'armée autrichienne fut un nouveau prétexte. Oudinot redouta-t-il, en effet, longtemps et sérieusement l'action autrichienne contre la France, ce qui eût été, d'ailleurs, le moyen de réunir celle-ci aux Romains, moyen justement trop maladroit pour que les généraux autrichiens, guidés par la cour de Gaëte, puissent l'employer ? D'après Farini, Oudinot aurait écrit au moment de cette marche au général Wimpfen : On m'annonce que vous êtes arrivé à Pérouse avec une partie de vos troupes, et que vous vous proposez d'aller en avant, en vous mettant en communication avec l'armée napolitaine qui est dans les Abbruzzes. Je dois vous rappeler que l'armée française a commencé seule le siège de Rome, qu'elle est en mesure de s'emparer de Ponte Molle et, de là, de se mettre en communication avec les routes de Florence et d'Ancône. Je suis résolu à faire avancer mes soldats de ce côté ; retenez donc les vôtres ; l'honneur des armes françaises l'exige. J'ai appris à honorer les troupes autrichiennes sur les champs de bataille ; mais, en ce moment, tout mouvement de leur part sur Rome semblerait offensif et hostile à la France. Si nos soldats se rencontraient dans de telles conjonctures, il en pourrait résulter des conflits que tous deux nous devons avoir à cœur de prévenir. Radetzki ne se laissait pas émouvoir, et pour cause ; il savait dans quel esprit d'entente les apparentes protestations françaises lui étaient adressées. — Cependant Lesseps, sincère, quant à lui, voyant que cette armée menaçait Ancône, voulut la faire occuper. Oudinot répliqua qu'il enverrait trois mille hommes dès son entrée à Rome. Mécontent, l'envoyé de Drouyn de Lhuys demanda les trois mille hommes au gouvernement. De son côté, le général en chef écrivait à Paris : Je n'ai pas d'avis à émettre, cette question politique n'est pas dans mes attributions ; je laisse à d'autres le mérite ou la responsabilité des opinions qu'ils produisent à cette occasion. — Il ne convenait pas décidément que l'affaire romaine eût une solution pacifique. Ce qui précède l'établit et ce qui suit démontre davantage l'obscure mainmise d'un certain parti catholique clérical sur les destinées de la politique française[102]. M. de Rayneval arrivait justement au camp pour détourner Lesseps de ses desseins ou s'il n'y réussissait pas, comme il était à peu près prévu, précipiter les événements. Une conférence se tint entre les deux diplomates. Selon Rayneval, qui négligeait sciemment ainsi tout un côté, encore qu'équivoque, du point de vue gouvernemental, Lesseps avait été invité par son gouvernement à concerter ses démarches avec les plénipotentiaires de Gaëte, afin de ne pas adopter deux langages et deux attitudes. — Lesseps aurait pu répondre que, s'il s'était arrêté à cet inconvénient[103], il n'aurait pu accepter sa mission ni même tenter de l'entreprendre, puisqu'il avait été envoyé justement pour réagir contre la cour de Gaëte ; il se contenta de faire observer qu'il s'était toujours entendu avec d'Harcourt et Rayneval pour ce qui comportait une action immédiate en leur communiquant non seulement ses actes, mais encore les pensées qui les dirigeaient. Il ne leur avait rien caché, surtout à Rayneval, auquel il avait fait saisir tout les mobiles publics ou secrets qui dirigeaient sa conduite ; mais il ne pouvait évidemment pas consulter ses deux collègues pour chaque démarche qui, heure par heure, minute par minute, réclamaient des décisions immédiates et variées ; le général en chef lui-même ne l'avait pas exigé. Cependant Rayneval maintenait son point de vue ; d'après lui, le négociateur n'agissait que sur ses inspirations, sans aucune direction secrète du gouvernement. Lesseps évoquait alors l'évidente volonté du pape de faire le contraire de ce qui lui était conseillé, guidé qu'il était par une véritable Coblentz d'où la pensée française demeurait exclue : il ne pouvait donc, en tant que Français, quant à lui, se baser uniquement sur les antécédents qui avaient inspiré la conduite de son collègue ; les faits postérieurs à l'occupation de Civita-Vecchia avaient, en outre, déterminé une situation nouvelle, dans laquelle le gouvernement ne pouvait pas voir clair, le 8 mai, jour de mon départ de Paris, disait Lesseps, au lendemain de la séance de l'Assemblée nationale du 7[104]. Voilà pourquoi les instructions précises et détaillées avaient manqué. Le gouvernement avait dit à son agent : Votre jugement vous inspirera suivant les circonstances. A court, son contradicteur passait outre : Vous disposez en maître de la situation et paralysez l'armée. C'était tout un aveu. Il ne fut même pas relevé. Rayneval reconnaissait, d'ailleurs, renseigné sur ce qui se passait à Paris, qu'il fallait attendre la décision gouvernementale. Acculé, il soupirait : Il se peut que les Romains nous ouvrent leurs portes. Ils tarderont d'autant plus qu'ils verront l'armée moins disposée à agir. Mais, grâce aux conditions que vous avez faites, la question, suivant moi, reculera au lieu d'avancer. Et, sans une extrême bonne foi, semble-t-il, il concluait : Je proteste, de toute la force de mes convictions, contre vos propositions. Elles entraînent non seulement la reconnaissance d'un gouvernement que la République a formellement déclaré ne pas vouloir reconnaître, mais nous fait faire avec lui offensive et défensive. — Il n'y avait pas un mot de reconnaissance de la République romaine dans les propositions, tellement que Mazzini les avait déclarées inacceptables, semblables, disait-il, nous nous le rappelons, bien que sous une autre forme, à celles d'Oudinot. — Se dérobant de nouveau, Rayneval prenait une autre attitude. Grâce à la façon dont les affaires avaient été conduites, déclarait-il, la France jetait le gant non seulement aux trois puissances, qui avaient déclaré la guerre au gouvernement romain, appuyées en cela par l'Europe unanime, mais à un autre pouvoir supérieur aux autres, appelé à jouer un rôle important dans nos destinées intérieures : la papauté. Là résidait toute la question : la diplomatie française devait se régler, en dépit de certaines restrictions auxquelles Rayneval aurait voulu faire consentir le pape, mais qu'il sacrifiait assez allégrement, sur la diplomatie pontificale. Les allégations de l'ultramontain, quant au gant jeté vers les puissances, tombaient d'elles-mêmes. Naples et Madrid étaient hors de cause. Quant à l'Autriche, était-ce la faute de la France si ses principes étaient différents de ceux du gouvernement autrichien ? Saisissant alors la possibilité d'une occasion nouvelle, Rayneval avançait que, par notre union avec les ennemis du Saint-Père, celui-ci se trouvait exclusivement rejeté vers l'influence de l'Autriche. Lesseps n'eut pas de peine à prouver que loin de nous unir aux ennemis du pape, nous lui montrions que nous étions la seule nation sympathique aux populations romaines qui pût servir ses intérêts dans une mesure juste et libérale. Nous seuls pouvions lui faciliter une entrée à Rome, non par le sang, mais par le consentement des Romains. Des amis sincères de Sa Sainteté, disait Lesseps, m'ont encouragé dans la voie que j'ai suivie ; ils l'ont vivement engagée à ne pas me susciter d'obstacles. Rayneval ne savait plus qu'opposer. Est-il bien dans le vœu de la France, demanda-t-il, de tendre la main à un gouvernement qui a commencé par l'assassinat ? Lesseps aussitôt : Il n'est pas plus exact de dire que la République romaine est solidaire de l'assassinat de M. Rossi que de rendre notre République de 1848 responsable des crimes de 93. La République romaine, que, d'ailleurs, je n'ai pas été chargé de reconnaître, a succédé par le vote universel au gouvernement qui avait été l'héritier direct du meurtre de M. Rossi, et elle a été proclamée par une Assemblée qui avait pour mission de choisir la forme du gouvernement qui lui conviendrait. Ceci est un fait. Je n'ai pas à en discuter ici les conséquences. Rayneval se rabattait sur l'armée : Vous la paralysez, oubliant la maxime : si vis pacem, para bellum. Vous l'exposez aux maladies, à la démoralisation. L'armée qui veut prouver ce qu'elle sait faire, qui veut jeter une gloire de plus sur le nom français, l'armée est condamnée à capituler. Lesseps protesta : Je ne paralyse point l'armée, mais je fais tous mes efforts pour que son ardeur admirable ne la fasse pas dévier de la vraie route. Elle aura bien mérité de la patrie en réservant cette ardeur pour combattre les ennemis de l'indépendance et de l'influence de la France, au lieu de l'employer par une déplorable erreur à faire des brèches sur des vieux murs et à détruire les plus beaux monuments du génie ancien et moderne. Alors Rayneval parla de nouveau sur la marche en avant des Autrichiens et de la diminution de prestige dont serait atteinte la France, si l'autorité pontificale allait être rétablie par eux, à Bologne, sous leur égide. Battu quand Lesseps avait fait ressortir le danger de l'occupation de Rome par les troupes françaises, Rayneval critiquait maintenant leurs positions et celles qui avaient été prévues. L'examen des cantonnements qui nous laissaient de toutes parts des débouchés, comme la faculté d'agir à notre guise, furent détaillés ; quant à la papauté rétablie à Bologne dans les conditions décrites, personne ne la redoutait. — Rayneval abordait enfin la question romaine et présentait la seule objection valable : Les assemblées primaires, dans des pays comme ceux-ci, n'ont pas la force morale qu'elles peuvent avoir chez nous, parce que chacun sait qu'en Italie les populations sont incapables d'exprimer leurs vœux de cette manière. En nous référant à elles du sort futur des États romains, nous déclarons implicitement que nous ne connaissons plus la souveraineté du pape, tandis que nous avons promis solennellement à l'Europe que nous respecterions les divisions territoriales admises par les traités. Lesseps répliqua :En déclarant aux populations romaines que nous ne leur contestons pas le droit de choisir librement la forme de leur gouvernement, nous n'indiquons pas de quelle manière ce libre choix devra être exercé ; si nous n'agitons pas, dans ce moment, les questions relatives aux intérêts du Saint-Père, c'est que nous croirions fort imprudent de le faire prématurément dans la persuasion que le temps seul peut amener un retour volontaire vers lui. Quant à un retour forcé, personne ne peut contester qu'il ne serait pas durable, à moins qu'il ne fût toujours maintenu par la violence qui l'aurait établi. Réponse assez vague, encore qu'elle fût la seule possible, vague comme la situation même. L'entente ne se faisait pas ; chacun restait sur ses positions. Il concédait qu'il serait évidemment déplorable d'ouvrir à la papauté une voie de sang et de ruines et qu'il ne fallait pas qu'il en fût ainsi ; mais il repoussait toute responsabilité dans ce qui avait été fait depuis l'arrivée du plénipotentiaire. Le 28, Lesseps passa en revue, aux côtés d'Oudinot, dix mille hommes récemment arrivés de France. Le 29, il s'entendait avec le général pour adresser aux autorités romaines une communication pressante, car, à ce moment, il espérait de plus en plus aboutir. Une importante délibération avait eu lieu à l'Assemblée romaine, au cours de laquelle le triumvirat s'était vu sur le point de donner sa démission. Le parti modéré semblait, de nouveau, possible. L'Assemblée, la municipalité et le triumvirat reçurent donc des mains de M. Leduc un exemplaire des déclarations suivantes, contresignées d'Oudinot : Je, soussigné, Ferdinand de Lesseps, envoyé extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, en mission à Rome, considérant que la marche de l'armée autrichienne dans les États romains change la situation respective de l'armée française et des troupes romaines ; — considérant que les Autrichiens, en s'avançant sur Rome, pourraient s'emparer de positions menaçantes pour l'armée française ; — considérant que la prolongation du statu quo, auquel avait consenti, sur sa demande, M. le général en chef Oudinot de Reggio, pourrait devenir nuisible à l'armée française ; — considérant qu'aucune communication ne lui a été adressée depuis sa dernière note au triumvirat en date du 26 de ce mois ; — invite les autorités et l'Assemblée constituante romaine à se prononcer sur les articles suivants : Art. 1 : Les Romains réclament la protection de la République française. — Art. 2 : La France ne conteste point aux populations le droit de se prononcer sur la forme du gouvernement. — Art. 3 : L'armée française sera accueillie par les Romains comme une armée amie. Elle prendra les cantonnements qu'elle jugera convenables, tant pour la défense du pays que pour la salubrité de ses troupes. Elle restera étrangère à l'administration du pays. — Art. 4 : La République française garantit, contre toute invasion étrangère, le territoire occupé par ses troupes. En conséquence, le soussigné, de concert avec le général Oudinot, déclare que, dans le cas où les articles ci-dessus ne seraient pas immédiatement acceptés, il regardera sa mission comme étant terminée et que l'action française reprendra toute sa liberté d'action. — Le triumvirat fit demander quel était le sens exact du mot immédiatement. Lesseps répondit que, toujours d'accord avec le général, un délai de vingt-quatre heures était entendu expirant le 30 à minuit. Lesseps attendit alors le mouvement d'opinion qu'il escomptait, car il n'espérait pas dans la bonne volonté du pouvoir exécutif. Est-ce Mazzini qui, se doutant de ce qui risquait de se passer, fit venir dans les tribunes du Parlement un public à lui ? A la séance où le traité fut connu, des rumeurs et des protestations arrêtèrent l'effet des bonnes résolutions de la Chambre ; pourtant les députés, refusant de céder, restèrent sur la réserve ; ils évitèrent de prendre une décision et les triumvirs furent chargés de donner un arrangement définitif. — Nouvel échec pour Lesseps puisque Mazzini demeurait chargé des négociations. Toutefois le dictateur se sentait ébranlé et menacé. Les journaux du parti modéré avouaient leur désir de voir accepter les conditions de Lesseps, et la connaissance que l'on avait maintenant des élections françaises, à la majorité si catholique, appuyait particulièrement la nécessité de l'entente. Tandis qu'il attendait avec confiance l'issue des négociations, la nuit du 29 au 30, Lesseps s'aperçut d'une grande agitation dans l'état-major du général en chef, au point qu'il redouta la préparation d'un mouvement pour le lendemain. A une heure du matin, Vaillant recevait, en effet, d'Oudinot l'ordre de hâter l'établissement d'un pont sur le Tibre, d'étudier les abords de la villa Pamphili et de commencer sur-le-champ les travaux d'une tranchée. Lesseps fut, de plus, averti que, le matin même, les chasseurs à pied devaient s'emparer de la basilique Saint-Paul. — Ainsi, sans prévenir le plénipotentiaire, au mépris du traité récemment signé par lui, Oudinot, de nouveau poussé par son entourage, se décidait à tout brusquer. Lesseps, qui se refusait à le croire, se renseigna. Il apprit qu'un conseil de généraux devait se tenir à neuf heures du matin et qu'on avait évité de l'y convoquer. N'ayant rien reçu encore du ministère des Affaires étrangères, Oudinot et Lesseps se trouvaient sans ordres officiels. Le devoir de Lesseps était de prévenir discrètement Oudinot, car il ne pouvait lui donner d'ordres et se dégager. Il lui fit remettre immédiatement une lettre conçue dans ce sens[105]. — Oudinot ne lui répondit même pas. Lesseps sut bientôt que son avis n'avait compté pour rien et qu'on était décidé à passer outre ; l'attaque des avant-postes devait commencer, disait-on, d'un moment à l'autre. Désespéré, son plan sur le point de manquer au moment même où il allait réussir à concilier l'honneur de son pays et ses intérêts, il se tourna vers le général Vaillant. Il lui dit que le mieux serait d'occuper Albano et Frascati, de manière à empêcher l'approche des 4.000 espagnols débarqués récemment à Terracine. Il est de notre honneur de les devancer dans les campements qu'ils pourraient venir occuper autour de Rome et de nous rendre, en les prévenant, les seuls dominateurs de la ville par une ceinture de troupes. De cette manière, nous ne compromettons point notre gouvernement par une entrée intempestive à Rome, par un séjour dans une ville qui est abandonnée, l'été, par ses propres habitants et même par un passage momentané où les projets infernaux de deux autres fanatiques suffiront pour détruire en une minute notre œuvre de patience et de patriotisme. Nous serons les vrais maîtres de Rome en l'entourant au lieu de l'occuper et le gouvernement de la République, qui ne désire notre entrée à Rome que si nous sommes d'accord avec les habitants, nous remerciera un jour d'avoir contribué à faire triompher par la sagesse de vos conseils, la vraie, la grande politique dégagée de toutes les petites questions d'amour-propre personnel ou de vaine gloriole... Cela aussi fut sans effet. Au conseil, le général Vaillant insista sur l'attaque pour qu'elle eût lieu entre la porte Portèse et la porte San-Pancrazio. Tout allait cependant de mieux en mieux. Dans la même journée, à trois heures, neuf heures avant l'expiration du délai fixé, Lesseps recevait les réponses du président de l'Assemblée romaine et du triumvirat. Le ton conciliant et modérateur des objections faites à l'ultimatum prouvait l'entente facile et prochaine susceptible de mettre les deux pays d'accord ; on voulait, de part et d'autre, arrêter les malheurs dont était menacée une ville tranquille, siège des monuments et des arts[106]. Un autre passage insistait sur la volonté d'apaisement et, même, de concession du pouvoir romain : Comme vous le remarquerez d'un coup d'œil, les modifications que nous croyons devoir nous permettre portent beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Le temps presse ; il faut renoncer aux détails. Nous aimons mieux, d'ailleurs, nous confier, pour suppléer à cette mission, à votre loyauté et à la vive sympathie que vous nous avez toujours manifestée pour notre cause et pour ses destinées. Ce n'est pas de la diplomatie qui peut se faire entre nous, c'est un appel de peuple à peuple. Cet appel à la cessation d'un état de choses anormal, nous vous l'adressons, Monsieur, avec la puissance de conviction et de désir qui vit en nous... Un contre-projet accompagnait la lettre, et qui apportait à l'ultimatum des changements insignifiants. On proposait, notamment, amitié fraternelle et appui, au lieu de protection. Lesseps approuva. Il rejeta l'article 2 ; l'article 3 acceptait la protection, mais repoussait l'installation des Français à Rome : L'armée française, disait-il, sera regardée par les Romains comme une armée amie et accueillie comme telle... Rome n'entre pas dans les cantonnements que choisiront les troupes françaises. C'était le point le plus difficile. L'armée, si elle n'entrait pas à Rome, se demanderait ce qu'elle était venue faire à Rome et ne cacherait pas son indignation ; pourtant l'occupation militaire de la ville était superflue et Lesseps, quant à lui, n'y tenait pas. Il s'efforça de tout concilier en proposant que le général en chef vînt habiter Rome avec la garde qu'il jugeait nécessaire à sa sûreté. L'article 4 avait été maintenu. Lesseps ne pouvait plus douter du succès et, de fait, sans la volonté formelle du général en chef de faire la guerre, il semble bien qu'il était acquis. Il fit porter le dossier à Oudinot, toujours lié par la dépêche télégraphique du 10 qui ne lui permettait pas d'attaquer[107]. Et il lui expliquait de nouveau : Parti de Paris sous l'impression de l'affaire du 30 avril et venu pour traiter avec les populations romaines, je n'ai pas besoin de rappeler que je n'ai ni voulu, ni souffert que l'on pût jamais séparer ma cause de celle de mon gouvernement et de l'honorable chef de l'armée française. Pour arriver à persuader que les dispositions du gouvernement de la République et de son général étaient les mêmes, avant le 30 avril et après, je ne me dissimulais pas tous les obstacles que j'avais à surmonter. Aujourd'hui, j'ai réussi. Il insistait sur la suppression de l'article 2 et concluait : Le projet maintient l'honneur sans tache de notre armée et de notre glorieux drapeau. — Le commandant Espivent, chargé de transmettre le dossier, le rapporta au bout d'un instant. Le général refusait d'en prendre connaissance, en faisant savoir qu'il n'avait pas le temps de le lire parce qu'il était trop occupé des détails de son service ainsi que des ordres à donner à l'armée. Il proposait cependant à Lesseps de s'expliquer plus tard dans la salle des conseils où se réuniraient les généraux dont les campements étaient rapprochés du quartier général. Lesseps réussissait donc à Rome, là où la lutte était la plus difficile, et échouait près du corps expéditionnaire qui était là pour appuyer son action et l'aider. Oudinot savait sans doute, renseigné officieusement, que Lesseps ne devait réussir à aucun prix. Falloux, selon toute vraisemblance, par lettre ou par l'un de ses lieutenants, fit savoir au général en chef que l'œuvre de Lesseps était condamnée à Paris, cette fois, d'une façon enfin sûre, et tandis même qu'elle aboutissait à Rome. Il avait été certain dès lors, une fois les élections connues, que la Législative l'absoudrait toujours, à condition qu'il ramenât le pape dans les conditions les meilleures pour celui-ci et de façon à bien anéantir la République romaine, car le général avait été circonvenu dans son camp chaque jour davantage par un petit état-major de prêtres et de diplomates étrangers qui obtenait de lui presque tout ce qu'il voulait en faisant jouer l'honneur national ; c'était, surtout, le prince Wolkonsky, celui-là même qui connaissait si bien les appartements de l'ambassade de France et avait prévenu le plénipotentiaire de la tentative d'assassinat ; un général prussien, équivoque et singulier, Willisten ; l'abbé de Brimont et un jésuite, le Père Vaure. Celui-ci venait directement de Gaëte et ne lâchait pas l'ami de l'admirable[108] Falloux. Heure par heure, il consignait les événements, puis envoyait ses rapports aussitôt à Rayneval et à d'Harcourt, prompts à agir sur ses instigations. Ce monde presque interlope, en tout cas déplacé, représentait Lesseps sous les plus vilaines couleurs. Son action explique l'humeur variable d'Oudinot, ses colères, ses brusques changements. Odilon Barrot, dupe ici encore, peut-être à demi volontairement, prêtait les mains. Il se vante de ses actes dans ses Mémoires, non sans étrangement déguiser la vérité : Oubliant ses instructions les plus formelles[109], M. de Lesseps traitait avec les chefs de la République romaine comme avec un gouvernement régulier et reconnu ; il acceptait même d'eux des conditions humiliantes pour notre drapeau, déshonorantes pour notre politique... L'humiliation était à son comble, et, cependant, M. de Lesseps avait tout accepté. Heureusement, le vieil honneur militaire se révolta chez le général Oudinot qui refusa de donner son adhésion[110]. Et faisant le jeu de Falloux, qui devait, lui aussi, accuser Lesseps d'un dérangement mental, négligeant de signaler les raisons qu'avait le narrateur de faire connaître la place de ses appartements, il ajoutait[111] : M. de Lesseps nous avait rendu compte de ses négociations dans la plus singulière correspondance qui soit jamais sortie de la plume d'un diplomate ; c'est au point que quelques-unes de ses lettres, une, entre autres, dans laquelle il nous parlait de projets d'assassinat contre sa personne et nous transmettait le plan de ses appartements, nous fit croire à un égarement accidentel de sa raison. Pour être cru, il aurait été indispensable que Lesseps eût été assassiné. La suite du récit n'est pas moins curieuse par l'ignorance des faits qu'elle fait entrevoir chez ce ministre pourtant loyal et persuadé d'accomplir tout son devoir : Lorsque nous connûmes la première convention, il n'y eut qu'un seul et même sentiment dans le conseil, celui de la surprise et de l'indignation, sentiment que vint naturellement accroître la communication de la seconde convention... Il fut à l'instant même résolu que, par voix télégraphique, un désaveu et un rappel seraient notifiés à M. de Lesseps en même temps que l'ordre exprès serait expédié au général Oudinot de reprendre et de poursuivre énergiquement les opérations actives du siège et de s'emparer de Rome à tout prix[112]. Il est réellement difficile de croire que ce récit n'est pas arrangé[113]. La seconde convention date du 31 mai, ce qui rend impossible son annonce le 29, jour où l'ordre de rappel fut expédié. Peut-on admettre que la première convention, celle qui fut présentée le 19 mai à l'Assemblée romaine, ait motivé le rappel de Lesseps ? Le texte de cette convention avait été apporté le 24 à Paris, par Forbin-Janson. Si elle fut désapprouvée comme il n'est pas douteux, Lesseps, du moins, ne fut pas rappelé ; et l'attente d'une convention meilleure, plus acceptable, subsistait si bien que le gouvernement recommandait à Oudinot de ne pas entraver l'action de Lesseps. Mais Lesseps n'était pas des servi seulement au camp par le général, Rayneval et d'Harcourt, il l'était par eux auprès du gouvernement et il l'avait été plus directement par La Tour-d'Auvergne, son propre envoyé, qui ne comprenait même pas qu'on pût discuter avec les Romains. Il avait, lui aussi, poussé Oudinot à l'attaque. A Paris, il accrédita la légende de trouble cérébral si commode, si favorable à ce que l'on voulait ; stupéfait par l'activité du négociateur, incapable de saisir les explications qui lui étaient détaillées, il avait déclaré tout net que l'envoyé du gouvernement ne lui avait pas paru dans un état normal. Cependant la délibération qui suivit l'arrivée du secrétaire de la légation, loin de conclure au rappel de Lesseps, le maintint à son poste ; dans l'ordre d'attaquer Rome le 28, on ne parla même pas de lui. Et dans une autre lettre, écrite également le 28, il était dit : Je fais part à M. de Lesseps des instructions que je vous envoie. Dans le cas où des négociations nouvelles viendraient à s'ouvrir, ce serait encore lui qui devrait les suivre, en se concertant avec vous. Si l'on donnait l'ordre à Oudinot de marcher, tout en conservant Lesseps, c'est que le plan primitif subsistait. Le télégraphe n'apporta que le 29, à trois heures et demie de l'après-midi, l'ordre de rappel. Le gouvernement de la République française a mis fin à votre mission. Vous voudrez bien repartir pour la France aussitôt que vous aurez reçu cette dépêche. En même temps, et en conséquence, le ministre des Affaires étrangères modifia la lettre qu'il avait écrite, la veille, à l'adresse d'Oudinot et qu'il n'avait pas encore envoyée ; il changea la date — 29 au lieu de 28, biffa le passage relatif à Lesseps et y substitua les lignes suivantes : J'envoie par télégraphe à M. de Lesseps l'avis que sa mission est terminée et l'invitation de rentrer en France. C'est désormais avec MM. d'Harcourt et Rayneval, à qui j'écris aujourd'hui, que vous aurez à vous concerter pour tout ce qui concerne l'objet politique de votre mission[114]. Le revirement fut soudain. On est en droit de se demander si la décision d'attaquer Rome n'influa pas sur la crise ministérielle étudiée dans les pages précédentes, et ne pesa pas, notamment, sur le refus définitif du maréchal Bugeaud. Les motifs que lui fait présenter Barrot ne sont peut-être pas les seuls dont il se servit : il avait d'abord accepté le poste ministériel, puis le refusa brusquement, le 28 mai. Il redoutait l'opinion d'une certaine partie de l'armée et voyait dans l'attaque de Rome un prétexte favorable au jeu de la Montagne. Falloux ne demeurait aux affaires que par son confesseur[115] et le jour de sa plus grande inquiétude avait été ce 28, justement, où le ministère avait appris par dépêche que Lesseps confirmait ses renseignements précédents. Nos affaires, disait-il, marchent au delà de toute espérance. Le gouvernement fut désorienté, ce qui permet une fois de plus de saisir le sens véritable du mandat qu'il avait remis à son agent. Drouyn de Lhuys reconnut la gravité de la situation. Falloux fut sur le point de croire tout perdu. En effet, l'ordre d'attaque était parti. Une fois là, il semble possible de pousser plus loin l'investigation interrogative. Le désaveu envoyé à Lesseps n'aurait-il pas été, à travers certains masques plus ou moins marchandés et diplomatiques, le véritable prix de l'adhésion de Falloux au ministère ? Simple prévision à souligner comme telle, mais que les faits rendent vraisemblable, ou, du moins, autorisent. Falloux ne s'est pas réellement expliqué dans ses Mémoires. Il eut besoin de prendre ses garanties auprès de Tocqueville avant de l'agréer, et nous nous rappelons aussi que pendant un certain temps, même après avoir été nommé vice-président de l'Assemblée (1er juin), Tocqueville n'était pas sûr d'être ministre. Il est fort surprenant que Drouyn de Lhuys, une fois ses collègues revenus au pouvoir, n'y soit pas rappelé ou n'y revienne pas de lui-même ; et aucune explication plausible, en dehors, de celle que notre argumentation suggère d'elle-même, n'a été donnée de ce fait si souvent négligé. Le président de la République estimait infiniment son ministre des Affaires étrangères et le préférait à Tocqueville. Son départ ne s'explique, de quelque côté que la recherche s'étende, que par la question romaine[116], et il semble permis d'avancer que, notamment par l'entremise de M. Bois-Lecomte, il aida beaucoup la légende de folie sous laquelle on diminua, puis perdit Lesseps. Lesseps apparaît donc injustement condamné, au moment même où il faisait réussir sa mission, mais cette condamnation était nécessaire aux instruments souvent inconscients du parti qui avait voulu l'échec, parce que sans elle, revenu dans la capitale, le plénipotentiaire devenait un terrible accusateur qui annulait la défense du ministère et rendait le rôle du ministre impossible[117]. Au contraire, le ministre une fois remplacé, son successeur pouvait lui dire avec apparence de vraisemblance, comme le fit Tocqueville : Monsieur, je ne suis pas au courant de l'affaire de Rome, puis, ajouter avec vérité : Je ne suis pas responsable. Une partie de l'art politique, depuis longtemps, consiste, en effet, à supprimer les responsabilités. — Tocqueville, alors, parlait volontiers, — nous l'avons vu, — de son inaptitude à remplir une tâche à laquelle rien ne l'avait préparé ; cette inaptitude était une garantie, la meilleure et la plus désirée. On prit toutes les précautions pour qu'il ne risquât pas de se renseigner petit à petit, et, dans ce but, on épaissit encore la brume qui entourait le cerveau de cet homme si intelligent dès qu'il était question de Rome ; on trompa même sa bonne foi. Il lui fut impossible d'avoir sur ce qui s'était passé dans la péninsule une opinion quelconque : cela lui était, même, en quelque sorte, interdit. L'affaire lui fut décrite comme terminée absolument ; et le 6 juin, il écrivait à d'Harcourt : J'ai trouvé, en arrivant aux affaires, que l'ordre de s'emparer de Rome immédiatement avait été donné depuis près de huit jours... — Il ne paraît pas qu'il ait mis beaucoup de scrupule à accepter cette ignorance. Ce fut le 30 mai, à quatre heures, que les officiers
généraux se réunirent. Lesseps vint à eux en sachant combien il aurait de
peine à faire prévaloir son opinion. Un narrateur volontairement mal renseigné
s'en targua pour écrire : Le grand équivoque de M.
de Lesseps, son attitude embarrassée, prouvaient suffisamment qu'il avait le
sentiment d'une action contraire aux intérêts de la France[118]. — Lesseps
épuisa en vain toute son adresse en récapitulant les faits, dossiers à
l'appui, et en faisant apparaître l'évidence qu'ils démontraient ; il se
heurta à un parti pris irrévocable. La lecture que
je fis des derniers documents, les observations puisées dans le péril et
l'urgence de la situation, le manque d'ordres de la part du gouvernement dont
les instructions télégraphiques du 10 devaient nous servir encore de règle, rien
ne put changer la détermination du général Oudinot. La manière dont elle se
manifesta rendit impossible toute discussion et me mit dans la nécessité
d'opposer mon caractère officiel à des emportements que je déclarai ne
pouvoir supporter[119]. Oudinot, en
effet, cria, menaça, soutenu par le général Saint-Jean d'Angély. — Le manque
d'entente était d'autant plus grave que les opérations militaires allaient
commencer dans quelques heures, malgré la réponse faite précédemment. Lesseps
craignit, pour sa part, qu'une attaque aussi subite, ordonnée au mépris des
conventions établies, ne fît massacrer la colonie française ; la nuit même,
il insista de nouveau près du général. Une scène identique se renouvela, en
présence du capitaine de frégate Chaigneau, qui commandait le Magellan.
Lesseps déclara que si les ordres d'attaque n'étaient pas révoqués, il irait
sur-le-champ à Rome avertir les autorités, de façon à garantir l'honneur
français et à couvrir sa bonne foi. Devant ce qu'il considérait comme une
menace personnelle, Oudinot ne se contint plus et, marchant sur Lesseps avec
fureur, lui cria qu'il allait le faire arrêter. Le plénipotentiaire, pour
toute réponse, mit la main sur la garde de son épée. L'officier entrevit d'un
coup toutes les conséquences et céda. Des courriers partirent pour toutes les
lignes des avant-postes contremander l'ordre d'attaque. Lesseps redoutait
maintenant que l'alarme ne fût donnée dans Rome et même que les contre-ordres
ne fussent pas parvenus partout assez à temps pour empêcher des conflits
déplorables ; il fit donc aussitôt prévenir qu'on ne devait pas s'inquiéter
de nos mouvements, destinés à assurer des positions dont des armées
étrangères, en marche sur la Ville Éternelle, auraient pu, sans cette
précaution, s'emparer. Une partie de la troupe, justement, ne fut pas
prévenue et occupa Monte Mario. Sans ces précautions, il est presque probable
que rien ne se fût passé d'une façon pacifique ; les soldats romains, sans l'assurance
donnée, ne se seraient pas montrés disposés à abandonner leurs postes sans
combattre. Au point de vue militaire, c'était si bien un succès qu'Oudinot, —
un peu rapide, — en fit part à Paris le jour même : Je
me suis applaudi d'avoir eu à vous annoncer l'occupation sans effusion de
sang de Monte-Mario. Lesseps l'emportait encore au milieu des colères
accrues. Le P. Vaure racontait ainsi les événements à Rayneval : Hier, tout était préparé pour une attaque à la villa
Pamphili. Le ministre plénipotentiaire y a mis son veto. Contre-ordre à été
envoyé aux troupes, à leur grand mécontentement. Le ministre vient de partir
pour Rome où l'on ne veut même pas lire ses lettres. Cependant il arrête le
mouvement des troupes et promet un prompt et heureux dénouement, tout en
ayant des discussions désagréables avec beaucoup d'officiers supérieurs, s'en
prenant à tout le monde, même à moi, parce que je viens de Gaëte. Il m'a fait
ce matin des menaces qui m'effrayent peu, parce que c'est ici la cause de
Dieu. Un colonel a échangé avec lui des paroles dures qui pourraient avoir
des conséquences, et tout le monde est très froissé. Je ne sais ce que nous
deviendrons si Dieu n'y met la main, avec les fièvres qui menacent les
troupes. Le ton de la lettre laisse entendre la qualité des
suggestions étrangères auxquelles obéissaient les officiers de l'expédition
et les diplomates. Le 31, vers trois heures du matin, Lesseps, sur le point de regagner Rome, rédigea une note destinée au général Oudinot. Mais celui-ci, ayant su ces préparatifs, le fit demander. Lesseps répondit que son intention était justement de l'aller voir. Oudinot lui dit, dès le début de l'entrevue, qu'il regrettait sa vivacité, et son interlocuteur, après lui avoir serré la main[120], lui expliqua qu'il allait en ville pour terminer la négociation ; il s'efforça en même temps de lui faire saisir les inconvénients d'une occupation de Rome prématurée. Il lui lut la note préparée et lui en laissa l'original afin qu'il n'y eût pas de malentendu possible. Il est utile, disait-il, jusqu'à ce que toutes les passions soient calmées, d'éviter le contact de l'armée avec une population que tant de causes laissent encore en effervescence. Il récapitulait les raisons énoncées déjà et concluait : Une fois entrés à Rome, dans les conditions et l'obligation de la force imposée, pouvons-nous répondre que la force ne sera pas encore nécessaire plus tard pour nous y maintenir et que nous serons libres de nous retirer lorsque notre but politique sera rempli et que la France aura besoin de rappeler ses soldats ? Il valait mieux patienter et entrer appelé par les Romains. Il proposait enfin au général d'ajouter au traité un article qui établissait la liberté des communications entre les cantonnements français et tous les quartiers de la ville. Le général, de son côté, lui remit un billet au crayon dans lequel l'aide de camp envoyé vers le commandant de la colonne chargé de prendre position sur le Monte Mario, prévenait qu'il n'était pas arrivé assez à temps pour contremander le mouvement. De la sorte, en cas de besoin, — car il semble que ce contre-ordre même présentait du danger, puisqu'en contremandant l'attaque il avouait l'ordre donné, — Lesseps pouvait prouver la bonne volonté d'Oudinot. L'entente semblait donc solide et durable. — Le général rédigea pour le ministre de la Guerre une note qui présentait, en réalité, la possibilité d'une double interprétation, mais qui témoignait, du moins, d'un nouvel accord : Les fièvres vont venir ; il n'est pas moyen de prolonger la trêve du 17 mai. M. de Lesseps le comprend. Il est parti pour Rome en grand uniforme pour y porter une déclaration. A peine entré à Rome, il constata l'effervescence que l'occupation de Monte Mario par nos troupes avait suscitée. Fort émus que ce point stratégique fût tombé entre nos mains, les triumvirs demandèrent des explications. Lesseps présenta l'aventure comme un malentendu. Il leur remit une dernière proposition, celle qui avait été rédigée en fusionnant la seconde et les contre-projets ; mais ce texte ne répondait pas aux espérances, parce qu'il ne faisait pas mention de la République romaine et ne garantissait contre l'invasion que les territoires occupés par nos troupes. Les triumvirs laissèrent, néanmoins, voir de suite leur bonne volonté, et, peu à peu, assez rapidement, acceptèrent. Mazzini seul fit observer que les intentions du gouvernement français n'étaient pas telles que les garantissait son envoyé ; les Romains couraient donc, selon lui, bien des dangers. Les positions, disait-il, dont nous allons vous faciliter la possession, la faculté que vous vous réservez de ne repousser nos ennemis extérieurs que dans la mesure où ils viendraient vous toucher vous-mêmes livrent notre existence politique à votre bonne foi. On accorda même à Lesseps que l'Assemblée où ses propositions seraient discutées tiendrait une séance secrète. Mazzini n'y assista d'ailleurs pas et lit engager ses amis à voter pour le traité. Il fut adopté à l'unanimité moins trois voix. C'était l'entente absolue[121]. La lettre des triumvirs l'appuyait définitivement : Monsieur, voici les résultats de la longue discussion de la Chambre : Art. 1 : L'appui de la France est assuré aux populations des États romains. Elles considéreront l'armée française comme une armée amie qui vient concourir à la défense de leur territoire. — Art. 2 : D'accord avec le gouvernement romain et sans s'immiscer en rien dans l'administration du pays, l'armée française prendra les cantonnements extérieurs convenables, tant pour la défense du pays que pour la salubrité des troupes. Les communications sont libres. — Art. 3 : La République française garantit contre toute invasion étrangère les territoires occupés par ses troupes. — Art. 4 : Il est entendu que le présent arrangement devra être soumis à la ratification de la République française. — Art. 5 : En aucun cas, les effets du présent engagement ne pourront cesser que quinze jours après la communication officielle de la non-ratification. Je ne crois pas que les légers changements de rédaction apportés au projet puissent être sujets à objection ? Si cela est, il ne reste plus qu'à arranger les moyens, la forme de la communication. Il est impossible de tirer ce soir même une députation de la Chambre pour l'envoyer au quartier général, mais nous pouvons obtenir qu'un sénateur de Rome, Sturbinetti, fasse partie de celle que nous formerons demain. Les bases une fois admises, on élirait des plénipotentiaires qui se rendraient au camp pour s'entendre sur les détails, le choix des cantonnements, etc.. — Lesseps fit préparer trois expéditions de l'arrangement, immédiatement signées par les triumvirs. En dépit d'une lettre un peu inquiétante d'Oudinot reçue dans l'intervalle, Lesseps pouvait espérer. Le général, d'autant mieux circonvenu de nouveau que son contradicteur était absent, s'étonnait de la lenteur mise à discuter, comme de la discussion même ; il ne concevait pas que son ultimatum n'ait pas été accepté de suite, sans discussion. Dénoncez au plus tôt la fin de l'armistice, ordonnait-il. — Le premier article était absolument conforme aux déclarations faites par Barrot à la tribune, le 16 avril, ainsi qu'au vote du 7 mai. L'article 2 répondait surtout aux vues de Lesseps, mais aussi à celles du général, puisque, par la dernière clause, la circulation dans Rome était accordée aux Français. De plus, par l'article additionnel placé à la suite du traité qui invitait Oudinot à venir loger dans les murs avec une garde d'honneur et après l'engagement verbal pris entre Lesseps et Mazzini que les différents corps d'armée viendraient tour à tour constituer cette garde, satisfaction semblait fournie à tous, d'autant que l'article 3 facilitait l'entrée à toute la troupe sur l'appel de la population. — Lesseps revint au camp avec le sentiment du devoir accompli et celui du succès. Cependant le général, plus encore que sa lettre ne l'avait fait supposer, était complètement retourné. Lesseps lui donna lecture du projet sans parvenir à lui en démontrer les avantages ; l'officier se buta et lorsqu'il fut question de cantonnements extérieurs, il déclara qu'il ne signerait jamais. Il refusa d'entendre de plus longues explications et, comme la veille, ne sachant plus que dire, s'emporta. Son ton n'était pas supportable et Lesseps lui répondit avec une énergie qui coupait court à toute discussion[122]. Il prit ensuite une plume sous le regard furieux du militaire et, sans ajouter un mot, se retira. Comme j'avais la conviction que le projet satisfaisait à toutes les nécessités, aussi bien que le précédent, approuvé par le général, qu'il n'en dénaturait pas l'esprit et que, sous plusieurs rapports, nous devions même le préférer, il m'était impossible de céder lorsque je savais que l'intention du général Oudinot était de profiter de la rupture des négociations, sans attendre les ordres officiels de Paris, car je ne doutais plus de son entente secrète avec les membres de notre gouvernement appartenant au parti réactionnaire[123]. Il ne se trompait pas. Immédiatement après la scène avec Oudinot, le père Vaure la consignait ainsi à Rayneval : ... Le général refuse de signer le traité et renvoie M. de Lesseps de sa chambre à la suite d'une discussion pénible. Il sort avec des menaces de la lui faire payer et s'en retourne à Rome pour y recevoir les ovations des rouges, ses confrères. Le général réunit tout son monde et formule les protestations dont j'envoie aussi copie et fait partir Regnault de Saint-Jean-d'Angély pour Paris, moi pour Gaëte, pour vous prier de venir protester contre la perfidie et la trahison. Nous partons à cinq heures avec Monseigneur Rampon et le prince Wolkonsky. Oudinot avait donc l'approbation de tout le monde[124]. A ce personnel, si français et si régulier, qu'il tenait au courant de tout et au sujet duquel il ne fut jamais interrogé par son gouvernement, il lut les deux lettres qu'il venait de rédiger, l'une à Lesseps, l'autre au gouvernement romain. — Vous avez, disait-il dans la première, depuis le 17 de ce mois, paralysé tous les mouvements du corps expéditionnaire sous mes ordres. Et, non sans une certaine mauvaise foi devant le traité conclu : Les conventions sont en opposition formelle avec les instructions que j'ai reçues. Je les crois contraires aux volontés de mon gouvernement ; non seulement je ne leur donnerai pas mon assentiment, mais je les considère comme non avenues et suis forcé de le déclarer aux autorités romaines, sans retard. Quand le ministère aura fait connaître à la suite de la mission de M. de La Tour-d'Auvergne ses intentions, je m'y conformerai scrupuleusement. En attendant, j'ai le regret d'être dans l'impossibilité de concerter désormais mon action politique avec la vôtre. Et au gouvernement romain : A mon grand étonnement, M. de Lesseps m'apporte à son tour de Rome une convention en opposition complète avec l'esprit et la base de l'ultimatum. Je suis convaincu qu'en la signant, M. de Lesseps a dépassé ses pouvoirs. Les instructions que j'ai reçues de mon gouvernement m'interdisent formellement de m'associer à ce dernier acte. Il envoyait tous ses papiers accompagnés de ce commentaire : Quand je compare un tel acte avec les déclarations que vous m'avez chargé de faire à mon arrivée dans le pays, mon honneur et ma raison me prescrivent de refuser à M. de Lesseps mon concours. Oudinot était sincère. Il suivait les conseils qui lui étaient donnés avec d'autant plus de bonne foi qu'ils répondaient à sa façon de voir, qui l'empêchait de concevoir celle de Lesseps. Le plénipotentiaire envoyait, de son côté, à Paris un
exemplaire du traité. Rentré à Rome dans la nuit, il y recevait, à six heures
du matin, la protestation du général. Il y répondit une assez longue lettre
justificative dont le passage le plus important était celui-ci : Je rends justice à M. le général en chef, au fils d'un
illustre maréchal. On a exploité votre ardeur militaire. Vous vous êtes
rendu, sans le savoir, l'instrument d'une conspiration ourdie par les ennemis
de la France. Vous avez, par votre affaire du 30 avril, ébranlé un ministère.
En faisant avorter le 30 mai qui eût été un nouveau 30 avril sur une plus
grande échelle, je vous ai heureusement empêché d'obéir aveuglément à ceux
qui, par leurs perfides conseils, vous avaient entraîné une première fois et
voulaient aujourd'hui perdre la France. Si vous ne me croyez pas bon
Français, vous jugerez peut-être que ceux qui m'ont remplacé au quartier
général le sont plus que moi, entre autres l'agent officiel de la Russie près
du Saint-Siège, le P. Vaure, un général prussien, premier envoyé de Radetzky,
l'abbé de Brimont... Toute relation personnelle cesse entre nous. Mais les
relations officielles écrites doivent subsister. Il reprochait enfin
au général d'avoir laissé éclater au dehors un dissentiment politique qui
devait demeurer entre eux. — Cette lettre eut au moins le résultat de faire
disparaître immédiatement l'aide de camp du roi de Prusse, le général de
Willisten. Le commandant Dieu, envoyé au camp afin de transmettre au ministre
de la Guerre des renseignements exacts sur ce qui s'y passait, écrivit
aussitôt pour protester contre des allégations
perfides ; il ajoutait, alors que le P. Vaure venait de partir et
n'avait pas encore atteint Civita-Vecchia : l'abbé
Vaure et M. de Brimont sont partis depuis plusieurs jours. — Lesseps
répondit aux triumvirs, qui s'étonnaient à juste titre, qu'il maintenait son
traité et qu'il partait de suite pour Paris, afin de le faire ratifier. Tout, malheureusement, était devenu inutile. Le 1er juin, de grand matin, la vedette qui avait quitté Toulon, dans la nuit du 29 au 30, entra en rade à Civita-Vecchia. Les deux dépêches qu'elle était chargée de transmettre parvinrent au camp à neuf heures. Oudinot les ouvrit et la joie fut générale. Partout le chef du corps expéditionnaire fit annoncer la révocation de Lesseps. Il écrivit vite au gouvernement : Je vous remercie de votre dépêche télégraphique que je reçois à l'instant. Les instructions qu'elle renferme vont être exécutées. Je crois pouvoir vous garantir que les intentions du gouvernement seront entièrement réalisées. Lesseps, — il en avait prévenu le ministre des Affaires étrangères, — considérait déjà sa mission comme terminée et faisait ses préparatifs de départ quand M. de Gérando, chancelier de l'ambassade de Rome, lui remit, en lettre ouverte, de la part du chef d'état-major, la dépêche télégraphique, ainsi conçue : Paris, 29 mai, quatre heures du soir. Le gouvernement de la République a mis fin à votre mission. Vous voudrez bien repartir pour la France aussitôt que vous aurez reçu cette dépêche. — Quelques heures après le départ de la vedette, Lesseps arrivait à Civita-Vecchia, faisait chauffer la frégate à vapeur Descartes et cinglait dans la direction d'Antibes. Il ignorait la seconde dépêche qui ordonnait d'attaquer Rome et conservait l'espoir de défendre son traité à Paris. Sans renseignements sur la tactique des partis dans la capitale, il ne savait pas non plus que le clan catholique agissait. — Falloux, Dupanloup, Montalembert et d'autres avaient assuré l'impossibilité de toute transaction nouvelle. — Le P. Vaure célébrait ainsi la victoire dans sa lettre à Rayneval : 1er juin, Civita-Vecchia, une heure. La tristesse se change en joie. Ma dépêche est arrivée en réponse à celle portée par M. de la Tour-d'Auvergne. M. de Lesseps est rappelé !... Tout le monde est dans la joie. On remercie Dieu de nous avoir délivrés de l'abîme où l'on voulait nous jeter. Les hostilités vont recommencer de suite... Le même jour, à trois heures de l'après-midi, la lettre de Mazzini par laquelle il déplorait le malentendu survenu entre le général et l'ambassadeur, arrivait au camp ; elle faisait — on ne peut plus à propos — observer que les conséquences de cette mésentente ne pouvaient aucunement retomber sur le triumvirat et la population romaine. Oudinot avait prié le chancelier de l'ambassade de donner communication au gouvernement romain du rappel de Lesseps ; il avait aussi fait prévenir les avant-postes que la trêve expirait dans vingt-quatre heures. Il répondait à la lettre qu'il n'avait jamais accepté d'autres propositions que celles de l'ultimatum du 29, ne se considérait donc pas lié par le traité du 31, et laissait vingt-quatre heures pour accepter cet ultimatum, seul valable, du 29. Pressé par Gérando, il consentit seulement à différer l'attaque jusqu'au lundi matin, 4 juin. Or, le dimanche 3 juin, l'assaut était donné à trois heures du matin contre les différentes positions extérieures à l'enceinte de la ville, mais la couvrant, et les Romains commençaient par céder sans même combattre, ne croyant pas à une attaque réelle de notre part. Revenus de leur erreur, ils acceptèrent le combat et luttèrent, jusque dans la défaite, avec acharnement. A Gaëte, la satisfaction fut définitive : les hostilités
étaient reprises de manière à en entraîner de nouvelles. D'Harcourt, depuis
qu'il n'avait pu faire accepter du Saint-Père les garanties réclamées,
annonçait que Pie IX les accorderait certainement une fois rentré au château
Saint-Ange ; il se réjouissait donc aussi. Il semble cependant peu probable
qu'il ajoutât une foi entière à cette assurance qu'il s'efforçait si
activement de propager, peut-être parce qu'il avait besoin d'y croire
lui-même. Il savait la parole d'Antonelli à son collègue Rayneval, lorsque
celui-ci, le 29 mai, lui avait dit qu'il convenait d'attendre encore la
décision de la République française : En cherchant,
comme on fait, à éviter de répandre le sang sous les murs de Rome, on court
le risque d'en verser bien davantage ailleurs. Et d'Harcourt écrivait
simplement à son ministre : Les Autrichiens
établissent à Imola et à Bologne l'autorité pontificale, tandis que les
Français semblent pactiser avec la République romaine. Le 5 juin, au matin, Lesseps arrivait à Paris. Il se présenta au ministre, qui lui répondit ainsi que nous l'avons précédemment consigné. Lesseps lui déclara, sans manifester sa surprise, qu'il restait à sa disposition. Il ne fut pas rappelé. En montant vers le ministre, il avait croisé dans l'escalier Drouyn de Lhuys, qui s'était assez vite esquivé, un peu troublé de cette rencontre. Il essaya de s'adresser ailleurs, notamment auprès d'Odilon Barrot, mais avec le même insuccès ; aucun membre du gouvernement ne voulut l'entendre. On lui fit saisir, et pas toujours avec discrétion, qu'il passait pour fou, et il fut bien obligé de reconnaître que cette opinion, accréditée, était plus forte que ses dénégations ou les preuves qu'il fournissait du contraire[125]. Un seul homme, qui savait à quoi s'en tenir, mais ne pouvait le dire, reçut le malheureux avec affabilité : il se sentait aussi quelque peu responsable : c'était le prince-président. Il ne protesta, d'ailleurs, après s'être plaint et du pape et des montagnards, que par cette bienveillance même, qui ne transpira point au dehors[126]. Les journaux de gauche, mal renseignés, se montrèrent les plus durs, pendant quelques jours, pour le plénipotentiaire. Le National le traitait d'homme à plaindre et de malade à guérir[127]. Quand ils reconnurent la vérité, il était trop tard, l'opinion publique était faite[128]. Le tour aussi était joué. La République romaine, dont le triomphe eût sans doute, et même presque certainement, changé la face de l'Europe, était déjà morte. * * *Dès que les affaires romaines furent de nouveau présentées
à l'Assemblée, il apparut de toute évidence que le gouvernement reculait, ce
qui équivalait à avouer ses torts, et qu'il ne voulait pas les reconnaître.
Ledru-Rollin, le 4, proposa d'interpeller le jour suivant sur les affaires
étrangères, et, tandis que le député Estancelin demandait : quelles affaires ? d'Allemagne ou d'Italie ? l'ami
de Tocqueville, Tracy, se leva pour dire, sans doute avec peu de sincérité,
car il restait inadmissible que cette demande d'interpellation que le
ministère redoutait tant n'eût pas fait l'objet d'un de ses débats : La demande de l'honorable M. Ledru-Rollin arrive sans que
personne n'ait pu la prévoir. Le ministre des Affaires étrangères est absent
de la séance. Et il ajoutait, pour répondre à un membre de la gauche
prompt à décréter que le ministre n'avait qu'à venir le lendemain : Il n'entre pas dans la pensée d'aucun membre de cabinet,
et de moi, assurément, en particulier, de contester à l'Assemblée le droit
d'interpellation à l'égard du ministre ; néanmoins tout le monde comprendra
que l'Assemblée elle-même est maîtresse de fixer comme il lui convient les
interpellations qu'on demande à adresser. Il excusait son collègue,
entré seulement de la veille à son poste. Ledru-Rollin maintint sa
proposition. Il me semble que je me fais ici le
défenseur des droits et des nécessités, si je puis dire, de l'Assemblée. Elle
n'a rien à faire demain. Le ministre de la Marine répéta, en insistant
et en spécifiant davantage, qu'il ne pouvait promettre la présence de
Tocqueville. Le représentant Mauguin essayait de départager les deux
tendances, sans grande adresse. Ledru-Rollin constata : Nous n'avons pas de bonheur quand nous demandons à faire
des interpellations : nous avons toujours en face de nous des ministres qui
reconnaissent le droit ; nous avons M. Mauguin qui monte toujours à la
tribune, prêt à parler sur les affaires du monde, mais qui demande toujours
l'ajournement quand nous demandons les interpellations. Il prouvait
l'urgence. Quand demain nous vous rapporterons les
faits, quand vous entendrez les lettres, non pas d'hommes qui sont étrangers
aux affaires, mais d'hommes qui sont aux affaires, qui les manient, vous
reconnaîtrez que ce n'est pas une vaine fantaisie, que ce n'est pas quelque chose
de frivole, mais quelque chose d'indispensable, d'impérieux. — Tracy
renouvela les mêmes excuses. Un député protesta vainement : Je ne conçois pas qu'un ministre monte à celte tribune et
puisse venir dire que son collègue ne se rend point ici pour une raison de
déménagement, quand l'Europe tout entière est en feu. Le débat fut
renvoyé au jeudi 7. Le 7, Ledru-Rollin, malade, s'excusait par lettre et
demandait à la Chambre l'ajournement. Après un court débat, la majorité
convenait du lundi suivant. Emmanuel Arago obtenait de communiquer quand même
un premier point sur ces affaires romaines si confisquées. Il apprenait au
pays, du haut de la tribune, que les conventions obtenues par Lesseps étaient
honorables. Aussi se refusait-il de croire aux bruits
sinistres qui circulent dans le pays, à savoir que, au mépris de ces
conventions, signées par notre plénipotentiaire, qui ont besoin d'être
ratifiées, sans doute, et qui, dans tous les cas, stipulent l'armistice,
l'ordre aurait été envoyé de Paris d'entrer à Rome par force, coûte que
coûte... Nous devons être certains qu'on n'a pas expédié l'ordre dont je
parlais tout à l'heure, car si un pareil ordre a été envoyé de Paris et en
présence de l'acte que je vous ai signalé, nous aurions le regret de voir que
le gouvernement de la République française aurait méconnu toutes les lois
internationales. Arago racontait aussi les obstacles continuels
dressés sous les pas de Lesseps par l'entourage d'Oudinot. Tocqueville ne
pouvait pas ne pas répondre : Je n'ai que deux mots
à dire. Il est évident pour tout le monde que ce que vient de faire notre
honorable collègue n'est autre chose que ce que M. Ledru-Rollin voulait
faire. (Dénégations à gauche.) Quant à moi, je me sens incapable de discuter séparément
le fait qui vient de vous être soumis ou qui vient d'être allégué, et les
raisons qui peuvent être données sur les autres. Il demandait à
l'Assemblée de statuer sur le renvoi à lundi. — L'extrême-gauche s'écria : On trahit la France, nous ne pouvons pas attendre. Le
député Bac demandait : Lesseps a été envoyé comme
plénipotentiaire à Rome. Il a fait un traité avec le gouvernement romain.
Est-il vrai qu'au mépris des pouvoirs donnés à M. de Lesseps on ait méconnu
cette convention ? que M. Oudinot n'ait pas voulu s'y soumettre et que le
gouvernement français ait approuvé sa conduite ? Il spécifiait qu'il y
avait là une simple demande particulière, un fait encore ignoré lorsque Ledru-Rollin
avait parlé le 5. Il me semble, disait-il, que dans un gouvernement républicain il n'y a pas de fait
qui puisse rester longtemps un mystère ; il est nécessaire que le
gouvernement expose s'il a envoyé des ordres qui renversent le système
prescrit par la Constituante... Odilon Barrot adoptait, de suite, un ton exagéré qui ne dissimulait guère son embarras, et, en accusant ses adversaires de jeter des calomnies ou des imputations odieuses, il savait bien que le mensonge demeurait de son côté ; mais il lui répugnait de le croire ; il n'y parvenait que par moments et, comme il possédait le pouvoir, il continuait à ne pas se rendre compte de ce qu'on lui faisait faire, achevant son suicide politique avec la même sérénité lointaine que précédemment. Tout ce qui se rattache à cette négociation est arrivé seulement hier au ministère, ajoutait-il, afin de mieux se dérober cette fois au moins ; je sais qu'il y a une partie de cette Assemblée qui est aussi bien instruite que le gouvernement lui-même. Et une voix de gauche rectifiait : Mieux instruite ; c'est fort heureux, sans cela nous ne saurions rien. Le président du Conseil persévérait : Je sais qu'il y a une diplomatie en partie double, et nous éclaircissons quelques détails dont la connaissance importe au gouvernement pour savoir quel jugement il doit porter sur ses agents. Et pour se réserver ici aussi, ici surtout, la possibilité de perdre Lesseps : Trouveriez-vous extraordinaire, par hasard, que le gouvernement eût désavoué des actes formellement contraires aux instructions qu'il a données ?... Le prince Napoléon demandait alors à interpeller sur le rappel du plénipotentiaire. La gauche seule l'appuyait ; le centre et la droite décidèrent qu'il ne serait même pas entendu. Vainement il observa qu'il usait d'un droit en demandant à répondre à un ministre. Bac parvenait à jeter quand même : M. Odilon Barrot, en qualifiant les paroles que j'avais apportées à la tribune, a dit que c'étaient des calomnies. Il me semble qu'un gouvernement qui se tait sur des faits essentiels, s'il s'expose à de fausses interprétations et à de fausses allégations, s'est voué lui-même, et par sa propre volonté à ce qu'il a appelé calomnie. Lundi, Ledru-Rollin commença aussitôt l'attaque. Les
sourires renseignés de la droite répondaient à ses paroles. Citoyens, il est des minutes suprêmes où les phrases
paraissent complètement inutiles... Pour savoir quoi ? A quoi ont-elles servi
jusqu'à présent ? Il faut le dire nettement, à dénaturer la vérité ou à
couvrir sous la pompe des mots la honte des choses... Malheureusement, nous
savons ce qui s'est passé ! Chacun de nous a pu savoir que Rome avait été
attaquée avec énergie, avec fureur, il faut le dire, pendant une longue
journée, et que Rome avait été défendue avec non moins de courage... Dans les
journées fatales des 3 et 4 juin, les troupes françaises, après des efforts
de valeur, ont été, à deux reprises différentes, repoussées, et aujourd'hui,
les murs de Rome ne sont pas encore entamés. Mais le sang français, mais le
sang romain ont coulé à torrents ; voilà ce que tout le monde sait, voilà ce
qui fait saigner le cœur aussi et voilà pourquoi je n'ai pas besoin
d'interpellation. Ledru-Rollin développait ensuite un certain nombre
de faits contre lesquels protestaient les ministres, puis il posait cette première
conclusion : Il est certain que nous avions promis,
à Rome sous la Constituante, de protéger son indépendance ; mais il est
certain que par la constitution nous avons déclaré que jamais nous ne
porterions atteinte à la souveraineté, à la nationalité, à la liberté d'aucun
peuple ; il est certain que par le vote du 7 mai l'Assemblée constituante a
décidé que l'expédition d'Italie ne pouvait pas être détournée plus longtemps
du but qui lui avait été assigné par elle. La discussion était stérile
; Oudinot était allé à Rome afin de s'en emparer par la violence. Les faits
étaient suffisants et on n'y pouvait rien répondre. Ce
qui est vrai, c'est que le gouvernement a manqué au plus sacré de ses
devoirs, c'est qu'il a violé la constitution. Ce qui est vrai, c'est qu'une
mise en accusation est le seul acte qu'on puisse diriger contre lui. Et
pour répondre aux objections déjà présentées et qui n'allaient pas manquer de
reparaître : Il ne faut pas essayer de donner le
change ni à notre armée, ni à l'opinion publique ; il ne faut pas essayer de
dire que nous voulons combattre contre l'honneur du drapeau français...
L'honneur du drapeau français, je l'ai dit déjà, il est compris par certains
hommes d'une façon qui n'est plus de cette époque. La question n'est pas de
savoir si la force vitale d'une nation de trente-six millions d'hommes peut
s'emparer d'une ville ; la question est de savoir si nous avons pour nous le
droit et la justice ; la question est de savoir si en allant attaquer Rome,
un peuple de frères, une république comme nous, nous ne manquons pas au plus
sacré des principes. Or il ne faut pas nous dire que, parce que les Français
ont essuyé une défaite, il faut une victoire aujourd'hui ; celle-ci n'est pas
possible. Il ne peut pas y avoir de victoire contre la violation du droit.
S'emparât-on de Rome un jour, on ne pourra jamais compter cela dans nos
annales pour une victoire ou un succès ; ce serait une honte, je ne crains
pas de le dire à la tribune, parce qu'il y a quelque chose de supérieur à la
question d'honneur, c'est la question du droit, la plus vivace et la plus
sacrée... Je ne puis donc faire qu'une chose, c'est de descendre de cette
tribune après avoir déposé aux mains du président de l'Assemblée un acte
d'accusation contre le président de la République et contre les ministres qui
se sont rendus coupables, quoi que vous en disiez, au plus haut chef, de ce
qu'il y a de plus grave, de la violation formelle de la constitution... Et,
vu l'urgence, je demande que nous nous retirions immédiatement dans les
bureaux pour délibérer. Les tribunes commençaient à soutenir l'orateur. Elles ne pouvaient oublier les assurances si positives de M. O. Barrot dans la séance du 9 mai, lorsqu'il avait représenté l'intervention française comme une garantie sérieuse et réelle des États romains. Aux yeux du public à qui l'enchaînement des faits demeurait étranger, il y avait quelque chose de choquant pour le bon sens et la bonne foi dans ce bombardement de Rome pour la sauvegarde de ses libertés. L'opinion ébranlée oscillait. Un souffle pouvait l'incliner d'un bout à l'autre de la France en faveur de la gauche ; sans la peur du socialisme, la victoire morale était consommée, et cette victoire-là, en France, entraîne tout[129]. Cette constatation de Castille, faite en 1856, montre en outre qu'il y avait un fonds sérieux dans les espérances de ceux qui poussaient la Montagne et explique assez par certains côtés comment ce qui a paru depuis une faute de tactique évidente fut peu à peu commise. Barrot déclara qu'il n'avait aucune
connaissance des détails de l'honorable M. Ledru-Rollin. Il
l'accusait, en venant ainsi publiquement raconter ce qui ressortait de
lettres privées, d'affoler l'opinion publique. Il utilisait le sentiment de
la peur toujours si puissant. Effrayé à son tour, dans une certaine mesure,
mais autrement que ses adversaires, il dira même, mis en face de l'accusation
du président de la République et de ses ministres : Il
ne faut pas cumuler la lutte légale et la sédition ! Il aurait
d'ailleurs attendu pour répondre si lui seul avait été en jeu, mais il
s'agissait du pays, et il risquait une déclaration surprenante : Après avoir tout fait pour éviter cette situation, tout,
excepté de sacrifier notre honneur, l'honneur de notre diplomatie, l'honneur
de notre armée, après avoir tout fait pour éviter cette cruelle extrémité,
oui, nous sommes engagés dans un conflit de guerre avec des populations à
qui, dans la sincérité de nos convictions et de nos résolutions, nous
n'entendions porter que protection et liberté. Il donnait cette explication
au rappel de Lesseps : Au moment où le gouvernement
a décidé que les négociations étaient épuisées et que la mission de l'agent
plénipotentiaire qu'il avait envoyé pour faciliter les négociations était
terminée, le gouvernement ne l'a fait que devant les plus impérieuses
nécessités car, je le répète, cette nécessité était l'honneur. Il
donnait un historique ingénieux de l'affaire romaine, décrivait les promesses
libérales dont l'avènement de Pie IX avait été auréolé, rappelait que
Cavaignac avait aiguillé la politique romaine dans le même sens, selon le
même esprit, avec l'approbation de la majorité constituante ; il reprenait la
thèse, jamais épuisée, semblait-il, de l'intervention française empêchant
celle de l'Autriche et, par là même, la réaction inévitable. Amalgamant le
vrai et le faux, il embrouillait infiniment la question avec un art
parlementaire consommé, réalisant l'un de ses plus beaux discours au point
d'effacer la réalité et de supprimer le fonds du débat[130]. Il effleurait,
pendant quelques instants, la question véritable en rappelant que le
gouvernement s'était, dès le début, expressément refusé à reconnaître la
République romaine comme à établir avec elle une espèce de solidarité, alors
qu'au contraire il s'engageait à la conférence de Gaëte et était en rapports
constants à Paris, avec le nonce. Il donnait enfin la mesure de ses illusions
quand il concluait, après avoir invoqué la honte qu'il y aurait eu, selon
lui, à accepter les conditions romaines : La cause
que nous soutenons à Rome, la cause que fera triompher la valeur de nos
soldats, c'est non pas seulement la cause de la dignité de la France, de
l'honneur de nos armes, c'est la cause, je le dis sincèrement, de la liberté
romaine[131]. Ledru-Rollin relevait l'artifice ministériel. Lui aussi
rappelait aux députés les textes mêmes qu'Odilon Barrot avait omis de citer,
le décret voté par la Constituante après Novare, notamment les déclarations
qui avaient suivi les discours de Jules Favre ; il fournissait la preuve que
le gouvernement avait fait la promesse formelle de ne pas attaquer la
République romaine ; et il proposait le texte suivant : L'Assemblée nationale invite le gouvernement à prendre
sans délai les mesures nécessaires pour que l'expédition d'Italie ne soit pas
plus longtemps détournée du but qui lui est assigné. Et dans l'espoir
d'atteindre au vieux fonds d'honnêteté du président du conseil : Je ne comprends pas qu'un homme se commette, je dirai
presque, qu'il se déshonore à soutenir par des phrases ce qui est si clair,
ce qu'il ne pourrait jamais rendre plus lumineux. Vous aviez prétendu que
vous aviez le droit d'aller dans le cœur de Rome faire couler le sang
français mêlé avec le sang italien. Je vous dis, moi, que vous ne l'aviez
pas. Vous dites à ces membres qui n'étaient pas de la Constituante nationale
que l'Assemblée vous en avait donné le droit. Je vous dis que vous ne l'aviez
pas et je vous le prouve. Vous venez nous jeter je ne sais quelle histoire de
pape pour déplacer la question. Je ne parle pas de sa vertu, la question
n'est pas là ; je ne vous parle pas des griefs qu'on lui reproche, la
question n'est pas là. Un peuple souverain s'est levé qui a proclamé sa
nationalité et son indépendance. Une assemblée nationale a dit : Vous
n'irez pas le secourir, non, mais vous ne pouvez pas l'attaquer. Voilà la
question... Cela vous fait sourire, monsieur Barrot, cela me paraît pourtant
assez clair. Et après avoir récapitulé l'affaire Lesseps, il s'écriait
: Je ne saurais trop le répéter, vous profitez d'une
lacune entre une Assemblée qui va finir et une Assemblée qui n'était pas
encore debout pour faire un empiétement de pouvoir, pour révoquer votre agent
d'une part et pour donner l'ordre d'entrer dans Rome, coûte que coûte... Et
vous dites que vous n'êtes pas responsable ! Je vous dis que vous avez au
front une tache de sang ! Vous osez nous dire que la France agit libre dans
son indépendance, sans être influencée par les cours de la Sainte-Alliance,
vous osez nous dire cela ! ... J'avoue franchement que je ne comprends pas
que vous riiez. — Sur Lesseps même : Comment,
cet homme que vous avez été choisir entre tant d'agents honorables et dont
vous avez tant de fois fait l'éloge, il aurait manqué à ce point de déclarer
une chose contraire à la vérité, il aurait manqué à vingt-cinq ans de sa vie
! Non ! Il a dit la vérité, l'avenir le prouvera. Entraîné alors par
son indignation, par l'attitude de la droite, exprimant tout son parti, si
travaillé les jours précédents, et heureux, dans sa colère, de se solidariser
avec lui, acculé à son désespoir, il s'écria, d'une voix plus forte,
menaçante, et qui n'étonna pas ceux qui avaient remarqué le calme contenu
avec lequel il était descendu lentement des bancs de la gauche pour répondre
au ministre[132]
: Vous nous dites en commençant, comme pour nous
intimider : Vous qui nous interrogez, vous qui nous accusez, êtes-vous bien
sûrs de rester dans la légalité ? Je vous répondrai : je vous trouve bien
téméraires, vous qui avez violé la constitution, de nous adresser une telle
question. Notre réponse est bien simple : La constitution a été violée ; nous
la défendrons par tous les moyens possibles, même par les armes ! Et
toute la gauche se levait en face de la droite furieuse : Oui ! Oui ! nous repousserons par les armes les complots
des royalistes. Rappelé à l'ordre par le président, Ledru-Rollin se
défendit par l'article 110 de la constitution : La
défense de la constitution est confiée au patriotisme de tous les Français
; puis une fois de plus : J'ai dit et je le répète :
La constitution violée, sera défendue par nous, même les armes à la main. Après le tumulte, M. de Ségur d'Aguesseau proposait un ordre du jour qui escamotait la question. Emmanuel Arago protestait contre. Le président avait mis cet ordre du jour aux voix sans consulter l'Assemblée. Et comment admettre qu'une question de cette importance fût ainsi reléguée ? Mais on l'empêchait de parler. Thiers réclamait avec les autres la clôture et montait à la tribune pour s'en expliquer ainsi : "Il n'a jamais été dans nos usages de vouloir étouffer les discussions et si, maintenant, contre nos usages, contre nos goûts, contre nos intérêts, nous demandons la clôture, c'est parce que le cri aux Armes ! a été poussé, et qu'il n'est plus de la dignité de l'Assemblée de discuter après un tel cri. Arago parvenait encore à faire entendre quelques paroles, dont celles-ci : Si vous entrez dans Rome, vous serez embarrassé de votre victoire, dont vous aurez honte, dont vous ne saurez que faire, car, encore une fois, nous savons vos projets... Crémieux proposait un ordre du jour qui ordonnât la cessation immédiate des hostilités. L'ordre du jour pur et simple fut adopté par 361 voix contre 203. C'était relever le gant jeté par la Montagne[133]. * * *Paris s'était déjà fortement ému à la seule nouvelle de
l'attaque contre Rome. C'est alors que Laviron, destiné à périr sous la
carabine d'un chasseur de Vincennes en défendant la Ville Éternelle, et
quelques autres, avaient préféré la fraternité internationale à un
patriotisme que la réaction leur rendait impossible. Les esprits se
montraient fort agités, depuis cette période, chez tous les révolutionnaires
demeurés en France. Le mouvement, sincère, spontané, datait de loin. Il
datait de décembre 1848 et, en réalité, de toutes les luttes électorales
autour de l'élection présidentielle, si décisives pour renseigner sur la
réaction des classes possédantes. Là, même, l'invisible trame logique qui
relie le 13 juin 1849 aux journées de juin 1848, défaite purement
prolétarienne, au 15 mai, défaite parlementaire et révolutionnaire des
représentants du prolétariat, sans vouloir remonter au mois d'avril, se
laisse facilement toucher. Nous avons vu les tendances du mouvement nouveau
en janvier et février[134]. Examinons-les
de plus près en rappelant nos indications principales. — Dès le 4 novembre
1848, la Solidarité républicaine arrêtait et signait des statuts à Paris. Le
préambule établissait une position d'attaque : Considérant
que les partis contre-révolutionnaires conspirent ouvertement et s'efforcent
de discréditer la République ; que, dans presque tous les départements, en
même temps que la République est systématiquement calomniée, les démocrates
ne peuvent, le plus souvent, trouver dans les administrations locales la
protection qui leur est due ; qu'en présence d'une position aussi périlleuse,
il est du devoir et de l'intérêt de tous les républicains de former entre eux
une alliance étroite pour se protéger mutuellement et, surtout, pour opposer
une action unitaire à des manœuvres qui, si elles réussissaient, auraient
pour effet d'enlever à la France le bénéfice de la victoire de février et de
retarder l'émancipation générale des peuples. Art. 1 : Une association est
formée entre les républicains des départements et des possessions françaises
d'outre-mer sous le titre de la Solidarité républicaine pour assurer, par
tous les moyens légaux, le maintien du gouvernement républicain et le
développement pacifique et régulier des réformes sociales qui doivent être le
but et la conséquence des institutions démocratiques[135]. A la date du
25 décembre, entre autres, on sait qu'elle organisait minutieusement l'avenir
; Martin Bernard et Delescluze prévoyaient de prochaines émeutes dans des
lettres aux affiliés de province. Ils donnaient le conseil de se tenir prêt
afin de n'être pas pris au dépourvu comme en février[136]. La force et la
durée de Louis-Napoléon n'étaient pas admises une minute. Martin Bernard, le
27 décembre 1848, ne trouvait pas la situation mauvaise. La venue de Bonaparte nous procure deux avantages. Le
premier c'est que Cavaignac est mort et enterré ; le second, c'est de nous
mettre de suite en présence d'un danger qu'il nous fallait toujours subir tôt
ou tard, et mieux valait que ce fût de suite[137]... Il disait
aussi : Notre défaite nous donne le temps de nous
ménager un triomphe définitif ; si nous avons reculé au 22 février, ce sera
pour revenir à un 24 février plus complet. Le résultat est certain si nous
savons comprendre que, pour notre parti, la question va devenir une question
d'être ou de n'être pas... Il faut, en un mot, que notre solidarité couvre la
France, que pas une commune de la République ne soit privée de son action
centralisatrice pour qu'au jour prochain où la France, pour se sauver, sera
obligée de se jeter dans les bras de la vraie démocratie, nous trouvions un
personnel tout créé, pour qu'au moins nous ne manquions pas, sinon d'hommes,
au moins de renseignements positifs sur les hommes comme au 24 février[138]. Dans une autre
lettre s'affirme le même optimisme : Nous avons
compris, comme vous, que le résultat de l'élection du 10 décembre ne pouvait
rien contre la République... Comme vous, enfin, nous pensons que les
difficultés financières appelleront très prochainement la réalisation de nos
doctrines et l'avancement des hommes qui les représentent. Il faut donc
attendre patiemment et l'arme au bras... Nous ne prendrons le fusil que si la
République est ouvertement attaquée par la violence. Il n'y a pas à regretter
de voir mourir la Constituante, d'autant que l'on a le droit de compter sur
une Législative bonapartiste ; — et l'on peut se demander ici si la
suite des contradictions qu'apportèrent les faits n'entama pas petit à petit
chez les chefs mêmes la prudence patiente dont ils voulaient armer leurs
troupes. En tout cas, le révolutionnaire ne s'illusionnait pas sur son parti
: Il faut s'avouer que la Montagne n'est pas à la
hauteur des circonstances ; la plupart de ses membres manquent de foi et
d'intelligence révolutionnaire ; le reste est paralysé dans son initiative et
se laisse diminuer par des traditions parlementaires. Une sorte de
pressentiment lui permettait de prévoir que le mouvement serait prématuré : ...
La bataille peut se présenter demain, et pour nous
il est important que la victoire ne nous trouve pas au dépourvu[139]. La Déclaration
des Droits de l'homme servait encore de base : C'est
l'arche sainte et la constitution de 93 n'a évidemment besoin que de quelques
modifications rendues nécessaires par le progrès. Je suis donc très partisan
comme vous de remplacer au sommet de notre République la Déclaration des
Droits et la constitution de 1793. C'est, comme le disait la charte de Louis
XVIII, le moyen de renouer la chaîne des temps et le respect de la tradition
à une valeur incontestable. Et le résumé du programme donnait : Voilà comment nous entendons opérer. Après une révolution
nouvelle, promulguer la Déclaration des Droits et la constitution de 93
légèrement modifiée ; provisoirement, une dictature révolutionnaire résumée
dans un comité de salut public et s'appuyant sur un comité consultatif
composé d'un délégué de chaque département... La révolution n'était
pas prête, surtout par le nombre, mais elle se persuadait qu'à force de
vouloir l'être elle le serait, et même qu'elle était en train de le devenir.
Qu'un événement, propre à placer le parti dans une sorte d'impasse survînt,
que l'avenir parût devoir étouffer de plus en plus les dernières espérances,
au point de supprimer la suprême issue qui se dissimulait encore, la révolution nouvelle ne pouvait manquer d'éclater.
Elle était dans l'air de par la situation[140], de par le
recul constant du pouvoir et si visiblement que Barrot, qui accusait la
Montagne d'avoir voulu l'irréparable[141], déclarait
d'autre part qu'il s'attendait à la bataille[142]. Il savait par
ses préfets qu'elle se préparait[143] ; il affectait
seulement de voir dans la lutte entreprise par les Montagnards une diversion
promise aux Romains, alors qu'elle venait d'un sentiment différent, de bien
plus loin, et que le bombardement de Rome en était simplement la raison
définitive ; la victoire non dissimulée de la droite réactionnaire et
cléricale entraînait fatalement, aucun autre moyen d'action ne restant à la
gauche, la révolte, et la révolte seule, car il n'y avait plus en France les
éléments d'une révolution. Barrot a même raconté que, le 17 mai, un rapport du
préfet de police annonçait que le comité central
socialiste était toujours le grand centre d'action, que la propagande de ce
parti continuait à faire des progrès dans les rangs de l'armée, que
l'organisation matérielle de l'insurrection se poursuivait tous les jours et
que la population qui devait prendre part au mouvement armé était prête à
obéir au premier signal, enfin que le concours et l'initiative des
représentants de la Montagne ne serait même pas nécessaire pour donner ce
signal, parce que le parti qui s'appuyait sur eux comptait toujours en
trouver deux ou trois disposés à se mettre à sa tête[144]. Fidèle à
répéter les bruits de son entourage, Castellane notait sur son journal : Les montagnards voudraient faire encore beaucoup de mal[145] ; mais il
n'oubliait pas de remarquer que le choléra, qui faisait des ravages considérables,
retenait les ouvriers[146]. — Le ministre
s'attendait même à un mouvement pour le 12, averti
par des rapports ultérieurs, successifs, que l'exaspération allait toujours
croissant et que le moment de l'action approchait[147]. Nous verrons
plus loin que, dans ce peuple, la lutte était annoncée pour plus tôt.
Auparavant, renseignés déjà par les lettres précédentes, il nous faut étudier
de plus près encore les origines du dernier effort révolutionnaire désespéré
que fut le 13 juin. En remontant à la source des faits, dit l'historien qui, jusqu'à présent, a le mieux exposé la question, Castille, il est impossible de passer sous silence les actes, l'attitude et les tendances d'un corps politique peu important d'abord, mais qui ne tarda pas à influer singulièrement sur la marche des événements. Je veux parler du comité démocratique-socialiste, plus connu du public sous le nom de conclave, parce que cette commission électorale, le jour où elle faisait le choix de ses candidats, prenait le nom et les allures discrètes d'un conclave. Les journaux de la réaction se plurent à employer en parlant du comité démocratique socialiste, ce nom un peu extraordinaire qui fit fortune dans le public mal renseigné[148]. En réalité, le complot n'exista pas, surtout dans le sens que lui donna plus tard le réquisitoire d'août 1849[149] ; il y eut conflit entre forces opposées qui devaient en venir à une rencontre. Toutes les journées de 1848 se lient entre elles, découlent les unes des autres, s'expliquent les unes par les autres. Le 13 juin ne se sépare pas du 29 janvier qui, lui-même, est une sorte de prolongement de l'insurrection de juin, et nous avons établi précédemment le reste de la filière. La lutte entre la réaction et la révolution était si bien, elle aussi, une suite, qu'elle datait de février même[150]. Battue, la démocratie avait essayé de se ressaisir et, commençant à comprendre ses fautes, avait fait taire certaines rancunes afin de parvenir à l'unification. Elle savait, maintenant, le danger des rivalités inutiles en face d'adversaires unis ; elle avait expérimenté les caprices spontanés du suffrage universel et, sans invalider celui-ci, né de la révolution, principe et moyen quand même, elle s'efforçait de ressaisir l'action dirigeante à travers l'expansion générale de l'individualisme : elle s'essayait à ramener au sentiment de la discipline nécessaire les masses à peine émancipées qui s'abandonnaient déjà. — Le congrès général et le conseil central s'étaient réunis le 2 mars 1849, afin de réaliser l'action nécessaire, et, sous leurs auspices, une réunion électorale avait été organisée, dans chaque arrondissement de Paris ou de sa banlieue, pour que les véritables démocrates pussent nommer des délégués chargés de représenter dans le comité dirigeant leur tendance socialiste. C'était attirer habilement le peuple qui se plait toujours, et se plaisait peut-être, en ce temps-là plus encore, aux actes de souveraineté ; les réunions électorales, ouvertes six semaines avant les élections, remplaçaient les clubs fermés ou réglementés depuis le 29 janvier. Par ces délégués, en tout cas, encore que ceux-ci restassent libres vis-à-vis de lui, le peuple avait l'appréciable sentiment d'agir. Le danger étant, d'ailleurs, réel, peu de personnes, en dehors des convaincus, en face des périls réactionnaires si nets à l'horizon, recherchaient un poste de combat, et les délégués se trouvaient ainsi, de nécessité, sincères. Une organisation assez sérieuse, puissante même, se forma donc et qui aurait pu acquérir une force redoutable, surtout au moment du coup d'État. Le résultat obtenu fut curieux, surtout par sa perfection théorique. Une véritable machine de guerre était créée, propre à porter de rudes coups si ceux qui l'utilisaient, la formaient aussi et l'animaient, avaient répudié l'abstraction des mots et l'intransigeance préconçue. Chacun des quatorze arrondissements de Paris nommait quinze délégués ; ces quinze délégués se choisissaient un président et, sans négliger leurs fonctions de membres du comité, ils dirigeaient des réunions publiques, plongeant à la fois dans le peuple dont ils étaient le produit et remontant dans le comité où se fournissaient les résolutions supérieures. Dans chaque arrondissement, le président formait en outre des sections électorales, divisées et subdivisées en chefs de sections et en sectionnaires, de façon à atteindre ainsi les derniers rameaux de la fibre démocratique et donner la pâture à cette aspiration à la fonction qui est un trait distinctif de la démocratie française et qui prouve combien elle est éloignée du système américain. Le comité démocratique socialiste forma donc une sorte de chambre électorale, produit d'environ cent mille suffrages, et dont les résolutions allaient faire loi dans le prolétariat parisien et gagner du terrain en province. Le suffrage universel se trouvait ainsi éludé et réduit, sinon en principe, du moins de fait, à deux degrés, le peuple, à qui les présidents d'arrondissement ne cessaient de prêcher la discipline, acceptant sans contrôle la liste du comité. Ces grands électeurs devenaient en outre, en face de l'Assemblée nationale, un corps politique d'autant plus menaçant qu'il faisait, lui, les députés[151]. Développé dans les réunions, le thème sur la République au-dessus du droit des majorités était alimenté par les comités qui espéraient mettre hors de discussion et d'atteinte le principe républicain en même temps qu'avertir, en quelque sorte, la majorité monarchique du Parlement. Placée ainsi au-dessus de tout, la République présentait quelque chose de théocratique, une sorte de socle dogmatiquement religieux, qui paraîtrait étrange peut-être, aujourd'hui, à certains, mais semblait tout naturel alors. Un des membres du comité était prêtre, l'abbé de Montlouis. De nombreux discours dans les clubs firent pénétrer peu à peu cette légitimité républicaine à travers les masses ; si elles ne saisissaient pas toujours toute sa nécessité, elles sentaient, du moins, le côté sérieux de la tactique nouvelle et ce qui l'avait imposée ; elles se demandaient si elles n'étaient point obscurément menacées ; et ce qui restait de sain, d'énergique, de vivant dans le prolétariat, sans se donner tout à fait, se laissa grouper, prêt, assez volontiers, à agir. La colonne d'attaque était facile, incertaine, comparée à celle de mai et de juin — car en février elle se forma tout à coup — mais son incertitude était compensée par son organisation et, en haut des cadres, par une conscience résolue[152]. En face du danger, la nécessité de la discipline s'était définie, car il s'agissait bien de discipliner le suffrage universel, de reprendre une manière d'action gouvernementale sur le peuple. Les hommes qui aspiraient à ce but, et qui se trouvaient aptes à l'exercer, étaient bien certains de se rencontrer dans le comité démocratique socialiste, de s'y reconnaître au milieu des profanes et des néophytes que le caprice des réunions primaires pouvait y amener. Ils savaient combien il leur serait là facile de se grouper et de s'emparer de la direction du comité par l'avantage certain que toute coalition, surtout lorsqu'elle est secrète, rencontre dans une réunion parlementaire encore inexpérimentée[153]. Les vieilles lames ne pouvaient manquer de se joindre, le prolétariat, toujours si peu éduqué, désorienté de plus en plus depuis février, malgré quelques exceptions, choisissant avant tout des candidats connus, éprouvés, aux noms célèbres. Dans les assemblées populaires, tumultueuses, composées d'éléments distincts où les curieux sont en si grande part et dont la majorité se forme, en général, d'enthousiastes irréfléchis, attirés par l'atmosphère politique, Castille a remarqué que la foule de son temps allait, d'instinct, au groupe placé en face du bureau, au centre, composé d'ouvriers sérieux qui, par leur attitude d'hommes qui savent ce qu'ils veulent, donnaient l'impulsion. Dans ces individualités renseignées, généralement affiliés aux diverses fractions socialistes et aux sociétés secrètes, les candidats au suffrage universel et les chefs des comités directeurs sont à peu près sûrs de trouver un appui et du dévouement. L'intangibilité républicaine dirigée par le comité avait aussi visé Girardin, champion du suffrage universel dans toutes ses conséquences, qui se portait candidat à Paris, faute qui semble avoir été reconnue dans la suite où de nouvelles avances furent tentées près du journaliste. Cette fois, en effet, le parti socialiste l'avait fait comparaître devant lui à sa barre, de la plus singulière façon, avec cette solennité théâtralement hostile, profondément exagérée, qui semble, en France, l'apanage éternel de certains groupes d'extrême-gauche. La scène se passa dans une rue déserte, au fond d'un hôtel inhabité, à deux heures du matin. C'était à la fin d'une réunion commencée la veille. La salle s'allongeait en longue galerie mal éclairée. Les délégués, au nombre d'environ deux cents, étaient assis sur des banquettes et, dans toute la longueur, au milieu, un passage étroit avait été ménagé pour conduire de la porte à la tribune où se tenait le bureau. Le journaliste, après avoir attendu fort longtemps, fut introduit. L'assistance demeura immobile, solennelle, figée ; pas une tête ne bougea ; à peine un regard furtif se glissa-t-il de son côté[154]. A la tribune, il tourna vers les visages sévères et tirés qui lui faisaient face son masque pâle, doué de peu d'expression en apparence, immobile, lui aussi, impassible, effacé, pâle et las, comme en cendres sous la mèche frontale, armé de tant de sérénité rigide cependant que l'audace et l'ambition les plus dures y transparaissaient malgré tout. Mais aucun observateur, quelque peu affiné par la vie, ne se dissimulait dans l'assistance. Où qu'il regardât, Emile de Girardin s'arrêtait sur des regards malveillants[155]. Faites votre profession de foi, citoyen ! cria une voix sèche, coupante, sans timbre. Le temps n'y prêtait guère, et il fallait s'exécuter. Girardin s'expliqua brièvement et offrit de répondre aux interpellations qui lui seraient adressées. C'était entendu d'avance ; mais le conclave, afin, sans doute, de mieux perdre le candidat qu'il récusait, avait imaginé une combinaison qui empêchait le journaliste de connaître son contradicteur ; il devait tenir tête à tous et n'avait devant lui qu'une masse anonyme ; il voulait saisir, convaincre, combattre, et il ne savait contre lequel des deux cents idéalistes abstraits réunis là portait sa parole. Le président lui faisait passer, en effet, les questions sur de petits morceaux de papier sans dire d'où ils venaient. Aucun signe d'approbation ou de colère, rien ne répondait à ses arguments ; lui seul animait le silence morne, plombé, hostile. Les questions se succédaient les unes aux autres, et de la même façon : questions de principe, questions de finance, questions de politique étrangère, république, etc. ; quant aux questions personnelles, on n'en souffla pas un mot... Girardin attendait. A chaque morceau de papier, il espérait trouver le messie, le sauveur ; il aurait pu attendre le retour d'une saison. Alors, sentant la profondeur de cette admirable tactique, il désespéra de vaincre en fouillant des yeux l'assemblée, il demanda, il implora, sans pouvoir l'obtenir, ce combat singulier dont il savait bien devoir tirer avantage. On fit silence, toujours. La voix brisée de rage ou de fatigue, il parla quelques instants sur ce qu'on ne lui demandait pas, sur des attaques fictives. Ce système, au lieu de le sauver, retomba comme le rocher de Sisyphe. Les feuillets continuèrent ; enfin, il se retira, ayant parlé en ministre et en homme d'affaires à des gens de sentiment[156]. Le comité démocratique socialiste de Paris, qui s'organisa pour l'élection de l'Assemblée législative, comprit deux cent trente enfants perdus de la démocratie, parmi lesquels l'élément ouvrier fut largement représenté. Mallarmet, Guérard et quelques autres étaient des artisans d'un mérite réel. Le vieux parti républicain y figurait par Paya, Chipron, à la tête pâle et ascétique, Napoléon Lebon, Berryer-Fontaine, Baudin, qui devait mourir au coup d'État. Toussenel, l'ami des bêtes et l'ennemi des juifs, David d'Angers et d'Alton-Shée, étaient célèbres. Il faudrait citer aussi Pilhes, Thoré, rédacteur de la Vraie République ; Delescluze, rédacteur de la Révolution démocratique et sociale ; Considérant et bien d'autres. Quand le comité s'était réuni, le 22 avril, à la salle des concerts, 28, rue Lamartine, afin d'arrêter la liste définitive de ses candidats, on avait mis en avant et inscrit le nom de Proudhon, mais celui-ci avait aussitôt refusé[157]. Dans une autre séance, un débat s'engagea sur la question de savoir s'il fallait déférer à la réponse de Proudhon. D'Alton-Shée voyait de graves inconvénients à ce qu'on effaçât, ne fut-ce qu'un seul nom, à la liste arrêtée ; il craignait que des discussions interminables ne fussent reprises et que le résultat ne fût qu'une confusion complète. Proudhon avait proposé de nommer Guinard à sa place, mais cette proposition avait paru inadmissible, car la majorité se montrait inexorable pour tous ceux qui, de près ou de loin, avaient pris part à la répression de juin ; certains voulaient même mettre Proudhon en jugement[158]. A la fin, il céda ; Guinard fut, cependant, maintenu. Il y avait de nouveaux venus, dont le peuple s'était épris, des gens de main comme Dufélix, Cournet, Philippe, forgeron du faubourg Saint-Antoine, des exaltés comme l'abbé de Montlouis, grand curé maigre à figure de brigand calabrais, un ancien élève de l'école polytechnique connu par un duel trop heureux, Servient. Une harmonie toute psychologique régnait d'ailleurs dans cette assemblée disparate. Le comité démocratique socialiste représentait à son début le radicalisme le plus pur. Les amis de la constitution, les représentants du peuple, les journalistes, quoiqu'il y en eût dans le comité, y étaient l'objet d'une sorte de dédain. Tout y était porté à l'excessif. Le délégué homme du monde avait soin de cacher son linge pour assister aux séances. L'ouvrier, qui sait si bien à Paris prendre, les jours de repos, le costume et les façons de la classe moyenne, affectait de n'entrer au comité que vêtu de la façon la plus orde[159]. Est-ce aussi dans un but d'ostentation prolétarienne, ou,
plus normalement, par économie, que le lieu de réunion était tout à fait
médiocre, un des bouges les plus infâmes qu'il soit
possible d'imaginer et tel que Paris n'en recélera bientôt plus[160]. Et le narrateur
a cette réflexion : Chose étrange de la part d'un
corps politique aussi mal vu de la police, la salle des séances était située
au fond d'une impasse[161]. Il la décrit
ainsi : Dans un quartier voisin de la cour des
Miracles, entre la rue Bourbon-Villeneuve et la rue du Caire, il existe un
écheveau de petites rues noires et mal famées, peu connues des Parisiens. Le
passage du Caire se divise en deux branches : l'une aboutit à la rue
Saint-Denis, l'autre, beaucoup plus courte, plonge dans le centre du triangle
de ruelles dont nous parlions plus haut. Ce sont les rues Sainte-Foi,
Philippe-Aubert, Saint-Spire et des Filles-Dieu. Au milieu de la rue
Saint-Spire bâille une impasse étroite, profonde, immonde. Presque au fond de
cet antre menaçant, à l'une des dernières maisons à gauche, pendait un
écriteau rougeâtre à demi effacé par les intempéries et sur lequel on lisait
ces mots : A la Grosse Tête. Cette enseigne désignait une salle sombre
et délabrée où l'on arrivait par un de ces escaliers déshonnêtes tels qu'on
en rencontre dans les distiques orduriers du poète Régnier. Dans cette salle
funeste, dénuée d'air, à peine ajourée de deux étroites fenêtres, meublée de
bancs de bois et d'une estrade destinée à un orchestre, la basse prostitution
réfugiée en ces ruelles, comme lapins en clapiers, venait s'ébaudir et danser
une fois par semaine. Les filles publiques qui piétinaient, silencieuses,
dans la boue, à la lueur des réverbères, ont, bien des fois, avec une
surprise craintive, vu sortir de leurs conciliabules attardés ces groupes de
patriotes, et demandé quels étaient ces hommes qui traversaient de tels
quartiers sans pensée de débauche. C'est là, au milieu des ardeurs de la
canicule, sous l'influence des passions les plus irritantes et des influences
épidémiques, que se réunissaient les délégués du peuple de Paris[162]. Lorsque le
comité, après divers travaux préparatoires, se forma en conclave,
afin de choisir ses candidats, on adopta pour cette séance, qui dura
trente-six heures, un autre lieu de réunion, la salle de concert de la rue
Coquenard. Les murs résonnaient comme un tambour et les orateurs, élevant
instinctivement la voix afin de dominer la sonorité des murailles, ne
parvenaient qu'à augmenter les vibrations[163]. Tout se mêla,
d'ailleurs, dans cette réunion, les passions politiques, les passions
personnelles, sourdement dissimulées, la méfiance, l'envie et les sentiments
démagogiques les plus mauvais. Toutefois le Constitutionnel et la Patrie,
incapables de comprendre, et ne le voulant pas, l'effort désintéressé qui
persistait chez la plupart, la grandeur de la lutte entreprise par cette
poignée d'hommes contre la réaction générale, donnèrent des comptes rendus
trop visiblement arrangés de manière à obtenir du ridicule pour qu'ils
fussent venus d'une observation absolument exacte[164] ; mais ils
laissaient voir une partie de la vérité, les discussions, le côté
maladroitement dogmatique déjà signalé, enfin cette inexpérience des partis
de gauche en face de certaines lois de la vie et de certaines erreurs
sociales qui, pour être honorable au point de vue idéal, n'en reste pas moins
pernicieuse, dès qu'il est nécessaire d'agir. Le plus cruel, dans ces
publications de quotidiens, venait de ce que les séances étaient secrètes ;
la rue de Jérusalem avait donc fourni des collaborateurs aux journaux peu
scrupuleux ; la qualité de leur plume donnait la mesure de ce qu'il fallait
croire, et aurait adouci, pour quelques-uns, le côté irritant des
divulgations, mais le comité, très ardent, s'exaspérait d'avoir des traîtres
et de les ignorer. La réaction, harcelant ainsi ce qui subsistait de la révolution
de la manière la plus perfide, la plus blessante, semblait un peu, comme en
juin, quoique autrement, vouloir décider un nouveau conflit. Bien des menées
réapparaissaient ici, dont les circulaires de Léon Faucher, les bruits
répandus dans la capitale, subrepticement, et ce fait même que le comité
démocratique socialiste devint en peu de temps la terreur de tout Paris. Il
était bien difficile que, les circonstances aidant, le projet d'en finir
d'une façon ou d'une autre avec les ennemis de la République ne se fît pas
jour ; il ne restait plus que la perspective d'un coup de main afin de
reprendre la révolution et la replacer sur la voie des réformes chaque jour
plus évidemment nécessaires pour le salut de la république. Les Débats
du 30 mai allaient dire : La république sociale est
contraire à la constitution, incompatible avec elle. L'équivoque était
impossible. Il fallait recommencer février ou disparaître, ou attendre, en
préparant une vraie revanche ; mais il se faisait tard. Puisque l'heure était
venue de céder la place, il valait mieux le faire en combattant. Le comité, émanant directement du peuple de Paris, rayonnant sur
chaque rue, sur chaque maison, pour ainsi dire[165], sentait sa
force, et, n'ignorant pas le secret mépris du peuple pour le Parlement, se
tenait prêt avec une sorte d'orgueil. Il avait stigmatisé le mauvais vouloir
de la Chambre. Il savait, mieux que personne, faiblesse, le manque de foi,
les vices, publics ou privés, des montagnards. Il connaissait, par son
contact continuel avec le peuple, l'impopularité des Amis de la
constitution, et, tout en profitant du zèle tardif, d'ailleurs sans
abandon réel, de ceux-ci, il ne croyait plus à la garde nationale, à laquelle
le peuple, pas plus que lui, n'avait pardonné Juin. De ces sentiments divers,
de cette connaissance du peuple vint même justement chez quelques-uns l'idée
de constituer une commune de Paris, formée des principaux délégués de chaque
arrondissement et munie de toutes les prérogatives d'un gouvernement
révolutionnaire. On revenait ainsi, sans s'en douter, sans y prendre garde,
aux conceptions précédentes de 1848, à cette imitation du passé qui avait
déjà entravé, parce que trop voulue, parce que insuffisamment adaptée aux
circonstances, tant d'efforts, tant de promesses. Il
y avait les clubs, une Montagne, il fallait une commune. En 1793, on n'avait
imité, au moins, que les Romains, ce qui, en raison de l'éloignement, était
presque une nouveauté[166]. Le comité
n'avait qu'à se conserver pour mener à la dictature l'élite de ses membres,
mais quand l'idée de cette commune parisienne se fut logée dans les cerveaux
d'une partie du comité, la thèse de l'insurrection nécessaire, déjà si
répandue, fit des progrès rapides ; elle devint un besoin. La ruse et la
réserve demandaient trop de science ; on n'en fut pas capable. L'affaire du 13 juin eut des racines dans le sein du
comité démocratique socialiste deux mois avant qu'elle n'éclatât. Il n'y
avait pas de délibérations où cette pensée d'un combat ne se trahît. Les
idées d'insurrection gagnèrent bientôt comme une tache d'huile les divers
corps da démocratie[167]. Les mécontents
la secondaient. Marrast et ses amis, tournés au vinaigre, ne voyaient pas la
révolte d'un mauvais œil. Les représentants de la Montagne, qui ne
partageaient pas tant de fièvre belliqueuse, étaient débordés ; et si, en
tant que parlementaires mieux placés pour se rendre compte de l'inutilité de
certains efforts[168], ils avaient
suivi avec inquiétude l'effervescence grandissante de leurs électeurs les
plus influents, peu à peu, devant l'obstination redoutable de la droite, ils
avaient modifié leur façon de voir ; ils cédaient ensuite, contraints, a pression
qui les entourait de toutes parts. La Montagne devait marcher, coûte que
coûte, à la tête du mouvement, et son chef surtout, que tout le monde se
désignait, Ledru-Rollin, hésitait, résistait, comme ses lieutenants, mais
tout le poussait, lui aussi : les affaires romaines qui révoltaient ses
sentiments d'indiscutable loyauté, sa complexion sanguine, son imagination,
si facilement enthousiaste, jusqu'à la faiblesse, et qui aidait d'autre part
à dominer les circonstances. Beaucoup de ceux qui le trouvaient utile se
réservaient de le dépasser par la suite, prêts à lui faire jouer le rôle
d'Odilon Barrot une fois la révolution faite. Il apparaissait, et avec
raison, faute de mieux, Girardin étant écarté, l'unique espoir, la seule
chance de salut de la classe moyenne, ce que
celle-ci sembla, du reste, comprendre par la suite, à mesure qu'on se
rapprochait de 1852[169]. Girardin se
fût montré autrement circonspect, et d'un caractère bien plus redoutable. L'ouverture du scrutin pour l'ouverture de l'Assemblée législative rendit les réunions électorales sans objet. Le comité se transforma donc de réunion délibérante en comité d'action. Il réduisit le nombre de ses membres et le chiffre de vingt-cinq fut adopté. Depuis que l'éventualité d'une insurrection commençait de se faire jour si progressivement et que l'idée d'une commune s'y juxtaposait, deux autres délégués, inquiets des suites, prévoyant que le moment d'agir n'était pas encore venu et que la démocratie allait perdre les fruits de son dernier effort, par une manifestation prématurée, essayaient de combattre là nouvelle tendance. Ils expliquaient le danger à la tribune, cherchaient à démasquer leurs adversaires et se flattaient d'avoir le dernier mot : ils restèrent cependant la minorité et ils finirent par être écartés à la suite d'une véritable campagne. Le groupe secrètement affilié demeura le maître. Les vingt-cinq, résultat, au second degré, du vote de cent mille hommes, et qui avaient une si sérieuse puissance, s'épurèrent en un troisième groupe de huit ; ces huit, si importants, comprenaient d'ailleurs un traître. — Il faut citer parmi les acteurs les plus isolés, Jean Macé, le futur fondateur de la Ligue de l'enseignement, qui avait établi un bureau de propagande afin d'éclairer un peu l'entendement du soldat et du paysan. Son action désintéressée était opiniâtre. Les montagnards qui se réunissaient rue du Hasard avaient comme secrétaire un nommé Martin Lauterie. Plus tard, l'accusation fera ressortir l'obligation imposée à tous les membres de la réunion de voter, dans les questions de principe, d'une manière conforme au programme montagnard, et de ne pas donner à la cause son concours seulement moral et financier, mais d'y faire, si besoin était, le sacrifice de leur sang[170] ; et résumant une des conclusions de son enquête, elle dira : Les premières séances de l'Assemblée avaient dessiné la situation ; les principes d'ordre et de modération y furent défendus par une incontestable et ferme majorité. Le parti démagogique, quel que fût son but, quels que fussent ses moyens d'action, dès longtemps préparés, avait ajourné l'attaque tant qu'il avait cru pouvoir fonder quelques espérances sur les résultats des élections. Une fois la conviction acquise de son impuissance constitutionnelle, il reprit l'attitude révolutionnaire et chercha résolument l'occasion d'agir 4. Le secret du complot de juin est là tout entier... Nous avons fait justice de ce mot de complot. Les journaux — et nous n'avons pas la place ici de citer les circulaires ou les affiches — appuyaient l'effort actif des militants. C'étaient la Vraie République, de Thoré ; le Peuple, de Darimon et Langlois ; la Réforme, de Ribeyroles ; la Démocratie pacifique de Considérant et de Cantagrel ; la Tribune des peuples, la République, le Travail affranchi, de Toussenel. On se réunissait aussi, assez fréquemment, dans les bureaux du Peuple ou de la République, surtout dans ceux de la Démocratie pacifique. La Vraie République du 15 mai disait : Le droit est acquis, le fait seul est à conquérir. Nous avons, comme disent nos amis du faubourg, gagné la première manche en février, perdu la seconde en juin ; enlevons la belle au printemps de mai. Le Peuple du 19 s'écriait : Qu'on y réfléchisse ; il y a un terme à tout, même à la patience. Le socialisme tient maintenant dans les plis de son drapeau la paix ou la guerre ; veut-on la guerre ? Et le lendemain : Que les quatre cent cinquante blancs qui vont entrer à l'Assemblée législative se le tiennent pour dit : ce ne sera pas la majorité parlementaire qui gouvernera, ce sera la minorité, seule représentation possible de la majorité républicaine et socialiste. Le 9 juin, quand on annonça la lutte au club de la salle Roisin, 169, faubourg Saint-Antoine, ce fut en ces termes[171] : Il y aura une lutte ; elle sera terrible : si nous succombons, beaucoup des nôtres disparaîtront ; mais si, comme je l'espère, nous sommes vainqueurs, nous conserverons ce que nous avons conquis. La trahison est consommée, on est allé assassiner la République romaine. Nous avons le droit de dire à un fonctionnaire de la République qu'il a trahi la République, et Bonaparte est fonctionnaire... Louis XVI a conspiré et peu de temps s'écoula entre le retour de Varennes et l'expiation ! Le 11, le journal de Thoré sonnait le tocsin : La Patrie est en danger ! Plus de dissentiment, union parfaite entre tous pour vaincre les factieux qui ont attenté à la République. Demain sans doute la Montagne viendra à la tribune proclamer la déchéance. Il y a crime de haute trahison, la déchéance est de plein droit. S'y opposer serait déchirer la constitution, violer la République, et abdiquer par là même le titre de représentant du peuple. Le nombre n'est rien sans la justice. La veille du 10 août, 406 voix contre 224 amnistiaient de nouveau le pouvoir exécutif. En février, quelques députés seulement eurent pour eux le droit, la nation, la victoire. Avec la Montagne sera la loi, l'Assemblée, la nation... L'accord des journaux affiliés était entier, le 11 juin, ils publiaient une pièce émanée du comité démocratique socialiste, signée de la commission des vingt-cinq qui, rappelant l'article 5 de la constitution, déclarait celle-ci violée et terminait en reproduisant l'article 2 du programme électoral du 13 mai : Si la constitution est violée, les représentants du peuple doivent donner au peuple l'exemple de la résistance. La Montagne paraissait désireuse de répondre à la sommation des vingt-cinq, en donnant au peuple l'assurance qu'elle ferait tout son devoir ; elle lui proposait néanmoins le conseil de rester calme. Il peut compter, disait-elle, que la Montagne se montrera digne de la confiance dont il l'honore. Enfin l'association des Amis de la Constitution, ennemie mortelle, en 1848, de la Montagne et du socialisme, protestait solennellement devant Dieu et devant les hommes contre la violation de la constitution et du droit international, après accusation portée contre le gouvernement d'avoir souillé le drapeau en le déployant pour une cause inique, sacrifié indignement nos généreux soldats, dont l'héroïsme peut être si nécessaire au salut de notre propre nationalité, et fait couler des flots de sang français et de sang italien aux applaudissements et au profit de la Sainte-Alliance. Elle rappelait aussi la constitution violée à l'article 110, à savoir que le dépôt de la constitution et les droits qu'elle consacre sont confiés à la garde et au patriotisme de tous les Français. Trois cents gardes nationaux envoyaient de leur côté une lettre au colonel de la 5e légion, l'invitant à engager ses collègues à protester par une manifestation contre la violation des articles 5 et 84 de la constitution. Ils espèrent, disaient-ils, qu'une manifestation de la garde nationale de Paris, cédant au vœu et au sentiment populaires, aurait pour effet de faire cesser cette guerre impie où s'entr'égorgent des frères que la République française devait réunir sous le même drapeau pour la défense de la démocratie européenne. Bien que nous n'ayons indiqué que le principal de ce qui est connu à la date où nous écrivons, on voit ici ce qui animait et qui avait préparé la journée révolutionnaire attendue qui fut celle du 13 juin. La démocratie était réellement groupée, encore que chacune de ses factions fît ses réserves et espérât utiliser le succès surtout à son profit. Ceux du parti républicain qui se tenaient encore à l'écart n'attendaient qu'une victoire pour se décider et connaître de quel ordre serait son résultat. Le lendemain du 9, après la conférence de la salle Roisin, la même velléité de combat se faisait jour boulevard Monceaux, à un banquet socialiste de six cents couverts. Le 10 également, la société des Droits de l'homme qui, après les journées de juin 1848, avait déclaré se réserver l'avenir, s'était mise en permanence, et cinq de ses membres avaient noué des relations avec la Montagne. La Démocratie pacifique, par son secrétaire de rédaction, Brunier[172], envoyait une convocation aux directeurs des journaux démocratiques, même au Siècle, au Crédit et à la Presse, pour le 11 juin, onze heures du matin. La réunion eut lieu vers onze heures et demie[173]. Quelques membres de la commission des vingt-cinq y assistaient, qui n'y avaient cependant pas été convoqués[174], dont Servient, Chipron, Tessier, Dumothay et Morel, cordonnier ; on y remarquait Duras, Cantagrel, Vautier, Bareste, Chotard, Toussenel. Considérant présida d'abord, puis Girardin 4. La discussion porta sur le parti que devaient prendre les représentants et la presse dans les circonstances actuelles, particulièrement au cas où la majorité rejetterait la proposition de mise en accusation[175]. La majorité réclamait une manifestation populaire. Girardin, toujours pratique, prévit la pauvreté du résultat : Vous aboutirez au ridicule, dit-il. Le procédé n'avait déjà que trop prouvé son insuccès. Girardin détailla ensuite le danger d'une insurrection. Selon lui, le prolétariat, dans son ensemble, n'était pas disposé au combat et il y avait faute à étendre au peuple l'agitation spontanée de la Montagne, de la presse, de la garde nationale et des Amis de la constitution. Un auditoire renseigné eut vite saisi même que des éléments aussi rudimentaires et disparates ne lui inspiraient qu'une médiocre confiance et du dédain ; quelques-uns n'étaient autre chose que les ennemis de la veille, aigris par la perte du pouvoir. Soutenu même, paraît-il[176], par Considérant, il aurait insisté pour que la Montagne, constituée en insurrection ne sortît pas du palais de l'Assemblée afin de s'y déclarer pouvoir unique et souverain[177]. Il combattait le projet de mise en accusation des ministres comme un moyen usé et puéril, manquant à la fois d'à-propos et d'efficacité ; selon lui, l'opposition devait, par l'organe de ses chefs, monter à la tribune et faire les déclarations suivantes : Attendu que la majorité s'est mise hors la constitution et a conséquemment cessé d'être la représentation constitutionnelle de la volonté nationale, l'opposition, voulant donner un grand exemple de la résistance légale, se déclare en permanence. Et il justifiait la proposition en ces termes : Il est impossible qu'une pareille déclaration ne mette pas la majorité dans la nécessité de se soumettre ou de créer un conflit. Le conflit entraînerait des conséquences trop graves pour que le président ne fasse pas tous ses efforts afin de l'enrayer à son début et ne s'interpose pas entre les deux fractions de l'Assemblée. La conciliation ne pouvant s'opérer que par un changement de politique de la part du gouvernement, la minorité obtiendrait ainsi, sans quitter les bancs où elle siège, ce qu'une manifestation ne lui donnerait certainement pas, c'est-à-dire le retrait des troupes et le respect de la constitution. Le peuple, ajouta-t-il, a donné sa démission de l'insurrection. Il est affaissé en ce moment sous le choléra qui le décime, il est certain qu'il ne répondrait pas à l'appel qui lui serait fait et qu'un recours aux armes retentirait dans le vide[178]. Une éloquence aussi froide, raisonnée, fondée sur des considérations exactes, loin de porter, en dépit de quelques adhésions, exaspéra des gens qui voulaient agir, quelle que fût l'action, la préférant imprécise, folle même, que retardée ; l'action leur était une délivrance ; las de discipline, las d'attente, pénétrés du sentiment de leur droit à un point si naïf qu'ils le faisaient passer avant toute prudence, avant toute politique, avant, peut-être, le devoir, ils avaient la volonté indéfinissable de servir un devoir supérieur, conçu d'une façon presque mystique. Aussi des propositions radicales succédèrent-elles à la discussion. Elles réclamaient la déchéance du pouvoir exécutif et de la majorité de la Législative ; elles voulaient que la minorité parlementaire refoulée se mît en permanence sous la désignation de représentants constitutionnels. Cependant, si l'on en croit Darimon[179], il ne se produisit pas d'opinion dissidente ; tout le monde serait tombé d'accord, naturellement, pour reconnaître que la constitution était violée, mais que, pour résister à une violation flagrante, il fallait se renfermer dans les voies légales. Une seconde séance fut décidée pour le soir même, aux bureaux du Peuple, rue du Coq-Héron. Elle était composée des mêmes éléments que le matin, grossie par des personnes étrangères à la presse démocratique[180]. Ledru-Rollin s'y trouvait et répudiait tout recours aux moyens révolutionnaires. Girardin renouvela ses explications ; mais l'attitude prise à l'Assemblée par la Montagne avait jeté le trouble, et les propositions de Girardin portèrent encore moins. Alors il déclara que la presse, dans les circonstances graves où l'on se trouvait, n'avait pas d'initiative à prendre et que son rôle devait se borner à critiquer ce qu'elle jugeait blâmable autant qu'à approuver ce qu'elle jugeait utile[181]. — Considérant avait apporté un programme qui résumait les vœux acquis aux représentants de la Montagne réunis dans le 14e bureau, mais rien ne fut encore arrêté[182]. La Montagne déclara seulement à une sous-commission des Droits de l'homme qu'elle épuiserait les moyens légaux avant d'en venir aux armes. Quelques assistants proposèrent aussi de se rendre, 6, rue du Hasard, dans le local de la Montagne, afin de conférer avec les représentants sur la conduite à suivre[183]. Ledru-Rollin apparaît donc, ici encore, dépassé. L'idée de la manifestation avait précédé son discours. Et, tandis qu'il parlait dans cette chambre parlementaire, si souvent visée depuis 1848, battue par la vague populaire, les regards se tournaient encore du même côté, comme si les protestations suprêmes et le signal du combat devaient venir du bloc dur, agréable au surplus, de cette fausse citadelle athénienne au fronton triangulaire, comme s'il devait sortir tout à coup de derrière ses colonnes, le long de ses marches, vers ces grilles cuirassées, à cette heure, de sergents de ville et de soldats, baïonnettes au canon, — de même qu'en avril, mai et juin 1848. Ledru-Rollin avait d'ailleurs abordé la tribune avec le sentiment d'une grande responsabilité, tout à la vision de l'armée révolutionnaire impatientée qui grondait derrière lui. De fait, pour qui était renseigné, il se démasquait de suite quand à une heure et quart, à l'ouverture de la séance, il avait dénoncé l'inutilité des interpellations. Girardin avait déconseillé d'aller rue du Hasard, sûr de rencontrer là beaucoup de théoriciens sans connaissances exactes, et trop renseignés, d'autre part, sur ses antécédents politiques pour lui pardonner ceux-ci ; seul de son avis, il s'était retiré, suivi de quelques collègues mécontents[184]. Quarante environ persistèrent, mais les montagnards n'en admirent que dix, à titre de délégués, choisis parmi les rédacteurs en chefs et les membres de la commission des vingt-cinq. Le conciliabule se termina vers minuit et les délégués se rendirent à l'imprimerie du Peuple. Les résultats furent publiés le lendemain par les journaux socialistes. Ils contenaient trois proclamations. La première venait de
la Montagne qui, redoutant d'être débordée et ne se rendant pas compte
qu'elle était, en réalité, trop faible pour opposer aucune digue efficace,
avait voulu prendre la tête du mouvement. Elle déclarait au peuple, à la
garde nationale, et à l'armée qu'elle venait de déposer un acte d'accusation
contre le pouvoir exécutif. Nous, membres de la
presse républicaine, disait-elle, en outre,
nous, membres du comité démocratique socialiste, nous disons au peuple de se
tenir prêt à faire son devoir. La Montagne fera le sien jusqu'au bout. Nous
avons sa parole... Tous les républicains se
lèveront comme un seul homme. — La proclamation des écoles engageait
la jeunesse à marcher au premier signal des représentants. La lutte est aujourd'hui entre la République et ses
éternels ennemis. La minorité de l'Assemblée, la Montagne, soutient seule
l'inviolabilité de nos droits. Tous les citoyens qui ont le cœur et une
conscience républicaine doivent la soutenir dans l'accomplissement de son
devoir sacré. A vous, citoyens des écoles de Paris, qui avez pris
l'initiative de la protestation vengeresse de février, de vous réunir les
premiers autour du drapeau constitutionnel. — Le comité électoral
typographique, après avoir publié lui aussi l'article 5 de la constitution,
rappelait aux députés de la Seine leurs engagements envers leurs électeurs. Agissez... Le peuple a les yeux sur vous. C'était
une sorte de menace. En dépit du petit passage cité dans la proclamation de la
Montagne, le comité démocratique socialiste, qui avait tout animé, demeurait
un peu dans l'ombre. Son action ostensible se
fondait dans l'ensemble du mouvement. Il n'avait plus d'ailleurs qu'à
attendre l'événement et à en tirer parti selon les circonstances au milieu du
reflux des compétitions toujours actives à l'heure de la victoire. Les
feuilles démocratiques étaient en feu. Leurs articles éclataient comme des
bombes et pleuvaient sur la France entière[185]. La
Révolution démocratique et sociale, notamment, écrivait : Le sort en est jeté ! Paris tout entier répondra, comme en
février, au cri poussé par Ledru-Rollin au nom de la Montagne et de toute la
France. Les traîtres, qui forment la majorité de l'Assemblée, ont déchiré la
constitution en sanctionnant par un vote infâme la trahison de M. Bonaparte
et de ses ministres et, du même coup, ils ont déchiré le mandat que le peuple
avait eu la faiblesse de leur donner pour défendre la République et la
Constitution. Que la Montagne ne perde pas un instant ! Qu'elle prononce la
mise hors la loi de Bonaparte, de ses ministres, et des représentants félons
de la majorité royaliste ! C'est en ses mains que résident maintenant tous
les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Nous attendons avec confiance son
énergique initiative ; elle ne faiblira pas ; elle a mesuré le danger et le
devoir, et ce n'est pas le danger qui l'arrêtera quand le devoir l'appelle.
La garde nationale et l'armée entendront la voix de la Montagne, nous en
avons l'assurance, car elle parlera au nom de la patrie et de la
constitution. Elle a courageusement brûlé ses vaisseaux et jeté au loin le
fourreau ! Qu'elle marche dans sa généreuse audace ! Le peuple est avec elle,
car le peuple est toujours du côté du droit. Il faut que l'odieux guet-apens
de Rome soit payé par le châtiment des coupables ; il faut que la République
française se régénère par un sublime effort et qu'elle gagne à Paris la
dernière bataille de la liberté contre le despotisme... La justice de Dieu ne manquera pas au généreux peuple de
Paris, qui défend le droit et la liberté[186]. Le 12, l'Assemblée législative statuait sur l'urgence de la proposition de mise en accusation du président et de ses ministres et, bien que le résultat fût escompté d'avance, pour beaucoup, ce moment eut une certaine solennité, à cause des suites[187]. — Au groupe de la Montagne, qui tint séance dans le quatorzième bureau de la Chambre avant les débats parlementaires, on ne sut à quoi se résoudre ; la minorité seule se déclarait pour les mesures violentes ? Cette division fut sans doute une des raisons pour lesquelles la Montagne s'abstint de voter. Pyat, du moins, s'était écrié : Devant Dieu et devant les hommes, en présence des cadavres de nos soldats, je jure que la constitution, à mes yeux, a été violée. Je somme M. Thiers et les membres de la majorité les plus convaincus de venir à la tribune et de jurer le contraire. Quelques-uns l'avaient fait. Pyat alors avait dit : Entre votre serment et le mien, le pays jugera. Quant à moi, je suis décidé à soutenir ma conviction jusqu'à la mort. Pierre Leroux avait murmuré : Nous pouvons toujours en appeler au peuple sans armes. — Le caractère ambigu de la journée du 13 juin se trahissait dans cette double allusion à une révolte insurrectionnelle et à une manifestation pacifique. Cette ambiguïté devait persister jusqu'au dernier moment et entraîner la perte de la journée[188]. L'hésitation de la Montagne se montra encore dans ses derniers conciliabules. Les allées et venues furent continuelles. On prenait tour à tour la résolution de la lutte ou celle d'une agitation pacifique légale presque, comme en février 1848. Pendant toute la journée du 12, à la Démocratie pacifique et rue du Coq-Héron, quelques-uns des membres du comité de la presse s'étaient tenus en permanence ; d'autres avaient gagné la rue du Hasard. Félix Pyat, Considérant et Ledru-Rollin, étaient restés rue de Beaune[189] jusqu'à trois heures du matin, et ce furent eux qui rédigèrent les proclamations destinées à paraître le lendemain. Les délibérations ne se tinrent d'ailleurs pas en commun. Les représentants de la Montagne siégeaient dans un salon séparé, et de grandes précautions avaient été prises afin qu'aucun étranger ne pût être admis parmi eux. Ils semblaient s'être prémunis contre toute pression extérieure. Dans la grande salle de rédaction de la Démocratie pacifique s'étaient réunis les délégués des journaux et les membres des comités démocratiques socialistes des élections. Il s'y était glissé quelques jeunes gens appartenant au comité des écoles, des membres du comité typographique et plusieurs orateurs de clubs[190]. Cette réunion fut moins calme que celle de la veille. Le 11, Schmitz, capitaine de la 5e batterie d'artillerie,
avait loué, sous prétexte d'élection de garde nationale, le manège Pellier,
11, rue du Faubourg-Saint-Martin, et le soir du 12, il y réunit un assez
grand nombre de gardes nationaux afin de les préparer aux éventualités
imminentes. A dix heures, tandis qu'on annonçait les délégués de la Montagne,
le propriétaire, M. Pellier, inquiet, pria Schmitz de chercher un autre local
et, afin d'éviter toute objection, fit éteindre le gaz. L'assistance se
transporta 28 bis, rue Saint-Nicolas, chez le frère du colonel Schmitz, et y
attendit les ordres de la Montagne[191]. Elle se sépara
en se donnant rendez-vous pour le lendemain, à onze heures, au Château-d'Eau[192]. En dehors des
groupements directeurs, des patriotes, décidés à payer de leur personne,
s'agitaient aussi confusément. Le même caractère
énigmatique enveloppait toujours le mouvement. Rien de clair ne se dégageait
de cette situation tendue outre mesure. Les heures s'écoulaient ; cette pâle
nuit de juin allait s'argenter des premières lueurs de l'aube avant qu'on eût
rien précisé. Déjà, il avait été question de s'emparer, à une heure et demie
du matin, du Conservatoire des arts et métiers, ce qui eût devancé les
manœuvres de la police et de la force armée. Mais des ordres pacifiques
avaient prévenu ce coup de main. Pendant ces courtes heures d'obscurité, les
officiers de la garde nationale, qu'on savait dévoués à la démocratie
socialiste, reçurent de divers points des avis contradictoires. Il était
pourtant bien décidé, dans la pensée du chef de la Montagne, de n'opposer à
la résistance de la majorité qu'une manifestation pacifique. Mais des hommes
pressés de risquer une partie, quelle qu'elle fût, des ambitieux de bas étage
qui se partageaient déjà en imagination des ambassades et des portefeuilles,
propageaient des bruits contraires. Ils ne craignaient pas d'affirmer qu'ils
tenaient de M. Ledru-Rollin lui-même l'ordre de répandre l'appel aux armes.
Ils espéraient ainsi tromper quelques cerveaux brûlés, les lancer en avant et
entraîner un mouvement insurrectionnel. La société des Droits de l'homme
n'apprit la vérité que le 13, à six heures du matin. Elle résolut de ne point
se mêler à cette absurde manifestation, mais d'épier la colonne et
d'échelonner ses sectionnaires de façon à se conduire selon les circonstances
dans une journée qui promettait de si graves incidents[193]. Pourtant Ledru-Rollin,
malgré son désir de voir finir la journée sans effusion de sang, s'attendait
à l'action ; il la redoutait, il n'en voulait pas, tout en demeurant résolu à
subir sa nécessité. Il était d'autant plus prêt qu'il n'y avait plus de moyen,
maintenant, de réagir[194]. La dernière journée révolutionnaire avait une importance tellement évidente qu'elle décida la défaite républicaine. Elle consacrait la mort, presque totale, de cette révolution de 1848 que tant d'espoirs avaient fait croître, puis accueillie et que tant de chercheurs avaient annoncée[195] ; le 13 juin 1849, anniversaire de juin 1848, fermait toute issue à une nouvelle espérance. La réaction triomphait par la suppression de la question sociale et, dans l'ordre politique, par un retour offensif de l'idée monarchique. Si l'idée napoléonienne ne s'était pas trouvée là, puissamment assise par le vote populaire, afin d'empêcher l'épanouissement royaliste et de filtrer ses tendances, en ne conservant que le meilleur et le difficilement éliminable alors de celles-ci, comme en réalisant contre elles — et, néanmoins, à côté d'elles, — par un travail d'équilibre et de construction, tout ce qu'elles maintenaient encore de possible, étant donné le recul des classes bourgeoises dans la doctrine républicaine ; si les partis monarchistes, d'autre part, n'avaient pas été divisés, en dépit de leur union parlementaire et conservatrice, une sorte de monarchie moitié orléaniste, moitié restauration, aurait eu les plus grandes chances d'aboutir. La présence de Louis-Napoléon l'empêcha. Si l'entente entre les deux ailes s'était constituée, malgré tout, ni l'une ni l'autre n'admettant de capituler, une république ultra-conservatrice, beaucoup plus réactionnaire que celle de Thiers se fût, sans doute, tant bien que mal, insinuée. — Cette suite de suppositions nous permet — c'est son seul motif — de situer l'orientation politique française et, semble-t-il, d'en mieux saisir l'enseignement. |