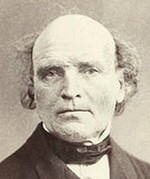LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
ET LE MINISTÈRE ODILON BARROT
III. — LES DÉBUTS DE L'AFFAIRE ROMAINE ET LA MORT DE LA CONSTITUANTE.
L'effort de la réaction. — Jeter l'une contre l'autre les deux républiques équivaut à détruire l'avenir européen ouvert par la révolution de Février. — Ce qui domine la politique de M. de Falloux. — L'exploitation catholique de 1848 grâce à l'action catholique entreprise sous le règne de Louis-Philippe. — Impossibilité de marcher contre le clergé. — La question politique et la question religieuse mélangées. — Les sentiments personnels du prince et sa situation. — Impossibilité d'agir autrement que dans le sens de la majorité. — Caractère politique de Louis Bonaparte. — Gioberti. — Tommaseo. — Hésitation de Louis Bonaparte en face de l'Italie. — Novare. — Thiers et le prince-président. — Thiers et M. de Hübner. — M. de Falloux et le prince-président. — Subterfuges dangereusement optimistes de la pensée napoléonienne. — Le prince suit la ligue politique qui mènera la France à Sedan. — Les critiques de Mickiewicz. — La Chambre et la question romaine. — L'opposition de Ledru-Rollin. — Thiers et la question italienne. — Ledru-Rollin et Cavaignac. — L'ordre du jour de l'Assemblée. — Le pape. — MM. de Rayneval et d'Harcourt. — M. de Forbin-Janson. — Le conseil de cabinet du 16 avril et la séance de la Chambre. — La Commission. — Jules Favre. — La restauration du pape. — Clairvoyance de Ledru-Rollin. — Réponses d'Odilon Barrot. — Lamoricière. — Schœlcher. — Protestations du colonel Frapoli. — Les instructions de Drouyn de Lhuys afin de décider Pie IX à des mesures libérales. — Intransigeance pontificale. — Allocution du 20 avril. — Le général Oudinot, ami personnel de Falloux. — Les catholiques français font passer l'intérêt catholique avant l'intérêt national. — Les instructions remises à Oudinot. — Le texte de Drouyn de Lhuys non délibéré au Conseil. — Méfiance et démarche de Barrot. — M. Manucci, le commandant Espivent et la lettre d'Oudinot. — Le commandant Espivent à Gaëte et les paroles de Pie IX. — Protestations de l'Assemblée romaine. — Mazzini, ce qu'il voulut par la résistance. — Le triumvirat. — Forbin-Janson, le colonel Leblanc et les triumvirs. — Oudinot et les deux délégués du Parlement romain. — Négociations nouvelles par le capitaine Fabar. — La résistance décidée. — D'Harcourt et Rayneval, leur rôle. — Oudinot marche sur Rome. — Défaite et triomphe des intérêts catholiques. — Déception à Paris. — La fête de la République. — Falloux et le prince-président au conseil des ministres. — Excellent réquisitoire de Jules Favre au Parlement. — Le 7 mai. — Embarras des ministres. Ferdinand de Lesseps. — Lesseps et Drouyn de Lhuys. — Visite à l'Elysée. — Paroles de Barrot au plénipotentiaire. — Entrevue avec Louis-Napoléon. — L'Assemblée. — Marrast, Forey et Changarnier. La situation de plus en plus embarrassante de Barrot. — Nouvelles attaques de Ledru-Rollin. — Le clergé romain. — Le parti modéré à Rome. — Oudinot et Mazzini. — L'arrivée nocturne de Lesseps. — Oudinot et Lesseps. — Lesseps à Rome. — Difficultés innombrables de sa mission. — Lesseps et Mazzini. — Mazzini explique la République romaine. — Forbin-Janson envoyé à Paris ; perfidie d'Oudinot. — La conférence de Gaëte. — L'échec de Rayneval. — Menaces de Drouyn de Lhuys et ses réticences. — La fin de la Constituante favorise la tactique des cléricaux. — Aspect des partis en face des élections prochaines. — Jugement de Marx sur la République de 1849. — 1848, résultat des fautes de l'opposition sous Louis-Philippe. — Louis-Napoléon résulte du fait prouvé qu'aucune classe n'est prête à trancher la situation politique. — Réflexions générales. — Le programme de la presse démocratique. — Démission de Léon Faucher. — Les élections et le ministère. — Fin de la Constituante. — Après la défaite républicaine, la défaite socialiste. — Résultats significatifs des élections. — Situation de la Montagne. — Craintes de la bourgeoisie. — L'affaire hongroise et les considérants qu'elle permet. — Malaise de la politique suivie à Rome. — Désarroi général. — L'affaire Changarnier. — Ledru-Rollin définit le rôle de Barrot. — Les partis les uns contre les autres. — L'œuvre de la Constituante résumée par Marrast. — Position exceptionnelle de Louis Bonaparte. — Appel de Mickiewicz. — L'équivoque napoléonienne. — Louis-Napoléon ment à son destin et perd sa signification. — La tactique de la droite en face du suffrage universel. — L'autorité. — Tournées du prince-président. — Mort de Mme Gordon.Nous avons noté précédemment[1] la constitution légale de la République romaine par une assemblée régulière, à la suite de l'abaissement du pouvoir temporel de la papauté ; nous avons reconnu l'avènement logique de ces faits, dont tout devait prouver, de plus, la nécessité, ce qui les avait soutenus, ce qui leur valait une consécration légitime, la somme d'avenir que représentaient les deux républiques ainsi constituées au milieu de la réaction européenne unanime qui avait suivi février. L'effort de cette réaction, et surtout de la réaction cléricale[2], tendit à les précipiter l'une contre l'autre[3], à l'aide d'un malentendu progressivement accentué, lourd de conséquences funestes pour la France comme pour l'avenir européen. La diplomatie de Cavaignac, acceptée, encouragée même, par le gouvernement provisoire, amorcée déjà par Lamartine, avait mené la République, dès le début, sur ce terrain[4], et Louis-Napoléon s'y trouvait engagé. Comment empêcher les gouvernements d'hériter les uns des autres[5] ? Une époque nouvelle, ou qui semble telle, n'est souvent ainsi que l'expression des besoins, enfin admis, de l'époque directement précédente. Deux pays, surtout, dépendaient du Saint-Siège, la France et l'Autriche. On sait le titre de la première, si glorieux, ne manquait-on pas de dire, et qui avait eu longtemps son importance, de fille aînée de l'Église. L'opinion était courante alors, indiscutable, que la France possédait à Rome le point d'appui le plus utile et que, de ce fait, le pouvoir temporel s'imposait ; le pouvoir spirituel, sans celui-ci, n'aurait pu s'exercer avec indépendance ; on ajoutait que le pouvoir temporel ne constituait pas seulement une garantie pour l'Eglise, mais encore pour les États. La majorité française voulait le retour de la papauté dans la Ville Éternelle, et Louis Bonaparte, tout récent, dépendait trop de cette majorité, pour aller contre elle, prisonnier qu'il était d'un ministère hostile à sa personne autant qu'à ses idées. L'Autriche ne dissimulait pas, ouvertement décidée à ramener le Saint-Père en même temps qu'à détruire, de la façon la plus brutale, la République mazzinienne. Par l'intermédiaire du roi de Naples, Schwarzenberg, que soutenait Antonelli, poussait Pie IX à l'intransigeance. En face de ce pouvoir temporel, dont nos diplomates faisaient une base intangible, la République de février avait proclamé le principe de la souveraineté nationale, au nom duquel les Romains s'étaient constitués comme ils l'entendaient. Il fallut nier cette vérité, pour la combattre. Les modérés furent représentés victimes des révolutionnaires, après un coup de force qui faisait de leur autorité une usurpation[6]. Des nuances séparaient les partis du centre ; mais la droite et la gauche réclamaient jusqu'au bout, avec violence, pour le succès de leurs théories opposées. La justice et la raison étaient encore à gauche sur ce point. Par quelles subtilités déconcertantes faire prévaloir que la République romaine fût moins admissible que la République française ? Une semblable lutte soulevait une fois de plus les intérêts divers auxquels notre pays offre un champ de bataille si favorable, sur lequel, avec la force de l'instinct, chacun les déchaîne à son bénéfice, tout en se réclamant du patriotisme ; elle explique la situation compliquée du centre, allant des uns aux autres, oscillant sans répit, artisan d'une politique stérile ou fléchissante lorsque l'autorité fait défaut, car personne ne dépose alors l'épée nationale dans la balance. Enjeu provisoire, Louis-Napoléon n'avait eu ni le temps, niles moyens de la forger. Falloux, en outre, l'avait doucement accaparé[7] mieux qu'aucun de ses collègues. Dans l'examen qu'il a donné du ministère dont il faisait partie, — à l'inverse de Tocqueville qui, si curieusement, pèse les faits et les hommes en se plaçant au point de vue d'un aristocratisme de valeur quelquefois restreint ou sans bases suffisantes, surtout ignorant de certaines réalités économiques, — il mesure tout d'après les intérêts ecclésiastiques. M. Passy était le seul qui nourrît et qui manifestât des dispositions anti-catholiques[8]. Barrot admirait Pie IX et professait volontiers le respect du culte catholique[9]. Drouyn de Lhuys et Faucher considéraient le pape comme la clef de voûte de l'édifice européen[10] ; Drouyn de Lhuys répétait même : J'aime mieux un bon pape qu'un mauvais pape, mais j'aime encore mieux un mauvais pape que pas de pape du tout[11]. Tracy, par élévation de nature, inclinait vers la cause de Pie IX[12]. Lacrosse, — et Falloux, sur ce point, en parle comme Tocqueville, — tenait à se régler sur les idées présumées du président[13]. Rulhières et Buffet s'entendaient au mieux avec le ministre des cultes. Ce résumé en avoue plus que ne le pensait son auteur. Joint à l'apologie de Pie IX, que devait présenter à la Chambre un pasteur protestant, Athanase Coquerel, il trahit, selon le mot de Castille, la profondeur du scepticisme religieux dans la vieille Europe[14], tout en indiquant de quels débris de matériaux ce scepticisme était fait ; il signale, en même temps, la forte résolution de maintenir à tout prix le faisceau de l'autorité politique[15], la majorité écrasante du sentiment conservateur[16]. C'était dans le même sentiment, auquel il accédait, de plus, par intérêt électoral, que Cavaignac avait envoyé une flotte à Civita-Vecchia[17]. Il n'y a pas lieu de s'étonner ici. Le clergé, qui avait combattu Louis-Philippe[18], comme il combat tout gouvernement, en paraissant le soutenir, et même en votant pour lui, avait été aidé, cependant, dans la mesure où il répondait au sentiment conservateur du pouvoir, ce que Rome ne pardonnait pas. Louis-Philippe avait été amené peu à peu, en reniant ses origines révolutionnaires, dont les outranciers s'efforçaient de lui rendre le bénéfice impossible, à rêver et même à essayer, d'assez loin, un clergé demi-gallican, comme la Restauration[19], comme Napoléon qui, étendant l'horizon, avait même voulu faire servir l'internationalisme catholique à l'idée napoléonienne. Guizot n'avait-il pas abandonné aux catholiques, par une sorte de concordat, l'instruction primaire, tout en réservant à l'Etat l'enseignement secondaire, et ceci n'explique-t-il pas beaucoup le sentiment catholique des masses, la mainmise du clergé sur elles, le caractère religieux de 1848 ? Les catholiques ne cessèrent, d'ailleurs, de vouloir accaparer l'enseignement secondaire. Malgré la lutte contre l'Université[20] et la défense de certains, dont Michelet et Quinet, ils se savaient soutenus. Si les évêques, aurait dit le roi des Français à Montalembert, veulent retirer leurs aumôniers des collèges, l'athéisme, le communisme, le fouriérisme y déborderont... Oui, l'athéisme va prendre le dessus... Il est vrai qu'il faudra qu'il me passe sur le corps[21]. 1848, envisagée sous un angle un peu spécial, à l'exclusion des autres, apparaissait toujours bien une révolution sociale, mais préparée et exploitée religieusement[22], à la faveur de laquelle le clergé, dont la politique répartie en actions différentes, opposées d'apparence, est presque toujours un modèle d'esprit de suite et de diplomatie, sut conquérir toute une partie de l'enseignement secondaire. Lamennais avait jeté un appel qui portait ses fruits en conviant les libéraux, même incroyants, à s'unir aux catholiques[23]. Le règne de Louis-Philippe avait, bien réellement été l'époque d'un véritable réveil catholique[24]. C'était dans une série de conférences à Notre-Dame, terminées le 20 février 1848, que Baurain avait proclamé solennellement l'adhésion du clergé aux principes du XIXe siècle[25]. Il revendiquait pour l'Église l'esprit de la liberté. Elle l'avait donné au monde, disait-il, en opposant jadis au patriotisme absorbant de la cité antique les droits de l'individu. 1848 fut salué par tous les catholiques, au début, sans une dissonance ; ceux qui étaient brouillés, comme Montalembert et Veuillot, se réconcilièrent. Un président de la République qui eût marché contre le clergé en 1848 ou en 1849 eût été renversé[26]. Le gouvernement monarchique le plus absolu ne l'aurait pu davantage. Constatation certaine, formidable en plein XIXe siècle, et dont on ne semble pas encore avoir mesuré toute l'importance. Lamennais, dans l'Avenir, avait indiqué, en 1830, qu'il ne devait rien y avoir de religieux dans la politique ni rien de politique dans la religion, or la question religieuse et la question politique se trouvaient mêlées au point de ne pouvoir être séparées l'une de l'autre, ni tranchées l'une sans l'autre[27]. Comme tout rétrogradait, le clergé avait d'avance cause gagnée[28]. Ainsi s'explique, dans une certaine mesure, la conduite du prince-président et pourquoi elle ne répondit, pas à ce qu'on en espérait. Il attendait, forcé à un double jeu dont les événements seuls décideraient. Si le 1er janvier, à la réception officielle de l'Elysée, certains l'avaient vu s'avancer vers le nonce et lui annoncer ses vœux en faveur du rétablissement pontifical, quelques-uns racontaient que, dans un entretien avec l'envoyé de la République de Venise, Tommaseo, il s'était montré disposé à réduire le pouvoir temporel plutôt qu'à le fortifier ; et nous verrons plus loin que c'était vrai. A quelques jours de là, recevant M. de Corcelles, retour de Gaëte, il exprimait la pensée que la révolution italienne serait peut-être florissante[29]. Il est hors de doute que ses sympathies allaient aux patriotes italiens et que, libre de suivre ses seuls sentiments personnels, il leur aurait porté secours, ou par prudence se serait abstenu d'intervenir[30]. Il remit son plan d'action à plus tard, étroitement immobilisé entre son intérêt, celui de la France et l'opinion toute-puissante de la majorité qu'il représentait. Marcher non contre le Saint-Père, mais simplement contre ses prétentions exagérées, eût équivalu à remettre la pacification française et cette reconstitution de l'unité nationale auxquelles il s'estimait prédestiné, saper lui-même ses rêves personnels, renoncer presque à son destin. Et il ne possédait pas une conscience assez scrupuleuse ni assez exacte pour y consentir ; il n'estimait pas non plus que cela eût été hostile ni même eût servi les idées qu'il préférait. Il savait, avec moins de conviction, toutefois, que dans sa jeunesse, que l'intérêt du pays n'était pas de soutenir Rome, mais le pays et ses ministres lui répétant, non sans autorité, le contraire, il ne pouvait, par son opposition, recommencer la guerre civile, à une heure, surtout, où on la prétendait constamment imminente ; nommé pour la clore, afin même d'empêcher son retour à jamais[31], il estima qu'il devait obéir à la nation. Ce fut le commencement d'un long chapitre de dol et d'arrogance dont les catholiques français sont plus responsables que Napoléon et qui, commençant par une sorte d'orgueil national perverti, se termina par le sacrifice de la nation à la papauté, et eut sa récompense à Sedan[32]. Sans liberté, le prince-président commit la faute inévitable de ne pas s'opposer à l'intervention d'abord, puis de ne pas réduire celle-ci à quelque chose qui eût rappelé l'occupation d'Ancône ; mais les circonstances permettaient-elles, l'action une fois entreprise, cette réserve même ? Il ne nous le paraîtra pas, après examen. Pour agir selon son sentiment personnel, Louis-Napoléon devait se résoudre à un coup d'État non seulement contre le ministère, mais contre le pays, et avec qui l'aurait-il fait ? La Montagne l'aurait renié le lendemain ; au surplus, elle n'était pas assez forte, et ceci étant, pourquoi se solidariser avec elle ? Il n'était pas sûr d'ailleurs qu'elle voulût réellement agir[33] ; enfin il était un peu tard pour demander la main qu'il n'avait pas acceptée quand elle était offerte ; en dernier, sur ce point aussi, il brisait son avenir par une entente totale avec elle. Sa réserve s'explique encore autrement : 1848, levier momentané du vieux continent, avait prouvé que les peuples savent aussi peu se mettre d'accord que les rois ; l'inexpérience des premiers avait même permis aux seconds de s'entendre à demi-mots, sans efforts, réunis en dépit des rivalités par l'intérêt[34]. Louis-Napoléon ne pouvait rien, à cette date, pour faire cesser un pareil fait. La révolution, assoupie par le verbe de Lamartine, n'ayant pas déclaré la guerre au moment de la crise, celui qui se trouvait à la fois l'héritier de la révolution, malgré la majorité, et, surtout, l'espoir d'ordre et de réaction équivoque de cette majorité, devait s'abstenir. Ici encore il était donc seul, toujours, parmi ses amis et parmi ses ennemis, seul en Europe comme en France, ou à peu près, car les Italiens, à l'instant d'une velléité importante, l'eussent d'abord suspecté. A son tour, il occupait un peu, sur le terrain international, la situation des premiers révolutionnaires de février, qui s'étaient trouvés seuls en avant, déjà vaincus par la majorité à laquelle ils avaient fait subir, quelques jours, la Révolution. C'était bien une révolution étouffée que Louis-Napoléon traînait derrière lui, sans que sa situation ou les circonstances lui permissent d'en délivrer la flamme vacillante. Il apparaissait ainsi, en dépit de lui-même, l'expression d'une sorte de classe moyenne despotique, plus rétrograde, à peine au pouvoir, qu'elle ne s'en doutait elle-même. Sa réserve a été définie, par la suite, le fatalisme de l'empereur. Cette appréciation semble erronée, au moins en 1849[35] ; vers 1865, et déjà lors de l'affaire des duchés danois, la politique napoléonienne égare son flottement calculé ; en 1849, on touche les raisons de son laisser-faire comme de son apparente inaction. Avant la bataille de Novare, déconseillée par notre diplomatie[36], il rêva d'agir. Qui sait même, si, malgré ses ministres, il n'essaya pas alors de cette politique personnelle secrète qui lui réussit si bien dans la première partie de son règne ? Nous en aurons le sentiment assez formel un peu plus loin. Louis-Napoléon, toujours représenté comme un idéaliste, tenait beaucoup compte des faits, une fois parvenu à un certain point dans la tentative et, après avoir estimé qu'il ne pouvait en venir à bout, il n'insistait pas toujours assez, résigné dans son attente, parce qu'il escomptait le bénéfice de celle-ci. En 1849, les faits pesèrent trop lourdement. La majorité et le clergé ne se seraient pas seulement détournés de l'idée napoléonienne qui, à défaut d'autre possibilité, demeurait la plus réformatrice ; vire volte plus grave, mais qui n'aurait rien coûté à des troupes assez dépourvues de scrupules du moment qu'il s'agissait d'intérêts, matériels ou catholiques, les deux amalgamés par une entente naturelle, elles se seraient dirigées vers les partis monarchiques dont l'intrigue se révélait progressive, la position excellente, et s'y fussent peut-être adaptées[37]. Le ministère redoutait tellement les penchants de Louis
Bonaparte vers la question italienne[38] qu'il s'efforça
de se prémunir contre eux trois jours après l'entrée du président à l'Elysée,
deux jours avant la venue d'Arèse. Le 23 décembre, le conseil des ministres,
dont ce fut la première réunion, décida l'intervention en faveur du pape[39]. Autour de ce
traquenard, Falloux a laissé filtrer une certaine lumière qui indique le
genre d'espérance placée dans l'ancien combattant de Forli : Le président ne voulait à aucun prix risquer sa popularité
et peut-être son pouvoir, au service du pape ; à aucun prix, non plus,
cependant, il ne consentait à laisser l'Autriche, déjà trop prépondérante en
Italie, envahir le reste de la péninsule et y rendre sa domination exclusive.
Ces deux points de départ n'étaient pas aisés à concilier, et c'est pour
échapper à cette difficulté par un moyen qui lui paraissait ingénieux, qu'il
imagina faire du Piémont l'agent officieux de sa propre politique. Il mit
autant d'obstination à me faire entrer dans ce dessein que j'en mettais de
mon côté à lui faire agréer des idées différentes. Vouloir cacher la France derrière le Piémont, lui disais-je,
c'est vouloir cacher un géant derrière un brin d'herbe. Tout le monde nous
apercevra et l'Autriche avant tout le monde. La France, ouvertement déclarée,
arrêtera l'Autriche ; la France, se dissimulant elle-même sous le couvert du
Piémont, sera battue sans se défendre, sans avoir ni le bénéfice de la
propagande révolutionnaire, ni celui de l'action conservatrice. Lorsque je le pressais
avec trop de vivacité sur ce sujet, le président recourait à sa méthode
ordinaire et mettait fin à la conversation par un silence qu'on pouvait
interpréter comme on voulait, mais il gardait in petto son plan intact[40]. Une de ses négociations les plus connues se poursuivit avec l'abbé Gioberti, tourné d'autant plus volontiers vers la France qu'il commençait à se sentir moins sûr de ses amis italiens. Guelfe, peu à peu résigné à des considérations gibelines, il saurait comprendre les atermoiements ; entre le Risorgimento et le Rinnovamento, il excellerait peut-être à découvrir le meilleur terrain, car ces changements apparents, venus d'un patriotisme qui primait tout, et réglés sur lui, étaient nourris par la sève la puis sincère. — En décembre 1848, Gioberti avait chargé Arèse de dire à l'illustre neveu de l'homme le plus grand, peut-être, qui ait jamais vécu, que la patrie italienne attendait de lui sa rédemption et que tout cœur italien avait éprouvé une très vive joie de sa très heureuse élection[41]. Louis-Napoléon, sans motifs pour se cacher là-dessus d'un ancien ami, se dit décidé, dès qu'il en aurait le pouvoir, à faire quelque chose pour un pays auquel il avait conservé son intérêt et son affection ; il reconnaissait que la carte d'Europe n'avait pas le sens commun ; mais si, actuellement, il proposait de la changer au profit de l'Italie, il n'obtiendrait pas d'autre voix que la sienne, soit au conseil, soit à la Chambre. Donnez-nous alors, dit Arèse, au moins, un appui moral. — En pareille matière, répondit le président, le choix n'existe qu'entre l'abstention et une action résolue, ou se tenir tranquille ou passer les Alpes avec une armée. Je ne puis pas passer les Alpes, je me tiendrai tranquille[42]. Arèse avait donc emporté la conviction que l'Italie pourrait compter à l'avenir sur Louis Bonaparte[43]. Avec quelques-uns de ses compatriotes, il se rendait compte de la contrainte exercée par le ministère, par le Parlement, par le pays[44]. Drouyn de Lhuys, avec lequel il avait eu quelques entretiens, lui avait laissé voir, tout en évoquant de préférence d'autres difficultés, le désaccord du prince et de ses ministres, la force de l'opinion publique, toute médiocre qu'elle soit souvent en période de repos où elle se livre facilement aux courants semés par ceux qui en abusent, le poids du Parlement. A la même date du 25 décembre, le président de la
République vit aussi l'envoyé de la République de Venise, Tommaseo, qui raconta
son entrevue à Manin : Un Bonaparte, dit-il[45], est certainement appelé par la Providence au gouvernement
de la France pour faire trois choses : défaire la centralisation excessive de
ce pays afin de lui donner une véritable liberté ; augmenter le respect du
pouvoir spirituel du pape, en réduire le pouvoir temporel ; enfin réparer
Campo-Formio. La première de ces propositions lui plut ; il adhéra à la
seconde ; quant à la troisième, elle ne l'offensa pas et il fit même un signe
d'assentiment. Il remarqua parfaitement, quoique je ne l'eusse pas dit, que
dans les trois choses il devait, selon moi, agir en sens inverse de son oncle.
— Il parle peu, mais poliment, semble peu instruit
des faits, mais désireux de s'en instruire et d'agir. Il se dit arrêté par
les difficultés de détail, et, parmi ces détails, par le plus fâcheux de
tous, qui est les hommes de détails. Il objecte que, pour enlever au
pape le pouvoir temporel, il faudrait une guerre européenne, qu'il a été l'initiateur
du mouvement, etc. A tout cela je ne répondis pas grand chose, me bornant à
témoigner, comme particulier, le désir que le pape vînt dans quelque ville du
midi de la France. Lui-même parut aussi le désirer. Il n'a pas l'air de se
soucier du Piémont, mais de préférer un État lombard-vénitien indépendant...
En somme, ce nouveau gouvernement semble moins éloigné de la guerre ou du
moins, d'un langage plus ferme que l'autre, non pas ses ministres, mais lui
personnellement. Le 29 du même mois, le gouvernement de Venise lui
disait dans une adresse de félicitations : Nous
sommes persuadés que vous, ancien soldat de la liberté italienne, vous êtes
appelé par les desseins de la Providence à reconstituer la nationalité de la
grande patrie des Napoléonides. Le prince-président, dit Falloux, comptait trouver en Gioberti l'orateur persévérant des idées qui leur étaient communes... C'était un homme adroit et sincère, mais un esprit chimérique et faux[46]. Ne croyant pas l'unité possible encore en combattant Mazzini sur ce point, car il avait certaines de ses idées sur d'autres, Gioberti voulait faire prévaloir, au-dessus des petits Etats italiens, mais animé par eux, un droit national capable de les fédérer. Au nom de ce droit, il rêvait une action du Piémont en Toscane et à Rome. Appartenant à l'école libérale catholique, il pensait un peu comme Pie IX, quand il n'était qu'évêque d'Imola. — Arèse avait soumis ce plan à son ami qui, dans la suite, en dépit de Falloux, en avait recommandé l'adoption à Florence comme à Gaëte. Prévoyant loin, Louis-Bonaparte cherchait à faire entendre au Saint-Siège que l'exclusion de la Sardaigne aurait des conséquences dangereuses quand il s'agissait de toute l'Italie ; il suppliait Pie IX de ne pas se séparer de la cause péninsulaire. A ce moment, dans son idée, Charles-Albert, entraînant à sa remorque peut-être, le roi de Naples, eût été l'agent de la restauration libérale[47] de Florence et de Rome[48]. Aucun de ces avertissements ne fut admis par le pape, ni par l'Autriche, et d'autant moins que l'Angleterre avait approuvé. Antonelli déclara le Piémont au ban de l'Europe, et le Saint-Père, exécuteur fidèle, exclut le Piémont du nombre des puissances catholiques auxquelles il consentait à demander secours, flèche bardelée qu'il savait devoir entrer profondément au cœur de Charles-Albert. — Tel était donc le programme au sujet, duquel Louis Bonaparte voulait s'entendre avec Gioberti. Tombé de son ministère, volontairement, le 20 février, l'abbé vint à Paris où il habita bientôt un petit appartement rue de Parme. Une foi aussi spontanée que la sienne ne dépendait pas d'un revers ; sa confiance trop robuste, même, lui faisait demander plus qu'il ne pourrait lui être accordé et ne prévint pas en sa faveur chez beaucoup. Il m'honora de ses fréquentes visites, raconte toujours le familier de Mme Swetchine[49], et se mit en rapport avec de nombreux membres de l'Assemblée, sans succès, du reste, pas plus auprès de la gauche qu'auprès de la droite. A gauche, son caractère ecclésiastique et ses convictions religieuses lui fermaient beaucoup d'oreilles ; à droite, on ne regardait pas le Piémont comme un protecteur du pape, sûr et désintéressé. A gauche on ne voulait pas mettre la République romaine entre les mains d'un roi ; à droite, Gioberti ne trouvait rien à répondre quand on lui demandait : Comment le Piémont parviendrait-il à désarmer ou à vaincre l'Autriche ? Gioberti essayait en vain une politique de juste milieu que la gauche et la droite empêchaient l'une et l'autre. Notre ambassadeur, le duc d'Harcourt, faisait remarquer au Saint-Père, malgré son entourage, que des institutions représentatives étaient universellement demandées et que le courant en leur faveur ne pouvait pas être méconnu, même par ceux qui en contestaient, les avantages, mais la majorité inclinait visiblement à la résistance et regardait les transactions comme plus dangereuses qu'opportunes[50]. La défaite de Charles-Albert arrêta donc net cette querelle qui aurait pu durer longtemps. Elle ne fut pas un coup de foudre pour le président de la République, qui s'y attendait tout en espérant quand même[51], mais brisa, pour un temps assez long, la maison de Savoie. Louis-Napoléon, cependant, aurait hésité à capituler devant les faits ; il aurait même songé quelques heures à la guerre ; il y voyait peut-être aussi la possibilité de faire revivre par elle une partie de l'idée révolutionnaire, qui lui aurait permis soit de ne pas aller à Rome, soit d'y agir plus librement, sans attaches aussi étroites avec les cléricaux. Il est toutefois assez difficile de délimiter l'exacte vérité sur ce terrain ; il faut même se résoudre à l'examiner telle qu'elle se présente, en tant que contribution supplémentaire à l'enquête essayée autour des sentiments de Louis Bonaparte. Cavour, en tout cas, évidemment dans l'intérêt de son plaidoyer, a évoqué une partie des faits que nous allons conter, au moment de la campagne d'Italie sous le second Empire, en déclarant, dans un discours destiné à préparer l'entrée de Napoléon III en Italie, que le président de 1849 aurait vengé Novare sur-le-champ si les chefs des anciens partis ne l'avaient détourné de son dessein[52]. Et il semble bien, en effet, que ce bruit ait couru quelques jours au lendemain même de Novare. Le soir du jour où la nouvelle de la défaite parvint à Paris, Louis-Napoléon aurait envoyé à Thiers un aide de camp pour le prier de passer sans retard à l'Elysée. Thiers y vint et trouva le prince-président, assure-t-on[53], absolument convaincu que la France devait répondre à la victoire de l'Autriche en passant les Alpes tambour battant et drapeaux déployés[54]. Thiers s'opposa complètement à ce projet, fit valoir, avec plus d'insistance encore, les arguments présentés à la Chambre, affirma les dispositions pacifiques de l'Autriche, trop heureuse d'avoir abattu la puissance de Turin, pour fournir un prétexte à intervention en violant le territoire piémontais ; il soulignait la défaite et mettait l'Italie dans l'incapacité aussi bien de conquérir sa liberté que de la recevoir de nos mains. Tout cela n'aurait pas encore entamé la résolution napoléonienne. Je vous dis que c'est la guerre, répétait Louis Bonaparte. L'idée de ne rien faire après ce Waterloo italien était visiblement insupportable au patriotisme du prince-président[55]. Tout en reconnaissant qu'abandonner le Piémont n'aurait
pas répondu à la générosité de notre diplomatie, Thiers répliquait que la
cause des vaincus devait être prise en main dans le seul intérêt de la
France, en abandonnant le principe absolu de l'unité italienne ; il fallait
simplement exiger l'intégrité du territoire piémontais, — qu'il venait
justement de déclarer certaine. Il aborda ensuite les difficultés matérielles
en se réclamant d'une expérience qui faisait défaut à son interlocuteur. Arrivé à quarante ans au maniement des affaires,
dit l'annaliste de ces faits, il en ignorait
profondément la langue, le mécanisme et les ressources. Ayant des solutions
générales sur chaque point, le vague envahissait sa pensée dès qu'il
s'agissait d'en venir à l'application. On l'avait même trouvé, en plus d'une
circonstance, tellement étranger aux plus simples notions pratiques, que
l'opinion était accréditée parmi ses conseillers qu'étant naturellement doué
d'un esprit assez porté aux chimères, il avait, achevé de perdre en prison le
sentiment de la réalité. On devine si M. Thiers dut user largement de la
supériorité qui lui était acquise en toute matière d'administration,
d'organisation militaire, de finances. Il fallait emprunter trois cent,
millions, élargir les cadres, lever deux cent mille conscrits ; préparer
l'équipement de huit cent mille soldats, afin de pouvoir en opposer cinq cent
mille aux efforts de l'Europe. Il fallait, en outre, refaire presque en
entier le matériel d'artillerie, remonter la cavalerie, augmenter le nombre
de nos frégates à vapeur. Le président, non encore gagné, ayant manifesté le
désir que les plus urgentes des mesures à prendre lui fussent présentées sous
forme de décrets prêts à recevoir sa signature, la rédaction en fut essayée
séance tenante, mais il fallait tout d'abord l'approbation de la Chambre, et
l'ancien ministre constitutionnel, étonné de s'entendre demander s'il ne se
chargerait pas de l'obtenir, dut répondre qu'il se faisait fort, au
contraire, de parler à la tribune comme il avait parlé à l'Elysée... On se
sépara ainsi, à une heure tout à fait nocturne, sans avoir rien conclu.
Seulement M. Thiers devait causer avant le jour avec le chargé d'affaires
d'Autriche et venir rendre compte de cette conférence dans la matinée[56]. M. de Hübner,
en ce temps-là secrétaire de légation, représentant du cabinet de Vienne à
Paris, réveillé au milieu de la nuit, se serait alors rendu à l'hôtel de la
place Saint-Georges dans la voiture de Thiers qui l'attendait à sa porte. Il
n'était pas renseigné sur les intentions de l'Autriche au sujet du Piémont,
n'ayant reçu aucune instruction nouvelle, mais il estimait que le royaume
sarde, deux fois agresseur, et deux fois battu, devait payer la peine de sa
témérité. L'Autriche, ajoutait-il, était bien autorisée à lui réclamer deux
cents millions. C'est donc la guerre que vous voulez,
répondit Thiers. En ce cas, vous allez être servi à
souhait, plus vite que vous ne le pensez. Et il raconta sa
conversation de l'Elysée. Il conseillait ici l'évacuation du Piémont,
immédiate. Il faut vous en rapporter à nous et à
l'Angleterre pour régler la rançon de Victor-Emmanuel. Il terminait en
représentant la guerre imminente et terrible : C'est
la guerre, c'est en même temps la révolution. L'épée une fois hors du
fourreau, il n'y a plus de partis en France, et le chef de l'Etat est assuré
d'avoir derrière lui ceux-là même qui s'opposent, en ce moment, à ses
velléités de recommencer l'Empire. Nous ne sommes plus en 1814 ; nous avons
derrière nous trente-quatre ans de paix et une armée d'Afrique qui n'a pas
montré encore tout ce qu'elle peut faire. Une ligne au Moniteur, un mot du
président peuvent engager dès demain cette terrible partie. Ce n'est pas,
vous le comprenez bien, sur de vaines alarmes que j'ai pris la liberté de
vous donner rendez-vous chez moi au milieu de la nuit. Si vous ne me mettez à
même de rapporter ce matin une réponse satisfaisante au président, je ne
réponds pas des résolutions qui seront prises. Thiers venait ensuite
annoncer à l'Elysée que le chargé d'affaires autrichien avait fait partir un
courrier pour recommander chaudement les propositions françaises au prince de
Schwarzenberg. Elles servirent au traité de paix. Les cléricaux tenaient déjà une partie de l'avenir ; le terrain était déblayé : Je laissai passer les premiers jours d'émotion, dit Falloux, puis j'allai demander au président si nous allions laisser l'Autriche qui, déjà, se préparait à marcher en avant, absorber les États pontificaux, et dépopulariser Pie IX en le plaçant irrésistiblement sous le protectorat d'une puissance si antipathique à l'Italie[57]. — Aujourd'hui, vous avez raison, me répondit-il, la France ne peut plus rester spectatrice impassible et, en face du drapeau autrichien triomphant, le nôtre sera salué en Italie par d'unanimes acclamations[58]. — Cette thèse de l'intervention française préférable, puisque l'intervention était nécessaire, à celle des Autrichiens, prévalut un peu partout. Emile Ollivier en a résumé les lignes essentielles : Maîtres de Rome, les Autrichiens eussent accompli une réaction impitoyable. Quel moyen de leur en fermer la porte si ce n'est d'y arriver avant eux ? Notre abstention n'eût pas sauvé la République romaine, cernée de toutes parts, condamnée, morte, avant que nos troupes se fussent mises en route. Puisqu'elle devait succomber, ne valait-il pas mieux qu'elle tombât dans nos bras amis que sous l'étreinte féroce du Croate ?[59] — En admettant qu'elle dût succomber contre tout droit, par suite des circonstances, il y avait au moins à ne pas hâter sa chute à coups de canon, à ne pas la diminuer le plus possible, à la défendre même, dans la défaite, en conservant de son effort plus qu'on n'en sauvegarda. Le futur ministre qui, en 1870, devait subir la responsabilité de cette campagne, ajoute : Le président avait pour aller à Rome toutes les raisons qui décidaient les conservateurs et d'autres, toutes personnelles, qui ne les touchaient pas. Eux pensaient surtout à restaurer la papauté ; lui songeait à profiter de sa restauration pour commencer l'œuvre de rénovation européenne qu'il considérait comme sa mission[60]. Peut-être, à la longue, par suite de pressions exercées, le pensa-t-il contre son intérêt véritable, contre celui de la France[61]. Louis-Napoléon allait à l'encontre même de cette mission. Son ministère et le Parlement, qui avaient déjà essayé de l'atteindre par l'impôt du sel, espéraient détruire sa popularité comme son pouvoir en le contraignant, dès ses débuts gouvernementaux, à renier ses idées de jeunesse, en marchant dans une voie qui n'aurait dû, à aucun prix, devenir la sienne. Il n'était ni le premier ni le dernier chef politique que la majorité moyenne de la bourgeoisie menait ainsi à sa perte, dès qu'elle s'en servait, contre l'idée vraiment nationale, et, par suite de ses fautes, sur le terrain politique comme sur le terrain politique, économique et moral, vers l'avènement progressif de cette lutte des classes, à laquelle ne saurait se restreindre sans ténèbres tout l'effort humain, mais que son intransigeance, trop sûre d'elle-même et peu renseignée, ne parvenait ni à pressentir, ni à comprendre, ni à poser à sa place exacte. Forcé d'agir contre son gré, Louis-Napoléon, utilisant l'art des nuances auquel il excellait, laissa libre cours à cette faculté d'excuse et de disculpation dont il ne régularisait pas suffisamment l'abus à l'usage d'autrui, ni au sien propre ; il se consola de l'expédition rendue fatale[62] en se persuadant que la guerre était déclarée moins en faveur de Pie IX que contre l'Autriche. En dépit de l'évidence, pris déjà par l'optimisme dangereux que les événements l'aidèrent à développer le long de son règne, il espéra toujours dans l'imprévu de l'aventure, qui permettrait de la conduire vers d'autres fins[63], secrètement ; et il se pensait autorisé sur ce sentier obscur, à peine visible, par le vague même du but que ne définissait pas la diplomatie française. Dangereux subterfuges, le premier suggéré par Falloux[64] sans doute, et qui montrait déjà, peut-être, aux ennemis attentifs de Louis-Napoléon, une des tendances les plus fortes de son caractère, porté à vouloir concilier jusqu'à l'impossible, — problème inévitable sous lequel, d'ailleurs, les dissensions françaises ont toujours courbé, plus ou moins, les hommes d'État vraiment nationaux. En laissant marcher nos troupes contre Rome, il allait donc, vaincu par ses ennemis, à l'encontre de ses désirs, de sa conscience, de l'intérêt français, et, pourtant, le destin faisait, que la plupart des raisons qui lui permettaient de se disculper fussent jusqu'à un certain degré probantes ; vues dans l'époque comme dans l'entourage, elles présentaient le visage même de la nécessité. Mais il commençait de décevoir certains amis, dont Mickiewicz, qui faisait dans la Tribune des Peuples une campagne de presse intéressante. Le président semble malheureusement ne pas vouloir. Certes, nous concevons combien dans sa position il est difficile de vouloir... Il signalait, la situation anormale du gouvernement, l'attitude si peu française qu'il prenait dans la question romaine[65] et en appelait au peuple, oubliant que le peuple incertain, ne savait, en réalité, ce qu'il voulait. Il disait : Depuis la journée de Waterloo, c'est toujours l'étranger qui règne et gouverne en France[66]. Il rappelait la modération de la France[67] ignorante d'un sentiment de vengeance, instinctivement animée toujours d'un patriotisme européen, et l'avertissait qu'on allait s'en servir une fois encore contre elle : Les ennemis de la France tentent le parti napoléonien comme ils ont jadis tenté Napoléon en persuadant à l'homme de la révolution universelle qu'il n'était que l'homme d'une dynastie nouvelle[68]. Il rappelait son nom au président de la République. Que signifie ce nom ? Il définit les qualités du peuple, et l'armée admirait dans Napoléon la foi dans la grande nation, la foi dans les principes qu'elle a proclamés, la foi dans le triomphe de ces principes, la conformité de la parole, de l'action, — la parole brève et l'action vaste, — l'homme qui parle répondant de l'homme qui agit, l'homme que les soldats appelaient leur camarade, leur caporal ; les conseillers d'Etat, leur président né ; les membres de l'Institut, le plus légitimement choisi de leurs collègues ; les aristocrates, le plus terrible des plébéiens ; le clergé, l'Antéchrist (preuve de son christianisme), et que les rois, maîtres du monde ancien, malgré leur orgueil satanique, venaient tour à tour adorer et tenter. Napoléon, c'est la révolution devenue autorité régulière. C'est l'idée sociale faite gouvernement. Il terminait son article : Alexandre le Grand a laissé son héritage au plus digne. Le peuple français a donné à ceux qui sont les plus proches du héros tous les moyens de devenir les plus dignes du plus grand des héritages. Les familles et les dynasties périssent. L'idée reste[69]. * * *La décision prise au conseil des ministres, le 23
décembre, ne resta pas un secret pour le monde parlementaire et, le 8
janvier, le ministère fut interrogé à ce sujet. Le député Beaune lui
demandait des explications, redoutant que la France ne prît part à la
restauration du pape. De suite, le mot juste se trouvait dit ; nous verrons comment
il fut rejeté, puis répété, à peu de temps de là, par le président du
conseil. L'Assemblée Nationale, déclarait le
représentant, ne peut plus se contenter d'une politique anonyme... En ce qui
concerne le pape, notre rôle politique est tracé. Que notre diplomatie, tout
en l'entourant de respects et d'honneurs, de protection, lui donne cet avis ;
il est le seul prince qui ait semblé comprendre la marche du siècle ; ramené
au sentiment de ses intérêts, il se rappellera que son autorité religieuse
est indépendante du lieu qu'il habite et que la croix de bois a été le
sceptre du monde. C'étaient de belles paroles. Comme la majorité
s'étonnait de voir l'orateur étudier la politique générale, il souleva la
gaieté en citant un mot de Metternich, ou du moins à lui attribué, et que le
vieux chancelier avait peut-être exprimé autrement : Pour
réduire la révolution de Février, il faut la laisser bouillir dans son jus.
— Sous ces ignobles paroles, disait M.
Beaune, se cache une grande vérité ; la révolution a
besoin d'une juste expansion, l'isolement, c'est sa mort...
L'affranchissement de l'Italie, l'alliance avec l'Allemagne libre, la
reconstitution de la Pologne sont les trois engagements pris par la France
républicaine. Pourquoi donc le gouvernement provisoire avait-il pensé
différemment ? Lamartine, sans se croire visé, reconnut qu'il pouvait le
paraître, et comme si son manifeste, renforcé par ses actes, ne suffisait
pas, se défendit d'avoir tenté quoi que ce fût pour répandre la révolution en
Europe ; glorieux de sa modération, il en appelait aux cabinets étrangers ;
il déclarait que toute autre politique eût été indigne de la France.
Ledru-Rollin, à son tour, se disculpa d'avoir voulu la guerre et, — car les
temps étaient changés, — se posa comme un observateur minutieux du manifeste.
Le premier couplet sur le pacifisme républicain terminé, après avoir spécifié
que les délimitations territoriales actuelles devaient servir de point de
départ aux rapports avec les puissances, il déclarait considérer comme déchirés
les traités imposés par la trahison et la lutte
terrible autant qu'inégale de Waterloo. S'il estimait juste que le
gouvernement provisoire eût étouffé, ou du moins, retenu, la révolution, il
demandait au pouvoir actuel de quel droit, au nom de quel principe, il
continuait la même politique au lieu de déclarer la guerre ; il avait
maintenu l'orléanisme, alors qu'il était mieux placé que quiconque afin de le
détruire et s'écriait : De cette politique
monarchique, nous ne voulons plus. C'était détruire, d'avance, la
portée des arguments souvent si justes qu'il opposait à ses adversaires, mais
qu'ils pouvaient lui retourner, ce à quoi ils ne manquèrent pas, pendant une
autre séance, avec d'autant plus de soin que la majorité se montrait acquise
à toutes les capitulations. Ledru-Rollin avait dit, au sujet du conseil des
ministres, le 23 décembre : Vous avez décidé qu'on
laisserait proposer l'intervention de l'Autriche et de Naples, pour ramener
forcément le pape dans ses États. Passy, au nom de ses collègues, déclara
ces paroles inexactes. Il ajoutait qu'intervenir au milieu des affaires
romaines dans un sens contraire aux votes des Romains serait marcher contre
la révolution de Février. Mais une exclamation du colonel de L'Espinasse
dévoilait le sens véritable de ce langage à double éventualité : Tout le monde espère que le pape sera rétabli dans ses
Etats. Passy avait également raison au point de vue du droit, — que
nous avons reconnu ne pas exister en fait, — en séparant la question
religieuse de la question politique : Je ne touche
pas à la question spirituelle. A ce sujet, j'ai mes croyances, je veux qu'on
les respecte, comme je respecte celles des autres, mais ce n'est pas la
première fois qu'un pape est resté éloigné de ses Etats sans que la religion
ait eu à en souffrir. Ainsi, ne confondons pas deux questions parfaitement
distinctes. — Le ministère ne devait pas tenir longtemps ce langage ni
mettre en avant M. Passy ; il eût trop craint que ce porte-paroles, bon quand
la crise n'était pas venue, ne l'engageât, et trop, dans un sens où on ne
voulait pas qu'il allât. Le 20 février, à l'occasion de la proclamation de la République romaine, que cent un coups de canon avaient annoncée du haut du château Saint-Ange, Ledru-Rollin parla de cette bonne nouvelle aux amis de la liberté. Aussitôt des voix nombreuses, — qui donnaient une fois de plus la mesure de l'Assemblée[70], — protestèrent : C'est indécent ! Vainement Ledru-Rollin s'étonnait-il d'entendre une pareille clameur de ce côté de l'Assemblée où le cri de Vive la République ! avait si souvent été poussé et faisait-il remarquer que si le gouvernement avait, accueilli un pareil fait comme il devait le faire, il l'aurait annoncé à la tribune. Drouyn de Lhuys, sans ambages, mettait les choses au point : La République française n'entend pas adhérer et sympathiser avec les mouvements et insurrections qui pourraient se produire dans tous les Etats de l'Europe. Ainsi, si nous voulons crier Vive la République ! nous dirons à notre tour : Laquelle ? Forcé de s'expliquer quand même davantage, malgré la répugnance évidente qu'il y apportait, le ministre commença par déclarer le pouvoir du pape à la fois temporel et spirituel, — ce qui équivalait à en avouer beaucoup, le temporel ayant été supprimé par un décret de la Constituante romaine — puis, enveloppé dans les considérations les plus impénétrables, traitait des difficultés diplomatiques en même temps que de la nécessité du rétablissement de la paix et de l'ordre dans le sens de la religion catholique. —Ledru-Rollin constata : Le ministre cherche à confondre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ; il a traité une question religieuse dans cette enceinte, je m'en étonne au premier degré. Nous ne sommes pas ici dans un synode... Il y a ici des hommes de plusieurs religions. C'est alors que, dans un langage assez maladroit d'ailleurs, qui prêtait à l'ironie, le pasteur Coquerel avait défendu Pie IX. Devant la confusion, doutant qu'elle fût volontaire chez
tous, Ledru-Rollin demandait à ses adversaires s'ils avaient lu le décret de
la Constituante romaine. Pour seule réponse, la droite se mettait à rire. Comment, s'écriait alors le centre gauche, il pourrait y avoir une guerre pour le chef du pouvoir
spirituel de l'Eglise, une guerre de religion ! Mais si ce pape, que vous défendez
si mal, avait des sentiments chrétiens, il ne prêterait pas les mains à un
semblable projet. La droite prouvait encore que la question religieuse
n'était pas en jeu, mais, avant tout, la cause de ses intérêts, tels, tout au
moins, qu'elle savait les entendre. Et elle protestait stupidement à ces
paroles : C'est l'idée qui a renversé à Rome un
pouvoir de onze siècles. Les députés ne connaissaient le fait
formidable qui venait de se passer dans le monde que pour le nier en
l'estimant une monstruosité passagère, sans plus. Ils se récriaient à tout ce
qui gênait cette opinion. Ils ne concevaient même point qu'on pût avancer,
ainsi que le faisait un des représentants : La
révolution romaine est aussi grande que la révolution de Février. Et quand
nous voyons tomber une couronne au pied du trône d'où tombait le sacre des
rois, il y a là tout à la fois la preuve que le peuple a le sentiment de ses
actes, et c'est un grand spectacle[71]. La théorie des
nationalités était alors résumée telle que, née de la révolution, elle avait
été confirmée par l'école de la tradition historique, célèbre sous la
Restauration, malgré les créateurs de cette école qu'ils voulaient fermer,
productrice d'autres résultats, et d'esprit bien différent : Vous avez livré chaque peuple à sa conscience, à sa
liberté, vous devez respecter les décisions qu'il prend, car vous ne voulez
pas mettre la main sur la liberté des nations. Vous croyez qu'à chaque peuple
appartient le droit de faire et de défaire les gouvernements ; vous avez
proclamé l'égalité entre les citoyens ; vous voulez donc les nations. Si vous
laissez mettre la main sur la République romaine, ce sera un indigne abus de
la loi de la force ; vous substituerez la loi de la force à la loi de la
justice. — Le député Aylies, soutenant la cause conservatrice,
s'efforçait de souder la catholicité à la question mondiale selon les vœux de
la majorité. Une seule protestation se fit entendre, celle de Proudhon : La liberté est plus que la catholicité, entendez-vous,
Monsieur ! La Chambre passa à l'ordre du jour pur et simple par
rétractation de M. Bac qui retira le texte qu'il avait proposé. A cette
séance, la complicité flottante des députés entre eux se laissait surprendre,
en dépit de quelques-uns, par-dessus leurs harangues et leur ordinaire
véhémence. La gauche recommençait le 8 mars. Le député Buvignier attaquait le premier. L'indépendance et l'affranchissement de l'Italie, dont personne ne contestera les droits, au point de vue de la liberté et de la politique française est une garantie. L'Italie est pour nous une avant-garde contre une Sainte-Alliance. Il montrait les idées révolutionnaires attaquées dans presque tout le continent et engageait le gouvernement à veiller sur toutes les politiques extérieures. Il s'étonnait douloureusement que les envoyés de la république sœur aient été éconduits et que seul, à Paris, le nonce du pape représentât le gouvernement romain. Persévérant malgré le tumulte : Des bruits graves circulent... Des puissances doivent intervenir pour rétablir le pape. Le gouvernement empêchera-t-il cette intervention ? Il ne l'empêchera pas. Il y prendra part. Et il demandait que l'Assemblée votât de nouveau sur le principe de l'affranchissement de l'Italie. — Drouyn de Lhuys jetait le cri d'alarme : On veut faire consacrer une décision précédente qui peut être grave. Il ajoutait que la politique du gouvernement était bien celle de la majorité. Ledru-Rollin rappelait encore le pacte de février et une seconde fois aussi montrait son inconséquence en reprochant à ses successeurs de méconnaître un serment qu'il avait prêté, mais qu'ils n'avaient point fait, quant à eux. Il était plus judicieux en disant : Nier à Rome le droit de chasser son prince temporel, c'est refuser à la France le droit de chasser Louis-Philippe. Il demandait à être réfuté sur le pouvoir spirituel : Pendant quatorze ans, Napoléon a séparé le spirituel du temporel, et cependant c'est lui qui a rouvert les églises catholiques. Lamartine réapparaissait également, et parlait toujours dans le même sens. Après avoir appuyé sur les tendances non révolutionnaires de sa politique internationale, il rappelait que l'Italie avait refusé le secours que lui proposait la France. Il étudiait ensuite très curieusement la question romaine et semblait comprendre au mieux la situation de Louis Bonaparte. Cette question implique la plus difficile des interventions. Mille intérêts se croisent là : intérêt italien, intérêt européen, intérêt religieux. Si l'on me demandait de prendre une résolution à l'avance sur cette question, moi qui ai, depuis vingt-cinq ans, étudié les questions étrangères, je serais fort embarrassé de répondre... Il y a à Rome trois points de vue, un point de vue ultra-catholique, un point de vue radical, un point de vue politique et républicain français. Je m'attache pour ma part à ce dernier. Les ultra-catholiques veulent que nous intervenions ou, au moins, que nous laissions intervenir. Les radicaux nous conseillent de tout livrer au hasard ou au chaos, et de nous laver les mains du sang qui sera versé. Les radicaux nous mènent inévitablement à une guerre de religion internationale, à une guerre de coalition entre les puissances européennes. Et maintenant au point de vue politique, qui est le mien, que disons-nous ? Qu'il peut concilier les principes de religion avec les principes de paix et de liberté. Nous devons respecter, comme un droit, au point de vue des puissances catholiques, l'indépendance catholique du pape. Eh bien, en écartant la question d'intervention par nous ou par d'autres, nous devons nous livrer à des négociations sur ce grand et beau thème : il faut arriver à laisser au peuple romain toutes les libertés compatibles, mais exiger de lui qu'il reconnaisse au pape les garanties de dignité, de puissance et d'autorité qui lui sont indispensables dans l'intérêt de la chrétienté. Ce sera l'œuvre d'un congrès. De pareilles questions ne se tranchent pas par un coup de vote ou par un coup de canon... La France n'interviendra pas. La France déclarera à l'Europe qu'elle ne souffrira pas d'intervention en Italie, mais qu'elle est prête à ouvrir des négociations sur les bases que je viens d'indiquer : liberté du peuple romain, indépendance et inviolabilité non pas du souverain, mais du pontife. Après cette déclaration, si la République romaine n'est pas une ébullition légère de la démocratie, si elle est un mouvement sérieux, vous traiterez dignement, noblement pour elle. Mais, à l'heure qu'il est, la France ne peut ni intervenir, ni laisser intervenir. Agir autrement, ce serait ressusciter la Sainte-Alliance. Dans un petit discours, Cavaignac venait souligner les contradictions de ses amis du pouvoir en même temps que déclarer qu'il avait été, quant à lui, contre le manifeste. Cette explication entraînait celle d'Emmanuel Arago, et il était assez significatif de voir l'ancien gouvernement avouer ainsi ses querelles. Drouyn de Lhuys utilisait l'aubaine : Le général Cavaignac a rappelé que l'Assemblée lui avait permis plusieurs fois de se renfermer dans une grande réserve à propos des affaires extérieures. Je ferai appel à la même bienveillance de la part de l'Assemblée. La situation est la même. L'ordre du jour pur et simple était une fois de plus voté. Tandis que la majorité croyait à la restauration du pape, chaque jour davantage, la minorité révolutionnaire s'y résignait de moins en moins ; les colères, de part et d'autre, étaient vives en paroles ; et la majorité ne concevait même plus, petit à petit, que l'on pût discuter la question temporelle. Le vote du 8 mars l'avait déjà montré quand, par 438 billets blancs contre 341, elle avait été victorieuse, et stupéfaite de ne l'être pas davantage. Les journaux de la gauche annonçaient une conflagration européenne, et certains y croyaient. La République disait : Aux armes ! Il n'est plus d'arrangement possible avec l'Autriche. Devant votre énergie, la diplomatie européenne va se trouver prise au dépourvu... La Russie et la Porte Ottomane seront aux mains ; les hostilités reprendront sur les bords de la Baltique ; la guerre allumera toutes les rivalités des nations. De ce conflit doivent sortir la ruine de tous les pouvoirs despotiques de l'Europe et l'indépendance de tous les peuples qu'ils oppriment. Le débat reprenait le 30 mars. Il rejetait les précédents avec un pas de plus dans la voie du recul, en définissant davantage les intentions ministérielles. Ledru-Rollin plaidait à satiété la cause du gouvernement provisoire, en reportant la faute de l'immobilité, — qu'il finissait par reconnaître, — sur la maison de Savoie. Les résultats de la discussion étaient encore nuls, au point que les Débats en faisaient la remarque. Nous aussi nous aimerions mieux voir l'Italie italienne ; mais, pour faire une nationalité, il faut une nation. Pour faire une Italie, il faut des Italiens. S'il y en a, qu'on nous les montre... Le sentiment de la nationalité est un produit de sol qui ne s'importe pas... Les Français à Gênes, ou ailleurs, ne donneront pas aux Italiens le sentiment national qu'ils n'ont pas dans le cœur. Il faut que cette question italienne soit décidément éclaircie ; il faut que nous sachions si nous sommes absolument obligés de créer et d'inventer une Italie. L'article de la République et celui des Débats suggèrent assez bien les deux horizons entre lesquels Louis-Bonaparte évoluait et qu'il eût aimé concilier l'un et l'autre. A l'ouverture de la séance suivante, faisant allusion à
Novare, Bixio constata : Le sort des armes a anéanti
la seule force armée qui existât en Italie. Redoutant l'intervention
autrichienne et son insistance, se l'exagérant même, Ledru-Rollin devait
faire observer que l'Autriche vivait sur une vieille réputation militaire
loin d'être aussi forte qu'elle le paraissait[72]. Il suppliait la
France de l'arrêter, prêtant ainsi la main à la tactique présidentielle. Son
projet de résolution était assez équivoque. L'Assemblée
Nationale, jalouse d'assurer la conservation des deux plus grands intérêts
qui lui soient confiés, la dignité de la France et le maintien de la paix
fondé sur le respect des nationalités, souscrivant au langage tenu dans la
séance du 28 mars courant par le président du conseil, confiante, d'ailleurs,
dans le gouvernement du président de la République[73] (longs murmures à l'extrême gauche), déclare que si, pour mieux garantir l'intégrité du
territoire piémontais et mieux sauvegarder les intérêts et l'honneur de la
France, le pouvoir exécutif croyait devoir prêter à ces négociations l'appui
d'une occupation partielle et temporaire en Italie, il trouverait dans
l'Assemblée Nationale le plus sincère et le plus entier concours. Molé
trouvait ce projet trop révolutionnaire. Drouyn de Lhuys fit connaître les
termes de la paix de Turin : l'Autriche ne menaçait pas le Piémont ; elle
reconnaissait Victor-Emmanuel, s'arrêtait à Alexandrie. Il demandait ensuite
au Parlement de se prononcer. Il ne fournissait aucun détail nouveau sur ses
intentions, et le député Billault le fit remarquer dans une longue péroraison
sans utilité, fantaisiste et dépourvue d'exactitude sur plusieurs points.
C'était faciliter le jeu du ministre, qui vint justifier la réserve du
gouvernement provisoire. M. de Lamartine, dans le
manifeste, promettait à la nation italienne l'assistance de la France. Et
quand faisait-il cette promesse ? Le lendemain de la révolution. Je n'ai pas
besoin de signaler tout ce qu'il y avait de sagesse et de précautions dans
ces paroles. Quand on parle d'assistance, on distingue dans quelles
conditions elle pourra avoir lieu. Quand on parle des traités de 1815, on les
déclare morts endroit, mais en fait, on les regarde toujours comme le point
de départ des relations avec les puissances étrangères. Vous voyez donc,
Messieurs, que ces paroles prononcées dans un mouvement tout révolutionnaire,
n'impliquaient pas un engagement absolu. A cette époque, quel fait de guerre
s'est produit ? Il rappelait que la France, dans sa politique
extérieure, s'était toujours préoccupée de trois points : d'une grande guerre en Italie, de la constitution
intérieure de l'Allemagne, et de la situation de la Pologne en partage.
Il se résumait : Je dis alors que la France devait
rester fidèle à cette tradition de son histoire, qu'elle ne devait pas
sacrifier l'Italie à l'Allemagne, ni l'Allemagne à l'Italie, mais qu'elle
devait suivre une politique de conciliation et de transaction qui donnerait
satisfaction à un but qui embrasserait trois objets différents. Jamais,
en somme, la question de guerre n'avait été portée à la tribune. La politique
de Cavaignac montra que l'Italie nouvelle rejetant ses offres, nous avions
quand même maintenu celle-ci en remplaçant l'action armée par une assistance
diplomatique. Une fois en moins bonne posture, l'Italie changea d'avis et
réclama ce qu'elle venait de refuser ; le général répondit : Nous n'avons pas fait un engagement absolu, nous avions
manifesté notre intention au milieu des circonstances qui s'accomplissaient
alors, mais les circonstances sont changées... Le ministre renouvelait
sa déclaration de n'avoir continué que la politique de Cavaignac. Et Billault
ayant dit qu'on restaurait les traités de 1815, il s'expliquait ainsi, après
avoir démenti les faits allégués à ce sujet. Il a
été proposé au gouvernement français d'entrer dans un congrès où il
s'agissait de donner une consécration nouvelle aux traités de 1815. Nous
n'avons pas voulu participer à ce titre au congrès en question. La France ne doit
pas mettre la date de 1848 sur les traités de 1815. Mais nous ne nous sommes
pas drapés dans notre manteau ; nous n'avons pas refusé d'entrer dans le
congrès pour y traiter d'autres questions diplomatiques auxquelles peuvent
être intéressés l'honneur et la dignité de la France. Il y a trois manières
de résoudre les questions. La première c'est de s'en rapporter au hasard ; la
seconde c'est d'agir solitairement ; la troisième c'est de procéder en
commun. C'est cette dernière manière de procéder que je suivrai toujours,
tant que cela me sera possible. Pour ce qui regarde la question pontificale,
je ne puis non plus accepter ce que dit M. Billault. Nous ne permettrons pas
à la première puissance venue, comme il l'a insinué, d'agir dans cette
question. Nous considérerons, nous réserverons l'intérêt de l'Italie,
l'intérêt religieux et l'intérêt de la liberté. Eh bien, pour sauvegarder ces
trois intérêts, la France devra s'entendre avec le plus grand nombre de
puissances possible ; car plus il y aura de puissances, et plus la question
recevra une solution impartiale. Ledru-Rollin relevait ce langage, qui, sous les apparences de la forme, cachait au fond l'abandon
de l'Italie. Il était de plus singulier que le gouvernement, qui
disait hériter de la révolution pût, tout en déclarant ne pas admettre les
traités de 1815, consentir à s'entendre avec des puissances qui faisaient de
ces traités la base de leur action et de leur accord même. Le ministre avait,
d'ailleurs, préparé à cette capitulation quand il avait constaté que
l'admission générale des traités de 1815 était parallèle à la protestation
beaucoup plus restreinte qui s'élevait contre eux. Mais, au lieu de se tenir
sur le terrain où il voyait si juste quelquefois, Ledru-Rollin menaça la France
de l'invasion de l'Autriche[74]. Ici encore il
détruisait lui-même le bien fondé de ses autres observations : En 1830, comme aujourd'hui, tous les peuples se sont
éveillés à l'invitation de la France. Au moment solennel, Louis-Philippe
avait deux politiques à suivre, l'alliance avec les peuples, l'alliance avec
les monarchies : il a préféré, dans un intérêt dynastique, se faire admettre
dans les politiques des rois. Où cela a-t-il conduit ? Au 24 février 1848.
Comme il invoquait encore le manifeste, Thiers, Barrot, Faucher lui jetaient
enfin : Il fallait intervenir... Vous n'avez pas
fait vous-même ce que vous conseilliez. Il s'en prenait, vraiment,
aujourd'hui, ne découvrant plus de meilleure excuse, aux événements de juin ;
bien avant juin, la non-intervention était décidée et Lamartine l'avait
revendiquée comme un titre de gloire pour son gouvernement[75]. — Le procès
fait aux pouvoirs de février se poursuivait ainsi doublement, à la Chambre,
au point de vue de la politique extérieure, à la Haute Cour de Bourges, sur
la politique intérieure. Les hommes de la révolution de 1848 avaient capitulé
avec leur principe, de même que leurs successeurs capitulaient avec leur
passé et ils étaient qualifiés pour se le reprocher les uns aux autres.
Ledru-Rollin rappelait à Odilon Barrot ses discours au banquet de Saint-Quentin
: Cependant, si l'Autriche voulait étendre sa
domination sur les Etats indépendants de l'Italie, si le conflit s'engageait
entre les gouvernements et les peuples, la France ne demeurerait point
immobile, la France ne pourrait rester indifférente en face de cette lutte...
Non ! Non ! Si notre gouvernement refusait de marcher au secours de l'Italie,
les canons, comme on l'a dit, partiraient tout seuls. Il faisait
souvenir qu'en 1831 ceux qui combattirent le retrait des troupes d'Ancône
furent non seulement le président du conseil actuel et son ami Duvergier de
Hauranne, mais Thiers et Guizot. Billault, revenu à la tribune, serrait mieux
la question : M. le ministre des Affaires étrangères
a cité une parole de M. Cavaignac sur les dangers de l'isolement. Nous
connaissons ce débat. M. Guizot a fait ressortir aussi les avantages de faire
partie du concert européen. Si l'on va dans ce sens, si l'on sacrifie à
l'entente intime avec ceux qui en font partie toutes les combinaisons qui
pouvaient assurer le triomphe de la liberté dans le monde, nous nous
hasardons dans une voie fort douteuse et nous devons refuser d'y suivre le
cabinet. Jules Favre essaya de disculper le gouvernement provisoire.
Son abstention, disait-il, venait des dissensions italiennes. On aurait dit
de l'autre côté des Alpes : Plutôt les Autrichiens
que Charles-Albert. Comme Ledru-Rollin, il voulait ce jour-là faire
faire par le gouvernement actuel ce que les précédents n'avaient même pas
essayé. Nous avons à parler à l'Europe,
disait-il ; nous avons à lui rappeler les droits
imprescriptibles, non seulement des nationalités menacées par la force, mais
encore de l'humanité... Pour le faire, non seulement avec dignité mais avec
force, il ne faut pas qu'une résolution, émanant de cette assemblée,
ressemble à je ne sais quel coup de dés dirigé contre un cabinet pour en
provoquer le renversement, non, il faut que ce soit l'élan de la pensée
française, il faut que ce soit le cri du cœur de la France s'unissant au
pouvoir exécutif, oubliant toutes les divisions intérieures. Ce n'est qu'à
cette condition que notre pays pourra figurer dignement, sinon sur les champs
de bataille de l'Europe, du moins dans les négociations semi-armées, où il
aura à faire prévaloir sa volonté. Après une discussion sur les divers ordres du jour proposés, Thiers demanda la parole, et la discussion fut remise au lendemain. Celui qui devait être le président de la troisième République céda la parole au premier chef exécutif de la seconde, désireux de réfuter Ledru-Rollin qui, dans le courant de son discours, avait déclaré, la veille, que la politique suivie parle gouvernement provisoire n'avait pas été celle de Cavaignac. Le général tournait le regard vers Lamartine, regrettait son absence et expliquait que la différence n'existait pas, au moins au point où l'avait indiquée Ledru-Rollin ; pourtant il récusait le ministère actuel. J'éprouve le besoin de faire, s'il le faut, une coupure entre nous et le ministère actuel. Il priait les députés de comprendre qu'il ne pouvait pas, quant à lui, avoir de politique personnelle. Je n'avais pas de politique à imaginer ; j'en avais une à suivre, celle de l'Assemblée... J'étais l'agent de l'Assemblée[76]. Et il prouvait, — ce que nous savions, — qu'il l'avait toujours été avec une fidélité scrupuleuse. Mais il ajoutait que s'il avait réservé la guerre pour le présent, il ne l'avait pas réservée pour l'avenir.- Et l'on soupèse ici l'héritage doublement, — triplement même, si l'on songe à l'orléanisme, — lourd que laissait la révolution de Février à ses véritables héritiers. La situation avait effectivement changé, ainsi que l'indiquait le général, mais défavorablement à la cause qu'il estimait, comme ses anciens amis forcés, maintenant qu'il n'était plus au pouvoir, nécessaire de servir. D'après Thiers, il y avait trois politiques en face de la question italienne. L'une était celle de l'intervention, et il se montrait contre ; l'autre consistait à négocier utilement pour l'Italie, même dans la situation malheureuse où les imprudences l'avaient placée, et c'était la meilleure ; celle qui se résumait à ne rien faire en paraissant faire quelque chose n'était pas digne de la France, et il la rejetait. Il prouvait que ceux qui voulaient arracher l'Italie à l'Autriche n'en avaient pas les moyens. Vouloir la guerre était ne pas se rendre compte de l'intérêt du pays, d'autant moins que la guerre avec l'Autriche entraînait une guerre continentale. Il traitait de l'union de l'Autriche avec la Russie et déclarait que les sentiments des nationalités englobées dans le mouvement contre la France même, nous étant acquis, ne serviraient pas. Cela nous est arrivé : nous avions les peuples avec nous, et cependant les gouvernements luttaient énergiquement, et les armées se battaient avec courage. Nous n'aurions pour nous qu'une faible minorité. Faire la guerre en Italie, pour une question d'influence, était une folie. La politique que je soutiens ici, c'est que, pour l'Italie, quelque intérêt qu'elle doive nous inspirer, nous ne devons pas faire la guerre. Depuis le 24 février, vous n'en avez pas suivie une autre. La politique du gouvernement de Février était elle-même la continuation de la politique prudente de la monarchie orléaniste au moment des mariages espagnols. Pourquoi donc la révolution de Février n'avait-elle pas affranchi l'Italie ? Pourquoi les hommes qui la conduisaient, se trouvant en face des faits, avaient-ils dû changer leur façon de voir, et constater, eux aussi, nécessairement que les traités de 1815, abolis en droit, subsistaient en fait. Il était cependant si peu l'apologiste de ces traités qu'il regrettait que la République n'eût pas profité de sa puissance pour organiser la force armée de la nation, préparatrice d'une armée qui pût, au jour favorable, déchirer ces traités. Le gouvernement provisoire n'avait pas le droit de prétendre qu'il n'avait pu faire la guerre : il avait laissé passer une occasion unique, telle qu'il ne s'en était jamais présenté une pareille depuis le 24 mai. L'Autriche restait alors abattue. Mais la présence d'un roi à la tête d'un mouvement italien fut la véritable cause de l'abstention républicaine. Si vous aviez eu l'intention énergique de profiter de la situation, vous le pouviez ; et quand vous avez eu des amis assez imprudents pour tourner le dos à la fortune, vous voulez aujourd'hui leur sacrifier la France ? Et après s'être égaré sans exactitude contre la République romaine, il remarquait plus judicieusement que l'on demandait notre intervention à un moment où il n'y avait plus de force organisée en Italie, quand l'occasion était passée, quand il n'y avait plus que des malheurs à recueillir. Ayez donc la justice de reconnaître que vos successeurs ne font que ce que vous avez fait vous-même, et qu'ils ont pour eux l'excuse des circonstances que vous n'aviez pas. L'intervention devait se borner à ceci : Il faut empêcher qu'à une liberté insensée ne succède une réaction déplorable. Il terminait par un coup de trompette élogieuse envers la Russie, seul pays européen qui n'avait pas été désorganisé par la Révolution. Il n'y a de puissance et de force aujourd'hui que pour les Etats qui savent s'organiser, soumettre le désordre et triompher. Ledru-Rollin récusa les paroles de Cavaignac. Il affirmait
que le général n'avait pas été aux ordres de l'Assemblée et avait agi à sa
guise. Qu'on ne vienne pas dire qu'on a suivi une
consigne. Encore une fois, cela n'est pas. La responsabilité en est donc à
vous, car, dans toutes les affaires diplomatiques, vous avez gardé le
silence. La politique que vous avez suivie était donc la vôtre et non celle
de l'Assemblée. Il attaquait Thiers, qui ne faisait que changer
d'opinion. En 1840, il avait voulu la guerre, pour une question d'influence
justement. Les arguments par lesquels il s'efforçait d'effrayer aujourd'hui
étaient justement ceux invoqués contre lui sous Louis-Philippe. Ah ! monsieur Thiers, prophétisait-il, vous avez pu comprendre le passé, vous ne comprendrez ni
le présent ni l'avenir ! Le président du conseil concluait en préconisant comme seul terrain admissible celui de la négociation armée. Et à la suite de nouvelles discussions, l'Assemblée concluait, elle aussi, par l'adoption d'un ordre du jour ainsi rédigé : L'Assemblée Nationale déclare que, si pour mieux garantir l'intégrité du territoire piémontais et mieux sauvegarder les intérêts et l'honneur de la France, le pouvoir exécutif croit devoir prêter à ses négociations l'intérêt d'une occupation partielle et temporaire en Italie, il trouvera dans l'Assemblée nationale le plus entier concours. Il est à remarquer que la discussion avait dévié peu à peu du pape à Charles-Albert et à la cause italienne, ce qui avait permis, en quelque sorte, de perdre le sujet véritable, de le réformer en tout cas, loin de la tribune et, finalement, de l'exclure de l'ordre du jour, afin que celui-ci, vague à souhait, légitimât jusqu'à son contraire dans la suite, à force de ne signifier rien. — Cependant le ministère, devant la difficulté d'une entente avec l'Autriche, n'était pas sans projets. Drouyn de Lhuys jugeait que la France pouvait et devait intervenir à Rome. Dans les premiers jours de mars, il aurait reçu deux délégués de la République romaine, MM. Pescantini et Beltrami[77], qui se seraient assurés favorables à une action de la France ; et sans doute cette action leur fut-elle indiquée dans un sens différent de celui qui lui fut donné. C'est le 7 mars que le ministre avait envoyé à Rome M. Mercier, chargé de préparer les voies à un accommodement des Romains avec le pape[78]. Bientôt, un autre agent s'y employait, M. Micard. Le pape, qui redoutait un congrès général des puissances où celles-ci eussent délibéré en paix, librement, en avait décidé un à Gaëte entre puissances catholiques, maniables à sa guise. Situation difficile pour le gouvernement français qui, en refusant d'y adhérer, indisposait la majorité nationale, et, en y prenant part, confondait son action avec celle des autres pays convoqués. Contraint, il y assista en la personne de MM. de Rayneval et d'Harcourt, le premier ambassadeur auprès du roi des Deux-Siciles, le second ambassadeur auprès du Saint-Siège. Le congrès s'ouvrit le même jour que le débat parlementaire le plus récemment décisif sur les affaires italiennes, le 30 mars. De suite nos représentants se rendirent compte que les puissances réunies là étaient mal disposées à l'égard de la France. Les délégués de l'Autriche, de l'Espagne, des Deux-Siciles, préparaient une croisade contre la République romaine, aiguillonnés par Antonelli. La défaite de Charles-Albert avait changé, — tout au moins selon le principal secrétaire de l'ambassade de France à Rome, M. Forbin-Janson, — l'état d'esprit des Romains qui inclinaient vers une politique d'accommodement entre le pape et ses sujets. D'après lui, ces Romains libéraux reconnaissaient qu'une médiation française pouvait seule sauver Rome d'une brutale représaille de l'Autriche ainsi que d'une occupation napolitaine[79]. C'était la thèse même soutenue à Paris où on dut l'accueillir, venue de la Ville Éternelle, avec un plaisir particulier[80]. Mazzini aurait avoué la fatalité d'une intervention, et, trop politique pour ne pas flairer ce que menaçait d'être celle-ci, mais pas assez renseigné pour connaître l'esprit de la Constituante parisienne, il aurait ajouté : De toute autre puissance, nous ne pouvons pas entendre parler de médiation, nous l'acceptons de la France, à condition d'en fixer les termes avec l'Assemblée constituante[81]. Il était très admissible, — comme l'avait dit Thiers à la tribune, — que l'influence française eût empêché les Autrichiens de pousser plus loin leur triomphe après Novare. A Rome, la France, mais en agissant effectivement, jouait un peu le même rôle : Elle irait avant l'Autriche, avant le roi de Naples, avant l'Espagne ; elle ferait seule avec ses principes ce que les souverains coalisés eussent fait selon des maximes qu'elle réprouvait[82]. — Beau programme, — auquel peu de personnes durent croire, à moins d'être peu averties sur le nouveau Pie IX qui remplaçait progressivement l'ancien et sur la partie de la population, bien plus nombreuse que les catholiques de France ne permettaient de le croire, qui ne se soumettrait pas à cette restauration papale imposée par des armées étrangères. Mais la personnalité propre de la République romaine n'entrait pas chez nous, — sauf dans les discours montagnards, — en ligne de compte, les catholiques la niaient en tant qu'impie ; les républicains estimaient qu'elle n'avait qu'à se déclarer satisfaite puisque nous empêchions les abus de la papauté tout en la restaurant. Le ministère utilisa ce double point de vue en présentant l'un et l'autre visage, selon les interlocuteurs, l'un pour Gaëte et les cléricaux de France, confit en dévotion, habile à expliquer le service qu'il rendait à la restitution de Rome, l'autre aux dupes volontaires de la gauche accommodante en faisant valoir que l'expédition, en réalité, protégerait les Romains contre l'Autriche. Le débat parlementaire reprit le 16 avril. Le matin même,
dans un conseil de cabinet, on décida l'intervention. Barrot a prétendu que,
dans ce conseil, le prince s'était montré un des partisans les plus
convaincus de celle-ci[83]. Emile Ollivier
revendique aussi l'expédition de Rome comme une œuvre présidentielle[84], et Falloux
parle naturellement de même[85]. Nous avons
expliqué précédemment quel fut, à notre sens, le sentiment véritable de
Louis-Napoléon, toujours mal compris, président ou empereur, de ses ministres[86]. — A cette heure
cependant, sans doute par intérêt, devant l'unanimité de son entourage
céda-t-il. — Odilon Barrot fit à l'Assemblée la déclaration suivante : Lorsque nous vous avons informés des derniers événements
dont l'Italie a été le théâtre, l'Assemblée Nationale a pressenti la
nécessité où la France pourrait se trouver d'occuper temporairement une
portion du territoire de la péninsule ; c'est de votre initiative qu'est
émanée l'autorisation donnée au gouvernement de prendre une telle mesure dans
le cas où il la jugerait utile[87]. Depuis le vote que je viens de rappeler, la situation,
encore incertaine â cette époque, s'est fortement caractérisée. L'Autriche
poursuit les conséquences de sa victoire : elle pourrait se prévaloir des
droits de la guerre à l'égard des Etats plus ou moins engagés dans la lutte
qui avait éclaté entre elle et le roi de Piémont. Le contre-coup de ces
événements s'est fait sentir dans l'Italie centrale. Les informations qui
nous arrivent annoncent que les Etats romains-traversent une crise imminente
; la France ne peut y rester indifférente. Le protectorat de nos nationaux,
le droit de maintenir notre légitime influence, isolée, le désir de contribuer
à faire obtenir aux populations romaines un bon gouvernement fondé sur des
institutions libérales : tout nous fait un devoir d'user de l'autorisation
que vous nous avez accordée. Il nous serait impossible d'entrer dans plus de
détails sans compromettre le but que nous avons en vue. En pareille
circonstance, une part doit toujours être réservée aux éventualités ; mais,
ce que nous pouvons vous affirmer, dès à présent, c'est que, du fait de notre
intervention, sortiront d'efficaces garanties, et pour les intérêts de notre
pays, et pour la cause de la vraie liberté. Le gouvernement croit nécessaire
de constater avec précision la nature et la portée du vote qu'il demande à
l'Assemblée nationale ; déjà investi par elle d'un mandat dont il apprécie
l'importance[88], il n'y renonce pas et ne demande pas qu'elle lui en
donne un nouveau ; il regarderait comme indigne de lui, comme contraire à ses
devoirs, toute démarche par laquelle, changeant la position qu'on lui a faite
à dessein, il essayerait de couvrir sa responsabilité de celle de
l'Assemblée. En venant aujourd'hui vous demander le crédit qui lui est
indispensable pour assurer l'exécution du mandat qu'il a reçu, il reste, il
veut rester pleinement responsable des conséquences qu'il entraînera. Sa
responsabilité ne cesserait que le jour où le refus de ce crédit, en le
réduisant à la nécessité impérieuse de rester inactif en présence des
événements qui vont s'accomplir, lui prouverait que l'Assemblée a entendu
annuler son vote du 30 mars. Le projet était ainsi conçu : Art. I : Il est ouvert au ministre de la Guerre, au titre
de l'exercice de 1849, un crédit extraordinaire de l.200.000 francs pour
subvenir au surcroît de dépenses qu'exigera l'entretien sur le pied de guerre
pendant, trois mois du corps expéditionnaire de la Méditerranée. Cette
déclaration, qui permettait tout et n'indiquait rien de précis, fut reçue, —
note son auteur, — au milieu d'un silence vraiment
solennel. Une commission fut choisie d'urgence pour faire un rapport.
Elle comprit : Thiers, Duvergier de Hauranne, Aylies et Layssac, pour les
conservateurs, Schœlcher, Pascal Duprat, Subervie, Grévy et Germain Sarrut
pour la gauche, et pour les réactionnaires modérés : Lamoricière, Dufaure,
Sénard, Freslon, Ferdinand de Lasteyrie ; Jules Favre, encore que montagnard,
gardait une certaine neutralité ; et celle-ci lui valut peut-être d'être
rapporteur. La commission demanda le président du conseil et le ministre des
Affaires étrangères qui y trouvèrent, raconte le premier, cette préoccupation assez générale que notre intervention
à Rome était chose convenue et concertée avec les puissances catholiques et
même avec l'Autriche. — La méfiance était mal orientée, ne faisant pas
peser ses demandes sur le point essentiel. Nous
dûmes donc surtout insister sur ce point que notre action à Rome était et
resterait exclusivement française, que nous étions libres de tout engagement
quelconque avec d'autres puissances : nous donnâmes en même temps
communication des lettres et dépêches de nos agents restés à Rome, qui nous
annonçaient qu'une réaction s'y opérait dans les esprits et que
l'intervention de la France serait reçue comme un bienfait[89]. Comment ne le serait-elle pas, ajoutions-nous, puisqu'elle a pour objet de sauver de la liberté romaine ce qu'on en peut sauver, et de préserver cette population des violences qui suivraient infailliblement une restauration faite en dehors de notre influence[90]. Ces explications suffirent, paraît-il, à la commission ; sa majorité, en tout cas, se prononça en faveur du crédit demandé. Les conclusions du rapport de Jules Favre furent discutées le soir même. On tenait à agir vite pour ne pas laisser aux rares députés qui le désiraient le temps de se ressaisir. Jules Favre lut à la Chambre un court papier qui répétait les déclarations de Barrot, sans renseigner davantage. On y parlait de l'influence qui appartient nécessairement à la France dans tout débat européen, sans spécifier son genre autrement que pour affirmer la persuasion que le gouvernement n'abuserait pas du droit d'occuper un point de l'Italie. Un seul passage en dirait plus et même trop : La pensée du gouvernement n'est pas de faire concourir la France à l'accroissement de la république qui existe actuellement à Rome. Et dans ses Mémoires, Barrot insinue qu'il y avait, en réalité, désaccord sur ce point, car si, tel, sans doute, n'était pas le but de notre intervention, tel pouvait en être le résultat[91]. C'est ici qu'il fallait frapper, et le premier interpellateur, Emmanuel Arago, ne le fit pas, satisfait d'obtenir encore l'assurance que les trois couleurs ne voisineraient pas avec l'aigle autrichienne, mal habile à spécifier, suffisamment, les desiderata nécessaires dans une affaire si sournoisement drainée par la droite, quand il demandait si la France était résolue, — et le rapport Favre lui répondait déjà non, — à respecter la souveraineté du peuple romain. Le seul mérite de ses observations fut de forcer la vérité. Barrot lui-même l'avoua, prouvant d'une part que le ministère avait menti précédemment à l'Assemblée, de l'autre que celle-ci lui en demeurait plutôt reconnaissante : Le gouvernement fera prévaloir sa politique et celle du pays, qui est de ne pas permettre une restauration du pape en dehors de son influence et de ses principes. A vrai dire, la stupéfaction de la gauche ne fut pas extrême ; une seule voix s'y étonna : Comment, la restauration du pape ! C'était la seconde fois que le mot se trouvait dit. Le président du conseil ajouta : Le gouvernement consultera avant tout les intérêts de la France. Agacé par quelques cris, il se démasquait plus encore : Nous ne voulons point établir de solidarité entre l'existence de la République française et l'existence de la République romaine. Ledru-Rollin devait se récrier ; il n'y manqua point,
seul, d'ailleurs, dans la confusion, à indiquer la faute et son danger. Dans le discours que vous venez d'entendre, un mot m'a
frappé : ce mot, c'est la pensée du gouvernement ; ce mot fatal, je l'avais
prévu ; il n'est donc pas nouveau aujourd'hui ; on vient de le prononcer :
c'est la restauration du pape. On lui opposait les intérêts de la
patrie : Votre politique est une politique
superficielle. Avertissement de haute importance et profondément vrai.
Et comme il déplorait une fois de plus que le ministère ne reconnût à Rome
qu'une seule autorité, celle du pape, la droite faisait entendre au milieu de
son tapage : Quel malheur y a-t-il à cela ?
Malgré le silence de Marrast, la droite ne parvenait pas à interrompre : Vous commettez une lâcheté en faveur de l'Autriche : vous
entreprenez la guerre non pour délivrer un peuple, mais pour l'opprimer...
Vous voulez que les fils des anciens vainqueurs de Rivoli, de Castiglione,
prennent les armes, non pour rendre la liberté aux peuples de l'Italie, mais
pour les opprimer[92]... Vous suivez les errements de la Restauration et du
gouvernement issu de la révolution de Juillet, car rien de ce qui se passe
n'est nouveau. Il se trompait en avançant que le pays tout entier
était avec lui pour repousser la restauration papale. — La mauvaise foi de
l'Assemblée complice s'étala lorsque le général Lamoricière vint dire : L'honorable préopinant raisonne comme s'il était question
d'employer les baïonnettes françaises pour ramener à Rome le pape en triomphe
! Le scrutin fut annulé à défaut d'une voix, et la séance reprit le
soir. Barrot renouvelait ses déclarations, invariablement vagues. Elles se résumaient à ce que la France ne permettrait pas qu'une restauration se fît en dehors de son influence et de ses principes. Les événements pressaient, disait-il, la contre-révolution s'avançant à grands pas, et la cause de la République romaine était perdue ; interrompu par l'extrême-gauche qui, sur ce dernier point, manifestait une tendance invariable à méconnaître les faits : Ce n'est pas la politique d'une minorité de cette Assemblée, tranchait-il, c'est la politique qui a reçu la sanction de la majorité que le gouvernement est chargé de suivre et de pratiquer. Infatigable et persévérant au fur et à mesure de la nécessité de la décision, il répétait : Nous ne voulons pas établir de solidarité entre l'existence de la République romaine et celle de la République française. Mais nous ne voulons pas non plus qu'un événement important, qui peut avoir une grande influence sur les destinées de l'Italie, auquel peut se rattacher la légitime influence qui appartient à la France dans ce pays, se consomme par une influence étrangère ; nous ne voulons pas que l'abstention de la France, que l'exclusion de toute influence de sa part, porte préjudice à des garanties et à des libertés qui ont toutes nos vieilles sympathies. Ledru-Rollin expliquait que le secret espoir du
gouvernement était qu'à la vue du drapeau tricolore les populations se
levassent en faveur du pape : la restauration se ferait de la sorte sans
coups de fusil. Oui, le parti que vous prenez est le
parti de la restauration papale, c'est-à-dire le parti des prétentions
religieuses contre la souveraineté des peuples. Puis, revenant au
thème du passé : Il est grave, mille fois grave pour
un gouvernement de marcher à l'encontre de ses principes ; il est périlleux
pour un gouvernement, de vouloir étouffer du pied des germes de la même
origine que ceux qui l'ont fait naître. Rappelez-vous le gouvernement sorti
de la révolution de juillet... Il semble que nous n'ayons changé que les noms
et que la plupart des hommes soient restés les mêmes. Il faisait
ressortir que 12.000 hommes seraient insuffisants et soulevait une question
dont ne s'embarrassait pas le ministère, plein de cet éternel optimisme
officiel qui mène à tout : Et si l'Italie résiste ? Lamoricière se contentait d'agiter le spectre autrichien, d'exagérer son imminence, et, toujours sans franchise, ou, dans le cas contraire, avec une innocence déconcertante, il affirmait : Si la République romaine ne devait courir d'autre danger que celui qui résulterait de l'occupation de Civita-Vecchia par une division française, elle n'aurait rien à craindre, vous le savez bien. Il se montrait plus voisin de la vérité en disant : Je ne pense pas que la France puisse engager une guerre pour aller soutenir contre l'Autriche et contre toutes les puissances qui ont envie de ramener le pape à Rome une guerre pour faire vivre la République romaine, de la possibilité d'existence de laquelle les plus chauds amis de cette même République ne sont pas bien convaincus. Amorçant le drame même, il concluait : Je pense, avec la majorité de la commission, qu'il y a lieu d'accorder le crédit demandé, qu'il y a lieu d'autoriser le gouvernement à occuper Civita-Vecchia. De plus, si, comme tout porte à le croire, d'après les nouvelles qui nous ont été communiquées par le gouvernement, lorsque cette expédition sera débarquée à Civita-Vecchia, on apprend que l'Autriche marche vers Rome pour y détruire la république, y rétablir le pape à la demande des populations, y sceller son influence, nous pensons qu'il y a lieu d'autoriser le gouvernement à faire marcher son expédition sur Rome, afin de sauver ce qu'on peut du naufrage, sinon la République romaine, au moins la liberté et l'influence de la France en Italie. Le lendemain Félix Pyat expliquait le sens de l'abstention du vote des gauches. Malgré que le nombre des votants n'ait pas été suffisant la veille, l'Assemblée maintenait' la validité de son vote. Le tour était joué. — L'expédition partait à l'aventure. La lutte parlementaire, une fois de plus, n'avait pas désarmé le plan réactionnaire préconçu ; elle l'avait couvert et même, à cause de la majorité conservatrice, servi. Aux deux questions : Si l'expédition rencontrait de la résistance, d'abord à Civita-Vecchia, puis à Rome, on n'avait pas répondu. La droite n'avait cessé, — et sans résultat, — de montrer par la force des choses sa suffisance ignorante. Elle avait ri quand Schœlcher lui prédit que nos soldats trouveraient de la résistance. Le ministère, aux appels répétés du représentant, s'était tu. Vous me permettrez bien de poser une hypothèse, — avait-il maintenu en dépit des vociférations. J'admets, vous ne l'admettez pas, mais je l'admets que la République romaine ne veuille pas recevoir le pape des mains des troupes françaises : que feront les troupes françaises ? Et tirant la moralité de ce silence : Il reste constant que, cette question posée, le ministère refuse d'y répondre. L'Assemblée peut juger quelles sont les intentions du ministère. La majorité avait approuvé par un subterfuge peu honorable. La République romaine était représentée à Paris parle colonel Frapoli. Le soir du 16, il envoya au ministre des Affaires étrangères sa protestation, qui remettait les choses au point. Je vous ai conjuré d'éviter une guerre fratricide ; je me suis montré disposé à toute honorable transaction, pourvu que vous ayez consenti à entrer comme ami sur le territoire de la République romaine. J'obtiens de vous pour toute réponse : Que vous ne pouviez négocier avec ce qui n'existait pas ; que Rome, pour vous, c'était le pape et son droit, que la France s'interposerait pour empêcher une réaction peut-être trop violente et afin que le principe de la sécularisation fût appliqué le plus largement possible dans l'administration de l'État. Envoyé d'un gouvernement et d'un peuple que vous condamniez d'avance à mourir, il ne me restait plus désormais qu'à protester contre la violation éventuelle, et sans avis préalable, du territoire que je représente[93]. * * *Selon Barrot, le succès de l'entreprise tenait, en grande partie, à la rapidité de son exécution. Il fallait agir sur les esprits, les étonner, et, surtout, ne pas donner à la résistance le temps de s'organiser[94]. Il le fallait d'autant plus que l'opinion française attendait beaucoup de l'expédition, au point d'escompter que la seule présence des troupes à Civita-Vecchia concilierait tout ; elles éclaireraient à la fois le pape et son peuple ; un miracle devait s'opérer ; le drapeau français remplaçait la Sainte Ampoule. Pie IX publierait même un manifeste libéral, accordant pleine amnistie et sécurité, et ses sujets, pleins de confiance dans les promesses d'amélioration gouvernementale, libres encore, mais repentis, se jetteraient aux pieds de leur maître, que l'armée expéditionnaire encadrerait, néanmoins, pour plus de sûreté. Afin de décider le Saint-Siège à manifester ses sentiments
libéraux, M. Drouyn de Lhuys avait donné de nombreuses instructions à MM.
d'Harcourt et de Rayneval. Il leur indiquait notamment : Le pape n'est pas seulement le chef d'un gouvernement de
troisième ordre, il est encore, il est surtout le chef de l'Eglise catholique
; ces deux titres ne sont pas unis en lui par le pur effet du hasard. Sa
souveraineté temporelle, construite en quelque sorte pièce à pièce, dans le
cours des siècles, moins par les moyens ordinaires qui fondent les Etats que
par la politique et par la générosité des princes et des peuples dévoués au
catholicisme, lui a été donnée précisément pour le mettre en mesure d'exercer
son autorité spirituelle avec cette haute indépendance, cette dignité, qui, seules,
peuvent la rendre efficace ; renverser cette base, c'est porter une atteinte
sérieuse à une institution dont toutes les nations catholiques ont le droit
de revendiquer l'intégrité, parce qu'elle est la clef de voûte de leur
religion... Nous ne prétendons pas que le peuple des États de l'Église ait le
devoir de se sacrifier à l'intérêt des autres peuples... Ce que nous disons,
c'est qu'il faut concilier ces intérêts également respectables, ce qui ne
permet pas d'abandonner aux passions d'une seule des parties intéressées la
solution des questions qui y sont engagées, d'où il résulte qu'invoquer en
cette circonstance le principe de la non-intervention, ce serait en faire une
application erronée. Il faut que le pape soit rétabli dans l'indépendance et
le degré qui lui sont absolument nécessaires pour le libre accomplissement de
ses devoirs spirituels ; c'est là ce que le catholicisme tout entier, ce que
le monde civilisé a le droit d'exiger ; il faut en même temps que les
populations des États de l'Église soient mises à Vabri du détestable régime
qui a été la cause première de toutes les calamités de ces derniers temps...
La France ne pourrait accorder son concours à aucune combinaison qui, en
restaurant le pouvoir du Saint-Siège, ne contiendrait pas en faveur du peuple
romain des garanties de liberté raisonnable, de bonne administration et de
clémence... Le cardinal (Antonelli) comprendra que, pour se mettre en mesure
de tirer parti de l'expédition, le pape devra se hâter de publier un
manifeste qui, en garantissant au peuple des institutions libérales, pût
rendre impossible toute résistance. Ce manifeste sera le signal d'une
réconciliation dont un petit nombre de mécontents seront seuls exclus. Vous
ne sauriez trop insister sur l'utilité et même la nécessité d'un tel
document. Ce que nous voulons, c'est que le pape, en rentrant dans Rome,
puisse se trouver dans une condition acceptable pour lui comme pour son
peuple, qui rassure l'Europe comme l'Italie, contre les nouvelles commotions[95]. Le 18 avril, il
expliquait à nouveau ses espoirs, ceux du gouvernement : Nous avons cru, nous croyons plus que jamais que, par la
force des choses, par suite de la disposition naturelle des esprits, le
régime qu'a fondé à Rome la révolution du mois de novembre dernier est
destiné à succomber bientôt, que le peuple romain, avec empressement, se
replacera sous l'autorité du souverain pontife et que Pie IX, en rentrant
dans ses États, y rapportera la politique éclairée, libérale dont il s'est
montré animé[96]. Ces documents,
— qui seront encore appuyés par d'autres plus loin, — ne laissent pas de
doute sur l'illusion française, entretenue par nos attachés, désireux de
faire leur cour à leurs chefs. Le cardinal Antonelli, quoi qu'en ait pensé ou
dit M. Emile Ollivier[97], influençait le
Saint-Père, entretenait ses craintes, exagérait son irritation, résolument
opposé à toute réforme ; il combattait même dans l'esprit de son chef le
prestige qu'exerçaient sur lui les forces françaises et ses idées sur les
sentiments catholiques de la fille aînée de l'Église. Nos agents, MM.
d'Harcourt et de Rayneval, ne convenaient pas à la situation. Ils
appartenaient à ce personnel instinctivement arrêté sur toute forme établie,
préféré par la monarchie de Juillet à son déclin, en dépit de quelques
velléités libérales, si restreintes, d'ailleurs, que la liberté s'y alliait
sans combat, par un penchant irrésistible, avec son contraire. Ils ne
croyaient pas à l'avenir, niaient les nouveaux pouvoirs, jugeaient la
République romaine criminelle et, très catholiques, ne discutaient pas au
fond de leur conscience la nécessité du temporel. Ils avaient besoin de la faveur papale et subordonnaient les débats mêmes à celle-ci. Leur patriotisme, restreint au cadre étroit de leurs sentiments catholiques, — et non chrétiens, — discipliné, éliminé, diminué, autorisé par ceux-ci, les ancrait encore plus loin du réel sol national. D'Harcourt, de plus, n'avait aucun caractère, et appartenait d'avance à qui saurait s'en servir[98]. Rayneval était l'incarnation du Journal des Débats. Tout concourait ainsi pour que les tendances véritables de la France fussent reléguées au second plan[99]. — Une lettre du duc d'Harcourt, du 13 avril, qui rapporte au ministre l'essentiel d'un entretien avec le pontife, découvre les sentiments de ces messieurs, la facilité comme la difficulté de leur situation, les mauvais services qu'ils rendaient au gouvernement[100]. C'est une grave difficulté, ai-je dit au Saint-Père, pour nous républicains, nés d'une révolution, d'aller détruire ailleurs une république : c'était pour échapper à ce que cette situation avait de difficile que nous l'avions prié de venir en France. Si là, le pape avait déclaré qu'il tenait d'elle le patrimoine de Saint-Pierre et la sollicitait de lui en maintenir la possession, il n'y a pas un gouvernement français qui n'eût pensé que l'honneur national était engagé à répondre à un semblable appel. La religion y aurait gagné en associant son sort et sa fortune à celle de trente-quatre millions de catholiques qui se seraient trouvés engagés d'honneur à rétablir leur chef dans sa dignité et ses droits. Après une telle démarche, on n'aurait rien pu refuser au pape en France... Le pape ne veut pas, ou veut être restauré sans conditions. Vous déciderez dans votre sagesse. Venir pour notre compte serait, semble-t-il, le parti le plus net. J'ai lieu de croire qu'il n'y aurait à Rome aucune résistance ; mais restaurer le pape lui serait assez difficile. La papauté voudrait nous faire intervenir avec l'Autriche. Au reste, tous les inconvénients de ce parti existent principalement chez nous, et si l'on croit pouvoir faire avaler celte couleuvre à la France et aux Chambres, sans leur donner des hauts de cœur, les difficultés qu'on trouve ici seront faciles à surmonter. — Il faut pourtant défendre les couvents et les prêtres à Rome[101]. — En somme, il y avait accord entre les deux représentants et le ministre des Affaires étrangères ; ils étaient trois à aimer mieux un mauvais pape que pas de pape du tout ; le pape indispensable était la base de leurs efforts ; et ils avaient reconnu qu'ils devaient se contenter, sinon d'un mauvais pape, ce qu'ils n'auraient su s'avouer, du moins d'un pape tout différent de celui qu'ils avaient espéré et qu'il avait permis d'escompter lui-même. Le 20 avril, l'ancien évêque d'Imola, de plus en plus transformé, prononça dans un consistoire une allocution qui ne laissait plus de doute sur la manière dont il entendait le libéralisme, et que l'assistance jugea excellente, selon ses vœux. A l'examen, il n'en subsiste guère que des menaces, des plaintes ou des bénédictions, et cette assurance formelle que la foi du Christ, sans plus, pourvoit admirablement au bien public et à l'ordre de la société civile[102]. Pie IX se donnait l'air d'avouer, mais avec insistance, sa préférence pour l'Autriche. La Ville Éternelle était avertie du bonheur que lui vaudrait le retour de son maître. Notre premier soin sera de jeter la lumière de l'éternelle vérité sur les erreurs, les rases et les grandes fraudes des impies, afin que les hommes connaissent les fruits funestes des erreurs et des vices. Rome était devenue, en effet, une forêt pleine de monstres frémissants. L'illusion demeurait-elle possible au sujet de Pie IX ? Au lieu du manifeste qui devait ouvrir Rome à Oudinot, Pie IX faisait, quatre jours avant l'arrivée de l'expédition, des déclarations directement contraires à celles que le gouvernement français attendait de lui. Il condamnait par avance à un échec cette médiation dont il ne voulait pas. Mais il fit plus encore. Le roi Ferdinand II de Naples avait mis à la disposition du Saint-Siège l'armée qui venait d'étouffer la révolte de Sicile, et il attendait l'instant propice pour marcher sur Rome. Peut-être Antonelli, prévenu qu'une expédition française approchait, pensa-t-il à ce moment qu'il n'y avait aucune raison de soutenir davantage les troupes napolitaines. Il est plus vraisemblable qu'il chercha à contrecarrer les plans du gouvernement français et que, pour le brouiller avec la population de Rome, il fit en sorte que les troupes parussent agir de concert avec les armées de la croisade. C'est pourquoi le roi de Naples, réunissant ses troupes depuis longtemps répandues le long de la frontière des États de la République, en prit lui-même le commandement, et se mit en marche sur Rome dans les journées du 23 et du 24 avril. En même temps les Autrichiens s'avançaient par Ferrare et Modène, ayant avec eux Monsignor Badini, délégué de la cour pontificale[103]. MM. d'Harcourt et de Rayneval espéraient cependant encore assez dans le manifeste indispensable pour en réclamer la rédaction. Le pape refusa, — si c'était un refus que cette réponse bienveillante : Soyez tranquille ! Pie IX sera Pie IX. Mais ma vieille expérience ne doit-elle servir de rien ?[104] Et il ajoutait, non sans finesse : Ne faudra-t-il pas museler la presse, fermer les clubs, comme vous avez été forcés de le faire en France ? — Il y avait également accord entre les catholiques français et le Saint-Père[105] ; il s'établissait si bien que le chef du corps expéditionnaire, le général Oudinot, était un ami personnel de M. de Falloux. Le décret du président de la République qui l'avait appelé au commandement offrait une matière favorable à la surprise et dont se servirent les feuilles de gauche pour des commentaires légitimes. Oudinot ne possédait pas les titres nécessaires à justifier sa nouvelle position. Officier de cavalerie qui n'avait commandé que quelques mois des régiments d'infanterie, malgré ses campagnes en Algérie, et qu'il se fût fait remarquer par le souci de certains détails à l'armée des Alpes, il ne possédait pas les qualités requises au commandement de troupes ainsi qu'aux opérations d'un siège. Du côté présidentiel et ministériel, la presque certitude de ne pas rencontrer de résistance ou, tout au moins, de résistance sérieuse sert à expliquer la faute ; du côté de Falloux, le calcul opposé en faisait une victoire anticipée. Louis-Napoléon, de plus, en cédant aux insistances du ministre de l'Instruction publique et des Cultes, tout en escomptant un débarquement pacifique et en pensant le faire sans inconvénient pour sa diplomatie personnelle, donnait satisfaction au parti catholique. Le seul bon calcul fut celui des amis de l'abbé Dupanloup. La mission du général en chef à la fois politique et militaire, principalement politique, était rendue encore plus compliquée par les instructions de Drouyn de Lhuys, qui nécessitaient un tacticien fort au courant des subtilités politiques et internationales, et Oudinot classé à la Chambre sous Louis-Philippe parmi les opposants les plus ordinaires et subordonnés, n'était pas l'ouvrier d'une pareille tâche. Général, disait le ministre des Affaires étrangères, je vous ai fait connaître l'objet de l'expédition dont le gouvernement de la République vous a confié le commandement. Vous savez qu'une réaction intérieure et une intervention étrangère menacent le gouvernement actuel de Rome que nous n'avons jamais reconnu. A l'approche de cette crise désormais inévitable, le devoir nous prescrit de prendre les mesures nécessaires, tant pour maintenir notre part d'influence dans les affaires de la péninsule italienne que pour ménager dans les États romains le rétablissement d'un ordre de choses régulier sur des bases conformes aux intérêts et aux droits légitimes de la population. Bien que vous n'ayez pas à intervenir sur les négociations définitives qui assureront ce résultat, vous êtes autorisé à recevoir des autorités établies toutes les propositions et à conclure avec eux tous les arrangements qui vous paraîtront propres à le préparer, en évitant seulement dans la forme de cet arrangement tout ce qu'on pourrait interpréter comme la reconnaissance du pouvoir d'où émanent ces autorités. Vous trouverez ci-joint le projet de la lettre que vous devez écrire, en arrivant, au gouverneur ou au magistrat supérieur de Civita-Vecchia, pour demander votre admission dans cette ville. L'entrée ne vous en sera sans doute pas refusée ; toutes les informations qui nous parviennent donnent lieu de penser que, bien loin de là, vous serez reçu avec empressement par les uns comme un libérateur, par les autres comme un médiateur contre les dangers d'une réaction... Si, cependant, contre toute vraisemblance, on prétendait vous interdire l'entrée de Civita-Vecchia, vous ne devriez pas vous arrêter à la résistance qu'on vous opposerait au nom d'un gouvernement que personne en Europe n'a reconnu[106] et qui ne se maintient à Rome que contre le vœu de l'immense majorité des populations... Une fois sur le territoire des États de l'Église, vous vous empresseriez de vous mettre en relations avec MM. d'Harcourt et de Rayneval, chargés par le gouvernement de la République de traiter à Gaëte les intérêts de la mission qui vous est confiée. Vous pourrez dès lors vous concerter avec eux, et d'après les informations qu'ils seront en mesure de vous transmettre, voir les dispositions que vous aurez à prendre. Vous enverrez à Rome un de vos officiers avec l'ordre de déclarer aux chefs du gouvernement la nature de la mission qui vous est confiée, de leur faire entendre bien nettement que vous n'êtes nullement autorisé à soutenir l'ordre des choses dont ils sont les représentants, et de les presser de prêter les mains à des arrangements qui puissent préserver le pays de la crise terrible dont il est menacé. Vous jugerez si les circonstances sont telles que vous puissiez vous y rendre avec la certitude, non seulement de n'y pas rencontrer de résistance sérieuse, mais d'y être assez bien accueilli pour qu'il soit évident qu'en y entrant vous répondrez à un appel de la population. Partout où vous vous trouverez, jusqu'au moment où un gouvernement régulier aura remplacé celui qui pèse actuellement sur les Etats de l'Église[107], vous pourrez, selon que vous le jugerez nécessaire ou convenable, soit maintenir les autorités civiles en tant qu'elles consentiront à se restreindre à une action municipale et de police, et qu'elles ne vous susciteront aucun péril ni embarras réel, soit favoriser le rétablissement de celles qui étaient en fonctions, soit même en établir de nouvelles, en évitant, autant que possible, d'intervenir directement dans ces changements et en vous bornant à provoquer, à encourager l'expression de la partie honnête de la population. Vous pourrez vous servir, quand vous le jugerez à propos, pour les communications avec ces autorités, de l'intermédiaire du consul de France à Civita-Vecchia, que je mets à votre disposition. Telles sont, Général, les seules instructions que je puis vous donner dans ce moment. Votre bon jugement suppléera suivant les circonstances, et je ne manquerai pas, d'ailleurs, de vous faire parvenir successivement les directions nouvelles qu'elles pourront exiger. Je joins à cette dépêche le texte d'une proclamation que vous voudrez bien publier aussitôt après votre débarquement. — Les instructions ressemblaient à tout ce qui avait émané jusqu'à présent du ministère ; il fallait lire entre les lignes, puis interpréter cette découverte selon les circonstances ; elles trahissaient la volonté bien arrêtée d'en finir avec la République romaine, et n'osaient pas l'exprimer ouvertement ; elles poussaient et retenaient tout à la fois le général ; elles lui traçaient une conduite timide et fausse ; elles faisaient de lui une sorte d'agent provocateur en lui disant d'encourager les honnêtes gens à faire une contre-révolution ou en lui recommandant en même temps de ne s'avancer qu'autant qu'il paraîtrait appelé[108]. On indiquait aussi au général que le pouvoir n'était pas dans les mains des honnêtes gens. Ces instructions répondaient surtout à la pensée de Drouyn de Lhuys, plus qu'à celle de Passy ou même d'Odilon Barrot. Ce ne fut pas sans quelque surprise, dit celui-ci, qu'à la lecture de l'instruction de Drouyn de Lhuys, je vis qu'il avait plutôt traduit sa pensée et celle de la partie du conseil qui faisait du rétablissement du pape le principal objet de l'expédition que celle que j'avais examinée dans l'Assemblée... Il n'y avait sans doute qu'une nuance, mais cette nuance suffirait pour que l'instruction pût être en désaccord avec nos paroles à l'Assemblée[109]. Le texte de Drouyn de Lhuys n'avait pas été délibéré au conseil ; seul, celui du ministre de la Guerre, qui indiquait simplement d'occuper Civita-Vecchia, puis d'y attendre des ordres nouveaux, avait été lu et, n'ayant pas agréé à ceux des membres du cabinet qui marchaient dans les traces de Falloux, il fut remplacé par un renvoi aux ordres du ministre des Affaires étrangères. Barrot raconte s'être méfié. Il avait été, en effet, convenu dans le conseil que les instructions données au général seraient la traduction fidèle des pensées exprimées à l'Assemblée ; mais après la séance du 16 avril, qui s'était prolongée dans la nuit, il vint au président du conseil un remords ou un pressentiment[110], et il se rendit, malgré la nuit avancée, au ministère des Affaires étrangères pour y prendre communication des textes. Drouyn de Lhuys s'était retiré, et un veilleur de nuit, seul, était là[111]. Les instructions partirent sans qu'il en eût connaissance, emportées le lendemain matin même parle prince de la Tour d'Auvergne, secrétaire de la légation et attaché à Oudinot pour le temps de l'expédition[112]. Le 20 avril, Oudinot arrivait à Marseille et publiait un
ordre du jour tendant à prouver qu'à ce moment le général, à moins qu'il
n'ait encore été conseillé sur ce point, évitait de se compromettre ; lui
aussi acceptait le vague officiel. Soldats, le
gouvernement, résolu à maintenir partout notre ancienne et légitime
influence, n'a pas voulu que les destinées du peuple italien puissent être à
la merci d'une puissance étrangère ou d'un parti en minorité. Il nous confie
le drapeau de la France pour le planter sur le territoire romain, comme un
éclatant témoignage de nos sympathies... Vous prendrez en toute occasion pour
règle de conduite les principes d'une haute moralité ; par vos armes, par vos
exemples, vous ferez respecter la dignité des peuples. L'Italie vous devra
ainsi ce que la France a su conquérir par elle-même, l'ordre dans la liberté.
L'expédition comprenait trois brigades d'infanterie représentant un effectif
d'environ douze mille hommes, de dix-huit bouches à feu et de deux cent
cinquante chevaux, ainsi que seize pièces de siège, et deux compagnies de
génie. Deux convois différents devaient transporter les troupes ; le premier
comprenant le Labrador, l'Orénoque, l'Albatros, le Christophe
Colomb, le Panama, et deux corvettes à vapeur, le Véloce et
l'Infernal, commandés par l'amiral Tréhouart. Tous les vaisseaux de
l'escadrille quittèrent Marseille dans la nuit du 21 avril et dans la matinée
du 22. Le 24, devançant le reste de l'expédition, le Panama arriva devant
Civita-Vecchia, portant M. Espivent de la Villeboisnet, aide de camp du
général en chef, et M. de la Tour d'Auvergne, secrétaire de la légation.
Reçus à l'hôtel de ville par le préfet M. Manucci, ils le rassurèrent sur les
intentions de la France. Le commandant Espivent remit une lettre du général
Oudinot, rédigée d'avance au ministère des Affaires étrangères : M. le gouverneur, le gouvernement de la République
française, désirant, dans sa sincère bienveillance pour les populations
romaines, mettre un terme à la situation dans laquelle elles gémissent
depuis, plusieurs mois et faciliter l'établissement d'un ordre de choses
également éloigné de l'anarchie de ces derniers temps et des abus invétérés
qui, avant l'avènement de Pie IX, désolaient les États de l'Église, a résolu
d'envoyer à cet effet à Civita-Vecchia un corps de troupes dont il m'a confié
le commandement. Je vous prie de bien vouloir donner les ordres nécessaires
pour que les troupes, en mettant pied à terre, au moment même de leur
arrivée, ainsi que cela m'a été prescrit, soient reçues et installées comme
il convient à des alliés, appelés dans votre pays par des intentions aussi
amicales. M. Manucci, bien que sincère dans son dévouement à la République romaine, hésita devant un texte qui permettait aussi bien toutes les interprétations. Il lui était impossible de s'opposer au débarquement, d'autant qu'il n'avait aucun ordre à ce sujet ; il croyait commettre une faute en accueillant les Français comme en repoussant des alliés ; en face d'une responsabilité pareille, si grave en elle-même, et plus par ses conséquences, il se tourna vers le conseil municipal, oubliant peut-être que celui-ci se montrerait avant tout pacifique. Son principal objectif fut, en effet, d'éviter jusqu'à l'éventualité du bombardement. Le commandant Espivent, vite renseigné, étendit la déclaration précédente avec les assurances les plus inexactes. Le gouvernement de la République française, toujours animé d'un esprit très libéral, déclare vouloir respecter le vœu de la majorité des populations romaines et vient sur ce territoire amicalement, dans le but de maintenir sa légitime influence. Il est, de plus, bien décidé à ne pas vouloir imposer à ces populations aucune forme de gouvernement qui ne serait pas choisie par elles. Pour ce qui concerne le gouvernement de Civita-Vecchia, il sera conservé dans toutes ses attributions, et le gouvernement, pourvoira à l'augmentation des dépenses occasionnées par le corps expéditionnaire. Toutes les denrées et toutes les réquisitions qui seront faites pour les besoins des troupes françaises seront payées en argent comptant. La municipalité fut conquise et le préfet se retira derrière elle pour accepter en son nom : Civita-Vecchia déclarait se fier à la loyauté de la France. Le préfet disait à la fin de son manifeste : Notre population vous bénira vous et votre armée si vous êtes pour nous des frères qui nous secourrez aux jours de l'adversité... Recevez l'affectueuse bienvenue que, par notre bouche, vous offre une population confiante dans la noblesse et l'honneur de la nation française. Vive la République française et Dieu sauve la République romaine ! Cette dernière invocation ne révélait peut-être pas une grande confiance dans la République de Mazzini. Le 25, les troupes débarquèrent. La population fut sympathique. Le lendemain, Oudinot publia une nouvelle proclamation également rédigée d'avance par Drouyn de Lhuys[113], et il télégraphia au ministre : Toutes les mesures étaient prises pour un débarquement de vive force ou pour un siège en règle de la place. Le conseil de guerre de Civita-Vecchia a écouté les conseils de la prudence, et nous ne saurions trop nous en louer au point de vue de l'humanité. L'Assemblée romaine qui avait ordonné au gouverneur de Civita-Vecchia de résister[114], m'a envoyé le ministre des Affaires étrangères avec une protestation contre ce qu'elle appelle une invasion ; l'espèce de menace dont le document est empreint n'a pas lieu de m'effrayer. Je fais au contraire partir pour Rome avec M. Saffi (le ministre romain), le capitaine Fabar, mon officier d'ordonnance ; il déclarera à l'Assemblée (elle est en séance depuis trois jours) que je suis résolu à entrer à Rome, en ami ou en ennemi... J'ai besoin d'avoir très promptement pour réserve les troupes de la troisième brigade ; le dénuement complet de cavalerie me fait grand défaut. Toutefois je me rends garant que le drapeau français sera porté d'une main ferme dans les États romains[115]. Comment croire qu'Oudinot eut jamais la pensée que sa mission fût purement pacifique ? Le 25, il envoyait aussi à Gaëte le commandant Espivent de la Villeboisnet pour y présenter le déférent hommage du corps expéditionnaire. Introduit par d'Harcourt, il annonça au Saint-Père l'arrivée de l'expédition. Pie IX s'écria de suite : Je l'avais dit. Malgré ses utopies, la France était prête à défendre le Saint-Siège, à dépenser pour lui son sang et ses millions. Il fallait être Odilon Barrot pour s'illusionner sur l'envoi d'un matériel de siège. Peu de temps après, un délégué du pape se présenta auprès du général en chef afin de prendre possession de Civita-Vecchia. Oudinot n'osa pas ne pas reconduire. Il était encore trop tôt. Le doute s'éloignait des volontés les plus entêtées dans
leur erreur comme des plus conciliantes. A R.ome, dès le début, la méfiance
se manifesta. La protestation envoyée à Oudinot avait été rédigée par
l'Assemblée constituante dans une séance de nuit, et le ministre des affaires
étrangères avait reçu l'ordre de la porter immédiatement. L'Assemblée romaine, disait-elle, émue de la menace d'invasion du territoire de la
République, convaincue que cette invasion, que n'a pas provoquée sa conduite
à l'égard de l'étranger, que n'a précédée aucune communication du
gouvernement français, excite à l'anarchie un pays qui, tranquille et bien organisé,
se repose sur la conscience de ses droits et sur la concorde de ses citoyens,
qu'elle viole en même temps le droit des gens, les engagements contractés par
la nation française dans sa constitution et les rapports de fraternité qui
devraient naturellement lier les deux républiques, proteste, au nom de Dieu
et du peuple, contre cette invasion inattendue, proclame sa ferme résolution
de résister et rend la France responsable de toutes les conséquences. La
majorité de l'Assemblée et de la population romaine était pour la guerre[116], ce qu'on ne
disait pas toujours à Paris. Avait-on aussi insisté sur l'arrivée à
Civita-Vecchia, le 25 avril, parallèle à celle de la flotte française, de
deux bâtiments italiens[117], qui portaient
un millier de chasseurs lombards au secours de la république péninsulaire ?
Avait-on même compris et reconnu les chasseurs pour de véritables soldats ?
Oudinot. les avait empêchés de débarquer, satisfait par la promesse, — exigée
d'eux, — qu'ils ne pénétreraient pas dans la Ville Éternelle avant le 4 mai.
Ils furent à Rome le 29 avril et ajoutèrent à l'enthousiasme des habitants. Il y avait toujours eu à Rome deux peuples différents,
l'un qui vivait du gouvernement pontifical et lui était dévoué, l'autre qui
se tenait complètement en dehors de la vie politique et administrative de la
cité, race plus rude, fruste, qui, malgré les siècles, était mal habituée à
la domination ecclésiastique. Seule, cette dernière faction était alors
agissante à Rome, l'autre s'étant enfuie ou terrée. Au premier abord, elle
s'était montrée assez indifférente à la république et l'avait acceptée plutôt
que faite, ayant coutume d'être passive ; mais plusieurs mois d'agitation
politique, le bonheur d'être délivrés de l'administration des prêtres, les
menaces de l'Autriche et de Naples, les colères de la cour de Gaëte, et,
enfin, les paroles enflammées de Mazzini lui avaient donné le goût de
l'indépendance. Sans doute, il y avait des désordres à Rome, mais c'étaient
des méfaits isolés, et on ne pouvait en somme reprocher au gouvernement que
de n'être pas assez fort pour les prévenir, et, quelquefois, pour les
réprimer. La liberté était réelle ; la population s'y attachait d'autant plus
qu'elle la voyait en plus grand danger[118]. Mazzini, sans
douter de la défaite générale, — de la sienne et de celle de la République, —
utilisa ces dispositions. Sa foi le conduisait à vouloir implanter la
religion de Rome capitale, par conséquent, à combattre une diplomatie trop
habile, et par l'art de la capitulation, à diminuer celle-ci. J'avais plusieurs raisons, a-t-il raconté[119], de préférer la guerre ; parmi elles, il en était une qui
se liait pour moi intimement à ce qui avait été le but de toute ma vie, la
fondation de l'unité nationale. A Rome était le centre naturel de l'Italie ;
or les Italiens avaient perdu la religion de Rome. Il était nécessaire d'y
remédier et de la placer très haut, de façon que les Italiens la
considérassent comme le temple de la patrie commune... La lutte fut donc
choisie par l'Assemblée par générosité de sentiments et par respect pour
l'honneur de l'Italie ; et elle fut choisie par moi comme conséquence logique
d'un dessein que j'avais identifié avec moi-même. A côté de Mazzini,
Armellini et Saffi, ainsi que Mamiani eussent souhaité volontiers de trouver
le joint pouvant empêcher l'effusion du sang. Une dernière chance persistait
et offerte, même au point où en étaient arrivées les choses, par la
République romaine. Il est vrai que la République française ou, du moins,
ceux qui la représentaient, n'en voulaient à aucun prix. Parmi ses instructions, Oudinot comptait celle d'envoyer à Rome un de ses officiers pour y déclarer aux chefs du gouvernement la nature de la mission qui lui était confiée ; il devait leur dire qu'il n'était pas autorisé à soutenir l'ordre des choses qu'ils dirigeaient et les presser d'aider aux arrangements qui puissent préserver leur pays de la crise terrible dont il apparaissait menacé. — Le général, méditant devant la suite des instructions qui lui avaient été remises, ne pouvait guère douter qu'il n'y eût trois politiques en présence, celle que l'on racontait au Parlement, et qui n'avait d'autre utilité que de cacher celle poursuivie par le ministre des Affaires étrangères, puis celle que Falloux, son ami, lui avait insufflée plus particulièrement. Il était inutile de lire entre les lignes pour comprendre qu'il fallait prendre R.ome, et il y était trop résolu lui-même, déjà, pour en douter. Le jour du débarquement, il envoya un de ses officiers, le colonel Leblanc, qui entra le soir, à onze heures, dans la Ville Éternelle, et se rendit aussitôt chez le secrétaire de la légation française, M. Forbin Janson. Celui-ci le vit arriver avec plaisir. Pris entre les plaintes de ses compatriotes, celles des prêtres et des moines, il s'épuisait, sans même obtenir de résultat, à constituer cet insaisissable parti modéré tellement réclamé à Paris qu'on y finissait par croire à son existence. La conquête de Rome était dans ses idées, il n'eut aucune peine à s'entendre avec l'envoyé d'Oudinot ; il pensait l'action militaire supérieure à tous les raisonnements et qu'elle ramènerait au pape les sympathies. Ici encore, nous allons voir un officier brusquer les choses, soit complicité, soit maladresse inconsciente. Vers minuit, Forbin-Janson présenta le lieutenant-colonel aux triumvirs. Armellini était absent. Leblanc expliqua que le but de la France était de prévenir les desseins de l'Autriche. Saffi gardait le silence. Mazzini réfuta ce début, en s'efforçant de démontrer que la menace de l'intervention autrichienne demeurait sans fondements. Et comme Leblanc ripostait que la France voulait réconcilier les Romains et le pape, le dictateur prouva que ce refus venait de Pie IX. L'officier, peu préparé à se rendre compte de la valeur de l'homme dont il ne savait pas réfuter les démentis, laissa voir le peu de cas qu'il faisait de la république romaine. Agacé, blessé dans son arrogance naturelle, il ne sut pas se contenir quand Mazzini le pria de lui signifier nettement les intentions françaises véritables et répondit qu'elles consistaient dans le rétablissement du pape[120]. On avouait ainsi, tout net, à Rome, ce qu'on avait dissimulé le plus longtemps possible à Paris, ce que l'on y démentait encore. Tout fut rompu ; et il n'y avait plus à demander, comme l'avait fait l'officier, si ses compatriotes seraient reçus en amis ou en ennemis ; il n'y avait que des adversaires. Leblanc écrivit aussitôt à Oudinot. Toutefois, Forbin-Janson, lié avec Armellini, continuait de certifier que la résistance serait nulle. — On pouvait cependant, déjà, le jour même où il l'écrivait, assurer du contraire. La nouvelle ayant été répandue de l'approche des troupes napolitaines, la foule manifesta et vint se masser autour de la salle des séances de l'assemblée. Mazzini y rendait compte de son entretien avec l'envoyé de l'ennemi. Et c'est alors que la majorité décida d'opposer la force à la force. Quand elle sut la résistance décidée, la foule applaudit. — Tout pouvait n'être pas encore perdu. Le même jour, Oudinot discutait pour la seconde fois avec les deux délégués de l'Assemblée romaine, MM. Pescantini et Rusconi, qui se montraient l'un et l'autre favorables à notre intervention. Le général, sans grande sincérité, leur répétait qu'il n'était pas venu pour détruire les institutions et la liberté des Romains, mais pour les aider, et il s'étonnait d'être accueilli avec froideur. Il ne cachait pourtant pas qu'il était résolu à entrer à Rome de force, si les autorités l'y contraignaient. Comment expliquer un aussi curieux garant d'amitié que son matériel de siège ? — Rusconi, malgré tout, se retira plutôt satisfait[121], accompagné d'un officier d'Oudinot, le capitaine Fabar, qui fut également reçu par les triumvirs. Plus adroit que Leblanc, il sut faire apercevoir les bénéfices que les dictateurs retiraient de la conciliation ; il préconisait comme terrain d'entente certaines concessions à la papauté. La République romaine a deux voies à suivre, indiquait-il, celle des protocoles ou celle des armes ; peut-elle hésiter dans son choix ? Mazzini fut atteint. Rusconi se déclara fortement pour les protocoles, habile à faire valoir les négociations poursuivies d'année en année, comme cela était arrivé pour la Belgique et la Hollande. Armellini et Saffi penchaient aussi de ce côté. Mazzini, après s'être longtemps tu, déclara que la France avait peut-être des desseins cachés et que le mieux serait de s'en remettre à l'Assemblée souveraine. La Constituante se réunit en hâte, de nuit ; et la loyauté du dictateur fut prouvée dans ces circonstances. Troublé comme il l'avait été par les arguments français, il ne se présenta pas, de peur d'influencer les députés par sa présence. Toute sa politique allait être discutée ; en cas d'échec, son rôle nécessairement terminé, il ne lui restait guère qu'à disparaître, et il y avait tout lieu de croire que la majorité, par suite du nouveau terrain de la discussion comme de l'imminence du danger, ne lui serait pas acquise[122]. — Saffi, dès l'ouverture des débats, insista sur la situation changée ; il se porta, en quelque sorte, garant des Français venus dans le seul but d'empêcher l'invasion. Aussitôt les protestations s'élevèrent, profondes, visiblement insurmontables. On veut tâter le pouls à notre République, dit un représentant, et on l'a trouvé sans fièvre. Persistons dans la résolution prise. La majorité, contrairement à ce qu'on avait supposé, avait à ce point le désir de combattre que des concessions réelles d'Oudinot, selon Rusconi, ne l'eussent pas désarmée[123]. Quand le ministre des Affaires étrangères vint rendre compte de son entretien avec le général, il fut écouté froidement, Armellini déclara en vain qu'il obéissait à sa conscience en conseillant de traiter avec la République amie la question pontificale. Il fut interrompu avec rudesse ; on couvrit sa voix, tandis qu'il s'écriait : Il vaut mieux avoir à Rome les républicains français que les Croates et les bombardeurs de Messine. La question de la guerre maintenue définitivement, on se sépara au cri de Vive la République ! Et, de suite, on se prépara au combat avec sincérité. On décida que le Saint-Sacrement serait exposé dans les églises pour implorer Dieu pendant la bataille[124]. L'état de siège fut proclamé, une commission martiale créée. On fortifia les barricades. Le service d'ambulances s'organisa spontanément. Le lendemain, Garibaldi passait les remparts avec douze cents hommes. Le 28, une revue entretenait l'enthousiasme général. Toute réticence devenue, du fait, inutile, le gouvernement afficha de violentes proclamations. Les vœux monastiques cessèrent d'être reconnus par l'État, dans l'espoir de se fournir ainsi des soldats. Une commission de barricades s'employa sans répit. On réquisitionna l'argenterie et les chevaux. Tandis que certains criaient Mort aux Français ! d'autres proposaient de rédiger une adresse à répandre parmi l'armée d'Oudinot afin de lui faire entendre qu'elle ne remplissait pas son véritable devoir[125]. Le 29, arrivèrent les troupes dont nous avons parlé précédemment. Les recrues étrangères, formées des débris des volontaires qui avaient combattu à Novare, c'est-à-dire de tout ce qu'il y avait de plus passionné, de plus fanatique dans le parti dit de la Jeune-Italie, achevèrent d'exalter les passions et l'orgueil de ce peuple romain déjà si disposé à s'exagérer sa force. A partir de ce moment, toute hésitation cessa dans la population ; les plus timides, ceux-là mêmes qui, la veille, nous ouvraient les bras, prirent les armes et coururent ou aux barricades, ou aux remparts[126]. Il ne restait plus qu'à combattre. Coûte que coûte, nécessairement, se réalisait ainsi le plan des cléricaux. Oudinot était excité de toutes parts à marcher sur Rome. Il y penchait de lui-même, nous l'avons vu, autant qu'il était possible, comme catholique, comme militaire, comme l'exécuteur des indications ministérielles. Le Saint-Siège, renseigné au mieux sur sa victoire, sûr de celle-ci, se montrait déjà plus exigeant. Lorsque M. d'Harcourt avait essayé, — le 26, — d'obtenir d'Antonelli, à défaut du fameux manifeste, au moins la promesse d'un traitement meilleur pour les sujets des États romains, le cardinal avait répondu sans plus qu'il serait temps pour Pie IX de faire connaître ses intentions, une fois son pouvoir restauré[127]. Cette demande parut même indiscrète. Et comme rien n'est pire qu'un prêtre victorieux, à Gaëte on affecta d'être irrité contre Oudinot, parce qu'il ne s'était pas présenté au nom du pape à Civita-Vecchia, mais en tant que défenseur des libertés romaines. On criait à l'anathème parce que le drapeau français flottait encore à côté du drapeau romain sur la forteresse. Afin de frapper mieux et de plus vite envenimer tout, on ne cessa d'opposer à nos deux représentants, d'Harcourt et de Rayneval, les visages les plus irrités ; ceux-ci tenant à leur crédit, comme catholiques et comme Français, et ne pouvant concevoir la simple séparation de ces deux qualités, sacrifièrent la politique modérée, et cependant catholique, qu'ils avaient mission défaire prévaloir. Oublieux de leur conscience, de leurs engagements, de leur pays, devenus avant tout serviteurs de la papauté, ils pressèrent Oudinot d'écraser la République romaine[128]. Le général répondit à cette invite, et Rayneval, appuyant encore les courriers précédents, lui écrivait le 27 avril : Je trouve excellente l'idée de marcher sur Rome. Le plus tôt sera le mieux. L'occupation de Rome donnera à la France une attitude digne d'elle. Notre gouvernement parle beaucoup du vœu de la majorité à consulter. Au lieu de cela vous trancheriez immédiatement la question. Je n'y verrais pas grand mal. Il nous semble qu'un gouvernement militaire serait la meilleure des combinaisons. Autrement quels hommes choisir ? Seulement, votre présence à Rome nous semble exiger une attitude très nette en ce qui concerne le pape. Pie IX est à nos yeux le souverain légitime des États romains, c'est au nom de Pie IX, c'est pour lui que nous entrons à Rome. Nous y entrons aussi pour protéger contre une réaction possible la partie saine, modérée de la population. Il est probable que votre présence à Rome, surtout si les intentions de la France à l'égard du pape sont nettement exprimées, déterminera une réaction. — P. S. Je viens de lire la séance de la Chambre. Il me semble que je vous parle dans ma lettre beaucoup plus de Pie IX que ne l'a fait M. Odilon Barrot. Cela ne m'empêche pas de maintenir mon dire[129]. Nous n'allons à Rome ni en conquérants, ni en soutiens de la République romaine. Nous ne pouvons donc y rentrer qu'au nom du pape. Cela dit avec tous les ménagements que vous savez bien mieux que moi[130]. Forbin-Janson, qui pressait aussi le général de se mettre en route, mentait en assurant que la résistance de Mazzini ne se basait pas sur des données sérieuses[131]. Il voulait voir les troupes se présenter au moins à Palo, dès le 27, avec une avant-garde à quatre lieues de Rome. Le père Ventura, prêtre libéral influent, est de cet avis. Si on promet une armistice, les troupes romaines fraterniseront et occuperont les portes conjointement avec les troupes françaises[132]. Rien de plus improbable, bien qu'il assurât encore dans sa dépêche suivante, timbrée de deux heures de l'après-midi, que la garde nationale maintiendrait l'ordre, ne se battrait pas et que les carabiniers désiraient avant tout le retour du Saint-Père. L'ensemble de ses indications était erroné au point que le consul de France à Civita-Vecchia tenait dans le même temps le langage contraire : il prédisait une résistance forcenée et avertissait Drouyn de Lhuys de ses sérieuses inquiétudes[133]. L'équivoque durait plus à Civita-Vecchia. Éclairé enfin sur nos intentions, le peuple laissa voir son irritation, qui apportait une preuve nouvelle aux mensonges de notre diplomatie quand elle représentait les citoyens romains hostiles à la Constituante. Oudinot profita de l'aubaine pour en arriver plus vite à la bataille et proclamer l'état de siège. La garnison fut désarmée, le fort occupé par nos troupes. Le préfet menacé fut mis en prison pour avoir protesté. Il venait d'être décrété d'accusation par le triumvirat pour avoir capitulé. — La France affirmait de plus en plus sa singularité dans sa sympathie envers le peuple romain. Le général en chef poursuivait son projet de se présenter devant Rome[134]. Malgré les prières du consul de Civita-Vecchia, en dépit des avertissements de MM. Rusconi et Pescantini, certifiant l'inexactitude des lettres de MM. Forbin-Janson, Rayneval et d'Harcourt[135], et que notre armée rencontrerait sous les murs célèbres une résistance énergique, sans attendre le retour du lieutenant-colonel Leblanc[136], il marcha en avant le 28[137], dédaigneux de sa réserve et de son parc d'artillerie[138], après avoir fait lire à ses troupes une proclamation dépourvue de vérité[139]. — Le 29, l'expédition campait à Castel-Guido, à 4 lieues de Rome. Le général se montrait confiant parce qu'il n'avait rencontré aucune résistance. Il envoya son fils en reconnaissance, escorté de quelques chasseurs à cheval. Des coups de fusil les accueillirent, deux chasseurs furent démontés et un autre demeura prisonnier. Cette courte lutte ne servit cependant à rien. La confiance du général n'en persistait pas moins[140]. Il se porta en avant. Le 30, il était sous les murs de la ville ; ses troupes s'avançaient en plusieurs colonnes, à découvert. Les soldats pouvaient lire de grands placards qui portaient en grosses lettres l'article 5 de la constitution de la République française : La France respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; elle n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquêtes, et- n'emploie jamais ses armes contre la liberté d'aucun peuple. Il est probable que l'armée ne comprit point et même se moqua ; elle était trop exclusivement de métier pour entendre ce langage[141]. Oudinot était venu sur la rive gauche du Tibre. Rome est défendue, de ce côté, par une enceinte bastionnée percée de cinq portes : la porte Portese, au sud, la Saint-Pancrace, près du Janicule, la porte Cavallegieri et la porte Fabricia, qui aboutissent à la place Saint-Pierre, enfin la porte Angelica, tout à fait au nord ; de l'autre côté, elle ne présentait qu'une simple muraille. Le général marchait donc contre un des points les plus forts de la place ; le plateau sur lequel est construit Saint-Pierre de Rome formait lui-même un des saillants de cette enceinte bastionnée. Telle était la persistance de ses illusions sur la disposition des Romains à notre égard qu'il prit d'abord le tocsin qui, à l'approche de nos soldats, appelait la population romaine aux armes, pour des signes de réjouissance en notre honneur[142]. Deux coups de canon tirés à mitraille le contraignirent à changer d'avis. Une vieille carte de la ville, — car nos états-majors ne semblaient pas mieux montés qu'ils ne le seront en 1870, — indiquait une ouverture dans la partie du bastion qui est en face de l'église de Saint-Pierre. Sans faire même vérifier la carte ni l'endroit, Oudinot lança un bataillon vers l'ouverture supposée. La porte, murée depuis vingt ans, était remplacée par une terrasse de 20 à 30 pieds d'élévation. Décimés dès le début par un feu facile à diriger, nos soldats n'eurent d'autre ressource que de se dissimuler dans un pli de terrain jusqu'à la fin de l'action. Le général dirigea une autre troupe, la brigade Vaillant, sur la porte Angelica, près Ponte-Molle. Mais, au lieu de faire un circuit, cette brigade, pour arriver plus tôt à son but, prit une route directe qui longeait les remparts pendant l'espace d'un mille ; elle se trouva, ainsi exposée, à une portée de 200 mètres environ, au feu de l'artillerie romaine qui, la prenant en flanc et en écharpe, la contraignit à se replier après avoir essuyé des pertes sensibles, entre autres celle du capitaine Fabar[143], celui-là même que le général Oudinot avait envoyé aux Romains en parlementaire ; deux pièces de campagne furent démontées[144]. Du côté de la porte Saint-Pancrace, le bataillon Picard, après avoir repoussé quelques tirailleurs et s'attendant au succès de l'attaque principale, persévéra dans une marche imprudente sans s'apercevoir qu'un corps de volontaires était revenu derrière lui, masqué par l'aqueduc de l'Acqua-Paula qui cache la villa Pamphili. Brusquement, les coups de fusil cessèrent chez les assiégés ; les Français entendirent la Marseillaise sur les remparts. Des drapeaux blancs s'élevèrent. Des hommes crièrent avec des démonstrations d'amitié que la lutte était finie : La paix, la paix, nous sommes frères ! Étant données la foi d'une solution pacifique inculquée au corps expéditionnaire, la certitude que les Romains nous attendaient et, d'autre part, l'invitation enthousiaste d'entrer dans la ville, la confiance des soldats ne fût pas surprenante. De plus, séparé du gros de l'armée et ayant négligé de conserver des communications avec elle, n'entendant pas le canon, le commandant se persuada que le général en chef avait pénétré dans Rome. Il entra donc et à peine le dernier soldat eut-il passé la porte, qu'elle se referma sur des prisonniers. L'affaire se présentait désormais au mieux des intérêts catholiques : le siège de Rome était certain. Oudinot ne pouvait plus se faire illusion ; l'ennemi s'était défendu avec acharnement ; nous avions perdu beaucoup de monde. Il fallait battre en retraite. Le général revint à Civita-Vecchia et, pendant plus de deux semaines, demeura malade de chagrin, en proie à une forte fièvre. Le soir du désastre, il avait télégraphié laconiquement à Paris : Nous avons trouvé ici une résistance beaucoup plus vive que nous ne pouvions le supposer. Nos troupes se sont battues admirablement. Mais n'ayant aucun matériel de siège et l'ennemi se battant derrière ses murs, il était impossible de l'entamer. Je reste à Castel-Guido, à 10 lieues de Rome. Cette première campagne était le résultat de l'équivoque que l'Assemblée avait répandu à dessein, au moins dans sa majorité, sur la question romaine. La séance du 7 mai le confirma. * * *Après avoir cité la dépêche dans laquelle Oudinot annonce être entré à Civita-Vecchia sans coup férir, Falloux écrit : Personne, alors, ne douta que quarante-huit heures après, une dépêche analogue ne parvînt à Paris, datée de Rome[145]. Tel était, en effet, l'état d'esprit du public. La déception fut très sérieuse. Le gouvernement ou, du moins, le ministère tel que s'imaginait le conduire Odilon Barrot, recevait un coup sensible. Dans d'autres circonstances, cet échec eût été d'une faible importance, mais dans la situation de la France, c'était un très gros événement ; d'une part, il exaltait les Romains et les encourageait à la résistance, de l'autre, il réalisait les prévisions de nos Montagnards, et fournissait un nouveau texte à leurs violentes accusations ; en outre, et jusque sur les bancs des conservateurs, il répandait la douleur et l'humiliation : nous devions donc nous attendre à voir se soulever contre nous les passions qui agissent le plus énergiquement sur les assemblées, le fanatisme et l'orgueil blessés[146]. Le 3 mai, tandis que les journaux annonçaient à Paris la marche d'Oudinot sur Rome et qu'une feuille de droite prétendait même que nous y étions entrés, le bruit d'un échec s'imposa. Aussitôt, presque, le cinq pour cent baissa d'un franc. Des correspondances particulières, venues de Marseille, confirmèrent la nouvelle. Les Montagnards semblaient surtout renseignés. Mieux servis que nous, ils recevaient une masse de lettres de leurs amis et correspondants, lesquels ne manquaient pas d'exagérer notre échec et d'en faire un véritable désastre. Ces lettres circulaient sur tous les bancs : on les lisait avec avidité ; elles donnaient des détails que les uns accueillaient avec tristesse, les autres avec une joie mal dissimulée. Tous s'étonnaient que le gouvernement ne fût pas en mesure de fixer les esprits par une communication officielle[147]. Barrot ajoute qu'il n'avait pas en mains les dépêches nécessaires. Ce fut le 4 mai qu'Oudinot écrivit deux lettres un peu détaillées, datées du quartier général de Palo, l'une à Drouyn de Lhuys, l'autre au ministre de la Guerre ; il ne s'étendait que pour expliquer les raisons de sa confiance, que le ministre des Affaires étrangères connaissait mieux que lui ; il avouait avoir reçu visite d'un nouveau monsignor, porteur de lettres du pape et du cardinal Antonelli ; il avait prié qu'on lui laissât toute liberté d'action. Bien qu'il assurât : N'ayez aucune inquiétude sur le résultat définitif, il reconnaissait que la situation ne se dessinait pas telle qu'elle lui avait été décrite... Les sympathies pour l'ancien gouvernement sont loin d'être ardentes comme on le suppose. On aime Pie IX, mais on redoute très généralement le gouvernement clérical[148]. Le post-scriptum de la dépêche démontrait une fois de plus la bonne volonté du gouvernement romain, circonspect, et plus encore de ne pouvoir l'avouer, devant son succès. Le père Ventura, effrayé de la situation de Rome, vient de quitter cette ville ; en passant à Palo, il a demandé à me voir, de la part des triumvirs. MM. Mazzini, Armellini, Saffi l'avaient chargé de me dire que la journée du 30 n'avait été qu'un malentendu, qu'il était peut-être encore possible de concilier les choses si je consentais à faire une nouvelle déclaration établissant d'une manière nette et précise que la France n'imposerait aucun gouvernement aux Etats romains. J'ai répondu au Père Ventura que je croyais avoir suffisamment fait connaître la pensée de mon gouvernement, pensée toute libérale, qu'après ce qui avait eu lieu, j'avais à coup sûr le droit de me montrer sévère, que j'en usais si peu que j'étais encore prêt à entrer à Rome en ami, comme intermédiaire, entre l'anarchie et le despotisme[149]... Malgré le double jeu que jouaient peut-être à certains moments les triumvirs, fort au courant des dissensions françaises, ces dispositions devaient être vraies. Mazzini avait dit à un officier prisonnier : Vous n'avez rien à craindre, vous pouvez compter sur tous les égards qui vous sont dus ; nos amis de Paris désirent qu'une confraternité commune s'établisse entre nous[150]. La seconde lettre expliquait aussi, plus brièvement, les raisons de la marche en avant et donnait le récit des opérations militaires. Il ne semblait pas qu'Oudinot s'y rendît compte de la situation dont pourtant il avait touché un mot en dépit de ses restrictions au ministre des Affaires étrangères ; son optimisme était extraordinaire. Prêt à recommencer la lutte, il disait la vouloir ; et l'armée fanatisée, furieuse de son échec, toujours incompréhensive, la voulait encore davantage. La cérémonie du 5 mai montrait, à point nommé, l'esprit tout spécial dans lequel était conçue la République dont se célébrait, prétendait-on, l'anniversaire. Aucun curieux perspicace ne s'en étonna ; la fête était à peu près semblable aux cérémonies de l'année précédente, par son côté purement officiel comme par la froideur ou la rareté des assistants. Elle eut lieu aussi place de la Concorde. L'obélisque, tout entouré, ne laissait plus voir que sa pointe ornée d'un bouclier traversé d'une palme ; un autel se dressait à sa base sous un grand velum de drap d'or soutenu par des lances byzantines. Au bas de ses vingt-cinq marches, les statues de la Paix, des Cultes, de la Liberté, de l'Égalité, de la Fraternité. Une armée de colonnes portant les noms des départements et des colonies, cerclait la place. Des pylônes, des mâts vénitiens, des lampadaires, complétaient l'ensemble. Les statues de l'Industrie, des Arts et du Commerce ornaient le pont de la Concorde. — Les troupes apparurent à l'heure fixée dans ce décor un peu carnavalesque, suivies de l'Assemblée nationale, Marrast en tête, tout au souvenir sans doute de cette solennité de 1848, au cours de laquelle il avait eu si froid. Les ministres portaient l'habit de ville, sauf Rulhières en grand uniforme, accompagné des maréchaux de France, Sébastiani et Dode de la Brunerie. Le clergé, — au moins huit cents ecclésiastiques, — arriva processionnellement, croix en tête, sur deux longues files, de l'église de la Madeleine : M. l'archevêque, dit la Patrie, assisté de MM. Duguet et Sibour, ses vicaires généraux, précédé de sa croix, avec la crosse en mains et la mitre, bénissant sur son passage cette armée de baïonnettes et la population qui se pressait de toutes parts aux fenêtres et aux balcons, fermait le cortège religieux. Une fois que l'archevêque, arrivé à l'autel, se fut assis sur un fauteuil faisant face à l'avenue des Champs-Elysées et à l'Arc de Triomphe, le président de la République, escorté de Changarnier, arriva par l'avenue Marigny ; un demi-escadron de dragons et la garde nationale à cheval formaient son escorte. Il descendit de cheval, vint devant l'autel, salua le prélat et s'assit à son tour. Marrast se tenait à sa droite, Boulay de la Meurthe, — vice-président de la République, rappelons-le, — se tenait à sa gauche. Le corps diplomatique, le Conseil d'État, en habit noir, la Cour de cassation, la Cour des comptes, l'Institut, l'Université, la Cour d'appel en robes, le Conseil général de la Seine, le préfet, M. Berger, en habit noir, les maires de Paris, les tribunaux, l'ordre des avocats, les officiers généraux en retraite, l'École Polytechnique, en uniforme, occupaient l'estrade à gauche de l'autel. Le Te Deum, annoncé par cent un coups de canon, fut commencé par l'archevêque. Les chœurs entonnèrent le : Domine salvam fac rempublicam, et la cérémonie se termina par la bénédiction épiscopale, au roulement des tambours. Le clergé, demeuré en colonnes, reprit alors sa marche processionnelle. L'archevêque descendit le premier, suivi du président, et après avoir écouté quelques paroles pleines de dignité[151] de Louis Bonaparte, il se mit en marche, donnant sa bénédiction en traversant cet immense cordon de troupes[152]. — Comment aurait-on pu suivre à Rome une politique différente ? La République comparait cette cérémonie à celles que ses lecteurs regardaient avec curiosité dans les livres de Bernard Picard, qui rapportent les cérémonies religieuses des Peghuans ou des Chinois. Elle y opposait l'ancienne fête de l'Être suprême, selon l'esprit véritablement religieux qui imprégnait les évolutionnistes révolutionnaires de 1848. Après avoir reconnu qu'il fallait à l'homme une religion et flétri le culte de la Raison prôné par Chaumette, auquel se rallia l'évêque de Paris, Godel, abjurateur du catholicisme à la Convention, le rédacteur rappelait : Cet athéisme indigna l'esprit élevé de Robespierre. Dans le club même des Jacobins, il prit enfin la défense de la religion attaquée : — On a dénoncé, s'écria-t-il, des prêtres pour avoir dit la messe ; ils la diront plus longtemps si on les empêche de la dire. Celui qui veut empêcher la messe est plus fanatique que celui qui la dit. Il est des hommes qui veulent aller plus loin, qui, sous prétexte de détruire la religion, veulent faire une religion de l'athéisme même. Et : Cette fête du 18 floréal fut belle et grande. On n'y entendait pas de psalmodies latines que nul ne comprend, pas même ceux qui les chantent, mais on y recueillait des paroles mâles et fières qui expliquaient, faisaient aimer Dieu, la patrie et l'humanité. Comparant la fête d'alors à celle d'aujourd'hui : Celle du 20 frimaire an VI était plus éclatante ; c'était un triomphateur qu'on saluait d'applaudissements frénétiques. Et cependant on ne criait pas encore : Vive Napoléon ! on criait Vive la République ! C'était à cette République que le général en chef de l'armée d'Italie faisait hommage de ses victoires, de ses conquêtes, et la République lui donnait l'ovation que méritaient ses succès. Que n'a-t-il su rester le soldat de la République ? Le vainqueur d'Arcole et de Lodi offrait surtout la reconnaissance des peuples à qui il avait donné la liberté. Bologne, Ferrare, Modène, la Romagne, la Lombardie, Bergame, Mantoue, Crémone, Brescia, etc. saluaient avec amour le nom de la France, leur libératrice... On conçoit ce que ces souvenirs avaient pour nous d'attristant. Quelle antithèse avec ce qui se passe maintenant ! Notre Montenotte à nous, c'est Civita-Vecchia ! Une lithographie de Raffet montrerait bientôt le soldat français, humilié, inconscient, irresponsable et néanmoins portant sur le visage, avec la colère, le sentiment qu'il y avait dans son cas quelque chose d'anormal, injurié par le peuple romain, défendu par deux prêtres. Spectacle à retenir. Il n'y a pas si loin de ce dessin à l'Assemblée qui, au lendemain de la défaite, vouait la France au Sacré-Cœur. * * *Le jour où la première dépêche d'Oudinot parvint à Paris,
le 3 mai, le conseil des ministres s'était réuni, comme chaque matin, à
l'Elysée. Falloux, en entrant dans le salon des séances, vit venir à lui le
prince président : Vous allez être très malheureux,
lui dit-il, et je le suis aussi, mais je crois que
M. Barrot prend le mécompte trop à cœur[153]. Barrot, qui
venait de lire la dépêche, était allongé dans un fauteuil, à moitié évanoui.
— Falloux a conté la scène à sa manière, si pleine d'enseignements : L'accueil du président m'indiquait du moins qu'il se
rendait bien compte de la situation et que je pouvais compter sur lui pour la
faire comprendre à M. Barrot. Je m'employai donc de mon mieux à le tirer de
ce profond désespoir. M. Drouyn de Lhuys ne tarda pas à me venir en aide. M.
Buffet, moins que personne, était homme à reculer et, peu à peu, nous
amenâmes M. Barrot à reconnaître que, sans user nos forces en stériles
gémissements, nous n'avions plus qu'à porter devant l'Assemblée une bonne
contenance et un ferme langage. N'était-il pas, en effet, évident que
l'Autriche était, après notre échec, ce qu'elle était avant, sinon plus
menaçante encore, et qu'une humiliation de nos armes qui ne serait pas
immédiatement réparée serait la double défaite de l'influence française et de
l'esprit libéral en Italie ? — Un thème de
discours se trouvait pour M. Barrot, et c'était là qu'il excellait. Il ne
voyait pas toujours très vite ni très loin, mais il écoutait avec bonne foi
les opinions autres que les siennes et, quand il les avait adoptées, quand,
surtout, il les avait conduites au feu de la tribune, il se les assimilait si
bien qu'il les tenait complètement pour siennes. En plus d'une occasion, ses
mémoires font foi de cet aimable don. Un homme d'État pouvait aisément avoir
plus de pénétration que lui ; aucun n'apportait dans les résolutions prises,
spontanées ou non, plus de courage et plus de loyauté[154]. On s'accorda
vite sur la stérilité des regrets et l'envoi des renforts. Louis-Napoléon,
qui s'était montré très attentif et particulièrement
sensible à tout ce qui concernait l'honneur militaire, ne déguisait
même plus sa conduite ; il avait besoin de l'armée et du clergé et leur
sacrifiait ses préférences personnelles. Au point où nous en sommes, il
semblait, même que ces dernières se fussent évaporées. En attendant de subir l'Assemblée, il fallait renseigner, au moins en apparence, l'opinion publique, de plus en plus inquiète. Comme le rapport détaillé d'Oudinot n'arrivait pas, la nouvelle, qu'on avait primitivement décidé de tenir secrète, ne l'étant plus, une note fut rédigée, ainsi conçue, qui parut dans la Patrie, journal semi-officiel : D'après une dépêche télégraphique parvenue au gouvernement, le général Oudinot se serait mis en marche sur Rome où, suivant tous les renseignements, il était appelé par le vœu des populations ; mais, ayant rencontré de la part des étrangers qui occupent Rome une résistance plus sérieuse qu'il ne s'y attendait, il a pris position à quelque distance de la ville où il attend le reste du corps expéditionnaire. Le mensonge était fleuri à souhait. Porté au journal à six heures, il y parut à sept, et le Moniteur le reproduisit en commençant : On lit dans... Le public, lut, quant à lui, entre les lignes, et l'émotion précédemment signalée augmenta. Il attendait l'après-midi parlementaire. Jules Favre commença l'attaque. Lui, que son adhésion aurait pu faire accuser de connivence, avait plus que quiconque le droit de dresser le réquisitoire. Il ressortait de son discours qu'il aurait été réellement trompé. On peut se demander si une partie de sa colère ne venait pas de son manque de méfiance. ... J'ai été membre et rapporteur de la commission chargée par vous d'examiner la question d'urgence sur le décret voté dans la nuit du 17 au 18 avril, et peut-être ma parole, les rapports que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Assemblée n'ont pas été sans influence sur quelques votes dans cette déplorable affaire. J'ai donc le droit, j'ai le devoir de décharger ma responsabilité. — Il rappelait, — sans pouvoir être interrompu, — l'assurance fournie que l'expédition française ne pouvait avoir pour objet de protéger une forme de gouvernement qui serait repoussée par la population romaine, et donnait cette explication que son rapport était basé sur celte promesse à laquelle il avait cru. Il faisait saisir la trahison. Nous avons été joués, disait-il en désignant le ministère coupable, voué, selon toute justice, à porter la responsabilité de sa faute. Après que cette constatation eut fait rire le préfet de Paris, Favre indiquait que nous avions marché contre Rome au lieu de marcher pour elle, contre les ennemis de la France. Il soulignait le silence du ministère, son embarras, son manque de renseignements. Citant la communication envoyée à la Patrie, il s'écriait : Sommes-nous en 1814 ? Sont-ce les Autrichiens qui ont écrit ce bulletin ? Et face à l'action nécessaire : Vous comprenez tous la position qu'on vous a faite et dont nous devons sortir immédiatement coûte que coûte ; nous ne devons pas y rester une heure sans être déshonorés... Je prends les faits tels qu'ils existent, et ces faits, en voici la moralité et la partie politique : c'est qu'au moment où on nous annonçait à notre tribune qu'on allait en Italie pour protéger la liberté... on ne nous disait pas là vérité. Il maudissait l'arrière-pensée gouvernementale qui avait fait couler le sang de la France. Puis il demandait : Quelle est donc cette cause que vous avez servie ? Pour qui a coulé le sang de nos officiers et de nos généreux soldats ? Pour qui a coulé le sang italien, le sang de cette noble nation aussi pour laquelle vous affectiez les plus généreuses sympathies ? Il a coulé pour le pape, il a coulé pour l'absolutisme. Voilà, aujourd'hui que le voile est déchiré, ce qu'il est impossible de ne pas voir. Il parlait alors selon l'avenir même, semblant prévoir qu'un jour la France serait forcée d'enlever de ses drapeaux une date peu honorable pour elle[155] : Vous avez aventuré les troupes françaises, vous les avez compromises dans une guerre impie, vous avez abaissé, vous avez souillé votre drapeau. Il suppliait l'Assemblée d'arrêter la guerre. Les renforts pouvaient partir pour la sécurité de nos troupes vaincues, mais quelques négociateurs devaient aussi s'entendre au plus vite afin d'arrêter le mal avant qu'il n'en fût plus temps. Un représentant ou plusieurs représentants ne seraient pas déplacés dans cette mission. Il importe que la pensée de la France soit clairement séparée de celle des autres hommes qui ont si désastreusement conduit cette expédition ; il faut que l'Assemblée intervienne pour imposer sa volonté et son autorité. Et puisque cette pensée a été si malheureusement exécutée par le ministère, l'Assemblée ne doit plus avoir confiance qu'en elle-même. C'était s'adresser à un agonisant, et les catholiques le savaient trop pour redouter l'effet de ces paroles. Favre ne voyait cependant de salut que dans le Parlement et à cette heure, en effet, étant donnée l'irritation présidentielle, le salut n'apparaissait possible que là. Prenez un parti ! De grâce, prenez-en un ; que ce parti émane de vous, ne le laissez pas accomplir par d'autres. Les sourires recommençaient lorsqu'il nous représentait comme ayant fait l'œuvre de l'Autriche, mais comment la droite n'aurait-elle pas souri d'un homme qui paraissait convaincu au point de s'écrier : Quant à moi, je déclare, dans ma conviction profonde, si, à l'instant même, en face du pays, en face de Dieu que nous avons outragé par l'effusion impie du sang... Stupéfait devant l'ironie grandissante de la droite : Cette attitude, le sentiment qui l'inspire, je les dénonce au pays. Comment, quand je viens raconter ici la lamentable histoire d'une armée française envoyée sous le drapeau de la liberté et mettant à mort des populations amies qui ont bien le droit de vivre probablement sous le soleil italien, vous ne trouverez pas d'autres protestations dans votre cœur ? Vous riez encore ! Eh bien ; soyez une fois jugés, je n'en demande pas davantage. Quant à moi, Messieurs, je termine en vous disant que dans ma conviction profonde, si cette Assemblée ne proteste pas solennellement, si elle ne prend pas immédiatement un parti de vigueur, c'en est fait de notre influence en Europe... Sous la monarchie française, sous une monarchie qui n'était pas la vôtre, car c'était une monarchie d'honneur et de dignité pour le nom français, sous la monarchie, la France envoyait des soldats en Grèce pour y protéger la liberté ; la France, à une époque plus reculée, envoyait ses hommes sur la terre d'Amérique... Et qu'en faites-vous, vous, de la France ? Vous en faites le gendarme de l'absolutisme ; avec des perfidies et des phrases équivoques, vous déterminez un vote, et ce vote vous en usez pour que le nom de la France soit maudit. La réponse du président du conseil ne pouvait être brillante. Il fit ce qu'il put, mais il fallait devenir malhonnête pour sauver la partie et il ne le savait point. Accuser Drouyn de Lhuys eût équivalu à détruire le ministère et il ne le voulait à aucun prix. Il se retrancha donc derrière la non-réception des dépêches d'Oudinot. Sans se l'avouer, il répugnait assez au rôle qu'on lui faisait jouer et auquel il consentait cependant un peu de lui-même. Je doute, a-t-il dit[156], que jamais le ministère ait passé par de telles angoisses. Lamoricière demandait ensuite au gouvernement : 1° qu'il communiquât à une commission nommée par l'Assemblée les instructions, les dépêches télégraphiques dont les termes ne sont pas littéralement transcrits dans les journaux ; 2° qu'il s'expliquât devant la commission de la question de savoir s'il entend, oui ou non, continuer la lutte contre la République romaine qui ne paraît pas aussi désorganisée qu'on nous l'avait dit. — Flocon, en faisant observer que le gouvernement français était peut-être en ce moment-ci le seul à ne pas savoir ce qui s'était passé à Rome, lisait une lettre officielle datée de Toulon. Cette lettre, terrible pour la droite, suscitait son éternel sourire, et le ministre des Affaires étrangères lui opposait cette unique riposte : Il y a autre chose dans la lettre, il y a que Rome est remplie d'aventuriers étrangers. Amené quand même à s'expliquer davantage, il égrenait les phrases vides obligatoires, un peu plus hautaines que celles d'Odilon Barrot, en se retranchant aussi derrière le manque de nouvelles. Il acceptait toutefois la proposition d'envoyer un agent nouveau à Rome, ainsi que de paraître devant la commission. — Favre disait alors : Je n'ai pas, je pense, à m'excuser auprès de l'Assemblée de la vivacité peut-être passionnée que j'ai mise tout à l'heure dans mes paroles, le fardeau de la responsabilité que je porte est assez lourd. La droite souriait éternellement. Drouyn de Lhuys soupirait : Et la nôtre ! Mais Favre, sans s'émouvoir : Dans le sein de la commission, nous avons cru à la parole ministérielle. Il est évident que M. le ministre des Affaires étrangères, pas plus que le président du conseil, n'a touché à ce point délicat, que la question de la sincérité de cette parole est singulièrement enveloppée dans un nuage par la façon dont les instructions ont été exécutées... Quand vous avez promis que vous n'iriez en Italie que comme pacificateurs, il y a certes entre cette parole et la façon dont elle est comprise une assez désolante contradiction pour que nous ayons le droit de nous émouvoir... Ce serait une méthode assez commode que de prendre pour un acte contraire à la loi tout ce qui aurait pour conséquence de faire connaître la vérité et de faire exécuter les volontés de l'Assemblée... Vous avez entendu M. le ministre des Affaires étrangères et M. le président du Conseil vous dire qu'ils avaient été loyaux dans leurs déclarations : je le crois ; mais, s'ils ont été loyaux, on les a trompés ; si on les a trompés, il faut de deux choses l'une : ou que l'honneur du nom français périsse, ou bien que celui qui a compromis ainsi le nom français reçoive, je ne dirai pas un châtiment... mais qu'il nous rende la satisfaction que demande l'opinion publique... Le ministère ne vous a pas dit, après avoir fait l'éloge de son passé, quelle serait sa conduite à venir, et quant à moi, j'aurais beaucoup mieux aimé, au lieu de toutes les explications louangeuses dans lesquelles est entré M. Barrot, en ce qui le concerne et en ce qui concerne sa politique, qu'il nous dise : Voilà le parti que je prendrai ; je continuerai ou je discontinuerai la lutte commencée. Les faits sont encore cachés. Une commission fut nommée pour prendre connaissance des instructions données à Oudinot, ainsi que de sa correspondance, et il fut décidé qu'elle se réunirait le soir même. — A neuf heures un quart, la séance recommença et l'Assemblée prit note que les rapports lui seraient présentés vers dix heures. — A onze heures moins un quart, M. Sénard, de la gauche très modérée, vint lire son travail ; il avouait : La majorité de la commission a jugé que la direction donnée à l'expédition n'était pas conforme à la pensée dans laquelle elle avait été conçue et acceptée. Les instructions données au général commandant l'expédition nous ont paru s'éloigner des déclarations faites à la tribune par le gouvernement. Il nous a paru s'écarter aussi de ces instructions, puisqu'il a attaqué la République romaine. En conséquence, la commission vous propose la résolution suivante : L'Assemblée nationale invite le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l'expédition d'Italie ne soit pas plus longtemps détournée du but qui lui a été assigné. — Drouyn de Lhuys ne voulant pas permettre que la gauche demandât mieux, ne lui laissa même pas le temps de s'apercevoir que la résolution proposée abandonnait, en définitive, le soin de conclure au ministère, et combattit la proposition. Il commença par lire les instructions confiées au chef du corps expéditionnaire et il s'étonna de la surprise qu'il causait : C'est une honte pour la France ! s'écria, au milieu de l'indignation, le député Brives. Et Drouyn de Lhuys glissait tout doucement : Nous n'avions pas de sympathie pour la République romaine. Il ajoutait : Si le général Oudinot a éprouvé une résistance plus ou moins vive, est-ce une raison pour qu'il ne se croie pas appelé par le vœu des peuples ? Il estimait honteux pour l'armée de reculer et comptait bien que le Parlement ne lui en donnerait pas le conseil. Il comprenait de moins en moins les interruptions. On lui criait : Allons donc ! Vous avez donc perdu le sens moral ? — Odilon Barrot garda le silence. Il connaissait les instructions de son collègue pour la première fois, et sa surprise, qu'il dissimula mal, était extrême. Le ministre des Affaires étrangères se souciait peu de cette critique muette, incertaine d'elle-même, et qui chaque seconde diminuait. Il prit le parti de se glorifier, — à son tour : Vous n'avons rien à changer à notre conduite, rien à rétracter dans nos paroles. — Revenu à la tribune pour défendre son texte, Sénard voulut tout concilier : Nous ne voulons pas formuler une demande qui aurait pour résultat de dicter au gouvernement une résolution difficile, impossible peut-être à exécuter dans un état des faits qui ne nous est pas connu. Ce sont les instructions qui se sont écartées des déclarations sur la foi desquelles nous avons voté l'expédition... Nous proposons une formule qui nous ramènera à ce que l'Assemblée a voulu et qui nous laisse cependant la liberté dont vous avez besoin pour ménager dans tous les cas ce que la dignité de nos armes, ce que l'honneur de la France exigeront pour faire face à des éventualités qui ne sont pas encore connues... Barrot essaya vainement d'arrêter les succès de la gauche. Un amendement de Baraguey d'Hilliers fut repoussé et la résolution proposée par la commission adoptée à une majorité de quatre-vingt-sept suffrages. Toute la république modérée avait voté cette fois avec l'extrême gauche[157]. Au moment où la séance allait être levée, Victor Considérant présentait une proposition tendant à mettre en accusation le président de la République et son ministère et, le lendemain, la proposition était déposée dans un bureau où plusieurs députés se rendirent afin d'y apposer leur signature. Les Débats[158] disaient : Déjà un assez grand nombre avaient signé, mais on assure que plusieurs d'entre eux, mieux avisés, sont allés, ce matin, effacer leurs noms. On dit même que l'auteur, averti de cette sage réserve de ses amis, ne donnera pas suite à sa proposition. Un homme encore assez ignoré, sauf du monde diplomatique et de l'étranger, avait assisté à cette séance du 7 mai, Ferdinand de Lesseps. Les débats l'avaient singulièrement intéressé. La difficulté à résoudre était de celles qui lui plaisaient, à ce point qu'elle l'empêcha de voir, sans doute, que le ministère venait de subir sinon un échec, — l'Assemblée n'était plus assez vivante pour lui en infliger un, — du moins un blâme[159]. * * *Odilon Barrot se pensait si sincèrement indispensable qu'il écrit dans ses Mémoires : Nous aurions pu bien embarrasser M. Sénard et ses amis en donnant notre démission et en rejetant sur eux la responsabilité de l'exécution ou du programme qu'ils nous imposaient. Placés entre l'honneur du drapeau français qui, ils le reconnaissaient eux-mêmes, défendait de rétrograder, et la constitution qui, d'après eux également, interdisait d'avancer contre Rome, qu'auraient-ils pu faire ? Dans des temps ordinaires, nous nous serions donné le plaisir d'une facile vengeance. Mais pouvions-nous, par notre retraite, donner raison à M. Jules Favre et fournir à cette Assemblée expirante l'occasion de ressaisir une puissance conventionnelle que la Montagne eût dirigée ?[160] Bien qu'il y eût du vrai dans cette dernière observation, au point où se plaçait le ministère, le motif qui pesa le plus sur la décision de Barrot fut sa volonté de demeurer président du conseil. La gauche avait évidemment vu dans la lutte un moyen de prolonger la Constituante, mais le raisonnement et les faits le forçaient de constater que la majorité véritable, malgré un succès momentané, se maintenait à droite ; elle se savait condamnée, et elle pressentait aussi que la cause mazzinienne, un jour ou l'autre, succomberait. Les Italiens les meilleurs, les plus dévoués à l'unité nationale, l'assuraient tout bas, assez haut du moins pour que bien des montagnards de Paris fussent persuadés. Cavour, Arèse, Tommaseo, Gioberti, Minghetti et leurs amis, qui savaient les intentions secrètes de Louis Bonaparte, se taisaient, interprétant l'affaire romaine comme un malheur passager à subir avec espoir. Le recul de Considérant vint même, sans doute, des explications qui lui furent fournies. — Enfin Paris, désorienté par le choléra, ne s'enthousiasmait pas jusqu'au sacrifice pour la République romaine ni contre un président dans lequel il voulait espérer toujours quand même. Malgré le caractère officiel de la cérémonie de la place de la Concorde, bien des cris de Vive Napoléon ! avaient été jetés. Le prince-président retenait à lui par son attitude courageuse ; il visitait les hôpitaux les plus infectés, restait des heures au chevet des malades. Un soulèvement ne pouvait aboutir. Le prince-président laisserait voir bientôt qu'il jouait double jeu, comptait profiter de la cause victorieuse pour le présent et pour l'avenir, s'imaginant même pouvoir orienter la campagne forcée qu'il approuvait vers cet avenir même. Dans la nuit du 7 mai, malgré l'heure avancée, ses ministres lui avaient offert leur démission, bien persuadés qu'il ne l'accepterait pas ; elle eût cependant servi sa cause et son avenir plus qu'il ne le pensait. Il se méfiait toujours de la gauche ; c'était sur elle qu'il fallait appuyer un nouveau cabinet ; il est vrai que si une partie de sa popularité y eût gagné, une autre, la plus considérable, en eût subi de graves atteintes. L'armée, dont il avait besoin, ne lui continuerait pas sa sympathie et, pour la reporter sur Changarnier, moyen provisoire des blancs les moins scrupuleux. Le clergé, dressé tout d'un bloc contre la cause napoléonienne, l'aurait empêché d'aboutir. L'œuvre de pacification se trouvait donc brutalement arrêtée. Comment douter, en effet, des sentiments de la majorité ? L'Assemblée était perdue et les élections législatives s'annonçaient favorables aux partis de droite. De part et d'autre on n'eut pas de peine à se dire qu'on devait vivre ensemble, et le Moniteur du lendemain annonçait à la France que le président gardait son ministère en lui conservant sa confiance. Le sens de cette entente était que le cabinet voulait se reconnaître assez fort pour ordonner l'assaut de Rome et, de cette façon, en finir. Pourtant Odilon Barrot, qui n'arrivait pas de suite à cette décision, comme son collègue Falloux, se sentait plus embarrassé encore que ne l'eut été M. Sénard. Il fallait servir le parti catholique, continuer à faire avancer l'armée en déplorant son honneur atteint, tout en ne combattant pas ouvertement l'Assemblée à laquelle il ne restait que vingt jours d'existence. Reculer ou avancer paraissait également difficile ; il ne restait que la négociation. Le ministre des Affaires étrangères s'en était rendu compte lorsqu'il avait applaudi de suite à la proposition de Favre. Celui-ci avait réclamé l'envoi de plusieurs députés, mais les remplacer par un seul agent diplomatique paraîtrait répondre à cette invite, et en réalité empêcherait la négociation de mûrir ses fruits[161]. La tactique réactionnaire continuait sous les apparences du libéralisme, ce qui n'était pas nouveau, et ne s'annonce jamais comme périmé. En admettant que les pourparlers efficaces s'établissent au point même de durer, ils n'aboutiraient eux-mêmes qu'au développement de la politique précédente, à ce rôle de soi-disant médiateur qui nous avait si mal placés. Avec la meilleure volonté, l'envoyé ne pouvait donc réussir dans le sens où il l'eût fallu ; les espérances du Parlement à ce sujet prouvaient son manque de politique, ou bien son désespoir, grand et superficiel à la fois au point de se duper avec élan, ou, enfin, son incertaine complicité. — Barrot n'a pas caché les sentiments de ses collègues[162] : Nous cédions aux nécessités de la position... nous avions une affaire à terminer, très difficile en elle-même et grandement compromise dès son début ; nous étions enchaînés dans notre action par une résolution ambiguë, espèce d'arme à deux tranchants, destinée à nous frapper dans tous les cas, et nous étions, en outre, en face d'une majorité défiante, anxieuse, hostile... Gagner du temps afin d'atteindre le terme de l'Assemblée qui devait bientôt mettre fin à la lutte en faisant disparaître un des combattants, jusque-là éviter autant que possible les débats irritants et, par un mélange de fermeté et de condescendance, éloigner tout prétexte à des mesures extrêmes et désespérées de la part de l'Assemblée, telle était la seule ligne de conduite à tenir. Malheureusement cette politique de modération et de patience avait peu de faveur dans les hautes régions du pouvoir et dans les rangs de la majorité. — Nous résolûmes de faire un nouvel essai de conciliation à Rome, mais tout en donnant cette preuve de déférence à l'Assemblée, nous profitâmes de la suspension d'armes qu'allait entraîner la reprise des négociations pour envoyer au général Oudinot tous les renforts en hommes et en artillerie dont il avait besoin. Nous connaissions trop les hommes à qui nous avions affaire à Rome pour ne pas nous préparer à vider la question par la force aussitôt que les moyens pacifiques auraient été de nouveau reconnus impuissants. Le négociateur proposé fut accepté à l'unanimité. Ferdinand de Lesseps était alors âgé de quarante-trois ans et se trouvait depuis quelques jours à Paris, sans poste. Sa carrière s'était accomplie dans les consulats, à Alexandrie, au Caire, à Rotterdam, à Malaga, à Barcelone où, en 1842, il s'était signalé en protégeant la ville contre les violences d'Espartero ; il avait, dans ces circonstances compliquées, sauvé la vie à beaucoup de Français et d'Espagnols avec un courage qui l'avait même mis en danger. Estimé de Guizot, il s'était valu une situation dans la péninsule ibérique ; tout en sachant toujours se tenir à l'écart de la politique, il avait applaudi celle menée à l'extérieur par le gouvernement provisoire. Nommé plénipotentiaire à Madrid par Lamartine, il y demeura jusqu'en février 1849, date à laquelle le prince Napoléon, qu'on désirait éloigner, lui succéda. La légation de Rome lui était destinée. La nécessité de démêler l'écheveau romain sur place, au moins en apparence, fit penser à lui. Il savait les révolutions et les peuples du Midi ; son renom de libéralisme contenterait le Parlement ; sa réputation d'habileté donnerait confiance. La nouvelle négociation que nous allions entamer était hérissée de difficultés ; il s'agissait non seulement de faire entendre raison à des fous furieux, mais de donner un peu de courage à cette partie inerte de la population qu'on appelle juste milieu et qui, à Rome moins que partout ailleurs, n'était capable d'une vigoureuse initiative. Il fallait, en outre, faire comprendre à la papauté la nécessité de séculariser un peu plus son gouvernement afin de le rendre possible[163]. Le lendemain de la séance parlementaire, le 8 au matin, Drouyn de Lhuys fit appeler Lesseps au ministère. Il lui demanda s'il était disposé à aller remplir une mission à laquelle il attachait la plus grande importance, tout en lui apprenant que le gouvernement, réuni au conseil, l'avait déjà désigné[164]. Il ajouta beaucoup de compliments[165]. Lesseps, sans doute parce qu'il était mal au courant des intentions subsistantes de la politique ministérielle et comme s'il prévoyait, toutefois, des possibilités de malentendu futur, répondit que du moment qu'il était l'objet d'une si honorable confiance, il devait avoir la franchise de déclarer que si le gouvernement n'avait pas été inspiré dès le début par une politique franche et décidée, il eût été bien préférable de ne pas nous compromettre en faisant partir l'expédition de Civita-Vecchia. Au surplus, ajouta-t-il, il s'agit de réparer le mal causé par l'affaire du 30 avril et de ne pas recommencer. Je partirai dans deux heures, si vous voulez, et je vous promets que, pour atteindre le but indiqué par le vote d'hier, je ne reculerai devant aucun obstacle[166]. Le ministre le félicita de son empressement et ajouta que la manière dont il s'exprimait justifiait le choix du gouvernement[167]. Il fit, en sa présence, appeler le chef de la direction politique, M. de Vieil-Castel, et l'invita à rédiger des instructions destinées à laisser au négociateur assez de latitude et d'initiative pour que son action politique ne fût pas entravée, soit par le général chargé des opérations militaires, soit par des directions trop précises que l'ignorance d'événements imprévus ayant pu survenir en Italie depuis le 30 avril ne permettaient pas de donner actuellement. Il lui recommanda de prendre des exemplaires du Moniteur du 8 mai, afin d'en remettre un, dès son arrivée, au général Oudinot ; c'était là qu'ils devaient puiser l'un et l'autre leurs instructions et leurs déterminations[168]. Si ce récit est exact, — et les protestations formulées beaucoup plus tard, que nous étudierons plus loin, ne l'infirment pas, — il est évident que Drouyn de Lhuys n'était pas sincère, soit qu'il eût modifié sa ligne de conduite en apparence, soit qu'il eût intérêt à mentir au négociateur, soit, enfin, qu'il supposât chez lui un tel dévouement à la pensée ministérielle que la mesure d'y répondre l'amènerait à lire de préférence les déclarations gouvernementales dans le Moniteur conseillé ; il pensait peut-être aussi que Lesseps était moins réellement actif qu'il le paraissait et que le vague des instructions qu'il lui remettait lui feraient pressentir qu'il jouait un rôle neutre, tout en ayant mission de paraître en effectuer un tout contraire ; or il se posa, dès le début — ainsi qu'il le raconte dans son mémoire au Conseil d'État[169] — comme l'exécuteur du vote du 7 mai, comme le diplomate de l'Assemblée, plus que du ministère, bien que désireux de les concilier l'un et l'autre. Aurait-on eu recours à un tiers s'il n'avait fallu départager deux parties aux prises et inconciliables ? Et il est inutile de rappeler que l'intérêt français ne résidait nullement dans la politique gouvernementale. — La défense présentée par Drouyn de Lhuys, par d'Harcourt 3, n'était ni franche ni admissible. Il y avait, en réalité, deux missions diplomatiques qui devaient concourir au même but, l'une à Rome, l'autre à Gaëte. Elles devaient éviter toutes deux de s'imprégner outre mesure du milieu dans lequel elles vivaient. Les dépêches de MM. de Rayneval et d'Harcourt montrent qu'ils étaient loin de subir les influences antilibérales qui dominaient autour d'eux[170]. M. de Lesseps ne sut pas se garantir au même degré contre les avances du triumvirat romain... Il y avait une sorte d'incompatibilité entre la mission et le titulaire. Le trait saillant du caractère de M. de Lesseps est une impatience des obstacles qui mènent aux grands résultats ou aux grands échecs. La mission qu'on lui confiait avait plus d'apparence que de portée et consistait surtout à gagner du temps... Jusqu'à l'heure où le suffrage universel se serait prononcé, on avait le désir de laisser la question entière[171]. Suit un passage qui fait observer que M. de Lesseps n'appartenait pas à. la diplomatie proprement dite et ne possédait pas cette éducation professionnelle acquise pour ainsi dire d'une manière inconsciente par celui qui a parcouru tous les grades diplomatiques[172] ; il avait le malheur de n'être pas encore ce diplomate qui a vu échouer beaucoup de missions et qui, en assistant aux naufrages, apprend, par une sorte d'instinct, comment on s'en préserve[173]. — Pourquoi en ce cas, même de loin, n'avoir pas suggéré à l'envoyé qu'il allait à Rome avant tout afin de ne pas aboutir[174] ? Celui qui reçoit des instructions dans les moments de troubles doit avoir l'habitude de lire entre les lignes. Dans le cas dont il s'agit, un ministre des Affaires étrangères ne pouvait évidemment dire que le vote des représentants du pays était inexécutable... Les directions données avaient un caractère très vague ; au fond, elles signifiaient : Examinez la situation qui résulte à Rome des derniers événements ; rendez-vous compte ; bornez-vous à des arrangements partiels ; ne donnez pas d'inquiétudes au Saint-Siège, ni d'encouragements aux triumvirs et tenez-vous dans une réserve qui vous permette d'attendre le moment très prochain où les intentions de la majorité de la France vous seront mieux connues[175]. Nous avons entendu le langage ministériel. Voici les textes et les faits. M. de Vieil-Castel remit à Lesseps, l'après-midi, la
minute des instructions. Les faits qui ont marqué le
début de l'expédition française dirigée sur Civita-Vecchia étant de nature à
compliquer une question qui se présentait d'abord sous un aspect plus simple,
le gouvernement de la République a pensé qu'à côté du chef militaire chargé
de la direction des forces envoyées en Italie, il convenait de placer un agent
diplomatique qui, se consacrant exclusivement aux négociations et aux
rapports à établir avec les autorités et les populations romaines, pût y
apporter toute l'attention, tout le soin nécessaires dans d'aussi graves
matières... Votre zèle éprouvé, votre
expérience et l'esprit de conciliation dont vous avez fait preuve en plus
d'une occasion, dans le cours de votre carrière, vous ont désigné, pour cette
mission délicate, au choix du gouvernement. Je vous ai expliqué l'état de la
question dans laquelle vous allez avoir à intervenir. Le but que nous nous
proposons, c'est, tout à la fois, de soustraire les États de l'Église à
l'anarchie qui les désole et d'empêcher que le rétablissement d'un pouvoir
régulier n'y soit attristé, et même compromis dans l'avenir, par une aveugle
réaction. Tout ce qui, en présence de l'intervention exercée par d'autres
puissances animées de sentiments moins modérés, laissera plus de place à
notre influence particulière et directe, aura pour effet naturel de rendre
plus facile à atteindre le but que je viens de vous indiquer. Vous devez donc
mettre tous vos soins à amener, le plus promptement possible, un tel résultat
; mais, dans les efforts que vous ferez à cet effet, vous aurez à fuir deux
écueils que je tiens à vous signaler. Il faut vous abstenir de donner lieu
aux hommes investis, en ce moment, dans les États romains, de l'exercice du
pouvoir, de croire que nous les considérons comme un gouvernement régulier,
ce qui leur prêterait une force morale dont ils ont été dépourvus jusqu'à
présent. Il faut, dans les arrangements partiels que vous pourriez avoir à
conclure avec eux, éviter toute parole, toute stipulation, propres à éveiller
les susceptibilités du Saint-Siège et de la conférence de Gaëte, trop portée
à croire que nous sommes disposés à faire bon marché de l'autorité et des
intérêts de la Cour de Rome. Sur le terrain où vous allez vous trouver placé,
avec les hommes auxquels vous aurez à faire, la forme n'est pas moins
importante que le fond. Telles sont, Monsieur, les seules directions que je
puisse vous donner. Pour les rendre plus précises, plus détaillées, il
faudrait avoir, sur ce qui s'est passé depuis quelques jours dans les États
romains, des informations qui nous manquent. Votre jugement droit et éclairé
vous inspirera, suivant les circonstances. Vous devez, d'ailleurs, vous
concerter avec MM. d'Harcourt et de Rayneval sur tout ce qui n'exigera pas
une solution absolument immédiate. Je n'ai pas besoin de vous recommander
d'entretenir avec le général Oudinot des rapports intimes et confiants,
absolument nécessaires au succès de l'entreprise à laquelle vous êtes appelés
à concourir ensemble. Drouyn de Lhuys donna lui-même lecture de ces
instructions. Il s'arrêta au premier passage qui
m'autorisait à me consacrer exclusivement aux négociations et aux rapports à
établir avec les autorités et la population romaine et me fit remarquer qu'on
me faisait une part assez large et assez indépendante du général en chef ; il
appuya sur le dernier paragraphe qui me donnait toute latitude, en présence
d'événements ou de difficultés imprévues. Quant au passage concernant le
concert avec MM. d'Harcourt et de Rayneval, je fis observer que ce concert
était impossible, leur mission et la mienne ayant un principe tout différent
et même contraire. Il me fut répondu : Bornez-vous à leur envoyer des
duplicata de vos dépêches[176]. Le matin, sur
le conseil du ministre, Lesseps avait été voir Louis-Napoléon ainsi que le
président du Conseil. A l'Elysée, rien de précis ne fut énoncé. Barrot se
révéla soucieux des embarras parvenus à la suite du 30 avril, comme de la
situation vis-à-vis de l'Assemblée qui,
dit-il, en définitive, est souveraine[177]. Il aurait
adressé à Lesseps à peu près le discours qu'il comptait prononcer le
lendemain et le pria déporter en Italie l'expression fidèle, exacte, delà
pensée de l'Assemblée et du Gouvernement[178], conseil bien
difficile à suivre, puisque ni l'un ni l'autre n'étaient d'accord. Nous ne changions rien au fond de notre politique, a écrit
Barrot. Il avait encore dit à Lesseps confidentiellement : Nous ne vous
donnons pas d'instructions. Vous êtes notre sauveur ! Sans vous nous étions
perdus, le ministère était mis en accusation[179]. — Avant même
qu'il ne partît, Lesseps était sacrifié et remplissait, sans le savoir, le
rôle de bouc émissaire. Le ministre plénipotentiaire, qui allait représenter
la France sous les murs de Rome, emportait avec lui l'image fidèle de la
situation. L'exécutif lui disait par l'obscurité de ses instructions : Entre dans Rome ; le législatif : Souviens-toi du vote du 7 mai. Il portait l'eau et
le feu, et entre l'une et l'autre de ces deux inconciliables, l'heure de
faire un choix approchait[180]. Tandis qu'il s'entretenait avec Drouyn de Lhuys, un message présidentiel venait le prier de retourner à l'Elysée. Le ministre lui recommanda de venir aussitôt lui rendre compte de ce qui se serait passé. Louis-Napoléon dit au diplomate avoir beaucoup réfléchi sur l'objet de sa mission et qu'un point, dont il craignait ne pas l'avoir point entretenu, le préoccupait surtout : l'attitude de nos troupes en présence d'une intervention armée des Autrichiens et des Napolitains dont nous devions, à tout prix, éviter de laisser l'action se confondre avec la nôtre. Il lui demanda ensuite à prendre connaissance de ses instructions, qu'il déclara peu explicites, même ambiguës. Il annonça qu'il allait faire partir pour Rome le général Vaillant, avec lequel il aurait à s'entendre. Vaillant posséderait les pouvoirs de remplacer Oudinot si celui-ci ne marchait pas d'accord avec eux deux, ou de prendre le commandement des opérations du génie dans le cas ou l'on renouvellerait le siège de Rome. Il ajouta que je ferais bien, si j'en avais l'occasion, de rappeler qu'en 1831 il avait pris parti contre le pouvoir temporel lorsqu'il se trouvait devant Rome avec son frère aîné[181]. Mais, en même temps qu'il semblait se plaire à ce souvenir, il remettait à Lesseps une lettre pour le général Oudinot. Elle était cachetée, et contenait ceci, qui devait paraître le lendemain, tandis que le voyageur serait déjà parti, dans la Patrie[182] : Mon cher général, la nouvelle télégraphique qui annonce la résistance imprévue que vous avez rencontrée sous les murs de Rome m'a vivement peiné. J'espérais, vous le savez, que les habitants de Rome, ouvrant les yeux à l'évidence, recevraient avec empressement une armée qui venait accomplir chez eux une mission bienveillante et désintéressée. Il en a été autrement ; nos soldats ont été reçus en ennemis ; notre honneur militaire est engagé ; je ne souffrirai pas qu'il reçoive aucune atteinte. Les renforts ne vous manqueront pas. Dites à vos soldats que j'apprécie leur bravoure, que je partage leur peine, et qu'ils pourront toujours compter sur mon appui et sur ma reconnaissance. L. N. B. Revenu chez le ministre des Affaires étrangères, Lesseps lui raconta son entretien, à l'exception de la confidence sur Forli, dont il devait même ne pas faire usage durant son séjour à Rome, afin de ne pas exciter les esprits[183]. Lorsqu'il répéta l'observation du président au sujet d'une intervention étrangère, le ministre lui demanda quel sens il donnait à ces mots : à tout prix : C'est à vous, répondit-il, de vous entendre avec M. le Président et de m'en écrire. Quant à moi, je les accepte dans le sens le plus large en attendant de nouvelles directions[184]. Il lui confia également une lettre pour Oudinot[185]. C'était jour de réception et le salon ministériel était rempli de monde. Drouyn de Lhuys mit Lesseps en rapport avec un membre de la Constituante romaine en mission et qui retournait justement à Rome, M. Accursi. Il engageait même l'envoyé défaire route avec Accursi jusqu'à Toulon ; mais Lesseps lui fit observer que cette compagnie pourrait le compromettre. Accursi partit seul[186]. Peu d'heures après, Lesseps était en chaise de poste sur la route de Paris à Toulon, où il prit place sur un bâtiment de guerre. Il y reçut deux dépêches que le ministre des Affaires étrangères le priait de faire parvenir sans retard à MM. de Rayneval et d'Harcourt ; il indiquait que la copie de la plus importante de ces dépêches lui ferait connaître qu'il conseillait de combattre les pensées de réaction absolutiste qui se manifestaient malheureusement dans les conseils du Saint-Père[187]. Lesseps retint l'esprit libéral qui paraissait les animer et qui l'ancra dans ses résolutions[188]. Il occupa ses loisirs à lire les œuvres de Mazzini et de ses disciples[189]. Enfin une dépêche avait été envoyée directement à Oudinot, destinée à devancer Lesseps, et ainsi conçue : Faites dire aux Romains que nous ne voulons pas nous joindre aux Napolitains contre eux. Poursuivez des négociations dans le sens de vos déclarations. On vous envoie des renforts. Attendez-les. Tâchez d'entrer dans Rome d'accord avec les habitants ou, si vous êtes contraint d'attaquer, que ce soit avec les chances de succès les plus positives[190]. La lettre du président de la République à Oudinot parut
donc le 9, accompagnée du commentaire suivant : Paris
s'est réveillé ce matin la rougeur au front et la douleur dans l'âme, en
apprenant les résultats de la tumultueuse séance de nuit qu'a tenue
l'Assemblée nationale. Certes, cette heure était bien choisie pour cette
œuvre de ténèbres, le coup a été frappé dans l'ombre. Quel démon vous a donc
poussé, violents tribuns de la Montagne ? Ainsi nos soldats sont pris entre
les carabines des aventuriers de Rome qui les frappent en pleine poitrine et
votre désaveu qui va leur arriver en place de renfort... Odilon Barrot
voyait là une sorte de provocation. La lettre était inutile ; elle ne
s'expliquait que par les vues du président sur l'armée. Rien de plus simple et de plus légitime, prises en
elles-mêmes, que ces paroles du chef de l'État à des troupes qui venaient de
subir un échec, dont le moral avait besoin d'être relevé, et, quoique cette
lettre n'eût pas été délibérée en conseil, il est probable que si elle nous
eût été soumise, nul d'entre nous n'y eût fait la moindre objection, mais, en
politique, les paroles comme les actes reçoivent un sens de la position
respective des partis, et il faut convenir que, par sa date, par son contenu,
par les antécédents du président, cette lettre pouvait bien être prise pour
une réponse, et même pour une protestation contre la résolution du 7 mai[191]. La situation
du président du conseil, entre les ambitions diverses qui se jouaient autour
de lui, et quelquefois de lui-même, en entendant l'utiliser, devenait sans
cesse plus difficile. Alors que le ministère affectait surtout d'avoir voulu
prévenir un second désastre en envoyant des renforts, Louis-Napoléon parlait
de revanche avec brutalité ; il se mettait en avant de la manière la plus
audacieuse, la plus personnelle, la moins justifiée ; or, de même qu'il
n'avait pu désavouer Drouyn de Lhuys, de même Barrot ne pouvait désavouer
l'Elysée ; il se préparait ainsi aux défaillances dont il allait successivement
faire preuve. A son tour, il pensa tout sauver par un compromis comme ceux
qui l'entouraient, comme la France qui, depuis 1815, semblait avoir de moins
en moins le courage de ses opinions ; il résolut donc de porter devant
l'Assemblée les sentiments dont faisait preuve la lettre présidentielle en
même temps qu'il déclarait n'avoir ni connu, ni approuvé celle-ci. Quel
ministre, — à moins de démission, — eût agi différemment ? Seulement à
l'Elysée, en séance intime, plus d'un aurait tenu un langage particulier et
catégorique au président de la République. Il répondit, le 9, dans le sens indiqué, aux demandes de
renseignements de Grévy, et la tactique parut réussir. C'est une lettre de sympathie, dit-il, d'encouragement, de reconnaissance envers les soldats. Je
n'aperçois rien qui engage la politique, qui établisse, et, même, qui ait
l'intention d'établir un conflit entre la résolution de l'Assemblée et
l'exécution que doit donner le gouvernement à cette résolution... Cependant,
cette lettre n'est point un acte de cabinet et de conseil. Puis il
renouvela ses déclarations précédentes, se plaignant de ceux qui ne voulaient
pas reconnaître que nos troupes servaient la cause de l'humanité. Il tournait
vite pour entretenir de Lesseps de ses intentions libérales ; il s'étonnait
de certaines attaques ; il affirmait l'entente du gouvernement et de
l'Assemblée. Et puisque tout ce qui avait été fait ne l'avait été qu'en vue
d'empêcher la réaction, il ne restait qu'à continuer. La question se trouvait
si bien embrouillée qu'il ne subsistait rien de sa réalité, sinon, pour ceux
qui savaient et voulaient comprendre, la preuve que, sur le fond, Barrot
demeurait d'accord avec le président ; on n'allait pas à Rome le moins du
monde pour essayer une nouvelle politique et la faire prévaloir, mais afin
d'y préparer la certitude d'une revanche. — Grévy, néanmoins, parut
satisfait. La gauche murmura et Ledru-Rollin recommença le duel. On nous a dit que, peut-être, des dépêches dont la marche
est aujourd'hui entravée, arriveront demain et que, si elles arrivent, alors
on pourra faire des communications et discuter. Arriveront-elles demain,
d'abord ? Et en supposant qu'elles arrivent demain, en quoi cela pourra-t-il
modifier l'exécution du vote que vous avez rendu avant-hier ? Il fallait que ce vote fût exécuté, sinon c'était, de la
part du gouvernement, méconnaître la représentation nationale. Quant à la
lettre présidentielle, il était bien évident qu'il y avait moquerie à la
déclarer presque confidentielle. Ses termes mêmes prouvaient qu'elle ne
l'était pas. Oui, la lettre est officielle, car elle
engage la politique malgré nous ; vous avez pu ne pas la connaître, vous
pouvez avoir la générosité de la couvrir, la question n'est-pas là. Il est
certain, encore un coup, que cette lettre est un document public qui
parviendra à nos soldats, qui aura influence sur leur esprit et qui engage,
quoi que vous fassiez, le gouvernement... Les soldats comprendront qu'on
encourage l'armée à suivre la politique d'attaque, non de protection,
politique qui a été blâmée par notre dernière résolution. Il faisait à
nouveau l'historique de la façon dont le Parlement avait été trompé ; il
prouvait qu'on s'était servi du vote arraché à sa bonne foi pour faire ce
qu'elle n'avait jamais permis. Et il s'écriait : On
nous a dit : Nous voulons sincèrement exécuter la résolution de
l'assemblée ; nous nous inclinons devant elle, nous avons pour elle un grand
respect. On sait ce que valent ces banales protestations. Il est certain
pour tout homme impartial que le reste du discours, à l'insu, si vous le
voulez, du président du conseil, était un moyen d'étudier votre décision,
même dans ce qu'elle a d'impérieux : le respect de la République romaine
et de la grande cité des souvenirs... Président et ministres, sachez-le
bien, l'échec des armes françaises, dans cette circonstance, n'est pas
honteux pour elles... Il ne voyait pas d'accord possible entre la
manière dont le ministre comprenait la liberté et la sienne. Vous appelez liberté celle qui vous conviendra ; vous
appelez liberté la réintégration de Pie IX ; vous appelez liberté tout ce qui
ne sert pas la République. Et comme on lui objectait qu'il n'était pas
encore prouvé que le gouvernement de Rome ne fût pas un pouvoir de minorité,
il répliquait : Non, citoyens, ce n'est pas un
gouvernement de minorité que celui qui est parvenu à galvaniser ainsi tout un
peuple ; non, ce n'est pas un gouvernement de minorité que celui qui a rendu
des décrets déclarant que chacun des représentants présiderait à une
barricade et qui n'a pas été démenti par le peuple ; non ce n'est pas un
gouvernement de minorité qui vous a dit : Honneur à la nation française si
elle est libératrice, mais si elle vient nous opprimer, honte à son gouvernement
; que ses soldats soient mis hors la loi des nations ! Répondez. Où
avez-vous recueilli une seule parole, malgré vos provocations à la discorde,
où avez-vous entendu une seule voix qui ait protesté contre les décrets de
l'assemblée romaine ? Puis, revenant à la lettre présidentielle. Maintenant que j'ai protesté au nom de l'honneur national,
au nom de l'humanité, au nom de la solidarité des peuples, attendez à demain,
si vous voulez, pour prendre une résolution ; mais ce qu'il fallait surtout,
c'était s'élever contre cette lettre qui jetée à l'heure qu'il est, dans la
situation de la France et de l'Italie, est un engagement contraire à votre
volonté ; ce qu'il fallait, c'était une protestation vigoureuse pour faire
comprendre au pays que le premier magistrat qu'il amis à sa tête ne conserve
ni son honneur, ni celui de la République. — Barrot s'était trop
engagé dans le sillage du président pour ne pas devoir se défendre, mais il
le fit mal, en exagérant et dans des termes trop empruntés à la droite : Vous pouvez accuser, vous ne pouvez pas outrager. L'accusation
peut être l'accomplissement pénible, rigoureux d'un devoir civique ;
l'outrage, savez-vous ce que c'est ? Ce n'est pas que de la haine, c'est de
la conspiration. La droite était transportée d'aise. — Flocon, après
Clément Thomas, toujours maladroit, après Grévy singulièrement conciliateur,
s'élevait à son tour contre la fameuse lettre, mais ne fit qu'augmenter
l'entente en demandant : S'il y avait sur les bancs
ministériels un membre du ministère qui voulût dans ce moment apposer sa
signature à la lettre du président. — Tous !
Tous ! répondirent-ils. Il déposa la proposition suivante : Vu l'article 67 de la constitution, ainsi conçu : Les
actes du président de la République autres que
ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils
sont contresignés par les ministres, l'Assemblée nationale déclare que la
lettre du citoyen Louis Bonaparte, président de la République, adressée à M.
le général Oudinot, le 8 mars 1849, est nulle et de nul effet. Des
clameurs accueillirent ce texte auquel il ne fut pas donné suite. Jules Favre
parla aussi en faveur de la discussion renvoyée au lendemain. Paris avait été fort agité. Les débats s'y étaient révélés très violents sans arrêt. Marrast avait fait protéger le Palais-Bourbon par les troupes, deux bataillons venus des Invalides, où commandait le général Forey. — Que craignait l'ancien directeur du National ? Ce n'était pas l'émeute ; c'était donc l'Elysée. Il ne prouvait pas, dans la circonstance, une grande habileté. Ce petit événement était d'autant plus maladroit qu'il entraînait des suites. En recevant la réquisition de Marrast, le général Forey n'obéit pas immédiatement, ainsi que c'était son devoir ; il transmit l'ordre au général Changarnier qui commandait en chef la garde nationale de Paris et l'armée. Changarnier, qui trouvait toute naturelle cette défense et méprisait le Parlement, se contenta de détacher un seul bataillon et ne l'envoya qu'au bout de deux heures. — Marrast fit appeler Forey. Celui-ci déclara au président de l'Assemblée qu'il ne connaissait pas la loi, se contentant d'en référer à son général en chef et de n'obéir qu'à lui. Un des questeurs présent à l'entretien, qui se tenait dans le cabinet de Marrast, lui dit : Cependant, si, par hasard, le président de l'Assemblée requérait une troupe passant devant l'Assemblée, cette troupe serait obligée d'obéir. — La troupe n'obéirait pas, affirma le général. Il ajouta, plus catégorique encore, qu'il avait l'ordre formel de ne pas tenir compte des décisions de l'Assemblée ou de son président qui lui seraient directement transmises. — Marrast fit alors prier Changarnier de venir lui parler. Le général ne se dérangea pas et envoya dédaigneusement, le lendemain, un aide de camp, chargé d'exprimer les regrets de son chef ; il fit savoir aussi qu'à l'avenir les ordres donnés aux généraux auraient à passer par l'intermédiaire du commandant en chef. — Le 10 mai, dès le début de la séance, Marrast, sur un ton solennel, avertissait ses collègues qu'il aurait une communication importante à leur faire dès que le président du conseil et le ministre de la guerre seraient à leurs bancs. Il raconta, le moment venu, l'incident, rappela que le général Lebreton, questeur de l'Assemblée, en plus de l'ordre expédié à Forey, avait prévenu de sa demande le général Changarnier. Il interrogeait alors le président du conseil, qui déplorait ce malentendu et le lui avait dit, ainsi que le ministre de la Guerre, afin de savoir s'ils avaient autorisé par un ordre quelconque, la désobéissance à la loi. Il demandait, à titre d'exemple, une punition. Il ajoutait que, les militaires ne connaissant pas la loi, il serait bon de la leur apprendre et promit de faire afficher dans les casernes les décrets concernant le cas présent. Ces demandes, que la gauche soutenait, étaient combattues, elles aussi, par la majorité. Pourtant l'Assemblée semblait s'être un peu ressaisie. En entrant au Palais-Bourbon, Barrot avait été frappé : Les membres du Parlement étaient répandus dans les salles d'attente et dans les couloirs, en partie groupés, et d'où s'échappaient les mots de trahison et d'accusation. Mes amis paraissaient consternés et ne m'abordaient que pour déplorer ces imprudents défis jetés à l'Assemblée ; quelques-uns parlaient même de faire la part du feu et d'abandonner Changarnier en expiation au courroux des représentants[192]. — Forcé de répondre à Marrast, Barrot continuait d'éprouver les difficultés de cette situation embarrassante dans laquelle il s'enlisait. Il n'y avait pas à s'y méprendre ; le président, d'abord dominé par son ministère, l'avait joué peu à peu, tout en lui paraissant soumis, et le menait en sous-main, logiquement, où il voulait qu'il allât. Je ne pouvais, dit Barrot[193], méconnaître les droits de réquisition au président de l'Assemblée nationale et, cependant, je ne voulais pas livrer les généraux qui avaient refusé d'obéir à ces réquisitions. Je m'en tirai tant bien que mal, en proclamant bien haut que le droit était incontestable, mais qu'à moins de circonstances extraordinaires, le président ferait bien de concilier l'exercice de ce pouvoir exorbitant avec les règles de la discipline et de la hiérarchie militaires. Il déclarait, toutefois, exorbitant le pouvoir dont la loi avait armé le président de l'Assemblée. Le général Rulhières vint ensuite déplorer le malentendu. La discussion dura, elle fut vive, et, une fois de plus, l'Assemblée capitula, satisfaite par l'affichage dans les casernes des décrets de loi qui donnaient au président de l'Assemblée le droit de requérir directement la force publique. C'était monter davantage celle-ci contre le Parlement. La non-condamnation de Changarnier lui prouvait aussi que l'impunité dans cet ordre de choses lui serait acquise ; le général avait violé la loi et se tenait prêt à la violer encore. Louis-Napoléon avait décidément écrit à Oudinot dans un moment malheureux ; plus d'une réflexion pouvait être faite avec justice. La lettre, soi-disant confidentielle, destinée à la seule armée d'Italie, était communiquée par Changarnier à tous les généraux de la capitale, et le chef de la garde nationale l'avait soulignée de ce commentaire : Mon cher général, vous avez remarqué dans les journaux la lettre du président de la République au général Oudinot ; faites que cette lettre soit connue de tous les rangs de la hiérarchie militaire. Elle doit fortifier l'attachement de l'armée au général en chef de l'État, et elle contraste heureusement avec le langage de ces hommes qui, à des soldats français placés sous le feu de l'ennemi, voudraient envoyer pour tout encouragement un désaveu. — Barrot avait le droit de dire : Il était impossible de signaler avec plus d'audace le triple but de la lettre du président qui était de capter la faveur de l'armée, de l'irriter contre l'Assemblée et d'afficher le plus profond mépris pour les résolutions parlementaires[194]. Il y avait de quoi soulever une tempête, malgré la lutte menée en pure perte les mois précédents, et ce fut encore Ledru-Rollin qui se fit entendre. Il dénonçait le lien étroit qui rattachait la conduite tenue à Rome à celle tenue en France. Vous y verrez un plan arrêté, un système tout entier de contre-révolution ; c'est la République qu'on médite d'étouffer au dehors comme au dedans. Et après avoir révélé les ruses dont il s'était servi pour décider les rares officiers qui marchaient sur Rome à regret, notamment en leur assurant que les Napolitains occupaient déjà la Ville Éternelle, après avoir résumé de nouveau le conflit, la trahison du ministère et le texte de Changarnier, il s'écriait : Ministres, si vous avez ignoré cette lettre outrageante pour l'Assemblée, donnez votre démission, autrement vous êtes des complices... Etes-vous des hommes ? La main sur le cœur, avez-vous le sentiment de votre dignité ? Si vous l'avez, répondez à cet acte insolent, ou, comme hommes et comme représentants, disparaissez, car vous avez l'opprobre au front. Montrant la lutte menée de toute part contre la République : Au dehors que faisons-nous ? Nous nous allions avec les rois, avec les aristocraties contre les peuples, oh ! je sais bien sous un vain prétexte de religion. La religion, elle est avec le peuple qui se bat... c'est là qu'est la vraie religion !... La République est-elle moins sacrifiée au dedans ? Non, cela ne peut plus être une question. Il suffit de quelques faits pour le prouver. Le 29 janvier, que fait le commandant en chef ? Il environne l'Assemblée de troupes par ordre du président. On le demande, il est trop occupé. Il envoie un officier de l'état-major. On crée pour lui un commandement spécial qui lui met 300.000 hommes dans la main. Ce commandement est menaçant ; c'est une véritable dictature ; il est contraire à la loi. Nous demandons sa suppression, le gouvernement ne cède pas... Puis arrive la lettre du président, puis la lettre de ce prétorien qui vient déclarer que notre volonté n'est rien, que la volonté du chef d'État est tout, et vous vous taisez ! Et la République n'est pas menacée ! C'est la contre-révolution, ou la lumière n'est plus la lumière. Il concluait par la mise en accusation du ministre et du président, en même temps que par l'envoi d'une lettre ainsi conçue à la Constituante romaine : Nous reconnaissons votre république ; nous voulons la paix ; la guerre a été faite malgré nous ; désormais soyons frères et cicatrisons nos blessures communes. Il n'y avait pourtant, là, au point où se précisaient les faits, guère que des paroles. Recommencer la guerre civile, risquer la guerre étrangère, étaient deux impossibilités ; nous l'avons reconnu précédemment, et cela était plus impossible encore aujourd'hui. Pour de telles témérités, il aurait fallu un autre peuple, une autre Assemblée et même une autre opposition[195]. Depuis Louis-Philippe, on avait mis une certaine lâcheté sage à l'ordre du jour de la politique française. A ce point de vue, qu'il était indispensable à une politique d'envisager, Ledru-Rollin demandait trop, et en demandant trop, bien qu'il eût parfaitement raison en principe, il perdait tout. Plus modéré au moins dans ses déclarations définitives, il eût porté au ministère un coup infiniment terrible, qui eût même, peut-être, décidé sa chute ; et qui sait si Louis Bonaparte n'avait pas un instant envisagé cette éventualité, prêt d'ailleurs et armé pour tous les cas ? Barrot profita de la faute, aidé par les sentiments de la majorité parlementaire : Quoi, dit-il, c'est à la suite du conflit malheureux dans lequel le sang de nos soldats a coulé sous les murs de Rome qu'on nous propose de reconnaître la République romaine ? Je ne discute pas une telle proposition ; il suffit de la présenter à une Assemblée telle que celle-ci pour qu'il en soit fait justice à l'instant même. Un artifice de ce genre réussit presque toujours sur des individualités qui s'orientent d'elles-mêmes, déjà, dans le sens où on veut les convaincre et, de plus, ignorent le véritable patriotisme. Poussé par son succès même, le président du conseil réitérait : Oui, on nous le fait trop voir, cet échec à Rome est pour certain parti comme une bonne fortune... La gauche se dressa : A l'ordre !... Je demande formellement le rappel à l'ordre du ministre. C'est une lâcheté ! C'est une infamie ! Indiscutablement, et qui sauvait le ministère, Barrot poussa le procédé jusqu'au bout, moitié complice, moitié sincère, après qu'Arago lui eut fait entendre qu'il parlait en tant qu'accusé : Mon juge, c'est le juge souverain dont la délibération commence et qui, dans quelques heures, fera connaître sa volonté suprême. Cet hymne au suffrage universel enflamma la droite, sûre de la majorité. Tourné ensuite vers Clément Thomas, qui l'avait apostrophé avec sa maladresse ordinaire, Barrot se défendait ainsi d'avoir permis ou préparé la guerre civile : La responsabilité, savez-vous sur qui elle retombe ? Sur ces hommes qui ont proclamé leur mépris pour le suffrage du souverain ; elle retombe sur ceux qui, alors que cette Assemblée n'était pas encore nommée, protestaient déjà contre elle, cherchaient à la dégrader avant qu'elle fût née, et, quelques jours après, venaient audacieusement la violer dans cette enceinte. (Applaudissements à droite.) La responsabilité, elle appartient à ceux qui, lorsque le peuple entier s'est assemblé pour désigner le chef du gouvernement de la République et en faire, pour ainsi dire, toute sa personnification, ont traîné cet élu du peuple dans toutes les infamies de la diffamation et de l'outrage. (A droite : Très bien, voilà la vérité.) Ils sont responsables, ceux-là qui, tous les jours, par tous leurs organes et de toutes les manières, prennent à tâche de dégrader celui que le peuple a honoré. (Nouvelles et vives marques d'approbation.) Ce sont ces hommes qui, se jouant du suffrage universel, pleins de mépris pour la grande et légitime souveraineté de la nation, ne reconnaissent d'autre Dieu que leur orgueil et leurs passions et, s'effrayant à bon droit du jugement que la nation va porter, veulent prévenir ce jugement à tout prix. (Bravos, applaudissements à droite.) La guerre civile, vous nous en prêtez la pensée ! Ah ! si votre reproche avait la moindre apparence de raison, ce n'est pas un acte d'accusation, mais un brevet de folie que vous devriez nous lancer !...[196] On ne pouvait mieux dire, et cette dernière phrase montre bien que Barrot fut, par certains côtés, aussi étrange que cela paraisse, sincère, car il y a des pentes sur lesquelles on ne peut plus s'arrêter une fois qu'on y a mis le pied. Il terminait : Jugez au moins vos adversaires d'après cette notion vulgaire, mais sûre, de leur intérêt. Nous ne sommes cependant pas tous des insensés. Pourquoi songerions-nous à une guerre civile, à la veille de cette solennelle manifestation de la volonté nationale dans laquelle, vous le savez bien, nous avons, nous, une foi profonde et complète : il y a, je le reconnais, dans le jugement du peuple, quelque chose de saint et de mystérieux ; téméraire serait celui qui voudrait préjuger ses décisions autrement que dans l'intimité de sa conscience ; mais, enfin, nos espérances et les appréhensions de nos adversaires sont assez notoires. Eh bien, j'en appelle au bon sens de cette Assemblée, au jugement du peuple entier : sont-ce ceux-là qui ont pleine foi dans le droit et dans son exercice régulier qui peuvent être soupçonnés de vouloir en appeler aux violences ? — Le suffrage universel était ainsi dressé contre ceux qui auraient dû être servis par lui et qui ne l'étaient pas. La Montagne, dit Barrot, était silencieuse, quoique frémissante. Que pouvait-elle expliquer ! Elle aussi était un des aboutissants de ce suffrage universel. Comment le déclarer incompréhensif sans le nier ? La loi de la majorité pesait de toute sa force sur la situation et, moins encore qu'en 1848, ne se laissait apercevoir le plus petit des ressorts susceptible de permettre un essai de Convention. Barrot ajouta que, tout en comprenant la lettre de Changarnier, il n'y approuvait point une phrase ; il promettait de demander même des explications au général à ce sujet. Revenant ensuite à Rome, après avoir déclaré une fois de plus que la majorité et le gouvernement ne voulaient par reconnaître la République péninsulaire, il recommençait la romance précédente : le pape devait être remis sur le trône de saint Pierre pour le triomphe de la liberté. Il demandait au Parlement un geste formel. Barrot affirmait ainsi davantage ce rôle de modérateur tout à la fois dupe et complice où Falloux le trouvait excellent. — La tactique réactionnaire de l'Assemblée s'accentuait. Tout la servait, même ce qui aurait dû la desservir. Jules Favre intervint si malheureusement qu'il ajouta au succès. Il lut une lettre du ministre de la Guerre de Rome où il était dit que les prisonniers français s'étaient offerts à combattre l'Autriche dans les rangs des Romains. La droite découvrit là un outrage à notre drapeau. Au lieu de comprendre et de vider la France du parti sans honneur et sans humanité qui avait poussé les dirigeants à mettre les soldats nationaux dans une situation pareille, la droite, déchaînée, invectivait la Montagne, et Drouyn de Lhuys s'écria : Car, enfin, ceux qui tirent sur nous sont nos ennemis ! Une fois de plus la majorité donna l'absolution au ministère. Elle ne fut, cependant, que de quarante voix. Le projet de Ledru-Rollin, — mise en accusation du ministre et du président, — fut repoussé par 388 voix contre 138. Le lendemain, Léon Faucher, ministre de l'Intérieur, ennemi sans tache des manœuvres électorales sous le gouvernement de Juillet, envoya une dépêche aux préfets : Après une discussion très animée sur les affaires d'Italie, l'Assemblée nationale a repoussé par l'ordre du jour pur et simple, à la majorité de 329 voix sur 621 votants, la proposition de Jules Favre de déclarer que le ministère avait perdu la confiance du pays. Ce vote consolide la paix publique ; les agitateurs n'attendaient qu'un vote de l'Assemblée hostile au ministère pour courir aux armes et renouveler les journées de Juin. Paris est tranquille. Parmi les représentants du gouvernement, ont voté pour l'ordre du jour et pour le gouvernement MM. XX... Se sont abstenus, ou étaient absents MM. XX..... Le jour même des élections, on eut soin de répandre la dépêche dans les villes et dans les campagnes ; elle y produisit une impression sérieuse. L'effroi recommença. On agita l'éternel spectre rouge. Des bruits d'insurrection s'étendirent. Les journaux catholiques annoncèrent sans sourciller que les montagnards se préparaient à livrer aux flammes les études des notaires. La Bourse s'affola. — Ledru-Rollin avait raison : la réaction marchait de pair, à l'intérieur et à l'extérieur. Changarnier faisait subir un nouvel affront à l'Assemblée par l'insignifiance de ses excuses. — Une des feuilles cléricales disait le 10 mai, en parlant de la veille : Seul, le président de la République a su ce qu'il faisait et fait ce qu'il voulait. Il voulait surtout laisser faire ce que voulait l'Église. * * *Oudinot, décidé à prendre une revanche, la préparait. Quand il reçut le P. Ventura, chargé par Mazzini de représenter la journée du 30 avril comme un malentendu, il répondit à peine aux avances du prêtre qui, dans son désir de tout concilier, excusait encore ensuite l'inexacte version française en attribuant ses erreurs à l'état de santé du général. Ventura, quoique son rôle ait été, en général, très équivoque, appartenait à cette partie du clergé, dont on avait pris soin de ne pas parler à Paris, qui s'était rallié à la République romaine ; après avoir essayé sans succès une entente avec le pape et les Romains, il s'était déclaré pour ceux-ci. A ses côtés, bien que différent surtout par la sincérité, Ugo Bassi partageait la conception religieuse de la République mazzinienne ; d'autres prêtres seraient à citer. Muzzarelli, quant à lui, avait rejeté le froc. Personne n'est entraîné au scepticisme ni à l'enthousiasme, suivant les caractères, tour à tour ou simultanément, comme le clergé, surtout dans la Ville Éternelle ; ceci explique l'indifférence avec laquelle une partie du clergé accueillit les excommunications. La division, — quelquefois simplement apparente, — s'imposait donc un peu dans le clergé comme ailleurs, entre ceux qui se tournaient vers l'avenir, et ceux qui se cramponnaient au passé, et ceux qui voulaient les confondre dans le meilleur présent. Seule, en Europe, Rome n'avait pas d'administration pour réprimer la puissance cléricale qui avait absorbé l'État ; la tâche imposée aux hommes de gouvernement qui avaient à réaliser en un moment, presque, l'œuvre de plusieurs générations[197], les entraînait donc vers un juste milieu fort modéré dont la nécessité achève de faire ressortir les manœuvres de la réaction française. Oudinot ne se rendait pas compte de ces faits, mais il ignorait si peu la réalité de la défaite récente, tout en la niant dans ses dépêches, qu'il en demeurait toujours malade. Il alla jusqu'à la transformer en opération éducative : Ce n'était pas un siège que nous voulions faire, écrivait-il au ministre de la Guerre, mais une forte reconnaissance. Elle a été exécutée ou ne peut plus glorieusement... Cette journée du 30 avril est une des plus brillantes auxquelles les troupes françaises aient pris part depuis les grandes guerres... Le ministère n'avait que fort peu partagé cette façon de voir ; le décret confiant au général Vaillant le commandement éventuel de l'expédition attestait ses réticences. — Lesseps allait se heurter de toutes parts à l'impossible. Atterré depuis le 30 avril, le parti modéré de Rome ne se reconnaissait point et, Rusconi en tête, désespérait de la République. Le peuple se montrait de plus en plus belliqueux ; Mazzini, favorable à l'entente progressivement, comptait sur l'échec du 30 pour éclairer l'opinion française et rendre l'accord possible ; sans croire à une alliance, il pensait que, du moins, la lutte était terminée. Or Oudinot voulait si peu entendre raison qu'il voyait dans la destruction de la République romaine le triomphe de la barbarie sur la civilisation. Afin de gagner les sympathies françaises, Mazzini renvoya les prisonniers le 7 mai et les fit accompagner jusqu'aux portes de Rome par des acclamations enthousiastes. Le peuple romain, proclama-t-il, ne rend pas responsables des fautes d'un gouvernement trompé, des soldats qui n'ont fait qu'obéir en combattant. Il écrivait à l'Assemblée : Nous envoyons ainsi des apôtres dans les corps d'occupation et nous provoquons puissamment par cet acte le développement de l'opinion en notre faveur. — Oudinot ne fit pas savoir cela en France et revendiqua comme un succès personnel la restitution des prisonniers[198]. Il annonçait aussi une fois encore son intention de se porter en avant, tenace à affirmer cette persuasion d'être reçu dans un combat qui l'avait mené à la défaite. La situation politique est très complexe, sans doute, avouait-il, cependant il est facile de prévoir que le moment n'est pas très éloigné où la capitale et le gouvernement lui-même prendront la France comme arbitre[199]. — Il alla camper à Castel-Guido au-dessus de Rome. Les Romains pouvaient assister difficilement à ce spectacle de sang-froid, et Mazzini devait ressentir des difficultés à persévérer dans ses avances ; désespéré, ne sachant sans doute sur qui placer son espoir, il crut aux bonnes paroles de l'Angleterre. Prévoyant des malheurs prochains, le consul de Wurtemberg à Rome offrit alors au dictateur d'essayer une dernière tentative de conciliation. Mazzini lui répondit : Il commence à être évident que le général ne veut pas avoir de contact avec nous. Par notre ministre des Affaires étrangères, par le P. Ventura et d'autres encore, nous avons fait toutes les avances possibles sans en avoir obtenu le moindre résultat. Aujourd'hui, nous ne pourrions prendre l'initiative d'un contact quelconque sans manquer à l'Assemblée, au peuple, à notre mandat. On nous dit qu'on est venu pour nous protéger. Protège-t-on en nous prenant nos armes, en nous empêchant d'aller défendre notre sol contre les Autrichiens et les Napolitains, en disant : Nous vous empêcherons de vous défendre si vous ne nous laissez pas occuper Rome ?... Qu'Oudinot se rende sans son armée à Rome et qu'il vérifie par lui-même l'unanimité des opinions ; s'il veut suggérer un moyen légal de vérification, qu'il le propose avec des garanties pour la papauté... qu'il nous aide à combattre l'Autriche, qu'il nous rende nos armes séquestrées à Civita-Vecchia. — M. Kolb, accompagné d'un officier supérieur romain, vint cependant voir Oudinot. Celui-ci comprit si peu sa démarche qu'il y découvrit la certitude de son succès. Il télégraphia au ministère que les Romains, se voyant cernés de toutes parts, étaient venus lui apporter des paroles de paix et de soumission. Il concluait : Nous touchons à un dénouement conforme aux intérêts de la France. Il écrivait, dans le même temps, au contre-amiral Tréhouart : Déjà des propositions sérieuses me sont faites ; nous sommes pour les Romains l'ancre du salut. Et comme s'il craignait qu'une entente pacifique fût quand même possible, il posait à Mazzini les conditions les plus dures. La France, disait-il, n'a pas reconnu la politique romaine... J'ai dû prescrire des opérations militaires qui, dans peu de jours, me rendront maître de Rome. Mais la France ne cherche pas à prolonger la guerre par de nouveaux triomphes... Mazzini se tint sur la réserve. Le général De perdit rien de son assurance, et la dépêche du gouvernement, datée du 10 mai, l'assura dans ses illusions. Ignorant l'envoi de Lesseps, il répondit : Les expressions exprimées dans votre dépêche télégraphique du 10 sont toutes réalisées. J'ai conservé ma liberté d'action vis-à-vis de l'armée napolitaine. Mes relations avec elle sont convenables et modérées. J'entrerai à Rome avec le concours des habitants et sans coup férir, du moins, j'ai tout lieu d'y compter... Il continuait toutefois à être souffrant. Le 13 mai, à une heure du matin, au lit, il reçut le
plénipotentiaire de Paris. Lesseps lui donna aussitôt lecture, d'après le
Moniteur, dont il lui laissa un exemplaire, de la séance du 7 et lui
communiqua ses instructions. Il lui fit vraisemblablement part de ses
projets, en s'efforçant de deviner le généralissime, jusqu'où il voulait
aller, dans quel sens exactement. Que se passa-t-il dans l'esprit du
militaire ? Il dut éprouver le sentiment qu'il avait déplu à Paris, malgré
tout, et qu'on lui barrait la route un peu. Il est humain que, de suite, il
n'ait pu se défendre d'en vouloir à l'envoyé ; il n'en laissa pourtant rien voir
et promit son bon concours[200]. L'entretien
dura longtemps, jusqu'au jour. Oudinot, étant décidément trop malade pour
tenir une plume, Lesseps écrivit à sa place sous sa dictée et de sa part au
comté de Ludolf, ministre des Affaires étrangères du roi de Naples, qui
campait de l'autre côté de Rome, et joignit à la dépêche un exemplaire du Moniteur.
Mon arrivée, a raconté Lesseps, devant modifier des opérations déjà commencées, le général
s'empressa de faire expédier dans plusieurs directions des ordonnances, afin
que des mouvements offensifs, qui pouvaient gêner mes négociations, ne
fussent pas exécutés[201]. — Ainsi le
général se rendit donc compte que le siège de Rome n'était pas l'objectif de
l'expédition. L'arrivée nocturne de Lesseps avait transformé le camp. On y annonçait que le but de l'expédition était complètement changé et les nouvelles de Paris entraînaient à croire qu'on allait lutter contre l'Autriche ; le bruit courait aussi que l'armée des Alpes devait descendre en Italie. Les officiers s'en montraient satisfaits[202]. Un correspondant du Times racontait : Tous les mouvements de M. de Lesseps ont été épiés, surveillés avec attention par chacun. L'empereur Napoléon, le duc Wellington lui-même n'auraient pas fait plus d'effet que le diplomate français arrivant dans de semblables circonstances. Monté sur une voiture à quatre chevaux, il a disparu comme l'éclair, laissant tout le monde dans l'ignorance et la stupéfaction[203]. — Lesseps n'aurait-il pas dû profiter de l'effet qu'il faisait pour frapper un grand coup ? On l'a dit. Il semble cependant qu'il ne le pouvait ; personne ne l'eût aidé ; seule la révolution aurait su le soutenir, mais ici encore il nous faut rappeler depuis combien de mois elle était morte. — Au lever du jour, Lesseps se rendit à Rome accompagné par La Tour-d'Auvergne. Il eut quelque peine à entrer. En faisant le tour d'une partie des murailles, dont la plupart des portes étaient barricadées, il vit, le long de la route, des poteaux sur lesquels étaient écrits en gros caractères l'article de notre constitution qui défendait d'attaquer une nationalité. Du haut des remparts, des sentinelles le couchèrent en joue, mais le valet de chambre, installé sur le siège, agitait autour d'une canne un mouchoir blanc, et les armes s'abaissaient. Enfin, une porte s'ouvrit. Un jeune officier s'avança, le colonel Médici, qui reconnut Lesseps et lui offrit ses services ; il ajoutait que la ville serait heureuse d'apprendre son arrivée. Un détachement accompagna le plénipotentiaire jusqu'à la voie Condotti, à l'hôtel d'Allemagne. J'avais jugé, a dit Lesseps[204], qu'il n'était pas encore opportun de se rendre au palais de l'ambassadeur de France. Il y reçut plusieurs visites, notamment celle du président de l'Assemblée, Charles Bonaparte. Il se rendit compte de tout ce qu'il put, alla parler aux blessés français, soignés dévotement par des dames romaines, dont la princesse Beljiojoso, et acquit la conviction que c'était bien tout le peuple romain qui entendait défendre la ville[205]. Lesseps écrivit, en effet, aussitôt au général en chef : Dans la situation d'attente où nous nous trouvons, il me paraît extrêmement important d'éviter toute espèce d'engagement. Je vois une ville entière en armes... Je trouve, ici, au premier abord, l'aspect d'une population décidée à la résistance et, rejetant les calculs exagérés, on peut compter, au moins, sur 25.000 combattants sérieux. Si nous entrions de vive force dans Rome, non seulement nous passerions sur le corps de quelques aventuriers étrangers, mais nous laisserions sur le carreau des bourgeois, des boutiquiers, des jeunes gens de famille, toutes les classes enfin qui défendent l'ordre et la société à Paris... Il faut donc que nous tenions compte de cette situation, que nous ne précipitions rien, que nous n'engagions pas notre gouvernement, contrairement au but qu'il a manifesté au commencement de l'expédition, dont il vient encore de renouveler la déclaration et, en définitive, contrairement au vœu de l'Assemblée nationale. Aussi je croirais engager très gravement ma responsabilité si je ne faisais tous mes efforts pour vous amener à suspendre tous actes d'hostilités et toutes démonstrations susceptibles d'en produire, jusqu'au moment où je vous aurai vu et où je vous aurai rendu compte de l'état de choses tel que je l'aurai constaté. Vous êtes, d'ailleurs, dans les mêmes sentiments que moi. Je déclarerai de toute façon que nos soldats ne reculeront pas d'une semelle ; votre attitude, vos bonnes dispositions ne peuvent que faciliter une conciliation honorable. Nous sommes forts, attendons ![206] Il convint de plus verbalement avec Oudinot et les autorités romaines d'une suspension d'hostilités. Parvenu là, Lesseps s'efforça plus avant dans la réalité stricte de la situation et reconnut qu'à Rome même il aurait à lutter contre les préventions d'un peuple encore fort irrité du 30 avril, tandis que, du côté de la France, il se heurtait à l'impossibilité de reconnaître la République romaine officiellement, ou même de promettre le maintien d'un gouvernement se croyant aussi légitime que le nôtre[207]. Enfin, il luttait contre l'aveuglement de certaines personnes influentes qui comptaient, pour la réussite de leur cause, sur un mouvement révolutionnaire à Paris, de même que beaucoup de personnages politiques français, même parmi les membres de notre ministère, croyaient à l'existence d'un parti modéré romain, lequel avait promis de nous faire ouvrir les portes de Rome le 30 avril et serait plus heureux, une autre fois, si nous recommencions l'attaque de la ville[208]. Il avait enfin vérifié que l'impatience de plusieurs généraux, le désir de réparer un échec personnel, les sentiments si constamment et généralement réactionnaires de nos diplomates[209], les excitations continuelles d'agents intéressés à la reprise des hostilités, l'écho des conseils peu éclairés que dirigeait Pie IX, lui suscitaient au quartier général français des obstacles moins imminents, mais plus persévérants, peut-être, que ceux dont il avait triomphé à Rome. Un résultat, qui aurait pu devenir sérieux, était cependant acquis, au point que la République romaine, se considérant libre du côté des Français, se tourna vers les Napolitains. L'honneur de cette solution fut attribué par les Romains à Mazzini. Plus que les autres, il semblait avoir eu raison, et son tort ne venait que de l'erreur où il était maintenu quant aux véritables sentiments de la majorité française. Le Moniteur romain du 15 mai déclarait : Nous n'avons plus qu'à combattre nos éternels ennemis, l'Autriche et Naples. Ainsi victorieux, pensait-il, Mazzini crut agir avec politique en se montrant intransigeant. Lesseps, comprenant dès lors qu'il ne céderait plus, tourna ses efforts contre lui. Il expliquait son plan dans son rapport à Drouyn de Lhuys : ... M. de La Tour-d'Auvergne, sur le compte duquel je n'ai pas tardé à avoir la même opinion que vous, partage tout à fait les idées que j'émets dans ce billet. M. de Gérando, homme de sens, et dont on m'a fait l'éloge au ministère avant mon départ de Paris, m'a confirmé dans ma conviction d'une résistance à peu près générale. En vous parlant de résistance, ce n'est pas que je ne sois persuadé que nos braves soldats n'en viendraient pas à bout, mais le sang coulerait abondamment de part et d'autre : c'est ce que nous ne voulons pas, ni vous, ni moi. Il racontait sa visite aux triumvirs, ainsi que les déclarations pacifiques qu'il leur avait adressées, fournissait le récit de son entente avec Oudinot, par l'entremise de La Tour-d'Auvergne, afin de faire cesser les hostilités. Il entendait venir à bout de Mazzini : J'ai émis confidentiellement l'idée de faire décider par l'Assemblée nationale qu'une députation choisie dans son sein irait au quartier général pour traiter et viendrait me demander de me joindre à elle. J'ai l'espoir que cette idée sera adoptée ; j'ai déjà reconnu par moi-même les dispositions favorables des triumvirs, du président de l'Assemblée nationale, de plusieurs députés et de quelques hommes influents dans la population. Le résultat me paraît assuré et ne nous compromet pas, puisqu'il a pour but de nous faire négocier avec le pouvoir exécutif d'un gouvernement que nous ne devons pas reconnaître officiellement ; il a été amené par des démarches qui ne m'ont pas laissé un moment de repos. Lorsque je me présenterai, avec une députation de l'Assemblée, au quartier général, il y aura lieu de conclure un arrangement[210]. Il transmettait au ministre la copie de son projet, annonçant qu'il en discuterait les bases le lendemain matin avec le général, et, sans doute, M. d'Harcourt. Vous jugerez, disait-il, s'il concilie les intérêts si compliqués que nous avons à ménager, s'il réserve au gouvernement de la République pour suivre, selon les intérêts et les circonstances nouvelles, une politique claire et décidée. Mazzini, flairant le coup, voulut le prévenir en cherchant à se faire élire lui-même délégué. Le temps pressait, l'Assemblée devant prendre une décision pour le 17. Le 16 au soir, Lesseps, averti, s'efforça devoir le dictateur. Un révolutionnaire auquel il avait sauvé la vie quelques années auparavant, et qui lui était resté dévoué, lui fit savoir comment il pourrait, cette nuit même, rejoindre Mazzini dans ses appartements particuliers[211]. Lesseps put donc reprocher à Mazzini sa conduite et se sentit rassuré, au moins momentanément. Le lendemain matin, le 17, il alla s'entendre au camp français avec Oudinot sur les propositions à faire aux délégués. D'Harcourt déclara qu'il n'y avait aucune concession à attendre de la cour pontificale et se montra intransigeant à l'égard des Romains ; il exigeait l'entrée rapide de nos troupes dans la Ville Éternelle. Oudinot, quant à lui, déjà quelque peu différent de celui que Lesseps avait connu à son arrivée, réclamait la démission du pouvoir exécutif. Lesseps fit ressortir que cette clause était contraire à tout ce qui avait été dit à l'Assemblée par le gouvernement français et sur la proclamation même du général ; néanmoins, désireux de se mettre d'accord à tout prix, il céda. L'entente s'établit alors sur trois articles : 1° aucune entrave ne sera apportée par l'armée française à la liberté des communications de Rome avec le reste des États romains ; 2° l'armée française sera accueillie comme une armée de frères ; 3° le pouvoir exécutif actuel cessera ses fonctions ; il sera remplacé par un gouvernement provisoire composé de citoyens originaires des États romains et désignés par l'Assemblée nationale romaine jusqu'au moment où les populations appelées à faire connaître librement leurs vœux se seront prononcées sur la forme du gouvernement qui devra les régir et sur les garanties à consacrer en faveur du catholicisme et de la papauté. Lesseps apprenait que l'Assemblée avait à l'unanimité décidé qu'une commission de trois membres serait désignée, et qui comprendrait : MM. Sturbinetti, Andino, de Bologne, et Cernuschi. Ce dernier, Milanais, qui n'accepta pas, par délicatesse, fut remplacé par M. Agostini. Avant la séance qui avait précédé ce vote, Lesseps avait reçu dans son salon plusieurs hommes politiques, dont Charles Bonaparte. On avait essayé d'abord d'établir une distinction entre les intentions du plénipotentiaire, celles de son gouvernement et celles du général Oudinot. On lui avait demandé aussitôt les moyens de détruire les préventions qui existaient à ce sujet dans la population romaine. En rapportant cet épisode au ministre, notre envoyé développait : Je leur dis alors que rien n'était plus facile puisque vous veniez de m'écrire, en date du 10, en donnant votre approbation à la conduite du général Oudinot, qui avait cru devoir faire partir de Civita-Vecchia un envoyé du Saint-Père dont la présence produisait un effet fâcheux et gênait notre action. Je n'ai pas besoin, M. le ministre, de vous assurer que je ne dis que ce que je suis obligé de dire pour sortir du pas le plus difficile peut-être dans lequel nous avons été engagés depuis longtemps, que, pour le reste, je suis très réservé vis-à-vis de tout le monde et que si j'écoute les hommes de tous les partis, de toutes les conditions, de toutes les nations qui viennent à moi, depuis cinq heures du matin jusqu'à minuit, et reçoivent naturellement un bon accueil, c'est pour accomplir aussi bien que possible la mission que vous m'avez confiée. Mazzini avait remis à Lesseps, sur sa prière, une note explicative sur la manière dont il envisageait la situation actuelle de Rome, et notre agent la joignit à sa lettre, non sans laisser entendre qu'il l'estimait remarquable. Mazzini, après avoir prouvé combien la République avait été calomniée en Europe, avançait : La France ne nous conteste sans doute pas le droit de nous gouverner comme nous l'entendons, le droit de tirer, pour ainsi dire, des entrailles du pays, la pensée qui règle sa vie et d'en faire la base de nos intentions. La France ne peut que nous dire : En reconnaissant votre indépendance, c'est le vœu libre et spontané de la majorité que je veux reconnaître. Liée aux puissances européennes et cherchant la paix, s'il était vrai qu'une minorité s'opposât chez nous aux tendances nationales, s'il était vrai que la forme actuelle de votre gouvernement ne fût que la pensée capricieuse d'une faction substituée à la pensée commune, je ne pourrais pas voir avec indifférence que la paix de l'Europe fût mise continuellement en danger par les emportements de l'anarchie qui doivent nécessairement caractériser le règne d'une faction. Nous reconnaissons ce droit à la France, car nous croyons à la solidarité des nations pour le bien. Mais nous disons que si jamais il y eut un gouvernement issu de ce vœu de la majorité et maintenu par elle, ce gouvernement, c'est le nôtre[212]. La république s'est implantée chez nous par la volonté du suffrage universel, elle a été acceptée avec enthousiasme. Elle n'a rencontré d'opposition nulle part. Et remarquez bien que l'opposition ne fut jamais si facile, si peu dangereuse, je dirai même si provoquée, non par des actes, mais par les circonstances exceptionnellement défavorables dans lesquelles elle s'est trouvée placée à son début. Le pouvoir sortait d'une longue anarchie de pouvoirs, inhérente à l'organisation intime du gouvernement déchu. Les agitations inséparables de toute grande transformation, fomentées en même temps par les crises de la question italienne et par les efforts du parti rétrograde, l'avaient jeté dans une excitation fébrile qui le rendait accessible à toute tentative hardie, à tout appel aux intérêts et aux passions. Nous n'avions pas d'armée, pas de puissance répressive. Conséquence des dilapidations antérieures, nos finances étaient appauvries, épuisées. La question religieuse, maniée par des mains habiles et intéressées, pouvait servir de prétexte auprès d'une population douée d'instincts et d'aspirations magnifiques, mais peu éclairée. Et cependant, aussitôt le principe républicain proclamé, un premier fait incontestable se produisit : l'ordre. L'histoire du gouvernement papal ne détaille pas ses émeutes ; il n'y a pas une seule émeute sous la République. L'assassinat de M. Rossi, fait déplorable, mais isolé, excès individuel, repoussé, condamné par tout le monde[213], provoqué peut-être par une conduite imprudente, et dont la source est restée ignorée, fut suivi par l'ordre le plus complet. La crise financière atteignit son apogée ; il y eut un instant où le papier de la République ne put, par suite de manœuvres indignes, s'escompter jusqu'à 41 ou 42 %. L'attitude des gouvernements italiens et européens devint de plus en plus hostile. Difficultés matérielles et isolement politique, le peuple supporta tout avec calme. Il avait foi dans l'avenir qui sortirait du nouveau principe proclamé. Par suite de menaces obscures, mais, surtout, du manque d'habitudes politiques, un certain nombre d'électeurs n'avaient pas contribué à la formation de l'Assemblée. Et ce fait paraissait affaiblir l'expression du vœu général. Un second fait caractéristique, vital, vint répondre d'une manière irréfutable aux doutes qui auraient pu prévaloir. Il y eut, peu de temps avant l'installation du triumvirat, réélection des municipalités. Tout le monde vota, partout, et, toujours, l'élément municipal représenta l'élément conservateur de l'État. Chez nous, on redouta, un instant, qu'il ne représentât un élément rétrograde. Eh bien ! l'orage avait éclaté, l'intervention était entourée ; on aurait dit que la République n'avait plus que quelques jours à vivre ; et ce fut ce moment que les municipalités choisirent pour faire acte d'adhésion spontanée à la forme choisie. Pendant la première quinzaine de
ce mois, aux adresses des cercles et des commandants de la garde nationale,
vinrent se joindre, deux ou trois exceptées, celles de toutes les
municipalités. J'ai eu l'honneur, Monsieur, de vous en transmettre la liste.
Elles proclament toutes un dévouement explicite à la République et une
profonde conviction que les deux pouvoirs, réunis sur une seule tête, sont
incompatibles. Ceci, je le répète, constitue un fait décisif. C'est une
seconde épreuve légale complétant la première, de la manière la plus absolue
et constatant notre droit. Aujourd'hui, au milieu de la crise, en face de
l'invasion française, autrichienne et napolitaine, nos finances se sont
améliorées, notre crédit se refait ; notre papier s'escompte à 12 % ; notre
armée grossit chaque jour, et des populations entières sont prêtes à se
soulever derrière elle. Vous voyez Rome, Monsieur, et vous connaissez la
lutte héroïque que soutient Bologne. J'écris ceci, dans la nuit, au milieu du
calme le plus profond. La garnison a quitté la ville hier soir. Et avant
l'arrivée de nouvelles troupes, à minuit, nos portes, nos murailles et nos
barricades étaient, sur un simple mot passé de bouche en bouche, garnies,
sans bruit, sans forfanterie, par le peuple en armes. Il y a, au fond du cœur
de ce peuple, une décision bien arrêtée : la déchéance du pouvoir temporel
investi dans le pape, la haine du gouvernement des prêtres, sous quelque
forme, mitigée, détournée, qu'il puisse se présenter. Je dis la haine, non
des hommes, mais du gouvernement. Envers les individus, notre peuple s'est
toujours, Dieu merci, depuis l'avènement de la République, montré généreux ;
mais l'idée seule du gouvernement clérical du roi-pontife le fait frémir. Il
luttera avec acharnement contre tout projet de restauration. Il se jettera
dans le schisme plutôt que de la subir. Lorsque les deux questions se
posèrent devant l'Assemblée, il se trouva quelques membres timides qui
jugèrent la proclamation de la forme républicaine prématurée, dangereuse,
vis-à-vis de l'organisation européenne actuelle ; pas un seul pour voter
contre la déchéance. Droite et gauche se confondirent. Il n'y eut qu'une
seule voix pour crier : le pouvoir temporel de la papauté est à jamais aboli.
— Avec un tel peuple, que faire ? y a-t-il un
gouvernement libre qui puisse s'arroger, sans crime et contradiction, le
droit de lui imposer un retour au passé ? Ce retour au passé, songez-y bien,
Monsieur, c'est le désordre organisé, c'est la lutte des sociétés secrètes à
recommencer, c'est l'anarchie jetée au sein de l'Italie, c'est la réaction,
la vengeance inoculée au cœur d'un peuple qui ne demande qu'à oublier ; c'est
un brandon de guerre en permanence au cœur de l'Europe ; c'est le programme
des partis extrêmes remplaçant le gouvernement d'ordre républicain, dont nous
sommes aujourd'hui les organes. Ce n'est pas la France qui peut vouloir cela,
ce n'est pas son gouvernement, ce n'est pas un neveu de Napoléon. Ce n'est
pas surtout en présence du double envahissement des Napolitains et des
Autrichiens. Il y aurait aujourd'hui, dans la poursuite d'un dessein hostile,
quelque chose qui rappellerait le concert hideux de 1772 contre la Pologne.
Il y aurait, au reste, impossibilité de réalisation, car ce ne serait que sur
des monceaux de cadavres et sur les ruines de nos villes que le drapeau
renversé par la volonté du peuple pourrait se relever... Mazzini
avait, en outre, écrit à Lesseps pour se plaindre que des courriers romains
avaient été arrêtés aux portes de la ville par nos troupes. Que signifie cette cessation des hostilités si nous
continuons d'être cernés et entravés... Quel
effet cela doit-il produire sur nos populations si ce n'est celui de croire que
la trêve n'est, pour nous, qu'un mot vide de sens ?... Lesseps, dans
sa réponse, utilisa le malentendu afin de ne pas se laisser séparer du
gouvernement qu'il représentait. Après avoir garanti que l'affaire des
courriers s'arrangerait de suite, il disait : On
pourrait induire de quelques paroles prononcées hier, à la Chambre, que l'on
cherchait à faire une distinction entre la conduite et les intentions de mon
gouvernement. Je dois avoir la loyauté de vous déclarer que, si les pouvoirs
avec lesquels nous allons traiter ont une telle idée ou si un langage, qui en
serait la conséquence, était tenu, soit contre le président de la République
française, soit contre les ministres qui m'ont envoyé à Rome, soit contre
l'honorable et brave général Oudinot, toute négociation serait rompue à
l'instant... Forbin-Janson avait été chargé de porter à Paris la lettre
du plénipotentiaire à son ministre. Il devait aussi renseigner de vive voix
sur les véritables dispositions du peuple romain. Mais, tandis que Mazzini,
battu quant au choix des délégués, s'arrangeait à leur laisser le moins de
pouvoirs, Oudinot confiait également des lettres à Forbin-Janson et dans
lesquelles il desservait Lesseps, qui, naturellement, l'ignorait ; il l'y
représentait de la façon la moins équivoque comme une entrave[214]. Il répondait,
d'autre part, au président de la République dont la lettre l'avait affermi
dans ses résolutions : L'armée française est aux
portes de Rome. Quelque vaste que soit l'enceinte de cette place, elle est
entièrement investie. Bientôt nos pièces de siège seront en batterie. Maîtres
du haut et du bas Tibre, à cheval sur la route de Florence, nous avons intercepté
toute communication, et nous avons une pleine liberté d'action. Dès
aujourd'hui, la soumission absolue du parti qui domine Rome nous serait
infailliblement assurée si le Moniteur du 8 n'était de nature à
ranimer de fatales espérances. Quoi qu'il puisse arriver au surplus, la
France sera sous très peu de jours l'arbitre des destinées centrales. Bientôt
notre gouvernement recueillera les fruits de la politique énergique et
généreuse qu'il prétend suivre et que vous lui inspirez. Au ministre
de la Guerre, il déclarait, le 18 : Le moment est
venu de fixer le point d'attaque... Notre
forte situation sur plusieurs points ne peut laisser aux Romains aucun doute
sur l'issue d'une lutte prolongée[215]. Des renforts
considérables arrivaient tous les jours et, en ce moment même, on embarquait
à Toulon vingt pièces d'artillerie de siège, avec des bombes, des obus, et
mille barils de poudre. La politique de Falloux se continuait et la cour de Gaëte
y avait la main. La sixième conférence, qui se réunit le 26 mai dans la ville
bourbonienne, prouva bien définitivement son esprit et que le gouvernement
français, malgré sa bonne volonté sur ce point, n'avait plus aucune excuse à
croire aux intentions conciliantes du Saint-Siège[216]. Le comte
Ludolf, ministre des Affaires étrangères de Naples, montra la plus vive
irritation contre la France et Oudinot ; il les rendait responsables du
désastre de l'armée napolitaine à Velletri par Garibaldi. Il reprocha au chef
de l'expédition romaine d'avoir laissé trop longtemps flotter le drapeau
mazzinien à Civita-Vecchia. L'ambassadeur d'Autriche fit preuve de la même
aigreur : Le ministre a déclaré, dit-il, que l'intervention de la France a pour objet d'empêcher
celle des autres puissances. Peut-être la France prétendrait-elle se charger
à elle seule de la restauration du pape. Rayneval riposta : Puisque, à tort ou à raison, les Napolitains et les
Autrichiens ne se montraient pas trop favorables à la cause italienne, la
France a cru de son devoir de la défendre avec son propre drapeau, sans que
son intervention eût quelque chose d'hostile à l'intervention autrichienne,
napolitaine, espagnole. Antonelli déclara : Certainement,
le retour au régime antérieur de 1846 est impossible. Au reste, il faut avoir
pleine confiance dans les dispositions du Saint-Père. Mais, maintenant est
hors de propos toute discussion sur l'organisation future du pouvoir
pontifical. Mon devoir est de vous rappeler qu'il convient de ramener la
confiance à son véritable objet, qui est de déterminer les moyens
d'intervention pour le rétablissement du pouvoir temporel du pape. D'autant
que les armées étant en marche, il pourrait en résulter les plus fâcheuses
conséquences si leurs façons d'agir réciproques n'étaient pas réglées avec
précision. Rayneval avait échoué. Il en éprouvait vraisemblablement un
certain ennui en tant que Français, et une vague satisfaction en tant que
catholique. Le 20 mai, il écrivait à Oudinot : Les
plénipotentiaires et Antonelli sont très offusqués de la séance du 7 mai.
Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour les tranquilliser. Nous sommes
entre trois ou quatre formidables écueils. Ménager les susceptibilités de l'Assemblée
tant qu'elle continuera à vivre, avoir l'air d'être ennemi de l'Autriche sans
lui faire la guerre et rester ami du pape sans en avoir l'air. Éviter de nous
engager à faire prévaloir des conditions que le pape refuserait, ne fût-ce
que pour ne pas paraître recevoir la loi, promettre sans pouvoir tenir serait
un triste rôle. Ne pas nous faire de la cour de Rome, je ne dis pas une
ennemie, c'est déjà fait, mais une ennemie irréconciliable. Rome jouera son
rôle chez nous tant qu'on y dira la messe[217]. L'affaire romaine était naturellement influencée par les élections, et Drouyn de Lhuys, un moment si ferme, au moins en apparence, à réclamer de la cour de Gaëte le manifeste qui devait être à la fois la garantie des Romains et la justification de la France, le renvoyait peu à peu, selon les événements, jusqu'à permettre ainsi, en quelque sorte, la catastrophe finale. Un moment même, au moins devant l'ambassadeur de Naples à Paris, le ministre s'était déclaré très mécontent d'Oudinot et faisait observer que le pape était l'artisan de la brouille qui semblait devoir s'établir entre les nations catholiques[218]. Comme on paraissait ne pas l'entendre, Drouyn de Lhuys avait ajouté, au cours d'une autre entrevue, et tout en ne le pensant pas, que si le pape ne consentait pas décidément, à son manifeste, la France serait obligée de se mettre à la tête du mouvement en Italie[219]. Le nonce ayant été chargé, au lieu de nous répondre comme certains le rêvaient, de faire des remontrances, le ministre renouvela ses déclarations, et toujours, sans doute, en persévérant, à part lui, dans les mêmes réserves : La France attend la promesse d'institutions constitutionnelles et laïques, sinon 20.000 Français occuperont Rome, y créeront des institutions libérales, et attendront d'y être attaqués par quelque allié du pape qui n'aurait pas en le restaurant les mêmes intentions ; nous laisserons à Pie IX, et particulièrement à ses conseillers, la responsabilité des complications qui peuvent résulter de cette obstination cardinalesque[220]. A la suite de l'armistice obtenue par Lesseps, il put renouveler de plus belle son essai d'intimidation. Il disait que la meilleure issue pour la République française serait de s'entendre avec la République romaine et que cette entente serait d'autant plus salutaire pour les deux pays qu'elle arrangerait tout à Rome en même temps qu'elle ferait cesser en France l'irritation causée par la supposition que le drapeau tricolore servait au rétablissement du pouvoir absolu des prêtres. L'ambassadeur napolitain s'indigna : Soyez bien persuadés en tout cas, dit Drouyn de Lhuys, que nous ne prendrons pas des engagements qui puissent compromettre l'attitude ultérieure de la République. Antonelli ayant alors demandé, en cas où les troupes françaises se retireraient à Civita-Vecchia, si le gouvernement interdirait aux autres pays de forcer la résistance des Romains, Drouyn de Lhuys répondit évasivement, mais d'une façon caractéristique : Dans l'état actuel des choses en Europe, et dans la position violente où se trouve la République française, il serait sage et désirable que les Napolitains, les Autrichiens ne se trouvassent pas en contact avec les troupes françaises ; car ces troupes sont travaillées par des sentiments bien contraires aux principes que représentent les souverains alliés. Néanmoins, Drouyn de Lhuys laissait bien comprendre par son insistance que, d'abord, Rome serait, coûte que coûte, mise à la raison, et que même, son plus grand désir était de s'entendre avec le pape. Quand on allait au fond des choses, on remarquait que les menaces étaient vaines, surtout intéressées ; il n'y fut donné aucune suite. Enfin, si le ministre adoptait, pour les nécessités de sa politique, une attitude pareille en face l'ambassadeur du roi de Naples, en même temps il écrivait à Oudinot : Paris, 26 mai... Je vous envoie ci-joint la copie d'une dépêche que j'écris à M. de Lesseps pour lui annoncer que le gouvernement de la République ne peut donner son assentiment aux bases de la convention qu'il négociait avec le gouvernement romain. Je n'ai pas besoin de vous recommander de ne faire usage de cette notification qu'avec les ménagements convenables pour ne pas affaiblir les moyens d'action de M. de Lesseps. Vous voudrez bien vous concerter avec lui sur les mesures à prendre, par suite de la détermination que je vous fais connaître, pour vous replacer l'un et l'autre sur le terrain indiqué par les instructions émanées de mon département. Et la minute portait ces mots raturés : ... et dont le résultat est de replacer les choses où elles étaient avant les négociations[221]. A Lesseps, qui se débattait au milieu des complications nouvelles que nous étudierons plus loin, il disait brutalement que la convention était inadmissible. Il semblait évident que son but était d'arrêter l'agent de l'Assemblée. Il avait été soi-disant envoyé pour arrêter le mauvais effet, non seulement de la politique personnelle d'Oudinot, mais encore de celle du ministère, et on lui opposait tout à coup, presque sans explications, les instructions même contre lesquelles il avait été désigné. On le prévenait, en outre, assez tardivement, le gouvernement évitant avec soin de prendre aucune décision grave avant la dissolution de l'Assemblée nationale. — Ainsi les préférences ministérielles n'avaient guère cessé de s'accentuer et de se mieux définir, à peine contenues un moment par la pression parlementaire. La fin de la Constituante aidait Oudinot. Le gouvernement n'avait-il pas dit la messe pour fêter l'avènement de la République ? Sur qui s'appuyer afin d'empêcher la politique suivie vis-à-vis de Rome ? Tout en protestant dans sa minorité, la Constituante laissait l'aventure se poursuivre et, dans sa majorité, la favorisait ; elle avait permis jusqu'au bout, encouragé par son silence, le procès de Bourges ; elle semblait aider le destin qui la condamnait à disparaître[222]. Le procès de Bourges n'avait été lui-même que le résumé des procès précédents, laissés plus ou moins de côté, exprès : celui du Calvados, qui jugea les fauteurs de l'insurrection de Rouen ; celui de la Haute-Vienne, qui décida sans exactitude sur les troubles de Limoges. Partout on sentait un recul de l'idée républicaine. La lutte entre les divers groupes républicains s'était déroulée tout au long, comme l'incapacité des nombreux commissaires, comme le manque de préparation des Français à se gouverner eux-mêmes et, peut-être, leur paresse méfiante à ce sujet. Sur l'anniversaire du 24 février, les Débats avaient dit tranquillement, impunément : La République s'est échappée par surprise, il y a un an, des mains ignorantes qui se vantent aujourd'hui de l'avoir fondée... L'anniversaire de février peut être une fête de famille, ce ne sera jamais une fête nationale[223]. Dans diverses crises précédentes, les Débats avaient déclaré bien comprendre, avec la presse conservatrice, la véritable République. * * *Les élections prochaines étaient préparées, comme toujours, par les partis, — et avec un soin extrême, cette fois, par les hommes de la rue de Poitiers, — mais l'expérience des luttes précédentes, ce que l'on appelait l'imminence du danger, le fait aussi, que Louis-Napoléon, maintenant à l'Elysée, tout en demeurant à lui seul un parti, ne participait plus directement à cette mêlée-là, simplifièrent les cadres. La réaction accrochée, presque de suite, à l'élan de Février, avait progressé d'une manière ininterrompue, tout en groupant d'anciens adversaires ; elle avait cependant, d'autre part, — nous l'avons indiqué déjà, — condamné ce qui subsistait du parti révolutionnaire ouvrier, petit noyau après les journées de Juin, les déportations et le procès de Bourges. Le gouvernement se tenait un peu, en somme, entre les conservateurs et les partisans de la république démocratique et sociale, comme Louis Bonaparte même entre les monarchistes et les parlementaires, malheureusement dans l'impossibilité, parmi tant d'intérêts en lutte, de garder toute indépendance. Le comité de la rue de Poitiers, en pleine vigueur, agissait comme avant l'élection de décembre, à visage plus découvert, à grands renforts de brochures et d'intrigues, heureux d'accueillir parmi ses soldats les anciens comités de défense religieuse amenés par Montalembert[224]. Le parti dit de l'ordre, grâce au président de la République, qu'il subissait avec les apparences de la satisfaction, débarrassé désormais des éléments du National, comprenait avant tout les orléanistes et les légitimistes. Il aurait aimé recueillir M. Guizot qu'il écarta par prudence, de peur de nuire à sa cause, et sans doute parce que Thiers était là[225]. La classe bourgeoise se décomposait en deux grandes fractions qui avaient tour à tour prétendu à l'hégémonie : la grande propriété foncière sous la Restauration, la bourgeoisie industrielle sous la monarchie de Juillet. Bourbon était le nom royal qui couvrait la prépondérance des intérêts d'une fraction. Orléans désignait la prééminence des intérêts de l'autre. Le règne anonyme de la République était le seul sous lequel ces deux fractions pussent faire prévaloir les intérêts communs de leur classe en une domination unique, sans qu'elles dussent renoncer pour cela à leur rivalité réciproque. La république bourgeoise ne pouvait être que la domination parfaite, pure et simple, de la classe bourgeoise toute entière. Pouvait-elle, dès lors, représenter autre chose que le règne des orléanistes complétés par les légitimistes et celui des légitimistes complétés par les orléanistes, autre chose que la synthèse de la Restauration et de la monarchie de Juillet ? Les républicains du National ne représentaient pas une fraction importante de leur classe au point de vue économique. Ils n'avaient qu'une seule importance, un seul titre historique : c'était d'avoir, sous la monarchie, à l'encontre des deux fractions de la bourgeoisie, qui ne concevaient que leur régime particulier, préconisé le régime général de la classe bourgeoise, le règne anonyme de la république, qu'ils idéalisaient, il est vrai, et décoraient d'arabesques antiques, mais en lequel ils saluaient surtout la suprématie de leur coterie. Si le parti du National s'était trouvé désorienté en apercevant les royalistes coalisés à la tête de la République qu'ils avaient fondée, les royalistes, par contre, ne s'illusionnaient pas moins sur le fait de leur suprématie commune. Ils ne comprenaient pas que si chacune de leurs fractions était royaliste, le produit de leur combinaison chimique devait être nécessairement républicain : la monarchie blanche et la monarchie bleue devaient se neutraliser dans la république tricolore. S'opposant au prolétariat révolutionnaire et aux classes intermédiaires qui se concentraient autour du prolétariat, le parti de l'ordre était obligé d'avoir recours à la coalition de ses forces et de maintenir en état de conservation l'organisation de ses forces coalisées. Chacune des deux fractions de ce parti devait faire prévaloir, à l'encontre des désirs de restauration et d'hégémonie de l'autre, la suprématie commune, la forme républicaine de la suprématie bourgeoise, Les royalistes qui, au début, croyaient à une restauration immédiate, qui, plus tard, conservaient la république l'écume et l'invective aux lèvres, finissaient par accorder qu'ils ne pourraient vivre en bonne intelligence que sous la seule république et par remettre la restauration à une date indéterminée. La jouissance commune du pouvoir renforçait même chacune des deux fractions, rendait, par suite, chacune d'elles plus incapable encore et moins disposée à se subordonner à l'autre, c'est-à-dire à restaurer la monarchie[226]. N'était-ce pas surtout la bourgeoisie de la banque qui avait régné sous Louis-Philippe ? La bourgeoisie industrielle s'essayait, faisait ses premières armes sérieuses, dépendait trop de la banque, qui la tenait en tutelle, pour être au premier plan, au point qu'elle se tourna même un jour vers le socialisme, en la personne de Louis Blanc, curieuse de voir si, de ce côté, elle ne trouverait pas quelque issue. Le second Empire fut, à un bien plus haut degré et réellement, l'ère de la bourgeoisie, foncière, boursière, industrielle, en les mettant, — elle aussi, — d'accord. Réaction et révolution, corrélatifs l'un de l'autre, s'engendrant réciproquement, sont, pourrait-on dire, inévitables ; le gouvernement devait les utiliser pour le mieux du pays, modérant les uns par les autres, contraignant la réaction à transiger avec la révolution. Il n'y a peut-être pas d'exemple, aussi bien dans l'antiquité que de nos jours, d'un gouvernement qui n'ait été révolutionnaire. Isolé, trop inquiet, le pouvoir de 1849 en jugea autrement, et le prince-président, n'ayant pas la possibilité d'agir, remit à plus tard, ici encore, oubliant un peu vite qu'il s'engageait avec ses ennemis[227]. Nous avons vu qu'une grande partie du pays l'entraînait de ce côté. La France de 1848 différait assez de la France actuelle. En majeure partie, elle était agricole, et si de là venait, peut-être, sa réserve physique, de là découlaient aussi, par suite des conditions rudimentaires et volontairement isolées, inhérentes alors à la vie agricole, une absence d'éducation et une infériorité industrielle nuisibles. Les sociétés financières étaient très rares ; on comptait les grandes industries. Dans plus d'un endroit, le régime de l'atelier familial demeurait implanté. Les chemins de fer, espacés encore, nécessitaient, sur de nombreux points, la continuation des diligences. Le commerce se faisait par roulage. Dans plusieurs villages, le touriste se serait cru au XVIIIe siècle, et des habitudes séculaires gardaient aux diverses contrées du territoire leur caractère. Malgré la Révolution, les classes restaient séparées. — Le premier moment de surprise évanoui, il est facile d'imaginer le formidable contre-coup réactionnaire qui devait suivre à travers une nation si rapidement bouleversée par sa capitale, d'où survenaient les événements les plus terribles et les plus imprévus à ses yeux, car Paris tranchait complètement sur la province. Il est bien évident que le malaise de la société française, déjà si réel sous Louis-Philippe[228] et sous la seconde partie de la Restauration, surtout depuis 1824, avait augmenté. Sous Louis-Philippe, les causes en avaient été multiples, et nous en avons déjà signalé les grandes lignes. Une des raisons initiales était sans doute la disproportion entre le principe de l'individualité, qui s'affermissait partout, révélé comme la loi même du siècle[229], encore que souvent renié par peur[230], et les moyens de le mettre en œuvre, insuffisamment répartis entre les hommes, non seulement par rapport à leurs prétentions, mais aussi à leurs capacités. Les capacités elles-mêmes ignoraient les moyens de la lutte et de la conquête. Tournées vers l'avenir, tout en demandant le mot d'ordre au passé révolutionnaire, au lieu de scruter profondément et patiemment le présent, elles s'égaraient sur des voies abandonnées, dans les couloirs souterrains des conspirations charbonniques ou le long de tirades sentimentales, cantiques d'une religion révolutionnaire à la fois mystique et violente qui avait ses bons côtés, mais à condition de s'unir étroitement à l'action positive au dehors. Une négation plus étudiée de l'actualité leur eût appris à vaincre celle-ci par l'arme même qu'elle mettait en leurs mains, cet individualisme renié trop vite, et le correctif d'organisation qui s'y juxtaposait, l'industrie. Une infime minorité[231] du prolétariat comprit seule que son devoir, puisque l'accès au pouvoir politique par le bulletin de vote lui était dénié, consistait à préparer son rôle économique ; si cet instinct s'était généralisé, quelle ne se fût pas affirmée la force du peuple au lendemain de Février ! Il eût été presque le maître, la bourgeoisie gouvernementale et commerçante étant demeurée sur le seul terrain politique. Il aurait contraint la bourgeoisie industrielle à compter avec lui nécessairement, bon gré, mal gré[232]. Mais, empêtré de catholicisme, retenu par le sentiment d'une fatalité supérieure, inapte, par cela même, à tendre en lui les ressorts de la réflexion et de l'action patientes, comme avait fait la bourgeoisie jadis, il se contenta d'un anathème stérile qui, faute de se compléter d'une action efficace, le voua d'avance à la défaite. Dans son combat contre l'individualisme, il avait joué le rôle de don Quichotte en lui opposant le communisme absolu[233], sans pressentir, même par instinct, ce que cet individualisme comportait de fécond, de dur et de beau. Ses excès entraînaient son remède ; en développant le moi jusqu'à son extrême, il lui faisait sentir ses limites certaines ; en portant la bourgeoisie à sa plus haute puissance, il la forçait à l'examen de conscience, à se renouveler ou à disparaître. La bourgeoisie n'était plus le tiers-état, c'est-à-dire, selon la définition de Sieyès, la nation française, moins la noblesse et le clergé ; par cela même, elle se préparait à un autre rôle. Elle s'était prétendue tout. Mais sa nature, qui est de propager les prérogatives de l'individu dans tous les citoyens, du plus grand au plus petit, du premier au dernier, l'emportait malgré elle. A travers la décomposition orléaniste dont Louis-Philippe, simple et tranquille, avait été le conducteur, en quelque sorte le révolutionnaire pratique[234], au point, avec le modèle des épouses, et en étant lui-même le modèle des maris, de tuer la famille à force d'en faire avant tout une sorte de raison sociale subordonnée à l'argent, à travers le champ des idées labouré brusquement par le soc de Février, une donnée nouvelle se faisait jour. Les partis brisés s'aggloméraient en vain, de nouveau ; ils étaient d'avance éphémères et les indications de Saint-Simon, d'Auguste Comte, de Proudhon, se prouvaient sinon exactes, du moins nécessaires au monde, appelé à se reconstituer sur une base plus large. L'opposition allait être entraînée à devenir économique. L'intérêt dominait à cette heure, mais porterait aussi chacun dans un avenir proche à posséder la conscience, — plus ou moins juste, d'ailleurs, — de son droit ; et cette conscience, plus ou moins développée, éveillerait dans le prolétariat la capacité politique qui était demeurée jusque, vers 1832, l'apanage exclusif de la bourgeoisie. Cela était si vrai que la nécessité politique s'imposait au premier plan et que Louis-Napoléon paraissait résulter, en partie, de ce qu'aucune classe n'était prête pour la trancher, la bourgeoisie trop atteinte, n'ayant encore su se reprendre, le prolétariat insuffisamment prêt. Plus encore, nous avons reconnu que le scepticisme avait prouvé la nécessité d'une donnée nouvelle également, dans l'ordre moral, poussant ainsi, par ailleurs, la politique à la révolution religieuse, et l'affaire de Rome démontrait l'incapacité créatrice de ceux qui avaient mission d'agir en ce sens. Aucun docteur de la bourgeoisie n'était capable de révéler une théodicée nouvelle après avoir dressé la synthèse de la philosophie et de la science. Nul n'apportait le dogme nouveau qui eût donné naissance à un gouvernement issu d'une grande origine, un de ces gouvernements qui marquent les phases de l'émancipation humaine et lèguent aux nations un repos de plusieurs siècles[235]... Les influences générales et particulières ne firent donc pleuvoir sur les citoyens de l'avenir que doute, incertitude, contradiction et ne laissèrent au fond de leur cœur, pour les plus hautes questions qui doivent occuper l'homme, que dédain ou indifférence. Le niveau de l'intelligence nationale en fut singulièrement abaissé[236]. Les événements emportaient les hommes et leur commandaient, en paraissant même leur laisser de moins en moins de répit. L'expédition romaine, venue de nos discordes, facilitée par la guerre civile, et à laquelle cette guerre civile empêchait justement de donner la solution qu'elle comportait, le désespoir des républicains, la fureur de la Montagne, l'indécision des esprits, l'incohérence des politiques les plus réputés, l'absence d'hommes véritablement trempés pour une lutte de ce genre ou l'impossibilité de parvenir à laquelle les meilleurs, peut-être, à jamais inconnus, furent condamnés, enfin le choléra emportant chaque jour de nouvelles victimes, amalgament un tableau sombre dont le morne aspect plombé, lourd de résignation pourtant mécontente, est pénible[237]. Les circulaires de la rue de Poitiers surprennent par leur insignifiance malgré qu'on la sache, quelquefois, voulue ; leur appel à l'ordre sonne faux. Du côté opposé, les revendications, malgré leur bien fondé, suggèrent le sentiment qu'elles ne peuvent aboutir, et par suite de leurs exagérations, — l'exagération à été la faute constante, toujours la plus grave, des révolutionnaires, — et parce que les éléments généraux de la société française, telle qu'elle existe alors, ne le permettent pas. La presse démocratique et sociale, ainsi qu'elle s'intitulait, avait proclamé son programme le 5 avril. Considérable, inquiet, désordonné, quoique judicieux, il résumait bien les aspirations de l'époque : La république et la société tout entière sont en danger, indiquait le préambule. Une fraction incorrigible rêve le retour de la monarchie ; elle sait qu'en peu de temps le développement régulier du régime suffirait pour renverser de fond en comble les abus et les privilèges. Cette assurance ne montre-t-elle pas ses illusions ? Il est vrai que nous jugeons d'une rive que son honnêteté quelquefois un peu simple se serait refusée même à prévoir... Aux prochaines élections, le suffrage universel, conquis par la République, deviendrait, entre les mains des royalistes, une arme contre la République elle-même, si les démocrates ne s'empressaient d'opposer la lumière aux ténèbres, la vérité au mensonge... On accuse les républicains socialistes de vouloir détruire la famille, la propriété. Ceux qui veulent rendre les avantages de la propriété et les joies de la famille sensibles à tous, n'attaquent ni la famille ni la propriété. Ceux, au contraire, qui veulent réserver au petit nombre les jouissances du foyer domestique et les privilèges de la propriété, ceux qui veulent maintenir l'exploitation des travailleurs, ceux-là sont les véritables ennemis de la famille... Le programme réclamait, entre autres choses, la défense de la France républicaine et du suffrage universel direct, le maintien et le développement de la constitution dans le sens démocratique, l'unité du pouvoir, la subordination formelle de l'exécutif à l'Assemblée nationale. Il voulait l'inviolabilité du droit au travail, l'éducation commune, gratuite, obligatoire et intégrale, en raison des aptitudes. La réforme administrative et judiciaire, la justice véritablement gratuite, l'abolition de la conscription, la réforme financière, dont l'organisation du crédit foncier, agricole, industriel et commercial, ainsi que la neutralisation, au profit de la société tout entière, des assurances, de la banque, des chemins de fer, des mines, enfin l'abolition de l'usure, la réduction du budget, le développement de l'agriculture et de l'industrie, l'affranchissement des peuples, la fraternité des races montrent l'ampleur des questions à réaliser. C'était un monde en quelques lignes, le cosmos démocratique et social, moins l'harmonie, l'organum d'une société nouvelle, moins la logique[238]. C'était l'avenir, et, mis en face du programme de la rue de Poitiers, il avait sa grandeur, répondait à des aspirations justes ; tout grossier qu'il fût encore, il était vivifié par cet avenir lointain vers lequel il tendait et qui le légitimera. Son effort, son essai d'élaboration servaient d'excuse à ses illusions ; il répondait aux besoins du XIXe siècle qui a menti à sa promesse en ne réalisant pas la pensée économique que n'avait dégagée que par intermittences, occupée toute entière par la lutte politique et la défense du sol, la Révolution initiatrice de 1789. Le programme de la Montagne ressemblait beaucoup à celui-ci et se prouvait de lui-même aussi peu pratique. Il souhaitait en outre l'épuration du bas clergé, l'abolition complète des impôts qui frappent les objets de première nécessité, la suppression du président de la République, la réduction des gros traitements, l'augmentation des petits. Le ministère restait préoccupé des élections autrement que Louis Bonaparte. Il n'était pas admis dans la République, au moins officiellement, que le pouvoir eût le droit d'intervenir dans les opérations électorales ; une grande prudence était donc nécessaire, l'État n'entendant pas cependant que les élections fussent faites contre lui. L'habileté d'un ministre de l'Intérieur, en ce temps-là, consistait à stimuler les préfets, à leur tracer une ligne de conduite, à choisir des candidats dévoués, à les appuyer, en un mot, à remporter une victoire électorale, le tout sans avoir l'air le moins du monde de s'être mêlé des élections[239]. Nous avons vu que Léon Faucher n'avait pas la main légère. Il dut, à la fin, donner sa démission, mieux désigné que quiconque à payer pour d'autres. Le ministère, pourtant, ne pouvait s'en plaindre, car la dépêche de Faucher avait porté ses fruits quand le Parlement, dans un dernier sursaut, l'exécuta ; il est vrai qu'on n'en avait plus besoin. Ce malheureux, bien qu'ancien libéral, égalait à son tour en impopularité, — comme Guizot, — M. de Polignac. Nulle part il ne trouvait d'appui, s'étant même aliéné la droite par la raideur de ses procédés. Il était ainsi parvenu à être un objet de répulsion pour tous... Les faits les plus insignifiants en eux-mêmes prenaient de la gravité lorsqu'il y était personnellement engagé[240]. Le penchant pour les anciens fonctionnaires de Louis-Philippe, qui était aussi celui de Sénard et de Dufaure, ne lui fut pas pardonné, comme à ceux-ci, par l'opposition. Enfin, dans la séance où ses adversaires le mirent en cause, il se défendit aussi maladroitement qu'il avait gouverné, opposant aux indications nettes devant lesquelles il reculait, le seul spectre rouge. On semblait retombé très bas. Glais-Bizoin dit à la tribune : Je dois dire que jamais, dans les dix-huit années que j'ai passées aux anciennes Chambres, nous n'avons eu un fait aussi exorbitant : dire qu'une partie de l'Assemblée a voté pour l'ordre, n'est-ce pas dire que l'autre a voté pour le désordre ? Un tel fait eût soulevé la réprobation de toute l'opposition, celle à laquelle appartenait M. Léon Faucher. Tout se coordonnait pour rendre la fin de la Constituante encore plus lamentable. Il semblait que dans la France politique il n'y eût plus de noblesse que chez certains journalistes de gauche qui dénonçaient infatigablement, à travers les amendes, les poursuites et le manque d'argent, car la plupart n'étaient pas payés, les dangers de notre politique romaine, la réaction victorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur[241]. Ils pouvaient difficilement espérer que l'avenir les dédommagerait. L'écrasement des hommes de Février, net, certain, confirmait l'élection de décembre. Lamartine, élu par dix départements l'année précédente et résultat alors, à Paris, de 259.000 suffrages, n'était pas renommé[242]. Marie, Garnier-Pagès, Flocon, Dupont de l'Eure, Marrast étaient également exclus. Faut-il rappeler Louis Blanc exilé, Albert en prison ? Carnot, dont le rôle à l'Instruction publique s'était prouvé si juste et si pur[243] ? Goudebaux, Bastide, Buchez aux tendances mêlées, mais presque toujours intéressantes, Trélat, Jules Favre et Sénard subissaient aussi l'exclusion, réunissant un nombre de voix minime, sacrifiés, les uns aux conservateurs, les autres aux socialistes. C'était la défaite de la république modérée, de la république considérée politiquement. En face du bloc conservateur, seul se maintenait le parti de la république démocratique et sociale avec lequel cherchait à s'entendre dès lors la république radicale. Lamennais et Victor Hugo étaient l'un et l'autre élus. Cependant le socialisme, sans doute parce qu'il était l'avenir véritable[244], allait être, une fois encore, étouffé. Les élections de Paris étaient tristement significatives, estime Barrot, du point de vue ministériel. Murat sortait le premier et Ledru-Rollin le second du scrutin, l'un avec 134.825 voix, l'autre avec 129.000 suffrages. Le bonapartisme et le démagogisme se trouvaient ainsi associés dans le même triomphe ; était-ce de l'ironie ? Non, et il faut le reconnaître, c'était l'expression de la pensée des masses chez qui s'allie très bien la passion de l'envie et celle de la force. Deux ministres, M. Passy et moi, étions cependant nommés, mais à des chiffres inférieurs donnés aux favoris de la démagogie parisienne ; puis venaient un pêle-mêle de socialistes, de démagogues, de conservateurs. Lagrange à côté du général Bedeau, le sergent Rathier à côté du général Cavaignac, le phalanstérien Considérant à la suite du ministre protestant Coquerel, Pierre Leroux en compagnie de Roger, du Nord, le tailleur de pierres Perdiguier avec le général Rapatel, etc.. Les deux partis extrêmes, comme pour mieux se battre, avaient supprimé les intermédiaires[245]. Les conservateurs obtenaient une écrasante majorité qui rendait la lutte impossible, les socialistes n'avaient que cent quatre-vingts sièges, les républicains modérés ne comptaient que soixante-dix des leurs ; l'Assemblée comprenant un peu plus de sept cents membres, les conservateurs disposaient de cinq cents représentants, et il fallait compter parmi ceux-ci deux cents légitimistes. Barrot semble avoir exagéré le triomphe de ce qu'il nomme le bonapartisme. A vrai dire il n'y avait pas pour le peuple de bonapartisme, mais un Napoléon, et nommé en décembre ; le groupe qu'on appela plus tard le parti de l'Elysée n'était pas encore nettement défini ; il ne comprenait guère qu'un petit noyau, et les plus connus étaient Murat, Persigny, Ney de la Moskowa, Montholon ; toutefois les bonnes volontés particulières ou encouragées en sous-main étaient nombreuses. Une note communiquée aux journaux, le 12 mai, allait même laisser entendre, semble-t-il, que Louis-Napoléon, désireux de rester à part, ne répondait pas, au moins officiellement, aux actions individuelles de ses partisans[246]. Les circulaires d'Aristide Ferrère, datées des 2 et 17 janvier, du 19 février, du 4 mars, du 5 avril et du 5 mai[247], apparaissaient aussi comme une initiative purement privée, malgré l'entente probable avec Persigny[248]. Celui-ci, en compagnie du général Piat et de Morny, faisait partie de la rue de Poitiers, dont les napoléoniens de gauche et leur chef naturel, le prince Napoléon, avaient été exclus. Les divers groupements napoléoniens, fondés pour la plupart, ou amorcés, en 1848, demeuraient d'ailleurs libres, les uns vis-à-vis des autres et se livrèrent même des luttes entre eux. Plusieurs protestèrent contre l'alliance avec la rue de Poitiers[249]. L'un d'eux, formé à Paris, combattit à outrance la candidature de Morny dans le Puy-de-Dôme. Le président de la République dut même intervenir personnellement par une lettre, et les discordes ne cessèrent qu'à la longue, grâce au zèle infini de ses agents. Les bonapartistes dissidents songèrent même un moment à présenter la candidature du fils de Jérôme dans une vingtaine de départements[250]. Les groupes étaient assez nombreux, en effet. Le comité électoral napoléonien, fondé en juin 1848, comprenant beaucoup de compagnons de Strasbourg et de Boulogne, continuait[251]. Un comité central bonapartiste s'était constitué sous la présidence du général Bachelu. Il tenait ses séances 20, rue Bergère. Il comprenait les généraux Hulot d'Osery, Rémont Sour, Lamarre, Petiet, les colonels de Pontécoulant et Langlois, MM. Desarars, de Saint-Hilaire, Fayot, Lambert, Lemarrois, Lançon, Abrial, Mouillard, Davins, Rapetti, de Talvande, de Forbin-Janson, Paul de Vigny, de Bilmare, de Fauchemin, Mithivier, Fresnel (banquier), Pellegrini, Saucier, Lepoitevin, Saint-Anne, etc. Il recommandait aussi aux électeurs de choisir des hommes nouveaux[252]. Un comité succursale Napoléon, siégeant 46, rue Richelieu[253], envoyait la circulaire suivante sur un papier dont l'entête portait à gauche : Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République : Monsieur, de la nouvelle Chambre législative dépendront le bonheur de la France et le salut de notre élu du 10 décembre. Connaissant votre dévouement pour les Bonaparte, je ne saurais trop m'empresser de faire un appel fraternel à votre attachement pour la cause que nous avons défendue et que vous êtes sans doute disposé à défendre encore... Nous avons édifié, consolidons l'édifice. Ne vous laissez pas surprendre par la propagande intempestive des utopistes qui vous disent que l'ordre doit renaître d'eux. C'est faux. L'ordre n'a jamais été, n'est et ne sera jamais que par nous... A dater de ce jour vous êtes considéré comme délégué de notre comité ; à vos bons offices le soin de consolider l'édifice érigé par six millions de suffrages, dont Louis-Napoléon Bonaparte est la pierre fondamentale. Nous accueillerons avec empressement tous les renseignements que vous pourriez nous donner, avec prière de nous faire parvenir la liste des candidats proposés dans votre département pour la nouvelle Chambre législative[254]. Alfred d'Almbert, l'ancien conjuré, publiait un Dictionnaire politique napoléonien[255] dont la préface commençait ainsi : Notre époque veut la clarté ; tous principes veulent être nets, précis, arrêtés. L'ambiguïté n'est plus possible ; l'éclectisme politique a fait son temps. La majestueuse science du pouvoir laissant tout attendre, tout espérer pour ne se prononcer qu'en face d'une situation déblayée et de faits accomplis, serait aussi mal venue aujourd'hui que le bon plaisir de la puissance royale... On doit donc désirer, savoir l'opinion du premier magistrat de la République sur les questions dont la solution occupe tous les esprits, dont l'appréciation est soumise à l'Assemblée législative. Il terminait : La plupart des hommes qui se sont succédé aux affaires arrivaient sans principes arrêtés et conciliaient les exigences du moment aux besoins de leur intérêt personnel. Le prince Louis-Napoléon, au contraire, a formulé un code politique dont il maintiendra la stricte observation ; et c'est de son appréciation que nous devons attendre une ère nouvelle de grandeur et de gloire. En somme, comme les autres partis, comme tous les partis, le parti napoléonien comprenait une aile gauche, une aile droite et le centre qui les réunissait. Forts au point que, dans les provinces, les socialistes n'avaient pu passer que par suite des prétentions légitimistes, les conservateurs ne semblaient pas encore satisfaits, et cette tactique, soit quelle fut voulue, soit qu'elle fût sincère, montre, elle aussi, leurs espérances ambitieuses. Ils s'effrayaient avec fracas du succès de Ledru-Rollin à Paris, de celui de la liste socialiste à Lyon. A la Bourse, en deux jours, la rente 5 % baissa de 10 francs. Ils s'interrogeaient douloureusement sur le résultat de ces innombrables brochures dont ils avaient couvert la France, car le comité de la rue de Poitiers répandait en moyenne 577.000 exemplaires[256]. Berryer écrivait sans rire à ses amis de province : La déconvenue des partis est grande !... Nous allons nous trouver face à face avec le socialisme et le communisme. Que Dieu soit avec nous[257]. L'avènement de Ledru-Rollin était cependant naturel ; l'inquiétude venait de ce qu'un chef du parti de l'ordre n'avait pas remporté pareille victoire. La Montagne, en tant qu'avant-garde parlementaire de la petite bourgeoisie démocrate, réalisait ainsi son alliance avec les doctrinaires socialistes, consommée par nécessité et secret penchant. Le prolétariat, de son côté, ne pouvait marcher seul, s'il voulait s'emparer de la dictature révolutionnaire ; revenu donc vers ses serviteurs les plus proches, il s'y joignait ; l'alliance se faisait d'elle-même, par besoin réciproque des deux partis contractants. La Montagne bénéficiait de ce que le clan du National avait perdu, s'élevait sur la ruine de celui-ci, se plaçait entre la bourgeoisie et le prolétariat Elle présentait, à ce moment, une belle apparence, d'autant plus classique qu'elle devait se contenter de protester, et, sûre de son impuissance, pouvait protester plus aisément. Louis-Napoléon subissait toujours, quant à lui, à son point de vue, la pression parlementaire, quoiqu'elle fût maintenant d'une autre sorte, plus monarchiste que républicaine. Il lui fallait continuer de s'entendre avec la réaction toute-puissante, qui demandait toujours davantage. La Constituante avait-elle au moins planté les jalons de l'avenir ? Peut-être, mais alors rien n'en paraissait et, toute la première, elle devait constater que rien ne subsistait de son influence. Il ne lui restait que de protester, encore qu'elle sût la protestation inutile, et elle n'y manqua pas, jusqu'à la fin, avec une amertume désespérée, à travers des incidents variés, acharnée à se survivre, décidée à siéger jusqu'à l'installation de l'Assemblée nouvelle, refusant même aux questeurs les trois jours de répit nécessaires aux travaux d'appropriation du palais, cherchant à se venger de la Législative prochaine, notamment en décrétant pour le 1er janvier 1830 l'abolition de l'impôt des boissons, — que la Législative devait bien se garder de ratifier. Il faut savoir, dit Clément Thomas, toujours intempestif, à la séance du 15 mai, si nous conservons oui ou non toute l'intégrité de nos pouvoirs jusqu'au dernier jour où nous devons siéger. L'Assemblée fit sentir au général Changarnier qu'il n'avait pas ses sympathies en demandant la suppression du crédit au commandement des gardes nationales de la Seine. Qu'importait au général ? Il était le plus fort. Je les battrai gratis, dit-il[258]. Le péril social, volontairement exagéré, sans répit, paraissait terrible aux ignorants, et la contagion gagnait ceux mêmes qui l'avaient propagée d'abord sans réellement y croire. Il se racontait des choses effroyables sur les plans des insurgés. Le seul fait que, le 4 mai, la deuxième et la troisième légion avaient chanté la Marseillaise, puis le chant des Girondins, suffisait à faire croire à une révolution nouvelle. On n'en doutait plus quand on apprenait que quelques hommes de la 5e et de la 6e légion avaient crié : Vive la République démocratique et sociale ! Et l'on vantait toujours Changarnier, représenté par les purs comme le salut. On lui savait un gré spécial d'avoir fait mettre à la salle de police le sergent-major Boichot, du 7e léger, porté par la gauche à la députation, car le parti qui se réclamait le plus maintenant du suffrage universel ne le respectait que dans la mesure où il servait ses intérêts. Les blancs déclaraient d'ailleurs l'armée à peu près perdue, contaminée par le socialisme, et les régiments suspectés d'un tel esprit étaient dirigés vers l'armée des Alpes. Les bruits de complots étaient infinis. Partout, on pensait découvrir des sociétés secrètes, et moins on y parvenait, plus on les imaginait puissantes. Les burgraves arboraient des mines fatales, découragées, qui consternaient leurs troupes. Il y avait ces jours-ci des gens tout à fait démoralisés, dit Castellane[259], entre autres, M. Molé, qui n'a jamais brillé par le courage ; M. Thiers n'était pas non plus très rassuré. Le choléra, toujours persistant, qui venait de faucher à quelques jours de distance Mgr Fayet, Mme Récamier, Franconi, et qui allait emporter lady Blessington, nourrissait l'épouvante. La France apparaissait perdue littéralement. On annonçait un mouvement sérieux[260] pour le lendemain ou le surlendemain. On s'attendait d'un instant à l'autre à une collision, dit encore Castellane[261] ; cela commencera dans quelques clubs. La Cour de cassation ayant décidé que le commissaire de police avait le droit d'assister aux réunions électorales, le préfet Rébillot leur a adressé l'ordre de s'y rendre. Déjà on leur a refusé l'entrée. Il y est pénétré à l'aide de soldats, la baïonnette en avant. Aucun Mirabeau ne s'était trouvé là. Pourtant, en dépit d'un danger si considérable, le préfet de police Rébillot évaluait à six mille, tout au plus, le nombre de ceux qui sont disposés à descendre dans la rue[262]. Les esprits étaient montés. La foule recommençait de s'attrouper chaque soir entre la plaine Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Quelques représentants y furent arrêtés. Bien que relâchés de suite, ou presque, ils protestèrent. Barrot déplora l'incident en déclarant que, si pareil fait se renouvelait, le député arrêté serait amené de suite au Palais-Bourbon. Une scène à peu près du même genre se passa en province à Moulins, où Ledru-Rollin avait été présider un grand banquet organisé par des amis socialistes. Les convives, à leur sortie, furent injuriés et Ledru-Rollin eut une certaine peine à échapper aux furieux ; la voiture qui lui permit de s'enfuir fut criblée de coups de baïonnette et lapidée[263]. De retour à Paris, il demanda justice. Barrot promit sur ce point encore son intervention. Plus tard, le 28 mai, Thiers, sortant du Palais-Bourbon, était entouré par des ouvriers qui voulaient lui faire crier : Vive la République démocratique et sociale ! Des cochers vinrent à son aide et l'un d'eux l'emporta dans son fiacre[264]. En même temps que notre politique à Rome, l'affaire hongroise occupa les derniers moments de la Constituante. On a vu que les Hongrois avaient pris part, eux aussi, au mouvement de 1849. Depuis ils avaient résisté à la réaction, qui avait successivement replacé les autres provinces sous l'ancienne autocratie autrichienne ; puis ils avaient proclamé leur séparation de l'Empire et qu'ils combattraient pour leur indépendance. Le tzar Nicolas avait répondu par un manifeste. La gauche, Sarrans et Joly en tête, protestèrent en demandant au gouvernement de quelle façon il comptait agir afin de repousser l'intervention russe. Joly allait jusqu'à réclamer la guerre. Au premier abord, l'affaire hongroise ne semblait rien signifier, mais elle se reliait un peu à l'affaire romaine parce qu'elle montrait une autre face de la réaction triomphante ; et c'est en débutant par notre intervention dans la péninsule que Sarrans avait interpellé à son sujet. Elle servait à faire ressortir les dispositions réelles du gouvernement, à éclairer un peu plus tard la Constituante expirante sur la véritable situation européenne. La malheureuse Assemblée, frappée des dangers du pays, voyant la Hongrie, Rome et Venise acculées, commençait à comprendre cette vaste compression des faits qui trahit la coalition des rois[265]. La Montagne s'illusionnait d'ailleurs un peu[266] sur le danger russe, répondant en cela à des habitudes du temps[267], dominé par le mot de l'Empereur, que nous aurons à rappeler plus loin : Dans cinquante ans, l'Europe sera républicaine ou cosaque. L'ingérence de la Russie dans les affaires de l'Autriche semblait lui rendre l'actualité. En réalité, néanmoins, mêler l'affaire hongroise à l'affaire romaine, à cette date-ci, était une faute ; la force de l'opposition se trouvait diminuée sur la question qui, des deux, importait seule réellement au pays. Sarrans rejoignait mieux la ligne de conduite à suivre lorsqu'il désignait la corrélation entre le manifeste du tzar dans lequel il invoquait le Dieu des armées, et celui du roi de Prusse à ses troupes, où il en appelait aux intérêts généraux de l'Allemagne. Mais l'appel du député de gauche venait, lui aussi, trop tard, après le recul de février, et il semblait en outre, de plus en plus, que la Montagne tendait à se décharger de ses fautes précédentes sur ses adversaires. Il n'était pas sans éloquence. Voulez-vous
que je vous parle de la facilité d'une nouvelle fédération ? La Providence
vous l'a préparée. Les puissances séculaires qui, depuis les traités de 1815,
gémissent sous l'oppression, la Providence vient de les délivrer ; libres,
elles vous tendent les bras, elles vous appellent, elles demandent votre
appui. Qui s'oppose à ce que vous alliez chercher là votre force, cette force
qui n'est pas accidentelle, qui ne se déduit pas de votre forme républicaine,
mais de votre individualité française, de vos traditions, de vos intérêts, de
vos souvenirs ? Cette alliance, permettez-moi de le répéter, fut l'alliance
de Louis XIV, comme elle fut celle de la République, de Napoléon. Et
il s'écriait : Rappelez-vous, je vous en supplie, de
ce que l'empereur Napoléon disait au Sénat dans un message qu'il lui adressa,
je crois, pendant la campagne de 1807 ou de 1808. Napoléon, après avoir
signalé les dangers dont la politique menaçait l'occident de l'Europe, disait
au Sénat : Gardons-nous de nous endormir
dans un lâche repos, car il nous faudrait ensuite des sièges et des torrents de
sang pour sauver la civilisation de l'occident de l'Europe des dangers de la
barbarie russe. Sarrans croyait voir en Europe les éléments d'une
coalition contre la France. Le représentant Guichard disait : La manière dont la cause de la France a été défendue en
Italie peut-elle nous inspirer la confiance que la nationalité française sera
bien défendue en Allemagne ? Sur cette question de nationalité : Il y a un ordre supérieur à celui de la constitution et
des lois, c'est l'ordre qui consiste dans l'exécution de la loi divine et
humaine qui est écrite dans notre cœur, le premier article de cette loi,
c'est la nationalité. Eh bien, cette nationalité, est-ce que votre politique
ne la trahit pas lorsque votre armée, à Rome, n'est que le contingent que
vous fournissez, au nom de la France ? Il résumait son appréciation
sur la politique européenne. Lorsque les Autrichiens
sont à Alexandrie, lorsque l'escadre française reçoit l'ordre d'abandonner
Venise, lorsque, évitant les Autrichiens, dans le Piémont, vous allez
attaquer la république romaine, lorsque les Russes débordent en Hongrie et
lorsque l'expédition française, dans cette circonstance, vient étouffer la
révolution en Italie, comme pour donner à l'armée autrichienne la faculté
d'aller en Hongrie au secours de ses alliés les Russes afin d'étouffer la
révolution en Allemagne, je dis que les soldats français, dans ce moment-ci,
sont employés comme si vous aviez un traité secret avec la Sainte-Alliance et
que vous dussiez fournir un contingent pour écraser la liberté en Europe.
Ce débat rappelait toutes les proclamations faites contre la République
romaine, celle, notamment, du chef de l'armée autrichienne qui constatait que
quatre puissances s'étaient réunies. Il est donc
constaté que nous sommes devenus les alliés de l'Autriche dans la question
romaine, en même temps que la Russie et la Prusse sont devenues ses alliées
dans la question de Hongrie. Est-ce sérieusement, est-ce le voulant que la
politique du gouvernement français vous a envoyés de nouveau dans une
coalition européenne de rois ? Vous avez vu le manifeste de l'empereur de
Russie, vous n'avez qu'à le rapprocher du manifeste du roi de Prusse
déclarant qu'il permet le libre passage, le libre accès de ses États à
l'armée impériale russe pour aller vaincre les anarchistes de la Hongrie.
Vous n'avez qu'à vous rappeler les paroles de l'autocrate déclarant qu'il
poursuivra partout, et que personne ne pourra l'en empêcher, ce qu'il appelle
les hommes du désordre et les anarchistes, et vous devez voir qu'en même
temps qu'il va se trouver en présence de l'armée hongroise, en avant, plus
les regards se porteront sur la France. Voilà donc une nouvelle coalition
semblable à celle de Pillnitz, un nouveau manifeste aussi insolent que celui
du duc de Brunswick. Toujours l'évocation de 1790. Cavaignac craignait
aussi que le manifeste du tzar, qui changeait, disait-il, la situation
politique, ne devint une raison de guerre en Europe, et il proposait un ordre
du jour qui, tout en écartant soigneusement toute
expression qui imposerait à la République française l'obligation de se rendre
solidaire des autres républiques, exprimât cependant cette pensée qu'en
présence de l'attitude nouvelle prise par la Russie, la République française
voit une menace, si vous voulez, pour son propre avenir, un danger sérieux
pour son existence et, éventuellement, une chance de guerre contre laquelle
elle invite son gouvernement à se pourvoir et à se prémunir très sérieusement.
Une discussion s'élevait alors entre Cavaignac et Joly sur l'ordre du jour,
et Barrot en profitait pour repousser la proposition de la Montagne
dans laquelle il distinguait une déclaration de guerre. Ledru-Rollin défendit la Montagne, pas très heureusement, d'une manière un peu exagérée que la situation ne justifiait pas ; mais les questions extérieures et intérieures restaient toujours si mêlées que le principal orateur de l'opposition suivait une sorte de parti pris logique en ne les séparant pas. Pour éviter la guerre civile à l'intérieur, disait-il, répondez dignement aux despotes du dehors. Barrot, sur ce point encore, utilisait l'aveu. Il montrait la différence entre les deux situations révolutionnaires de 1790 et de 1848. Il rappelait le Parlement qui était déjà remplacé : Le peuple a prononcé : un grand nombre de membres non réélus n'ont plus rien à craindre ni à espérer du grand verdict national ; leur pouvoir se proroge, de fait, sans aucun doute jusqu'au 28 mai prochain, mais qu'est-ce qu'un pouvoir qui n'a ni responsabilité, ni contrôle ?... ou ce qu'on vous propose est sérieux, et, alors vous engagez vos successeurs dans une guerre dont seuls ils auront à supporter les conséquences, ou ce n'est qu'une vaine et stérile satisfaction que vous vous donnez à vous-mêmes. La droite menacée, utilisant une vieille tactique, s'abstint en masse de voter. Clément Thomas proposa une adresse au peuple ; Antony Thouret en appelait à l'insurrection ; Emmanuel Arago proposait à l'Assemblée de se déclarer en permanence et Goudchaux s'écriait que l'Assemblée, au cas où le vote ne serait pas régularisé à sept heures du soir, se tiendrait effectivement en permanence. La Montagne se dressait au pied de la tribune. Il ne semble pas que la situation ait été aussi grave que
la voulait voir Odilon Barrot[268], qui se
représente, pris dans ses Mémoires entre la majorité du Palais-Bourbon et
celle de l'Elysée. Le malaise venait de la politique suivie à Rome et de
l'Assemblée même, hantée par la pensée de sa fin, au point qu'elle
s'imaginait, dans sa passion, qu'on la voulait précipiter. Pendant cette agitation parlementaire, on se préparait à l'Elysée
à un conflit qu'on attendait, qu'on désirait peut-être. Les troupes étaient
consignées, et les généraux recevaient l'intimation du général Changarnier de
se tenir prêts et de n'obéir qu'à ses ordres[269]. Un certain
parti, celui qui s'agitait derrière Changarnier, une fraction du parti
bonapartiste et Changarnier lui-même rêvaient peut-être, assez
vraisemblablement, un conflit, mais Louis-Napoléon ne comptait pas sur cette
éventualité, ni ne la désirait ; il devait passer par la Législative, laisser
à celle-ci le temps de se former et de se révéler. On comprend moins encore
l'exagération du passage suivant : J'avais quitté le
Palais-Bourbon quand on vint m'avertir à la chancellerie et de la permanence
de l'Assemblée et des préparatifs menaçants de l'Elysée : ainsi nous
touchions de nouveau à la guerre civile, et, cette fois, elle eût été
inévitable si les républicains modérés, revenus de leur première irritation,
n'avaient eu le sentiment qu'il était bien tard pour que l'Assemblée tentât
un coup d'État républicain contre le pouvoir exécutif. Ils savaient,
d'ailleurs, que le président ne rendrait pas les armes sans combat et que le
succès était moins douteux dans les dispositions où était la troupe, d'une
part, et la population de Paris de l'autre[270]. A la séance du
23 mai, où les plaintes se déroulèrent sur les coups d'État présumables,
imminents ou plus éloignés, on vit bien quels sentiments animaient ces
discussions passionnées ; les accusations ne présentaient rien de
vraisemblable. Barrot avait tout à fait calmé ses craintes de la veille, et
il n'avait redouté, en somme, qu'une seule chose, que la séance ne fût pas
levée ; dès qu'il n'y eut plus de doute à garder, grâce à plusieurs efforts,
parmi lesquels il faut signaler ceux de Marrast[271], il se sentit
tranquille. Il reportait aussi trop dans la politique générale les
inquiétudes que lui inspirait son propre ministère[272]. Crémieux avait
lu à la tribune un manifeste signé de Considérant, dénonçant un projet de
coup d'État contre la République. On incriminait une revue passée la veille
au Champ-de-Mars par le Président et pendant laquelle on aurait crié : Vive Napoléon ! Vive l'Empereur ! Crémieux appuyait
sur sa dénonciation en racontant que plusieurs bataillons de chasseurs de
Vincennes avaient été appelés à la hâte de Metz et de Strasbourg à Paris, en
utilisant aussi une lettre de Metz, qui assurait que l'ordre avait été
transmis par dépêche de faire arriver à Paris, pour le 28, le 7e bataillon de
chasseurs ainsi que quarante infirmiers. Considérant était monté à la tribune
pour défendre son accusation. Pierre Bonaparte s'écria : Monsieur Considérant, quand vous avez dit que le président
de la République conspirait contre la République, vous avez menti ! On
cita aussi un article de la Presse, curieux parce qu'il laissait voir,
décidément, que ceux qui s'étaient servi du suffrage universel pour se
débarrasser des hommes de Février et nommer Louis Bonaparte, auraient aimé à
se débarrasser de l'instrument désormais inutile pour eux. Louis-Napoléon Bonaparte empereur. La peur ne raisonne
pas, ou raisonne mal. Elle ne voit pas la cause, elle ne voit que l'effet. Le
scrutin du 13 mai, les 110.000 voix données à Paris, aux candidats
socialistes, la quintuple élection de Ledru-Rollin, l'ostracisme électoral de
M. de Lamartine, la déception politique de la rue de Poitiers, la baisse de
10 francs en deux bourses, enfin les complications dont on entrevoit
l'approche, tout cela a jeté l'effroi dans les esprits prompts à s'alarmer.
Nous n'entendons autour de nous que des gens qui disent : Il n'est qu'un
moyen d'en finir avec le suffrage universel, avec la liberté de la presse et
toutes les libertés quelconques, il n'est qu'un moyen de sauver l'ordre,
c'est par un coup d'État. Le 20 décembre, Louis-Napoléon aurait dû, en
sortant de l'Assemblée nationale, se faire proclamer empereur héréditaire,
ou, tout au moins, consul à vie. Ayant, le 20 décembre, laissé échapper
l'occasion, il aurait dû la ressaisir le 29 janvier. Il faut qu'il la fasse
renaître... etc. La conspiration restait toujours douteuse ; on
pouvait seulement reconnaître là une sorte d'essai, une manière de tâter les
sentiments. Ledru-Rollin s'efforça d'offrir des preuves. Il rappela que, la veille, le président de l'Assemblée avait cru devoir prévenir le président du conseil que l'Assemblée resterait en permanence, si, à sept heures, le scrutin n'était pas complet et que, dans ce dernier cas, il serait obligé de requérir quelques dispositions militaires. Il continuait par l'attaque contre le général Changarnier, mais en récapitulant les faits à son actif, assez accablants, en insistant sur le dernier, un ordre envoyé aux commandants de brigade et aux colonels priés de n'obéir qu'à lui, à lui seul, et non à l'Assemblée. Ce que nous voulons, disait-il, c'est que si la constitution est violée, on sache qu'elle l'est par vous ; ce que nous voulons, c'est que si la bataille est offerte, — et nous la gagnerons, — il soit prouvé que vous avez voulu étouffer la République. Le général Bedeau constata que ce serait folie de porter atteinte aux lois lorsque le pays entier venait de nommer la Législative. Charras répliqua : Oui, mais il y a des fous ! Et il affirma que Changarnier avait bien écrit une lettre ainsi conçue : Les troupes sont consignées jusqu'à nouvel ordre. Vous n'aurez à obtempérer à aucun ordre de réquisition autre que ceux qui leur seraient donnés par le général en chef lui-même. Il appuyait la nomination d'une commission d'enquête ; elle prouverait que l'ordre avait été donné aux troupes, lors de la dernière revue, de crier : Vive Napoléon ! — Barrot se leva et eut un mot qui indiquait le véritable sens des débats. Le gouvernement n'aurait aucun intérêt à recourir à un coup d'État au moment où une autre Assemblée dans laquelle il avait la majorité allait le renier. La gauche cria aussitôt : Pas encore ! La droite riposta : Ils se sont trahis ! Et le président du conseil ; se saisissant d'un dialogue aussi spontané : On vient de le dire le mot qui pourrait bien expliquer toutes ces violentes accusations et toutes ces menaces. Il s'agirait d'empêcher la nouvelle Assemblée de se réunir, ou du moins, de lui imposer les conditions auxquelles on lui permettrait de vivre... Il ne put cependant amener la conclusion ; le débat fut renvoyé au lendemain. Les contradictions, les bruits de coup d'État et d'émeute résultaient de la confusion générale et de la mauvaise foi des partis. Les conservateurs ne pardonnaient même pas à la Montagne que sa défaite fût assez glorieuse, et doutaient de leur victoire au point de se demander s'ils la possédaient. Les montagnards, enhardis par les craintes et le désespoir, même simulé, de leurs adversaires, criaient, au contraire, au triomphe et comme celui-ci, pourtant, n'existait pas, ils attendaient avec impatience des événements nouveaux. Les conservateurs, de leur côté, redoutant l'émeute au début, la désiraient afin d'anéantir leurs adversaires ; ils répandaient avec d'autant plus de ferveur le bruit de son imminence qu'ils avaient dû leur élection à une pareille campagne. Tout le monde parlait donc d'émeute. Il n'y en aurait pas eu que, d'un côté ou de l'autre, on aurait fini par en faire éclater une. Mais les conservateurs qui y étaient surtout intéressés, ne serait-ce que pour prévenir celle qui, en arrivant à son heure, aurait présenté plus de chances de réussite, l'annoncèrent peut-être comme fatale, avant que leurs adversaires y aient réellement songé. Faucher avait habitué à ce procédé. Des rapports extraordinaires arrivaient de tous les points de la France, annonçant les catastrophes les plus invraisemblables[273]. Le mot socialiste, volontairement détourné de son sens, appliqué à un homme, le vouait à toutes les malveillances, à toutes les haines. Lamartine avait vainement expliqué dès avril, dans le Conseiller du peuple : Le mot socialiste n'est pas ce qui devait nous effrayer, mais c'est le sens qu'on lui donne en ce moment qui fait justement peur et horreur à la société. Le mot socialiste signifiait autrefois et devrait toujours signifier un homme qui cherche à améliorer et à perfectionner l'ordre social au bénéfice de tous ceux dont la société se compose[274]. Personne ne voulait l'entendre, même ses quatre-vingt mille abonnés[275], qui ne voyaient là que l'appréciation individuelle d'un poète. Tant d'ignorance, — et sans rappeler l'égoïsme et l'absence de culture des partis de droite, — venait aussi de la fatigue générale, à la suite d'une révolution apparue chaque jour plus inutile, parce que chaque jour moins réalisée. Les journaux entretenaient l'ignorance en rapportant à leur manière les procès divers, autre excellent moyen d'affoler l'opinion. Celui de Bourges, si clair cependant, était à peu près laissé dans l'ombre ou présenté de manière à signifier le contraire de sa preuve ; celui des assassins du général Bréa, celui des meurtriers du commandant Masson étaient, au contraire, mis en avant et exploités, de façon à faire juger tous les insurgés d'après ceux-ci. On étendait ensuite l'horreur de Choppart, de Lhar et de leurs complices à d'honnêtes magistrats municipaux comme Pinel-Grandchamp. On relevait les perpétuels conflits d'autorité que laissaient voir les débats à la Cour d'assises de la Haute-Vienne ou du Calvados. Une véritable campagne de la peur, — car on ne saurait trop le répéter, afin de faire comprendre l'état d'esprit qui présida aux élections, — exploita, comme après juin, les événements. Il fallait détruire cette légende républicaine que Lamartine et ses amis avaient réussi à accréditer[276]. Tout était bon pour cela. Le rapport parlementaire sur les dépenses du gouvernement provisoire, fait dans un évident esprit de dénigrement, malgré des vérités, servit aussi, et nul ne rappela dans quelles circonstances ce gouvernement avait dû agir. Pour sauver Changarnier, Barrot employait à la Chambre la même tactique que précédemment. Il répondait que l'officier avait répondu d'une manière satisfaisante à ses demandes d'explication. On ne lui eût pas attribué, disait-il, la pensée de contester directement ou indirectement les attributions du président de l'Assemblée si on avait pris attention que cet ordre purement militaire et de service était conçu en termes généraux et, en tout, semblables à ceux qu'il est d'usage d'adresser aux troupes en pareille circonstance ; lorsque cet ordre avait été donné, l'Assemblée s'était retirée ; aussi, aucune réquisition du président n'existait et n'était à prévoir ; quand il avait averti les généraux de n'obéir qu'à sa réquisition, il n'avait donc pu faire allusion à celle que le président aurait pu adresser aux troupes, la pensée d'établir un conflit avec l'autorité de l'Assemblée n'était ni ne pouvait être en question ; elle eût été, à la fois, de sa part, une haute inconvenance et une imprudence. Le ministère se déclarait naturellement satisfait de ces déclarations. La Montagne montrait moins de confiance. Considérant allégua de certaines paroles que lui aurait dites Barrot, — et qu'il prononça sans doute, puisque celui-ci ne les réfuta point. Le président du Conseil, après avoir déclaré qu'il estimait parfaitement loyales les intentions de Louis Bonaparte, aurait ajouté : Je ne puis pas dissimuler qu'il s'agite autour de lui des passions détestables. Ledru-Rollin, revenant de plus sur la lettre envoyée par Changarnier, assurait qu'elle était écrite de sa propre main. Les démentis apportés, assez faibles, ne lui enlevèrent rien de son assurance et, reprenant l'accusation de folie jetée précédemment : Est-ce que sous Louis-Philippe il n'y avait pas folie à attaquer le gouvernement en pleine force, et lorsque l'on avait écrit à ce prince qu'on conserverait une gratitude éternelle pour son gouvernement, n'y avait-il pas doublement de folie, alors qu'en 1840, malgré cet engagement, on a renouvelé cette tentative dans les circonstances les plus imprévues et les plus impossibles. Si un homme a été assez audacieux pour commettre deux fois cette folie, ne peut-il la renouveler aujourd'hui, et avec bien plus de chances de succès, puisque le pouvoir est dans ses mains ? Ernest de Girardin protesta : Il n'est pas permis de dire à la tribune que l'élu de six millions de suffrages soit un fou. La droite sommait Marrast de faire son devoir. Le président de l'Assemblée répliqua : Je n'ai pas d'ordre à recevoir de tous... Tout le monde veut présider ici. Charras avait dit ce que tous les parlementaires pensaient au fond d'eux-mêmes, mais ce que la droite ne pouvait plus ni ne voulait avouer : Le président de la République n'est pas le chef de l'État !... Il n'est chef que du pouvoir exécutif. Odilon Barrot défendait le président de la République et répéta : Je vous l'ai déjà dit, puisque vous avez le droit d'accuser, vous n'avez pas celui d'outrager. Ledru-Rollin tint alors au ministre un discours propre à le blesser au secret de lui-même, encore qu'il fût la plupart du temps invulnérable : Il y a quelque chose qui parle plus haut que votre protestation, et vous ne pouvez l'effacer... Vous nous dites : vous veillez, mais vous ne voyez pas. Toutes les fois qu'on a dénoncé ici un acte attentatoire à la Constitution, vous l'ignoriez... Oui, il y avait, en dehors de nous des hommes qui agissaient et, quand vous l'avez su, au fond de votre cœur, souvent vous les avez blâmés. Je ne prétends pas, comme on le dit, que vous vouliez vous perpétuer ici ; je ne le crois pas ; je crois que vous êtes souvent fatigué de ce pouvoir ainsi tiraillé. La question n'est d'ailleurs pas de savoir si vous en êtes fatigué, mais nous voyons les dangers à le laisser dans une main qui est débile. Oui, souvent, les faits, vous les ignorez... Quand le président, quand le général Changarnier, au moins, avait entouré l'Assemblée de troupes sans que le président de l'Assemblée le sût, qu'êtes-vous venu faire ? Vous êtes venu couvrir de votre vieille probité un acte que vous ne ratifiez pas... Un homme, quel qu'il soit, ne refait pas sa nature. Vous ne pouvez refaire la vôtre. Est-ce la première fois que vous avez été trompé ? Ça a été votre rôle dans l'ancienne Chambre pendant dix-huit ans... Encore un coup, il ne s'agit ni de probité ni d'honnêteté, il s'agit d'être un homme d'État et de voir. Si j'avais à vous qualifier... je dirais que vous êtes un aveugle. Falloux se sentit visé sous l'effort de la gauche divisant le ministère en deux parties et gagna la tribune. La Montagne, qu'on estima puérile et grossière, ne réclamait pas injustement contre lui. Il parla d'ailleurs mal. Comme les autres, il récrimina et, traîtreusement, car mieux que personne il savait combien son accusation était fausse ; il reprocha à ses adversaires de tirer à Rome sur les soldats français, puis, à la faveur de la nouvelle discussion ainsi soulevée, il s'esquiva. Le peuple ne veut plus des trembleurs, s'écria-t-il, mais il ne veut pas de ceux qui font trembler, sachez-le bien. Il disait encore, et ses paroles avaient une saveur particulière : Je serai toujours à cette tribune sans embarras, sans hésitation, parce que j'y suis avec une conscience parfaitement droite et parfaitement limpide. — L'abbé Dupanloup et Mme Swetchine lui en avaient donné maintes fois l'assurance. Il demeurait d'autant plus fort que les attaques contre lui étaient encore moins adroites que dans le passé. On arrivait à lui reprocher sa littérature en l'accusant d'avoir fait l'éloge de la Saint-Barthélemy. Une discussion s'ensuivit, des plus aigres, sur la question de savoir si l'accusateur, le député Joly, avait cité le texte véritable. Ce n'était plus qu'un déluge de récriminations et de personnalités ; les partis semblaient vouloir, avant de se séparer, épuiser tous leurs venins et satisfaire tous leurs ressentiments ; le spectacle était hideux[277]. Il était tel que quelques membres de l'Assemblée législative, qui assistaient des tribunes à cette scène, témoignèrent tout haut de leur dégoût, dans des termes naturellement désobligeants pour les Montagnards. On leur cria : Vous êtes bien pressés ! Cette agonie prolongée de la Constituante s'acheva le 26 mai. Sans doute afin de racheter le passé, Flocon proposa l'amnistie des condamnés, de ceux, du moins, arrêtés depuis le 27. La Constituante refusa, à une infime majorité, qui marquait jusqu'au bout sa véritable tendance en même temps que son indécision. Le député Victor Lefranc avait eu vraiment raison de s'écrier : Terminons, ou nous allons mourir sous le ridicule. Armand Marrast prononça le discours de clôture. Il ne se
faisait pas illusion sur l'avenir prochain, ni sur la maladresse d'un passé
si récent. Il s'efforça, du moins, à ne pas laisser tomber la Constituante
sans éloges et à rendre ceux-ci supportables par l'essai d'une équitable
balance. ... L'Assemblée nationale a eu cette
singulière destinée d'exciter, à ses premiers jours et à ses derniers jours,
les défiances et les injustices des partis extrêmes. Regrettée aujourd'hui,
peut-être, par ceux qui l'attaquèrent à son début, elle est chaque jour
attaquée par ceux mêmes qui l'appelaient alors avec le plus d'ardeur et le
plus d'espoir. C'est l'histoire de tous les pouvoirs modérateurs et grâces en
soient rendues à votre sagesse. Vous avez refusé l'abri de votre majorité à
toutes les violences ; vous saviez que la réaction et l'utopie s'engendrent
et, dans votre patriotique sollicitude, vous vous êtes tenus à une égale
distance de l'une et de l'autre, réalisant ainsi par un acte ce que beaucoup
prêchent, ce que bien peu savent pratiquer. Il avait toutes les
absolutions : Avertis par des signes dont l'évidence
est brûlante, que les sociétés sont arrivées à l'âge d'une transformation
nécessaire, vous avez conçu le pouvoir politique comme l'instrument actif du
perfectionnement social, et qu'il me soit permis de le dire, si nous, les
ardents et constants promoteurs de la République, nous n'avions travaillé
qu'à une œuvre personnelle, à un déplacement stérile d'hommes et
d'institutions, nous ne serions pas même des ambitieux vulgaires, mais de
détestables intrigants. On ne joue pas à ce jeu misérable de la personnalité,
la paix et la prospérité, même passagères, de la patrie. — Marrast
avait été sincère, — ou bien, près de la défaite, était-il devenu plus
clairvoyant ? Il y a de dangereuses sincérités. Il continuait un curieux
examen de conscience : Si le suffrage universel
devait ramener la France au point où il l'a trouvée, et, pour prix de ses
agitations, s'il ne devait nous donner qu'une société pétrifiée, un ordre
précaire, des iniquités permanentes, sans progrès, sans améliorations
générales, sans concorde au dedans, sans grandeurs au dehors — que Dieu
me pardonne ce mot impie ! —, mieux vaudrait pour
son peuple l'abrutissement du despotisme. — Tel
n'est pas l'avenir que l'Assemblée nationale a préparé aux générations.
Il rappelait alors, à sa manière, l'œuvre de la Constituante. Il glissait sur
les événements de Juin, dans des termes qui établissaient de nouveau son
incompréhension ; il n'insistait guère davantage sur la théorie des
nationalités ; il ne parlait pas de la question romaine. Il avait pris soin
de flatter la droite, qui ne lui ménagea pas ses applaudissements, en
évoquant les théories qui renferment plus de
déceptions qu'elles ne montrent de suffisance. Il termina : Voilà, citoyens représentants, dans quel état de
perturbation générale nous laissons le monde. A l'extérieur, des principes
ennemis qui ne se menacent pas seulement, qui déjà se mesurent ; au dedans,
deux partis hostiles qui se calomnient mutuellement, comme à la veille des
grandes luttes. A ceux-ci, du moins, vous léguez mieux encore que votre
exemple, vous léguez une constitution qui doit désormais servir à la fois de
règle et de bouclier à tous les pouvoirs comme à tous les droits. Je fais, en
votre nom, les vœux les plus ardents pour que cette loi suprême inspire à
tous les partis le regret dû à l'œuvre de l'Assemblée que le peuple avait
choisie pour la faire. Malheur à ceux qui tenteraient de la violer !
Indépendamment du châtiment qui les atteindrait aussitôt, ils attireraient
sur leur tête les malédictions de la patrie entière. — Saluons avec confiance
cette Assemblée nouvelle appelée à nous remplacer. Ayons foi les uns et les
autres dans les nobles destinées de la République ; elle ne faillira pas au
dedans aux espérances du peuple ; elle ne faillira pas au dehors à ses
alliances et à ses promesses. Que la sagesse de nos successeurs vienne
réparer ce qu'il a pu y avoir de fautes, d'erreurs et de dures nécessités
dans notre laborieuse carrière. Puissent-ils se garder eux-mêmes des passions
violentes et des funestes entraînements ! Qu'il me soit permis enfin,
citoyens représentants, de clore ce discours et vos travaux par le cri de
ralliement qui les a inaugurés : Vive la République ! La droite ne
jugea même plus la ruse nécessaire et se tut. La gauche salua d'un grand cri
celle qui allait mourir. Félix Pyat voulut distinguer : Vive la République démocratique et sociale !
Certains soulignèrent : Et sociale ! La droite
fit alors entendre des rires prolongés[278]. Le
surlendemain, le 28 mai, Armand Marrast, entouré des vice-présidents et des
secrétaires, reçut le bureau provisoire de la nouvelle Assemblée. Il appuya
dans son discours sur des vœux de concorde : Plus
heureux que nous, puissiez-vous éviter les horreurs de la guerre civile ! Les députés qui, pendant une année mémorable, s'étaient si longuement disputés, la plupart du temps avec peu de mesure, se quittèrent froidement, sans manifester ni rancune ni pardon, comme des acteurs qui, la pièce jouée, oublient leur rôle, ou comme des avocats qui, après s'être invectivés pendant une longue plaidoirie, sortent indifférents de la salle d'audience[279]. Sans doute éprouvaient-ils, plus qu'ils n'en voulaient convenir, le sentiment de leurs fautes. Les uns comprenaient enfin ce qu'ils auraient dû faire. Les meilleurs supputaient la pente stérile vers laquelle était entraînée la société française. La Montagne, démolie, escomptait les résultats prochains de la politique romaine. La révolution, définitivement vaincue, cherchait vainement quelque possibilité de revanche. D'autres, au contraire, étaient satisfaits, au point de compter sur un triomphe plus sérieux encore. Les cléricaux, seuls, en réalité, gagnaient, à cette heure historique, la bataille, l'avenir restant encore embarrassé pour Louis-Napoléon ; ils célébraient cette opinion publique quelquefois si utile, sur laquelle ils avaient mis la main d'autant plus facilement que les parlementaires semblaient avoir pris à tâche de la laisser mécontenter. Sur le moment de disparaître, une partie du gouvernement avait repris le sens de son devoir ; les voix qui revendiqueraient alors les nécessités de la politique nationale partiraient de l'Assemblée, mais trop tard, tandis qu'elle tombait sous le poids de ses fautes, qui coûtaient cher à la France et devaient lui coûter davantage. La différence était cruelle entre les Constituantes de 1789 et de 1848. De celle-ci qui se flatterait d'être le fils spirituel ? écrivait un historien de 1855[280]. Quels privilèges renversa-t-elle ? Quelle voie fraya-t-elle à la démocratie française en lui léguant une constitution pleine de germes morbides et incapable même de sauvegarder la forme gouvernementale, puisqu'elle avait créé un inévitable conflit entre l'exécutif et le législatif ? Quel fut le bon sens de cette Assemblée, sinon le bon sens du bien commun qui s'effraie de toute conception nouvelle. Où trouver la foi dans cette pépinière d'esprits sceptiques et blasés, éclos au monde des idées sur le fumier[281] du règne de Louis Philippe ? Le gardien de la Chambre qui balaya les petits vers érotiques, les épigrammes et les caricatures qu'ils laissèrent sur leurs bancs comme la marque du passage d'une troupe d'écoliers folâtres, sut, mieux que le pauvre peuple qui les avait élus, à quoi s'en tenir sur ces hommes chargés des destinées de la seconde République française. Il y a bien de l'exagération dans ces lignes à côté de la vérité qu'elles expriment, d'autre part. Ce qui s'essaya de grand se fit en dehors de la majorité parlementaire et contre elle. L'esprit de la révolution vécut en dehors d'elle[282], chez les alliés de la première heure, vite rejetés comme les plus dangereux des adversaires. L'Assemblée renia celte révolution qui lui avait donné la vie, et la sagesse qu'elle crut servir n'était trop souvent que celle de la médiocrité. Elle décima ses seuls enfants sincères et grands, sans répit. Elle fut trop fréquemment aussi l'efficace instrument régulateur de la réaction masquée, conduite, sans qu'elle s'en doutât, où elle ne voulait pas en venir, — comme son meilleur élève, Odilon Barrot, qui l'admirait de bonne foi et avec un contentement qui achève de les expliquer tous deux : L'Assemblée constituante s'était réunie le 4 mai 1848, elle se retirait le 29 mai 1849, après avoir exercé la toute-puissance une année. Dans cet espace de temps, elle avait eu à remplir une double mission, celle de raffermir et de rassurer la société, et celle de constituer la République. Après avoir montré à son début quelques hésitations, quelques faiblesses même, que son origine peut jusqu'à un certain point expliquer et excuser, il faut dire à son honneur que la lutte une fois engagée sérieusement, elle sut déployer un courage héroïque pendant le combat et une grande résolution après la victoire. Elle ne marchanda pas les mesures de répression que la paix et la sécurité publiques réclamaient. Rien n'est plus propre à faire ressortir la différence des temps et des mœurs entre les deux époques de 1789 et de 1848[283] que la manière si différente dont la première et la seconde Assemblée traitèrent les soulèvements populaires, que les tristes et impolitiques ménagements de l'une et les justes et trop nécessaires sévérités de l'autre... Le socialisme avait, dès le lendemain de la révolution du 24 février, insolemment revendiqué cette révolution comme sa création et sa proie. Le gouvernement provisoire l'avait ménagé, l'Assemblée constituante n'hésita pas, elle, à le traiter en ennemi ; elle lui refusa, dans la célèbre discussion du droit au travail, les satisfactions même purement théoriques qu'il réclamait impérieusement. Après l'avoir vaincu dans la collision la plus formidable dans laquelle une société ait jamais eu à défendre ses conditions d'existence, elle eut le bon esprit d'achever sa défaite par les débats libres de la tribune... et si avoir vaincu le socialisme, c'est avoir sauvé la société, c'est à cette Assemblée et à nulle autre qu'en appartient légitimement l'honneur[284]. Barrot l'accusa d'avoir manqué la seconde partie de sa mission, la constitution de la République. Il paraît cependant qu'en plus de ses erreurs et de ses contradictions, la constitution avait manqué beaucoup à cause de l'état d'esprit du pays ; les républicains véritables et éclairés, faisaient défaut ; l'Assemblée, discréditée d'autre part par la réaction, avait dégoûté du suffrage universel. De suite, et fatalement elle s'était révélée l'ennemie de l'homme que ce suffrage universel, selon le mécanisme mis en mouvement par elle-même, avait élu, contestant ainsi, aussitôt que créé, l'instrument sur lequel reposait, — toujours selon elle, — l'avenir démocratique. Le sentiment qu'elle perdait pied lui enseigna l'art des variations contradictoires ; ainsi elle vota une constitution contre laquelle elle se retourna dès qu'elle eut porté ses fruits, puis la revendiqua par son président à son heure dernière, au point même, alors, de la proclamer intangible. Tandis que, sous la Commission exécutive, elle écoutait les pires conseils de la droite, rapide à attribuer tout l'effort socialiste aux intrigues monarchiques ou bonapartistes, elle parut satisfaite seulement sous Cavaignac, parce qu'elle régnait. Méfiante sous Louis-Napoléon, à juste titre d'ailleurs, elle n'hésita pas à l'attaquer, avant même que son élection fût définitive ; puis, incertaine encore, elle se retourna contre les ministres, jusqu'à ce que le président de la République, par son attitude correcte, lointaine, insensible aux avances, redevînt l'ennemi. Et alors qu'au début le président couvrait les ministres, les ministres, cette fois, couvrirent le président. La Constituante n'avait su trouver nulle part de point d'appui un peu stable. En s'efforçant d'effacer Louis-Napoléon Bonaparte, en le compromettant et en le contraignant presque, avec l'aide des ministres, à une politique extérieure exécrable, la Constituante le laissait seul debout. Après l'avoir, sinon marqué, du moins relégué en apparence, elle le faisait apparaître, en le prouvant à nouveau nécessaire. Elle démontrait, au point de l'exagérer, la nécessité du pouvoir. Mais un gouvernement révolutionnaire pouvait seul en finir avec tant d'ennemis de la nation, acharnés à se prétendre ses amis[285]. * * *Napoléon Ier disait : S'appuyer sur les chefs de parti, en France, c'est s'appuyer sur le vide. — Au moment de l'élection définitive, son neveu était dans une position exceptionnelle, seul de tous les hommes au pouvoir, depuis la grande Révolution, qui y fût arrivé sans antécédents politiques, sans engagements. Depuis le 20 décembre, il avait compromis cette page blanche et, du même coup, l'autorité que lui avait value le suffrage universel, mais par nécessité, parce que tout autre moyen d'apaisement réel semblait pour le moment impossible. L'audace lui ayant paru inopportune ainsi que contre le vœu de la France au lendemain du succès, — et, sur ce point, il se trompait peut-être, — il avait dû, nécessairement, transiger. Une partie du pays, d'abord déçue, s'en rendit compte assez vite, décidée à lui faire crédit parce que lui seul, dans la mêlée qu'il dominait, en dépit de son effacement, permettait à tous les rêves, même opposés, une vague espérance. Il connaissait, bien entendu, mieux que ses alliés, son avantage. Avant décembre, à une soirée chez la princesse de Belgiojoso, interrogé par d'Alton-Shée, désireux de savoir s'il s'appuierait sur les blancs ou sur les rouges : Ni sur les uns ni sur les autres, répondit-il. Depuis, comme tous les gouvernements en France, il avait eu de la peine à rester bleu. L'orléanisme, qui saturait l'air, si constamment actif depuis février, l'avait circonvenu, puis éloigné du peuple, interposant entre lui et l'armée le général Changarnier, avec l'aide empressée des légitimistes, il s'était efforcé, d'autre part, de le discréditer par les bonapartistes dynastiques auxquels il ne devait rien[286], afin de mieux le trahir ensuite, — de même que Napoléon avait été miné au profit des Bourbons par ceux qui l'avaient poussé vers l'Empire. Afin de mieux l'accaparer, les éminences de la rue de Poitiers avaient fait assurer qu'il engageait ses amis à partager leurs craintes, et la campagne prit une proportion telle qu'il dut faire insérer une note dans les quotidiens[287]. — Élu du peuple, il ne pouvait se servir de lui une fois nommé. Il était en face de deux partis qui s'exécraient malgré, quelquefois, la confusion de leurs avant-gardes, et dont la lutte continuelle divisait la France sur des terrains souvent trop favorables à l'étranger. Le clan du National capitulait, quant à lui, de plus en plus vers l'orléanisme dont il était une contrefaçon qui s'ignore, quelque peu colorée. Tous s'entendaient ainsi assez bien contre l'idée napoléonienne, — c'est-à-dire, au moins, dans ce qu'elle aurait dû être, contre la révolution devenue autorité régulière, contre l'idée sociale faite gouvernement, — et raillaient ceux qui parlaient de la grande Nation, parce qu'ils assuraient, — quelques-uns de bonne foi, — découvrir des tendances réactionnaires dans cette volonté de la grandeur nationale. Le thème était facile, par certains côtés même juste[288], propice aux avocats ennemis du travail véritable et des réalisations, et cette catégorie d'hommes avait obtenu une telle place depuis le retour des Bourbons que Louis Bonaparte, occupé pendant son exil à se rendre compte des sentiments de la patrie, mal placé pour voir complètement la position de ceux qui façonnaient le jugement public et paraissaient parler en son nom, les avait écoutés, lui aussi, par sentiment français, pensait-il ; afin de mieux répondre aux nécessités nationales, il avait été le premier à diminuer, ou du moins à adapter, certaines de ses conceptions peut-être trop enthousiastes. Il ne faut pas oublier, non plus, que la France commençait à se pénétrer de cosmopolitisme[289]. Au fort de Ham, il avait mesuré la différence entre le passé, son rêve et le présent ; il s'y était imprégné d'une partie des idées sans lesquelles il lui eût été impossible de réussir, parce qu'il n'eût pas donné la sensation d'être un contemporain. Une fois au pouvoir, il oublia donc assez vite, sans effort, de lui-même, que le suffrage universel et la révolution avaient servi de moyen et de piédestal à un conspirateur à main armée, follement hardi, venu pour renverser, — pensait-il aussi, — l'orléanisme — cet orléanisme qu'avait jeté bas, justement, 1848, que le gouvernement provisoire avait continué et dont lui-même ne méconnaîtrait pas l'héritage ; voulut-il s'en souvenir, quand même, en plus de la leçon des circonstances, il avait, surtout autour de lui, des intrigants, accoutumés à se rendre indispensables ; ils étaient venus au-devant de lui dès son succès, ils s'éloigneraient de même, imperceptiblement, à l'heure de sa chute ; comme tout gouvernement, il y était condamné le long de son règne[290]. Leur empressement s'affirmait actif et spontané, car ils avaient peur, et cette crainte leur procurait les apparences de la sincérité. — Mickiewicz, sur ce point encore, tentait vers l'Elysée un appel émouvant : Que peut avoir de commun avec ces hommes-là M. le président de la République ? Qui l'oblige à assumer la responsabilité du passé des légitimistes et des orléanistes ? Est-ce à lui de protéger les hommes traîtres à Napoléon, les transfuges de Waterloo, les meurtriers de Ney et de La Bédoyère, et ceux qui ont applaudi au meurtre de Murat, à l'égorgement de la Pologne, à l'anéantissement de l'Italie ? Quel est le devoir pour lui d'obtenir du peuple français un bill d'indemnité pour les concessionnaires, complices des ministres de Louis-Philippe ? Il n'y a qu'à les laisser à leur triste destinée ? Un seul mouvement de sa volonté, un mouvement napoléonien, peut le rendre libre de tous ces parasites qui ne vivent que de la substance matérielle et morale d'autrui. Un seul mouvement de sa volonté, un seul mot napoléonien peut encore expliquer à la France et à l'Europe le mystère du 10 décembre qui est, en même temps, celui de la destinée du président. Il y avait un temps où il croyait à sa destinée ; il l'a cherchée à Strasbourg et à Boulogne. La France la lui a révélée dans la journée du 10 décembre. La France a fait tout pour Louis-Napoléon ; ce qu'elle attend de lui doit répondre à ce qu'elle a fait pour lui. Pour ce qu'elle attendait de lui, il fallait presque une révolution nouvelle[291], un coup d'État révolutionnaire tout au moins. L'hypocrisie était générale, officielle, à la fois gouvernementale et religieuse[292]. La France avait pensé que le nom et la personne de Napoléon suppléeraient à tout en arrangeant tout, et nous avons vérifié que les hommes, ainsi que les matériaux de l'action faisaient défaut ; il ne se trouvait d'aides réguliers que dans l'ancien personnel gouvernemental. Nous avons relevé aussi, au long d'une analyse progressive, ce qui lui manquait. — Il fallait, en outre, qu'il se fît pardonner son succès par tous ; la plupart des journaux, comme avant l'élection, continuaient d'aboyer contre lui[293]. Enfin, nous avons noté, en février 1848, qu'une sorte de convention nationale, montagnarde et girondine à la fois, eût été nécessaire, que ses éléments n'existaient nulle part et que l'idée républicaine, avant tout verbale[294], ne pénétrait pas les faits. De même, par suite de la défiance, de l'incompréhension et de la lâcheté qui pesaient sur tous, parce que la France dirigeante, demeurée réactionnaire, se refusait à saisir son mandat, Louis-Napoléon ne devenait pas le dictateur révolutionnaire désiré. Il ne semblait pas de taille à soulever, tout à coup, au milieu de l'abandon général, le suaire mortel sous lequel le légitimisme absolu et l'orléanisme peu à peu, sans conscience suffisante, après avoir étouffé ou endormi la France, la maintenaient encore par excès de précaution. Ne découvrant aucun moyen de lever l'épée, afin de livrer la bataille à ciel découvert et le plus grandement possible, il en était réduit à lui substituer, mais vers d'autres espérances, au moins pour le moment, l'arme de Louis-Philippe, la ruse, guidée par l'instinct, dont le fils de Philippe-Égalité avait su si attentivement se servir dans la première moitié de son règne ou même durant tout celui-ci, mais en la subordonnant trop aux principes de sa doctrine, souvent étroite, sur la fin surtout. Il ne rencontrait ni en lui, ni dans les possibilités françaises, le moyen de s'identifier aux besoins, aux désirs, aux volontés confuses qui avaient soulevé le peuple en février, et cette confusion même, que son esprit assez paresseux ne perçait pas, par prudence aussi, l'immobilisait également ; à son tour, il ne réalisait ni février, ni l'idée républicaine, ni même ce penchant consulaire dont les électeurs l'avaient accompagnée. Un manque d'énergie s'affirmait dans la France gouvernementale, — car le peuple avait donné tout son effort, — comme si la révolution de 1848, si différente cependant, économiquement, descendait trop directement, au point de vue politique, de celle de 1830. Par deux fois, l'élite, — très discutable, — du pays avait craint de renouer la tradition nationale, celle de Charlemagne, de saint Louis, de Jean-Jacques, de Mirabeau, de Carnot. Les élections récentes en apportaient une nouvelle preuve. Le président de la République ne pouvait toujours pas expliquer au pays la fausseté de sa situation. Les attaques de son cousin, sincères comme tout ce qui venait de lui, justes, sans doute envenimées par les tiers, lui fournirent cependant une occasion de se laisser entendre, de suggérer, même de très loin, ce qu'il aurait aimé dire. La lettre adressée par lui au prince Napoléon parut dans le Mémorial Bordelais, puis fut reproduite dans les journaux. Elysée national, 10 avril 1849.
— Mon cher cousin, on prétend qu'à ton passage à
Bordeaux tu as tenu un langage propre à jeter la division parmi les personnes
les mieux intentionnées. Tu aurais dit que dominé par les chefs du
mouvement réactionnaire, je ne suivais pas librement mes inspirations,
qu'impatient du joug, j'étais prêt à le secouer, et que, pour me venir en
aide, il fallait, aux élections prochaines, envoyer des hommes hostiles à mon
gouvernement, plutôt que des hommes du parti modéré. Une semblable
imputation de ta part à le droit de m'étonner. Tu me connais assez pour
savoir que je ne subirai jamais l'ascendant de qui que ce soit et que je
m'efforcerai sans cesse de gouverner dans l'intérêt des masses et non dans
l'intérêt d'un parti. J'honore les hommes qui, par leur capacité et
par leur expérience, peuvent me donner de bons conseils. Je reçois
journellement les avis les plus opposés, mais j'obéis aux seules impulsions
de ma raison et de mon cœur. — C'était à toi, moins
qu'à tout autre, de blâmer en moi une politique modérée, toi qui
désapprouvais mon manifeste parce qu'il n'avait pas l'entière sanction des
chefs du parti modéré. Or ce manifeste, dont je ne me suis pas écarté,
demeure l'expression consciencieuse de mes opinions. Le premier devoir était
de rassurer le pays. Eh bien ! depuis quatre mois, il continue à se rassurer
de plus en plus. A chaque jour sa tâche : la sécurité d'abord, ensuite les
améliorations. — Les élections prochaines avanceront, je n'en doute pas,
l'époque des réformes possibles, en affermissant la République par l'ordre et
la modération. Rapprocher tous les anciens partis, les réunir, les
réconcilier[295], — tel doit être le début de nos efforts. C'est la mission
attachée au grand nom que nous portons ; elle échouerait s'il servait à
diviser et non à rallier les soutiens du gouvernement. — Pour tous ces motifs, je ne saurais approuver ta
candidature dans une vingtaine de départements, car songes-y bien, à l'abri
de ton nom, on veut faire arriver à l'Assemblée des candidats hostiles au
pouvoir et décourager ses partisans dévoués en fatigant le peuple par des
élections multiples qu'il faudra recommencer. Désormais, donc, je l'espère,
tu mettras tous tes soins, mon cher cousin, à éclairer sur mes intentions
véritables les personnes en relations avec toi ; et tu te garderas
d'accréditer par des paroles inconsidérées les calomnies absurdes qui vont
jusqu'à prétendre que de sordides intérêts dominent ma politique. Rien,
répète le très haut, rien ne troublera la sérénité de mon jugement et
n'ébranlera mes résolutions. Libre de toute contrainte morale, je marcherai
dans le sentier de l'honneur, avec ma conscience pour guide, et lorsque je
quitterai le pouvoir, si l'on peut me reprocher des fautes fatalement
inévitables, j'aurai fait du moins ce que je crois sincèrement mon devoir[296]. — La querelle
avait commencé au début des affaires italiennes. Le fils de Jérôme était le
mieux placé pour servir de trait d'union entre Lucien Bonaparte, président de
la Constituante romaine, et le président de la République française, et il ne
l'oubliait pas. Le 28 mars, à la nouvelle des succès autrichiens, au moment
où, déjà jugé compromettant, il devait se rendre à son poste d'ambassadeur à
Madrid, il avait expliqué la fausse route suivie par le pouvoir au comité
chargé d'étudier nos rapports avec le gouvernement mazzinien. Bien que blâmé
par sa sœur même, devant son père, à un dîner de l'Elysée[297], il demeurait
dans la véritable tradition napoléonienne et le savait trop pour ne pas
insister. Aussi est-ce en rejoignant, contraint, son ambassade, qu'en passant
à Bordeaux, incapable de se maîtriser, il en avait dit davantage, et cette
fois sans mesure, paraît-il[298]. D'après Léon
Faucher, le gouvernement comptait agir à son égard comme
s'il n'avait pas été parent du président[299]. On le prouva
le 25 en le révoquant pour avoir quitté Madrid sans ordres, afin de venir
intriguer à Paris, au sujet des élections[300]. Louis-Napoléon ne semblait plus lui-même ni l'aboutissant de ce qu'il figurait[301]. Toujours influencé par Falloux, il nommait Changarnier grand-officier de la Légion d'honneur, malgré le reste du ministère qui craignait que la mesure ne déplût à l'Assemblée[302], malgré qu'il sût déjà à quoi s'en tenir sans doute sur les protestations de dévouement et de fidélité dont le général l'accablait. Changarnier laissait assez souvent voir qu'il se considérait comme bien supérieur au président, qu'il traitait, avec ses intimes, de perroquet mélancolique[303]. Dans les milieux où il était appelé le sauveur de la patrie, il aimait à railler Louis-Napoléon ; il le représentait comme son protégé et se vantait de le faire conduire à Vincennes à la première incartade, il laissait même entendre que l'armée n'hésiterait pas entre lui et un coureur d'aventures et de complots ridicules[304]. Mais savoir qu'un de vos obligés a risqué de tels propos est déjà une victoire et comment mieux en jouir que de la laisser durer ? Louis-Napoléon obéissait au même sentiment en ne remarquant ni les sourires de ses ministres le long de ses pantalons à bandes rouges[305], ni leur silence trop correct, au mépris mal dissimulé, dès qu'il donnait son avis. Il écoutait, de loin, pendant les séances du conseil, tout en confectionnant, avec calme et lenteur, des cocottes en papier[306]. Sa solitude augmentait au fur et à mesure des complications nouvelles, et du fait qu'aucun principe moral ne dominait la situation, les uns et les autres n'invoquant la loi qu'au service de leurs visées personnelles, incapables d'y croire ou de s'y soumettre. Tout reposant sur lui, point central, il était impossible qu'il ne fût pas accaparé par un ensemble, forcé qu'il était, pour créer l'autorité que la situation rendait indispensable, de trouver un point d'appui ; il avait été amené ainsi à pencher à droite parce que la droite avait, en même temps que l'argent, c'est-à-dire la force et les moyens, les apparences, au moins momentanées, de la collaboration. La droite, de plus, applaudissait en Louis-Napoléon, qu'elle pensait accaparer, l'arrivée au pouvoir de ce suffrage universel auquel rêvait déjà M. de Villèle pour sauver Charles X et que M. de Genoude et M. de Lourdoueix avaient réclamé durant des années dans la Gazette de France[307]. Louis-Napoléon, parmi les prétentions de revanche incessantes chez chaque parti, se trouvait d'autant mieux amené à l'autorité que celle-ci, transitoire, prenait dans la pensée d'alliés aussi féconds en réserve, l'aspect d'une dictature renouvelée, — quoique fort modifiée, — de celle de Cavaignac. Ainsi que Guizot l'avait dit dans sa lettre aux électeurs du Calvados : Les trois gouvernements sérieux qui ont vécu et qui sont tombés en France depuis soixante ans, ont laissé après eux, à côté de la République, trois espérances, dirai-je trois perspectives de gouvernement ? Là est la difficulté. C'est à la France elle-même à la lever. Elle seule le peut. Le pouvait-elle seule, par son unique initiative générale ? Il ne le semble pas. Tout ce qui précède ne le fait guère paraître, et l'élection de décembre donnait plutôt à entendre que la nation, ne se sentant pas encore assez majeure, débattue entre trop de convoitises, pressée par trop de difficultés, avait nommé le neveu de l'empereur afin qu'il réalisât la besogne nécessaire. Louis Bonaparte devait extraire de ces trois perspectives ce qu'elles indiquaient, arrêter ceux qui marchaient vers elles par un sentiment trop mêlé ou trop simpliste, qui ne répondait pas aux besoins du pays et, pourtant, de toutes ces tendances, en y retenant les indications utiles, en y ajoutant le sens exact de la nécessité présente, ainsi que celui de l'avenir, créer, solide, un gouvernement républicain, sur des bases durables que les républicains n'avaient pu cimenter eux-mêmes. Le devoir du second Napoléon était de fonder la République, œuvre colossale, à cette date, qui eût demandé, dans la mêlée des partis et par suite, l'insuffisance de la masse, un homme hors pair. Cette exigence de l'époque achevait d'expliquer la part de vrai ou, du moins, d'utilisation cachée dans la tendance messianiste, suite augmentée, mystique et religieuse, du mouvement vers une autorité créatrice qui entraînait le siècle après ses expériences révolutionnaires successives. Saint-Simon et Auguste Comte avaient exprimé ce penchant d'une façon rationaliste, chacun à leur manière, faisant tous deux, comme précédemment les conventionnels, comme plus tard Renan, du principe d'autorité le fondement le plus sûr et le plus efficace de la rénovation sociale, au point même quelquefois de beaucoup trop sacrifier l'individu et d'oublier la valeur de l'initiative personnelle, toujours si nécessaire et qu'il faudrait presque parvenir à réveiller quand elle paraît faire défaut. L'autorité apparaissait le salut en dépit des dangers de sa négation. Elle s'imposait au point que tous les partis successivement l'avaient voulue et la réclamaient toujours. La présence centrale de Louis-Napoléon semblait empêcher l'anarchie générale d'un monde où la question politique, devenue secondaire, primait la question économique, pressante, et pourtant reléguée chaque jour davantage. La République, dira Thiers, plus tard, sur un ton désabusé, est le gouvernement qui nous divise le moins. Il avait ici un régulateur qui départageait les tendances. Le danger ou le salut venaient de la manière dont l'équilibre serait acquis, et là se laisserait voir de nouveau l'inconvénient de ce pouvoir personnel qui, faute d'un homme parfait, de plus en plus impossible au fur et à mesure que la société se fait plus complexe, tourne si vite au médiocre, à l'aventure ou à la catastrophe. Enjeu de sollicitations diverses, il ne domine plus ; ou bien les classes possédantes en font leur instrument, et le peuple est alors amené à la Révolution, ou bien il sert réellement les intérêts généraux et ceux du peuple, et les classes possédantes poussent à une guerre étrangère, sans pitié, quel que doive être le résultat, quelquefois même quand elles la pressentent désastreuse, ou, elles aussi, à une révolution, ou, plus simplement, parviennent à remplacer le souverain, selon leur choix. Logiquement, en 1848, la monarchie constitutionnelle devait aboutir à la république constitutionnelle ; mais la monarchie ainsi comprise ayant échoué après un exemple de vénalité, d'atermoiement et souvent d'égoïsme présenté, comme toujours en France, de manière à dissimuler ses qualités, la république dictatoriale s'était imposée. — Il est bien évident que l'anarchie est engendrée constamment par la démocratie quand la volonté générale est impuissante à appliquer la raison au gouvernement des passions et des intérêts. Un homme de quarante-huit, Renouvier, l'a expliqué, montrant chacun porté à concevoir la justice selon sa seule appréciation personnelle, sans prendre même garde, en considérant le monde d'alentour, que la dictature découlait de la guerre civile, parce que le besoin d'ordre et de paix civile pousse le peuple à demander à l'action despotique d'une volonté individuelle la conservation du bien social qui semble prêt à se dissoudre[308]. Il ajoutait que dans le pouvoir dictatorial subsistaient, malgré tout, certains efforts, certaines conquêtes de la démocratie, — ou de la révolution, — c'est-à-dire des principes de droit, de philosophie politique, quelques maximes d'utilité gouvernementale et populaire. Une telle autorité se faisait régulatrice de ces luttes entre les classes qui minent, peu à peu, un pays jusqu'à le conduire à la décadence, ainsi que le monde gréco-romain l'a prouvé. Elle établissait l'unique sauvegarde, malgré les fautes commises[309]. Et il y avait là, véritablement, en partie, une sorte d'avènement saint-simonien que le second Empire devait, fort imparfaitement d'ailleurs, paresseusement et par bribes, s'efforcer de développer, avec quelques saint-simoniens eux-mêmes malheureusement trop vieillis, ou plutôt trop désenchantés. D'Eichtal et Enfantin avaient préconisé un pouvoir fort, progressif, perfectionnant la nation, au lieu d'assister, trop souvent impuissant, aux intrigues insuffisamment justifiées du parlementarisme. Jules Lechevalier avait réclamé, en face du libéralisme révolutionnaire, le libéralisme organisateur, montrant que si le pouvoir négligeait la science, l'industrie, l'art, les lettres, ces forces arriveraient à se constituer d'une manière indépendante, peut-être dangereuse[310]. Afin de relever le principe d'autorité, Laurent n'avait vu qu'un appui, qu'un moyen, la démocratie organique, fondée sur un bon système d'éducation populaire et qui éviterait l'égalité absolue en instituant l'égalité proportionnelle au mérite[311]. Duveyrier ne fut-il pas toute sa vie un apôtre ardent, par ses écrits et par ses actes, de la politique réaliste[312]. Michel Chevalier avait donné aux Débats une suite d'articles remarquables sur ces questions, en s'efforçant de persuader à la royauté qu'elle devait représenter les classes inférieures[313] ; strict disciple de son maître sur ce point, il voulait que le progrès social marchât de pair avec le progrès matériel. Se plaçant ainsi entre les deux extrêmes de la terreur blanche et de la terreur rouge, les saint-simoniens voyaient arriver leur heure, encore que bien peu s'en doutassent et que les journaux fussent muets sur eux. Après le juste milieu politique de Louis-Philippe, il semblait nécessaire d'aller vers un juste milieu social. La révolution de 1848 avait été, en effet, une tendance, l'effet d'une croyance à la théorie sociale, au socialisme réalisé par l'État. Louis-Napoléon, — le Directoire de février et Louis Blanc ayant manqué leur tâche, — apparaissait bien ici encore l'expression et l'aboutissant. Le pays gardait donc, malgré tout, sa confiance au
président de la République et regardait toujours vers lui. Lors d'une de ses
visites aux hôpitaux encombrés de malades atteints du choléra, à la
Salpêtrière, il avait été accueilli par la foule d'une façon spontanée, si
violemment émue que Falloux qui l'accompagnait en demeurait surpris. La scène
était d'ailleurs singulière. A peine Louis-Napoléon
avait-il mis le pied dans la première cour que plusieurs vieilles femmes
s'étaient précipitées vers lui, s'efforçant de saisir sa main ou son habit.
Celles que la foule empêchait d'approcher lui envoyaient les baisers les plus
passionnés, de leurs deux mains, en criant : Vive mon petit Napoléon !
Vive mon amour de Napoléon ! Vive le prince Eugène ! Vive le roi Joseph !
La multitude était absolument éperdue[314]. Et Falloux
ajoute : En visitant les malades, le président se
montra très simplement et sincèrement compatissant. Il leur consacra plus de
deux heures, épuisa l'argent qu'il avait apporté, m'emprunta quelques
centaines de francs et joignit à sa libéralité des paroles qui partaient
vraiment du cœur. Il a eu, depuis son règne, plus d'un trait de dureté, mais
je crois qu'en lui c'était l'exception. De premier mouvement, sa nature était
bienveillante et douce[315]. Plus d'un
passant l'examinait quand, chaque matin, accompagné d'un officier
d'ordonnance, il allait au Bois[316], ou quand il
passait une revue au Champ de Mars, car il continuait ses parades d'une
manière significative, le plus possible. Le 7 mars, distribuant des
décorations devant une foule nombreuse qui joignait
ses acclamations à celles de la troupe[317], il dit : Je suis heureux d'avoir à vous décerner ces décorations de
la Légion d'honneur, récompense des services que vous avez rendus à la patrie
et gage certain du bon esprit et de la noble émulation qui règnent dans
l'armée. Ces récompenses honorablement acquises sont, à mes yeux, un moyen
d'entretenir dans vos rangs cet esprit militaire qui fait, au dedans comme au
dehors, la gloire, la force, la grandeur de notre patrie. Le 30 mars,
toujours plein d'avances envers l'élément militaire, il visitait les
baraquements occupés par un régiment de la ligne campé dans les jardins du
Luxembourg ; il y examinait minutieusement les objets de literie et
d'habillement, et le Moniteur du lendemain racontait avec complaisance
qu'il avait défait lui-même plusieurs lits, visité les cantines, goûté la
soupe et le pain. Le 15 avril, les journaux annonçaient qu'il avait passé un
arrangement avec le directeur d'un panorama de la bataille d'Eylau pour que
toute la garnison de Paris pût l'aller voir. Le 22 avril, il passait à
Versailles la revue de la garde nationale et de la garnison, en tout
vingt-huit mille hommes. Le 21 mai, au Champ de Mars, où s'alignaient
quarante mille hommes de toutes armes de l'armée de Paris, il arrivait à
midi, accompagné de Changarnier, de Rulhières, de Perrot, nommé la veille,
par intérim, commandant supérieur des gardes nationales de la Seine[318] ; d'autres
généraux, présents dans la capitale, s'étaient joints d'eux-mêmes au cortège
qu'ils suivirent jusqu'au retour à l'Elysée, à trois heures et demie. Les
régiments rangés en bataille sur neuf lignes, dont sept d'infanterie et deux
de cavalerie, s'étendant, perpendiculairement, de l'École militaire au pont d'Iéna,
saluèrent le prince par les cris de : Vive Napoléon
! Vive le président de la République ! La cavalerie surtout se montra
enthousiaste, levant ses sabres en jetant un : Vive
Napoléon ![319] Les assistants
répondaient. Malgré le temps incertain, les tribunes étaient bondées de
femmes élégantes et parées. Le 29 avril, il s'était rendu à Saint-Denis, qu'il avait visité avec sa mère dans son enfance ; il était accompagné du maréchal Molitor, du général Saint-Mars, du colonel Vaudrey et de deux officiers d'ordonnance, dont Laity. A la suite de sa visite à l'établissement d'éducation où la surintendante lui présenta notamment une demoiselle de Poniatowski, petite-fille du général de 1812, il désira voir les tombeaux de la basilique et fut reçu, sur le seuil, par l'abbé Coquereau, aumônier de la Belle-Poule en 1840[320]. Le lendemain 30 avril, dans l'Aube, où il allait distribuer les drapeaux de la garde nationale, il était attendu d'avance avec le plus vif enthousiasme. Troyes, qu'un journal républicain de l'endroit[321], favorable cependant au clergé, semble-t-il, appelait la métropole de la réaction, voyait dans Louis-Napoléon le sauveur attendu, car la vieille cité d'autrefois, si vivante, nid de songe où des alluvions variées entretenaient une race peut-être unique en France, si curieuse par la double tendance de sa timidité et de son audace, de son âme traditionnelle et de son âme révolutionnaire, semblait endormie depuis la fin de ses célèbres foires de Champagne et depuis que les routes de France, de Flandre et d'Allemagne ne menaient plus vers elle. Elle se souvenait, en tous cas, de l'Empire. Il y a quarante-quatre ans, disait l'Aube[322], à peu près à pareille époque, le 12 avril 1805, l'empereur Napoléon et son épouse Joséphine faisaient à Troyes une entrée triomphale par la porte de Paris... Tout le long du trajet, l'ovation s'était accentuée. Parti à cinq heures trente de l'Elysée, à six heures quarante-cinq, le prince entendait à Melun le premier discours. A chaque station, ensuite, il fallait descendre, pour satisfaire au besoin que l'on avait de le voir ou de l'entendre[323]. A la station dite des Ormes, la population était immense, conduite par le sous-préfet de Provins et le maire de Bray-sur-Seine. Le chef du bataillon cantonal dit au président : Je suis un vieux soldat ; nous nous estimons tous heureux de l'honneur d'avoir été passés en revue par vous, moi qui ai connu votre oncle, comme tous ceux qui n'ont pas eu ce bonheur... Nouvelles acclamations à Romilly. A dix heures vingt, cent un coups de canon annonçaient l'entrée du prince dans les murs de Troyes. Au discours du maire, il répondit notamment : Le dévouement de votre département dans la campagne de France, la fidélité qu'il a montrée le dernier à la cause impériale, méritaient bien mes sympathies et mon intérêt. L'enthousiasme était extraordinaire. On criait : Vive la République ! mais surtout : Vive Napoléon ! et aussi Vive l'Empereur ! Que devaient penser Odilon Barrot et le ministre de l'Agriculture qui accompagnaient le président ? — Louis Bonaparte gagna la place de la préfecture. Sur le petit pont qui la relie, par-dessus le canal, au quai des comtes de Champagne, un autel était dressé, de style gothique haut de cinquante pieds. Mgr Cœur, l'ami de la princesse Belgiojoso, qu'il avait même aidée de si près dans la littérature religieuse, y officia ; appelé à l'évêché troyen par son ami Falloux, il avait quitté, au début de mars, le cours de théologie à la Faculté de Paris, où l'avait remplacé l'abbé Gerbet ; la foule était compacte. La garde nationale des deux côtés de l'eau lourde et noire, enthousiaste à l'arrivée de son hôte, se montrait maintenant recueillie. L'évêque, avec la chaleur oratoire qui le caractérisait, et qui devait décider plusieurs jeunes filles troyennes à entrer dans les ordres, adressa au président un discours enflammé, empreint du bonapartisme le plus ardent[324]. Il terminait par une tirade sur les drapeaux remis à la garde nationale : Si un jour la patrie était menacée, rappelez-vous, pour être invincibles, qu'ils ont été tenus par le neveu de l'empereur, car il y a dans le sang des héros une vertu secrète et mystérieuse qui se communique à tout ce qu'il touche. Le président embrassa ce prélat si concordataire. Cette fête à l'aspect un peu archaïque, au milieu de ces bonnes gens confiants et simples, sûrs cependant de leur malice, montrait avec quelle facilité l'Empire était réalisable. Le 5 mai, il entendait la messe aux Invalides, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Napoléon. Il se rendait ensuite au tombeau, accompagné du roi Jérôme, du général Petit et de sa suite. Beaucoup d'anciens officiers de l'Empire, revêtus de leurs vieux uniformes, y assistaient. — Le 6 mai, au banquet donné par la ville de Paris, pour l'anniversaire de la proclamation de la République par l'Assemblée nationale, il avait répondu au discours du préfet : Je suis heureux d'entendre à l'hôtel de ville M. le préfet de la Seine associer mon nom à la prospérité de la République. Je remercie les membres du conseil municipal de m'avoir appelé au milieu d'eux pour fêter en commun un grand anniversaire. C'est qu'ils sont convaincus, comme le peuple qui m'a élu, de mon dévouement aux grands principes de notre Révolution, principes que l'ordre, la loyauté et la fermeté du gouvernement peuvent seuls consolider. Que la Ville de Paris reçoive donc ici mes remerciements et l'hommage d'un sincère attachement. Et c'était toujours au dehors, à son arrivée comme à son départ, les mêmes acclamations. Il continuait de recevoir à l'Elysée et d'y donner à dîner, — des dîners toujours bien servis dont il faisait les honneurs à merveille[325]. Il se retirait, quand il le pouvait, vers neuf heures et demie. Les bals, très courus, finissaient tard, celui du 16 mars, même, à plus de quatre heures. L'Elysée, transformé, prenait d'ailleurs une place de plus en plus importante ; c'était une cour dont le prince semblait le souverain. Les personnalités de la rue de Poitiers s'y montraient assidues et, en principe, tout le monde politique se donnait rendez-vous dans les salons présidentiels ; toutefois le personnel républicain s'étant rendu justice, dit assez singulièrement et injustement Maupas[326], s'en retirait, laissant petit à petit la place au faubourg Saint-Germain, de plus en plus envahissant et à tous ceux, — le fait est à noter[327], — qui depuis 1830 s'étaient tenus éloignés du gouvernement ; ces hommes-là éprouvaient un plaisir tout particulier à se rapprocher du pouvoir, et si certains, les opposants de 1830 et 1832, Sarrans et ses amis, apportaient une critique utile, les autres, en grande majorité légitimistes ou catholiques absolus, s'affirmaient de plus en plus dangereux. C'était, du reste, pour quelque temps un terrain neutre que l'Elysée ; on pouvait y paraître sans rien effacer de ses couleurs. Grâce à ce mélange des individualités considérables de tous les partis, de toutes les origines, de la diplomatie, du clergé, de l'armée, de la magistrature, des grands corps d'État, de la haute finance, le parfum de la République disparaissait de plus en plus[328]. Beaucoup, parmi les assidus à faire déjà leur cour, pressentaient le maître prochainement incontesté ; d'autres pensaient l'arrêter à temps, soit pour reprendre la République à leur profit, soit pour lui substituer un personnage légitimement royal. La cravate donnée à Changarnier n'avait été que la récompense de son perpétuel empressement, auquel l'encourageaient aussi ses amis. Tocqueville lui avait dit, à la suite de l'incident parlementaire qui avait supprimé son traitement : Même sous la monarchie, aucun ministère ne pourrait continuer votre commandement après un tel vote ; et il lui avait répliqué : Oui sous la monarchie, mais en cas de désordre et de danger, le président, persuadé qu'il s'agit de son pouvoir, peut-être de sa vie, me conservera mon commandement[329]. Comment aurait-il pu douter de sa valeur ? Thiers et Barrot auraient été jusqu'à lui dire au moment de la reconstitution du ministère : Si vous voulez être président du conseil, nous vous proposerons au prince, qui vous acceptera avec plaisir[330]. Et Louis-Napoléon lui aurait dit, lui-même, le 7 mai, après le débat sur la campagne de Rome : Laissez les ministres bavarder avec cette Chambre. Quand ils seront déconsidérés, ils en prendront d'autres. Vous êtes seul indispensable. Réservez-vous pour le moment où nous devons faire notre affaire ensemble[331]. Paroles bien surprenantes, d'ailleurs, étant donnée la réserve constante du prince à cette date. Il allait dans les magasins. Le 30 mars, il achetait un cachemire français chez Biétry[332]. Le 11 avril, il approuvait les nouveautés de chez Delisle, qui faisait mettre dans les quotidiens la réclame suivante : L'exposition des nouveautés de chez Delisle a réuni l'élite de la société parisienne. Chaque année, la reine et les princesses venaient dans les somptueuses galeries de l'hôtel de la rue Grammont admirer les chefs d'œuvre de l'industrie française. Le président de la République, à son tour, est allé aujourd'hui visiter l'exposition Delisle ; il a adressé de grandes félicitations aux chefs de l'établissement et il a fait de nouveaux achats. A la revue du 21 mai où il fut si acclamé[333], tout le monde avait remarqué dans les tribunes une belle personne ; les connaisseurs avaient même admiré sa voiture, charmante, sans armoiries, timbrée d'un simple petit cheval[334]. C'était Miss Howard. D'après la chronique galante, il la trompait d'ailleurs avec des actrices nombreuses, dont Mlle Plumkett, et l'on racontait diverses histoires, quelques-unes assez scabreuses. Un membre de l'Institut, numismate, le marquis de Lagrange, écrivait même à M. Read, à la date du 7 février 1849, dans le style du temps : L'Italie est en proie aux barbares, la France est paralysée par le mot sacramentel de république, elle ne peut agir. Le président continue à se bien conduire, il devrait seulement ne pas découcher toutes les nuits ; il vaudrait mieux recevoir ses houris à l'Elysée, ce serait plus sûr[335]. — Deux mois auparavant, le 27 mars, une femme encore jeune s'éteignait aux Néothermes, à la suite d'une longue et douloureuse maladie[336]. C'était Mme Gordon. On n'a pas su, jusqu'à présent, si l'ancien conspirateur vint auprès de sa complice à ses derniers moments. |