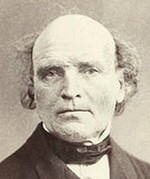LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
ET LE MINISTÈRE ODILON BARROT
II. — LE PROCÈS DE BOURGES.
Le palais de Jacques Cœur à Bourges. — Le réquisitoire, ses imprécisions, ses accusations formelles. — La condamnation décidée d'avance. — L'énumération et le signalement des prévenus. — Le 7 mars. — Entrée et costume des accusés. — Protestations préliminaires de Blanqui, d'Albert, de Barbés, de Courtais. — Le président Baroche. — Les interrogatoires. — Déposition de Raspail, de Quentin, de Bonne, de Courtais. — Blanqui, d'après les dépositions des témoins mêmes, cherche à prouver que la journée du 15 mai a été voulue par la police. — Le témoin Grégoire condamné à 100 francs d'amende à cause de sa déposition. — Déposition caractéristique de Buchez. — Déposition d'Etienne Arago, de Quentin, d'Edmond Adam, secrétaire général de la préfecture de police. — Explications de Sobrier. — Protestations nouvelles et réitérées de Blanqui. — Flocon et Barbés. — Degousée et Raspail. —La déposition de Lamartine. — Le colonel de Goyon. — Déclaration de Ledru-Rollin sur les accusés. — Armand Marrast. — Le célèbre Vidocq. — L'incident Ginoux-Courtais. — Le cas Huber. — Marie. — Le réquisitoire du procureur général. — Les avocats généraux de Chènevières et de Royer. — Plaidoyers des défenseurs. — Raspail, Blanqui et Barbés se défendent eux-mêmes. — Blanqui et Barbés au sujet du document Taschereau. — Le procès représente en petit une sorte de liquidation nouvelle de la Révolution. — Situation et aspirations de la bourgeoisie française.Le 7 mars, le palais de Jacques Cœur, à Bourges, attachant par son architecture irrégulière et bien vieille France, était entouré, dès avant dix heures du matin, par la gendarmerie mobile, les gardiens de Paris, en uniformes d'anciens sergents de ville, et la troupe de ligne. Dans la salle d'audience exiguë, que le triple banc des accusés et du jury, ainsi que le bureau de la Haute Cour, occupaient en grande partie, des ouvriers travaillaient encore ; deux vastes tribunes, l'une inférieure, l'autre supérieure, destinées aux témoins et aux jurés que le sort ne désignerait pas pour siéger, garnissaient le fond, du côté de l'auditoire ; au-dessus de la Cour se trouvaient des stalles grillées réservées pour les membres de la Cour de Bourges et les notabilités de la ville. L'acte d'accusation racontait la fameuse journée du 15 mai, avec beaucoup de détails, quelquefois à sa manière, souvent avec une sorte d'innocence qui ne semblait pas voulue et, de ce fait, montrait à quel point le personnel gouvernemental avait mal conscience de son rôle, des réformes, tout au moins, que la situation économique rendait nécessaires, du véritable esprit de la révolution et d'où elle venait. Le gouvernement, après avoir parlé de l'agitation des clubs et du décret de l'Assemblée, du 12 mai, interdisant l'apport de pétitions en personne à la barre, constatait : Par les élections du mois d'avril, le suffrage universel avait déféré à l'Assemblée nationale le gouvernement du pays jusqu'à la promulgation de la constitution. Avant même d'entrer en fonctions, ce nouveau pouvoir avait de nombreux ennemis. L'hostilité soulevée par le mécontentement, l'impatience des ambitieux et des novateurs, et par la perversité des anarchistes, éclatait surtout au sein des clubs. A ce mois de mai, Blanqui présidait le club central républicain, Flotte en était le trésorier, Quentin en était membre. Sobrier donnait asile, rue de Rivoli, 16, au Club des Clubs, club centralisateur, présidé par Huber, et siégeant en dernier lieu dans l'orangerie des Tuileries. Seigneur et Housseau étaient membres actifs et rédacteurs du journal la Commune de Paris, fondé par Sobrier. Raspail présidait le club des Amis du Peuple ; Villain était président de la société des Droits de l'Homme, dont faisait partie Laviron ; Barbès et Huber étaient membres du comité central de cette société. Thomas appartenait au club des Jacobins, Larger à un club résidant à Passy. Degré était d'un club établi à Montargis. Soit à raison de ce décret, soit par suite des convocations incomplètes, le 13 mai, premier jour fixé pour la manifestation, la réunion fut peu nombreuse ; les porteurs de la pétition s'arrêtèrent au milieu de la place delà Concorde et la remirent à un représentant du peuple. Le 14, nouvelle réunion dans les clubs, nouvelle délibération où fut résolue une tentative plus complète pour le 15 ; on décida des termes de la pétition ainsi que du caractère à donner à la manifestation. Suivant les uns, elle devait avoir lieu sans armes, sous peine de prêter la main à la réaction et de tomber dans un piège ; l'heure n'était pas venue de recourir à la force ouverte. Selon les autres, la sympathie de la population pour la cause de la Pologne, la violation du décret de l'Assemblée amèneraient infailliblement une collision ; on devait, pour en profiter, se munir d'armes cachées. Aussi les uns marchèrent-ils à la manifestation sans armes, les autres y vinrent armés ; d'autres donnèrent des instructions pour tenir des armes prêtes en cas de résistance à la garde nationale. Dans cette prévision, les sections de la société des Droits de l'Homme furent déclarées en permanence. Les chefs de cette révolte contre la loi pouvaient ne pas être d'accord sur les préparatifs et l'heure de l'attaque contre l'existence même du gouvernement, mais tous étaient résolus, dès que le moment paraîtrait favorable, à armer les citoyens les uns contre les autres et à parvenir, par la guerre civile, à la destruction du gouvernement[1]. Ainsi le gouvernement accusateur ne précisait pas davantage les préparatifs. La Constituante était dans son rôle en se défendant ; représentant une majorité violemment conservatrice, elle poursuivait jusqu'au bout de ses rancunes ceux qui avaient voulu que 1848 portât ses fruits ou même ceux qui, plus modestes, avaient, du moins, voulu maintenir ses promesses. Louis Bonaparte, quant à lui, demeurait à l'écart. Il bénéficiait, toujours sans agir, de la condamnation, visiblement décidée, mais il n'était pas diminué par ce nouvel acte brutal contre ce qui subsistait de la révolution ; il demeurait entre la révolution et le Parlement ; lorsque le Parlement aurait liquidé les derniers soldats révolutionnaires, il prendrait d'autant mieux et plus vite possession de la scène, déblayée sans répit par ses adversaires. L'acte continuait par le récit détaillé du 15 mai. Il racontait la manifestation partant à six heures et demie du matin, après avoir entendu deux discours de nature à ajouter à l'excitation des esprits, de la place de la Bastille, conduite par Sobrier et Huber, rejointe boulevard du Temple par Blanqui et ses hommes, plus loin par Raspail. A midi, elle était arrêtée place de la Madeleine par le général Courtais, investi du commandement général des forces destinées à faire respecter les décrets de l'Assemblée et à la protéger contre un envahissement. Le général, pour éviter le sang, — ce qu'on prenait soin de ne pas dire, — consentit à crier : Vive la Pologne ! ainsi qu'à laisser présenter une pétition dans l'intérieur de l'Assemblée. Il s'efforça en même temps, sans succès, de faire ratifier sa promesse par le président parlementaire, et, pendant qu'il s'y employait, la colonne insurrectionnelle s'avança sur la place de la Concorde. Elle gagna bientôt l'autre rive et flotta contre les grilles du Palais-Bourbon. Toujours afin de la calmer, Courtais donna l'ordre de mettre les baïonnettes au fourreau. Lamartine et Ledru-Rollin essayèrent aussi de la haranguer du haut du péristyle. Après des efforts inutiles pour ne laisser pénétrer dans le palais que les délégués auxquels il en avait promis l'accès, le général Courtais fit ouvrir les grilles, et l'Assemblée fut ainsi envahie de ce côté vers une heure. Une partie de la foule gagna la rue de Bourgogne et, de ce côté également, Courtais accourut. L'acte d'accusation, qui ne redoutait pas l'hypocrisie, portait alors que l'officier parut à plusieurs témoins aider quelques individus à consommer l'escalade qu'ils avaient commencée. Sur ce point, et dans l'intérieur du palais, les efforts, quel qu'en fût l'objet, eurent le même résultat. — L'Assemblée envahie, Louis Blanc obtient le silence nécessaire à la lecture, — faite par Raspail, — de la pétition. Blanqui lui succède, on sait la scène. Louis Blanc et Raspail invitent ensuite le peuple à se retirer. Huber exige un défilé de citoyens devant la tribune. Barbès y reparaît. C'est alors qu'il demande le départ immédiat d'une armée pour la Pologne, le vote d'un impôt d'un milliard sur les riches, l'expulsion de Paris des troupes qui y séjournent. Nouvelles agitations jusqu'à ce que Huber jette la fameuse phrase sur l'Assemblée dissoute et finisse sa péroraison par le cri classique A l'hôtel de ville ! — Les révolutionnaires agissaient plus brusquement et avec plus de franchise, comme avaient agi Lamartine, Ledru-Rollin et Crémieux, au début de la révolution. Les premiers, se servant de l'Assemblée, n'avaient pas eu à la dissoudre avant de gagner la maison municipale ; les seconds, luttant contre l'Assemblée qui les rejetait — alors qu'ils en faisaient partie, ce qui est significatif, — suivaient une ligne de conduite presque fatale, défendable en tout cas, en essayant de lui infliger l'avertissement le plus sévère. Deux bandes, l'une sous la conduite de Barbès, qui suivit la rue de Rivoli, l'autre sous les ordres d'Albert, qui prit la rue de l'Université, se rejoignirent sur le quai, passèrent malgré la garde nationale, puis gagnèrent l'hôtel de ville. Barbès et Albert y auraient alors signé un décret de dissolution de l'Assemblée ainsi qu'une liste du nouveau gouvernement où, à côté de leurs noms, figuraient ceux de Ledru-Rollin, de Louis Blanc, de Raspail, de Leroux et de Thoré. Blanqui et Blanc auraient été vus à l'hôtel de ville. Sobrier, pendant ce temps, envahissait le cabinet du ministre de l'Intérieur. Courtais était arrêté à l'Assemblée de la façon, — le réquisitoire ne le mentionnait pas, — la plus outrageante. Lamartine et Ledru-Rollin se rendaient à l'hôtel de ville à leur tour où l'on s'assurait de Barbès, de Bonne, d'Albert et de Thomas. A sept heures, la garde nationale s'emparait de la maison de Sobrier, rue de Rivoli ; elle y trouvait des décrets, des munitions, des armes. Sobrier était arrêté lui-même au café d'Orsay. Huber était pris, à six heures et demie, rue Coquillère, puis remis en liberté. Flotte se rendait, à dix heures du soir, à la préfecture et en sortait vers minuit. On avait annoncé que la nuit serait terrible. Il ne se passa presque rien. L'acte d'accusation énumérait ensuite à la charge des accusés des paroles provocatrices dont plusieurs ne pouvaient résonner que péniblement à certaines oreilles, même en tant que simples menaces verbales, celle-ci notamment : Nous allons prendre notre revanche aujourd'hui, envahir l'Assemblée et nettoyer les écuries d'Augias. Le plus pénible avait été jeté par Quentin, ancien receveur général de 1830 : Le peuple a le droit d'entrer dans cette Assemblée de canailles qui veut escamoter la révolution. Et Albert, plus catégorique : Le peuple a assez des phrases... Dans une demi-heure, votre triste Chambre aura ce qu'elle mérite. Le rôle de Louis Blanqui, absent, et pour cause, ne pouvait se défendre, était très dénaturé. Raspail était présenté sous des couleurs contraires à sa généreuse et facile réalité ; Courtais presque travesti. — Le décret d'accusation se rédigeait ainsi : 1° Louis-Auguste Blanqui, âgé de quarante-deux ans, homme de lettres, né à Nice (Sardaigne), demeurant à Paris, rue Boucher, 1 ; taille de 1m,66, cheveux noirs grisonnants, sourcils bruns, front découvert, yeux gris et proéminents, nez aquilin et long, bouche petite, menton pointu, visage ovale, teint blême, barbe noire et longue. 2° Benjamin Flotte, âgé de trente-quatre ans, cuisinier, né à Cuers (Var), demeurant à Paris, rue Boucher, 1 ; taille 1m,70, cheveux et sourcils châtains, front moyen, yeux bleus, nez long, bouche moyenne, menton rond, visage rond, teint coloré. 3° Alexandre Martin, dit Albert, âgé de trente-trois ans, né à Bury (Oise), demeurant à Paris, rue et hôtel du Helder ; taille lm,68, cheveux et sourcils châtain clair, front large un peu couvert, yeux gris bleu, nez épaté, bouche grande, menton rond, visage ovale, teint clair, barbe rousse, un brèche-dent. 4e Armand Barbès, âgé de trente-huit ans, représentant du peuple à l'Assemblée nationale ; taille lm,80, cheveux châtain foncé, sourcils noirs, front découvert, yeux bruns, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, signe à la joue droite. 5° Joseph Marie Sobrier, âgé de trente-sept ans, rentier, propriétaire, né à Lyon (Rhône), demeurant à Paris, rue de Rivoli, 16 ; taille lm,70, cheveux et sourcils noirs, front découvert, yeux gris bleu, nez aquilin, bouche moyenne, menton pointu, visage ovale, teint blême. 6° Vincent-François Raspail, âgé de cinquante-quatre ans, chimiste, homme de lettres, représentant du peuple à l'Assemblée nationale, né à Carpentras (Vaucluse), demeurant à Montrouge, près de Paris, rue de la Tombe-Issoire, 55 ; taille 1m,76, cheveux et sourcils blond clair, front découvert, yeux gris bleu et proéminents, nez ordinaire, bouche grande, menton rond, visage ovale, teint coloré... Le catalogue de chair humaine suivait, mélancolique, avec les noms de Quentin, de Degré dit le Pompier, de Bonne, de Thomas, d'Amable Gaspard-Henri Courtais... ex-commandant de la garde nationale... affecté de strabisme, Laviron, de Napoléon Chancel, de Marc-Louis Caussidière, de Villain. Et l'acte se terminait : Fait au palais de justice, à Paris, 16 janvier 1849 en la chambre du conseil où siégeaient : M. Troplong, premier président ; MM. Degloset Aylies, présidents ; Faurs, Delahaye, Desparbès, Bosquillon de Fontenay, Roussigné, Brethom de Lasserre, de Boissieu, Perrot de Chezelles jeune, Saint-Albin, Poinsot, Carré, Tardif et Lascoux, conseillers, tous composant les chambres de mises en accusation et d'appel, de police correctionnelle réunies, lesquels, ainsi que M. Royer, greffier, ont signé le présent. Les signatures suivaient. * * *Le 7 mars, à une heure, les accusés furent introduits et prirent place avec calme, chacun entre deux gendarmes ; sur le premier banc, Blanqui, Albert, Barbès, Sobrier, Raspail ; sur le second, Flotte, Quentin, Degré, Larger ; sur le troisième, Bonne, Thomas, Courtais, Villain[2]. Les accusés sont généralement vêtus avec simplicité, rapporte le compte rendu, mais non sans élégance. Martin, dit Albert, étale seul un gilet blanc dit à la Robespierre. On remarque sur le troisième banc l'accusé Bonne en costume de chirurgien de la marine de l'État. Degré est vêtu d'une redingote blanche croisée sur la poitrine. Blanqui, appelé le premier, établit de suite : Monsieur le président, avant d'entrer dans le débat, je
dois déclarer que nous sommes dans l'intention de protester contre la
juridiction de la Haute Cour. Mon ami Raspail posera des conclusions
formelles au point de vue judiciaire. Quant à moi, c'est sur le rapport
politique et uniquement politique que je me propose de protester contre
l'attribution à un tribunal exceptionnel du procès politique qui nous est
fait. Blanqui devait renouveler souvent ce genre de réclamation. —
Albert déclare : Je ne veux, quant à moi, répondre à
aucune question. Barbès dit : Je dois répéter
ce que j'ai déclaré tout à l'heure dans la chambre du conseil : je ne
reconnais pas à la Haute Cour le droit de nous juger. Si vous le voulez, je
dirai pourquoi, cela seulement au point de vue politique et moral.
Flotte refuse de répondre. Courtais décline ses titres : ... Général, nommé le 24 février, à l'Hôtel de Ville,
représentant du peuple, élu par 71.833 voix, de l'Allier, chevalier de la
Légion d'honneur, décoré sur le champ de bataille par l'Empereur.
Après le discours du président aux jurés, Blanqui et Barbès protestent de
nouveau. Ils se plaignent de ce que toutes les pièces ne leur ont pas été
communiquées ; les notes de police étaient anonymes, ils ont le droit de les
connaître, ainsi, même, que leurs auteurs. Depuis
neuf mois nous pouvons dire que nous avons vécu sous verre. Les gendarmes qui
nous assistaient, les surveillants qui nous gardaient avaient ordre de faire
chaque soir un rapport sur nos actes, sur nos moindres mouvements, sur nos
soupirs même. Il n'est pas jusqu'à une larme qui soit venue mouiller notre
paupière qui n'ait été recueillie dans ce creuset de dénonciation.
Pendant la lecture de l'acte d'accusation, Courtais se lève, indigné : Mais c'est faux ! je m'inscris en faux ! Au sujet
de la phrase : Tu te trompes, Barbès, c'est deux
heures de pillage qu'il nous faut, Raspail ne peut se contenir et
Barbès certifie : C'est moi qui ai proclamé l'impôt
d'un milliard, et je jure devant Dieu et sur mon honneur que personne n'a
répondu par une demande de pillage. Puis, revenant sur le fond du
débat : De quel droit prétendez-vous me juger ? du
droit du plus fort[3]. Si nous avions été les plus forts au 15 mai, vous eussiez
acclamé notre gouvernement, comme vous avez acclamé le 24 février... Oui, c'est le droit de la force, rien que la force qui
vous constitue nos juges, puisque tel est le nom que se donne toujours le
parti vainqueur, et on vient demander ma condamnation[4] à un tribunal exceptionnel ; on vous a choisis pour être
bien sûr que vous ne failliriez pas à la tâche. Vous défendez contre nous
l'idole que vous adorez ; le capital, comme les païens défendaient Jupiter et
Mercure quand le Christ venait apporter une religion nouvelle. Quel bonheur
pour vous de frapper des socialistes, les gens qui ne vous font une guerre à mort
et ne veulent renverser votre idole que pour combler de biens l'humanité
entière et vous-mêmes qui nous combattez, qui voulez nous jeter dans les
cachots et qui nous condamneriez à mort si la révolution de Février n'avait
aboli cette peine ! Le président Baroche se récria : Je ne puis tolérer un semblable langage. D'ailleurs, vous
vous nuisez à vous-même, et je vous conseille plus de modération.
Alors Barbès : Qu'ai-je donc dit de blessant ?
J'explique la position que nous a faite la fatalité. Je n'en veux pas aux
citoyens qui sont là pour me juger ; ils obéissent, je le répète, à une
fatalité qui s'attache aux sentiments du gouvernement... J'ai dit tout ce que
je voulais, c'est que je proteste contre votre compétence. Je ne suis ici que
contraint et forcé. Mon rôle est fini, demain je ne me présenterai pas à ce
débat. Et étendant les bras : Faites de moi
ce que vous voudrez. Albert se solidarisait avec Barbès. Raspail
trouvait que le débat commençait mal, et s'efforçait de rappeler les juges au
sentiment de la réalité : Songez à la vie que nous
menons depuis neuf mois. Nous sommes éloignés du monde... Le secret nous a changés : nous ne savons plus rien de
cette vie de fraternité que nous voulons et, suivant le mot de Tacite, si la
parole s'en allait avec la mémoire, nous ne parlerions plus. Il faut faire la
part des calomnies qui pèsent sur nous et sur lesquelles nos méditations sont
arrêtées depuis neuf mois ; si elles nous arrachaient, je dirai même une
impertinence, soyez sûrs qu'elle pourrait être sur nos lèvres, mais jamais
dans nos cœurs. Il plaidait lui aussi, à la séance du lendemain, où Barbès et Albert devaient être amenés de force, l'illégalité du jugement, à l'aide de conclusions assez difficilement réfutables, et qui tendaient à bien montrer que les retards apportés au jugement des accusés répondaient nettement au plan politique poursuivi contre eux par l'Assemblée Nationale. Un jeune avocat, Me Lévy, déniait encore ensuite, toujours au nom de Raspail, la compétence de la Cour en faisant observer que les membres des conseils généraux n'avaient pas été élus pour être juges. Etrange destinée que celle des accusés, disait-il en terminant. Emprisonnés sous M. de Lamartine, conservés sous le général Cavaignac, les voilà qui vont être jugés sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. Pourquoi n'a-t-on pas attendu plus longtemps le retour impossible de la monarchie ? Nous n'aurions pas aujourd'hui la douleur de voir traiter devant les juges, comme ayant voulu renverser la République, des hommes dont le crime est, aux yeux de certaines gens, de l'avoir fondée. Blanqui renchérit sur la veille : Vous êtes un expédient dangereux, imaginé par un pouvoir qui se précipite dans des pensées de vengeance. Il faisait observer que l'Assemblée Nationale, outragée, voulait une revanche avant tout ; elle entendait se débarrasser d'hommes qu'elle regardait comme des obstacles à son œuvre rétrograde ; elle avait laissé ses adversaires en prison jusqu'au jour où, avec un aplomb de pape et de Sacré Collège, elle avait créé un tribunal, contraint de formuler un arrêt, à l'heure donnée. Prévoyante, elle ne faisait pas juger les accusés à Paris, ville redoutée au point que, parmi tant de jurés venus des lieux les plus divers de la France, celui de la Seine manquait justement. Le suffrage universel est dans la proportionnalité du nombre de représentants avec la population. Paris devait, à ce compte, avoir trois jurés, il n'en a pas un seul. Croyez-vous donc que la présence d'un ou de plusieurs jurés parisiens parmi nous ne changerait pas notre situation ? La Cour rejetait naturellement le déclinatoire. Les interrogatoires commencèrent le 9 mars. Raspail racontait ainsi les Amis du Peuple : Mon club était plutôt une conférence qu'un club, j'étais
un professeur, et, tous les samedis, je faisais à un nombreux auditoire un
cours politique. Ce n'était pas un club, car il n'y avait pas de bureau ; j'y
étais seul et je n'étais affilié à aucun autre club. Je disais donc là à mes
nombreux amis ma pensée toute entière ; seulement, au lieu de professer à
l'École de Médecine, je professais à la salle Montesquieu qui se trouve
placée d'une façon plus centrale et plus facile pour les cinq mille ouvriers,
négociants et autres citoyens, qui venaient chaque jour m'écouter dans un
ordre parfait. Au commencement de mars, la question de la Pologne fut agitée
par moi ; cette question, j'en suis l'inventeur, oui. La Pologne a toutes mes
sympathies. Depuis 1821, j'ai combattu pour la délivrance de ce beau pays qui
est la France orientale, le boulevard de l'indépendance européenne. J'ai
publié en 1838 un manifeste appelé la Pologne sur la Vistule, ce qui vous
prouve que j'avais envers les Polonais des engagements écrits, des
engagements de cœur. La proposition est faite d'envoyer une pétition à
l'Assemblée Nationale, qui reproduirait tous les arguments que j'ai souvent
fait valoir contre les prétentions du czar afin de ne pas voir se réaliser le
second membre de la fameuse phrase de Napoléon : La France sera républicaine ou cosaque. Cette pétition fut cause de tout ; elle était rédigée
d'avance et acceptée. Enfin, vers le 15 mai, une manifestation est organisée
en faveur de la Pologne ; cette manifestation devait être pacifique,
essentiellement pacifique. Après de longs refus, j'acceptai de m'y joindre, amenant
mon club, mais à la condition de me placer à l'extrémité du cortège...
Ce cortège de deux mille hommes, c'étaient autant de
signatures ajoutées à la pétition et pas autre chose ; je le croyais du
moins. Dans le voyage qui commençait à l'Arsenal, je suis arrêté par un
émissaire des clubs qui me dit : Il faut
passer en tête du cortège, sans cela, sans votre présence, le désordre va
éclater. J'y consens alors. En arrivant
place de la Madeleine je vis de ces figures sinistres qui n'appartiennent pas
aux républicains et que je connais très bien. J'étais embarrassé. Je ne
pouvais pourtant pas reculer et je commençai alors à marcher à la tête du
cortège. — Des agents de la police auraient exagéré le mouvement
populaire pour mieux faciliter la répression. L'ensemble de la déposition
achevait de révéler Raspail excellent homme, incapable de la plus petite
malhonnêteté et en même temps que facilement émotionnable, un peu naïf sur
plusieurs points. On vient pour m'arrêter ; je
demandai le mandat d'arrêt. Ce mandat était signé de Marie, qui avait oublié
des relations anciennes qui ne devraient jamais s'oublier, de Marie qui
aurait dû se brûler le poignet avant de le signer, — de Marie qui se
préparait aux journées de Juin, en compagnie de quelques autres. — Et Raspail
s'écriait encore à propos d'un nouvel incident : J'ai
dit la vérité, je n'ai jamais menti. Ce n'est pas la prison qui m'effraye,
mais le mensonge. C'était vrai. Quentin répondait au président qui lui reprochait d'avoir
agité une canne d'une façon menaçante : J'avais à la
main un petit jonc des plus légers, dont je suis porteur depuis quinze ans. —
Vous aviez des pistolets sur vous ! — En
sortant de l'Assemblée, je pris une voiture et je me fis conduire au
Luxembourg. Je savais la commission exécutive peu populaire et je voulais la
protéger. M. Arago, en m'apercevant, s'est écrié : Voici encore un
perturbateur, arrêtez-le, enfermez-le, ne le frappez pas, mais assurez-vous
de lui. Je fus mis dans le vestibule, gardé par huit gardes nationaux et
deux mobiles. Un officier me demanda si j'étais armé. Je lui répondis : je
suis porteur de deux pistolets de poche, les voici. Je passai là trente
heures, et, depuis, j'ai vécu en prison. Bonne fut gênant. Il avoua qu'il avait dénoncé l'insurrection de Juin. Et il s'écria en voyant rire l'avocat Léon : Ne riez pas, vous, car vous en étiez. — Un dialogue, plein d'enseignement, s'échangea : Bonne : Je dénonçai aussi le 20 juin, M. Lacambre qui aurait fait un plan de Paris en désignant la place de chaque barricade... Le 2juillet seulement, je fus appelé devant M. Trouvé-Chauvel, après une perquisition faite chez Lacambre où l'on avait trouvé un plan de l'insurrection. Il me dit alors : Si je ne m'en suis pas occupé plus tôt, c'est que le général Cavaignac avait son plan (profond mouvement) et que, d'ailleurs, vous avez déjà été signalé à M. de Lamartine comme un homme dangereux. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu égard à vos avis. — Raspail : Bonne n'a-t-il pas écrit à ses coaccusés une lettre où il rétractait sa dénonciation et disait n'avoir fait que céder à l'intimidation du juge d'instruction ? — Bonne : Non. — Flotte : La lettre existe. — Raspail : La lettre sera reproduite. Vous voyez, monsieur le président, que cet homme est trop honnête homme pour être avec nous. Je ne sais pas pourquoi on nous l'a associé. Vous devriez rougir et la justice aussi. Blanqui précisait : La lettre de Bonne était entre les mains d'un avocat qui devait plaider dans la cause. Courtais déclarait : J'ai eu la lettre en ma possession pendant quarante-huit heures. — Bonne, dans le récit le plus confus et le plus chargé, après un raccourci déjà bizarre sur son passé et ses relations avec Vidocq, prétendait que tous les accusés du 15 mai avaient juré d'assassiner Louis Bonaparte. Courtais répondait de la manière la plus satisfaisante et, avant qu'où ait entendu Me Bethmont, son avocat, auquel il disait remettre le soin de sa défense, il donnait le sentiment d'une innocence absolue. Il expliquait avec raison : On aurait pu m'accuser, me destituer, que sais-je, mais jamais m'accuser de trahison. Tous ceux qui me connaissent, vous-même, monsieur le procureur général, vous n'avez pu douter de mon honneur. Le procureur Baroche entendait remplir son rôle. L'accusation portée contre vous est soutenue par moi. Voilà ma réponse. Le 10, le premier témoin, un restaurateur, Dagneaux,
déposait de la manière la plus vague et la plus perfide. Il avait été déjà
cité contre les prévenus sous Louis-Philippe, ce qui justifiait Blanqui : On regardait son établissement comme un foyer de police et
lui comme un espion. Carlier chargeait peu les accusés. Blanqui notait : La déposition du citoyen Carlier n'est plus qu'un souvenir, une ombre de celle qu'il a faite dans l'instruction. Un autre témoin montrait par son récit la vérité des paroles de Courtais. Blanqui, sans cesse en éveil, tirait encore ici des conclusions qui amenaient le président à demander : Alors ce serait la police qui aurait poussé la manifestation dans la Chambre ? Et Blanqui : Je n'accuse pas... mais je demande si les hommes en blouse, dont l'action a été si fatale, n'étaient pas les hommes de la légion formée par ce témoin qui a dévoilé sa position secrète. Puisque le général y était, pourquoi les soldats n'y auraient-ils pas été aussi ? Qui donc a profité de la journée du 15 mai ? Le parti populaire y a tout perdu. Rappelez-vous ce vieil adage de la jurisprudence : Is fecit cui prodest. Nous, hommes de la république démocratique, cette journée a été pour nous la mort de tout avenir politique. La phrase suivante pouvait paraître, à la rigueur, glissée pour les besoins delà défense. Nous n'avions aucun intérêt à renverser l'Assemblée issue du suffrage universel ; cela eût été stupide et ne pouvait que nous précipiter dans l'abîme. Une main cachée a changé dans ce jour toute notre position, qui était magnifique, en une catastrophe inévitable, et cela au profit d'hommes politiques qui ont bien su en profiter... Carlier révélait l'existence de plusieurs polices aussitôt après la révolution, l’une à l'hôtel de ville, au profit du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, de plus celle de Sobrier. Dans ce temps de méfiance générale, chacun redoutait son voisin, et voulait être renseigné personnellement. Mis en cause, Barbès dédaignait la ruse de Blanqui au sujet de l'Assemblée : A mon sens, le peuple a plus et moins de droits que les représentants. Croyez-vous donc que je nie les actes de nos pères, que je nie le 31 mai ? Si, un jour, l'Assemblée résiste à la volonté du peuple, le peuple aie droit de la contraindre à s'y soumettre. La déposition de l'avocat Lagrange, encore qu'elle semblât un peu arrangée, fut intéressante. Elle non plus ne chargeait guère les accusés. L'hésitation de Louis Blanc y prenait une allure particulière[5] ; mais Blanc étant absent, il était impossible de savoir la vérité. Le témoin Grégoire déclara, quant à lui, qu'il ne parlerait pas devant la Cour : Le préambule de la constitution de la République française proclame des devoirs antérieurs et supérieurs à la loi positive. Les devoirs de conscience sont de cette nature. J'ai toujours accompli les devoirs de ma conscience et ma conscience s'oppose à ce que je réponde devant la Haute Cour. Voici pourquoi. La constitution inflige un supplément de peine aux condamnés de la Haute Cour de justice. Ce supplément de peine consiste en ce qu'ils ne pourront être graciés par le président de la République. La constitution du mois de novembre ne pourrait, sans une flagrante rétroactivité, être appliquée aux accusés d'un attentat commis le 15 mai. Ce qui révolte ma conscience, c'est de voir que, par son décret de renvoi, l'Assemblée Nationale veut se venger de ceux qui lui ont fait peur. Le témoin fut condamné à 100 francs d'amende et, comme il avait déposé précédemment devant le juge d'instruction, le président lut sa déposition. Elle était remplie de détails. D'après elle, Albert et Sobrier étaient ivres. Le témoin Lemansois, de la questure, qui racontait les événements passés dans l'Assemblée, montrait Raspail et Blanqui sous un autre jour que l'accusation : Raspail, après avoir lu la pétition, était descendu de la tribune. Il avait une canne à la main, et il m'a semblé qu'il faisait des efforts pour faire partir de la salle ceux qui l'emplissaient. On criait : Blanqui ! Blanqui ! Il était au pied de la tribune et il semblait combattre entre un effroi extrême et le désir de parler. Ses amis le hissèrent à la tribune en quelque sorte malgré lui ; mais, dès qu'il y fut, il prit la parole avec beaucoup d'audace et d'énergie. Blanqui intervint, sans adresse cette fois, contre le témoin ; il se montra tracassier, déplaisant. La présence de Bûchez était curieuse. Mieux que quiconque, il connaissait les accusés ; il en avait fréquenté quelques-uns, non seulement sous Louis-Philippe, mais au temps de la Charbonnerie, et dans les loges. Il racontait les mesures prises d'avance, car il faisait remonter l'événement au 12 au soir. Il y avait eu entente évidente avec Courtais, qu'il connaissait bien aussi, mais qui, sur la place même, au moment de la poussée, ne pouvait pas juger comme Buchez à l'intérieur du Palais-Bourbon. Bûchez et les parlementaires au courant avaient évidemment espéré que la manifestation pourrait tourner, grâce à un petit coup d'épaule, en faveur de l'Assemblée, décider celle-ci, peut-être, à moins de réaction ; au cas qu'elle avortât, Bûchez et quelques-uns de ses amis politiques l'avaient escomptée sans danger, sans résultat, puis admise et, cela étant, avaient estimé qu'il valait mieux la subir que l'empêcher, afin d'éviter l'éclat et le sang. Ceux-là ne semblaient pas avoir jugé qu'elle pouvait aussi, tout au contraire, servir les tacticiens de droite. J'entrai en séance, dit-il, rempli de confiance dans ces dispositions (les siennes) ainsi que dans celles qui m'étaient annoncées par le général Courtais. L'ordre du jour appelait les interpellations sur la Pologne. Le représentant Wolowski était à la tribune. Le général Courtais s'approcha de moi, me dit que l'attroupement était sur le pont de la Concorde et m'annonça que l'avis de Lamartine était de le laisser défiler devant l'Assemblée. Il prenait soin de n'accuser personne. Peu de temps après, mon bureau fut escaladé et je fus chassé violemment. Je suis moins en état de faire connaître les auteurs de ces violences que les personnes qui m'entouraient... ou : Je crois utile de raconter les faits, qui sont de notoriété publique, tels, par exemple, que les allocutions de Barbès, l'audacieuse allocution d'Huber. Je déclare que lorsque, la première fois, je les vis monter soit l'un, soit l'autre, sur les rebords de la tribune, j'ai cru que c'était pour calmer l'effervescence et en gager les envahisseurs à se retirer. Sur Courtais : Je déclare que je ne l'ai jamais cru et que je ne le crois pas encore d'accord avec les insurgés ; j'attribue toutes ses fautes à son âge, à sa faiblesse, à son désir immodéré de la popularité. Le président demanda : Qu'a dit Blanqui à la tribune ? — Je ne sais pas bien, répondit-il ; ce que je sais, c'est que Blanqui avait été poussé violemment à la tribune. — Et Barbès ? — Il avait refusé de se mêler à la manifestation et il paraissait tout attristé. Plus tard, il s'est exalté et ce qui m'a apparu le plus clair, c'est que cette exaltation était produite par la puissance et l'autorité dont semblait jouir Blanqui ; il ne voulait pas permettre qu'il se passât un acte d'autorité sans qu'il y participât. Le lendemain, un reviseur de la sténographie à l'Assemblée reconnaît que le compte rendu de la séance du 15 mai au Moniteur[6] n'était pas exact sur bien des points et ne pouvait l'être, puisqu'il ne pouvait être sténographié à plusieurs moments. Etienne Arago défend aussi Courtais : Mon impression est que, loin d'avoir aidé à l'irruption, le général s'y est opposé. Il parlait comme Bûchez au sujet de la présence de Barbès à la tribune : Il venait voir Blanqui ; il ne voulait pas laisser à Blanqui, qu'il n'estimait pas, la direction d'un mouvement qu'il croyait général. Il représentait Quentin comme un agent provocateur. Quentin se défendait en parlant avec une certaine force des rivalités des journaux. Le National, la Réforme, le Commerce, le Siècle même savaient bien venir me demander des renseignements sur les questions financières. La Réforme m'apportait même le budget chez moi pour que je l'annotasse. Mais, plus tard, par des considérations qu'on appelle des arguments irrésistibles dans certaines régions de la presse, je trouvai sur les questions de finances, comme celle des patentes, qui a commencé la révolution de Février, comme celle de recensement, qui jeta tant d'émotion dans toute la France, je trouvai les colonnes de tous ces journaux fermées par les mêmes motifs qui empêchent de parler de certaines questions, de chemins de fer ou de sucre. Ce fut alors que j'allai à la Gazette de France et à la Nation-leur demander la publicité que me refusaient les patriotes. Mais cette publicité, je ne la demandai que pour des articles spéciaux, et M. de Genoude me l'accorda avec le plus grand empressement, en même temps qu'avec une complète discrétion pour tout ce qui était en dehors des articles spéciaux. Voilà ce que j'avais à dire sur la disposition de ce Monsieur. Quand Ledru-Rollin fonda la Réforme dont il était le caissier central, il me consultait souvent et me disait : Portez cela à Flocon ou à Etienne Arago. Mon grand crime, c'est de m'être trouvé plus tard en dissentiment sur le système financier avec les hommes d'État qui se sont indûment et subrepticement substitués à ceux qui devaient avoir le pouvoir, et qui ont coûté à la France au delà des désastres de Moscou, de Waterloo, des invasions étrangères et des milliards d'indemnité. Ils avaient avancé que les caisses du trésor étaient vides, afin de pouvoir cacher leurs méfaits. J'ai dit, moi, qu'il y avait au contraire 254 millions ; il y avait plus, il y avait 300 millions, voilà la cause pour laquelle j'ai été attaqué par le témoin quand il a été obligé de se justifier, à la séance du 19 mai, devant l'Assemblée Nationale. Edmond Adam, secrétaire général de la préfecture de
police, disait à la fin de son récit : Je dois
ajouter un fait personnel à M. Marrast, maire de Paris, mais qui est connu de
moi. Nous comptions sur Huber et Barbès pour maintenir à la manifestation un
caractère pacifique. Le président l'interrogeant sur les divisions
possibles entre les différents chefs de clubs : Je
sais que M. Blanqui n'était pas aimé, même par les plus exaltés : il y avait,
je crois, contre lui, des haines personnelles. Sobrier jetait : J'ai dit que Marrast et Cie avaient remplacé les d'Orléans
et que nous n'y avions pas gagné. Voilà ce que ne m'ont pas pardonné les
hommes du National qui se sont fait de la démocratie un marchepied.
Quant à Blanqui, qui continuait de prendre volontiers la parole : On dit que j'étais hostile au gouvernement provisoire.
Oui, cela est vrai, je lui étais hostile dès le 28 février, parce qu'il
trahissait la République. Mais de là à vouloir le renverser, il y a loin.
Adam s'efforçait de faire une distinction sérieuse entre Barbès et Blanqui. Le colonel Yautiez déposait en faveur de Courtais : Je mettrais ma main au feu, je me laisserais couper en morceaux plutôt que de ne pas croire que le général Courtais n'était pas animé des meilleures et des plus pures intentions. Un ancien chef de bureau du gouvernement de l'hôtel de ville opposait aussi Barbès et Blanqui. Il prêtait au premier un discours au long duquel il aurait dit : Ne me parlez pas de Blanqui, s'il se présente, je lui casse la tête. Blanqui se récria : Je proteste contre ce parti pris de nous faire un procès de tendance. C'est un système immoral que celui qui consiste à mettre en relief des divisions qu'on est tellement avide de faire ressortir qu'on sacrifie à ce désir même la poursuite principale. Je signale ce système à MM. les jurés, je le signale au pays. Ce n'est pas un procès qu'on nous fait ; on exerce des vengeances, de basses vengeances contre ceux qui ont eu un instant la force entre les mains et qui n'ont pas su s'en servir comme on s'en sert contre eux. Barbès ne dit rien. Blanqui fit connaître encore son action au 17 mars, au 15 mai, ainsi que dans son club, et elle se réduisait à peu de choses. Il regrettait à nouveau le 15 mai : Je voyais que le peuple venait de perdre, par un mouvement stupide, une partie qui était gagnée. Il est peu probable cependant qu'il ait jamais pensé la partie gagnée. Au sujet d'Huber décrétant la dissolution de l'Assemblée : Cette phrase tomba sur moi comme un pavé lancé d'un sixième étage. Il ne nommait pas Barbès. Taschereau, fidèle à lui-même, fut venimeux. Il affirmait avoir vu Raspail et Blanqui à la tribune le désigner, ce qui ne laissait pas que de l'effrayer, car Flocon lui avait dit que Blanqui avait donné l’ordre de le faire arrêter. Raspail releva le mensonge et, insistant après que Taschereau eut certifié la véracité de son dire : Messieurs les jurés je ne viens pas vous demander un acquittement : ce que je défends, c'est ma réputation d'homme d'honneur à laquelle je n'ai jamais failli. On ne m'a pas vu à côté de Blanqui et je n'ai pas désigné M. Taschereau au poignard des assassins. Non, je n'étais pas à côté de M. Blanqui et je ne l'ai pas averti par un coup de coude de la présence de M. Taschereau. Aujourd'hui, on n'assassine personne, on n'assassine pas même les rois ; nous n'assassinons que les mauvaises idées, voilà tout. Flocon vint déclarer n'avoir jamais dit à Taschereau que l'ordre eut été donné par Blanqui de l'arrêter, puis il défendit Barbès. Celui-ci se leva : Pardon, pardon, ne me défends pas devant la Haute Cour ; je laisse dire tout ce qui est à ma charge, ne prends pas la peine de dire ce qui est à ma décharge. Il parla cependant pour certifier que jamais la phrase incriminée sur les deux heures de pillage n'avait été prononcée. Il défendit aussi Sobrier : Je déclare que je n'ai jamais trouvé en lui que les sentiments les plus honnêtes et les plus loyaux. Nous avons pu être en désaccord dans les discussions politiques élevées à la hauteur de discussions philosophiques ; je ne connais pas de caractère plus généreux, plus noble. Sur Raspail : Raspail, après avoir lu la pétition, a fait tous ses efforts pour engager les hommes qui étaient entrés avec lui, ou avant lui, à sortir. Il défendit également Courtais. Un vice-consul à Saint-Thomas, M. Landolphe, retirait sa déposition au sujet de Blanqui, qu'il avait consentie parce qu'il croyait Blanqui la cause de son malheur ; depuis, ayant vécu dans les casemates avec des hommes renseignés sur Blanqui, il déclarait solennellement se rétracter. Degousée, questeur de la Chambre, voyait dans Courtais un instrument, non un traître, mais le rendait responsable quand même de l'envahissement du Palais-Bourbon. Raspail fit alors savoir qui était le témoin : Lors du décret sur la transportation des insurgés de juin, M. Degousée n'a-t-il pas formulé un amendement pour que les accusés de mai fussent compris dans la transportation ? Et Degousée : Cela est au Moniteur et je ne le rétracte pas. Sur la fin de sa déposition, le questeur laissait passer une remarque qui montrait à quel point les clubs, au moins les principaux, demeuraient malgré tout peu dangereux, équilibrés par un gouvernement habile : Du 24 février au 15 avril, il n'y avait pas la moindre force dans Paris, que les clubs agitaient comme il leur plaisait et quand il leur plaisait. Blanqui concluait : M. Degousée n'est pas seulement un témoin, c'est un homme politique luttant contre nous qui sommes aussi des hommes politiques. Lamartine était trop naturellement généreux pour ne pas
déposer favorablement[7] : Je ne me souviens d'aucune menace, d'aucune arme, d'aucun
danger couru... Le général Courtais est pour
moi entièrement étranger à l'envahissement du 15 mai et je rougirais même de
le soupçonner un seul instant... S'il faut
dire ma pensée tout entière, je regarde l'attentat bien plus comme un
attentat d'occasion que de préméditation. C'est une grande étourderie populaire...
Ce qui exclut la pensée d'un complot consenti, c'est
précisément l'inimitié qui séparait depuis février tous les hommes de la
République extrême. Il y eut seulement un instinct qui les poussa tous à la
même heure : la Pologne était le prétexte, l'Assemblée Nationale était le but
général. Ceci sera-t-il reconnu juste par l'avenir ? L'étranger a joué un grand rôle dans cette affaire ; les
sociétés populaires de Cracovie et de Varsovie avaient, dès le commencement
de mai, envoyé des organes dans tous les clubs de Paris pour contraindre la
France à faire la guerre contre son véritable intérêt. Il jugeait le
17 mars comme le 16 avril, comme le 15 mai, comme les conjurés mêmes : Les hommes qui nous regardaient comme des républicains
trop modérés, voulaient un supplément de révolution ; leur projet était de
nous éliminer du gouvernement provisoire ou de remplacer le gouvernement
provisoire par un comité de salut public. Il narrait son entente avec
Blanqui : Je désirais voir Blanqui, que je savais
être un homme d'intelligence. Je voulus m'entretenir avec lui et, comme alors
on semait des bruits de conspiration occulte, je lui dis en lui tendant la
main et en riant : Eh bien, Blanqui, vous venez donc pour m'assassiner ?
Puis je le fis asseoir et j'eus avec lui, pendant trois heures, une
conversation des plus intéressantes, de son côté du moins. Il entra dans le
vif de la question politique. Il me parla de tous les moyens d'opérer une
véritable fusion républicaine sur les questions brûlantes de la propriété et
de la famille. Je représentais la force morale du gouvernement, lui
représentait la force de l'agitation publique ; il y avait lieu de compter
avec lui. Je le priai d'employer toute son influence à m'aider à remettre
entre les mains de l'Assemblée nationale la puissance dont le peuple nous
avait investis. Il me le promit ; je reconnais même qu'il était d'avance dans
ces idées-là. Une déposition du colonel de Goyon, du 9e dragons, caserne quai d'Orsay, fort bel homme, permettait de constater l'intelligence rudimentaire d'une partie de l'armée. Sobrier était confié à sa garde ; l'officier avait fait charger les armes de ses hommes, de tous ses hommes même, si l'on en croyait Sobrier, qui se révélait d'une nervosité maladive dans la séance suivante. Déjà pâle, peu à peu livide, fébrile et véhément, il s'écriait : L'appareil d'un supplice ne fait pas souffrir un républicain, et je lui ai pardonné comme Jésus-Christ a pardonné à ses bourreaux ! Il s'agissait du beau militaire et de ses dragons. François Arago défendit aussi Courtais. Il a commis la faute de ne pas masser ses troupes... Mais si c'est là une faute militaire, je crois le général Courtais trop loyal pour avoir pu tremper dans une combinaison hostile au gouvernement ou à l'Assemblée. Ledru-Rollin, après avoir dégagé Raspail, disait de
Barbès, — indiquant sans doute la vérité en se montrant sincère : Pour moi, Barbès a été monté, poussé par son cœur à mesure
que les événements se succédaient. Il expliquait, — il se souvenait de
février, — qu'aller à l'hôtel de ville semblait tout sauver et conduire,
arrêter même, le mouvement populaire plutôt que déchaîner la révolution ; il
le prouvait en rapportant que des membres du gouvernement l'avaient prié de
s'y rendre. J'y suis arrivé le premier. M. de
Lamartine y est entré quelques instants après moi. La garde nationale était
exaspérée ; les accusés étaient arrêtés, tout était fini. Sur Blanqui
à l'Assemblée et sur sa harangue : Je ne l'ai point
entendu distinctement. L'impression que ce discours m'a laissée est qu'il
était calme, habile dans la situation, et qu'il avait l'approbation d'un
certain nombre de représentants. Sur Courtais : Personne ne peut l'accuser. Pour moi, j'ai été dans sa
prison lui serrer la main. Il indiquait également l'existence de
plusieurs polices et même que celle de Marrast avait été chargée de le
surveiller en compagnie de Caussidière. Sur Sobrier : Nous ne considérions pas la maison Sobrier comme hostile. M. Lamartine
nous avait dit que le citoyen Sobrier avait les meilleurs intentions et qu'il
était prêt à soutenir le gouvernement. Je ne connaissais pas le citoyen
Sobrier. Je l'ai vu pour la première fois à la préfecture de police, le 24
février ; je l'ai vu depuis deux fois, au ministère de l'Intérieur où il a
toujours protesté de son dévouement. Selon Ledru-Rollin, le
gouvernement provisoire, au moins de son temps, comptait aussi sur un corps
de montagnards et sur deux ou trois clubs, dont celui des Droits de l'Homme.
Afin de soutenir Blanqui, assurant que certaines manifestations ne s'improvisent
pas, l'ancien ministre racontait : Pour vous donner
une idée de l'électricité avec laquelle une pensée commune pousse quelquefois
les hommes sur la place publique, un jour, un homme vint me dire : J'ai
appris que vous étiez menacé et je suis venu avec quelques amis. Je
regarde par la fenêtre sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Il y avait environ
vingt-cinq mille hommes ; c'est ce qu'il appelait quelques amis. Il
produisait une impression sur l'auditoire : Croyez-vous
donc que les révolutions se fassent en disant le mot pour lequel elles se
font ? Non ; on s'empare de toutes les circonstances qui peuvent émouvoir
l'opinion publique et, à l'aide d'un coup de main, on renverse le
gouvernement. Il expliquait que s'il n'avait pas fait battre le rappel
au 16 avril, c'est qu'il y avait eu danger. — Blanqui qualifiait alors la
déposition d'erronée. Il se donnait comme une perpétuelle victime offerte en
holocauste à tous les partis et la division entre les hommes de février
s'étalait une fois de plus. En attendant qu'elle se précisât mieux encore,
Barbès, après avoir spécifié de nouveau qu'il n'entendait pas se défendre,
disait remplir son devoir en certifiant que la 12e légion, dont il était
colonel, n'aurait jamais consenti à tirer sur le peuple. Ledru-Rollin
démentait aussi les deux heures de pillage. Armand Marrast semblait très affaibli : Une des circonstances les plus cruelles de ma vie à été le spectacle de l'arrestation du général Courtais qui avait, à ma connaissance, montré tout le zèle et le courage imaginables. Jamais je ne croirai qu'il ait été coupable de complicité dans l'attentat du 15 mai. Courtais le sauva d'un homme en blouse qui l'ajustait avec un pistolet. A l'hôtel de ville deux gouvernements avaient existé, dans l'aile droite, le maire de Paris qui représentait l'ancien, dans l'aile gauche, Barbès à la tête du nouveau. L'introduction de Vidocq produisit un vif mouvement de curiosité[8]. Il n'accusait guère plus de soixante-cinq ans, bien qu'il en eût soixante-dix-sept. Vêtu de noir, il portait une chemise brodée et des gants jaunes. Sa chevelure était très soigneusement peignée. Deux gendarmes le suivaient. Ses paroles mesurées, réglementaires, concernaient Bonne. Il en résultait que Bonne était un déséquilibré capable de devenir parfois dangereux. Et questionné sur les rapports que Bonne fut à même d'entretenir avec les autres accusés : Je n'ai jamais cru que Bonne eut pu avoir des relations avec des hommes taillés sur le patron de M. Blanqui et de ces messieurs. Un certain Point fut le seul qui, jusqu'à présent, maintenait une accusation contre Raspail. Il affirmait lui avoir entendu dire : Emmenez M. Barbès à l'hôtel de ville ! La déposition de Point était contredite par deux autres. Comment, s'écria alors Raspail, il ne reste à l'accusation que le témoin Point ! L'accusation contre moi croulait de toutes parts ! Les représentants disaient devant M. Point que je pourrais bien être innocent, et là-dessus il se dit : Mais il ne faut pas que notre proie échappe à Odilon Barrot ! Raspail se pensait souvent persécuté. Le reste de sa protestation était : Je me brûlerais la cervelle si j'avais eu le malheur d'envoyer un ami au danger sans y être allé moi-même. Tous ceux qui me connaissent, ceux-mêmes qui ont trahi notre cause et qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, les hommes du National, savent que si quelqu'un refuse l'action d'abord, c'est toujours moi, mais que ce n'est pas moi qui refuse de me mettre à l'action une fois engagée. Barbès se récriait aussi en se solidarisant avec Raspail pour lui exprimer sa confiance contre M. Point. Recurt reconnut que dans les clubs Barbès s'était opposé à la manifestation ; il défendit Courtais. Un lycéen déposa contre Courtais, déclarant qu'il l'avait vu tendre la mains aux envahisseurs. Le général se contenta de répondre qu'il trouvait le témoin un peu jeune. Un officier de cavalerie, Huteau d'Origny, disait que
l'appel aux deux heures de pillage avait été entendu par lui près de la
tribune. Barbès, comme Raspail précédemment, faisait alors observer que le
mot n'avait été entendu ni par les sténographes, ni par les représentants. Cela paraissait un incident vidé et les choses en étaient
arrivées à ce point que nous seuls luttions pour obtenir une enquête qui nous
permit de poursuivre, au nom du parti républicain, les hommes qui avaient
introduit ce mot odieux dans le Moniteur. Aujourd'hui, pour empêcher ces
poursuites, on fait venir un seul témoin et on en cite un autre qui ne veut
pas parler. Tandis qu'il venait de répliquer au président qui déniait
à ce mot de l'importance : Mon co-accusé, mon ami
Raspail, a très bien constaté qu'il ne fallait pas rendre le parti
républicain responsable de ce mot, le procureur Baroche s'écria : Nous ne pouvons tolérer que l'on semble ici vouloir faire
des distinctions en vertu desquelles on considérerait comme républicains ceux
qui attaquaient l'Assemblée, et comme ne l'étant pas ceux qui la défendaient.
Les vrais républicains étaient, au contraire, ceux qui résistaient à
l'envahissement. Blanqui releva : Les vrais
républicains sont ceux qui ont sacrifié leur liberté et leur vie pour établir
la république. Le procureur corrigea : Et qui
veulent la renverser quand elle est établie. Blanqui vivement : Tandis que nos adversaires qui l'ont toujours combattue
sont au contraire ceux qui veulent la renverser aujourd'hui... Je n'accuse pas le public d'hypocrisie. J'attaque le parti
qui nous impute d'avoir voulu renverser la république qu'il a, au contraire,
lui-même, toujours combattue ; je dis que c'est de l'hypocrisie...
Barbès demandait qui avait fait insérer la phrase deux
heures de pillage au Moniteur. M. Cruveilher s'écria : C'est moi-même. On demandait alors, puisqu'au dire
de ceux qui prétendaient l'avoir entendue la phrase venait d'un seul homme,
pourquoi le Moniteur l'indiquait comme poussée par plusieurs
membres des clubs ? Et Cruveilher avouait que, dans sa pensée, ces
mots devaient être supprimés. Peu satisfaite, l'accusation lâchait alors sur les accusés un sous-chef de l'administration des domaines en quête d'avancement, du nom de Ginoux, qui se vantait d'avoir désarmé Courtais en le traitant de traître. Le général sursauta : Je voudrais connaître quel est ce misérable-là ! La scène devenait invraisemblable. Le président priait l'officier de rétracter ses paroles, sans la moindre émotion devant le vieillard qui s'expliquait ainsi : C'est que je ne connaissais pas l'homme qui avait osé porter la main sur mon sabre, pas plus que celui qui m'a arraché ma croix d'honneur ; je ne la porte plus depuis ce temps cette croix, et je ne la reprendrai que quand je connaîtrai l'homme qui me l'a enlevée, car je l'ai gagnée sur le champ de bataille ; j'ai été la chercher au milieu de la mitraille, avec mon brave régiment, le 7e dragons. Cette demande de rétractation détonnait d'autant plus que le président, tourné vers le témoin, lui disait : Expliquez-nous comment il se fait que votre première déposition ne contienne rien de ces derniers faits. Et le témoin ne répondait que ceci : Le juge d'instruction ne m'interrogea pas au delà des faits généraux. Après quoi, il me dit que cela suffisait, qu'il était inutile de rien ajouter ; et M. Ginoux profitait des détails de l'arrestation qu'il se plaisait à donner pour insulter sans cesse l'accusé en répétant : Voici l'épaulette d'un traître ! Il ne pouvait quitter la barre, tant il était fait pour ce rôle singulier : Je demande à ajouter un mot : Des gardes mobiles se sont partagé des fils des épaulettes du général Courtais et les ont mis à leur boutonnière en guise de trophée. M. Fitz-James déposait dans un tout autre sens, aux applaudissements contenus de l'assistance : A ce moment, terminait-il, le général fut arrêté. Voilà tout ce que je sais. Courtais se levait aussitôt : Je remercie M. Fitz-James d'avoir dit que je n'ai pas voulu fuir ni courber la tête devant ces colères furieuses. Je le remercie d'autant plus qu'au péril de sa vie il m'a protégé et qu'il a reçu deux coups de baïonnette dont il ne nous a pas parlé. La confrontation de Saisset, qu'on avait indiqué comme le représentant d'un pouvoir occulte, placé auprès de Courtais, n'amenait rien de défini. Il en résultait que l'ordre de battre le rappel expédié au général par Buchez ne lui avait été remis que deux jours avant le 17. Il affirmait que son chef avait tenté tout le possible pour prévenir les événements du 15 mai... Les événements ont été plus forts que nous. Un incident de lettre disparue restait peu clair, et il y avait là un point qui pouvait permettre l'accusation ; cependant, malgré un débat des plus minutieux, aucune conclusion ne se dégageait. De nouveaux témoins venaient encore déposer que Blanqui, dans son club, avait essayé de s'opposer à la manifestation. Blanqui aurait même prononcé un discours, une fois, à la tribune, qui se termina par l'assurance donnée aux représentants que les pétitionnaires n'étaient tous animés que de sentiments fraternels. Antony Thouret, interminable, déposait aussi en faveur des accusés. Il racontait que Blanqui avait été forcé à coups de poing par les siens de parler de Rouen. Blanqui avouait de son coté : Les faits sont vrais ; ce sont de petites plaies secrètes que les hommes politiques tiennent cachées, car c'est le malheur des mouvements irréguliers que l'on est souvent dominé par les passions populaires que l'on voudrait dominer soi-même. Il n'y avait rien là de nouveau. Guinard défendait Villain, Sobrier et Barbès, qui l'interrompait. Ah ! mon ami, je ne me défends pas : je te prie de t'abstenir. Le Dr Leroy d'Etioles déposait que jamais Raspail n'avait dit : Emmenez Barbès à l'hôtel de ville. Un ancien secrétaire général de la préfecture de police apportait des pièces trouvées dans le dossier d'Huber, à la préfecture, et qui semblaient bien prouver son rôle de surveillant, tout au moins sous Louis-Philippe. S'était-il montré sincère en 48 ? On avait le devoir d'en douter. Huber ne figurait d'ailleurs pas sur le banc des accusés. Et Raspail observait justement : MM. les jurés doivent comprendre combien je me trouve dans une position difficile par suite de l'absence d'Huber. S'il avait été là, j'aurais tenu à confronter le témoin avec lui. C'est Huber qui m'a envoyé chercher à l'extrémité de la colonne, c'est lui qui a prononcé la dissolution de l'Assemblée, dissolution qui a compromis notre sainte cause. Aussi n'ai-je pas dû reculer devant une révélation qui me pèse sur la conscience. MM. les jurés remarqueront que personne n'a songé à arrêter Huber ; il a pu partir pour Londres quand nous restions là, ne voulant pas fuir. Il avait pourtant été arrêté le soir du 15 mai ; mais il a été relâché aussitôt et il a pu, malgré' les dénonciations, rester impunément quelques jours à Paris, puis passer en Angleterre. — Barbès demandait : Il y a ici un fait éminemment grave. Je voudrais qu'avant d'aller plus loin on sut si les lettres qu'on vient de lire sont bien de la main d'Huber. On décidait que vérification serait faite et le procureur Baroche reconnaissait : Nous devons dire à propos de la relation d'Huber, qu'il y a eu contre le maire qui l'a ordonnée un commencement d'instruction qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu. — Un témoin raconta en outre que, le matin de la manifestation, Huber vint dans un restaurant fréquenté par les socialistes pour les engager à y prendre part. Il fut assez mal reçu par les membres du club de la Révolution et du club Blanqui. Un témoin, soutenu par diverses déclarations, disait qu'il avait vu le président de l'Assemblée faire un signe d'assentiment à Raspail à la lecture de la pétition ; et on convenait alors de faire revenir Buchez. — Un membre du club de Blanqui faisait observer que parmi les affiliés, il y en avait un grand nombre appartenant à l'opinion la plus conservatrice. — D'autres témoins, nombreux, se succédaient, favorables aux accusés. Marie, comme il fallait s'y attendre, déposa sans bienveillance. Blanqui protesta contre les allégations assez vagues de l'ancien ministre des Travaux Publics : Je crois que M. Marie, comme ancien membre du gouvernement provisoire, cède un peu aux préventions que le gouvernement avait conçues contre moi... Le secret de la haine qu'on avait contre moi, c'est que mon club était sérieux et qu'on y discutait le fond des choses. Marie, après ses actes, eût dissimulé inutilement : Dans mon opinion, le club des Droits de l'Homme était plus nuisible qu'utile à la république comme je la comprends. Et il s'efforçait, sans y réussir, de prouver que Blanqui avait organisé la manifestation. Garnier-Pagès disculpait, à son tour, le général Courtais. Sobrier faisait une déclaration de foi qui entraînait une nouvelle manifestation de la Cour. Si l'Assemblée, disait-il, n'avait pas proclamé la république, nous avions le droit de nous insurger contre elle. — Barbès demandait de nouveau une enquête sur Huber, mais cette fois la réponse du président donnait assez à entendre qu'elle n'aurait pas lieu ; et Barbès concluait (le défilé des témoins prenait fin) : Je n'ai ici qu'à attendre ma condamnation. Le réquisitoire du procureur général contenait dès le
début un aveu volontaire, — car l'accusation roulait justement sur ce point,
— qui en définissant le sens du procès même, ne laissait pas, surtout un an
après la révolution, d'être curieux. Dès les
premiers jours une division profonde éclata parmi les républicains. Une
hostilité flagrante se manifesta contre le gouvernement provisoire... Quelle était la cause de cette hostilité entre des hommes
qui semblaient être les défenseurs des mêmes principes ? M. de Lamartine nous
l'a dit : Dès le 24 février, la question s'est posée entre la république
modérée et les partis extrêmes. Et frappé par la déclaration de
Ledru-Rollin, il la reprenait, tout en y glissant des variantes favorables à
la thèse qu'il devait, par son état, soutenir et qu'il défendait, en plus, de
lui-même, avec toute sa conviction d'accusateur : Les
agitateurs du 17 mars suivaient les pratiques ordinaires des révolutions ;
vous n'avez pas oublié la théorie qui a été révisée par M. Ledru-Rollin, qui
vous a dit : — Croyez-vous que les
révolutions s'accomplissent en disant le mot pour lequel elles se font ?
Quand on veut faire une révolution au profit de la monarchie, croyez-vous
qu'on crie : Vive le roi ?... Non, on saisit le sentiment qui règne
dans la foule, on s'en empare, puis, en un tour de main, on substitue au
gouvernement dont on veut se débarrasser celui qu'on veut mettre à sa place...
C'est de ce tour de main dont on a voulu user au 17
mars et au 15 avril contre M. Ledru-Rollin lui-même et ses collègues, comme,
plus tard, au 15 mai, on a voulu en user contre l'Assemblée Nationale.
Baroche aurait pu rappeler le 24 février, ainsi que les jours précédents, où
les bénéficiaires de la révolution n'avaient peut-être pas agi, au moins sur
la fin, d'une manière différente. — Blanqui était d'abord surtout visé : C'est un grand malheur que de verser le sang du peuple,
mais que serait-il arrivé si, au mois de juin, on n'avait pas déployé la
force contre ceux qui attaquaient la société ? Car c'est la société qui est
aujourd'hui attaquée, et malheur à ceux qui l'attaquent, car c'est sur eux,
c'est sur leur tête que doit retomber le sang versé pour la défense de la
cause de l'ordre ! Ne pouvant, malgré ses efforts, prouver le complot,
il insinuait peu à peu qu'à défaut de complot proprement dit il y avait pire,
puisque l'attentat se montrait manifeste contre la souveraineté nationale.
Tout servait : Vous savez quelle accusation avait
été soulevée contre Blanqui par les révélations de la Revue rétrospective :
un jury d'honneur devait s'assembler dans quelques jours pour apprécier les
faits. Nous ne nous expliquerons pas sur cette controverse ; nous imiterons
le silence gardé par l'accusé Blanqui en présence de M. Taschereau. Le réquisitoire était alors arrêté par le retour de Buchez, interrogé sur le signe qu'il avait fait ou non à Raspail pour lui permettre de lire sa pétition. Les réponses successives de Buchez aux questions posées furent assez dilatoires. Raspail, de son côté, ne s'expliqua pas bien nettement, peut-être par générosité. Il gagnait la partie aux yeux des honnêtes gens par son mot de la fin à Buchez qui se retirait : Vous devez avoir un petit remords. Après avoir établi à ses yeux la culpabilité d'Albert, de Barbès, de Sobrier, de Raspail, Baroche insistait en terminant sur la gravité du procès : Espérons, Messieurs, qu'il sera fécond en grands enseignements pour le pays et la société, en jetant une éclatante et triste lumière sur l'une des plus étranges époques de notre histoire. Ce peuple si honnête, si loyal, si généreux, et auquel on veut faire croire que nous sommes ses ennemis, il saura désormais que ses prétendus amis l'avaient trompé au 17 mars, au 16 avril, au 15 mai. Il saura que tous les faiseurs de révolution ne lui disent pas leur secret quand ils lui parlent d'organisation du travail, de ministère du progrès, de l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la Pologne et de l'Italie. Ce sont là des programmes menteurs qui servent de drapeaux aux habiles, tandis qu'en réalité il s'agit de satisfaire l'ambition de quelques démagogues mécontents ou de les débarrasser d'un rival qui les gêne, soit de faire triompher quelque honteuse théorie qui se cache, qui n'ose dire son vrai nom. L'avocat général de Chènevières développait d'une autre manière les mêmes arguments. Il fallait que la justice politique eût sa proie, et, de fait, ces vaincus n'avaient plus de place ni de raison d'être dans la société qui s'élaborait ; le Parlement continuait l'élimination révolutionnaire avec une sorte de fatalité : Rappelez-vous, s'écriait Me de Chènevières, cette théorie d'hommes à figures sinistres qui entourent le président de l'Assemblée ! L'avocat général de Royer parla ensuite. Le 28 mars, les avocats de la défense commencèrent de se faire entendre. Leur subtilité semble aujourd'hui facile, en général sans éloquence réelle, — car le style de l'éloquence est un de ceux qui vieillit le plus vite ; Me Maublanc, toutefois, déchirait assez bien une partie, — la plus petite, — du voile dont s'enveloppait la Haute Cour ; Derrière ce solennel appareil de la justice dont tous les ressorts fonctionnent avec la régularité d'une action suivie et vraie, dans les profondeurs où se dissimulent les causes premières de ces procès politiques et que l'œil du juge n'a jamais sondées, il faut aller chercher le secret véritable de cette accusation : c'est une pensée, c'est un mot enfoui aux entrailles de cette cause qu'il faut en arracher pour le jeter au grand jour. Ce mot était celui de suspect qui s'attachait aux accusés. Suspect ! Les pages sanglantes de notre histoire frémissent à ce seul mot, et l'ombre de Camille Desmoulins est prête à reparaître pour lancer encore contre cette parole homicide son immortel anathème. Bethmont défendit habilement Courtais. Raspail, Blanqui et Barbès se défendirent eux-mêmes. Raspail résumait : Mon crime se
réduit à trois points : Je suis entré dans l'Assemblée, je suis monté à la
tribune, j'ai suivi enfin la route, qui, comme toutes les routes, conduit à
l'hôtel de ville. Mais ce n'est pas l'auteur de ces faits qu'on poursuit en
réalité, c'est le clubiste, c'est celui qui ouvrait cette réunion où, comme
dans le temple, les riches et les pauvres venaient s'agenouiller sur la même
dalle. Cet homme, malheureusement incomplet, avait des paroles
étrangement belles, incompréhensibles pour la bourgeoisie d'alors et qu'elle
n'entendrait guère mieux, sans doute, aujourd'hui, parce qu'il est trop tard
et que plus l'échéance approche, moins elle semble susceptible de se
ressaisir. En guerre civile, nous ne voulons pas de
vainqueurs ni de vaincus ; cette croix de juillet que je vois vis-à-vis de
moi sur la poitrine d'un militaire, je pourrais la porter, mais je ne veux
pas porter un souvenir de guerre civile. Effaçons donc ces souvenirs ; lavons
ce sang qui a souillé les pavés de Rouen et de Paris ; entrons dans le temple
de Dieu et prions pour les pauvres ouvriers entraînés souvent par des provocations
à chercher cette mort qui serait belle dans les champs de Waterloo et qui est
hideuse dans les ruisseaux de la Cité. Raspail dévoilait son caractère
si profondément marqué par l'idéologie révolutionnaire de 93 et le sentiment
religieux. Les peuples du Midi n'ont pas de plus
belles fêtes que les manifestations religieuses, ils suivent l'image de Celui
qui fut crucifié comme nous le serons peut-être ; ils suivent le labarum
chrétien comme nous suivîmes, le 15 mai, le labarum de la république.
— La république universelle est la fraternité de
tous les peuples. Le czar Nicolas lui-même partage cet avis ; il a répété un
jour cette phrase que j'avais dite à son ambassadeur : Je ne connais que
deux gouvernements probes et honnêtes : la république pour les peuples majeurs,
et le despotisme dans les mains d'un honnête homme pour les peuples mineurs.
Les royautés constitutionnelles sont infirmes parce qu'elles ne vivent que de
fictions, et les fictions sont des mensonges. Selon lui, ce sont des
agents provocateurs qui ont tout gâté autour de l'Assemblée ; puis Huber, l'homme
du gouvernement dans le Palais-Bourbon même. Buchez lui a non seulement
fait signe, mais lui a dit : Lisez la pétition ! Une fois de
plus saisi par sa singulière habitude de se croire persécuté, il parlait de
ses ennemis les médecins[9]. Il s'écriait : Oui, il y avait complot, mais les coupables ne sont pas
ici, et, quand nous sommes sur ces bancs, je suis étonné de voir certains
individus marcher précédés de deux huissiers d'honneur... Notre vœu le plus cher, c'est la prospérité de notre belle
patrie. Nous sommes-nous jamais plaints, dans les journaux, des tortures
qu'on nous imposait, et c'est toujours sur nous que tombe le poids du jour,
c'est nous qui sommes les ambitieux, et nos anciens camarades, les
Ledru-Rollin, les Marrast, ne sont pas des ambitieux. Je le disais il y a
dix-huit ans, à la Chambre des Pairs, je suis toujours du parti des opprimés.
Qui sait si, un jour, je ne serai pas du vôtre ! Et avec cette
grandeur morale si sincère chez lui qu'elle le sauvait du ridicule où sa
bonne foi sans défiance l'entraînait quelquefois, avec cette générosité
d'autant plus admirable que le monde en donnait de moins en moins l'exemple,
il terminait : Si vous nous condamniez, croyez-vous
que nous vous en voudrions ? Voyez le passé. N'ai-je pas été condamné par des
juges, par des pairs de France ? Me suis-je vengé d'eux ? Si vous nous
condamnez, quand nous sortirons de ces lieux, où vous nous enverrez pourrir,
car ce ne sont pas des prisons, ce sont des sentines, nous irons vous tendre
la main, et vous la prendrez, car le passé sera oublié, et l'avenir
commencera. Blanqui se fit retirer la parole. Toutes les fois, disait le président, que vous établirez que les doctrines ne sont pas anti-sociales, qu'elles ne sont pas contraires aux principes établis, vous aurez la parole ; mais si vous avez l'intention de proclamer des principes qui sont contraires aux intérêts de la société, je vous interdirai la parole. Après avoir répliqué : Si nous avons adopté ces doctrines, c'est que nous les croyons bonnes, Blanqui parvenait à expliquer, en partie, ses idées. Il acceptait le débat, sinon sur les faits, du moins sur ces doctrines incriminées. Il démontrait que l'on prétendait écraser en lui le conspirateur monomane, c'est-à-dire l'homme qui, à
travers les évolutions des partis, poursuit sans ambition personnelle le
triomphe d'une idée. Il disait, non sans un certain orgueil, et qui se
montrait avec naturel, plus qu'il ne le pensait, sans doute : L'antiquité avait attribué à Hercule tous les faits des
temps héroïques, la réaction personnifie en moi tous les crimes et toutes les
atrocités ; un journal de Bourges n'a-t-il pas imprimé, le second jour de ce
procès, que ma figure n'avait rien d'humain ! Il ajoutait : Debout sur la brèche pour défendre la cause du peuple, les
coups que j'ai reçus ne m'ont pas atteint en face ; assailli sur les flancs,
par derrière, moi, je n'ai fait tête que du côté de l'ennemi, sans me
retourner jamais contre les attaques aveugles, et le temps a trop prouvé que
les traits lancés sur moi, de n'importe quelle main, sont tous allés au
travers de mon corps frapper la révolution. C'est là ma justification et mon
honneur. C'est enfin cette conscience du devoir rempli avec calme et ténacité
qui m'a soutenu la tête haute à travers les plus cruelles épreuves. En
faisant suivre à mes yeux, dans le lointain du jour, des détrompements et des
réparations, que ce jour ne doive briller que sur un cachot, peu m'importe,
il me trouvera dans mon domicile habituel, que j'ai peu quitté depuis douze
ans. La révolution victorieuse m'en avait arraché un moment ; la révolution
vaincue et trahie m'y laisse retomber. Voilà un de nos plus beaux titres de
gloire à nous ; souffrir et triompher des souffrances de ce grand peuple de
déshérités. Tourné vers le président : Doctrines
subversives, dit-on, doctrines anti-sociales ! Nous les connaissons ces mots,
ils sont presque aussi vieux sur la terre que les hommes : c'était le
vocabulaire de l'Inquisition ! C'était celui du paganisme mettant à mort les
premiers chrétiens ; c'est le langage des mondes qui s'en vont... J'ai
entendu déjà ces noires philippiques, modulées en termes tout semblables par
les réquisitoires de la monarchie, et j'ai vu en outre défiler bien souvent
devant moi ce vieux bagage des objurgations conservatrices. Il
expliquait ainsi son idéal, sa conception politique, qu'il ne séparait pas : Utopie ! Impossibilité ! mot foudroyant cloué par nos
ennemis à notre front et qui veut dire meurtrier ! Appel homicide à l'égoïsme
de la génération vivante qui n'entend pas être abattue en fleur et enfouie
pour l'engraissement des générations futures, à supposer même que le
sacrifice de la moisson du jour ne dût point stériliser les moissons à venir.
Cette arme est terrible, nous en savons quelque chose, mais elle est
déloyale. Il n'y a point d'utopiste, dans l'acception outrée du mot ; il y a
des penseurs qui rêvent une société plus fraternelle et cherchent à découvrir
leur terre promise dans les brumes mouvantes de l'horizon... De ces penseurs, les uns, comme Moïse, restent immobiles,
abîmés dans la contemplation de cette terre lointaine qui trompe
éternellement leurs regards de ses mirages fantastiques ; les autres disent :
Marchons, voici la route, elle traverse des contrées ignorées. Nous suivons
en frayant la voie, en suivant les ondulations du sol, l'œil toujours fixé
sur l'étoile qui nous guide. Ceux-là ne cheminent point à travers l'espace.
Ils s'avancent sur le terrain d'un pas rapide ou lent, selon les obstacles,
mais continu, ne reculent jamais, ne tournent pas la tête ; le 24 février ils
ont franchi d'un bond une crevasse entre deux rochers. Quelquefois, si le
fossé est trop large ou l'élan trop court, la chute est terrible : beaucoup
restent au fond de l'abîme ; la masse remonte et poursuit. Sur cette route,
la prison n'est qu'un repos pour les blessés que de nouveaux compagnons
remplacent au travail. Je suis un de ces voyageurs ; ils s'appelaient hier
des révolutionnaires, aujourd'hui des socialistes. Devant leur marche
infatigable, la distance s'efface, l'horizon soulève peu à peu son voile et
découpe la silhouette de la terre promise : nous avançons. Quelle magnifique
perspective après février ! et sitôt évanouie ! La route se montrait au loin
si belle et si large, et l'inertie nous a précipités dans d'horribles
fondrières. Ma voix a essayé de s'élever contre les perfides ; ils l'ont
étouffée sous la calomnie. Mon utopie leur déplaisait, et je n'en crois pas
d'autre possible ; c'est la clef qui doit ouvrir la porte du temple inconnu ;
il est vrai que ce n'est pas la clef d'or. Il y a des problèmes bien simples
qui semblent insolubles parce qu'ils sont mal posés. La révolution de 1848
voulait détrôner la corruption. Y a-t-elle réussi ? Non. Eh bien ! l'assaut recommencera,
la corruption a miné la France ; tous les partis en sont malades : les
dix-huit ans du dernier règne ont inoculé le virus jusqu'aux derniers
ramuncules du corps social. Traiter par des moyens matériels cette maladie
toute morale, c'est une erreur désastreuse ; on ne fera que l'aggraver. Le
pouvoir a causé le mal ; lui seul peut le guérir[10] ; qu'il ait au moins cette ressemblance avec la lance
d'Achille. Surtout, qu'il abandonne la méthode homéopathique, elle lui a mal
réussi jusqu'à ce jour. La cure doit être morale : Théories économiques,
sociales ou financières, utopies et routines échoueraient misérablement
contre le fléau qui ravage les âmes. La France est à la fois pervertie par
l'exemple de la corruption ; elle ne voit plus dans les hommes d'État qu'une
tourbe cupide, sans pudeur et sans foi. (Mouvement.) République, empire,
royauté, lui inspirent également mépris et méfiance. Trompée, ruinée,
démoralisée, elle ne croit plus à rien, se désespère et se tord sur son lit
de douleur. La république avait promis allègement et probité, ce qui se
traduisit par l'impôt des 45 centimes et les concessions. La présidence avait
promis des remboursements ; elle envoie des janissaires. — Le gouvernement provisoire acceptait trois mois de misère
des ouvriers en offrande sur l'autel de la patrie et adjugeait 200 francs par
jour à chacun de ses membres : tromperies, malversations, immoralités partout
et toujours. Aussi les crédulités et les patiences sont à bout ; il ne reste
plus que des appétits surexcités, des misères dévorantes, des consciences
montées ! C'est une dissolution générale, bientôt le chaos... Sans une
réforme radicale, la société va sombrer. On peut lui crier comme Jonas : Encore
quarante jours et Ninive sera détruite ! Que Ninive fasse donc pénitence,
c'est sa seule chance de salut. Si le pouvoir, par une brusque conversion,
balayait à coup de fouet les rapacités qui encombrent les hiérarchies, s'il
faisait succéder au cynisme de la cupidité, l'ardeur du désintéressement, si
la corruption faisait place partout, chez les fonctionnaires, au dévouement
et à la probité ; si les emplois publics, au lieu d'offrir le spectacle d'une
curée dégoûtante, n'étaient plus qu'un devoir, un sacrifice, quelle soudaine
et profonde révolution éclaterait dans les esprits ! L'exemple d'en haut est
toujours irrésistible ; l'austérité serait aussi contagieuse que la
corruption ; elle s'imposerait à toutes les classes, par l'ascendant du
pouvoir. — Mais, dira-t-on, le crédit, le travail, la circulation, sont
affaires de science et non de sentiment. Je le sais, mais la foi et
l'enthousiasme sont des leviers qui soulèvent le monde. Commençons par là,
tout le reste suivra. Alexandre, dans le désert de Gédrosie, répand sur le
sable les quelques gouttes d'eau qu'on lui apporte dans un casque et s'écrie
: Tous ou personne !... Cette abnégation de son chef électrise et
sauve l'armée macédonienne qui allait périr. Quand le peuple est à jeun,
personne ne doit manger. Voilà une utopie rêvée au lendemain de Février. Que
d'ennemis implacables elle m'a suscités ! Ils ne songeaient qu'à déchaîner
les intérêts, je voulais passionner les consciences ; il ne s'agissait point,
cependant, de ressusciter une république de Spartiates, mais de fonder une
république sans ilotes. Peut-être mon utopie paraîtra la plus folle et la
plus impossible de toutes. Alors Dieu sauve la France ! Il déclarait,
une fois de plus, n'avoir pas voulu violer l'Assemblée Nationale, ce qui eût
été abdiquer pour Paris la dictature morale
qu'il exerçait sur toute la France dont il était, en quelque sorte, la
représentation suprême : Pourquoi aurai-je voulu
renverser le gouvernement provisoire, au profit de qui ? Au profit de M.
Ledru-Rollin ? Mais vous avez pu voir, lors de sa déposition, qu'il n'était
pas mon cousin ; il était, de tous les membres du gouvernement provisoire,
celui qui m'en voulait le plus, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je sais
bien pourquoi ; ses opinions étaient plus rapprochées de la mienne que celle
de ses collègues et, dans les discordes civiles ou religieuses, les opinions
les plus voisines sont celles qui se détestent le plus... Ainsi je ne lui en veux pas, je lui pardonne bien
volontiers ; il a marché, marché ; il est allé de l'avant sans savoir ce
qu'il faisait, il a trébuché, il s'est cassé le nez... Si Blanqui
avait voulu attenter à l'Assemblée, il s'y serait pris autrement. Le procureur sentait-il l'accusation compromise ? Il fit un nouveau réquisitoire. Raspail y répondit, pas très heureusement. L'avocat de Villain, Me Rivière, s'élevait alors, avec habileté, contre les prétentions du ministère public. Les faits matériels de la cause, ceux-là dont vous a seulement parlé le réquisitoire, ne sont pas tout le procès, et là même n'est pas son véritable foyer. En effet, l'histoire de l'année qui vient de s'écouler prouve et contient tout ce que je dis. Là est le procès de Bourges ; 1849 assigne et fait comparaître 1848 en dernier ressort. C'est l'avenir qui décidera. Voilà pourquoi je disais d'abord : je plaide pour le haut jury et au delà et au-dessus pour le pays qui nous jugera tous deux. Il revenait à l'affaire du boulevard des Capucines et faisait réapparaître les journées révolutionnaires que le gouvernement provisoire avait si vite renvoyées, puis enterrées, dont il ne voulait plus même qu'on évoquât le souvenir : Un coup de feu venait de suffire pour crever une charte et toute une dynastie ; mais ce coup de feu éclatait sous les murs du ministère des Affaires étrangères, là où dormaient depuis trente-trois ans les parchemins de 1815, les outrages diplomatiques qui avaient suivi et aggravé Waterloo, et, le lendemain, une royauté se voyait écrasée par un choc soudain. Paris, qui se révoltait, réveillait la France d'un sommeil trentenaire, au milieu duquel 1830 avait ressemblé à ces paroles confuses, à ces instants de réveil vague et incomplet, qui viennent entrecouper un songe pénible. Oui, la France se réveillait enfin, émue et interdite, confuse et troublée à son réveil sous le cri perçant du peuple qui semblait lui reprocher la discorde de son long sommeil, puis, soudain, de son premier geste, précipitant en poussière les mânes monarchiques foudroyées en 93 et, depuis lors, revenant de son premier souffle, libre de sa première aspiration, désoppressée, elle dispersait les intentions vermoulues, comme le premier vent d'automne emporte en rondes folles les feuilles desséchées. Et ce peuple, qui n'a pour bonheur que la gaieté, arrivé au pouvoir, se hâtait de dépenser toute générosité en se faisant prodigue... Cependant, et tandis qu'ils étaient affaissés sous le bruit d'une chute violente, aveuglés par la poussière d'une complète ruine, ceux-là qui avaient fait jouer la sape et la mine au pied de l'édifice, se trouvèrent en cercle au premier rang autour des débris entassés des pans de murs qui surplombaient, au risque de leur tomber sur la tête ; ils conçurent et entamèrent la pensée généreuse, disons-le pour être juste, la tâche difficile d'arrêter au moins le plan et de jeter ainsi les bases de l'édifice nouveau où la société devait trouver la place et la mesure de ses idées et de ses besoins dont le développement avait ordonné la ruine de l'édifice disparu. — Vingt ans durant, dans le Parlement, dans la presse, on leur avait labouré la poitrine des souvenirs de 93, encore mystérieux et alors odieux, pour la plupart, terribles pour tous ; vingt ans durant, ils avaient protesté contre ces souvenirs d'une époque maladive dans notre histoire, qu'ils avaient comparés à ces maladies dévorantes dont la première atteinte préserve infailliblement de tout retour ; vingt ans ils avaient eu le chagrin de ne pouvoir que promettre sans même espérer pouvoir un jour prouver et tenir, et, dans leur joie, ils jetaient au vent leur cordiale hésitation, leur fraternelle timidité. Hommes de critique et de contrôle plutôt que de conception et de talents, plus habitués aux joutes du Parlement que préparés aux luttes des révolutions, leur esprit s'était dressé à démontrer ce qu'il faut éviter, plus qu'à inventer ce qu'il faut faire, et, oubliant que c'est souvent en doublant les voiles qu'on franchit les écueils, ils se vouaient avec une ardeur trop exclusive au désir de tout confier sans avaries à une embarcation improvisée et submergée entre le passé qui sombrait et la terre ferme de l'avenir. Ceux qui avaient laissé faire en février laissaient faire encore, tant ils croyaient que la révolution ne substituerait que des formes politiques nouvelles à un mécanisme gouvernemental passé de mode, comme il avait été en 1814 et 1830 créé par fantaisie des titres nouveaux à des dénominations devenues surannées ou ridicules, comme ils voyaient dans les rues des uniformes d'une coupe récente et d'une appellation inédite substitués à des insignes devenus odieux. Pour ceux-là, le passé est une série d'anecdotes. Le monde a toujours été, et partout, devra toujours être ce qu'il est à l'endroit de l'organisation du corps social. Ils ne croient, ni ne doutent ; ils ne s'interrogent pas... Pour eux, le mouvement social n'est que de l'agitation : ils confondent le silence avec l'harmonie, l'immobilité avec la régularité, et ils croient avoir tout dit, car ils ont dit tout ce qu'il savent, quand ils ont crié leurs deux vieux mots : ordre ou monarchie ! Donc ceux-là prenaient la révolution de 1848 pour un accident. ! Mais ceux qui avaient voulu et fait février, qui, le soir du 23 février, avaient recueilli et promené sur le pavé de la ville, aux lueurs des torches, ces cadavres dont le silence glacé prêchait par les rues la révolte et l'appel aux armes, dont les plaies béantes, à chaque goutte de sang perdu, faisaient bondir un pavé..., ceux-là avaient pour la révolution un autre coup d'œil, pour un avenir prochain d'autres prévisions, et dans le groupe de ceux-là se trouvait Villain, c'est-à-dire un de ceux qui tiennent au peuple par leur origine et leurs travaux, à une classe plus élevée par le nombre et la maturité des idées ; qui, le jour, pensent et réfléchissent, tandis que leurs mains manient le mètre ou le compas, qui, le soir, lisent et apprennent, qui, jusqu'alors exclus de l'arène électorale, suivaient jour par jour les luttes et en jugeaient les péripéties, qui avaient recueilli et conservé les traditions et les enseignements révolutionnaires de 89 et 93, et qui, tout d'abord, jugèrent que ce qu'on avait appelé la nation officielle était aveugle et que bon nombre de gouvernants provisoires étaient myopes. De loin, ils crurent deviner que cette ardeur des classes, la veille privilégiées et tout nouvellement républicaines, était ce que le peuple appelle un feu de paille, qu'après les premiers jours d'un enthousiasme inattendu à force d'être unanime, viendraient le refroidissement et le regret, puis la querelle, puis la lutte, comme jadis, après la nuit célèbre et féconde du 4 août, les deux ordres privilégiés avaient bientôt voulu commenter leurs serments et restreindre, sous prétexte de les limiter, leurs engagements et leurs sacrifices. Toutefois, s'ils entrevoyaient
qu'une première réaction les pousserait peut-être en arrière comme un flux
qui s'en va, un reflux sans doute les ramènerait à leur place, et tandis
qu'ils organisaient leurs forces, ils se consolaient des premiers échecs
qu'aurait à subir la démocratie en se disant l'un l'autre à l'oreille qu'il
faut d'abord tendre l'arc pour que la flèche puisse fendre l'espace qu'elle
doit traverser. Là est le principe de ces hommes dont Villain est un type et
un exemple, là est ce qu'il est venu vous dire et ce que demain le pays devra
juger. Là est la révolution de 1848, dont le procès de Bourges est une vive
miniature. D'un côté un parti plutôt obstiné que ferme dans ses opinions,
incertain de sa propre volonté, monarchique par ses sentiments, c'est-à-dire
par une crainte vague, un effroi confus d'un passé terrible, républicain sur
certains petits aspects, ayant la haine de toute domination, la soif de la
liberté ; de l'autre côté des hommes du peuple, assez loin des grandeurs
politiques pour n'en être pas éblouis, assez étrangers aux affaires du
gouvernement pour n'y avoir pas perdu ces souvenirs de notre première
Révolution et pour trouver dans ces souvenirs, chaque jour évoqués, des
éclairs illuminant à chaque pas les écueils du présent. Des hommes, enfin,
qui voulaient une bonne fois engager la nation dans la voie démocratique,
accumuler et dépenser toute leur force pour l'arracher à tout jamais aux
vieilles ornières du passé, sachant bien que plus on suit une ornière,
toujours la même, plus elle se creuse, plus il faut ensuite d'efforts et de
dangers pour s'en séparer. Entre ces deux partis, c'est-à-dire entre l'avenir
et le passé, devait éclater l'orage, comme entre deux nuées venues des deux
bouts de l'horizon d'où éclate la foudre, parce qu'elles sont chargées
d'électricité contraire, et celui-là le sentait bien qui disait, dans un
langage d'une poétique magnificence, quand l'orage semblait dissipé, qu'il
n'était peut-être qu'exporté au delà de l'horizon et de la journée : Oui, j'ai conspiré comme le paratonnerre conspire avec le
nuage, et voyez combien la résistance était immanquable et les
préparatifs de la lutte légitimes. Les révolutionnaires savent qu'en
révolution la légalité est et doit être morte, puisque la révolution se fait
tout juste pour effacer une légalité unique et insuffisante. Pour eux,
l'équité est tout et, en attendant, au milieu d'une nation dissoute, ils
savent et ils vont prendre pour règle de leurs actes la conscience qui a
toutes les preuves de l'arbitraire. Les autres, au contraire, qui prennent
toujours la légalité pour le droit, et qui dictent leur méprise au point
d'accuser les hommes de révolution d'illégalité, les autres ne savent et ne
veulent savoir que ce qui est légal. Tout ce qui est légal, ils l'acceptent ;
illégal, ils le refusent ; c'est-à-dire qu'à une révolution ils refusent tout
juste la révolution elle-même, sa réalisation et ses résultats. Pour les accusés, la république n'est que l'instrument
indispensable d'une réforme sociale, et réformer, c'est souvent transformer...
1848 est la seconde phase d'une crise humanitaire,
le second acte d'un drame séculaire commencé en 89 et 93. 89 a brisé la
vieille organisation sociale, toute de tradition empirique, et livré le monde
au chaos de l'individualisme absolu ; 48 vient recueillir les éléments mal
agrégés de la société qui suivit, et cherche son aplomb vers son mouvement
normal. La vie, c'est le travail ; 89 l'a rendu libre ; 48 doit l'organiser.
Le travail, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui fait obstacle au travail,
tout ce qui paralyse son mouvement, tout ce qui lui dérobe son but, est une
honte et une preuve de la faiblesse humaine ; l'obstacle qui ralentit le
mouvement, ou le fait dévier du but, doit s'aplanir et, pour cela, se
transformer. Là est le credo des révolutionnaires de 1848 ; ils saisissent
l'occasion solennelle de votre réunion pour le déclarer... Et il
s'efforçait de prouver que tout concourrait à l'avenir social : N'est-ce-pas la loi de l'humanité de chercher ardemment
avant de découvrir ?... Colomb avait-il vu le
nouveau monde quand il ouvrait ses voiles ? Gama savait-il les secrets de
l'Océan et les mystères de ses abîmes quand il doublait le cap des Tempêtes ?
Avait-il une certitude quand il débaptisait le cap maudit pour l'appeler
Bonne-Espérance ? Qu'importent les erreurs et les rêves ! Qu'importent les
dissidences et les querelles, les divergences, les écoles et la lutte
désordonnée des systèmes ! N'avons-nous pas vu la raison méthodique de
Montesquieu, la logique de J.-J. Rousseau et la critique subversive de
Voltaire se partager, se disputer le XVIIIe siècle et, pourtant, converger
vers le foyer qu'embrase leur génie, la première Révolution française !...
Pour l'humanité, la civilisation est comme la vie
pour l'homme et vibre sans cesse pour le transformer. La vie normale pour un
peuple, c'est l'ordre dans l'ordre avec le mouvement. Et savez-vous quels
sont ceux qui sont réellement des fauteurs de désordre et d'anarchie ?
Ceux-là qui dans leur prétentieuse ignorance, croyant tout savoir, sans avoir
appris ou cherché, rêvent l'ordre sans le progrès... L'ordre n'est pas à lui seul
l'organisation, et le pouvoir qui s'y méprend décèle la pauvreté de ses idées
; là il prouve qu'il fléchit sous le regard de la nation qui l'observe, et
comme il lui faut l'air d'accomplir sa tâche, il s'occupe de l'ordre et
toujours de l'ordre, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Ce n'est pas
l'ordre qu'il faut établir, il se trouve tout établi quand on a su réaliser
l'organisation. Le gouvernement qui comprime est vicieux et est condamné à
périr ; il doit employer les forces d'une nation ; il les absorbe s'il n'y a
plus de place pour la compression ; s'il pèse sur le peuple qu'il gouverne
autrement que pour y trouver la force d'agir, tout est perdu, tout doit se
briser : c'est l'anarchie. 1830 et 1848 sont là pour le prouver et quand
Paris a fait ses deux révolutions, ne pensez pas qu'il avait la sotte vanité
de vouloir imposer à la France des idées et des opinions qui lui
répugneraient. Paris oublie quelquefois la France, comme l'avant-garde,
bouillante d'ardeur, oublie quelquefois le gros de l'armée le matin d'une
bataille ; mais vouloir insulter à la France ou lui imposer une tyrannie,
jamais. Les révolutionnaires qu'il recèle dans son sein ont voulu vous dire
une fois leur pensée et leur but. Oui, ils ont voulu maintenir de toutes
leurs forces la révolution accomplie ; s'ils sont obstinés dans leur logique
et avancés dans ses conséquences, c'est que plus un fardeau à soulever est
lourd, plus il faut peser loin au bout du levier. S'ils veulent à outrance
combattre tout ennemi de la république fondée, c'est qu'ils savent bien qu'en
révolution il ne faut pas demander, il faut commander ; c'est qu'il faut
défendre avec vigueur la place conquise en attendant que tous les timides
soient venus doubler ses forces en remplissant ses murailles. Il y a toujours
dans une nation une fraction considérable qui désire une révolution sans oser
la vouloir, qui hésite quand elle éclate, qui accepte et applaudit quand elle
s'assied et fait sentir ses bienfaits. Ceux-là ne sont pas des
révolutionnaires, mais c'est à cause d'eux que les hommes d'action sont
nécessaires et que les hommes s'arrogent légitimement le droit de vouloir ou
de commander, sauf à en déposer religieusement le rôle le jour où la
révolution n'est plus ni ébranlable, ni contestée. Mais croire qu'une
révolution finit le soir du jour où elle éclate, qu'une fois la République
française sortie de son linceul, tout fut fait, et voir un crime dans ces
hommes qui ont puisé dans leur cœur l'inspiration de s'armer pour la
défendre, après avoir consacré leur intelligence et usé leur vie à la
préparer, c'est une folie autant qu'une injustice ! L'œuvre, en 1848, au lieu
d'être achevée, commençait à peine le jour où ils ont pris les armes, car la
proclamation de la république n'est que le prélude nécessaire de la
révolution sociale... La séance du 2 avril est restée fameuse. Un autre procès se greffait sur celui de la Haute Cour et sur celui de la révolution, autrement important pour les deux hommes en cause que leur condamnation. La réaction, quant à elle, pouvait être satisfaite. La guerre intestine s'était révélée enfin aux yeux de tous, entre Blanqui et Barbès. Blanqui, tout lé long du procès, se plaignait trop. Il ne manqua pas dans sa défense suprême, à cette habitude ; à l'entendre, il était la principale, presque la seule victime. Il finit par dire maladroitement : On vous a dit en comparant deux accusés : L'un se résigne et va à l'hôtel de ville. Et Barbès aussitôt, brusquement, avec un accent de pudeur offensée, inimitable dans son insolence : Ne parlez pas de moi ! Blanqui évoquait alors une autre accusation et déclarait : L'attaque de la Revue rétrospective n'est qu'une fausseté combinée au conseil des ministres. Barbès avec la même vivacité réplique : J'en ai parlé dans une autre enceinte et, puisque vous en parlez, j'en parlerai aussi. Blanqui toujours froid : Je me réserve de vider cette question plus tard. — Quand vous voudrez, dit Barbès. Et Blanqui ajouta : J'ai du moins la conscience de n'avoir jamais séparé ma défense de celle de nos co-accusés, cette conscience me suffit[11]. Appelé par le président à se défendre, Barbès, — et ici se manifestait une des différences de son caractère avec Blanqui, — répondit qu'il avait surtout à donner à MM. les jurés les moyens de le condamner plus facilement. Et après avoir parlé d'Huber : Tout à l'heure, malgré ma volonté, j'ai été obligé d'interrompre un des accusés qui disait qu'un fait que j'ai affirmé dans mon club était faux. Oui, j'ai dit dans le club de la Révolution que le fait était vrai et qu'il n'y avait qu'un individu qui pouvait être l'auteur des révélations dont il s'agissait, celui à qui elles étaient, imputées... J'ai tout fait pour que cette discussion n'éclatât pas ici, mais on a profité tout à l'heure de la fin des débats, pour dire, dans une espèce de discours étudié, que ce que j'avais affirmé était faux, afin de se donner le droit de dire plus tard : j'ai démenti le fait devant Barbès, et il ne m'a pas contredit. On ne s'est pas expliqué davantage ; on a bien su parler pour défendre sa liberté, pourquoi ne parlerait-on pas pour défendre son honneur ? Après que Flotte se fut inutilement mêlé au duel, dans un langage péniblement rudimentaire, Blanqui se disculpa de la sorte : Cet incident qui n'est pas flatteur pour nous, n'est pas arrivé par ma faute ; je devais répondre à ce qu'on me reprochait d'avoir fait le 16 avril, et j'ai dit que je m'étais occupé à détruire les calomnies élevées contre moi ; j'en avais le droit. Cet incident n'a aucun rapport avec le procès actuel ; si tout le monde avait fait comme moi, il n'aurait pas surgi dans le débat, mais j'en suis bien aise maintenant, puisque cela me donne l'occasion de m'expliquer, non pas devant le jury que ces discussions n'intéressent pas, mais devant le tribunal de l'opinion publique. Barbès demandait à cet individu pourquoi il avait été gracié en 1846 et le priait d'expliquer cette grâce autrement que par la rédaction du document qui lui avait été attribué. J'ai été gracié, dit Blanqui, sur le rapport d'un médecin qui a déclaré que, si je restais en prison, je n'avais pas huit jours à vivre, et, cependant, je n'ai pas voulu sortir de prison. Barbès ripostait : Il y a quelques jours, on avait l'air de dire qu'on n'était sorti de prison que le 24 février, et, cependant, on avait été gracié en 1846, on était resté dans un hôpital où on était très bien nourri... Quant à cette maladie dont on a parlé, c'est un drôle d'intérêt que le gouvernement portait à la santé des détenus. Parquin et Jeanne sont morts en prison... Pourquoi aurait-on été l'objet d'une exception ? Qu'on explique cela. Je l'explique, moi, en disant : on a fait des révélations sur des faits que personne autre ne devait savoir. Blanqui se leva de nouveau : Messieurs, l'incident qui s'est élevé tout à l'heure se videra ailleurs ; cependant je dois répondre que je ne voulais pas sortir de prison ; on m'a mis dehors malgré moi ; je réponds cela provisoirement, et je me félicite de ce qui vient d'arriver, car j'aime mieux une attaque armée qu'une haine cachée. Barbès rectifia : Vous connaissez depuis longtemps mon opinion ; je ne l'ai jamais cachée. Blanqui protesta encore : Je n'appelle pas une attaque ouverte celle qui a lieu dans un club où je ne suis pas présent[12] ; je n'ignorais pas votre haine, mais j'aime mieux qu'elle se soit produite devant moi que derrière moi. Barbès : J'ai dit mon opinion dans mon club ; le parti républicain a constitué un jury d'honneur, et vous n'y êtes pas venu. Blanqui : Je n'appelle pas un tribunal celui qui n'est composé que d'ennemis, je ne connais pas d'autres juges que l'opinion publique. L'incident n'était pas vidé et ne devait jamais l'être d'avantage. Barbès, interrogé encore une fois sur ce qu'il pouvait avoir à dire, après avoir constaté que les accusés étaient plus gênés ici que devant la Cour des Pairs, s'écria : Vous représentez une caste ennemie, parla fatalité de ses intérêts, des principes que je sers. Droit absolu du capital sur l'homme, telle est votre loi. Droit égal de chaque citoyen à tous les liens sociaux, voilà, au contraire, m'a foi. Comment donc, lorsque nous partons du point opposé de notre époque, pourrions-nous nous rencontrer ici autrement que pour nous choquer comme deux nuages chargés d'une électricité contraire ? Le besoin de défendre ce que vous croyez vos droits vous oblige à me frapper. La nécessité de détruire tout privilège pour arracher l'humanité à l'oppression du mal physique et moral me force, j'allais dire à vous attaquer, mais non ce n'est pas vos personnes que j'attaque, c'est l'inégalité seule que je combats en vous. Vous êtes les plus forts ; frappez-moi donc, Messieurs. Aussi bien, je suis peut-être plus coupable qu'on n'a su vous le dire dans ces débats. Avec une sincérité que son discours même, sa voix, son accent, les détails donnés ne permettent guère de mettre en doute, il racontait le 15 mai. Il avait d'abord cherché à prévenir la manifestation, puis il s'était imaginé qu'une occasion se présentait d'obtenir quelque chose pour la cause des opprimés et, se faisant comme une éloquence de la voix de la foule qui s'élevait au dehors et dans la salle, il sollicita l'Assemblée de ses paroles. Je ne voulais cependant pas toucher à l'assemblée même. Mais, s'écriait-il, lorsque, j'ai vu les représentants justifier, en quelque sorte, l'audace de ce décret en le prenant au sérieux, lorsque je les ai vus se disperser, quitter la salle, j'ai senti surgir dans mon âme la pensée d'un autre devoir et celle d'une plus grande espérance. L'anarchie devenait imminente, puisque tous les pouvoirs antérieurement constitués allaient manquer. Il fallait en préserver mon pays et c'était aussi le cas d'organiser, sous le bénéfice de la circonstance, un gouvernement qui ne tergiversât plus dans la voie républicaine. Je me suis donc rendu à l'hôtel de ville, non pas entraîné par la foule comme on l'a dit pour m'excuser sans doute, mais m'arrêtant de temps en temps pour voir si la foule me suivait. Pour ce crime, car je savais que, vaincu, ce serait un crime à vos yeux, vous devez me condamner, Messieurs. Et lorsque mes plus chères espérances sont trompées, quand la patrie entière est plongée dans les plus atroces douleurs, que sa chair et son âme se tordent sur ce brasier à la Gatimozin que, comme pour nous railler, on nomme du saint nom de la République, peu m'importe d'être enfermé dans un cachot ! Ses murs me préserveront du moins de voir de mes propres yeux des maux que je suis impuissant à soulager. Seulement, pardonne-moi, chère France, de ne t'avoir été utile à rien dans ma vie ! Et vous, mes frères opprimés de toutes les nations, pour qui je n'ai rien pu faire non plus, pardonnez-moi aussi, car nul ne fut plus animé que moi du désir de briser vos fers ! ... Vive la République démocratique et sociale ! Degré, Lorget,. Bonne, Villain et Courtais étaient acquittés. Barbès et Martin, dit Albert, étaient les plus frappés. Ils devaient subir la déportation. Blanqui était condamné à dix ans de détention, Sobrier à sept ans, Raspail à six ans, Flotte et Quentin à cinq. — Les six accusés contumaces, Louis Blanc, Seigneuret, Honneau, Caussidière, Laviron et Chancel étaient également condamnés à la déportation. Ce verdict frappait moins les accusés que la seconde République française. Elle était déjà lézardée ; l'événement de Bourges précipitait sa ruine. Elle croulait de toutes parts[13]. — Ce procès typique avait présenté l'aspect d'un panorama. La Haute Cour s'était précisée la scène offerte au Mystère de la Démocratie et, dans cette tragi-comédie politique, tous les acteurs de la révolution avaient comparu les uns après les autres, comme, après la cérémonie du Malade imaginaire, on voit défiler au Théâtre-Français tous les médecins grands ou petits[14]. Ces personnages marquants de la révolution s'étaient à nouveau rencontrés, les uns libres, ceux qui avaient su évaluer la distance entre les idées et les faits, quel que soit le sentiment qui les ait menés à ce calcul ou simplement à la réussite, les autres prisonniers et déjà marqués pour le cachot, ceux qui, par exagération ou pour toute autre cause, avec une véritable noblesse, en tout cas, et un sens politique en défaut, peut-être dans les détails, mais évident et très justifié dans son ensemble, avaient entendu résister au courant conservateur et le dominer[15]. La présidence de M. Bérenger (de la Drôme) était, elle aussi, savoureuse, car cet aimable vieillard aux formes académiques avait écrit et publié sous la Restauration un ouvrage contre les tribunaux d'exception[16]. L'assistance ne saisit guère, dans sa masse, ces diverses ironies. Généralement muette, elle ne s'indignait pas de voir Barbès, Raspail ou Blanqui aux mains d'agents comme des assassins. L'heure n'était pas, au surplus, au sentiment ; la France se préparait à cette indifférence vide, jugée de bon goût, qui la conduirait insensiblement à 1870. La sœur de Barbès, qui avait arraché son frère à la mort sous Louis-Philippe, et les deux filles du général Courtais entendaient seules le véritable sens des débats, au fond d'une tribune grillée. Quelques amis sentirent aussi leur importance, leur grandeur, tout ce qu'ils contenaient de poignant, de lamentable et, enfin, l'armée dispersée de tous ceux qui avaient lutté pour l'avenir, une fois de plus contraints au silence, à l'endettement dans la foule, à travers cette société sous laquelle ils n'avaient cessé d'en préparer une autre. Impressionnés, malgré tout, par Barbès, si sentimentalement chevaleresque, si éloigné des hommes de son époque et, par la compréhension pénétrante qu'il avait de ses besoins moraux, quelques journalistes le comparèrent à Luther devant la diète de Worms. Ce fut tout. La splendide défense de Blanqui, expliquant la situation de la société, resta sans écho. Le parti républicain, en réalité, paraissait s'absoudre. On vivait si vite ! L'avertissement jeté par les meilleurs des accusés ne fut pas entendu de la bourgeoisie. Prenant de plus en plus les conseils de sa crainte pour la vérité, les évaluant selon son intérêt le plus immédiat et substituant celui-ci aux véritables sentiments de conscience, d'honneur et d'intérêt réel bien compris, affolée par l'expérience parlementaire républicaine à laquelle avait conduit précédemment l'expérience parlementaire orléaniste, inquiète de ses politiciens, d'une part, du peuple, de l'autre, et reconnaissant qu'il fallait quand même fournir à celui-ci une sorte de gage, elle n'était plus cette bourgeoisie consciente d'elle-même, habile à se posséder et à se régler qui, amenée aux premières places par la Révolution, forgée par l'Empire parallèlement au peuple, puis reposée par la Restauration, avait préparé 1830 ; elle était la résultante de cet effort de 1830 réussi, quant à la révolution même, mais avorté aussitôt, ou presque, par sa faute ; elle se précisait l'aboutissant désemparé de l'élite orléaniste, si remarquable souvent, si vite désagrégée, d'autre part, par le manque de discipline et d'esprit de sacrifice, par le besoin hâtif du profit ; elle était habilement travaillée enfin, démembrée et brouillée par un clergé hostile, incapable, quant à lui, par essence, de ne pas nourrir de rancune contre tout groupe détenteur de pouvoir et de force qui ne lui réserve pas une place prépondérante. Désorientée, trop lasse et trop pressée de vivre en même temps, pour se ressaisir, portée en dépit d'elle-même, par un instinct inavoué, à reconnaître qu'elle ne parviendrait pas seule à se sauver, elle penchait toujours vers la conciliation napoléonienne qu'elle jugeait favorable à sa réunion, au moins momentanée, avec le peuple, réduit à lui-même, désolidarisé de ceux qui le conduisaient en lui donnant le sentiment de ses intérêts et de son devoir ; elle devenait de plus en plus propice à un essai de démocratie conservatrice en dehors du parlementarisme[17]. Elle avait reculé depuis les trois glorieuses ; elle reculait depuis février, et elle ne le pouvait plus, au moins en apparence, sans fournir une possibilité d'échappée à l'idée révolutionnaire. Aussi en voulait-elle, par ailleurs, au Bonaparte qu'elle était cependant contrainte d'appuyer, ou de laisser faire, hésitante, même ici, sur l'avenir inconnu qu'il représentait, haineuse contre la révolution qui l'avait permis et qu'il restait à même de continuer dans l'ordre, par la paix ou par la guerre, à son choix. Il y avait là fusion et confusion, avortement et aboutissement, ou, encore, ni l'un ni l'autre, surtout stagnation. Le lendemain dépendait de l'homme dressé au sommet de la nation, de l'usage qu'il ferait de son autorité, de la voie dans laquelle il guiderait le pays. — Dangereuse expérience, car un pays s'abandonne rarement sans le payer cher, un jour ou l'autre. La reprise des affaires romaines montrait aussi cette confusion. |