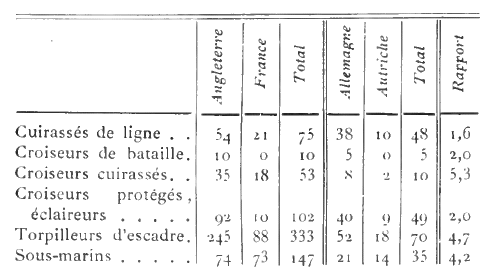HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA GUERRE DE 1914
CHAPITRE X. — LES PUISSANCES EUROPÉENNES : L'ANGLETERRE.
L'Angleterre voulait la paix. — Les Négociations anglo-allemandes avant la guerre. — La Concurrence pour les armements navals. — L'Homme anglais. — Ressources et puissance militaire de l'Angleterre.NOUS n'avons pas à revenir sur l'exposé de la politique britannique pendant les années qui se sont écoulées depuis la guerre de 187o jusqu'à la mort d'Édouard VII. Nous avons dit comment la transformation radicale qui s'est produite dans cette politique — faisant de l'associée de l'Allemagne que fut longtemps l'Angleterre, l'initiatrice de la Triple-Entente, — a modifié, du tout au tout, la balance des choses européennes. Je voudrais, dans l'espèce de revue que je tente, des puissances, à la veille de la guerre, indiquer de quel poids pèse l'Angleterre dans les affaires du monde, les dispositions du peuple anglais à l'égard de l'Allemagne, les dispositions du peuple allemand à l'égard de l'Angleterre et les forces dont l'Angleterre disposait pour prendre part au conflit ; en un mot, je voudrais dire quel adversaire était l'Angleterre pour l'Allemagne, tandis que l'Allemagne la provoquait si imprudemment. Le rôle de l'Angleterre, ou plutôt de la Grande-Bretagne, dans les affaires générales du monde, est si considérable qu'il a fallu, chez l'Allemagne, ou un véritable aveuglement ou une nécessité inéluctable, pour ne pas ménager cette force, au moment où elle se décidait à soutenir son alliée, l'Autriche-Hongrie, dans ses ambitions balkaniques. Ce n'était pas chose impossible : l'Angleterre et l'Autriche avaient de vieilles camaraderies et collaborations balkaniques, toutes deux étant liées, depuis de longues années, par une même opposition à l'expansion slave dans les Balkans. Quoique l'Angleterre eût pris, depuis l'avènement d'Édouard VII, le parti de se rapprocher de la France et de surveiller de près l'accroissement de la puissance allemande, quoiqu'elle eût été mise en méfiance par le fameux Notre avenir est sur l'eau, il n'est pas douteux que ce grand pays craignait d'en arriver à une rupture avec l'Allemagne. Les restrictions qu'il apportait à la mise en pratique de
l'Entente cordiale, le soin avec lequel il s'appliquait à éviter le mot
alliance, le souci de ne pas perdre le contact diplomatique avec Berlin, tout
confirme ce jugement. Les déclarations des ministres anglais marquent
toujours une grande réserve quand ce sujet délicat est abordé. Sir Edw. Grey,
M. Asquith ne cessent de répéter qu'il n'y a, entre
la France et l'Angleterre, aucun engagement secret obligeant l'Angleterre à
rendre un service militaire ou naval (déc.
1911). L'Angleterre avait, en effet, à prendre en considération l'ensemble de ses intérêts mondiaux, avant de se résoudre, et elle était décidée à attendre, pour se prononcer, les ultimes circonstances. L'ANGLETERRE VOULAIT LA PAIX.L'Angleterre est, par sa nature même, une puissance essentiellement pacifique. Les peuples marchands ont toujours eu, dans l'histoire, ce caractère. La prodigieuse importance des intérêts britanniques expose aux risques de guerre des richesses énormes, au moindre péril qui les menace. La prospérité accumulée, par des siècles de travail et de bien-être, dans l'archipel britannique et dans les autres pays de domination anglaise, appréhende le moindre trouble venu du dehors. La jouissance profonde de cet acquis séculaire, pénétrant des classes nombreuses de la société, cette vie, plantureuse et grasse, ces parcs aux arbres centenaires, ces villes puissantes aux rues actives, aux longs faubourgs pleins de repos, ces cottages aux vérandas fleuries, ces rivières lentes et ombreuses, ces plaines fécondes où se meut la tache errante des troupeaux, ces aubes éclatantes et pures, ces beaux soirs dorés, avec la fumée s'attardant en volutes au-dessus des maisons claires, tout ce qui caractérise la nature britannique, respire la paix. Le peuple anglais qui avait été, jadis, un peuple de soldats, avait, peu à peu, délaissé le métier des armes. Il n'en voyait plus l'emploi. Les sports et les exercices corporels n'étaient qu'un jeu, tout au plus bon à entretenir la robustesse physique et la vivacité morale. L'Anglais ne se sentait aucun goût pour verser le sang et il considérait l'apprentissage du meurtre comme tout à fait inutile. Personne n'admettait, sérieusement, que la Grande-Bretagne pût avoir, un jour, besoin d'une puissante armée. Malgré les avertissements de quelques hommes clairvoyants, on était d'accord sur ce point, dans tous les pays anglo-saxons, que le service militaire obligatoire était affaire aux continentaux, livrés aux dissensions des pays dans le devenir. Arracher des millions de bras aux travaux du commerce ou de l'industrie pour les asservir aux exercices de la caserne paraissait, à tous les Anglais sages, une grande folie. S'il y avait, contre la vieille politique d'intervention ou d'agression de la part de l'Angleterre, un parti pris bien établi dans la masse de la nation, il se personnifiait, pour ainsi dire, dans le parti radical. A la veille des élections qui devaient le porter au pouvoir, un de ses chefs les plus écoutés, sir Henry Campbell-Bannerman, gardien en titre de l'idéalisme radical, définit parfaitement le principe gouvernemental, hostile à toute politique belliqueuse, qui anime son parti. Il se montre absorbé uniquement par le souci des misères populaires et par la nécessité des réformes sociales. Au fort de la lutte électorale (4 juin 1904), parlant à Alexandra-Palace, devant 10.000 radicaux, il caractérise, ainsi, les deux systèmes : Nous sommes, aujourd'hui, à l'embranchement de deux routes. L'une, large et facile, conduit au protectionnisme, au service militaire, à l'abaissement de nos libres institutions. L'autre route conduit vers l'extension de la liberté et le développement de la justice dans notre pays, aux traités d'arbitrage et d'amitié, à leur conséquence naturelle, à un arrêt et à une réduction ultérieure des dépenses militaires, à une diminution des impôts qui pèsent sur notre commerce et pâlissent les visages des pauvres... Et encore : Nous avons lutté contre l'esprit agressif, fanfaron, envieux, qui animait notre diplomatie dans les diverses parties du monde ; contre l'esprit réactionnaire dans la législation et l'administration, contre l'esprit militaire dont on a essayé, dont on essaye encore de saturer le peuple anglais, alors que la paix est seule conforme à ses intérêts, à ses désirs, à ses nécessités... Et Lloyd George, avec son esprit incisif et son éloquence chaleureuse où les souvenirs de la Bible sanctifient les chiffres du matérialisme social, n'avait-il pas cent fois promis au monde la paix avec le bien-être ? Le jour viendra, où la nation qui tire l'épée contre une autre sera mise au banc des félons comme un frère qui frappe son frère dans un mouvement de colère. Je ne sais pas combien de générations, combien de siècles passeront avant que les glaives soient forgés en socs de charrue et les lances en serpes pour émonder ; mais, ce dont je suis sûr, c'est que, lorsque l'aurore de ce jour se lèvera, on considérera comme l'un des exploits les plus grands et les plus nobles dont fasse mention la merveilleuse histoire de la race humaine que les hommes et les femmes qui habitent cette petite île aient seuls, contre le monde, défendu avec succès le libre échange, cette voie par laquelle l'humanité a gagné le royaume dans lequel le Prince de la paix règne à toujours et pour toujours. Ce mysticisme économique apparaissait comme le dernier mot de la civilisation. On entendait le chant d'allégresse du parti radical, sur le point de pénétrer dans la Terre Promise. Il acceptait même, pour réaliser ce mythe, de porter une atteinte, peut-être décisive, à l'unité anglaise en accordant, malgré vents et marée, le home rule à l'Irlande.... quand les événements tournèrent subitement. Un vent se lève ; et ce même parti radical accepte l'inévitable et se résout à la guerre. Comment, par suite de quelles circonstances, un tel changement s'est-il produit ? Un livre paru en 1907 a exposé avec force les raisons de l'évolution qui s'est produite peu à peu en Angleterre, en présence du danger apparu du côté de l'Allemagne. Nous avons indiqué, plus haut, les conséquences de la campagne du made in Germany qui éveilla l'attention de tout ce qui pensait et réfléchissait dans le monde britannique. Mais la concurrence commerciale passa bientôt au second plan. C'est à peine si, dans la période nouvelle, on tient compte du fait que le commerce de l'Allemagne s'est accru de cent pour cent en douze ans : comme les affaires ont repris en Angleterre tout leur essor, durant cette même période, et que l'Angleterre tient toujours le sceptre, cet ordre de considération est à peine invoqué. Ce qui inquiète soudainement les esprits qui voient de loin, les vigies qui ont pris pour tâche de veiller ami salut de l'empire, c'est le parti pris, maintenant apparent et déclaré de l'Allemagne, de viser à l'empire universel. La conviction qui se répand à ce sujet tient aux déclarations réitérées de l'empereur d'Allemagne et de ses ministres prônant, un peu prématurément peut-être, la Weltpolitik ; elle tient à la connaissance accrue de la littérature pangermaniste et de cet enseignement de la Culture qui déclare sa volonté nettement déterminée de mettre l'Allemagne au-dessus de tout. Elle tient à un examen attentif des faits, — faits de préparation et faits d'organisation, faits diplomatiques et faits' expansionnistes, — qui, désormais, ne peut plus laisser aucun doute sur les desseins de l'Allemagne. L'Angleterre voit, dans cet ensemble, un trait de
l'orgueil allemand et de la vanité allemande (c'est le titre que le Dr Emile Reich donne à son
livre) ; et on explique le caractère de cet orgueil par cette sentence
biblique empruntée à une étude de Friedrich Lange, prêchant une espèce de
religion allemande (Deutsche Religion)
: Le peuple allemand est l'élu de Dieu et ses
ennemis sont les ennemis du Seigneur. Quels voiles furent levés des yeux de l'Angleterre, quand on déroula soudain devant elle tout le programme de la conjuration allemande et les preuves s'accumulant ! D'abord, le principe : l'Allemagne, à la façon dont elle conçoit sa destinée, est entraînée fatalement vers la domination universelle. Voici la vérité pure et simple : une nation qui atteint un chiffre d'habitants disproportionné à l'étendue de son territoire doit devenir impérialiste ou tomber dans le malthusianisme ; il lui faut, ou étendre son domaine d'action ou restreindre sa progéniture ; et, immédiatement, la première des conclusions : La question qui se pose est celle-ci : les Allemands peuvent-ils faire autrement que de s'étendre ? Et, ne le pouvant faire sur le continent, ne doivent-ils pas nécessairement songer à la mer ; d'où un conflit immanent avec la puissance maritime par excellence, la Grande-Bretagne. Le fait de cette nécessité explique, chez l'Allemagne, des projets d'expansion qui ne peuvent pas ne pas être dirigés contre l'Angleterre. La réalité avérée confirme le raisonnement : Une expansion transmaritime implique la suprématie sur la mer et cette suprématie implique, à son tour, une guerre victorieuse contre la Grande-Bretagne. Pour remplir leur dessein, les Allemands n'ont plus, devant eux, que l'Angleterre et ils comptent bien l'abattre. C'est une erreur fondamentale de croire qu'il n'y aura pas de conflit anglo-allemand. Personne ne peut l'arrêter, l'entraver, le pallier. L'antagonisme entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne est un de ces courants qui décident de la marche de l'histoire. Les incidents diplomatiques, les messages, discours, articles de journaux, conventions, meetings, banquets, dépêches et rapports, télégraphiques ou non, n'y peuvent rien : ils peuvent modifier l'aspect du courant, mais l'arrêter, non. L'Allemagne sait que ce conflit est inévitable et elle le prépare ; et, précisément, rien que la façon dont elle le prépare, le provoque. Le tableau du progrès de la flotte allemande ne peut avoir d'autre sens que celui de la prévision d'un conflit voulu avec la Grande-Bretagne. La flotte allemande croissante ne peut avoir qu'une seule mission, celle de se mesurer avec la flotte anglaise. En effet, ni la Russie, ni le Danemark, ni la Norvège, ni la Suède ne menacent les flottes allemandes. En 1906, la marine de guerre allemande s'est accrue de seize unités. La marine allemande possède donc actuellement (1907) vingt-quatre grands cuirassés. La capacité de construction des chantiers de construction allemands leur permet d'accroître ces chiffres avec une progression plus grande que ceux mêmes de l'Angleterre. Dès 1907, ces chantiers reçoivent la commande de construction de deux navires, du type dreadnought, atteignant près de 20.000 tonnes et dépassant de 2.000 tonnes le type de l'Invincible anglais. Pour l'Angleterre, un tel fait est à lui seul révélateur. Des centres de torpilleurs sont créés, notamment à Emden : ils visent uniquement l'Angleterre. De là l'Allemagne pourrait, en huit heures, jeter ses croiseurs sur la côte anglaise. Faut-il d'autres arguments ? La ligue navale allemande compte 906.000 membres et la ligue navale anglaise seulement 24.000. L'Allemagne, au point de vue naval, s'est entraînée à la voix de ses chefs ; elle brûle de la Grande Passion dont les Anglais brûlaient aux temps d'Élisabeth. Si l'on envisage, partout sur le globe, les jalons posés par l'Allemagne, on s'aperçoit sans peine qu'ils sont plantés pour une conquête expansionniste visant l'Angleterre. Quel est le sens de la mainmise sur la Turquie, à Constantinople, sinon une préparation silencieuse de la lutte contre la Grande-Bretagne, sur le canal de Suez, en Égypte, vers le golfe Persique ? Tout se comprend avec cette explication ; autrement, tout paraît désordre, incohérence, effort vain et il faut bien reconnaître aux Allemands cette qualité, qu'ils ne gaspillent pas leurs forces et qu'ils savent ce qu'ils font. Vainement l'Angleterre se confierait-elle en sa supériorité navale. Rien n'est plus vulnérable et moins assuré que l'empire britannique, précisément parce qu'il dépend de la maîtrise de la mer : Habitant une île, nous prenons du dehors plus de la moitié de notre nourriture quotidienne ; et cette île n'a pas une armée qui vaille. Parce qu'elle a une marine puissante, l'Angleterre pense qu'elle ne pourra jamais être battue... Quand il s'agit de la marine, de la chose au monde la plus aléatoire, la plus hasardeuse — une bataille navale — et que l'on demande aux Anglais de se prononcer sur l'issue d'une telle campagne, d'un de ces conflits européens où l'on emploie des engins de destruction infiniment plus redoutables que dans une bataille continentale, quand on les invite à se prononcer sur ce qui arrivera dans une guerre où une torpille peut, en un clin d'œil, faire sauter un bâtiment énorme, et réduire à néant les équipages qui le montent, où d'invisibles sous-marins ou des torpilleurs peuvent détruire toutes les escadres, quand on interroge un Anglais sur cette question, il répond invariablement : Il est impossible que les Anglais soient battus sur mer. Or, nous sommes à la merci d'une bataille navale, comme cela nous est arrivé tant de fois, au cours de notre histoire ; si la flotte anglaise était détruite ou diminuée comme elle l'a été à diverses reprises dans les guerres contre les Hollandais, devenus maîtres de la mer du Nord, nous serions à la merci d'une invasion allemande. Et nous répétons tout simplement : Les Anglais ne peuvent pas être battus sur la mer ! Et l'auteur prévoyant, avec une acuité de sens extraordinaire, que l'infériorité même de l'Allemagne contre une coalition la forcerait à devenir agressive, pour choisir son heure, concluait : Voici donc les principaux facteurs du problème : Il est un pays, l'Allemagne, qui, dernier arrivé, aspire à l'impérialisme et ne peut étendre son territoire sur le continent européen. Les Anglais, en cas de désastre sur mer, perdraient en quelque sorte tout. Pour la sécurité et le prestige de l'Angleterre, pour la dignité de son passé, tous les hommes qui ont une mission quelconque : prédicateurs, professeurs, hommes d'£tat, journalistes, devraient s'unir dans la tâche qui s'impose, de démontrer aux Anglais l'urgence de préparatifs qui, faits en temps opportun, retarderaient ou anéantiraient les ambitions des Allemands... Puisque les Allemands l'emportent par une marine puissante et une armée formidable, l'Angleterre devrait chercher à les surpasser par une marine plus forte encore et une armée encore plus formidable. Si l'Allemagne songe à attaquer l'Angleterre vers 1912, l'Angleterre devrait l'attaquer bien avant... Combien ces avertissements auraient paru plus émouvants, et, je dirai même, plus terrifiants, si l'auteur avait connu et répété le mot de l'empereur Guillaume au général Obroutcheff : Il est des guerres nécessaires, et c'est à Londres que j'irai signer la paix du monde. Oui, l'Angleterre était visée ; elle le savait. Ceux de ses hommes publics qui connaissaient l'Europe ou qui suivaient les événements ne pouvaient se faire aucun illusion à ce sujet ; la plus évidente de toutes les démonstrations se faisait au grand jour, rien que par l'accroissement fébrile de la flotte allemande. Mais, quand même, la crainte de troubler cette quiétude séculaire, ce repos somnolent et délicieux où l'Angleterre se complaisait depuis des années, était telle que le peuple anglais ne voulait pas savoir, ne voulait pas être convaincu. La pacifique Angleterre restait pacifique, les yeux et les poings fermés ; c'est à peine si elle écoutait d'une oreille distraite les porteurs de mauvais présage, les Cassandre qui s'ingéniaient à troubler son repos. Ce ne sont pas seulement les tendances pacifistes qui s'accusent dans tous les actes du cabinet radical arrivé aux affaires en 1905, c'est la volonté déclarée du cabinet radical lui-même. Plusieurs membres de ce ministère sont notoirement favorables à un accord avec l'Allemagne et cet accord est recherché, par eux, avec une ardeur extrême. Nous verrons, tout à l'heure, que, même quand il s'agit de la politique navale, vitale pour l'Angleterre, le cabinet radical se laisse entraîner un instant, par fidélité à son programme politique, jusqu'à courir le risque de laisser l'Angleterre désarmée. De grands journaux, comme le Daily News, organe déclaré du parti aux affaires, ne cache pas sa perpétuelle méfiance à l'égard de la Triple-Entente, et notamment à l'égard du rapprochement anglo- russe. Sir Edw. Grey est mis, à diverses reprises, sur la sellette à ce sujet ; et, si la marche progressive des affaires européennes amène le cabinet anglais à combiner les actes de sa politique avec celle des cabinets de Saint-Pétersbourg et de Paris, c'est toujours avec une sorte de réserve et de réticence ; il se surveille et il est surveillé ! En même temps que l'union diplomatique entre les trois puissances se confirme, il existe toujours une négociation parallèle entre l'Angleterre et l'Allemagne. En un mot, l'Angleterre ne veut pas rompre avec l'Allemagne et le cabinet radical ne le peut pas. Cette procédure hésitante est indiquée encore en décembre 1911, dans un discours où sir Edw. Grey explique le rôle de l'Angleterre dans la conclusion de l'affaire marocaine. Le ministre rappelle d'abord que l'Angleterre est libre : Nous avons publié les articles de l'accord secret de 1904 avec la France ; il n'existe pas d'autre accord secret ; et M. Asquith le répète, avec plus de précision encore, le 6 décembre. Mais cela ne suffit pas ; on tient à rendre manifestes et publiques les bonnes intentions de l'Angleterre à l'égard de l'Allemagne et est déclaré que la première de ces puissances, non seulement ne s'opposera pas à l'expansion mondiale de l'Allemagne, — c'est-à-dire, en somme, à la Weltpolitik, — mais qu'elle fera, au contraire, le possible pour la faciliter, en tant qu'elle ne nuit pas directement aux intérêts britanniques. Dans la négociation relative à la cession d'une partie du Congo français à l'Allemagne, cette ligne de conduite a été suivie : Quel a été le grand objectif de l'Allemagne dans la deuxième période de ses négociations avec la France ? Obtenir l'accès du Congo et de l'Oubanghi. Jamais nous n'avons élevé la moindre objection contre cette ambition, nous l'avons, au contraire, facilitée autant qu'il a été en notre pouvoir. D'ailleurs, voici le principe directeur : Si d'autres changements territoriaux se produisent en Afrique, s'ils peuvent s'opérer à l'amiable par d'autres négociations, nous ne serons plus de la partie ; si donc l'Allemagne, en concluant des arrangements amicaux avec d'autres pays, peut s'étendre en Afrique (il s'agit évidemment des colonies portugaises), nous ne nous mettrons pas en travers de son chemin. Jouer le rôle du chien qui, pour empêcher le cheval de manger, se met dans la mangeoire, ne nous dit rien. En rapprochant, par la pensée, de pareilles déclarations, toutes spontanées, des progrès accomplis au même moment et notamment dans ces années 1911-1912 par la flotte allemande, regagnant à grands pas la flotte britannique, on ne peut qu'être surpris de cette quiétude permanente chez les chefs de la politique anglaise. Aussi, les ministres de l'empereur d'Allemagne prennent acte et gagnent à la main. De quel ton hautain, M. de Bethmann-Hollweg répond aux avances de sir Edw. Grey, dans le discours qu'il prononce au Reichstag pour prendre acte des déclarations du ministre anglais et faire lui-même ses conditions : Je me félicite de constater que le premier ministre anglais, d'accord avec sir Edw. Grey, a déclaré que les progrès de notre nation ne lui inspiraient ni jalousie, ni mécontentement. Nous aussi, Messieurs (avec énergie), nous désirons sincèrement vivre en paix et amitié avec l'Angleterre. (Profond silence dans la salle en ce moment.) Cependant, les relations entre les deux pays ne pourront être en accord avec ce désir que dans la mesure où le gouvernement anglais sera prêt à exposer, d'une manière positive, dans sa politique, ce besoin de meilleures relations. (Applaudissements) Les autres nations, quelles qu'elles soient, doivent tenir compte des progrès de l'Allemagne. On ne peut arrêter ces progrès ! De quel côté est la morgue, où sont les ambitions sans frein, où le manque de mesure et de tact international ? L'Angleterre se froisse-t-elle ? Nullement. Sir Edw. Grey dans un discours où la maîtrise de soi se transforme jusqu'à devenir une sorte de philosophie de l'histoire, établit les bases de l'accord permanent, possible entre les deux grands pays. Dans ce pays (il s'agit de l'Angleterre) vit un grand peuple industriel, jouissant d'un grand développement industriel, en espérant un plus grand encore ; en Allemagne, vit aussi un grand peuple industriel, jouissant d'un grand développement industriel, en espérant tin plus grand encore. Dans l'intérêt de ces deux peuples, il faut que la paix subsiste. La main est tendue du côté de Londres. Les voyages réitérés, en Allemagne, de lord Haldane que l'on sait favorable à l'entente entre les deux pays, donnent corps à ce perpétuel bon vouloir de la politique britannique. Aussi, en considérant l'ensemble des situations respectives, il semble que l'on peut conduire à un accord plus ou moins tacite entre les deux puissances ; il paraît de toute évidence, que l'Allemagne, maîtresse des événements, et dont les forces se développent sans cesse en population, en richesse, en expansion, en pénétration, n'a qu'à laisser faire le temps. Dans la situation générale des affaires, elle a tout à gagner dans la paix et tout à perdre dans la guerre. Si celle-ci éclatait, en effet, trois grandes puissances, au moins, ont un intérêt identique à ne pas laisser l'Allemagne conquérir de haute lutte l'hégémonie. Alors, — traités ou non, — elles se trouveraient unies et l'Allemagne courrait le plus grand risque auquel sa puissance puisse être exposée. (La Politique de l'Equilibre.) Ces réflexions seraient certainement déterminantes aux yeux du gouvernement allemand, si son parti n'était pas pris de longue date et s'il n'avait la volonté déclarée, comme l'a dit Maximilien Harden, d'entreprendre la guerre universelle comme une grande industrie. On sait maintenant que l'Allemagne avait conçu le dessein secret de surpasser et de dominer la puissance navale de l'Angleterre, de couler un à un les bateaux anglais, pour obliger l'Angleterre de s'entendre avec l'Allemagne. (Interview à M. Andrews Juley, Eclair du 28 février 1915.) On sait, en un mot, que la volonté du conflit existait du côté de l'Allemagne et on ne peut attribuer la longanimité bien évidente de l'Angleterre qu'à la volonté inverse de faire tout le possible pour éviter une guerre dont sa claire vision de l'avenir prévoyait les terribles conséquences. LA CONCURRENCE NAVALE.Mais il était un point sur lequel, malgré le bon vouloir persistant de l'Angleterre, le désaccord fondamental ne pouvait pas ne pas s'affirmer. C'était la progression croissante et de plus en plus redoutable des armements navals allemands, mettant en péril la sécurité de l'archipel britannique. Plus l'Angleterre fait de concession, plus l'Allemagne se hâte. Elle profite du temps pour se mettre en mesure de devenir la maîtresse des mers : c'est ainsi que se révèle le dessein secret. Les phrases diplomatiques ne servent qu'à couvrir le travail haletant des ateliers, des chantiers et des docks : à chaque déclaration sentimentale, répond le lancement d'un nouveau cuirassé. En 1907, avait commencé, en quelque sorte, la course aux dreadnoughts ; l'Angleterre la mène, d'abord, comme à regret et avec une hésitation évidente ; mais, sans cesse talonnée par sa rivale, elle est obligée de faire de nouveaux bonds en avant, chaque fois qu'elle a essayé de reprendre haleine et, visiblement, elle ne garde pas ses distances. L'Angleterre est bien obligée de s'habituer, en même temps, à l'idée que son armée de terre est absolument insuffisante et incapable de répondre au rôle qu'elle peut être appelée à jouer dans les affaires internationales ; mais, avec quelle lenteur et quelle mollesse elle se laisse pousser dans la voie où quelques énergiques champions précèdent de loin l'opinion ! L'Angleterre compte, parmi les membres du cabinet, une forte proportion d'hommes dévoués aux idées de paix malgré tout, qui n'ont aucune disposition à pousser les choses au tragique, et deux, notamment, qui se sont prononcés en toute circonstance : c'est lord Haldane, que l'empereur Guillaume appelle familièrement mon cher Haldane, et M. Winston Churchill, dont les déclarations pacifistes sont notoires, avant que la nécessité des événements en fît le plus énergique protagoniste des constructions nécessaires. La réforme militaire de 1907, qui écarte les projets militaires de M. Brodrick, consacre, en somme, encore un système petite Angleterre. Mais, dès 1908, lord Roberts prend en mains la thèse de l'Angleterre toujours prête. Il prononce, le 23 novembre 1908, à la chambre des Lords, un discours qui est vraiment initiateur : N'est-il pas évident que, chaque jour, le danger devient plus pressant ? En une décade, l'Allemagne est devenue la plus grande des nations maritimes qui, l'Angleterre exceptée, ait jamais existé. En ce moment même, pour accroître cette puissance navale, elle prend les mesures les plus formidables. Les ports de l'Allemagne septentrionale, le monde n'en possède pas de mieux outillés, — sont améliorés chaque jour. Le réseau des chemins de fer devient plus serré, la marine marchande s'accroît. L'on peut dire que, de jour en jour, se raccourcit le temps qui serait nécessaire à la préparation de l'invasion. De jour en jour, à vue d'œil, les premiers mouvements que comporte l'invasion gagnent en brièveté et, parallèlement, s'accroissent les chances de succès. Jamais le parlement n'a compté
une majorité aussi dévouée aux armements navals. 80.000 Allemands habitent le
Royaume-Uni. Si une armée allemande paraissait chez nous, elle trouverait son
service d'espionnage complètement organisé. Pour que le coup de main
réussisse, il n'est pas nécessaire que l'Allemagne possède la maîtrise des
mers ; qu'elle possède cette maîtrise un instant et sur un point, il n'en
faut pas plus. Le général Bronsart von Schellendorf le déclare dans son livre
: Devoirs de l'État-major, quand il écrit : Afin de gagner, un
instant, le commandement de la mer et de faire marcher nos transports, nous
serions justifiés à sacrifier notre flotte entière. Ces paroles sont un
avertissement. Que le pays le prenne à cœur ! En ce moment, c'est tout au plus si, — notre armée régulière combattant à l'étranger, — 353.000 hommes (93.000 hommes de première ligne, 6o.000 anciens soldats de réserve spéciale, 200.000 territoriaux) seraient disponibles pour garder nos îles. Déduisons les malades, les non-incorporés, les renforts appelés à l'extérieur : 240.000 hommes, 200.000 hommes sont nécessaires à la garde de nos arsenaux, de nos bases navales, de nos places principales. 40.000 soldats-citoyens seraient donc, seuls, susceptibles de repousser l'envahisseur. Et lord Roberts conclut : J'estime
que 600.000 soldats-citoyens seraient nécessaires pour lutter à armes égales
contre 15o.000 continentaux bien entraînés. Notre situation est effrayante (appalling).
Hâtons-nous de remplir les cadres territoriaux combinés par M. Haldane. Si
nous ne nous hâtons pas, notre marine sera prisonnière dans nos eaux
territoriales, les craintes publiques retiendront sur notre sol notre corps
expéditionnaire, notre diplomatie sera privée de cette force armée qui,
seule, peut lui permettre de parler haut. En face de nous se développe le spectacle le plus étrange que le monde ait jamais contemplé : un peuple de 60 millions d'âmes, notre rival le plus puissant sur les marchés commerciaux, le premier peuple guerrier du monde, doublant sa force militaire écrasante d'une force navale rapidement accrue. Nous n'avons pas à nous offenser de ces efforts, mais nous avons à prendre les mesures qu'exige notre sécurité. Gardiens du droit de l'empire, nous devons maintenir la politique impériale au-dessus de la clameur des intérêts égoïstes et étroits. Il ne suffit pas à notre marine d'être la plus forte : il lui faut une liberté stratégique complète. Il ne faut donc pas que le manque d'armée l'enchaîne à nos rivages. Lord Rossbery, lord Landsdowne, celui-ci au nom du parti conservateur, adhérèrent pleinement aux pronostics impressionnants et aux conclusions formelles de lord Roberts. Mais le parti radical, et même le gouvernement, gardaient encore, de leurs vieilles tendances pacifistes, je ne sais quelles incertitudes, quelles irrésolutions. La question délicate était toujours celle de la limitation conventionnelle des armements navals. A la deuxième conférence de la Paix, en 1907, la Grande-Bretagne avait fait des propositions dans ce sens. On avait pu croire qu'à la suite du voyage du roi Édouard VII à Berlin et de son discours réellement sympathique à l'Allemagne, le 16 février, quelque chose serait changé ; mais il n'en fut rien. La question était insoluble. M. de Bülow disait, devant le Reichstag, le 29 mars 1909 : Depuis 1907, il n'a été trouvé aucune formule qui tînt compte des divergences considérables existant entre les intérêts des divers peuples et offrît une base de négociations favorables. De telles négociations ne permettent d'espérer aucun résultat pratique. Le point de vue des gouvernements confédérés est dicté par des mobiles pacifiques et humanitaires. Il n'y a rien là dont une puissance doive être surprise, ou qu'elle puisse considérer comme peu amical, d'autant plus qu'en cela, nous nous bornons à user du droit tout naturel de ne pas admettre de discussions avec des étrangers, au sujet de questions d'ordre intérieur. Si l'Angleterre ne comprenait pas, c'est qu'elle ne voulait pas comprendre. Le Standard, au nom du parti conservateur, avait défini ainsi les situations (fév. 1909) : Les escadres allemandes sont construites pour combattre dans la mer du Nord : nous devons nous préparer à les rencontrer. Les affaires sont les affaires... Les considérations d'argent sont, pour nous, absolument négligeables. L'Angleterre continuait à penser qu'en se prémunissant du côté de la mer, elle parait suffisamment au péril qui la menaçait. On peut dire que les yeux ne commencent à se dessiller pleinement, à ce point de vue, qu'en 1909. A partir de ce moment, le budget naval augmente, en raison de l'inquiétude qui commence à se répandre et qui a gagné même les chefs du parti radical. Répondant au programme naval allemand de 1909, le gouvernement demande au parlement une augmentation du budget de la marine de 35 millions de livres, en augmentation de 3 millions de livres sur celui de 1908-1909, et permettant de mettre en chantier deux dreadnoughts en juillet 1909 (pour être prêts en juillet 1911), deux autres en novembre (prêts en avril 1912) et, en outre, six croiseurs cuirassés, vingt contre-torpilleurs et des sous-marins. Sir Edw. Grey prenait l'initiative d'expliquer le péril
devant la chambre des Communes : Le programme
allemand crée à ce pays une situation nouvelle par cela seul qu'il existe,
indépendamment du fait que son exécution sera rapide ou lente. Ce programme
accompli, l'Allemagne, grand pays, voisin de nos côtes, possédera 33
dreadnoughts ; cette flotte sera la plus puissante que le monde ait jamais
vue, d'où la nécessité qui commence à s'imposer pour nous, de reconstruire
entièrement notre flotte, les dreadnoughts déjà existants, exceptés. Le gouvernement allemand nous a déclaré verbalement qu'il n'accélérerait pas son programme de constructions navales et ne posséderait pas en service actif, avant la fin de 1912, 13 dreadnoughts, croiseurs comptés... ... Les déclarations allemandes ne prouvent pas que, sans que des navires aient été commandés, des tourelles ne soient pas déjà préparées ; de plus, lorsque l'Allemagne possédera ses 13 dreadnoughts, elle en aura dix autres en construction, et ces dix unités peuvent entrer en ligne vers 1913 et 1914. Telle est la situation. Nous possédons 5 dreadnoughts en service, 7 autres en construction : 4 seront entrepris cette année. Total : 16. Si nos navires conditionnels sont construits et si, en 1910-11, nous déployons toute notre puissance de construction, en avril 1913, nous posséderons 26 unités. Jusque-là nos navires du type antérieur au dreadnought gageront notre sécurité. Répondant aux membres du parti conservateur qui faisaient au parti radical le grave reproche de s'être laissé arrêter dans le programme des constructions navales, M. Asquith ajoutait : Il n'y a aucun sujet d'inquiétude à avoir ; la marine anglaise aura, en 1912, une prépondérance énorme. La supériorité de l'Angleterre sur l'Allemagne sera maintenue. L'opposition était moins optimiste. Lord Charles Beresford disait, le 13 novembre : Depuis que nous avons conquis la maîtrise de la mer à Trafalgar, nous avons pris l'habitude de considérer notre suprématie comme une loi naturelle... La vérité pure, c'est que nous nous trouvons en présence de la rivalité, non pas d'une seule puissance, mais de toute grande puissance navale et que l'une d'elles a ouvertement défié notre suprématie... Actuellement, nous sommes en retard de quatre cuirassés... Nous sommes dangereusement à cours de croiseurs légers pour l'exploration... Nous n'avons pas une flottille de torpilleurs convenables en service dans la mer du Nord. Nous sommes très mal pourvus en équipements de tout genre. Nous n'avons pas non plus de docks pour les grosses unités... Nous n'avons pas de réserve de charbon... Mais, quelque graves que soient ces insuffisances, il y en a une bien plus grave encore : nous n'avons pas assez d'hommes ; je crois qu'il nous en manque 19.000. La préparation de l'armée de terre, à la suite des mesures prises par lord Haldane, n'avait pas donné pleine satisfaction, du moins à ceux qui avaient pris le parti, selon le mot de l'amiral Penrose Fitzgerald, de relever le gant jeté par l'Allemagne. Lord Roberts, lors Esher continuaient à affirmer que les réformes étaient tout à fait insuffisantes ; l'opinion se répandait qu'il fallait en venir franchement au service obligatoire. L'armée territoriale, aux premières manœuvres, avait fait un véritable fiasco. En 1911, survint la crise d'Agadir. C'est un fait d'agression mondiale qui ne peut laisser l'Angleterre indifférente. Cette fois, son attitude se précise ; les plus modérés ne peuvent rester impassibles ; comme pour témoigner de l'émotion qui atteint des couches plus profondes et les plus réfractaires jusque-là c'est à M. Lloyd George que le cabinet confie le soin de faire, à Mansion House, la déclaration qu'on peut considérer comme le premier avertissement à l'Allemagne : Si une situation nous était faite, dans laquelle la paix ne pourrait être maintenue que moyennant l'abandon de la grande et avantageuse position que l'Angleterre a acquise par des siècles de victoires et d'héroïsme, et si, au moment où ses intérêts vitaux sont en jeu, notre pays devait être traité, dans le concert des nations, comme une quantité négligeable, alors, je le déclare énergiquement, la paix à ce prix serait pour une grande nation comme la nôtre, une humiliation intolérable. Mais, de telles déclarations supposaient la force nécessaire pour les soutenir, et l'on vivait toujours sur l'axiome : L'Angleterre est imbattable sur mer. Pour cette fois, l'Allemagne, après avoir protesté, céda ; sans doute, elle ne se sentait pas encore prête. Tandis que la tranquille masse des pacifistes continue à se bercer d'illusions, tandis que sir Edw. Grey cherche, avec un calme parfait, les moyens de retarder la crise et poursuit, sans joie et sans confiance, les pourparlers avec l'Allemagne, l'opinion finit par s'émouvoir. La question de savoir si les forces militaires et navales sont suffisantes fait l'objet de plusieurs grands débats à la Chambre ; on sent que le temps presse ; on se hâte soudain. Lord Haldane, trop satisfait de sa réforme militaire notoirement insuffisante, est remplacé par le colonel Seely, qui passe pour favorable à la politique des armements. Le 18 mars 1912, le ministre de la Marine, M. W.
Churchill, en déposant un budget qui est pourtant encore un budget d'attente
et de réserve (1.092.350 livres de moins pour
les constructions navales que l'année précédente) met les choses au
point dans un esprit de mesure qui pourrait lui être reproché comme une
faiblesse : Le principe qu'a suivi l'amirauté, au
cours de ces dernières années, a été d'obtenir une supériorité sur l'Allemagne
de 60 % en dreadnoughts... Si l'Allemagne
devait s'en tenir à sa loi navale existante, nous croyons que l'étalon qui
vient d'être déterminé (16 contre 10), continuerait à être un guide commode pour les quatre ou
cinq prochaines années. Toute addition que l'Allemagne fait ou fera aux
nouveaux navires qu'elle met en chantier chaque année altérera le déclin militaire
de nos pre-dreadnouglits et accroîtra la construction de nouveaux cuirassés.
En appliquant notre étalon de 60 % en ce qui concerne la présente loi navale
allemande, il nous sera nécessaire de construire alternativement, durant les
six prochaines années, quatre navires et trois navires. Nous dépasserons
ainsi notre étalon... la proportion sera de
17 contre 10... Je veux dire clairement, cependant,
que tout retard dans les constructions navales allemandes, toute réduction
des constructions allemandes dans certaines limites, seront promptement
imitées ici par une réduction proportionnelle. Vit-on, en Allemagne, dans ces déclarations, une tendance au recul ? C'était le moment où l'Angleterre cherchait une base d'accord avec l'Allemagne dans les questions africaines, le moment où l'on pouvait espérer quelque résultat du voyage de lord Haldane à Berlin. Mais, bientôt, toute illusion fut dissipée. L'Allemagne continuait sa marche implacable ; elle poursuivait hâtivement ses armements navals et maintenait à effectifs complets, pendant toute l'année, la plus grande partie de sa flotte. En juillet, le ministre de la Marine déposa une demande de crédits supplémentaires pour mettre immédiatement en chantier cinq cuirassés au lieu de trois et pour augmenter le personnel de la flotte. Selon sa propre déclaration : le gouvernement était résolu à maintenir la suprématie de l'Angleterre sur la mer. En même temps, l'amirauté anglaise, répondant à une autre préoccupation de l'opinion, concentrait de plus en plus les forces navales anglaises dans la mer du Nord. Une entente intervenue avec la France confiait à la flotte française la défense des intérêts connexes dans la Méditerranée. Au cours des débats, 28 novembre, sur l'entente avec la France, lord Landsdowne, ancien ministre des Affaires étrangères du cabinet conservateur, et signataire du traité de 1904 avec la France, avait fait connaître la nature des engagements militaires franco-anglais. Ils ne constituent pas une alliance ; ils seront arrêtés dans chaque cas déterminé suivant les besoins du moment. Rien ne pouvait être moins agressif. La Grande-Bretagne restait libre. L'Allemagne conserve-t-elle l'espoir ou même le désir de maintenir l'Angleterre en dehors du conflit européen qu'elle prépare depuis si longtemps et qui, si l'on s'en rapporte à la conversation de l'empereur Guillaume avec le roi des Belges, est déjà décidé dans ses conseils ? C'est le moment où elle envoie, comme ambassadeur à Londres, une de ses capacités diplomatiques de tout premier plan, le baron Marshall. L'été de 1912 s'achève, pour l'Angleterre, sur une espérance de paix. Sir Edw. Grey déclare les relations entre les deux pays excellentes. L'hiver de 1912-1913 fut une saison d'inquiétude et de trouble pour la diplomatie européenne. La guerre avait éclaté dans les Balkans en octobre 1912. Personne ne pouvait savoir quels seraient les lendemains. Toutes les grandes questions internationales étaient mises à la fois sur le tapis. L'Angleterre constate toujours son insuffisance militaire ; la constitution d'une réserve nationale ne compense pas les défaillances du recrutement. Le budget de la Marine est, il est vrai, en augmentation de 16 millions de livres, rien que pour les constructions navales ; mais M. W. Churchill se propose de suspendre la mise en chantier de trois des cinq cuirassés proposés, si le gouvernement canadien donne suite à ses projets d'armements. Et, le 26 mars, M. Churchill propose un arrêt simultané des constructions, durant un an, dans tous les chantiers des grandes puissances... Pouvait-on vraiment pousser plus loin l'esprit de conciliation ? La proposition est repoussée, avec dédain, par la presse allemande Chose vraiment incroyable, l'illusion pacifiste n'est pas encore dissipée Le 24 mars, sir W. Byles et M. King demandent au
gouvernement si ce pays est dans l'obligation et, au
cas de l'affirmative, dans quelle mesure, est-il obligé, vis-à-vis de la
France, d'envoyer, dans certaines circonstances, une force armée opérer sur
le continent. M. Asquith, s'en tenant toujours au même système, répond : Comme on l'a déjà maintes fois déclaré, ce pays n'est tenu par aucun engagement secret et ignoré du Parlement qui l'oblige à prendre part à une guerre quelconque. En d'autres termes, au cas d'une guerre entre les Puissances européennes, aucun arrangement secret ne restreint ni ne gêne le droit du Gouvernement et du Parlement de décider si la Grande-Bretagne doit y participer. Il ajoutait, cependant, en indiquant une nuance qui, sans doute, se référait à l'arrangement entre les États-Majors, conclu en novembre 1912 : L'usage qui pourrait être fait des forces militaires ou navales, si le Gouvernement et le Parlement décidaient de prendre part à une guerre, n'est pas, pour des raisons évidentes, une question qui puisse faire l'objet, par avance, de déclarations publiques. Au fort de cette crise balkanique qui devait être considérée, dès lors, comme le prodrome d'un conflit plus grave, l'Angleterre, toujours attentive à chercher les éléments d'un rapprochement avec l'Allemagne, s'abstenait, avec le plus grand soin, de donner à l'entente le caractère d'une alliance. L'ANGLETERRE ET L'ALLEMAGNE.Les oscillations de ce système de bascule étaient singulièrement inquiétantes aux yeux de ceux qui avaient des raisons de suivre avec intérêt le développement de la politique britannique. On observait ces démarches incertaines et on ne savait quel but elles se proposaient. Parmi les révélations qui se sont produites au début de la guerre, il en est une qui éclaire d'un jour nouveau ce passé si proche et pourtant si mystérieux. M. Asquith, dans un discours prononcé à Cardiff, le 2 octobre 1914, s'est expliqué avec précision sur les propositions adressées par l'Angleterre à l'Allemagne, en 1912, pour établir une entente de politique générale entre les deux puissances. Nous avons adressé au Gouvernement allemand, déclare le chef du cabinet britannique, la communication suivante, dont les termes ont été soigneusement pesés par le Cabinet et qui indiquait quelles devaient être, à notre avis, les relations avec l'Allemagne : La Grande-Bretagne déclare qu'elle n'attaquera jamais sans provocation l'Allemagne, ni ne se joindra à une attaque de ce genre. Une agression contre l'Allemagne ne forme ni le sujet, ni une clause d'aucun traité, entente ou arrangement dont la Grande-Bretagne est partie contractante et elle ne prendra part à aucun acte diplomatique ayant un pareil objet. Voilà bien la preuve qu'aucun sentiment d'agression n'existait chez le Gouvernement britannique. On pourrait même dire, à la lumière des événements postérieurs, qu'il poussait la confiance aux extrêmes limites en se liant ainsi les mains. Eh bien ! L'Allemagne ne se déclare pas satisfaite. Cette déclaration ne parut pas suffisante aux hommes d'État allemands. Ils nous demandèrent de promettre de rester neutres, dans le cas où l'Allemagne serait engagée dans une guerre... Cela veut dire que l'Allemagne se réservait toute liberté pour l'agression en la refusant aux autres ; et c'est ainsi, en effet, que s'achèvent les déclarations de M. Asquith : Ils nous demandèrent de déclarer très clairement, qu'en ce qui nous concernait, nous leur laisserions les mains libres pour dominer le continent européen. A pareille demande, une seule réponse était possible ; et c'est celle que nous avons faite. La conclusion de cet incident historique, récemment révélé, est que la diplomatie allemande a eu en mains l'abstention de l'Angleterre, en cas de non-agression de sa part, et qu'elle l'a laissée échapper. Au cours de l'hiver 1913-14, l'Angleterre est absorbée par les longs et impuissants débats de la conférence de Londres. Les ministres anglais s'en tiennent, sur la situation générale, à des propos vaguement optimistes : mais quelle. n'est pas la surprise universelle, quand le chancelier de l'échiquier, Lloyd George, oubliant, sans doute, ses inquiétudes récentes, livre au Daily Chronicle, en janvier 1914, des déclarations où ses vieux sentiments pacifistes et germanophiles se réveillent avec une ardeur nouvelle. Un voyage récent à Berlin l'a sans doute converti. Il a constaté que jamais les rapports entre l'Angleterre et l'Allemagne n'ont été meilleurs. Par conséquent, l'Angleterre peut parfaitement procéder à un ralentissement dans ses armements navals. Au surplus, ajoute-t-il, les nations de l'Europe concentrent actuellement leurs ressources sur le renforcement de leurs armées de terre, ce qui permet à l'Angleterre de se retirer de la concurrence. Lloyd George ajoute que, dans l'état présent des choses, l'accroissement des forces militaires est une folie organisée. Si le libéralisme négligeait de saisir l'occasion actuelle, il trahirait grossièrement la confiance du peuple ! Lloyd George manquait peut-être de clairvoyance dans ses prévisions ; mais on ne peut contester la volonté énergiquement pacifique du cabinet dont il faisait partie, puisque sa longanimité ne se laissait décourager par rien et qu'il abordait dans de pareilles dispositions cette année 1914, exposée à de telles catastrophes ! Il est permis de penser que ce sont justement les hésitations et les défaillances du cabinet de Londres, d'une partie de la presse et de l'opinion anglaises qui ont trompé la diplomatie allemande et qui l'ont enhardie à engager la lutte, dans la conviction où elle était que l'Angleterre n'interviendrait pas. Preuve de plus, qu'en politique, la netteté des résolutions est encore la meilleure façon d'éviter ou de résoudre les grandes difficultés. L'Allemagne, aveuglée par l'ardeur de ses ambitions, par les doctrines absolues de ses publicistes et de ses militaires, incapable de s'arracher à son propre point de vue et de juger les choses comme on les juge du dehors, a commis, en ce qui concerne l'Angleterre, une double erreur. Elle a mal connu les dispositions de la politique britannique, elle a plus mal connu encore les véritables forces de ce pays. Elle a cru que l'Angleterre ne voudrait pas intervenir ; elle a cru que l'Angleterre ne pourrait pas intervenir. Que l'Angleterre ne voudrait pas intervenir, cela lui paraissait résulter des tergiversations du cabinet radical, de la désunion existant dans le sein même du cabinet, des graves dissensions où le pays tout entier était engagé, par suite des démêlés constitutionnels et du vote du home rule. Tous ceux qui ont vécu la vie anglaise, à la veille des événements, savent dans quel état de frémissement anxieux l'application des lois nouvelles relatives à l'Irlande avait mis le pays tout entier : ils savent que les réformes constitutionnelles et sociales étaient l'unique préoccupation de tous et que les partis étaient si acharnés qu'ils paraissaient sur le point d'en venir aux mains en Irlande et à cause de l'Irlande : fa discipline militaire, l'imité nationale elle-même paraissaient atteintes ou menacées. L'histoire saura, sans doute, de quel poids ces faits notoires ont pesé sur les résolutions du gouvernement allemand. Il a pu croire que de tels déchirements intérieurs le mettaient en présence d'un adversaire désarmé. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer le détail de cet émouvant débat ; j'évoquerai seulement quelques-uns (le ces souvenirs d'hier qui paraissent déjà si lointains : la résistance de l'Ulster, organisée de telle sorte qu'elle met en échec l'appareil législatif du Royaume-Uni, les vaines tentatives de conciliation entre le gouvernement et le parti conservateur, la parole angoissée de M. Balfour : Je suis convaincu que si le gouvernement persiste dans la politique qu'il poursuit actuellement, nous serons à deux doigts, — je crois que nous sommes à deux doigts — d'une grande tragédie nationale... Je crois que l'Ulster est décidé à maintenir — À TOUT PRIX — ce qu'il considère comme ses droits inaliénables ; enfin, le pays de Galles et l'Écosse se mettant aussi à réclamer un home rule et des parlements séparés, les choses étaient au pis quand l'horizon s'assombrit en Europe. Il ne fallut pas moins que la guerre pour refaire l'union. L'Allemagne se trompait en escomptant ces événements pour se croire à l'abri d'une intervention britannique. Elle se trompait plus encore, en sous-évaluant les forces que l'Angleterre unie était en mesure de lui opposer. L'EMPIRE BRITANNIQUE.Je ne sais s'il est possible à quelqu'un qui n'est pas Anglais d'avoir jamais le sentiment exact du caractère propre à la grandeur britannique. M. Asquith a tenté une définition de l'empire qui, quoique
noble et majestueuse, est encore inférieure à la réalité : Qu'est-ce pour nous que l'empire ? Ce n'est pas un
syndicat pour l'exploration et l'exploitation des races du monde ; ce n'est
pas une simple association commerciale fondée sur la communauté des profits
et des pertes ; ce n'est pas uniquement une société d'assurance mutuelle pour
la protection de ses membres contre les attaques du dehors. Pour nous, la signification
et la valeur de l'empire résident dans ce fait que, malgré tous ses échecs et
toutes ses fautes, malgré tous ses points faibles et toutes ses taches
sombres, il constitue le plus grand et le plus fécond essai que le monde ait
encore vu, d'une union corporative de communautés libres et émancipées...
Une pareille conception de l'empire, loin de
paralyser, stimule au contraire les aspirations et les efforts de tous, pour
que le sort de tous soit sans cesse amélioré. C'est à nos hommes d'État de
faire en sorte que l'empire mérite qu'on désire y vivre et qu'on accepte de
mourir pour lui. Cette communauté sans cesse élargie de volontés libres, c'est le résultat obtenu par les longues élaborations historiques qui ont formé l'Angleterre. Si l'Angleterre n'eût pas été la puissance insulaire et un peu retirée du reste du monde qu'elle est, par suite de sa situation géographique, elle n'eût pas eu, sans doute, ce caractère à part, cette activité constante et inlassable, cette manière originale et un peu distante qui donnent tant de saveur et une autorité si spéciale à la politique anglaise. On peut ne pas aimer l'Angleterre, mais, comment ne pas l'admirer ? L'Anglais a une constitution propre si nerveuse et si virile qu'il s'impose comme un type de puissante personnalité humaine. Aussi, est-il de mode de copier sa façon d'être, sa tenue, ses gestes, d'usurper sa langue, son accent ; l'Allemand, surtout, reconnaissait son maître dans ce premier-né des peuples modernes ; au cours ordinaire de la vie, il n'était pas peu fier de ce noble cousinage. Le citoyen anglais, fils d'une si belle patrie, porte tranquillement et modestement la conviction qu'il n'est rien de tel au monde que d'être Anglais ; mais il sait aussi que, pour être digne d'un tel honneur, il n'est pas de sacrifice auquel un homme ne doive être prêt, pour son pays, sans discuter, à l'heure même et galamment. Il me semble que le plus grand sacrifice que l'Anglais fasse à cet idéal, c'est celui du laisser-aller et de la douceur de l'existence. L'Anglais est dans un état perpétuel d'effort ; il se soumet, constamment, à une surveillance de soi qui ne va pas sans quelque rigidité. Ce contrôle spontané est tel que cet individualiste déclaré recherche de prime saut et d'instinct toute organisation qui, fût-ce dans le jeu, développe et entraîne l'énergie de la volonté et la pleine utilisation de l'existence. On devait voir au cours de cette guerre, — et je relève la chose ici comme un trait de caractère — que l'Angleterre était, sans doute, le seul pays du monde où l'on pouvait recruter, instruire et mener au feu, en vertu d'un engagement libre, des troupes aussi nombreuses et aussi bien entraînées que celles assurées aux autres nations par le service obligatoire : ce peuple marchand a des vertus romaines. C'était un risque très grand à une puissance toute d'organisation systématique, comme est l'Allemagne, de se heurter délibérément à ces beaux organismes de libre initiative que sont, d'une part, la nation britannique et, d'autre part, l'armée française. Il me semble qu'il y eut là une des plus graves erreurs, parmi tant de fautes de jugement, commises par les directeurs de la politique allemande. J'ai essayé d'esquisser le fort et le faible des monarchies et des républiques européennes, à la veille d'être engagées dans la guerre de 1914, le caractère des princes ou des ministres qui les ont guidées à ces heures graves : comment se fait-il que, quand il s'agit de l'Angleterre, je n'éprouve nul autre besoin — pour essayer de dire ce qui importe — que de parler de l'homme anglais. C'est lui, en effet, c'est le citoyen, et non ses chefs, qui prépare et dirige la puissance de la nation. Il y a certainement, dans la formation de l'Anglais du XXe siècle, des lacunes graves : l'Anglais manque de souplesse, de liant et même d'adaptation ; il est anguleux et froid ; même avec un sentiment exquis de l'équité, avec un grand respect de la liberté, avec des instincts profondément religieux, il a un souci trop constant du gain et du profit matériels ; il aime commander ; il sait faire travailler les autres ; mais il ne se mêle pas ; dans ses manières et dans son langage, on trouve presque toujours une nuance d'ironie où l'orgueil et la timidité font un mélange singulier. Ce qui lui manque le plus, c'est la bonhomie et même, parfois, la cordialité. Mais ces défauts sont des vertus, si on les considère au point de vue politique ; et l'Anglais est l'animal politique par excellence. Je ne lui ferai qu'un reproche : sa politique est surtout économique ; dans sa vie publique comme dans sa vie privée, il vise à l'enrichissement ; c'est surtout en Angleterre que le temps est de l'argent. Quand l'Anglais aura mis, dans ses affaires, la haute conception de la vie désintéressée qui est dans son idéal, il aura réalisé un type d'homme achevé, tel qu'une forte et ancienne civilisation a pu, seule, le former. Dans l'emprise qu'il exerce sur le monde, l'Anglais apporte une imagination hardie, un grand esprit d'initiative, la vigueur physique et morale, la ténacité bull-dog, la vigueur pour les autres et pour soi, la plasticité dans les méthodes et le dédain des procédures systématiques, mais aussi, comme l'a dit un excellent analyste de l'esprit anglais : un mélange, contradictoire en apparence, de libéralisme et d'autorité, de tolérance et de mépris, de bonté et de dureté. L'Anglais conquérant fait des sujets ou des fils, jamais des frères. Ce génie, avec son étrange amalgame de ténacité et de souplesse, qui se résout dans le sens pratique, est celui de la diplomatie britannique : et c'est sans doute ce qui trompa la diplomatie allemande ; elle ne sut pas démêler, dans les longues négociations qui, alternativement, rapprochèrent et séparèrent les deux gouvernements, ce qu'il y avait d'inflexible sous les apparences polies et patientes ; elle ne vit pas le roc sous l'onde. On crut à l'hésitation et même à la faiblesse, quand il y avait seulement une volonté sincère (le sacrifier les choses secondaires au bienfait général de la paix. Ce qu'il y a de mécanique dans l'esprit allemand ne saisissait pas ce qu'il y a de souple et de vivant dans le génie anglais. Les cousins parvenus auront à prendre, pendant des siècles la leçon de leurs cousins arrivés, pour parvenir à les égaler. Le professeur allemand a encore beaucoup à apprendre du gentleman anglais. Ces éternels pédagogues de la psychologie des peuples ont mal compris la psychologie des Anglais qu'ils ont si minutieusement étudiée. La fleur des choses ne se classe pas dans leurs herbiers. Mais, ce qui est plus étrange encore, ces organisateurs incomparables de l'enquête et de l'espionnage n'ont pas mieux compris la véritable force de l'adversaire qu'ils provoquaient et dont ils faisaient, en toute imprudence, leur principal ennemi. QUELLES SONT LES FORCES DE L'ANGLETERRE ? LES FORCES MATÉRIELLES ET MORALES.Quand il s'agit de l'Angleterre, le tableau de la puissance militaire ne suffit pas ; il convient aussi de signaler d'autres éléments qui s'ajoutent au poids de l'épée que l'Angleterre jette dans la balance. L'Angleterre est, de toutes les puissances, celle qui apporte dans les affaires de l'univers le plus grand appoint d'autorité et de prestige. Un tel surcroît d'influence, elle le doit à sa richesse, à son action sur l'opinion, à sa réputation historique d'implacable persévérance. La prospérité économique de l'Angleterre est comme un arbre puissant dont les racines se sont enfoncées dans toutes les contrées du globe et dont les fruits nourrissent des peuples innombrables. Si cet arbre périssait, le suc de la vie abandonnerait tant de nations qui, peu à peu, se sont habituées à le recevoir de lui. Cette subordination n'a pas été acceptée sans luttes, mais le fait est acquis. L'Anglais est devenu, pour des centaines de millions d'individus, le fournisseur, le convoyeur, l'instructeur indispensable. Si cette vigilance protectrice, parfois détestée, venait à leur manquer, ils la réclameraient eux-mêmes. L'Angleterre est pareille à ces grands magasins qui monopolisent le commerce du monde : on se plaint de leur existence, on se plaindrait plus encore de leur disparition. Ces avantages singuliers et véritablement uniques dans l'histoire, tiennent au génie commercial de l'Angleterre, à sa situation à l'entrée de la mer du Nord, et aussi à son caractère de puissance insulaire. A l'abri dans son archipel, elle se tient en réserve quand les autres peuples, dans les luttes pour l'indépendance ou la domination, sont sur le front. Même dans les querelles où elle est engagée, son existence est rarement exposée : le sol national est toujours indemne. En vingt ans de guerre, Napoléon n'a pas fait passer un brûlot dans un port britannique. La ceinture d'argent a protégé, comme une cuirasse, le sol intangible de l'Angleterre tant que la voie de l'air ne fut pas ouverte. L'insularité menacée fut certainement une des causes de la guerre actuelle. L'histoire du monde avait accompli sa révolution la plus considérable le jour où, par suite de la découverte de l'Amérique, l'hégémonie avait passé de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique et à la mer du Nord. La mer du Nord devint alors une autre Méditerranée. Les puissances occidentales conquirent, du sud au nord, la prépondérance ; ce fut le tour, successivement, du Portugal, de l'Espagne, de la France, de la Hollande, de l'Angleterre. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si une nouvelle puissance va entrer en ligne et si, du fond des terres germaniques, l'aigle noir va prendre son essor pour planer sur les mers et les terres britanniques. Au fond de ce conflit, il y a, comme on le sait, une bataille économique. L'Angleterre défend l'ordre qu'elle a fait régner, à son profit, dans l'univers. Puisqu'il s'agit de se défendre, elle a précisément la richesse et la force acquises. Même pour ceux sur qui elle règne, une nouvelle conquête plus violente, plus entreprenante et plus rapace serait un grand trouble. Le monde, habitué au léger tribut prélevé par l'activité britannique défend la paix anglaise qu'il connaît et dont il jouit. Il est impossible d'évaluer la richesse que l'Angleterre peut exposer au risque, pour garder son immense prospérité ; car celle-ci est, pour ainsi dire, adéquate à la valeur de la planète... des milliards, par centaines, ne la dénombreraient pas. Faisant désormais une somme unique avec la richesse des puissances alliées. elle est telle qu'on ne voit pas comment l'Angleterre pourrait être battue de ce chef, si la victoire doit rester au dernier écu. L'Angleterre dispose d'une autre force dont il est impossible de comprendre que l'Allemagne n'ait pas tenu compte, c'est la maîtrise qu'elle exerce sur l'opinion. La moitié du monde attend, pour penser, de savoir ce qu'on pense à Londres. Cet avantage incomparable, l'Angleterre le doit, d'abord, à la diffusion de sa langue. Le roi du Siam, Chulalongkorn, m'a dit, quand il vint en Europe : Avant que je n'eusse passé le canal de Suez, je croyais qu'il n'y avait qu'une seule langue européenne, l'anglais ; il ajoutait, d'ailleurs : Quand j'eus mis les pieds en Europe, il me parut qu'il n'y en avait plus qu'une seule, le français. La langue anglaise, par sa brièveté, sa commodité, sa manière directe et prompte, est un excellent agent de diffusion : elle convient à tous les états de civilisation ; non inégale au génie de Shakespeare, elle est abordable à la dispute d'un portefaix. N'ayant pas de dialectes, elle est, en raison de sa simplicité même, à peu près incorruptible ; sa trempe est excellente et elle ne se rouille pas. Mais si l'Angleterre est entendue partout grâce à sa langue, elle convainc surtout grâce à sa presse. L'admirable organisation d'une publicité sans égale, offre, chaque matin, à l'univers, sous le titre de chacun de ses journaux, un volume d'imprimé, pour satisfaire au besoin de savoir ou, plus simplement, à la curiosité des hommes. Où ? Qui ? Comment ? Ces trois questions sont le moteur initial de toute civilisation, et la presse anglaise a toujours une réponse prête à chacune d'elles ; et cette réponse anglaise n'est, d'ordinaire, ni pédante, ni banale : ce sont quelques mots fins et justes qui instruisent et qui décident. Je ne sais s'il est, au monde, un maître de style comparable à un journaliste anglais quand il s'agit de rédiger ce petit poème en prose : l'information. Le fait nouveau, la nouvelle, présenté ainsi, avec un art consommé, allume et excite cette puissance incomparable et reine du monde, l'opinion. Exercer la maîtrise de l'opinion, c'est l'art anglais par excellence. D'ailleurs, les théoriciens du droit public anglais sont les premiers à reconnaître qu'elle est, en Angleterre, le ressort suprême du gouvernement. L'Anglais n'obéit, ni à un roi, ni à un gouvernement, il obéit à l'opinion, c'est-à-dire à cet instinct de la race, à ce sentiment intime de conservation qui détermine le geste des foules, avant même qu'elles aient pu se livrer à de plus amples réflexions. Ayant attribué à l'opinion une si large part dans ses propres affaires, rien d'étonnant que l'Anglais en ait fait, au dehors, un instrument de règne ; rien d'étonnant qu'il en ait organisé le maniement avec un art si parfait. Ces admirables organisateurs de publicité que sont les négociants anglais avaient créé l'instrument ; les hommes publics et les hommes d'Etat n'ont eu qu'à le prendre en mains. Ils ont étendu et élargi à l'infini la puissance de l'information ayant son centre à Londres et dont les ondes tournent sans cesse autour du globe qu'elles inondent de lumière ou de ténèbres, selon qu'en décide la main qui tient le commutateur. Le mouvement des steamers sur les océans, le réseau des fils télégraphiques, les antennes des télégraphies sans fil, les succursales des agences de publicité, tout se prête à ce travail de captation par lequel l'Angleterre saisit les esprits de chaque homme, chaque jour et à chaque instant du jour : pas un esprit qui lui échappe et qui ne reçoive, sinon l'étincelle, du moins le choc. Tout lecteur des journaux anglais subit cette servitude volontaire ; l'Angleterre exerce, soit sur son propre domaine, soit sur le domaine des autres, par la répercussion des échos infinis, la dictature de la persuasion. Les gouvernants allemands n'avaient sans doute ni assez de lucidité, ni assez de tact pour sentir de quel prix devait être pour eux l'abstention de l'Angleterre ; ou plutôt leur passion l'emportait sur leur clairvoyance : ils détestaient l'Angleterre, on le voit maintenant, ils ne songeaient qu'à clore le livre de son admirable histoire... Ils ne savaient donc pas cette histoire ? Outre ses ressources matérielles et ses avantages insulaires, en plus de sa richesse, de son autorité mondiale, au-dessus de sa puissance militaire et navale, l'Angleterre a une force qui, jusqu'ici, l'a rendue invincible, c'est sa ténacité irréductible dans les entreprises, une fois décidées. Telle est la cause essentielle de la grandeur britannique. Qu'il s'agisse des armadas de Philippe II, des armées de Louis XIV ou de Napoléon, qu'il s'agisse de la conquête des Indes ou de l'Afrique, qu'il s'agisse de la Méditerranée ou des Océans, l'Angleterre, une fois le parti pris d'agir, s'engage à fond et va jusqu'au bout. L'Angleterre ne se désiste jamais : le léopard britannique sait attendre ; il avance par bonds, mais il ne recule pas. L'Allemagne avait paru le comprendre jusqu'ici, et elle s'était gardée de rompre en visière, à sa formidable voisine : le travail sournois de la contrefaçon économique et commerciale, l'insinuation lente et tortueuse dans les affaires de banque et de navigation, l'invasion occulte dans les positions avantageuses, avaient bien su prendre part aux bonnes entreprises et aux larges dividendes : mais la lutte décisive et à mort, face à face, la dague au poing, il n'en était pas question. Il a fallu l'erreur quasi démente de Guillaume II pour en venir là. Il a fallu qu'il renversât, pour ainsi dire, de fond en comble, tout le sens des intérêts allemands pour que la Weltpolitik devînt à la fois une agression contre le monde et une agression contre l'Angleterre. En se mêlant ainsi de tout, l'Allemagne s'exposait simultanément à tous les risques. Bismarck, pourtant, l'avait bien avertie. Mais comment le prince qui avait chassé Bismarck aurait-il goûté et suivi ses amers conseils ? Les armements ne suffiront pas dans l'avenir, écrit le ministre disgracié, dans ce livre des Souvenirs, qui est son véritable testament politique ; il faudra, en plus, la justesse du coup d'œil pour piloter le vaisseau de l'Allemagne, à travers tous les courants des coalitions auxquelles notre situation géographique et notre régime historique nous exposent. Je n'ai qu'une crainte, c'est que la route que nous suivons ne nous force à sacrifier l'avenir aux préoccupations mesquines du présent : autrefois, les souverains tenaient les aptitudes en plus haute estime que l'obéissance. Faire de l'obéissance le critérium unique en toutes choses, c'est attribuer à un souverain une universalité de talents que n'aurait pas eu le grand Frédéric lui-même : et, cependant, de son temps, la politique était chose moins difficile qu'aujourd'hui. Plus nous saurons nous tenir à l'écart dans les questions qui ne nous touchent pas directement, plus aussi notre considération et notre sécurité se développeront d'une manière régulière. Il faut, à cet effet, que nous sachions rester indifférents aux séductions de la VANITÉ. L'Allemagne commettrait une grande folie si, dans les questions d'Orient, dans lesquelles elle n'a aucun intérêt spécial, elle voulait prendre parti avant les antres puissances directement intéressées... L'absence de tout intérêt direct dans les questions d'Orient est, il est vrai, un grand avantage pour la politique allemande, mais il ne faut pas oublier que la situation centrale de l'Allemagne, situation forcément exposée à tous les dangers, et de plus l'étendue si vaste et si différemment orientée de ses fronts de défense ainsi que la facilité de créer des coalitions asti-allemandes, constituent, pour l'empire allemand, de sérieux inconvénients. Ajoutez à cela que l'Allemagne est la seule grande puissance en Europe que nul projet ne saurait tenter, s'il ne peut se réaliser que par la guerre (n'est-ce pas tout l'opposé du militarisme à la Bernhardi !) C'est notre intérêt de conserver la paix, tandis que tous nos voisins du continent (y compris l'Autriche, bien entendu) font des vœux qui ne sauraient se réaliser que par la guerre. Il convient donc d'organiser notre politique selon les exigences de la situation ; je veux dire qu'il faut empêcher ou limiter la guerre, rester, autant que possible, les derniers à jouer, et ne nous laisser forcer la main ni par l'impatience, ni par quelque complaisance consentie aux dépens du pays, ni par un sentiment quelconque de VANITÉ, ni PAR DES PROVOCATIONS D'AMIS ; rien ne doit nous décider, avant le moment voulu, à quitter l'expectative pour l'action : sinon, plectuntur Achivi (c'est-à-dire : sinon les peuples souffriront de la folie de leur prince). ... Nous devrions faire tout notre possible pour atténuer les mauvais sentiments que provoque le développement de nos forces. Devenus grande puissance, nous avons le devoir d'user de notre influence dans un esprit honnête et pacifique et de prouver au monde qu'en Europe, l'hégémonie allemande exerce une action plus salutaire, plus impartiale que la France, la Russie ou l'Angleterre, quand il s'agit de la liberté d'autrui... Notre unité une fois établie dans les limites possibles, mon idéal a toujours été de nous concilier la confiance des grandes puissances, comme celle des puissances secondaires de l'Europe, et j'ai cherché à leur prouver que la politique allemande ne voulait être que l'amie dévouée de la paix et de.la justice, après avoir réparé l'injuria temporum, le morcellement de la nation. Les conseils du vieux renard assagi n'ont pas été suivis ;
personne n'était de taille à le continuer. Bismarck a fait, d'avance, le
portrait du souverain qui ne demande à ses peuples, comme à ses ministres, d'autre mérite que l'obéissance ; sous ce maître, l'Allemagne
n'a pas su prévoir le danger des coalitions ;
elle n'a pas su se concilier la confiance des
grandes puissances, à tel point que ses alliés même l'ont abandonnée à
l'heure décisive ; elle n'a pas su attacher à sa cause les puissances secondaires et elle a violé
audacieusement le territoire et la liberté de la Belgique, uniquement parce
qu'elle avait besoin de passer et que nécessité fait
loi. Si dans cette balance générale des choses, elle a trouvé contre
elle des adversaires irréconciliables, comme l'Angleterre et la Russie, si,
en s'introduisant par les affaires d'Orient, dont le chancelier lui signalait
le péril, dans ces vastes questions méditerranéennes et mondiales qui
touchaient l'Angleterre à la prunelle de l'œil et qui la forçaient à
intervenir au nom de ses intérêts vitaux, à qui les peuples de l'Allemagne
doivent-ils s'en prendre, sinon à cette VANITÉ
deux fois signalée par Bismarck dans le passage terrible où, en signalant
d'avance la faute, il a d'avance inscrit le châtiment : plectuntur Achivi ! LES FORCES MILITAIRES ET NAVALES.L'erreur de l'Allemagne à l'égard des sentiments de l'Angleterre et des conséquences de l'intervention éventuelle de cette puissance tint aussi, sans doute, à l'appréciation erronée de l'empereur Guillaume sur la méprisable petite armée britannique. Précisément, parce que l'Allemagne connaissait mal l'Angleterre, elle n'avait pas prévu la prodigieuse élasticité de son système de recrutement et les ressources inépuisables que la politique anglaise pouvait trouver dans le dévouement à la cause nationale des habitants du territoire métropolitain et de l'immense domaine colonial. Le budget de la guerre britannique s'élevait en 1912-1913 à 242.895.354 livres sterling (la livre à 25 francs), somme énorme pour faire face aux services suivants : L'armée britannique se recrute par voie de recrutement volontaire. Elle a été profondément modifiée par la loi du 2 août 1907, due à lord Haldane, et par une série de mesures qui se sont succédé depuis cette époque sans interruption. Elle se divise en plusieurs parties : l'armée de campagne ou expéditionnaire, destinée à servir en dehors du territoire métropolitain, la réserve spéciale qui a remplacé les anciennes milices, l'armée territoriale qui remplace les anciens corps de volontaires et la cavalerie de milice ou yeomanry. Il existe, en outre, une réserve technique qui réunit les hommes chargés des services spéciaux, et même une réserve nationale ou réserve des vétérans qui, sans prendre d'engagements, se tiennent à la disposition du ministre de la Guerre en cas de besoin urgent. Les effectifs prévus pour l'exercice 1912-1913 donnaient les chiffres suivants :
En cas de guerre, l'armée britannique pouvait envoyer hors du territoire métropolitain un corps expéditionnaire fort de 6 divisions d'infanterie, 1 division de cavalerie, 2 brigades d'infanterie montée : au total, 156.000 hommes environ de l'armée régulière et de sa réserve ; il resterait en Angleterre 425.000 hommes environ, dont 260.000 de l'armée territoriale. (Jean Dany.) Le corps expéditionnaire (Striking force) est réuni, en tous temps, au camp d'Aldershot où il est tenu en état d'entretien et d'entraînement, de façon à pouvoir partir au premier signal. Mais l'on se ferait une idée très fausse des ressources militaires de l'Angleterre, si l'on ne considérait que les chiffres des effectifs : un certain nombre de considérations modifient la valeur réelle de ces corps et, en premier lieu, l'immensité du territoire placé sous la domination anglaise et qui exige partout la présence de détachements militaires plus ou moins importants : c'est ainsi que la plupart des régiments d'infanterie ont un bataillon à l'intérieur et un à l'extérieur. Par exemple, on compte, au point de vue des effectifs en 1911-12, sui le territoire du Royaume-Uni, 136.000 hommes, en Afrique du Sud, près de 12.000 hommes, dans l'Inde, 76.000 hommes, en Égypte, 6.000 hommes, à Malte, 7.000 hommes, etc., etc. L'infanterie compte 73 régiments dont 4 de la garde, armés du fusil à magasin Lee-Enfield transformé, modèle 1903, calibre 7 m/m 7, qu'il avait été question de remplacer par un fusil Mauser, à la veille de la guerre. L'infanterie montée compte 18 bataillons. La cavalerie se compose de 31 régiments dont 17 dans la métropole, 5 aux colonies et 9 aux Indes. L'armée territoriale compte 42 régiments. La cavalerie est armée de la carabine Lee-Enfield, du sabre et de la lance. L'artillerie (Royal Artillery) compte 144 batteries d'artillerie montée (dont 66 dans la métropole et 3 aux Indes), 28 batteries d'artillerie à cheval (14 dans la métropole), 21 batteries d'artillerie de montagne (aux Indes), 12 batteries d'artillerie lourde (6 aux Indes), 87 compagnies d'artillerie à pied (37 dans la métropole, 29 aux colonies et 21 aux Indes). Les réserves en voie de formation devaient former une artillerie puissante, mais qui était encore à l'état embryonnaire au moment de la guerre. Les batteries de campagne sont armées du canon à tir rapide, du calibre 8 cm 38 pour l'artillerie montée et du calibre 7 c m 62 pour l'artillerie à cheval. Un nouvel obusier à tir rapide a été distribué en 1912. Le génie compte 86 compagnies ; le train, 87 compagnies. Des perfectionnements très importants ont été apportés à l'armée anglaise au cours des années 1912 et 1913 ; la crise qui avait atteint le corps des officiers a été conjurée en partie, quoiqu'il y eût encore, de l'aveu de lord Haldane, un déficit de 1.100 officiers, rien que dans l'infanterie. Le service de l'aéronautique militaire a été créé, pour ainsi dire, par le décret du 11 avril 1912. Au printemps de 1913, l'Angleterre disposait, pour son armée et sa marine, de 150 à 160 aéroplanes. Le service des signaux, les transports mécaniques, le service des cyclistes, le recrutement des chevaux ont été l'objet d'une réglementation perfectionnée. L'armée anglaise était en pleine transformation et les perspectives s'ouvraient pour une plus large application d'un système nouveau, lorsque la guerre a éclaté. L'Allemagne put croire que l'armée anglaise ne compterait, sur le continent, qu'en proportion des effectifs indiqués par les chiffres budgétaires : elle ne prévoyait pas l'élan qui allait porter, au bout de quelques mois, plusieurs millions de volontaires à la défense du pays. Les colonies anglaises ont offert, en outre, à la métropole, un appoint qui n'est pas à dédaigner. Aux Indes, l'armée atteignait le chiffre de 365.000 hommes, dont 74.000 hommes de troupes européennes détachées de la métropole ; les autres troupes indiennes ont, jusqu'à concurrence de 128.000 hommes, des cadres européens. En Égypte, un corps expéditionnaire de 6.000 hommes est complété par une armée indigène de 16.500 hommes. Au Canada, les milices, recrutées par voie d'engagements volontaires, atteignent un total de 105.000 hommes. L'Australie a des milices pouvant fournir 80.000 hommes ; et le Cap, outre le corps d'occupation de 12.000 hommes, peut offrir à la métropole environ 15.000 volontaires. LA MARINE ANGLAISE.La volonté impérialiste de l'Allemagne a été si décidée et si énergique, qu'elle a transformé en problème ce qui paraissait antérieurement un axiome : l'Angleterre reine des Océans. Le rôle joué par la marine allemande depuis le début des hostilités prouve mieux que tout le reste à quel point cette guerre avait été voulue et préparée : il prouve aussi à quel point les tergiversations de l'Angleterre ont failli lui devenir funestes. Peut-être la guerre a-t-elle été déclarée un peu tôt par l'Empire d'Allemagne : cependant, le dernier mot n'est pas dit ; car la grande flotte allemande n'a pas donné jusqu'ici. Il ne faut pas oublier les deux objectifs que se proposaient les constructeurs de cette flotte ; ils disaient : L'Angleterre gardera peut-être une avance sur nous dans les constructions, mais le personnel lui manquera. Et ils disaient encore : Nous userons la flotte anglaise par la nécessité de tenir la mer, par les mines, les torpilles et les sous-marins, tandis que nos cuirassés resteront à l'abri et en bon état d'entretien dans nos ports : nous choisirons notre heure pour sortir, et alors on se comptera. Un point paraît ne pas avoir été prévu ou du moins avoué, la supériorité des unités anglaises, chaque fois qu'elles se rencontrent dans des proportions à peu près égales sur les unités allemandes. Et il faut tenir compte aussi de deux éléments que les opérations ont révélés : la guerre de croisière des navires allemands, gardés soigneusement hors de la nier du Nord, et poursuivie par eux dans la Méditerranée, dans la mer Noire, dans l'Océan Atlantique et dans l'Océan Pacifique ; l'emploi des sous-marins dans la Manche et dans les mers britanniques, contrairement aux règles du droit des gens en vue de terroriser la navigation de commerce, y compris celle des neutres. Ces indications rapides ne sont pas inutiles puisqu'il s'agit d'indiquer, maintenant, dans quelle mesure la flotte britannique était prête à remplir le rôle qui lui incombait dans la guerre de 1914, c'est-à-dire, d'une part, faire face à la guerre d'escadres, et d'autre part assurer, aux puissances alliées, la sécurité de la navigation et du ravitaillement. A partir du jour où l'Allemagne a commencé la course aux dreadnoughts, l'Angleterre abandonna le fameux principe two power standard, c'est-à-dire le système de construction qui devait assurer la supériorité de ses forces navales sur l'union des deux plus puissantes marines concurrentes. On essaya de remplacer ce principe par un autre : mettre sur chantier deux fois plus de cuirassés que l'Allemagne ; on dut y renoncer encore. Finalement, après de longues hésitations, M. W. Churchill s'arrêta, comme nous l'avons vu, à la règle empirique fixant la proportion : 16 cuirassés anglais contre 10 cuirassés allemands. Il convient d'ajouter immédiatement que cette règle n'avait d'application directe que dans l'hypothèse de la guerre d'escadres, c'est-à-dire de deux flottes se cherchant pour se combattre, mais qu'elle n'assurait pas le succès décisif au cas où la flotte la moins considérable se terrerait pour échapper à la recherche et à l'offensive de l'autre. Pour exposer les résultats les plus voisins possibles de la réalité, je suivrai les indications données par un des hommes les plus compétents assurément qu'il y ait en France, actuellement, M. Bertin. Il fait observer, avec raison, que les chiffres qui permettent d'établir une proportion approximative se rapportent au début de l'année 1914 et qu'ils ont été modifiés au cours des quinze derniers mois : mais, les chantiers ayant dû travailler de part et d'autre avec une activité égale, les rapports, sans doute, restent à peu près les mêmes. M. Bertin prend, pour base de ses tableaux comparatifs, cinq espèces de bâtiments de guerre, et il donne la classification suivante, qui met en regard les forces navales de l'Angleterre et de la France, d'une part, et celles des deux empires germaniques, d'autre part.
Il faut tenir compte, des deux côtés, des constructions en cours qui ont pu être achevées, et surtout de l'acquisition qui a été faite des navires en construction pour les puissances étrangères dans les ports respectifs. L'Angleterre a terminé 14 cuirassés et en a acquis 3 ou peut-être 4. La France a terminé 3 cuirassés. L'Allemagne a terminé certainement 4 cuirassés et elle a pu en acheter 1. L'Autriche a dû mettre en ligne 2 nouveaux cuirassés. Il faut supposer des modifications analogues pour tous les autres types, l'Allemagne ayant sûrement construit deux croiseurs de bataille et, probablement, un nombre très appréciable de sous-marins de haute mer, et l'Angleterre ayant dû porter son effort sur les canonnières et les bâtiments à fond plat, destinés à approcher des côtes, sorte de navires dont la nécessité s'est fait sentir pour les bombardements de la côte, pour la lutte contre les sous-marins et pour le dragage des mines dans la mer du Nord et dans la Manche. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre a maintenu, d'une manière très suffisante, sa supériorité proportionnelle en nombre, et il est permis d'affirmer qu'elle a maintenu également sa supériorité en artillerie et en personnel, malgré les pronostics allemands qui, sur ce dernier point, ont été trompés. Les engagements volontaires ont fourni, et au delà aux besoins de l'armée de mer comme à ceux de l'armée de terre. Le tableau suivant (complété, en partie, avec les acquisitions et les lancements postérieurs à la déclaration de guerre) expose l'état de la flotte britannique en tonneaux et en canons.
Artillerie des unités cuirassées : 132 pièces de 343 millimètres, 300 de 305, 8 de 254, 120 de 234, 98 de 190, 782 de 150 et 422 de 100. Le chiffre des effectifs atteignait, au 1er janvier 1914, 146.000 officiers et matelots. Le 23 juillet 1913, 350 bâtiments de guerre avaient pris part aux grandes manœuvres navales : c'était une armada comme le monde n'en avait jamais vu. Voici les noms des principaux dreadnoughts anglais de 17.000 à 28.000 tonneaux, dans les premiers mois de l'année 1914. Dreadnought
— Bellerophon — Téméraire — Superb — Saint-Vincent — Collingwood — Vanguard —
Neptune Colossus — Hercules — Orion — Conqueror — Monarch — Thunderer —
King-George — Centurion — Ajax — Audacious — Iron-Duke — Marlborough — Delhi
— Benbow. Les croiseurs cuirassés principaux sont : Invincible — Indomitable — Inflexible — Indéfatigable — Lion — Princess-Royale — Tiger (28.000 tonnes). Le type du croiseur cuirassé ou croiseur de bataille provoqua d'assez longues hésitations dans le monde des constructeurs : la valeur de ce type sera peut-être, avec le rôle des sous- marins et de la navigation aérienne, le problème de la guerre actuelle. Avec le croiseur de bataille, les constructeurs qui se sont lancés dans cette voie (on a remarqué que la France ne les avait pas suivis) ont voulu arriver à un cuirassé, en somme un peu plus léger et moins bien défendu, mais réunissant les meilleures conditions possibles de vitesse, d'artillerie et le plus grand rayon d'action. M. Bertin fait, à ce sujet, les observations suivantes dont nous ne manquerons pas de suivre l'application dans les faits de la guerre actuellement engagée. Le combat d'escadres est une lutte d'artillerie de grands cuirassés... Quand la parole est au canon, la supériorité est acquise au feu le mieux concentré. On obtient, par l'accroissement du tonnage, un gain rapide d'abord, dans le rapport du Poids d'artillerie au déplacement total. Cependant, ce bénéfice va diminuant proportionnellement quand on dépasse 30.000 tonnes. Fait plus curieux et longtemps imprévu, au delà de 60.000 tonnes, la fraction du déplacement disponible pour l'artillerie irait en diminuant. De plus, à même poids d'artillerie, les navires plus gros donnent une ligne de file plus courte et un feu plus dense. En somme, la tactique du jour est aux gros déplacements. Le nom seul de croiseurs de
bataille marque assez leur participation
prévue aux grandes actions militaires. Mais il y a peut-être quelque
contradiction à prétendre les faire répondre aux deux usages différents
d'éclaireurs, par leur rapidité, et de navires de combat, par la puissance de
leur artillerie, puisque la vitesse stratégique des escadres est
nécessairement commandée par les navires les plus lents. Les croiseurs de
bataille n'ont pas subi l'épreuve de la guerre, sauf dans une escarmouche où
le Gœben paraît avoir été assez maltraité par un cuirassé russe.
La question de leur aptitude au combat reste donc pendante. Le calcul conclut
à l'impossibilité pratique d'associer, sur un même navire, la plus grande
puissance militaire d'un cuirassé à la plus grande vitesse d'un croiseur.
Cette impossibilité paraît, d'ailleurs, évidente, si l'on admet que le
cuirassé et le croiseur ont, chacun de son côté, atteint la limite de
grandeur acceptée. Si cette limite approchait du maximum indiqué plus haut,
l'impossibilité pour le croiseur de bataille serait absolue. Si la
supériorité militaire sur les autres croiseurs reste acquise, l'égalité
militaire vis-à-vis du cuirassé reste au moins contestable. La question de coût mérite aussi d'être prise en considération : la Russie a mis sur le chantier quatre croiseurs du type Borodino, de 32.000 tonnes, pour être opposés aux Derfflinger allemand. Or, le prix d'un Borodino est estimé à plus de cent millions. Le sous-marin a pris, dès le début de la guerre, une importance qui, sans doute, ira toujours croissante. La flotte militaire et la flotte commerciale britannique ont été exposées aux coups des sous-marins allemands, tandis que la flotte commerciale allemande était à peu près supprimée et la flotte de guerre enfermée dans les ports. La question qui se pose est de savoir si le rôle des sous-marins ne s'accroîtra pas encore à bref délai : Le sous-marin n'a pas dit son dernier mot. Vienne le jour où il sera allégé des accumulateurs électriques qui lui fournissent sa puissance, mais la lui font payer à raison d'une surcharge de 60 kilogrammes par cheval-heure, vienne le jour où il naviguera en plongée comme en surface, à raison de 0 kg. 20 de pétrole, le sous-marin s'évadera de la catégorie des navires de flottille : il se révélera plus apte à poursuivre les grands navires en haute mer, qu'il ne l'est à aider aujourd'hui, par la crainte qu'il inspire, à les tenir terrés dans leurs repaires. L'Angleterre, qui a suivi le progrès des sous-marins avec une attention particulière, est prête de ce chef, et, au moindre mouvement de la flotte germanique, celle-ci rencontrera, du fait des sous-marins anglais, un obstacle que les calculs téméraires de l'amiral Tirpitz n'ont peut-être pas prévu. Le rôle des torpilles et des mines, dans la guerre navale, se révélera au fur et à mesure des incidents auxquels il donne lieu. Mais il ne faut pas le perdre de vue quand il s'agit d'apprécier exactement la puissance maritime de l'Angleterre : elle trouve là une certaine limite dont il faut tenir compte. Quelques indications au sujet de la répartition des flottes britanniques compléteront ce trop rapide exposé : en 1911, l'ensemble des forces anglaises était réparti en Home Fleet, Atlantic Fleet et Mediterranean Fleet. Depuis 1912, des remaniements profonds ont été apportés à cette distribution, d'accord avec les États-Majors français ; une partie des forces méditerranéennes a été rappelée dans la mer du Nord, pour être opposée spécialement à la flotte allemande, tandis que la flotte française prenait spécialement la garde de la Méditerranée. A partir de 1912, l'Angleterre eut trois flottes : la première, à effectifs complets, de 4 escadres de 8 cuirassés chacune ; la deuxième, composée de deux escadres, et la troisième, à effectifs réduits, qui devait aussi avoir deux escadres. En tout, il devait y avoir, à la veille de la déclaration de guerre, 8 escadres, appuyées chacune par une division de croiseurs cuirassés, formant un total d'environ 6o cuirassés et de 32 croiseurs cuirassés. Tous ces chiffres se sont modifiés selon les nécessités du moment, mais la grande flotte anglaise est prête pour combattre les flottes allemandes tenues soigneusement à l'abri dans les ports de la mer du Nord et de la Baltique. Cependant, les événements de la Méditerranée ont encore imposé de nouvelles modifications au plan primitif. Depuis la guerre balkanique, la flotte anglaise méditerranéenne a été renforcée. Une division de croiseurs de bataille et une escadre de cuirassés ont été tenues dans cette mer. Leur rôle apparaîtra et leur force se développera au fur et à mesure des événements. L'empire des mers est immense et il n'est pas une partie de l'Océan où la vigilance de l'Angleterre n'ait tenu des forces disposées à faire face à tous les périls. |