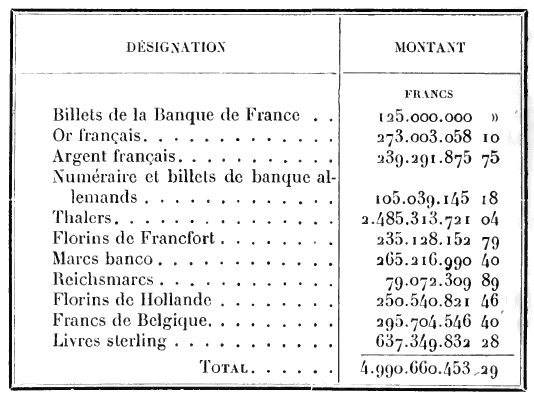HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE (1871-1900)
I. — LE GOUVERNEMENT DE M. THIERS
CHAPITRE VIII. — L'APOGÉE.
|
Les débuts de la session. — Interpellations. — Débat sur les marchés de la guerre. — Enquête sur les capitulations ; le maréchal Bazaine envoyé devant un conseil de guerre. — Négociations pour le paiement des trois derniers milliards de l'indemnité de guerre. Discussion et vote de la loi militaire du 27 juillet 1872. — La convention du 29 juin. — Le budget de 1873 ; nouveaux impôts. L'emprunt de trois milliards. — La situation parlementaire ; le centre gauche adhère à la République ; tentative de conjonction des centres ; le Conseil des Neuf ; la manifestation des bonnets à poil. — Les vacances : M. Thiers à Trouville ; seconde campagne oratoire de M. Gambetta. — La situation de l'Alsace-Lorraine. Agitation des partis ; expulsion du prince Napoléon ; le comte de Chambord et les princes d'Orléans. — Manifestations religieuses. — Les élections du 26 octobre 1872. I La Chambre se réunit le 22 avril 1872. La session devait se prolonger jusqu'au 3 août de la même année. C'est l'apogée du gouvernement de M. Thiers. Depuis quinze mois, depuis les premières séances où l'Assemblée nationale, réunie à Bordeaux, a confié à M. Thiers la mission de sauver et de relever le pays, un premier cycle d'événements s'est accompli. La paix a été débattue et signée, les derniers soubresauts de la crise ont été comprimés, un gouvernement a été inauguré, les administrations ont fonctionné, la France a repris conscience de son existence et de ses ressources ; elle a fait la première expérience de la liberté. M. Thiers avait dit à Bordeaux : Pacifier, réorganiser, relever le crédit, ranimer le travail, voilà la seule politique possible et même concevable en ce moment. Ainsi limitée, la tache est, en partie, accomplie. Mais M. Thiers avait aussi prévu, dès lors, les difficultés qui devaient entraver son œuvre et les nécessités qui devaient la précipiter ou, peut-être, l'interrompre. Il disait encore : Quand cette œuvre de réparation sera terminée, et elle ne saurait être très longue, le temps de discuter, de peser les théories du gouvernement sera venu. L'œuvre du relèvement n'était pas achevée que déjà l'heure des théories du gouvernement était sonnée, tant la politique est nécessaire aux hommes ! Le goût du commandement est inhérent à la nature humaine, non moins que celui de l'obéissance. La lutte pour le pouvoir est le premier acte de l'activité sociale. Les hommes commencent par se quereller : c'est par le dissentiment qu'ils arrivent à l'union. On dirait, en vérité, qu'ils aiment d'abord à se détester. La République se fondait au milieu du chaos des luttes parlementaires. Mais l'évolution naturelle de la crise lui imposait encore des charges que, seule, on l'avait vu, elle pouvait assumer. Les partis monarchistes avaient hésité devant ces taches si lourdes : la conclusion de la paix, la répression de l'émeute, la création des nouveaux impôts ; il fallait cette condition particulière de l'anonymat républicain, ou plutôt, il fallait qu'à la faveur de cette formule, la responsabilité fût répandue et diffuse sur toute la nation, pour que celle-ci s'inclinât devant les conséquences de ses erreurs et acceptât tout le fardeau. Or, les circonstances sont telles, à l'heure où nous sommes arrivés, que, malgré la véhémente ambition des partis et l'inquiétude de leurs aspirations, la forme républicaine s'impose encore à eux. Ils la détestent, ils sont les maîtres et ne peuvent la rejeter : par quoi la remplacerait-on M. Thiers l'avait dit déjà, en termes peu mesurés : Attendez huit jours... Mais ces huit jours ne paraissent pas près de s'achever. L'ennemi occupe le territoire national ; l'indemnité de guerre n'est pas entièrement payée : les grandes lois financières et militaires ne sont pas toutes votées. Et puis, il reste à établir les responsabilités : celles de la guerre, celles de la Commune. De redoutables conflits sont encore menaçants ; il faut qu'ils éclatent pour que les camus soient apaisés et l'atmosphère rassérénée. L'Assemblée emploiera ses séances à cette triple Début de ta nécessité qui la presse : achèvement de la liquidation. session. travail de la réorganisation, effort pour la constitution. Le passé et l'avenir se heurtent, sous les yeux du vieillard actif et avisé qui s'efforce de préparer les issues et d'amortir les chocs. Dès le début, une sorte d'avertissement indique à l'Assemblée combien cette vie est encore précieuse au pays. M. Thiers avait paru à la séance, le jour de la rentrée : le lendemain, on le dit gravement malade. L'alarme se répand, la Bourse baisse ; l'inquiétude sur la situation de la France est universelle. Heureusement, l'indisposition n'est que passagère. M. Thiers est, bientôt, plus alerte et plus dispos que jamais. Il signe, le 23 avril, le décret par lequel M. de Goulard, ministre de l'agriculture et du commerce, est nommé définitivement ministre des finances en remplacement de M. Pouyer-Quertier, M. Teisserenc de Bort, du centre droit, recevant le portefeuille du commerce. Ce remaniement passe presque inaperçu et l'attention de l'Assemblée est déjà tout absorbée par les premières escarmouches de la session : une interpellation du général Ducrot sur la nomination du maire de Châteauroux ; une autre, visant les adresses des conseils généraux ; une autre, la politique extérieure du gouvernement ; une autre, la présence des maires aux banquets offerts à M. Gambetta. Celle-ci seulement a quelque importance. Elle contraint le gouvernement de M. Thiers à se prononcer publiquement sur la question de la dissolution. M. Victor Lefranc, ministre de l'intérieur, interrogé par M. Raoul Duval, affirme que, seule, l'Assemblée a le droit d'assigner un terme à ses travaux. M. Raoul Duval se déclare satisfait et retire son interpellation, au milieu d'une agitation telle que la séance est suspendue pendant dix minutes. Cette déclaration et cette satisfaction données à la droite n'étonnent pas la gauche qui ; pourtant, voit le président prendre parti contre la thèse- que soutient M. Gambetta. Aussi, le vieux comte Jaubert, méfiant, s'écrie, en fronçant le sourcil, dans la séance du 27 avril : Je n'ai jamais vu une gauche aussi ministérielle. Mais toutes les passions sont surexcitées par la grave question, longtemps renfermée dans le secret des commissions, et qui, maintenant, se débat en séance publique, celle des responsabilités de la guerre. La forme dans laquelle se présente la discussion, c'est l'examen des rapports de la commission d'enquête sur les marchés passés par les administrations publiques, depuis le 18 juillet 1870, pour faire face aux dépenses occasionnées par la guerre. Il n'y en avait pas de plus agressive. Quand une enquête est ouverte, l'esprit de parti y pénètre d'abord. Au moment où le bonapartisme relevait la tête, on crut l'heure opportune de presser le débat. Une première discussion s'engage, le mai, sur la suite à donner aux premières constatations de la commission. M. le duc d'Audiffret-Pasquier, rapporteur, fait un exposé, la fois développé et précis. Les lacunes et les vices de l'organisation militaire impériale sont découverts. Les défaites de la France apparaissent comme la suite fatale d'une longue période de négligence et d'imprévoyance. Le rapporteur conclut en demandant la nomination d'une commission d'enquête chargée : 1° De rechercher la situation du matériel de guerre existant au 1er juillet 1870, par suite des crédits ordinaires et extraordinaires affectés à l'achat et à la transformation de ce matériel ; 2° De connaître l'emploi de ce matériel durant la guerre ; 3° D'étudier les mesures les plus propres à constater la situation actuelle des arsenaux. L'Assemblée vota l'affichage du discours du duc d'Audiffret-Pasquier dans toutes les communes de France. La discussion revint sur ce sujet à plusieurs reprises, pendant le courant de mai. Le 21 mai, M. Rouher interpelle le ministre de la guerre sur les mesures que celui-ci a prises, à raison des faits dénoncés par la commission des marchés. C'était un événement important que la rentrée parlementaire de l'homme que, si longtemps, on avait appelé le vice-empereur. La seconde période du gouvernement de Napoléon III avait reposé sur les épaules de cet Auvergnat, maitre robuste d'une majorité soumise. Allait-il retrouver, comme chef d'un parti d'opposition, l'autorité que sa vigoureuse faconde lui avait assurée ? La situation était périlleuse pour lui, a écrit M. Thiers, et il se présenta en homme ayant conscience du péril. Raisonneur vigoureux et sensé lorsqu'il releva toutes les légèretés de la commission, il eut l'avantage contre elle, sans toutefois entraîner les applaudissements de l'Assemblée. Tout en défendant habilement l'empire, il dresse un violent réquisitoire contre le gouvernement du 4 Septembre ; il termine par un appel aux passions de l'Assemblée, en protestant contre la campagne de dissolution entreprise contre elle. Le lendemain 22 mai, le duc d'Audiffret-Pasquier et M. Gambetta répondirent au discours de M. Rouher. Le duc d'Audiffret-Pasquier attaque l'empire, et particulièrement M. Roulier. Après avoir fait allusion aux paroles adressées par M. Roulier à Napoléon III, au moment on il partit pour le théâtre des opérations, il apostrophe son contradicteur en ces. termes, qui tirent une profonde impression sur l'Assemblée : Ah ! vous croyez, vous qui venez me forcer à individualiser les responsabilités, que vous n'en avez aucune ! Vous ne vous êtes donc pas fait dire, dans l'exil où voue vous étiez réfugié, ce qu'ont pesé, pour nous, ces heures où nous sentions le sol du pays envahi par la Prusse ? Vous ne sentiez, donc pas la fumée de nos chaumières brûlées ; vous ne savez pas qu'à chaque quart d'heure on nous annonçait qu'un des nôtres succombait glorieusement ? Vous ne vous l'êtes pas laissé assez dire ! Ah ! ne croyez pas qu'il suffira de dire, comme pour l'expédition du Mexique, que vous avez si complaisamment évoquée : C'est le secret de la Providence, qui ne respecte pas toujours ses propres combinaisons. Eh bien ! ce n'est pas assez. Je le dis, moi, quel que soit le sang-froid de tous vos gens au cœur léger, quels que soient les ombrages de Chislehurst, il y a une heure où vous avez dû entendre une voix qui criait : Vare, redde legiones ! Rendez-nous nos légions ! Rendez-nous la gloire de nos pères ! Rendez-nous nos provinces ! Et cette responsabilité, est-ce la seule ? Nous avez-vous seulement légué des embarras, des douleurs et des désastres ? Non ! vous avez fait pis encore ; vous nous avez légué — ah ! ce qu'on a bien de la peine à réparer — la démoralisation. Et le chic d'Audiffret-Pasquier poursuit : Quand un pays abdique ses libertés, quand il abdique le contrôle, quand il ne sait pas se faire à ces mesures libérales, qui font que les affaires de tout le monde sont les affaires de chacun. Quand le bourgeois rentre chez lui et se croit bien sage, lorsqu'il peut se dire qu'il ne s'est pas occupé de politique, c'est qu'il ne sait pas que la politique c'est notre sang, notre argent, notre honneur. Quand un pays ne sait pas défendre ses libertés ; quand il se met sous la protection d'un homme providentiel, il en résulte fatalement ce que vous venez de voir : la décomposition et la démoralisation. Le duc d'Audiffret-Pasquier rappelait cette parole de M. Thiers : Un pays doit apprendre qu'il ne faut jamais se donner à un homme, quel que soit cet homme tel quelles que soient les circonstances : il ajoutait : Et ne pouvons-nous pas le dire avec plus de vérité encore qu'il ne le disait pour Napoléon Ier, quand nous pensons aux deuils, aux tristesses et à la honte que nous a valus Napoléon III ? Enfin, opposant l'œuvre de l'empire à celle accomplie par M. Thiers, le duc d'Audiffret-Pasquier s'exprimait ainsi : Le pays ne sait pas ce que ces quatorze mois ont pesé sur cette tête blanche. Et quand vous l'aviez devant vous hier, quand vous avez pu surprendre sur son visage les traces des fatigues, vous êtes-vous souvenu de cc temps où il avait lutté contre vous, avec un patriotisme admirable, éclairé par une vieille expérience, il avait combattu toutes vos folies ? Il vous a prêché, lui, les libertés nécessaires ; il a fait appel à tout ce qu'il y avait de généreux dans le cœur des Français ; il vous a combattu au moment de l'expédition du Mexique. Lui seul, il a eu le courage de le faire, et souvenez-vous donc qu'à ce moment vous faisiez entourer sa maison pour faire parvenir jusqu'à lui les huées et les sifflets ! La Commune a parachevé votre œuvre ; elle l'a profanée, elle l'a détruite, cette maison ; mais c'est vous qui aviez commencé. Maintenant, pour nous, concluait le duc d'Audiffret-Pasquier, la cause est entendue, je demande à l'Assemblée de terminer ce trop long discours par un vœu et comme une dernière prière qui, malgré moi, s'échappe de mon cœur : Que Dieu qui aime ce pays, car c'est à lui qu'il a confié, de tout temps, la défense des grandes et dés nobles causes, lui épargne la dernière et la plus dure des humiliations : celle de voir jamais ses destinées confiées aux mains qui l'ont si mal servi. Le compte rendu officiel ajoute : Acclamations enthousiastes et applaudissements prolongés. Presque tous les députés sont debout, et la séance est interrompue en fait. M. Roulier répliqua, reprit ses arguments de la veille, en faveur de l'empire et contre le gouvernement de la Défense nationale. Son discours fut haché par des interruptions multipliées. L'attitude de M. Roulier est intéressante à observer. Elle dévoile, à elle seule, les projets, les espérances et les plaies de la cause impérialiste. Le dos rond, supportant avec une placidité froide le torrent qui déborde sur lui, gardant le silence' devant l'invective, il ne songe qu'au parti qu'il pourra tirer de ces laborieuses séances. Il laisse l'éloquence répandre les indignations inévitables, et il dénombre déjà, sur les bancs de la droite, le camp silencieux de ses futurs alliés. M. Gambetta, à son tour, riposte à celui qu'il avait appelé, la veille, l'avocat de l'empire aux abois. Les paroles de M. Gambetta furent plus véhémentes encore que celles du duc d'Audiffret-Pasquier. Il reprochait au gouvernement impérial de n'avoir ni prévu, ni préparé la guerre ; il évoquait, lui aussi, l'affaire du Mexique, et il produisait un puissant effet par sa péroraison : Le Mexique vous tient, le Mexique vous poursuit, le Mexique a déjà fait justice par l'éternel châtiment, qui sort des choses, de tous ceux qui ont compromis l'honneur et la grandeur de leur pays dans cette détestable équipée. Oui, la justice a commencé, elle a saisi tour à tour, et Morny, et Jecker, et Maximilien, et Napoléon III ! Elle tient Bazaine. Elle vous attend ! L'Assemblée adopta, à l'unanimité de 676 votants, l'ordre du jour suivant du duc de Broglie : L'Assemblée nationale, confiante dans la commission des marchés et persévérant dans sa résolution de poursuivre et d'atteindre toutes les responsabilités avant ou après le 4 Septembre, passe à l'ordre du jour. Au même moment, à partir du 5 mai, le Journal officiel publiait les avis motivés émis par le conseil d'enquête institué, conformément à l'article 26.i du décret du 13 octobre 1863, sous la présidence du maréchal comte Baraguay d'Hilliers. Pour la plupart des capitulations, le conseil d'enquête constatait que les officiers signataires avaient rempli intégralement leurs devoirs ; l'examen des conditions de la capitulation de Phalsbourg motiva, de la part du conseil d'enquête, une proposition de récompense en faveur des officiers qui commandaient la 'place. Par contre, le conseil d'enquête n'eut que des paroles de blâme sur ces événements militaires extraordinaires et, pour ainsi dire, sans précédent qui, à Sedan et à Metz, avaient livré à l'ennemi deux armées françaises et laissé le pays sans défenseurs. La conduite de l'empereur Napoléon à Sedan était sévèrement qualifiée. Ce document précise, avec clarté, les événements de la bataille et les circonstances de la capitulation. Quant au maréchal Bazaine, il était renvoyé devant un conseil de guerre. Le gouvernement donnait l'ordre d'informer contre lui, le 7 mai 1872, et l'instruction était confiée au général Seré de Rivière. Prétendant prendre les devants, mais cédant, en réalité, an cri de l'opinion qui l'accusait de trahison, le maréchal avait écrit au président de la République pour demander formellement des juges. Enfin, dans les derniers jours du mois de juillet, vint, devant l'Assemblée, le débat sur les conclusions du rapport de M. Riant, relatif aux marchés du 4 Septembre. La discussion l'ut vive. MM. le duc d'Audiffret-Pasquier, Naquet et Gambetta y prirent part. Des divers marchés, conclus dans ces heures de précipitation, un seul motiva des observations graves. La personnalité de M. Gambetta était au-dessus du soupçon, mais on visait particulièrement la commission d'études, notamment son président et un de ses membres, à l'occasion d'un marché passé avec des aventuriers américains, Billing, Saint-Laurent, etc., et par suite duquel des canons offerts à 35.000 francs pour chaque batterie, auraient été payés 70.000 francs. Après un débat tumultueux, où M. Gambetta couvrit la commission d'études, des lettres incriminant le lieutenant-colonel président furent lues à la tribune. L'Assemblée, par 371 voix contre 1, tandis que la gauche s'abstenait tout entière, prononça le renvoi du rapport de M. Riant aux ministres compétents. II Comme il arrive d'ordinaire, les passions avaient été plus vite que les faits. On se disputait sur les responsabilités de la guerre avant d'avoir fait disparaître les traces qu'elle avait laissées et guéri le mal qu'elle avait causé. M. Thiers se consacre à ces devoirs urgents, au milieu d'un enchevêtrement inextricable de travail et de difficultés. Toutes les affaires sont mêlées, quoique distinctes. Il faut avoir l'œil sur tout, calculer, combiner, retarder ou précipiter, selon le dessein général et selon le progrès d'une trame qui n'est, connue que de quelques-uns, et qui est sans cesse embrouillée par le plus grand nombre. Il ne faut pas regarder les parlements de trop près : le désordre apparent des séances surprend l'attention et la détourne de l'ordre intime qui subsiste, grâce à la force des situations et au travail latent des partis et des intérêts. Même au milieu du tumulte, le bien et l'utile trouvent leur voie. Pendant ces mois féconds, mai, juin, juillet 1872, on voit se -poursuivre, parmi les passions aveugles, trois œuvres principales qui servent de fils conducteurs à l'histoire : la négociation pour la libération définitive du territoire, la discussion de la loi militaire, le travail financier qui prépare l'emprunt des trois milliards. La simultanéité et la connexité de ces trois entreprises n'accablent pas un vieillard que l'hostilité de M. Thiers. des partis traque même aux heures réservées au repos et qui doit surveiller, jour et nuit, le piège parlementaire. Il fallait une préparation aussi complète que l'était celle de M. Thiers pour suffire à cette triple besogne : il fallait qu'il pût dire, comme il le disait et comme il était en droit de le dire, de chacune des compétences nécessaires, qu'elle était la sienne depuis cinquante ans, il fallait son goût des affaires, son ardeur joyeuse au travail, il fallait son optimisme, pour qu'il pût s'appliquer en même temps à ces multiples devoirs. D'autres eussent cru plus sage, plus prudent, plus conforme aux circonstances, de procéder par degrés et, comme on dit, de sérier les questions. D'autres eussent appréhendé une surcharge d'application et de responsabilités, avec le danger d'une rupture en cours de route. Mais le petit homme était pressé ; il sentait la mort et l'intrigue sur ses talons. Avec une énergie où il y avait une sorte d'allégresse insouciante et confiante, il prêtait son épaule au triple fardeau. Ce qu'il y eut de vraiment brave, dans toute cette conduite d'un vieillard aux pensées longues et aux nuits courtes, c'est qu'il n'hésita pas à laisser l'Assemblée aborder le problème de nos forces militaires, au moment même où les troupes allemandes occupaient encore le territoire français et où l'indemnité de guerre n'était pas payée. C'était sous le pied même de l'ennemi que la France se relevait et ramassait ses forces. Le vainqueur n'en revenait pas. Il comprenait la portée de cette preuve d'énergie morale, beaucoup plus frappante encore que le relèvement matériel. Il se demandait, ou feignait de se demander, si une pareille décision ne cachait pas de mauvais desseins ; et, lorsque des faits trop évidents le convainquaient du contraire, il cherchait par quel artifice ou par quelle exigence il pourrait arrêter un progrès si remarquable, entraver l'œuvre ou la diminuer. L'occupation du territoire était, pour M. de Bismarck, un puissant moyen d'action ; mais toucher promptement les cinq milliards était une forte tentation. Le crédit de la France, qui, seul, pouvait permettre à celle-ci de se libérer, dépendait du calme dans les relations des deux pays et de l'entente, du moins apparente, entre les deux gouvernements. M. de Bismarck et M. Thiers le comprenaient l'un et l'autre. Celui-ci usait de ses avantages en poussant hardiment, en même temps que le travail de la libération, le vote des lois militaires. C'était dire à l'Allemagne : nous payons, mais nous sommes libres. Il y avait, dans son allure, dans son calme, dans ses explications, — car il ne se dérobait même pas aux explications, une sorte de jeu prudent et d'ironie voilée qui surprenait le rude vainqueur, l'irritait, et parfois, tout de même, le séduisait. L'empereur Guillaume, qui était, à cette époque, le plus étonné et le plus fâché de tous, disait au général de Manteuffel : Cet homme est une véritable sirène ; il est si habile et si malin (klug), que mon esprit s'habitue, malgré moi, à ne plus détester ce mot de République, mon épouvantail jusqu'ici ; il me rendrait républicain s'il pouvait me garantir son immortalité aux affaires de son pays[1]. Et c'est pourtant ce même empereur Guillaume, inquiet d'un tel ressort chez un peuple que les déclamations hostiles avaient tant diminué à ses yeux, c'est l'empereur Guillaume qui talonne M. de Bismarck et le met en garde contre le danger d'une France trop tôt renaissante. M. de Contant écrit de Berlin, résumant la complication où se débat la négociation pour le paiement des derniers milliards de l'indemnité : L'esprit de l'empereur est sérieusement ému par la préparation de votre loi militaire, par les menaces de politique révolutionnaire, conséquemment de revanche augurées des mouvements de Gambetta et d'une prétendue entente qui serait faite entre M. Thiers et lui, pour la réorganisation visible de l'armée et l'accroissement relatif du budget qui la concerne. C'est un thème répété autour de lui : la presse allemande et, à sa suite, la presse italienne le développent journellement. Par l'intermédiaire du comte de Manteuffel et du comte de Saint-Vallier, on donnait à M. Thiers des avertissements analogues. L'attaché militaire à Paris, M. de Bülow, exagérait les chiffres énormes des futurs contingents français : D'après lui, nous appellerions dorénavant cent mille hommes, chaque année, sous les drapeaux, abstraction faite des non-valeurs, ce qui représenterait un appel annuel de 120.000 hommes. D'autre part, nous augmenterions de 80 millions le chiffre des budgets de la guerre sous l'empire, et encore, la création du nouvel armement, canons, fusils, ne s'y trouverait pas comprise[2]. Dans l'audience de congé que l'ambassadeur d'Allemagne avait eue de M. Thiers, vers le 7 mars, au moment des vacances de Pâques, le président de la République avait dit à son interlocuteur que, dès le retour de celui-ci à Paris, on aborderait la question du paiement des trois derniers milliards et, par conséquent, celle de l'évacuation totale. La France était donc en avance de deux ans sur les engagements qu'elle avait contractés. Cette proposition était, au fond, agréable à l'Allemagne. Or, le comte d'Arnim était parti pour Berlin et, quoiqu'il eût annoncé une absence de quinze jours, on ne l'avait plus revu. Les vacances de Pâques touchaient à leur fin. L'année financière avançait. On ne pouvait songer émettre un emprunt de trois milliards à une époque tardive de l'été. D'ailleurs, la présence de l'Assemblée était nécessaire pour voter, le cas échéant, la loi qui approuverait la convention nouvelle modifiant les clauses de la paix de Francfort. M. Thiers commençait à s'étonner. Ayant fait les premières ouvertures, il eût préféré ne pas faire les premiers pas. Je n'ai rien voulu précipiter, écrivait-il lui-même, parce que nous serions exposés, en nous montrant trop pressés, à rendre d'autant moins pressés les contractants adverses ; secondement, parce que le marché financier exigeait du repos. N'entendant parler ni du comte d'Arnim, ni de la suite donnée à ses ouvertures, il se décide, le 11 avril, à prescrire à M. de Gontaut-Biron de reprendre la conversation, à Berlin, avec beaucoup de précautions toutefois : Cette affaire est si grave pour la France, lui écrit-il, elle touche tellement à tout, qu'être renseigné à son sujet est d'une sérieuse importance. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut mettre, sur tout cela, une main fort légère, et être renseigné, sans cependant laisser voir trop d'impatience. M. de Gontaut-Biron dit qu'il était alors un peu novice en diplomatie. Il agit pourtant comme un vrai diplomate : il exagéra si bien la réserve et les précautions que, par crainte de se découvrir trop nettement, il s'en tint à des allusions à peu près incompréhensibles. Il avait le sentiment très vif, trop vif peut-être, de l'espèce de surprise et de méfiance sourde que les procédés fins et hardis de M. Thiers provoquaient à Berlin. On ne lui ménageait pas les avertissements. Les financiers allemands, qui n'avaient pas oublié l'échec de leurs combinaisons de Versailles, venaient, en toute amitié, lui faire des confidences : Il faut que je vous l'avoue (lui dit à l'oreille M. de Bleichœder), M. de Bismarck est fort content de vous voir ici, mais il n'est pas content de M. Thiers. — Et pourquoi donc ? demandai-je. — C'est que M. Thiers augmente dans de fortes proportions l'armée française. Le prince de Bismarck ne voit pas sans inquiétude la réorganisation de votre armée... Il assure que le nouvel effectif dépasse celui de l'empire, ce qui serait contraire aux promesses faites à lui-même, à Versailles, par M. Thiers. C'est le point noir à l'horizon ; le seul peut-être qui préoccupe M. de Bismarck pour le maintien de la paix. Puis, c'était le tour des diplomates neutres, eux aussi assurément bien intentionnés : Le parti militaire, dit l'un d'eux à M. de Gontaut-Biron, reprochera toujours à M. de Bismarck d'avoir lâché Belfort à la France, et il n'a pas renoncé à la pensée de prolonger beaucoup l'occupation, petit-être de la rendre définitive... Il sait bien que les traités s'y opposent ; mais il compte sur quelque imprudence de votre part... Comme on sait que la conservation de Belfort est le point d'honneur particulier de M. Thiers, c'est là qu'on vise : On voudrait bien, ici, garder Belfort... dit-on, toujours en confidence, à notre ambassadeur. Et celui-ci d'écrire, le 16 avril, à M. Thiers : Je vois percer de nouveau l'arrière-pensée de la conservation de Belfort. Enfin, on fait entrer en ligne le maréchal de Moltke. La face glabre exerce sa fascination sur le diplomate, qui aborde de lui-même le sujet : ... Oui, oui, répond M. de Moltke en riant d'un rire amer, M. Thiers s'occupe joliment à refaire votre armée. Au printemps prochain, elle sera en état de recommencer la guerre... Et il s'empresse de calmer lui-même l'émotion qu'il cause en se défendant avec chaleur de désirer un retour des hostilités. M. de Gontaut-Biron, ballotté, à propos de l'attitude du maréchal, entre deux sentiments contraires, en est réduit à se demander si, malgré les allégations qui lui sont transmises de tous côtés, M. de Moltke doit être, oui ou non, rangé parmi les partisans de la guerre[3]. Embarrassé, l'ambassadeur croit plus sage de se tenir coi, ou plutôt il prend le pire des détours, en s'adressant, faute de mieux, à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, le comte d'Arnim, qui prolongeait son séjour à Berlin. Celui-ci est, alors, dans le fort de ses intrigues. Il trouve l'occasion excellente pour se faire de fête des deux côtés à la fois. Il prend le fil ténu que lui passe son collègue français et l'embrouille à plaisir, tandis que M. de Gontaut-Biron, un peu soulagé, écrit à Paris : Je regarde comme une bonne fortune d'avoir eu M. d'Arnim pour interlocuteur. M. Thiers, sans connaître tous les détails, avait compris rapidement (averti, d'ailleurs, par M. de Saint-Vallier, qui, de Nancy, suivait le travail) qu'on perdait du temps et que, du moment où on voulait payer, on n'avait aucun avantage à finasser : il écrit, dès le 14, à M. de Gontaut-Biron : Vous demanderez simplement et franchement à voir M. de Bismarck ; une fois auprès de lui, vous lui direz (ce qui est la chose la plus naturelle du monde) que nous voulons deux choses : nous acquitter et faire cesser l'occupation étrangère, ce qui prouve évidemment notre ardent désir de la paix... Il est déjà trop tard. M. de Gontaut-Biron est entre les mains du comte d'Arnim. Celui-ci est jaloux de la conversation parallèle qui se poursuit à Nancy. Le prince de Bismarck est fantasque et méfiant. Notre ambassadeur, disons le mot, redoute de l'aborder. Il ne demande pas un entretien direct. Il craint que M. de Bismarck, selon sa manière rude, ne l'interpelle sur cette question des armements et de la loi militaire qui est au fond du débat : Le point essentiel, écrit-il le 19 avril, est de savoir si je dois accepter du chancelier de l'empire, ou même de M. Delbrück, l'entretien sur nos armements, qui sont l'objection ou plutôt le prétexte dans les retards apportés à la négociation de notre libération. La négociation s'enlise. Bientôt, M. de Bismarck, abusant de ces lenteurs, et exagérant ses méfiances, plus ou moins sincères, va joindre à ses autres griefs le reproche qu'il fait à M. Thiers d'ajourner les ouvertures au sujet des paiements anticipés. On se boude ; tout est arrêté. M. Thiers est presque résigné à laisser passer l'été. Mais ceci ne fait pas l'affaire de Berlin. Ce qu'on veut, c'est intimider le gouvernement français, peser sur lui, au moment du vole de la loi militaire, tâcher de retarder celle-ci, mais non les versements de l'indemnité. Le comte d'Arnim, revenu à Paris sur ces entrefaites, veut, lui, autre chose ; il veut le renversement de M. Thiers. A son retour, il a vu le maréchal Bazaine. Il sait, par quelques députés qui lui font l'honneur de causer avec lui, que les esprits sont très montés et qu'une crise est prochaine. Il conseille, dans l'intérêt véritable de l'Allemagne, de hâter l'inévitable changement gouvernemental par le rétablissement de l'empire napoléonien... Il s'agit de procéder à la manière de 1814 pour les Bourbons, c'est-à-dire de telle sorte que la présence des troupes allemandes dans le pays donne encore l'occasion d'exercer une influence sur la crise... Il avoue bien qu'il ne sera pas très facile de diriger les événements de façon que l'empire puisse réellement sauter en selle au moment opportun. Seulement, l'empire compte que l'Allemagne lui viendra en aide dans son propre intérêt, et il ne faut pas repousser ses avances, étant, de tous les partis, le seul qui recherche ouvertement l'appui de celle-ci, et inscrive dans son programme la réconciliation avec elle[4]. Ces vues, il est vrai, appartiennent à l'ambassadeur. Elles dépassent de beaucoup la pensée de M. de Bismarck. Celui-ci rappelle son agent, d'un coup sec, à la réalité des choses, et il poursuit sa manœuvre par d'autres voies, puisque celle-ci ne lui est plus ouverte. Le général de Manteuffel et M. de Saint-Vallier entrent en scène de nouveau : c'est par leur canal qu'on désirerait obtenir, de Versailles, des éclaircissements, des engagements, des déclarations au sujet de la loi militaire. M. de Saint-Vallier se rend donc à Versailles, le 17 avril. Il expose les sentiments qu'on lui dit être ceux de Berlin. M. Thiers croit sage d'écrire, le 18 avril, à son ambassadeur, une lettre dont celui-ci n'aura qu'il s'inspirer dans ses entretiens, s'il peut joindre M. de Bismarck. Mais le président ne perd pas un pouce de sa position ; il ne cède ni sur le contingent ni sur le budget de la guerre. il s'explique, voilà tout : Nous voulons la paix, nous devons la vouloir pour notre sûreté extérieure. Le contraire serait, de notre part, de la folie ; à mon âge, je ne puis désirer d'autre gloire, si je puis aspirer à en avoir, que celle de pacifier mon pays, de lui procurer, en un mot, non pas du bruit, mais du bonheur... Quant à nos prétendus armements, ce n'est pas parler la langue française que de les qualifier de ce nom. On fait des armements quand on augmente ses forces, et qu'on les augmente en vue d'une action prochaine. Mais je m'occupe à reconstituer la force militaire de la France, d'après les vues que j'expose depuis quarante ans, et que j'ai toujours qualifiées : pied de paix en France... Je veux une armée, limitée en nombre, mais solide, disciplinée, et aussi capable de maintenir l'ordre au dedans que notre indépendance au dehors... Apparemment qu'on ne nous demandera pas de-renoncer à notre situation dans le monde et à notre indépendance ! Jamais on ne m'a dit un mot qui eût un sens pareil, Versailles, pendant la douloureuse négociation de la paix, ni pendant les négociations de tout genre qui ont suivi. Certes, on doutait que nous pussions tenir nos engagements, payer la somme exorbitante de cinq milliards. On en doutait bien ! nous pouvons. Nous voulons la payer, nous allons la payer. Et on nous chercherait querelle parce que nous voulons reconstituer notre pays moralement, matériellement, politiquement ! Jamais on ne l'avait essayé, jamais pareille insinuation n'avait été tentée, et j'espère bien qu'on ne la tentera pas aujourd'hui ! Au cours d'une conversation qu'il avait eue, dans les premiers jours du mois de mai, avec le comte d'Arnim, M. Thiers s'était exprimé avec sagesse sur les relations présentes et futures de la France et de l'Allemagne. L'ambassadeur rend compte à son gouvernement de cet entretien : M. Thiers m'a dit et répété, dans les termes les plus chaleureux, combien est sincère et ardent son désir de maintenir la paix, une longue paix. La France, a-t-il dit, ne pourrait pas faire une nouvelle guerre. Aussi cherche-t-il à éviter toutes les nouvelles complications, à prévenir tous les conflits, en quelque lieu qu'ils puissent se produire. Après bien des années, a-t-il ajouté, quand la France aura retrouvé ses forces, sa tendance prédominante devrait être nécessairement celle de chercher une compensation pour les pertes subies, et si, un jour, l'Allemagne devait être entraînée dans des embarras avec d'autres puissances, le moment serait venu de régler ces comptes, mais cela ne voudrait pas dire que, dans un cas pareil, la France devrait se lever contre l'Allemagne. Il ne serait pas impossible d'envisager que l'Allemagne, alors, serait disposée à acheter l'alliance française par des compensations qui pourraient rendre une guerre inutile[5]. M. Thiers ne s'en rapporte pas à l'ambassadeur, dont il commence à soupçonner la fidélité. Il croit devoir se servir de la voie officieuse de Nancy pour préciser la situation en ce qui concerne la future loi militaire. M. de Saint-Vallier, qui retourne à son poste, est autorisé à remettre, le 21 avril, au général de Manteuffel un mémoire où sont exposées les vues de M. Thiers sur la reconstitution de l'armée. Le président s'opposera au service obligatoire ; il veut une armée de métier, — la loi de 1832 résolument et fermement appliquée ; — il est certain de l'obtenir. Or, la loi de 1832 n'est pas une loi de guerre ; c'est une loi de bonne organisation intérieure, puisqu'elle limite à 400.000 hommes l'effectif total de l'armée. M. de Saint-Vallier donne même le tableau rapidement tracé du futur état militaire. En résumé, conclut-il, on entend se servir uniquement de la loi de 1832, de l'effectif de cette époque, mais sérieusement entretenu, en évitant de le laisser-tomber au-dessous des proportions votées, comme ou le faisait quand où avait à couvrir les expéditions de Chine ou du Mexique. Voilà la vérité, et rien de plus. Le diplomate, dûment autorisé, insiste, en outre,. sur les
sentiments pacifiques de M. Thiers et sur l'autorité de celui-ci qu'on commençait
à mettre en discussion : M. Thiers n'a jamais varié à ce sujet ; il l'a dit au prince de
Bismarck dès la signature de la paix, il l'a répété depuis dans toutes les
occasions ; il le répète aujourd'hui ; il regarde une paix prolongée comme
nécessaire à la France... Les adversaires de notre
gouvernement lui objecteront qu'il est provisoire
et qu'il peut disparaître du jour au lendemain. Le danger n'est
pas à craindre. L'Assemblée est divisée en fractions dont aucune n'est assez
forte pour prendre et exercer le pouvoir... M. Thiers ne s'appuie ni sur la droite, ni sur
la gauche, mais sur toutes deux également, se servant de l'une pour maintenir
l'autre dans les limites de la sagesse et sachant les grouper et les réunir
quand il y a nécessité. Ou peut donc avoir confiance dans la durée du
gouvernement, comme on peut être assuré de ses résolutions fermement
pacifiques[6]. Le prince de Bismarck reçoit ce mémoire ; il ne se trouve que plus embarrassé. M. Thiers avait terminé sa lettre du 18 avril 1872 à M. de Gontaut-Biron par ce paragraphe, qui renferme son dernier mot : Nous sommes prêts à traiter au jour qu'on voudra et, par conséquent, ce n'est pas à nous qu'il faudra s'en prendre, si, laissant passer le temps de traiter, la saison financière, en un mot, nous étions reculés à six mois... Six mois de retard dans le paiement d'une aussi forte somme, ce n'est pas non plus une perspective faite pour réjouir le cœur du chancelier. Si quelque accident survenait à la traverse, que de reproches, que de regrets ! La discussion de la loi militaire commence à l'Assemblée le 27 mai. Tous les partis étaient à accord loi militaire. pour reconnaître que le système qui avait prévalu sous les régimes antérieurs ne convenait plus aux temps nouveaux. On admettait généralement que tous les Français devaient le service militaire personnel. M. Thiers lui-même est entraîné par le courant et se rend aux raisons de la commission[7] ; malgré l'ardeur de sa conviction, il renonce à défendre le principe de la loi de 1832 et ne discute plus la nécessité d'appeler désormais tous les citoyens valides sous les drapeaux. Mais, le principe une fois reconnu, deux systèmes étaient en présence : les uns préconisaient, dans une forme plus ou moins atténuée, les armées de milices : les autres s'en tenaient, en complétant le service actif par l'instruction et l'appel éventuel des réserves, à l'armée de métier. Depuis les origines de l'histoire de France, les deux systèmes se sont succédé, selon les lois d'une alternance régulière, résultant de la suite des événements. L'armée du Moyen-âge, l'armée féodale était une armée de milices ; le peuple ne devait le service militaire aux seigneurs et au suzerain qu'à des époques prescrites et selon certaines règles exactement déterminées. Mais, quand il advint que le royaume fut en péril, quand la royauté fut obligée de procéder à des campagnes longues et soutenues, cet appel parut inefficace, et on recourut, alors, au procédé des enrôlements et à la constitution d'armées de métier. Routiers, soldiers, gens d'armes, régiments suisses, allemands, albanais, écossais, tels étaient les noms de ces troupes recrutées à prix d'argent et qui alternèrent, au cours de notre histoire militaire, avec les contingents livrés à l'armée par le ban féodal, les francs-archers, les gens des communes, etc. La Révolution avait connu les engagements volontaires et les levées en masse. Le premier empire avait adopté le recrutement par le tirage au sort, qui renfermait, au fond, le principe du service obligatoire. Ce dernier système avait été fortement organisé par la loi Gouvion-Saint-Cyr (1818), et la nation s'était habituée à livrer au gouvernement les éléments d'une armée de métier, recrutée par le tirage au sort ; le temps de service étant de sept ans, la partie la plus riche de la nation s'exonérait de la charge militaire par le remplacement à prix d'argent. Cette inégalité sociale et le sacrifice disproportionné imposé aux hommes qui, après leur congé, étaient pour ainsi dire impropres à la vie civile, étaient compensés, aux yeux des hommes d'État, par la qualité du soldat et la cohésion des régiments et de l'armée. L'armée, organisée par la loi Gouvion-Saint-Cyr modifiée en 1832, avait fait les campagnes d'Afrique, de Crimée, d'Italie. Mais elle n'avait pu supporter la poussée de tout un peuple armé débordant sur la France en 1870, et elle avait succombé à Reichshoffen, à Sedan et à Metz. Les gros bataillons l'avaient emporté. Pour des raisons sociales, pour des raisons politiques, pour des raisons militaires, la France revenait donc, par l'alternative à un système se rapprochant, de celui des milices, le service militaire personnel, égal et obligatoire pour tous. Comme à la fin de la guerre de Cent ans, comme à l'époque révolutionnaire, elle voulait, à la suite d'une nouvelle invasion, avoir, elle aussi, les gros bataillons. Les nécessités financières restreignent forcément l'application du système si simple, répondant à la formule égalitaire : tout le monde conscrit, instruit et soldat. Les finances de l'État ne permettent d'en-[retenir qu'un nombre limité d'hommes, chaque année, sous les drapeaux. Si on prétend enrégimenter tous les-citoyens, il faut les garder peu de temps ; si on veut les-garder plusieurs années pour les instruire, il faut en laisser une quantité correspondante dans leurs foyers.. En somme, la difficulté du problème militaire aux temps modernes se résume en deux questions : Quel est le temps nécessaire pour que le soldat de l'armée active soit instruit, discipliné, entraîné ? Quelles sont les ressources budgétaires dont l'État peut disposer pour entretenir un contingent annuel plus ou moins nombreux et pour le maintenir plus ou moins longtemps. sous les drapeaux ? Selon que l'on se préoccupe de l'un, ou de l'autre des deux points de vue, on se rapproche du type des milices ou du type des armées de métier. En 1872, les deux doctrines étaient en présence. Les uns affirmaient que trois ans suffisent pour former un soldat complet ; ils conseillaient de s'assurer le nombre par la brièveté relative du service ; ils ajoutaient, qu'après un séjour de trois ans à la caserne, le soldat ne peut que prendre le dégoût du métier et l'habitude de la paresse ; ils demandaient qu'on n'imposât pas à la nation une charge trop lourde, si ou voulait qu'elle la supportât. Le général Trochu, le général Billot, le général Guillemaut, le général Chareton, défendaient ces idées. Ils invoquaient notamment l'autorité du général Lamoricière. Leurs adversaires opposaient plusieurs objections très fortes : vous aurez des hommes et peut-être même des hommes instruits, mais vous n'aurez pas de soldats ; ils invoquaient, à leur tour, le mot du maréchal Macdonald : il faut que les soldats d'un même régiment soient, pour ainsi dire, cousus ensemble. Ce résultat, vous ne l'obtiendrez jamais, ajoutaient-ils, avec vos jeunes recrues, auxquelles viendront se joindre, pêle-mêle, au jour du danger, les hommes des différentes réserves. Vous n'aurez, comme soldats, que ces courtauds de boutiques, frais émoulus de comptoir, dont parlait jadis avec tant de mépris le maréchal Villegagnon. D'ailleurs auriez-vous des hommes, que vous n'auriez pas de cadres. Selon la thèse du général Trochu : dans la première aimée, le soldat s'instruit ; dans la seconde année, il se forme, et c'est dans la troisième qu'il est complet... et — ajoutait-on encore — c'est alors que vous le renvoyez ! Comment constituerez-vous le cadre des sous-officiers, que l'organisation même de la vie civile et la grande natalité fournit à l'armée allemande et qui, dans votre système, feront toujours défaut à l'armée française ? Une troupe sans cadres n'est plus qu'un troupeau. Les victoires allemandes menacent de vous imposer la manie des gros bataillons. Vous exagérez la portée de l'exemple de 187o. C'est la seule fois que le nombre l'ait emporté sur la qualité. Tous les autres exemples, tous les avis compétents sont contraires. Les débats durèrent près d'un mois. M. Thiers s'était d'abord, nous l'avons vu, nettement déclaré en faveur de l'année de métier. Devant la commission, il n'avait pas caché ses préférences pour le service de huit ans ou de sept ans dans l'armée active. Le recrutement par l'application du service universel et obligatoire sacrifie la qualité à la quantité, disait-il, c'est une cause de faiblesse plutôt qu'une cause de force pour une armée. Cependant, en raison de l'insistance de la commission, il ne s'était pas opposé absolument au service de cinq ans, qui n'avait été voté, d'ailleurs, dans la commission même, qu'à une voix de majorité. Discussion de la loi militaire. Mais sur le minimum de cinq ans, il ne transigeait pas. Une raison, tout autrement grave, à ses yeux, qu'une pure question de doctrine, le portait à défendre énergiquement cette opinion : au courant, comme il l'était, de l'attitude ou des procédés d'intimidation de la chancellerie et surtout du parti militaire allemands, il voulait être prêt à tout événement. Or, il savait qu'avec le service de trois ans, dans l'éventualité d'une guerre prochaine, l'armée française, composée de jeunes recrues, n'aurait aucune solidité, tandis que le service de cinq ans lui permettrait de garder les deux classes d'hommes faits et de soldats expérimentés, grâce auxquels on pourrait opposer immédiatement, à l'armée allemande, des régiments fortement constitués. La loi de cinq ans, c'était, pour lui, comme il le disait, l'application d'une idée mûrie depuis quarante ans, mais c'était aussi la plus sûre garantie de la paix, dans les circonstances si délicates où la France se trouvait engagée. La discussion va commencer devant l'Assemblée nationale. M. Thiers n'est pas encore intervenu : c'est le moment où les nuages s'accumulent à Berlin, à Nancy, partout où l'on peut avoir quelque jour sur les sentiments du gouvernement allemand. Dans son discours du 4 mai, à propos des marchés de la guerre, le duc d'Audiffret-Pasquier s'était prononcé en faveur du service obligatoire. M. de Rémusat, ministre des affaires étrangères de M. Thiers, exprime lui-même son inquiétude et les dernières résolutions du président dans cette lettre qu'il adresse à M. de Gontaut-Biron : Ce qui n'aura pas rassuré le roi de Prusse, c'est le discours de M. le duc d'Audiffret-Pasquier qui, sous le rapport du talent, a bien mérité son immense succès, mais qui, j'en ai peur, n'est pas aussi prudent qu'éloquent. Il a fait pousser des acclamations en faveur du service obligatoire, et vous savez quels ombrages cause, en Allemagne, ce système, qui, cependant, nous donnerait vraisemblablement une armée plus anarchique que guerrière... Je vous dirai, en toute confidence, que cette question de la réorganisation de l'armée m'a toujours paru la plus critique de toutes, et s'il est un écueil où nous puissions nous briser, je crains que ce soit celui-là[8]. Le comte d'Arnim s'enferme dans une réserve inquiétante. Il demande au président de la République une audience secrète, dans une lettre singulière qui mérite d'être citée : Monsieur le Président, j'ai besoin d'avoir avec vous une petite causerie de conspirateur dont les journaux ne crient pas les détails sur les toits. Si vous pouvez me recevoir, demain, vers midi, je viendrai à Versailles ou en chemin de fer ou à cheval. — P.-S. Pour me donner un air mystérieux, j'entrerai par la porte du côté de M. de Rémusat. M. Thiers, un peu surpris, répond cependant avec beaucoup de sagesse : Nos entrevues sont bien légitimes et même patriotiques, puisque, vous et moi, nous servons notre pays de notre mieux[9]. Pourtant, il reçoit l'ambassadeur à l'heure dite. M. Thiers n'apprend rien que de nouvelles difficultés au sujet des délais des paiements et de l'évacuation, au milieu desquelles il croit démêler des calculs d'hommes d'affaires et de financiers[10]. Le 27 mai, jour de l'ouverture du débat, M. de Saint-Vallier avait, de son côté, reçu l'avis que les dispositions s'aggravaient en Allemagne. M. le général de Manteuffel et M. de Treskovy, stylés par Berlin, lui confirment que leurs nouvelles sont mauvaises, que les méfiances augmentent envers nous, que les suppositions de l'arrière-pensée, chez nous, de recommencer la guerre se multiplient ; on répète que nous n'avons pas fait de propositions sérieuses pour l'anticipation des paiements et que nous cherchons à endormir la vigilance du gouvernement prussien au moyen de fausses négociations ; dans l'entourage de l'empereur, les militaires s'agitent et le souverain est en proie à de graves préoccupations. Et les choses vont ainsi, s'accentuant de jour en jour. Cédant aux instances de M. de Saint-Vallier, dont l'impressionnabilité sert visiblement les desseins du gouvernement allemand, le général de Manteuffel lui fait connaître, en grande confidence, que M. de Moltke lui recommande de prendre des précautions, la probabilité d'une reprise d'hostilités de la part de la France paraissant augmenter. On ajoute que l'armée française est déjà bien plus belle, plus forte et plus redoutable qu'elle ne l'était avant nos revers ; que nous l'augmentons journellement ; que nous faisons revenir, peu à peu, d'Afrique les troupes les plus sûres et les plus éprouvées et que, ces jours derniers encore, deux nouveaux régiments sont arrivés d'Algérie[11]. De Saint-Pétersbourg, même note pessimiste. Le général Le Flô écrit, le 23 mai : Il est certain que tous les rapports des agents russes en Allemagne s'accordent à représenter le parti militaire comme animé des plus mauvaises dispositions et livré à une agitation très hostile contre nous ; il est certain également qu'on exprime publiquement le regret haineux de ne pas nous avoir assez abattus, assez suppliciés et qu'on proclame très haut la nécessité d'une nouvelle guerre... Ce langage a été tenu, ici même, par le prince Guillaume de Bade... Le monde officiel de Saint-Pétersbourg ne croit pas à la bonne volonté de M. de Bismarck de traiter sérieusement avec nous... Le bruit s'est répandu hier à la Bourse que M. d'Oubril (ambassadeur de Russie à Berlin) aurait écrit, à la suite d'un entretien avec M. de Bismarck, que celui-ci aurait dit qu'en raison de l'état des esprits en France, il n'oserait pas garantir une durée de plus de six mois à la paix. Le général Le Flô ajoute : Tout cela me fait regretter que la discussion de notre loi militaire soit aussi prochaine[12]. Le nœud se serre. M. Thiers tient bon. Il a conçu le dessein de faire sentir à l'Assemblée le poids de ses inquiétudes pour la déterminer à accepter son système, mais, d'autre part, de se servir de la discussion engagée pour exprimer franchement sa manière de voir à Berlin. En homme d'État expérimenté, en orateur consommé, il sait qu'une explication publique, quand elle est donnée par un homme maitre de sa parole, est souvent la meilleure manière de résoudre les difficultés et d'éclaircir une atmosphère surchargée. A tout événement, il établit la situation dans la lettre qu'il adresse, en pleine discussion de la loi, à M. de Saint-Vallier, le 29 mai 1872 : Rien de vrai dans ce qu'on écrit de Berlin. Nous ne songeons nullement à la guerre, et la preuve, c'est toujours que nous voulons payer... Nous n'avons fait, dit-on, que des propositions illusoires et sans rien de sérieux. Or, voici ce que nous avons proposé : soit un emprunt de 3 milliards en 5 %, soit un milliard en 5 %, soit un milliard en emprunt avec lots, un milliard en valeurs au trésor de Berlin. On ne nous a pas répondu... On nous objecte maintenant que ces propositions n'étaient pas jugées sérieuses parce que nous n'avions pas dit un mot de l'évacuation... Franchement, ce n'était pas à nous à prendre l'initiative sur ce point. C'était nous qui avions à payer, et les Allemands à évacuer[13]. La discussion avance. Le comte d'Arnim rend compte,
journellement, à Berlin. Dans quel esprit, il est facile de le deviner. Le
même jour, 29 mai, l'ambassadeur faisait insérer dans la Gazette de Cologne
un article, dont il était Fauteur, qui pouvait mettre le feu aux matériaux
inflammables déjà accumulés : Nous vous prions, bons
Français et mauvais politiques, de ne pas vous échauffer... L'état de choses, en vertu des traités, est tel que si la
France payait, par exemple, d'ici au 28 février 1876, 2 milliards 999.999.999
francs, l'armée d'occupation aurait encore le droit d'occuper, pour garantir
le paiement du reste, Reims, Epernay, Toul, Verdun, Nancy, Belfort, etc. Nous
ne savons pas, ainsi que nous l'avons déjà dit, comment le gouvernement
allemand répondra aux propositions du gouvernement français ; mais si, en
réalité, il ne consentait à l'évacuation que si la France s'engageait à ne
pas rassembler d'armée et à ne pas construire de fortifications dans les six
départements à évacuer, s'il se réservait, de plus, le droit d'avoir une
garnison à Belfort, Toul et Verdun jusqu'à ce que le payement fût effectué,
il en est libre. Les Français doivent, avant tout, ne pas oublier que nous ne
sommes obligés à rien[14]. La précision des renseignements et la dureté de la polémique révélaient une origine officielle. M. de Rémusat se trompait gravement, en ne mettant aucunement en doute les sentiments personnels de M. le comte d'Arnim qu'il croyait bienveillants : mais il était autorisé à demander, avec une inquiétude croissante, à ses agents, jusqu'où monterait cette disposition implacable d'hostilité ? A ce moment, M. Thiers, qui garde, au fond, sa belle confiance, veut se montrer plus embarrassé qu'il ne l'est en réalité ; du côté de l'Allemagne, comme du côté de l'Assemblée, il joue le jeu de la démission : J'ai dit plusieurs fois à M. d'Arnim que si, par hasard, j'étais l'obstacle, on n'avait qu'à me l'insinuer et à me le dire, et que je prendrais un prétexte pour me retirer... Grand récri de M. d'Arnim ! Si le gouvernement de M. Thiers s'effondrait, qui eût trouvé, qui eût payé les trois milliards[15] ? Les choses en sont là. L'ambassadeur d'Angleterre vient de faire une dernière confidence à l'oreille de M. de Gontaut-Biron : L'empereur Guillaume est vieux ; il croit au désir de revanche de votre part ; il veut la rendre impossible, en prenant toutes les précautions militaires qui lui paraissent nécessaires, l'agrandissement et l'armement des places fortes de l'Alsace-Lorraine, le maintien de l'occupation de votre territoire, etc., et M. de Gontaut-Biron ajoute, à titre de commentaire : L'adoption du service obligatoire par l'Assemblée est le prétexte mis en avant pour réveiller les appréhensions allemandes. On représente déjà cette mesure comme une preuve de la volonté de la France de se préparer[16]. Dans les cercles militaires, il n'est question que des provocations de la France. C'est toujours la même note, la même menace secrète : on veut obtenir une déclaration de M. Thiers sur la question de nos forces militaires, une promesse formelle pour le rejet du service obligatoire, ou, tout au moins, une remise de la discussion. Pourtant les premières lettres par lesquelles M. Thiers s'est expliqué à l'égard de M. de Gontaut-Biron et l'attitude adoptée par lui sont connues à Berlin. Le président fait la sourde oreille. Il ne cède pas. La discussion se poursuit devant l'Assemblée. Les arguments favorables au service de trois ans paraissent l'emporter. On peut craindre qu'un amendement du général Chareton, proposant le service de quatre ans, ne réunisse la majorité. A Berlin, on sait combien la corde est tendue ; on est en présence d'une résolution prise en France. Veut-on pousser les choses à bout ? Veut-on rompre ? C'est alors qu'une première détente se produit, soudain. Le 7 juin, M. de Thiele, second de M. de Bismarck, dit à l'ambassadeur de France, qui le télégraphie aussitôt à Paris, que le dossier de l'affaire, — il s'agit de l'anticipation sur le paiement de l'indemnité, — précédemment à Varzin, vient d'en revenir avec l'avis du chancelier, que le roi, après avoir réfléchi et avoir annoté cet avis, le renverrait à ce dernier, et que la réponse serait conforme aux désirs de M. Thiers, le débat devant porter seulement sur des détails et sur des modalités. Mon interlocuteur m'a répété deux fois, dit M. de Gontaut-Biron : Vous pouvez avoir confiance[17]. M. de Bleichrœder, le banquier, vient de nouveau à l'ambassade ; celte fois, ses confidences sont en sens inverse de celles qu'il avait faites quinze jours avant. C'est un des Montrond de M. de Bismarck, ajoute l'ambassadeur de France, mais avec moins d'esprit Glue celui de Talleyrand. Cependant son intérêt est en cause. Il affirme que l'affaire marchera et que M. de Bismarck veut s'entendre avec vous. M. de Saint-Vallier en est encore à dénoncer, d'après les confidences calculées de M. de Manteuffel, les combinaisons ténébreuses de M. de Bismarck et les bruits alarmants qui arrivent d'outre-Rhin, que M. Thiers, déjà rassuré, se décide à aborder la tribune et à donner, tout haut, les explications que l'on attend de lui. Il parle le 10 juin. Il parle pour l'Assemblée, il parle pour le pays, il parle aussi pour l'Allemagne. Il réalise son dessein d'employer au succès de ses vues les difficultés mêmes qu'il rencontre de part et d'autre. Il accepte le principe du service militaire obligatoire qui avait tant inquiété l'Allemagne ; mais il repousse le service de trois ans ; il s'en tient à l'armée de métier ; surtout il s'accroche, si j'ose dire, au service de cinq ans dans l'armée active et il ne cache pas ses véritables raisons : C'est bien loin de mon idéal, disait-il ; mais, avec ces cinq ans, nous aurons deux ou trois classes à mettre immédiatement en ligne, et nous pourrons former de bons cadres. Il insiste. Il adjure l'Assemblée. Le service de trois ans a réuni tous les partisans des gros bataillons et ceux des milices ; la majorité possible s'accroît de toutes les défaillances électorales. Le général Trochu couvre de son nom et de son éloquence cette inquiétante coalition. M. Thiers sent le péril et, reprenant, de ce côté, la tactique qui lui a servi du côté de l'Allemagne, il déclare que si le vote n'est pas conforme à ses vues, il est prêt à se retirer. Un trouble immense suit ces paroles. On lui crie de toutes parts : Vous n'en avez pas le droit ; vous ne pouvez pas vous retirer ; la France a besoin de vous. Il répond vivement : Tout le monde est libre ! Je le suis autant que vous et je dois l'être davantage, parce que j'ai une responsabilité écrasante. Si la loi est mauvaise, dans deux ou trois ans, vous aurez le droit de vous en prendre à moi, comme vous avez eu le droit de vous en prendre à ceux qui ont si légèrement déclaré la guerre. Je m'appuie là-dessus et je dis que je sortirai profondément affligé de cette enceinte, si vous ne votez pas les cinq ans. J'ajoute que je ne pourrai pas accepter la responsabilité d'appliquer la loi. L'inquiétude se répand dans l'Assemblée : l'émotion est au comble. Peu à peu, les sentiments de cette foule incertaine cèdent devant la ténacité du vieillard éclairé. On se compte sur l'amendement du général Chareton, qui propose de fixer le temps de service, dans l'armée active tout au moins, à quatre ans. L'amendement est repoussé par 477 voix contre 56 et 172 abstentions. Le service de cinq ans est ensuite adopté. Telle fut cette séance, dont l'effet fut si grand, selon le mot de M. le duc de Broglie, que tous les membres de l'Assemblée qui y assistèrent en garderont le souvenir. M. Thiers, non par une concession à l'Allemagne, comme on prétendit l'insinuer, mais par une juste appréciation de l'utile et du possible, passe entre les écueils et déjoue une manœuvre dangereuse pour l'avenir et l'honneur du pays, tout en imposant ses vues et une bonne loi militaire à l'Assemblée. La nouvelle loi organique militaire fut promulguée le 27 juillet 1872. Elle se résume ainsi : Tout Français doit le service militaire personnel et peut être appelé depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante ans. Le remplacement est supprimé. La substitution de numéros est permise seulement entre frères. La durée totale du service militaire se décompose de la façon suivante : cinq ans dans l'armée active, quatre ans dans la réserve de l'armée active, cinq ans dans la territoriale, six ans dans la réserve de l'armée territoriale. Chaque classe est divisée en deux portions égales, dont l'une reste cinq ans sous les drapeaux et dont l'autre, sans cesser de faire partie de l'armée active, dans les rangs de laquelle elle peut être appelée en cas de guerre, retourne dans ses foyers en congé illimité et y exerce tous les droits civiques : le droit de vote, le droit de contracter mariage... La division entre les deux parties du contingent se fait par la voie du tirage au sort. La loi prévoit un certain nombre de cas de dispense concernant quatre classes de jeunes gens : les soutiens de famille ; ceux qui, dans leur profession, rendent des services importants à l'État et ne pourraient être détournés de leur vocation sans dommage public ; ceux qui se destinent aux professions libérales ; et enfin ceux qui, appartenant aux carrières industrielles, ne pourraient, sans inconvénient grave, être immédiatement éloignés de leur comptoir ou de leur atelier. Les soutiens de famille, les professeurs, les étudiants cri théologie, obtiennent seuls des dispenses proprement dites ; on accorde aux autres, soit des sursis d'appel, qui peuvent être renouvelés d'année en année, jusqu'à rage de vingt-quatre ans, soit la permission de s'engager volontairement avant l'appel de leur classe, pour une durée d'un an. Celte dernière disposition constitue ce que l'on a appelé le volontariat d'un an. Cette faveur n'est pas donnée arbitrairement. Il faut la conquérir, et même la payer. Les engagés volontaires, en effet, produisent un diplôme, un certificat de fin d'études ou passent un examen ; s'équipent à leurs frais et restent une année entière dans un régiment. A l'expiration de leur année de service, ils subissent un examen de sortie et peuvent être retenus au corps pour une nouvelle année, par décision du colonel, si leur instruction militaire est incomplète. L'article 69 stipule que les jeunes gens appelés à faire partie de l'armée reçoivent obligatoirement l'instruction primaire. Ceux qui, à la fin de leur service, ne savent pas lire et écrire, sont retenus au corps pour une nouvelle année. Le vote de la loi, avec le principe du service obligatoire et celui du service de cinq ans dans l'année active, eut, sur les destinées de la France et sur sa situation dans le monde, la plus haute influence. Ce pays, sans martre, sans dynastie, où pourrait presque dire sans gouvernement, s'imposait donc à lui-même une charge si lourde : charge militaire, charge pécuniaire, charge sociale. La nation acceptait cette entrave de cinq ans apportée à l'activité pacifique de chaque génération ; elle s'engageait à faire, aussi longtemps qu'il serait utile, le sacrifice des sommes énormes qu'il fallait prévoir pour refaire l'armée, encadrer les nouvelles troupes actives, les réserves de l'armée territoriale ; elle se soumettait volontairement à la loi de la discipline militaire et à la loi de la discipline sociale qui est la conséquence naturelle de la première. Elle voulait vivre ; elle prétendait reprendre sa place indépendante dans le monde ; elle ne pliait pas la tête devant l'arrêt du destin. Elle avait conscience de son rôle à venir et de sa grandeur nécessaires. Le vote de cette loi entraînait une série d'autres mesures. L'armée suppose l'armement ; la défense nationale exige la création de tout un système de protection, de voies de communication et de dispositions matérielles, réalisé en un temps déterminé, selon un programme préconçu et onéreux. Pour concevoir, arrêter ce programme et en poursuivre méthodiquement l'exécution, il faut un autre genre de décision et une ténacité non moindre. Dès le 29 juillet 1872, le gouvernement institue une commission de défense, présidée par le ministre de la guerre et dont faisaient partie : le maréchal de Mac Mahon, les généraux Forgeot, Susane, de Berckheim ; de Chabaud-Latour, Frossard, Seré de Rivière, Ducrot, Frébault et Chanzy. Réorganisé par un décret en date du 11 juin 1873, ce conseil se livra à un minutieux travail d'enquêtes, d'études et de projets qui devait aboutir, en 1874, à l'adoption du système des rideaux défensifs, c'est-à-dire à la constitution, au nord-est de la France, d'une frontière artificielle. M. Thiers, sans être convaincu de l'excellence de la méthode, s'incline devant l'opinion des hommes du métier. Il s'attache surtout à l'organisation générale de l'armée. Il veille à la prompte mobilisation, par le procédé des formations permanentes qui consiste dans l'existence, préalable à la guerre, non seulement de régiments, mais de corps d'armée. Il apporte tous ses soins à la réfection du matériel, à la création d'une nouvelle artillerie. Le budget de la guerre atteint la somme totale de cinq cents millions. Il groupe les unités régimentaires, les batteries, disséminées auparavant en petites garnisons. Satisfait du système des campements, il crée deux nouveaux camps : celui d'Avor, près de Bourges, et celui du Ruchard, près de Tours. L'ensemble de ces mesures était de nature à impressionner vivement le gouvernement allemand. En ce qui concernait le vote de la loi militaire, on avait supporté ce qu'on n'avait pu empêcher ; on s'était contenté de la défaite que M. Thiers formulait lui-même, dès le 12 juin, dans une lettre à M. de Saint-Vallier : J'ai été obligé de lutter avec la dernière vigueur pour faire repousser le fond du système, et j'ai réussi... On savait bien, à Berlin, que, tout au contraire, le fond du système était adopté et que la loi militaire, qui permettait de reconstituer l'armée française sans qu'elle passât par une crise de transformation et d'affaiblissement, était une bonne loi, et par conséquent une loi dangereuse pour un adversaire éventuel. Aussi, il n'est plus question de cette reprise prochaine des hostilités, dont on avait fait tant de bruit quelques semaines auparavant. On en trouve le dernier écho dans les dépêches de M. de Saint-Vallier, du 3 et du 4 juin : C'est de Berlin que vient le mot d'ordre inquiétant ; toutes les lettres reçues par les officiers qui se trouvent en France sont unanimes à faire envisager la guerre comme probable pour le printemps de 1873... et encore : Le but principal de votre lettre est de savoir si les idées hostiles qui dominent à l'heure actuelle tous les esprits en Allemagne, ont gagné le roi Guillaume et le chancelier. Pour le roi, aucun doute n'est possible... son entourage partage la conviction où il est d'une prochaine reprise de la guerre... Quant au chancelier, inaccessible dans sa retraite de Varzin, il observe les progrès de l'incendie qu'il a certainement ; allumé et qu'il alimente soigneusement[18]. M. Thiers reçoit ces nouvelles si alarmistes au moment où lui arrivent les dépêches de M. de Gontaut-Biron. Il rassure M. de Saint-Vallier en souriant. Il sait, lui, qu'on est en pleine négociation pour l'arrangement qui va déterminer les conditions du versement des trois derniers milliards et pour l'évacuation progressive des départements occupés. De toute cette grande machine diplomatique, si puissamment montée pendant le printemps de l'année 1872, et dont l'action se produisait, en même temps, à Berlin, près de M. de Gontaut-Biron ; à Paris, par M. le comte d'Arnim et, à Nancy, près de M. de Saint-Vallier, il reste un certain travail positif ; on le voit apparaître dans les négociations et s'inscrire dans le texte de la convention par laquelle elles se terminent, le 29 juin. Il ne s'agit plus maintenant de rupture possible, d'hostilités prochaines, d'occupation prolongée et peut-être définitive ; mais seulement de méfiance persistante, avec tout l'attirail des précautions minutieuses et de la mauvaise humeur inutilement affichée. M. de Bismarck ayant pris le parti de toucher le plus rapidement possible les trois milliards, va droit au but. Il précipite le dénouement, et ne voulant rien changer à sa méthode du marché à la main, il fait la moitié de la route pour imposer, d'autre part, ses restrictions. Il accepte le paiement anticipé et n'écarte pas l'idée de l'évacuation corrélative. Mais, alors que le président avait envisagé l'espoir, conforme au texte du traité, de substituer des garanties financières aux garanties territoriales après l'acquittement des deux milliards et par conséquent de faire cesser l'occupation ; alors qu'il avait, du moins, considéré comme assurée l'adoption d'un système d'évacuation graduée et proportionnelle au paiement, on se refuse à le suivre dans ces perspectives, pourtant légitimes et raisonnables. On ne lui concède la possibilité de substituer les garanties financières aux garanties territoriales que comme une faculté toute à la disposition de l'Allemagne ; quant à l'évacuation graduelle, si l'on reconnaît que deux départements seront libérés après le paiement du premier demi-milliard et deux autres après l'acquittement du second, il est indiqué, par contre, que cette évacuation n'amènera pas nécessairement une diminution progressive dans le chiffre de l'armée d'occupation. De sorte que les départements non évacués seront, au fur et à mesure de la libération des autres, accablés d'une charge d'autant plus lourde et plus insupportable. Cette condition était une 'aggravation inutile et même dangereuse ; elle devait donner lieu, par la suite, aux difficultés les plus sérieuses ; elle indiquait, officiellement, la menace, qu'on ne se faisait pas faute de répandre par les voies indirectes, d'une occupation prolongée de ces malheureuses régions et celle, plus précise encore, et plus irritante pour M. Thiers, de la non-exécution possible du traité de paix en ce qui concernait Belfort. C'est sur ce point que les inquiétudes du président furent le plus vives ; il les exprima à M. de Rémusat qui, d'ailleurs, les partageait : Une question formidable pourra s'élever, dans un an ou deux, lui dis-je. Une indignité pareille au refus de l'Angleterre de nous rendre Malte sera peut-être tentée au sujet de Belfort. Je ne crois pas qu'on ose le faire à la face de l'Europe. Néanmoins, il faut tout prévoir, et je ne pourrais pas, quant à moi, accepter cette félonie, si nos vainqueurs voulaient l'imposer. — Je ne l'accepterais pas non plus, me répondit M. de Rémusat. — La France seule, repris-je, aura le droit de décider la question. Tout ce que nous pouvons faire est de la mettre, dès aujourd'hui, en état d'y répondre autrement que par la résignation. — Je fis part de nos préoccupations au ministre de la guerre et, dans le plus grand secret, nous prîmes ensemble les mesures commandées par la situation. Peu de temps après, nous avions la certitude que, dès 1873, la France pourrait faire respecter les traités, si on voulait les violer[19]. C'est au milieu de ces difficultés que fut signée, à Paris, par le comte d'Arnim et M. de Rémusat, cette convention du 29 juin 1872, qui était, en fait, le premier acte d'une grande œuvre, celle de la libération. Le public français ignorait tout. Aussi, en prenant connaissance du texte d'un accord qui eût dû lui causer une grande joie, il fut frappé surtout des réserves et des restrictions. Il n'éprouva qu'une profonde déception. La convention, soumise à l'Assemblée le 2 juillet, fut votée immédiatement (7 juillet), sur le rapport du duc de Broglie, par une unanimité triste et silencieuse. Chacune de ces négociations était, peut-être, un triomphe pour l'art à la fois raffiné et rude de M. de Bismarck, mais un succès moindre, au point de vue supérieur de la stabilité européenne. III Mesures La convention du 29 juin n'était pas encore votée, que le gouvernement et l'Assemblée s'étaient mis en mesure de faire face aux charges que le paiement du solde de l'indemnité et l'émission d'un très lourd emprunt allaient faire peser sur le budget. On était loin d'être sorti de peine, en ce qui concernait la liquidation du passé et l'établissement de l'équilibre financier. Les nouveaux impôts votés antérieurement donnaient lieu à de graves mécomptes. D'autre part, les dépenses dépassaient singulièrement les prévisions. L'œuvre avait été trop hâtive. Le budget demandait de sérieuses améliorations et, sur certains points, des remaniements ; en tout cas, le déficit n'était pas comblé. Aussi, la Chambre, après avoir voté, à la suite de discussions très vives, une loi sur le conseil d'État qui ne devait avoir qu'une durée éphémère et qui attribuait à l'Assemblée elle-même la nomination des membres du conseil, fait marcher de front, dans ses bureaux et en séance publique, pendant l'hiver de 1872-1873, le double travail de la préparation du budget de 1873 et des réformes financières jugées indispensables. Le projet de budget de 1873 avait été déposé, le 14 mai 1872, par le nouveau ministre des finances, M. de Goulard, successeur de M. Pouyer-Quertier. Il fallait, de toute nécessité, accroître de 191 millions le montant des recettes. Après divers remaniements, la balance devait s'établir par les totaux suivants : 2 milliards 365.677.869 francs pour les dépenses, et 2 milliards 476.470.63o pour les recettes, ce qui supposait un excédent de recettes de Lw millions de francs. On sut, plus tard, par la loi du règlement des comptes, que le total des dépenses fut en réalité de 2 milliards 724.482.658 francs, tandis que les recettes ne montèrent qu'à 2 milliards 447.060.176 francs, d'où un déficit de 277.422.482 francs, auquel il fallut subvenir par le reliquat de l'emprunt de 3 milliards. On ne se faisait pas grande illusion sur les chances d'obtenir l'équilibre financier que l'on recherchait. Mais le gouvernement et l'Assemblée ne s'en consacraient pas moins à cette tâche difficile, avec une grande application et une parfaite loyauté. On voulait, avant tout, libérer la France et faire honneur à ses engagements. Deux cents millions d'impôts nouveaux paraissent nécessaires : on les recherche, soit en remaniant les anciens impôts, soit en reprenant l'examen des combinaisons déjà adoptées ou rejetées. M. Thiers tient toujours en suspens l'impôt sur les matières premières, dont il évalue le rendement à 93 millions. Les propositions diverses relatives à l'impôt sur le revenu, repoussées antérieurement, laissent une trace dans le budget de 1873 : c'est la création d'une taxe, d'ailleurs sans avenir, sur l'intérêt des créances hypothécaires, et surtout d'une taxe annuelle de 3 °/„ sur le revenu des valeurs mobilières. La rente française et les emprunts d'État étrangers furent exemptés de cette taxe. M. Thiers avait dit, en parlant de la rente française : Si l'État commettait la faute de l'imposer, il se punirait lui-même, car lorsqu'il aura recours au crédit, on lui ferait payer le capital plus cher. Cette parole était vraie, surtout à la veille du jour où on allait émettre les emprunts les plus formidables que l'histoire financière eût jamais connus. L'Assemblée écarte une quantité de propositions, notamment l'impôt sur le chiffre des affaires et, un projet de surtaxe sur le sel, mais elle ajoute Go centimes additionnels au principal de la contribution des patentes ; si elle n'adopte pas un relèvement du droit des alcools, elle réprime sévèrement la fraude et soumet les bouilleurs de cru à l'exercice : la perte de ce chef, pour le trésor, était évaluée à 50 ou 60 millions. On constitue le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes (loi du 2 août 1872). L'Assemblée croyait trouver une source d'économies importantes dans la révision des services administratifs : il s'agissait de la fameuse diminution, toujours annoncée, du nombre et des traitements des fonctionnaires. Une commission parlementaire avait été chargée d'examiner attentivement les budgets spéciaux de chacun des départements ministériels. S'inspirant des travaux de cette commission, la commission du budget avait réduit de 21 millions les crédits demandés par le gouvernement. Mais les Chambres, en France, auront toujours l'âme tendre pour les administrations ; en fait, il y a réciprocité de services. Malgré l'exceptionnelle gravité des circonstances, l'Assemblée nationale, au lieu de 21 millions qui lui sont proposés, ne consent que 12 millions de réductions. Finalement, il faut en venir à l'impôt des matières premières. Le président de la République le réclame toujours avec la même insistance. On a pris, auprès de lui, un engagement. D'ailleurs, on ne veut pas laisser le budget en déficit, du moins apparent. Sans que l'Assemblée se fasse une grande illusion sur la
portée de ce vote, — et, en effet, les résultats obtenus par la suite ne
parurent pas justifier l'insistance de M. Thiers, — la loi du 26 juillet 1872
établit des tarifs nouveaux sur 538 articles. Le
gouvernement à l'origine avait proposé des droits de 10 à 20 %, remboursables
à l'exportation ; la commission du budget de 1871 les avait réduits à 3 %,
sans restitution à la sortie. L'Assemblée nationale adopte un système mixte :
à quelques articles, la loi du 26 juillet 1872 applique des taxes élevées,
avec drawback ; d'au, Ires articles, les plus nombreux, furent assujettis à
de faibles droits, non restituables à l'exportation[20]. Les 93 millions que cette ressource devait produire, d'après les prévisions très optimistes du gouvernement, furent inscrits aux recettes pour 1873. Complété par un certain nombre de mesures et de lois nouvelles, qui furent discutées et votées dans la session d'automne et avant le 1er janvier 1873, le budget paraissait clone en équilibre ; il assurait même les ressources nécessaires pour gager le grand emprunt qui allait être émis. Ces écritures, il faut le reconnaître, étaient en partie fictives. On tablait sur des prévisions de recettes dont la réalisation n'était rien moins qu'assurée. Mais il était impossible d'agir autrement. Ou ne pouvait procéder que par tâtonnements. La bonne foi et la bonne volonté du gouvernement, du pays et de l'Assemblée étaient indiscutables. On allait d'un même élan vers le même objectif qui se rapprochait chaque jour, par l'emprunt à l'acquittement, par l'acquittement à la libération. La convention du 29 juin 1872 contenait les clauses suivantes : La France s'engageait à payer en quatre termes : 1° un demi-milliard de francs deux mois après la ratification de la convention par l'Assemblée nationale ; un demi-milliard de francs au 1er février 1873 ; 2° un milliard le 1er mars 1874, et un milliard le 1er mars 1875. Par contre, l'Allemagne devait évacuer les deux départements de la Marne et de la Haute-Marne quinze jours après le paiement d'un demi-milliard ; les départements des Ardennes et des Vosges quinze jours après le paiement du second milliard ; enfin, les départements de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'arrondissement de Belfort, quinze jours après le paiement du troisième milliard et des intérêts. Le gouvernement français n'avait qu'un désir : hâter la mesure qui délivrerait nos départements de l'Est. Une plainte universelle 's'élevait du territoire envahi. On pouvait toujours craindre qu'un incident remit tout en question. Il fallait donc faire appel de nouveau au crédit ; on résolut de demander, en une seule fois, au public les trois milliards nécessaires. Jamais une opération financière aussi vaste n'avait été tentée. Et cette opération se doublait d'une autre non moins importante : celle du déplacement de cette somme qui devait, d'un mouvement continu, se transporter des caisses particulières dans celles du trésor français et, de celles-ci, dans les caisses de l'État allemand, sans provoquer une crise financière ou monétaire qui eût compromis l'ensemble de ce prodigieux mouvement. La préparation et le lancement d'un aussi puissant appareil exigeaient un calcul vaste et minutieux à la fois, prévoyant tous les détails et laissant même une certaine place à l'imprévu. La machine fut mise en branle, le 11 juillet 1872, par
l'acte de M. de Goulard, ministre des finances, déposant, sur le bureau de
l'Assemblée, le projet de loi autorisant le gouvernement à faire inscrire sur le grand-livre de la dette publique
et à aliéner la somme de rentes 5 % nécessaire pour produire un capital de trois
milliards. Dans ce chiffre n'étaient pas compris les fonds destinés à
payer les arrérages à échoir en 1872 et 1873 et à couvrir les dépenses
matérielles de l'opération. Il s'agissait, au total, de 3 milliards 500
millions (exactement 3.498.744.639 francs). La loi fut votée dans la séance du 15 juillet. Pour la forme et les modalités de l'emprunt, l'Assemblée s'en remit au gouvernement ; elle ne voulait pas troubler, par le moindre dérangement, l'œuvre énorme qui s'accomplissait. Elle n'accueillit même pas une proposition de M. Henri Germain qui indiquait une singulière confiance dans le crédit de la France et dans la richesse des particuliers, et qui avait pour objet d'accorder l'irréductibilité à tout souscripteur qui opérerait, d'un seul coup, le versement intégral de la somme souscrite. Cet amendement eût eu pour effet de déjouer la spéculation. Et, en effet, le reproche que l'on peut taire à l'emprunt de trois milliards, tel qu'il a été conçu et réalisé par M. Thiers et par ses ministres, c'est qu'il mettait en jeu et provoquait au gain la spéculation du monde entier. Un décret et un arrêté du 20 juillet 1872 déterminèrent les conditions de l'emprunt : il était émis, par voie de souscription publique, au taux de 84 fr. 50 ; la souscription devait avoir lieu le 28 juillet ; le paiement s'effectuait par un versement de 14 fr. 5o pour 5 francs de rente au moment de la répartition et par vingt paiements mensuels, dont le dernier devait être effectué le 11 avril 1874. La somme totale demandée au public étant de 3 milliards 498 millions, la rente inscrite au grand-livre étant de 207 millions de francs, la dette nominale que souscrivait la France était de 4 milliards 140 millions. Le taux d'intérêt auquel revenait l'emprunt était de 5,91 %. Les frais de l'émission de l'opération elle-même ont été évalués à 145 millions de francs, si bien que, tout compte fait, le taux de l'intérêt n'est pas moindre de 6,17 %. Dans ces conditions, le succès était assuré. Il fut colossal. L'emprunt fut couvert plus de treize fois. Le nombre des souscripteurs fut de 934.276. Les souscriptions s'élevèrent à 2 milliards 592.000 francs en rentes, et à 43 milliards 9oo millions en capital. L'État français refusa 4o milliards ; les 3 milliards 5oo millions furent payés, bien entendu, soit par anticipation pour des sommes importantes, soit aux termes convenus, sans la moindre difficulté. Le surlendemain de l'émission, le nouveau 5 1u s'avança de quatre points et l'emprunt libéré fut plus recherché Glue l'emprunt non libéré, tant il était évident que l'argent abondait et que le crédit de la France était intact. Sur l'ensemble de la souscription, la part de l'étranger fut légèrement supérieure au chiffre de la souscription française. Quand M. de Goulard vint, avec beaucoup de simplicité, fournir ces chiffres à l'Assemblée, ce fut une joie universelle. Il semblait que la France se sentit délivrée de l'obsession de la guerre et eût échappé à la fatalité qui, depuis deux ans, pesait sur elle. Il y eut une sorte d'explosion, qui donna à un peuple, aussi facile à l'espoir qu'au découragement, un élan nouveau et une confiance ferme en l'avenir. L'art de M. Thiers avait beaucoup fait pour obtenir ce succès. Citant un mot de Bossuet, il dit qu'il avait ôté à la fortune tout ce qu'on pouvait lui ôter par conseil ; il eût dû ajouter par argent. L'emprunt eût pu être émis à un prix beaucoup plus élevé, peut-être à 87, peut-être à 89 francs ; on dit pu restreindre le bénéfice de la souscription aux seuls souscripteurs français, en laissant une latitude moindre aux conditions de versement ou en assurant, comme le voulait M. Henri Germain, l'irréductibilité aux souscripteurs qui procéderaient immédiatement au versement intégral. En adoptant les conditions très avantageuses pour la banque qui furent déterminées par le décret du 30 juillet, le gouvernement prit sur lui d'ajouter une surcharge sensible au fardeau qui allait peser sur le contribuable français. L'emprunt revint rapidement se placer en France, en laissant, aux mains des souscripteurs étrangers, un bénéfice très appréciable. Même en tenant compte de la ressource de conversions éventuelles, il n'en est pas moins vrai que si l'opération, dans son ensemble, était brillante, elle était onéreuse. M. Thiers et son gouvernement pouvaient répondre d'un mot il ces objections : Avant tout, il fallait réussir ; avant tout, il fallait éviter une crise financière ; avant tout, il fallait craindre de compromettre l'opération en rétrécissant sa base. Étant si vaste, si hardie, si incertaine et si nouvelle, ce n'était pas trop que le concours non seulement, du capital, mais du crédit et de la confiance du monde entier. Modalité D'ailleurs, la souscription de l'emprunt n'était, qu'une première partie de l'affaire. La mobilisation des capitaux et leur mise en marche vers l'Allemagne ne présentaient pas une difficulté moindre : Un tel fait, comme l'a dit M. Léon Say, ne devient en quelque sorte probable que par sa réalisation. Un moment on put craindre que les appréhensions qu'on avait eues ne se réalisassent : en janvier 1872, l'encaisse de la Banque de France était tombée à 630 millions. Heureusement, de ce côté encore, les précautions étaient prises. La loi même qui avait autorisé l'emprunt avait, porté, de deux milliards trois cents millions, à trois milliards deux cents millions la limite d'émission des billets de ln Banque. Aussi, l'encaisse reprit bientôt une marche ascendante ; elle était, au 18 décembre 1872, de 790 millions. Au point de vue des versements à effectuer, M. Thiers avait pris également toutes ses précautions. Le 27 juillet, veille de la souscription de l'emprunt, il signa un contrat par lequel cinquante-cinq des plus grandes maisons de banque de l'Europe garantissaient la souscription de l'emprunt et s'engageaient, de plus, à mettre à la disposition du gouvernement français 700 millions de change pour les paiements à faire à l'Allemagne. Les deux opérations, emprunt et versement, étaient ainsi intimement jointes. Le monde financier international avait un intérêt extrême à seconder l'œuvre de la libération. Les maisons de banque de toutes les places importantes devenaient, pour la France, des rabatteurs de lettres de change et les propagateurs de son crédit. M. Thiers créa, comme nous l'avons dit, des agences spéciales à Londres, à Bruxelles, à Amsterdam, à Hambourg, à Francfort, à Berlin. Partout, un immense trafic de papier se fil, au nom de la France ; des frais énormes et des difficultés presque insurmontables furent ainsi évités. L'agence de Londres, dirigée par M. de Maintenant, eut souvent, à elle seule, en portefeuille, 15o millions et même plus. Pour donner l'idée de la complexité de l'œuvre ainsi accomplie en moins de vingt-six mois et qui porta sur la somme totale de cinq milliards 315 millions, il est bon de jeter un coup d'œil sur le tableau des valeurs de diverse nature qui furent recueillies, par toute l'Europe, pour produire le total de la rançon. Le voici, d'après les documents officiels[21] :
Que chaque citoyen français ait toujours sous les Feus la somme énorme de la dette qui, sous différentes formes, fut contractée par la France pour les dépenses extraordinaires de la guerre, de 1870 à 1872 : Dix milliards cinq cent cinquante millions ! Telle est la charge qui, rien que du fait des emprunts suite de la guerre de 1870, pèse sur la fortune de la France, sur la liberté de la France, sur la fortune, sur l'indépendance de chaque citoyen. Et, depuis trente ans, cette dette n'est pas allégée, au contraire. Les conversions successives ont encore accru le capital. La dette de la guerre ne se règle pas. Malgré une richesse croissante, la génération qui a vu ces événements et les générations qui se sont succédé transportent le fardeau, avec le devoir de l'acquittement, à leurs successeurs. On fut très fier, en 1871 et 1872, du succès des deux emprunts : on pourrait être plus fier si, après trente ans, ils étaient soldés. IV Pendant cette session si laborieuse d'avril-août 1872, la situation de M. Thiers est à la fois très haute et très périlleuse. Dans le même mois, il rend trois grands services simultanés : vote de la loi militaire, convention d'évacuation, emprunt de libération Situation de En outre, il dirige l'Assemblée et se consacre, avec une ardeur juvénile, à l'ingrat travail parlementaire. Il a su reconnaître le courant qui pousse le pays vers les institutions républicaines, et il le suit prudemment. Souvent., il a raison contre tout le monde ; mais, souvent aussi, il lui arrive d'abuser de sa clairvoyance, de son autorité, de ses services mêmes. Il se juge seul capable d'administrer, de gouverner et d'expliquer son gouvernement. Il se renferme dans cette formule : La République conservatrice, et il n'en sort guère. S'il a des mérites, — mérites exceptionnels, — il a aussi ses défaillances, ses entêtements, ses habiletés trop visiblement intéressées. Il s'est trompé sur la loi des matières premières ; il a dû céder dans la discussion de la loi militaire. Et puis, il avait toujours à la bouche ce mot de démission ; c'était un jeu au début, mais qui devenait dangereux à la fin. On commençait à admettre qu'il partirait un beau jour, sur un coup de tête, laissant tout en plan. Il se croyait vraiment un peu trop indispensable. Il le montrait trop. On n'aime pas les supériorités trop évidentes et, surtout, trop exigeantes. D'ailleurs, s'il faut des prétextes, il est toujours permis de dire qu'un pays a besoin de lendemains assurés. M. Thiers était vaillant, vigoureux, infatigable certes, mais il était vieux, et à la merci d'un courant d'air. Parfois il se disait malade ; parfois il l'était tout de bon, le teint jaune, les yeux pâles. S'il venait à mourir ?... Il écartait, lui, cette hypothèse. Il disait que le pays était thiériste. Il se demandait quel inconvénient il pouvait y avoir à ce que la France continuât de vivre sous la dictature de la capacité. Il trouvait stupides les résistances de l'Assemblée. Elles étaient souvent fondées. Au fur et à mesure que le passé disparaissait, s'effaçait, la préoccupation de l'avenir s'imposait plus forte. Ce n'étaient pas seulement lés intérêts et les ambitions qui étaient à l'affût, c'étaient les convictions et le patriotisme qui étaient en éveil. Ou ne pouvait pas vivre indéfiniment sans autre abri que les formules successivement inventées et substituées l'une à l'autre par la féconde habileté de M. Thiers : le pacte de Bordeaux, l'essai loyal, la République conservatrice. Les républicains entendaient bien que cette dernière expression voulait dire la République sans épithète, et M. Gambetta s'écriait bruyamment : Non, Messieurs, il n'y a pas deux Républiques ; il n'y en a qu'une !... Ces mots sont passagers... Mais les monarchistes aussi ne le savaient que trop. Tartuffe, disait l'un d'entre eux, s'appelle, aujourd'hui, républicain conservateur. On les menait donc, les mains liées, les yeux bandés, vers la République définitive, par le détour du provisoire que M. Thiers prolongeait si complaisamment. Il faut indiquer les raisons qui portaient beaucoup de
bons esprits, d'âmes honnêtes et d'intelligences éclairées à s'arrêter sur la
pente où les entrainait l'optimisme ardent et personnel de M. Thiers, poussé
par la volonté de plus en plus déclarée du pays. Je
n'ai pas de parti pris contre la forme républicaine, disait l'un d'eux à
cette époque ; j'ai même été républicain, à mon heure ; je sais qu'il y a,
dans la signification de ce mot (res publica),
un puissant attrait ; mais la voix du bon sens, ajoutait-il, me cric chaque
jour plus haut que nous ne sommes ni assez vertueux, ni assez soumis à la loi
divine, ni assez désintéressés, ni assez tempérants, pour garder, dans sa
pureté, la doctrine gouvernementale qui, en principe, devrait donner le
pouvoir au plus digne, qui, en pratique, le livrera toujours au plus remuant
et au plus audacieux... Comment ne pas
remarquer, disait encore ce monarchiste, que la République, toujours
intronisée par des coups de force, n'a jamais pu se maintenir quelque temps
que par la dictature ? Comment ne pas voir que c'est son impuissance à donner
l'ordre, à rassurer tous les intérêts, qui l'a toujours fait fatalement
aboutir au despotisme ? Comment ne pas se souvenir que le triomphe de la
République a toujours été le signal de l'insulte ou de la persécution de la
foi religieuse ? De sorte que tous ceux qui aiment la liberté et l'ordre,
ceux qui mettent avant tout le bien de leur âme, doivent se détourner comme
d'un mirage dangereux des séduisants aspects de la République[22]. Cette appréciation était passionnée, mais sincère. Elle était dictée, ainsi que toute la conduite qui en résultait, par une foi religieuse exclusive. Le marquis de Dampierre, qui tenait ce langage, comptait, en somme, parmi les raisonnables, les politiques du parti. Il était de ceux qui s'étaient ralliés franchement au drapeau tricolore. Il savait tenir tête à son Roi. Animé de pareilles convictions, tout le parti qu'il représentait, et ait nom duquel il prit la parole dans plus d'une circonstance décisive, se consacra avec une obstination désespérée à la restauration du régime monarchique. Des volontés non moins sincères, non moins vives, s'efforçaient d'arracher la République au provisoire pour la fonder définitivement. Aux yeux de ceux qui partageaient ce sentiment, la République était la forme politique à laquelle la France aboutissait par l'évolution naturelle des siècles. Le peuple voulait se gouverner lui-même. Il était capable de le faire. Pourquoi retarder l'époque où il assumerait la responsabilité de ses actes et la direction de ses destinées ? L'évolution se faisait chez les esprits les plus sages, longtemps indécis, tant le dégoût de l'incertitude commençait à se répandre. Le centre gauche recrutait des adhésions de plus en plus nombreuses. Ces partisans nouveaux de la République considéraient que la monarchie étant impossible, en raison des circonstances et par suite de la volonté même des princes, le mieux était de prendre parti et d'organiser les institutions, sans se laisser forcer la main par les événements ou par le pays. On n'était pas, au fond, si assuré des pouvoirs souverains de l'Assemblée. La campagne de M. Gambetta ébranlait même ses adversaires. Comme le dit fort justement M. de Meaux, une équivoque subsistait dans les esprits : Nous avions été nommés, avant tout, pour faire la paix ; l'horreur de la guerre avait décidé de notre élection... Nous n'avions pas encore appris à nous défier du suffrage universel... Nous ne nous rendions pas compte que les dispositions du pays étaient changées. Dès le début de la session, le centre gauche avait jugé l'heure venue de se prononcer. Par l'organe respecté du général Chanzy, il avait formulé une adhésion sans réserve aux institutions républicaines. Nommé président du groupe, celui-ci disait, le 12 mai : Je n'ai pas eu, comme vous, le privilège d'arriver à l'Assemblée avec une foi politique toute faite... Rien ne me forçait, au début, à afficher des idées que je ne pouvais sérieusement avoir, à me dire d'un parti que je ne pouvais connaître. J'ai di attendre qu'une conviction décidât ma résolution. J'avais été frappé, tout d'abord, par ce fait qu'aucun des partis qui rêvent la restauration du passé n'avait osé la tenter au seul moment opportun, celui où les représentants du pays, réunis à Bordeaux, se trouvaient en face des difficultés, des dangers mêmes de la situation terrible qui existait alors... Il ne me paraissait ni admissible, ni équitable, de laisser à la République le lourd fardeau de ces grandes mesures, en l'empêchant de montrer ce qu'elle peut pour le pays... Qui peut nier, avant d'en avoir fait franchement l'essai, que dans la forme républicaine n'est pas le salut ?... Nous acceptons donc franchement, dans le fond et dans la forme, la République puisqu'elle existe de fait, parce que nous sentons tous que, dans les conditions où se trouve la France, c'est la seule forme de gouvernement possible et que le provisoire serait la faiblesse et l'impuissance, alors qu'il nous. faut vouloir et produire... Ces paroles graves et sincères avaient, dans le pays, un immense retentissement. Chaque fois que le suffrage universel était consulté, il confirmait les votes qui s'étaient succédé depuis la paix ; aux élections, les monarchistes n'osaient plus que rarement déployer leur drapeau. Le 9 juin 1872, des élections partielles eurent lieu dans le Nord, la Somme, l'Yonne et la Corse. Ce dernier département réélut M. Abbatucci, qui avait abandonné son premier siège pour faire place à M. Roulier. Les trois autres départements élurent des radicaux : M. Barni, M. Derégnaucourt qui avait été invalidé, et M. Paul Bert. Ce dernier nom paraissait terrible à la droite et an parti catholique. Les succès répétés des bonapartistes n'étaient pas moins inquiétants : Voilà ce que c'est que de ne pas proclamer la République, l'empire reviendra, disaient les uns. Voyez ce qu'il en coûte de ne pas restaurer la dynastie légitime, l'empire est fait, clamaient les autres. De cet ensemble d'impressions naquit, chez certains membres de la droite, une pensée nouvelle, et qui marquait un premier pas, très hésitant, dans le sens de l'acceptation des faits. Pour parer aux dangers du radicalisme, on tente ce qu'on a appelé la conjonction des centres. On songe à former un grand parti conservateur libéral qui soutiendrait M. Thiers, le contiendrait au besoin, et, en lui offrant la perspective brillante d'une majorité stable, le détacherait complètement de la gauche. Il y avait, dans ce programme, de la résignation, de la sagesse et quelque machiavélisme. Pénétré de l'impuissance où le plaçait son isolement et rejeté de la droite par les manifestations ultramontaines, par l'insuccès des tentatives de fusion et par l'affirmation du drapeau blanc, le centre droit cherche à se rapprocher du centre gauche. La tentative avait été concertée entre M. Saint-Marc Girardin, président du centre droit, et le duc de Broglie, qui avait donné sa démission d'ambassadeur de France à Londres, afin de prendre, à l'Assemblée nationale, la direction de la politique de la droite[23]. Le duc d'Audiffret-Pasquier se charge de négocier avec le général Chanzy, président du centre gauche, les conditions de l'alliance projetée. Il expose que la politique de M. Thiers n'est pas suffisamment conservatrice, que son manque de fermeté donne de la force aux idées radicales ; si les deux groupes se réunissent, ils obtiendront du gouvernement qu'il accentue sa politique dans le sens conservateur. Le général Chanzy fut très catégorique dans sa réponse : Si le centre droit, dit-il, est résolu, sans arrière-pensée, à soutenir le gouvernement de la République et à travailler à son affermissement dans le pays, le centre gauche ne demandera pas mieux que de donner son concours à une campagne conservatrice contre les radicaux. Si, au contraire, les espérances monarchiques ne sont pas définitivement abandonnées, il ne faut pas compter sur notre appui. La fertile imagination des politiques du centre droit ne se décourage pas. Repoussé par le centre gauche, il renouvelle ses tentatives du côté de la droite pure. On ne parlera pas de ce qui divise, c'est-à-dire des projets de restauration monarchique, mais seulement de ce qui unit, c'est-à-dire des principes conservateurs. On confie les intérêts du grand parti conservateur à une délégation composée de MM. d'Audiffret-Pasquier, Saint-Marc Girardin, de Broglie, Batbie, Depeyre, de Kerdrel, de Cumont et de La Rochefoucauld. Le général Changarnier se joint bénévolement à cet état-major qu'on appela le conseil des neuf. Celui-ci se montre ému des élections radicales du 9 juin, de la seconde menace faite, le 10 juin, par M. Thiers de donner sa démission à propos de la discussion de la loi militaire. Après avoir examiné la proposition faite par le vicomte d'Haussonville, dans une lettre au Journal des Débats, d'interpeller le gouvernement sur sa politique, il décide de faire auprès de M. Thiers une démarche solennelle. On vient de franchir le cap de la loi militaire. La convention avec l'Allemagne est sur le point d'être signée. L'heure est favorable. Il faut sommer M. Thiers et lui notifier en quelque sorte un ultimatum au nom de la majorité. Le 20 juin 1879, le conseil des neuf se rend à l'hôtel de la Préfecture, à Versailles, affecté à la résidence du président de la République. M. Thiers, qui recevait une députation des membres du synode national protestant, fit attendre assez longtemps les délégués de la droite ; enfin, ceux-ci furent introduits. M. Thiers les reçoit avec affabilité, fait placer son vieil et illustre ami, le général Changarnier, à ses côtés, et s'informe, avec intérêt, du but de la visite de ses chers amis. Le général Changarnier prend le premier la parole. Il parle d'un ton doucereux. Il dit que ses amis et lui sont pleins de déférence pour M. Thiers. Il rappelle qu'ils sont ses plus anciens amis ; son nom était porté sur leurs listes quand vingt-six départements l'ont élu, le 8 février 1871. S'autorisant maintenant de ces anciennes sympathies, ils viennent vers le président pour lui exposer leurs craintes en ce qui concerne l'avenir du pays ; le radicalisme fait de tels progrès qu'on peut appréhender son prochain triomphe. Quelle est la cause du mal ? Le manque d'unité dans la direction gouvernementale. On a vécu jusqu'ici sur une confusion qui ne peut se prolonger plus longtemps. On s'appuie sur tous les partis : donc on les ménage tous. Le ministère n'est pas homogène ; l'administration obéit à des impulsions diverses ; enfin, M. Thiers, contrairement au pacte de Bordeaux, marque ses préférences pour la République. Comme conclusion, les délégués, qui prennent successivement, la parole, adjurent le président de la République de s'appuyer sur la majorité qu'ils représentent et de former, avec elle, un ministère résolu à combattre à outrance le radicalisme. M. Thiers écoute les doléances des délégués avec la plus grande attention, les mains appuyées sur les genoux, les yeux mi-clos, baissés vers le tapis. Au moment de répondre, il relève lentement la tête, sourit et s'étonne, tout d'abord, qu'on l'accuse d'être infidèle à sa mission conservatrice. Il est aussi conservateur que jamais, plus conservateur, dit-il, que la majorité de l'Assemblée, et il rappelle que le ministère, formé cependant de républicains et de monarchistes, a triomphé de la Commune. Il se demande, d'ailleurs, où il trouverait une majorité compacte pour soutenir un ministère homogène. S'il consulte les votes de l'Assemblée, il constate la désunion latente derrière des coalitions projetées ou éphémères. Le duc de Broglie s'était plaint, avec quelque acrimonie, des élections républicaines récentes et de la conduite des préfets. M. Thiers déclare nettement qu'ayant accepté et voulant garder fidèlement le dépôt de la République, il n'avait pas le droit de s'opposer à des élections républicaines. Ma réponse précise, nette et résolue, sans aigreur, ferma, dit-il, la bouche au duc de Broglie, qui prit, dès lors, une attitude de froideur affectée[24]. Parlant de l'avenir, M. Thiers rappelle qu'il avait parfaitement entendu, à Bordeaux, qu'on ajournerait le choix d'un gouvernement définitif. Cependant, chacun reconnaît, ajoute-t-il, qu'il faudra bientôt sortir de l'abstention. Peut-on trouver mauvais que, par prévoyance, il laisse connaître la solution que la pratique du pouvoir lui fait considérer désormais comme inéluctable ? Plus il étudie la société française, plus il se persuade que la monarchie est impossible. Sa ruine vient de l'irrémédiable division de ses partisans. Et puis, le pays l'ignore et se détourne d'elle. Il faut bien accepter comme légale la République, qui existe déjà en fait. Par quelques lois sages, dit-il, confions le pouvoir législatif à deux chambres ; donnons à la chambre haute et au pouvoir exécutif le droit de dissoudre, d'un commun accord, la chambre des députés ; faisons, enfin, une loi électorale garantissant, autant que possible, le suffrage universel contre ses propres entrainements, et, dans ces conditions, je suis persuadé que le gouvernement serait suffisamment armé pour résister aux pires entreprises de la démagogie. En ce qui concerne les radicaux, M. Thiers réprouve leurs principes et leur campagne. Il blâme notamment les attaques de M. Gambetta contre l'Assemblée. Mais si le pays vote pour ce parti, c'est qu'il veut marquer sa volonté de fonder la République et qu'on ne lui laisse aucun autre moyen de la faire que de porter ses suffrages sur les candidats qui seuls affirment leur dévouement aux institutions existantes. M. Thiers n'émet qu'un avis. Bien entendu, l'Assemblée est souveraine. Elle peut, si elle le juge bon, proclamer la monarchie. Et, s'adressant aux délégués, il leur porte ce coup droit : Puisque vous êtes la majorité, pourquoi ne proposez-vous pas vous-mêmes qu'on la rétablisse ? L'entrevue prit fin ; elle avait duré deux heures et demie. M. Thiers, en reconduisant les délégués, leur dit, avec un sourire : Que voulez-vous ! La République est de ces choses que l'empire nous a léguées, avec tant d'autres. M. Thiers avait cédé, une fois de plus, à la tentation d'avoir de l'esprit. Le conseil des neuf communiqua un compte rendu de sa démarche à la presse ; il se terminait par ces mots : Regrettant de ne pouvoir s'entendre avec M. le président de la République sur les véritables conditions de la république conservatrice, les délégués ont dû se retirer en maintenant leur opinion et en se réservant toute liberté pour la défendre. C'était une déclaration de guerre. Elle était inévitable. Depuis longtemps, l'accord était impossible entre les membres de la majorité et M. Thiers. L'équivoque entretenue par tout le monde sur le mot République conservatrice ne pouvait plus durer. Du moment que M. Thiers se refusait à jouer, en aveugle volontaire, le rôle d'un Monk, mieux -valait rompre franchement avec lui. Depuis le retour de M. de Broglie, la campagne prenait une allure où on sentait la main d'un chef. Ce dernier disait, dans les couloirs de l'Assemblée, le lendemain de l'entrevue avec le président : Il faut l'interpeller sur tout, le harceler sur tout, afin qu'il n'y puisse pas résister. Le colloque de M. Thiers et du conseil des neuf ne passionna pas l'opinion. Le lendemain, un spirituel article de M. John Lemoinne, dans le Journal des Débats, railla la Manifestation des Bonnets à poil. Le mot courut tout Paris et amusa aux dépens des auteurs de la démarche. En France, l'esprit gagne de ces victoires légères au profit du bon sens. Le Journal des Débats, qui attendait l'heure de son évolution, la fit, ce jour-là, et se rallia au centre gauche dont. M. de Laboulaye traça le programme dans un article inséré à côté de celui de M. John Lemoinne. M. de Larcy, ministre des travaux publics, qui représentait le parti légitimiste dans le cabinet, ne voulut pas se séparer de la droite et donna sa démission. Désormais, les positions sont prises. La majorité cherchera toutes les occasions de renverser M. Thiers : elle n'en laissera pas échapper une seule d'affirmer sa violente hostilité contre la République. M. Thiers, par contre, s'appuie nettement sur la gauche. Il brave la droite et semble prendre plaisir à réclamer l'essai loyal du gouvernement républicain. A partir de cette époque, les discussions sont heurtées, violentes ; les séances sans confiance, sans repos. Le 12 juillet, peu avant la séparation de l'Assemblée, M. Thiers saisit une occasion, au cours d'un débat d'affaires, pour jeter, une fois de plus, à la face de la majorité, l'affirmation de la République, de la République conservatrice, bien entendu. On sent, dans le ton de l'homme d'État, une résolution arrêtée, quand il s'écrie, au milieu de l'émotion générale : Messieurs, vous nous avez donné une forme de gouvernement qu'on appelle la République. Il n'était pas possible de dire à une majorité des vérités plus désagréables. Évidemment, M. Thiers avait pris son parti. Il savait où il allait. Cette nouvelle manifestation irrita profondément la droite. Quelques impatients songèrent même à tenter de réaliser immédiatement leurs projets de restauration. Ces bruits, exagérés dans les conversations de couloirs, firent parler d'une conspiration monarchiste à laquelle on mêla le nom du maréchal de Mac Mahon et celui de la duchesse de Magenta. La polémique fut bientôt si vive, que le gouvernement crut devoir démentir ces projets de conjuration, tandis que le maréchal et sa femme, par une démarche ostensible à l'hôtel de la Préfecture, témoignaient de leurs sentiments réels pour la personne de M. Thiers. Les dernières séances de la session sont consacrées à la discussion des marchés du 4 Septembre. Les violences de paroles, les incriminations véhémentes se produisent. Le 29 juillet, au lendemain du succès de l'emprunt de trois milliards, la veille du jour où M. de Goulard vient annoncer à l'Assemblée ce résultat inespéré et en faire honneur à la République conservatrice, on s'est battu, avec un acharnement sans pareil, au sujet du rapport de M. Riant sur les marchés passés par le gouvernement de la Défense nationale. La gauche avait dû quitter la séance et la droite voter seule l'ordre du jour de renvoi au ministre qui impliquait un blâme. On remarqua que M. Grévy, se sentant impuissant à diriger les débats, avait quitté le fauteuil et avait laissé la présidence à M. Martel. La session touchait à sa fin, cette session surchargée où M. Thiers avait rendu de si grands services et qui avait vu de si grandes choses. De part et d'autre, on comprenait que la mesure était dépassée et qu'on ne pouvait pas, pendant les vacances parlementaires, laisser le pays sur une telle impression. D'ailleurs, il fallait bien faire trêve, puisque l'heure des résolutions définitives était forcément retardée. La difficile opération du versement de l'indemnité et de l'évacuation était imminente. C'eût été une insigne folie de la troubler par le souvenir non atténué des dernières luttes parlementaires. Précisément, le conciliant M. Martel avait déposé, sur le bureau de l'Assemblée, une proposition de prorogation du 4 août 1872 jusqu'au 11 novembre suivant. M. Saint-Marc Girardin fut chargé de présenter le rapport sur cette proposition ; il le fit dans la séance du 11 août, et il profita de cette circonstance pour donner une interprétation plus adoucie de la démarche faite auprès de M. Thiers. Sa déclaration fut accueillie par des sourires amortis. En somme, on en revenait au pacte de Bordeaux. Le vieil arsenal des formules usées servait encore pour le temps des vacances. Mais chacun préparait, en vue des luttes décisives de la rentrée, une tactique nouvelle et des armes plus dangereuses. V On retrouve, dans le pays, pendant les mois de vacances qui suivent cette session agitée, les mêmes dispositions, les mêmes passions, les mêmes inquiétudes, le même travail que dans le gouvernement et l'Assemblée. Situation du pays. Cependant, la reprise des affaires, une prospérité inattendue, une plénitude de vie et une sorte d'exubérance qui succèdent souvent aux grands cataclysmes, répandent une confiance universelle. Pour la première fois, les plaisirs de l'été retrouvent leur clientèle légère et fastueuse. Les stations des bords de la mer sont envahies. Les toilettes, un moment assombries sous l'influence de la guerre, reprennent leur éclat. M. Thiers se rend à Trouville, où il resta jusqu'au 19 septembre. Il y est entouré, acclamé ; la saison bat son plein. Toujours préoccupé des questions militaires et mettant une sorte de coquetterie à descendre dans les moindres détails, il consacre ses loisirs à la reconstitution de l'armement : Pour le fusil, dit-il, je laissai au général Douai, créateur de l'école de tir de Vincennes, le soin d'en corriger les défauts. Mais il s'occupe lui-même des expériences, conduites par le général Frébault et le colonel de Reffye, qui amènent l'introduction, dans notre artillerie, du chargement par la culasse et la substitution de l'acier au bronze dans la fabrication des carions. Il visite Le Havre, où il reçoit un accueil enthousiaste. Partout, sur son passage, on crie : Vive la République ! Un hommage plus important encore, pour lui et pour le pays, lui est rendu : une partie de l'escadre anglaise de la Manche quitte son mouillage de Spithead, vient saluer le chef d'un État voisin et ami, l'escorte dans son voyage en mer, de Trouville au Havre. Le gouvernement s'applique, pendant cette période d'accalmie, à maintenir l'ordre et à donner des gages au parti conservateur. Des grèves, qui éclatent dans le Nord, sont réprimées avec une énergie singulière. Les manifestations politiques publiques sont interdites. La gauche ne peut célébrer, comme elle en avait eu l'intention, les anniversaires de la prise de la Bastille en 1789, du fi septembre 1870 et du 22 septembre 1792. M. Louis Blanc devait prendre la parole à Marseille : la réunion ne put avoir lieu, et l'orateur en est réduit à publier, sous forme de lettre, le discours où il demandait la dissolution immédiate de l'Assemblée. Cependant, M. Gambetta fait entendre sa voix. On organise partout des réunions privées où il parle. Ses discours, répandus par la presse, sont des événements : ils donnent une orientation aux esprits indécis ; ils résonnent d'autant plus haut, dans le silence universel. Ils exposent une doctrine, développent un programme, constituent un parti, accablent des adversaires muets, ébranlent les indécis. Quand on paraît si maître de l'avenir, on le conquiert, en effet. Seul, le parti républicain s'adresse au public, agit en pleine lumière. Depuis les croisades, la France n'avait pas assisté à une pareille entreprise de propagande verbale. Elle aime se donner à qui se donne ainsi. Le 14 juillet, M. Gambetta avait commencé la série de ses discours, à la Ferté-sous-Jouarre : c est là qu'il prononce les paroles qui portent au delà du monde politique et qui sont destinées à ébranler les masses profondes du pays : Il faut revenir à la féconde pensée de 1789, rétablir le faisceau qui a été détruit par des mains scélérates ; rapprocher le bourgeois de l'ouvrier, l'ouvrier du paysan... ou bien encore : Que vos champs, vos veillées, vos réunions, vos foires, deviennent pour vous des occasions d'entretien et d'instruction... Paroles franches, vives et directes, qui donnent l'éveil à la démocratie française et qui, en la groupant, la constituent. Sa campagne en Savoie et dans le Dauphiné est restée célèbre ; il se trouvait là en contact avec les fortes et vaillantes populations qui ont vu l'aurore de la Révolution. A Albertville, il fait, de nouveau, le procès de l'Assemblée : La véritable politique, c'est la vigilance, la patience ; et, après tout, nous n'avons pas longtemps à attendre, car il est certain que cette Chambre est arrivée au dernier degré de l'impopularité, de l'impuissance, de la stérilité et de l'incapacité. A Grenoble, le 26 septembre, il provoque l'attention universelle en proclamant, aux applaudissements des uns, à la surprise des autres, l'avènement de la démocratie dans la politique. Que voulez-vous ? dit-il. En France on ne peut pas s'habituer, depuis quarante-cinq ans, dans certaines classes de la société, à prendre son parti, non seulement de la Révolution française, mais de ses conséquences, de ses résultats. On ne veut pas confesser que la monarchie est finie, que tous les régimes qui peuvent, avec des modifications différentes, représenter la monarchie, sont également condamnés. Et c'est dans ce défaut de résolution, de courage chez une notable partie de la bourgeoisie française, que je retrouve l'origine, l'explication de tous nos malheurs, de toutes nos défaillances, de tout ce qu'il y a encore d'incertain, d'indécis et de malsain dans la politique du jour. On se demande, en vérité, d'où peut provenir une pareille obstination ; on se demande si ces hommes ont bien réfléchi sur ce qui se passe ; on se demande comment ils ne s'aperçoivent pas des fautes qu'ils commettent et comment ils peuvent plus longtemps conserver, de bonne foi, les idées sur lesquelles ils prétendent s'appuyer ; comment ils peuvent fermer les yeux à un spectacle qui devrait les frapper ? N'ont-ils pas vu apparaître, depuis la chute de l'empire, une génération neuve, ardente, quoique contenue, intelligente, propre aux affaires, amoureuse de la justice, soucieuse des droits généraux ?... N'a-t-on pas vu apparaître sur toute la surface du pays — et je tiens infiniment à mettre en relief cette génération nouvelle de la démocratie — un nouveau personnel politique électoral, un nouveau personnel du suffrage universel ? N'a-t-on pas vu les travailleurs des villes et des campagnes, ce monde du travail à qui appartient l'avenir, faire son entrée dans la vie politique ?... Oui, je pressens, je sens, j'annonce la venue et la présence, dans la politique, d'une couche sociale nouvelle qui est aux affaires depuis tantôt dix-huit mois, et qui est loin, à coup sûr, d'être inférieure à ses devancières... En même temps, comprenant le danger de renfermer la République dans des cadres trop étroits ; persuadé, comme il le fut Toute sa vie, que la République est la chose de tous, il définit en termes précis la politique accueillante et tolérante qu'il recommande à son parti : Le parti républicain, — celui qui est composé surtout d'hommes souvent et durement éprouvés, celui qui compte dans ses rangs presque autant de victimes que de serviteurs, c'est celui-là dont je parle, parce que c'est celui que je connais le mieux et que c'est celui auquel j'appartiens, — le parti républicain, qui l'a toujours été ou qui ne compte que des membres qui l'ont toujours été ; ce parti-là est tenu à beaucoup de largeur de main, à un grand esprit de conciliation et de concorde ; il est tenu à se recruter largement et sans mesquins calculs d'amour-propre dans tous les rangs du pays, afin de devenir la majorité de la nation elle-même. C'est son devoir immédiat, et il n'y manquera pas. Ce parti doit avoir cependant un certain critérium à sa disposition : il doit pouvoir distinguer entre la naïveté des uns et le calcul des autres, entre les nouveaux qui s'offrent à lui et les anciens, entre ceux qui viennent lui apporter leur concours par suite de convictions récentes et ceux qui ont des actes à mettre derrière leurs paroles ; il doit enfin pouvoir être mis à même aussi de reconnaître ceux qui, secouant une indifférence, hélas ! trop générale, veulent entrer dans la vie politique. Ceux-là, Messieurs, il faut les accueillir à bras ouverts... Au cours de cette campagne. M. Gambetta ménagea toujours la personne de M. Thiers. A. Annecy, il saisit avec empressement l'occasion qui lui était offerte de prononcer l'éloge du président de la République : J'ai été, pour ma part, dit-il, extrêmement sensible à l'honneur qu'on m'a fait, en associant mon nom é celui de l'homme éminent qui aura ce mérite, si rare en France, de subordonner ses convictions antérieures aux nécessités de la patrie et à la loi des événements. Au nom de l'ordre, de l'autorité légale, du bort respect des formes républicaines et aussi, permettez-moi de le dire, au nom des services rendus à la France par ce vieillard expérimenté, plein de ressources, si familier avec les difficultés de la politique, si étonnant de zèle et d'activité pour la chose publique, si prompt à saisir les indications de l'opinion, si sagace dans les moyens qu'il propose pour résoudre les difficultés qui se présentent ; et aussi, au nom des choses mémorables que le président de la République a déjà accomplies, et à l'aide desquelles il à su si bien servir les intérêts généraux du pays, rien qu'en s'inspirant de la volonté nationale, connue par une sorte d'intuition toute personnelle, et bien mieux, par exemple, — pardonnez-moi ce que je vais dire, — que s'il eût trop écouté la voix qu'on entend dans le département de Seine-et-Oise !... pour tontes ces raisons réunies, Messieurs, je suis très heureux de boire à la République d'abord, et à son président ensuite. Au diner, auquel assistait M. Gambetta, M. Duboutoz avait cru devoir insister : Si, à la suite d'événements improbables, avait-il dit, on était disposé à essayer de nouveau d'un régime monarchique, oh ! alors, nous nous souviendrions que, près de nous, se trouve un petit pays qui a su conquérir de grandes libertés et qui veut le maintien des institutions républicaines. Nous aurions alors ce souvenir, parce que là où se trouve la liberté, là doit exister une pairie. M. Gambetta ne laissa pas tomber de telles déclarations. Il les releva aussitôt, dans un beau mouvement de franchise et d'éloquence : Quand on parle de la France, dit-il, de ce qui lui appartient, de ce qui est son bien, de son intégrité, il faut bien peser ses mots... Pensez-vous que la France doive être rendue responsable. A Saint-Julien, le 20 octobre, M. Gambetta inaugure la campagne de principes qu'il va diriger bientôt avec tant de vigueur contre les menées cléricales. Il n'y a plus à parler, dit-il, des partis monarchiques. Il reste un parti que vous connaissez bien, un parti qui est l'ennemi de toute indépendance, de toute lumière et de toute stabilité, car ce parti est l'ennemi déclaré de tout ce qu'il y a de sain, de tout ce qu'il y a de bienfaisant dans l'organisation des sociétés modernes. Cet ennemi, vous l'avez nommé : c'est le cléricalisme. Par contre, il se montre non moins vigilant pour la défense de la cause nationale. Un certain sentiment séparatiste s'était manifesté dans ces régions. Le 30 septembre 1872, dans un discours prononcé à Bonneville, M. François Dumont, petit-fils du président de l'assemblée des Allobroges qui vota la réunion de la Savoie à la France en 1792, avait prononcé ces paroles graves : Nous ne sommes pas, disait M. Dumont, tout à fait comme nos pères, qui aimaient la France avant la République. Nous aimons, nous, la République avant la France, au point de vue de son unité, au point de vue de cet assemblage magnifique de provinces, qui toutes avec des traits distincts forment la grande figure de la patrie : pensez-vous qu'elle doive être éprouvée par ce dernier désastre de tomber en démembrement et en dislocation volontaire ?... Il faut réfléchir quand on parle du patrimoine de la France... Là où est la France, là est la patrie. Au moment même oh ces paroles étaient prononcées, une triste échéance avivait douloureusement le sentiment patriotique de la nation. Le gouvernement allemand annonçait officiellement que, passé le 1er octobre 1872, tous les Français, nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, qui n'auraient pas opté pour la France, seraient considérés comme sujets allemands ; que tous les annexés qui se trouveraient, à cette date, sur le territoire d'Alsace-Lorraine, même après avoir régulièrement opté pour la nationalité française, seraient déchus des bénéfices de l'option. D'après les instructions envoyées au directeur de chaque cercle, l'option devait être suivie d'un changement de domicile réel. Les Alsaciens-Lorrains. La séparation était donc accomplie. D'une part, en France, la loi du 7 septembre 1871 avait adjoint au département de la Meurthe les territoires du département de la Moselle restés français, c'est-à-dire l'arrondissement de Briey, moins quelques communes des cantons de Briey et de Conflans. Ainsi augmenté, l'ancien département de la Meurthe prit provisoirement, dit le texte de la loi, le nom de Meurthe-et-Moselle. Par contre, les territoires devenus allemands par suite du traité de Francfort avaient été organisés en pays d'empire (Reichsland), en vertu d'une loi datée du 9 juin 1871. Aux ternies de cette loi, l'Alsace-Lorraine était immédiatement rattachée au pouvoir impérial et administrée par l'empereur au nom de la Confédération. Elle devait avoir des représentants au Reichstag : mais l'usage de ce droit, d'abord ajourné au 1er janvier 1873, ne fut exercé qu'à partir du 1er janvier 1874. L'Alsace-Lorraine eut quinze députés à élire. Lors de la discussion de la loi, M. de Bismarck avait fait connaître, au Reichstag, ses projets relativement à l'Alsace-Lorraine. Dans un discours du 2 mai 1871, il rappela d'abord que l'Allemagne n'avait pu se contenter, comme on l'avait proposé, d'imposer à la France le démantèlement des forteresses d'Alsace et de Lorraine. Constituer, dit-il, une servitude sur le fonds et le terrain étrangers, c'est créer un poids très lourd, très incommode pour le sentiment de souveraineté et d'indépendance du pays sur lequel il pèse. Il explique ensuite qu'en raison de l'éloignement des habitants eux-mêmes pour leur séparation d'avec la France, l'empire n'avait pas accepté de faire avec ces cieux provinces un État neutre, comme la Suisse et la Belgique. Dans un nouveau discours, prononcé, sur le même sujet, le 25 mai, il précise : La seule chose, à côté de cela, qui ait pu sérieusement être mise en question, c'était de savoir si l'Alsace et la Lorraine seraient réunies à l'un des États confédérés existants, soit en totalité, soit par fractions, ou bien si elles resteraient d'abord un pays immédiat de l'empire. Et il ajoute : Sérieusement donc, la seule question était celle-ci : l'Alsace et la Lorraine doivent-elles être réunies à la Prusse ou former un pays immédiat de l'empire ? Je me suis, dès l'origine, absolument prononcé pour le dernier terme de cette alternative : d'abord, afin de ne pas mêler, sans nécessité, les questions dynastiques à nos affaires politiques ; en second lieu aussi, parce que je considérais comme plus facile d'assimiler les Alsaciens avec le nom d'Allemands qu'avec celui de Prussiens[25]. Jusqu'à la fin de 1871, l'Alsace-Lorraine fut administrée par la chancellerie impériale, représentée, à Strasbourg, par un gouverneur général et un commissaire civil. Au commencement de 1872, M. de Mœller fut nommé président-supérieur. En vertu de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1871-6 janvier 1872, il exerça des pouvoirs dictatoriaux. La même loi divisa le Reichsland en trois districts et en vingt-deux cercles. Les décisions du gouvernement allemand relatives à l'option de nationalité provoquèrent un véritable exode de la population d'Alsace-Lorraine. Pendant les derniers jours de septembre, les routes conduisant en France furent envahies par un peuple en fuite. Tout ce qui put partir, partit ; ceux qui restaient pleuraient de douleur de ne pouvoir abandonner leur foyer. On estime que, pendant la dernière quinzaine de septembre, l'émigration d'Alsace-Lorraine en France atteignit près de deux cent mille personnes[26]. A ce moment, la population de Metz était tombée à vingt mille habitants, sur lesquels il ne se rencontra que dix-sept conscrits disposés à servir dans les rangs de l'armée allemande. Sur deux cents magistrats français siégeant en Alsace-Lorraine, cinq seulement restèrent pour rendre la justice au nom de l'empereur Guillaume. Beaucoup d'usines furent vendues à la hâte ; patrons et ouvriers quittèrent l'atelier, faisant route commune vers la frontière française. En huit jours, Nancy vit sa population augmenter de dix mille habitants. La préfecture enregistra vingt-cinq mille options et on recueillit six mille engagements volontaires dans l'armée française. Dans le département des Vosges, on compta une augmentation de quarante-cinq mille habitants. Le gouvernement français dut subvenir aux premiers besoins de ces émigrants. Il fut aidé dans cette œuvre douloureusement patriotique par le concours des populations de l'Est. C'est alors que fut fondée, sur l'initiative du comte d'Haussonville, la Société de protection des Alsaciens-Lorrains, œuvre de haute pensée patriotique et humanitaire, dont les services ont affirmé, pour toujours, le sentiment qui unit tous les Français de l'Est. Par les soins des hommes actifs et intelligents qui la dirigèrent, le passé fut relié à l'avenir. Un grand nombre des malheureux arrachés à la terre maternelle par les cruautés de la guerre, trouvèrent en Algérie une patrie nouvelle : sous un autre ciel, dans une nature toute différente, le village d'Alsace s'éleva au penchant d'une colline, et, parfois, le voyageur s'étonne, en cette terre lointaine et âpre, parmi les visages farouches, de la rencontre inattendue des yeux bleus. VI A Versailles, l'agitation des partis grandissait au fur et à mesure que se rapprochait l'époque de la rentrée parlementaire. Le 10 octobre, la commission de permanence lit une démarche auprès de M. Thiers pour lui soumettre ses observations au sujet du discours de M. Gambetta, à Grenoble : on le considérait comme une menace de guerre civile. M. Thiers déclara qu'il jugeait ce discours mauvais, très mauvais, et que, si la tribune lui était ouverte, il le combattrait de toute son énergie. M. Thiers était plus que jamais nerveux, inquiet ; il sentait que quelque chose se tramait, dans l'ombre, -autour de lui. Un rien l'irritait. Parfois, il s'ingéniait à trouver les formules qui assureraient le lendemain et satisferaient à tout le monde ; parfois il s'abandonnait au découragement, prêt à se laisser porter par les événements. Il put, du moins, passer son humeur sur le parti bonapartiste. Napoléon III avait donné à son cousin, le prince Jérôme, une lettre lui permettant de présenter sa candidature dans toutes les élections. Je recommanderai à tous mes amis, disait-il, de soutenir ton élection, non seulement en Corse, mais dans tous les départements où tu auras chance d'être élu. Le prince Jérôme Napoléon recevait ainsi une sorte d'investiture. Nommé conseiller général de la Corse, à la fin de l'année 1871, il avait, une première fois, en août 1872, avec l'autorisation du gouvernement, sollicitée par l'intermédiaire de noire consul à Genève, traversé la France, pour se rendre à Ajaccio. Au mois d'octobre, il accepta l'invitation de M. Maurice-Richard, ancien ministre de l'empire, d'aller, accompagné de sa femme, la princesse Clotilde, chasser au château de Millemont (Seine-et-Marne). C'était se rapprocher ostensiblement de Paris et de Versailles. Le prince était un homme de hante valeur intellectuelle, ambitieux, intempérant, plus embarrassant peut-être pour les siens que pour ses adversaires. Il pouvait devenir encombrant sans être vraiment dangereux. Le but du voyage du prince était, dit-on, une réconciliation avec M. Rouher, qu'il ne voyait plus depuis plusieurs années, et avec qui il partagerait désormais la direction du parti bonapartiste. M. Thiers crut qu'il devait agir afin de ne pas créer un précédent, qui profiterait à Napoléon III. Invoquant la loi de déchéance, il fit reconduire le prince à la frontière. Cependant, l'appréhension d'une prochaine restait-ration impériale augmentait. On assurait que les puissances étaient favorables à ce projet. On savait que l'empereur tenait en haleine ses partisans, qu'il travaillait beaucoup. On disait qu'il se portait à merveille et qu'il apparaîtrait bientôt au milieu d'un des corps d'armée. Les monarchistes étaient plus inquiets encore que les républicains. On ne voyait plus qu'une chance de salut, c'était une combinaison quelconque qui amènerait le duc d'Aumale au pouvoir. Au mois d'octobre, une visite faite, à Frohsdorff, par M. le duc de La Rochefoucauld-Bisaccia, attira l'attention. On répandit le bruit que le comte de, Chambord autorisait les députés de la droite à tenter l'essai loyal de la République, et le duc d'Aumale à accepter la présidence du gouvernement. Dans une lettre adressée, le 15 octobre, à M. de La Rochette, député de la Loire-Inférieure, le comte de Chambord protesta contre ces allégations et affirma qu'en proclamant la République, on courrait à un abîme certain, aussi bien avec le parti violent qu'avec le parti modéré. Pour lui, la République inquiète les intérêts autant que les consciences. En ce qui concernait le duc d'Aumale, le comte de Chambord écrivit qu'il n'avait point à s'occuper de M. le dur d'Aumale. Celui-ci pouvait faire ou ne pas faire tout ce qu'il voudrait ; accepter ou refuser une situation dans l'ordre de choses actuel. La scission était complète, en effet, entre le chef de la famille et son cousin. Celui-ci, qui ne se faisait plus aucune illusion au sujet des tentatives de fusion, avait déchiré tous les voiles, dans un discours qu'il avait prononcé, dès le 28 mai 1872, au cours de la discussion de la loi militaire. Le duc d'Aumale avait rappelé cette vieille peine, autrefois inscrite dans le code : Privés de l'honneur de servir dans l'armée française ; puis il ajoutait, non sans éloquence : Je ne peux admettre qu'on renverse la proposition, et qu'on inflige, comme une peine, l'honneur de rester sous les drapeaux... (Vives approbations sur un grand nombre de bancs), sous le drapeau de la France... UN MEMBRE. — Lequel ? M. LE DUC D'AUMALE. — Sous ce drapeau chéri... (Ah ! ah ! Très bien ! très bien ! sur divers bancs du centre et du côté droit.) M. LE MARQUIS DE FRANCLIEU. — Qu'est-ce que cela ? (Bruit.) M. LE DUC D'AUMALE. — Sous ce drapeau chéri auquel tous les Français de toute opinion et de toute origine se sont ralliés pendant la guerre, que tous les bons citoyens ont entouré lorsqu'on en avait arraché un lambeau pour en faire le sinistre emblème de la guerre civile... (Très bien ! très bien !) Ce drapeau qui a 61é si longtemps le symbole de la victoire et qui est resté, dans notre malheur, l'emblème de la concorde et de l'union. (Applaudissements sur plusieurs bancs. — Rumeurs sur quelques autres. — Interruption prolongée.) Cette manifestation de l'oncle du comte de Paris avait fait apparaître pleinement les dissensions intimes qui déchiraient la famille royale. On caractérisait la situation, d'un trait plaisant, dans les couloirs de l'Assemblée : le comte de Chambord, disait-on, a un sujet de moins et M. Thiers un neveu de plus. Le comte de Chambord n'avait jamais oublié sa rancune et sa méfiance à l'égard des princes d'Orléans, et, en particulier, à l'égard du duc d'Aumale. Cette disposition d'esprit éclaire toute sa conduite. Un trait raconté par le marquis de Dampierre est lumineux : le marquis était allé à Breda, vers la fin de janvier 1872, et avait été reçu par le prétendant. Il avait soutenu, respectueusement mais fermement, des idées favorables à la fusion. Une conversation très franche et très vive s'engagea, dit-il, au bout de laquelle Monseigneur, se levant, me tendit les deux bras et, m'attirant à lui, m'embrassa en me disant : Je m'étais trompé, je vous croyais devenu orléaniste ; vous êtes toujours resté le même. Eh bien ! défendez, comme vous l'entendrez, dans la position difficile où vous êtes, la cause de la royauté ; je n'y trouverai plus rien à dire. Je vous demande une seule promesse : si le duc d'Aumale est appelé à la présidence de la République, donnez-moi votre parole que vous ne voterez pas pour lui. — Monseigneur, lui répondis-je, je n'ai aucun penchant pour une telle solution ; mais les circonstances peuvent devenir telles qu'une promesse de ce genre gênerait ma conscience de député ; je ne la ferai pas à Monseigneur. Cela lui déplut ; il dit : Vous ne me promettez même pas cela !...[27] Est-ce exagérer que d'attribuer à des sentiments si nettement déclarés dès le début et maintenus, en toutes circonstances, jusqu'à la fin, une influence décisive sur la non-réussite des projets de restauration monarchique ? L'espèce d'inquiétude et de désarroi où se trouvaient tous ceux qui, en France, étaient attachés aux idées royalistes et à la foi catholique, s'observe dans une recrudescence de manifestations religieuses qui implorent l'intervention du ciel. Une sorte d'élan mystique porte les âmes pieuses vers les lieux de pèlerinage, à Sainte-Aune d'Auray, à Notre-Dame de la Saiette et surtout à Lourdes. Quelques pèlerins vont jusqu'à Rome et leur double foi s'affirme dans leurs protestations contre l'occupation italienne. Partout, en France, des pétitions circulent en faveur du rétablissement du pouvoir temporel du pape. Elles se couvrent de signatures. Les évêques sont à la tête du mouvement. Et cette initiative aura bientôt, sur la politique intérieure et sur la politique extérieure, des conséquences singulièrement graves. Cependant, le suffrage universel marque nettement ses préférences et dicte sa volonté. Quinze jours avant la rentrée de l'Assemblée, le 26 octobre, sept élections ont lieu. Dans six départements : Calvados, Gironde, Indre-et-Loire, Oise, Vosges, Alger, les républicains triomphent. La droite ne compte, à son profit, qu'une seule élection, celle d'un monarchiste nommé dans le Morbihan. |