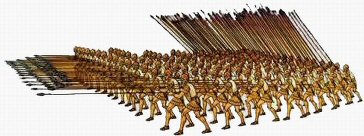HISTOIRE DE LA GRÈCE
DIX-HUITIÈME VOLUME
CHAPITRE II — CAMPAGNES ASIATIQUES D’ALEXANDRE.
|
Un an et quelques mois avaient suffi à Alexandre pour montrer une première fois son énergie et son habileté militaire, destinées à accomplir des exploits plus grands encore, et pour anéantir les aspirations vers la liberté parmi les Grecs au sud, aussi bien que parmi les Thraces au nord, de la Macédoine (335-334 av. J.-C.). L’hiver suivant fut employé à achever ses préparatifs ; de sorte qu’au commencement du printemps de 334 avant J.-C., son armée destinée à conquérir l’Asie fut réunie entre Pella et Amphipolis, tandis que sa flotte était à portée de prêter appui. Tout le reste de la vie d’Alexandre, depuis qu’il traversa l’Hellespont en mars ou en avril 334 avant jusqu’à sa mort à Babylone en juin 323 avant J.-C., onze ans et deux ou trois mois, — se passa en Asie, au milieu d’opérations militaires incessantes et de conquêtes toujours multipliées. Il ne vécut pas pour revoir la Macédoine ; mais ses exploits furent accomplis sur une échelle si gigantesque, ses conquêtes dépassèrent tellement toute mesure, et sa soif d’agrandissement ultérieur fut cependant si insatiable, que la Macédoine en arriva à être insignifiante dans la liste de ses possessions. A plus forte raison les cités grecques sont-elles réduites à l’état de dépendances éloignées d’un empire oriental nouvellement né. Pendant toutes ces onze années, il y a presque une lacune dans l’histoire de la Grèce, à l’exception çà et là de quelques événements épars. C’est seulement à la mort d’Alexandre que les cités grecques se réveillent et reprennent du mouvement et de l’activité. Les conquêtes d’Alexandre en Asie ri appartiennent pas directement et littéralement à la tâche d’uni historien de la Grèce. Elles furent accomplies par des armées dont le général, les principaux officiers, et la plus grande partie des soldats, étaient Macédoniens. Les Grecs qui servaient sous lui n’étaient que des auxiliaires, comme les Thraces et les Pæoniens. Bien que plus nombreux que tous les autres auxiliaires, ils ne constituaient pas, comme les Dix Mille Grecs dans l’armée du jeune Cyrus, la force sur laquelle il comptait surtout pour la victoire. Son premier secrétaire, Eumenês de Kardia, était Grec, et probablement la plupart des fonctions civiles et intellectuelles qui se rattachaient au service étaient remplies également par des Grecs. Un grand nombre de Grecs aussi servaient contre lui dans l’armée des Perses, et composaient à vrai dire une proportion plus considérable de la force réelle (en ne regardant pas simplement le nombre) dans l’armée de Darius que dans celle d’Alexandre. C’est ainsi que l’expédition devient indirectement mêlée au courant de l’histoire grecque par la puissante action auxiliaire de Grecs des deux côtés, — et plus encore par sa connexion avec des projets antérieurs, des rêves et des légendes qui précédèrent de beaucoup l’agrandissement de la Macédoine, — aussi bien que par le caractère qu’Alexandre jugea convenable de prendre. Se venger de la Perse pour l’invasion de la Grèce par Xerxès, et délivrer les Grecs asiatiques, tel avait été le plan du Spartiate Agésilas et de Jasôn de Pheræ, avec des espérances fondées sur la mémorable expédition et le retour heureux des Dix Mille. Il avait été recommandé par le rhéteur Isocrate, d’abord aux forces combinées de la Grèce, pendant que les cités grecques étaient encore libres, sous l’hégémonie commune d’Athènes et de Sparte, — ensuite à Philippe de Macédoine comme chef de la Grèce réunie, quand ses armes victorieuses avaient arraché une reconnaissance d’hégémonie, en écartant et Athènes et Sparte. Il plaisait à Philippe, avec son ambition entreprenante, d’être nommé chef de la Grèce pour l’exécution de ce projet. De lui il passa à son fils plus ambitieux encore. Bien qu’elle soit réellement un plan formé par l’ambition macédonienne et pour l’agrandissement macédonien, l’expédition contre l’Asie devient ainsi mêlée à la série des événements grecs, sous le prétexte panhellénique de représaille pour les insultes déjà bien anciennes de Xerxês. Je l’appelle un prétexte, parce qu’elle avait cessé d’être un sentiment hellénique réel, et qu’elle servait maintenant deux desseins différents : d’abord elle ennoblissait l’entreprise aux yeux d’Alexandre lui-même, dont l’esprit était très accessible au sentiment religieux et légendaire, et qui s’identifiait volontiers avec Agamemnôn ou Achille, immortalisés comme exécuteurs de la vengeance de la Grèce pour une insulte asiatique ; — ensuite elle aidait à maintenir les Grecs tranquilles pendant son absence. Il savait lui-même que les sympathies réelles des Grecs étaient plutôt contraires que favorables à ses succès. A part cet ensemble de sentiments éteints, rallumés avec faste pour les desseins d’Alexandre, la position des Grecs par rapport à ses campagnes en Asie était tout à fait la même que celle des contingents allemands, en particulier de ceux de la Confédération du Rhin, qui servaient dans la grande armée avec laquelle l’empereur Napoléon envahit la Russie en 1812. Ils n’avaient aucun intérêt public dans la victoire de l’envahisseur, qui ne pouvait avoir d’autre fin que de les réduire à un abaissement plus grand. Il était vraisemblable qu’ils resteraient attachés à leur chef aussi longtemps que sa puissance resterait intacte, mais pas plus longtemps. Cependant Napoléon crut avoir droit de compter. sur eux comme s’ils avaient été des Français, et de dénoncer les Allemands au service de la Russie comme des traîtres qui avaient manqué à la fidélité qu’ils lui devaient. Nous le voyons établir entre les Russes et les Allemands faits prisonniers la même distinction marquée, que faisait Alexandre entre des prisonniers asiatiques et grecs. Ces prisonniers grecs, le prince macédonien leur reprochait d’être coupables de trahison contre le statut proclamé de la Grèce collective, par lequel il avait été déclaré général et le roi de Perse ennemi public[1]. La Hellas, comme agrégat politique, a cessé actuellement d’exister, si ce n’est en ce qu’Alexandre emploie le nom pour ses propres desseins. Les membres constitutifs sont annexés comme dépendances, sans doute de valeur considérable, au royaume macédonien. Quatorze ans avant l’avènement d’Alexandre, Démosthène, en excitant les Athéniens à soutenir Olynthos contre Philippe, leur avait dit[2] : — La puissance macédonienne, considérée comme un accessoire, n’est- pas d’une médiocre valeur ; mais par elle-même elle est faible et remplie d’embarras. En renversant la position des parties, ces mots représentent exactement ce que la Grèce elle-même était devenue, par rapport à la Macédoine et à la Perse, à l’époque de l’avènement d’Alexandre. Si les Perses eussent joué leur jeu avec une vigueur et une prudence passables, son succès aurait eu pour mesure le degré auquel il pouvait s’approprier les forces grecques, et les enlever à son ennemi. Les manifestations mémorables et illustres, d’Alexandre, dans lesquelles nous entrons actuellement, appartiennent non au roi qui gouverne ou à l’homme politique, mais au général et au soldat. Dans ce rôle son apparition forme une sorte d’époque historique. Ce n’est pas seulement par les qualités militaires, — par la bravoure la plus hardie, et même la plus aventureuse, — par une activité personnelle infatigable et par la force à endurer la peine et la fatigue, qu’il est supérieur, bien que ces qualités seules, quand elles se trouvent dans un roi, agissent si puissamment sur ceux qu’il commande, qu’elles suffisent pour produire de grandes choses, même quand elles sont combinées avec un talent de général qui ne surpasse pas la moyenne de son époque. Mais sous ce dernier rapport, Alexandre était encore plus au-dessus du niveau de ses contemporains. Ses combinaisons stratégiques, l’emploi qu’il fit de différents genres de force concourant à une seule fin, ses plans à longue portée en vue de poursuivre ses campagnes, sa prévoyance constante et les ressources avec lesquelles il combattait de nouvelles difficultés, combinés avec la rapidité des mouvements même sur le terrain le plus difficile, — tout cela porté à une grandeur prodigieuse, — est sans exemple dans l’histoire ancienne. Par là l’art de la guerre systématique et scientifique est porté à un degré de puissance tel crie même ses successeurs élevés à son école ne purent le conserver dans son intégrité. Toutefois nous devons nous rappeler qu’Alexandre trouva le système militaire macédonien construit par Philippe, et qu’il n’eut qu’à l’appliquer et à l’agrandir. Tel qu’il lui fut transmis, il comprenait le résultat accumulé et les fruits mûrs d’une série de perfectionnements successifs, appliqués par des tacticiens grecs aux arrangements helléniques primitifs. Pendant les soixante années qui précédèrent l’avènement d’Alexandre, l’art de la guerre avait été remarquablement progressif, — au détriment, hélas ! de la liberté politique grecque. Autour de nous (dit Démosthène s’adressant au peuple d’Athènes en 342 avant J.-C.), tout a été en progrès depuis quelques années, — aucune chose n’est semblable à ce qu’elle était auparavant ; mais nulle part le changement et le développement ne sont plus remarquables que dans les affaires de la guerre. Jadis, les Lacédæmoniens aussi bien que les autres Grecs ne faisaient rien de plus que d’envahir le territoire les uns des autres, pendant les quatre ou cinq mois d’été, avec leur armée indigène d’hoplites-citoyens : en hiver ils restaient chez eux. Mais aujourd’hui nous voyons Philippe constamment en action, l’hiver aussi bien que l’été, attaquant tous ceux qui l’entourent, non seulement avec des hoplites macédoniens, mais avec de la cavalerie, de l’infanterie légère, des archers, des étrangers de toute sorte, et des machines de siége[3]. Dans plusieurs des chapitres qui précèdent, j’ai insisté sur ce changement progressif opéré dans le caractère de l’état militaire grec. A Athènes et dans la plupart des autres parties de la Grèce, les citoyens étaient devenus opposés à un service à la guerre dur et actif. L’usage des armes avait passé principalement à des soldats de profession, qui, sans aucun des sentiments propres au citoyen, servaient partout où une bonne solde leur était offerte, et qui se multiplièrent immensément, au détriment et au danger de la société grecque[4]. Beaucoup de ces mercenaires étaient armés à la légère, — peltastes servant conjointement avec les hoplites[5]. Iphikratês perfectionna beaucoup et arma de nouveau en partie les peltastes, qu’il employa conjointement avec les hoplites d’une manière si efficace qu’il étonna ses contemporains[6]. Son innovation fut encore développée par le grand génie militaire d’Epaminondas, qui non seulement fit concourir à un seul plan d’opérations l’infanterie ; la cavalerie, les troupes légères et les troupes pesamment armées, mais encore changea complètement les principes reçus des manœuvres de bataille, en concentrant une force irrésistible d’attaque sur un seul point de la ligne de l’ennemi, et en tenant le reste de sa propre ligne plus sur la défensive. Outre ces améliorations importantes, réalisées par des généraux dans la pratique actuelle, d’intelligents officiers, tels que Xénophon, consignèrent les résultats de leur expérience militaire dans d’importants traités critiques qu’ils publièrent[7]. Telles furent les leçons que Philippe de Macédoine apprit et appliqua à l’asservissement de ces Grecs, en particulier des Thébains, de qui elles étaient tirées. Dans sa jeunesse, comme otage à Thèbes, il avait probablement conversé avec Epaminondas, et il a dû certainement devenir familier avec les arrangements militaires thébains. Il avait toute raison, non seulement par ambition de conquête, mais même par besoin de se défendre, pour les mettre à profit, et il apporta à la tache militaire un génie et des aptitudes de l’ordre le plus élevé. Dans les armes, les évolutions, les engins, l’art d’enrégimenter, les dispositions des bureaux de la guerre, il introduisit d’importantes nouveautés, et légua à ses successeurs le système militaire macédonien, qui, perfectionné par son fils, dura jusqu’au moment où, près de deux siècles plus tard, Rome conquit le pays. Les forces militaires de la Macédoine, dans les temps qui précédèrent Philippe, semblent avoir consisté, comme celles de la Thessalia, en une cavalerie bien armée et bien montée, formée des riches propriétaires du pays, — et en un nombreux assemblage de peltastes ou infanterie légère (un peu analogues aux penestæ thessaliens) : ces peltastes formaient la population rurale, bergers ou cultivateurs, qui soignaient les moutons et le bétail, ou qui labouraient la terre dans les montagnes et les vallées spacieuses de la haute Macédoine. Les villes grecques près de la côte et les quelques villes macédoniennes de l’intérieur avaient des hoplites citoyens mieux armés ; mais le service à pied, n’était pas en honneur parmi les indigènes, et l’infanterie macédonienne, dans son caractère général, n’était guère plus qu’une foule tumultueuse. A l’époque de l’avènement de Philippe, les fantassins n’avaient pour toute arme que des épées rouillées et des boucliers d’osier, et ils n’étaient nullement suffisants pour résister aux incursions de leurs voisins thraces et illyriens, devant lesquels ils étaient constamment forcés de chercher un refuge aux montagnes[8]. La condition de ces fantassins était celle de pauvres bergers, à moitié nus et couverts seulement de peaux de bœuf, et mangeant dans des écuelles de bois ; elle ne différait guère de celle de la population de la haute Macédoine trois siècles auparavant, quand elle fut visitée pour la première fois par Perdikkas, le premier père des rois macédoniens, et que l’épouse du prince indigène faisait le pain de ses propres mains[9]. D’autre part, bien que l’infanterie macédonienne fût peu importante, la cavalerie du pays se montra excellente, tant dans la guerre du Péloponnèse que dans celle que Sparte fit à Olynthos plus de vingt ans après[10]. Ces cavaliers, comme les Thessaliens, chargeaient en ordre compacte, portant comme principale arme offensive, non des javelines à lancer, mais la courte pique destinée à percer dans un combat corps à corps. C’est dans cet état défectueux que Philippe trouva l’organisation militaire. Sous ses auspices elle fut complètement refondue. La pauvre et robuste landwehr de la Macédoine, constamment sur la défensive contre des voisins pillards, forma une matière excellente à faire des soldats, et ne se montra pas indocile aux innovations d’un prince guerrier. On l’exerça constamment dans le rang régulier et dans la file d’une infanterie pesamment armée ; de plus, on lui fit adopter une nouvelle espèce d’arme, non seulement en elle-même très difficile à manier, mais encore relativement inutile au soldat combattant seul, et qui ne pouvait être employée que par un corps d’hommes en ordre compacte, exercés à se mouvoir ou à s’arrêter ensemble. Cette nouvelle arme, dont nous entendons le nom pour la première fois dans l’armée de Philippe, était la sarissa, — la pique ou lance macédonienne. La sarissa était employée tant par l’infanterie de sa phalange que par des régiments particuliers de sa cavalerie ; dans les deux cas elle était longue, bien que celle de la phalange fût de beaucoup la plus longue des deux. Les .régiments de cavalerie appelés sarissophori ou lanciers, étaient une sorte de cavalerie légère, portant une longue lance, et distinguée de la grosse cavalerie réservée pour le choc d’un combat corps à corps, qui portait le xiston ou courte pique. La sarissa de cette cavalerie peut avoir eu quatre mètres de longueur et avoir été aussi longue que l’est aujourd’hui la lance des cosaques ; celle de l’infanterie ou phalange n’avait pas moins de six mètres trente centimètres de long. Une arme de cette dimension est si prodigieuse et si pesante que nous aurions de la peine à y croire, si elle n’était attestée par l’assertion distincte d’un historien tel que Polybe. La longueur extraordinaire de la sarissa ou pique constituait l’attribut ou force remarquable de la phalange macédonienne. Les phalangites étaient rangés en files généralement de seize hommes en profondeur, chacune appelée lochos, avec un intervalle de 90 centimètres entre les soldats de deux en deux du front à l’arrière. Sur le devant, se tenait le lochagos, homme de force supérieure et d’une expérience militaire éprouvée. Le second et le troisième homme de la file, aussi bien que le dernier qui fermait le tout, étaient également des soldats d’élite, recevant une paye plus considérable que les autres. Or, la sarissa, quand elle était dans une position horizontale, était tenue avec les deux mains — distinguée sous ce rapport de la pique de l’hoplite grec qui n’occupait qu’une main, l’autre étant nécessaire pour le bouclier —, et tenue de manière à dépasser de 4 mètres et demi le corps du piquier, tandis que la partie postérieure de 1 mètre 82 centimètres était chargée de telle sorte que, grâce à cette division, l’usage en était plus commode. Ainsi, la sarissa de l’homme qui était second dans la file dépassait de 3 mètres 05 centimètres le premier rang ; celle du troisième homme de 2 mètres 74 centimètres ; celles du quatrième et du cinquième rang, respectivement, de 1 mètre 82 centimètres et de 91 centimètres. Chaque file présentait ainsi une quintuple série de piques faisant face à un ennemi qui avançait. De ces cinq piques, les trois premières avaient naturellement une projection plus grande, et même la quatrième une projection non moindre que les piques des hoplites grecs venant comme ennemis à la charge. Les rangs derrière le cinquième, en servant à appuyer et à pousser en avant ceux de devant, ne portaient pas la sarissa dans une position horizontale, mais ils la plaçaient en biais sur les épaules de ceux qu’ils avaient devant eux, de manière à briser la force des dards ou des flèches qui pouvaient être lancés sur leurs têtes des derniers rangs de l’ennemi[11].
Le phalangite (soldat de la phalange) était, en outre, pourvu d’une courte épée, d’un bouclier circulaire d’un peu plus de 60 centimètres de diamètre, d’une cuirasse, de jambières et d’une kausia ou chapeau à larges bords,— couverture de tête commune dans l’armée macédonienne. Mais les longues piques étaient, à vrai dire, les principales armes défensives aussi bien qu’offensives. Elles étaient destinées à résister à la charge des hoplites grecs, ayant la pique d’une main et le pesant bouclier de l’autre, en particulier, à la plus formidable manifestation de cette force, la colonne thêbaine profonde organisée par Epaminondas. Ce fut à elle que Philippe eut affaire à son avènement, comme étant celle des infanteries grecques à laquelle il était impossible de résister, et qui renversait tout ce qu’elle avait devant elle en frappant de la pique et en poussant du bouclier. Il trouva le moyen de la vaincre, en exerçant sa pauvre infanterie macédonienne à l’usage systématique de la longue pique tenue à deux mains. La colonne thêbaine, chargeant une phalange armée ainsi, se trouva hors d’état de se faire jour dans la rangée des piques tendues en avant, ou d’en venir au coup porté par le bouclier. On nous dit qu’à la bataille de Chæroneia, les soldats thêbains du premier rang, hommes d’élite de la cité, périrent tous sur place ; et cela n’est pas étonnant, si nous nous les imaginons se précipitant, entraînés par leur propre courage aussi bien que poussés par les soldats de derrière, sur une muraille de piques d’une longueur double des leurs. Nous devons considérer la phalange de Philippe, eu égard aux ennemis qu’il avait devant lui, et non eu égard à l’organisation romaine, plus récente, que Polybe met en comparaison. Elle répondait parfaitement aux desseins de Philippe, qui avait surtout besoin de résister au choc de front, en l’emportant ainsi sur les hoplites grecs dans leur propre mode d’attaque. Or, Polybe nous informe que la phalange ne fut pas une seule fois défaite de front et sur un terrain convenable pour elle, et partout mi le terrain convenait aux hoplites il convenait également à la phalange. Les inconvénients de l’ordre de Philippe et des longues piques résultèrent de ce que la phalange ne pouvait changer de front ni garder son ordre sur un terrain inégal, mais ces inconvénients n’étaient guère moins sentis par les hoplites grecs[12]. La phalange macédonienne, nommée les pezetæri[13] ou fantassins compagnons du roi, comprenait- le corps général d’infanterie indigène, en tant que distingué du corps d’armée spécial. Sa division la plus considérable, que nous trouvons mentionnée sous Alexandre, et qui parait sous le commandement d’un général de division, est appelée Taxis. Combien y avait-il en tout de ces taxeis, nous l’ignorons : la primitive armée asiatique d’Alexandre (sang : compter ce qu’il laissa en Macédoine) en comprenait six, qui coïncidaient apparemment avec les divisions provinciales du pays : Œrestæ, Lynkestæ, Elimiotæ, Tymphæi, etc.[14] Les auteurs de traités sur la tactique nous donnent comme régnant dans l’armée macédonienne une échelle systématique — montant de l’unité la plus basse, le lochos de seize hommes, par des multiples successifs de deux, jusqu’à, la quadruple phalange de 16.384 hommes —. Parmi ces divisions, celle qui ressort comme la plus fondamentale et la plus constante est le syntagma, qui contenait seize lochi. Formant ainsi un carré de seize hommes de front et en profondeur, ou 256 hommes, il était en même temps un agrégat distinct ou bataillon permanent, auquel étaient attachés cinq surnuméraires, un enseigne, un homme d’arrière-garde, un trompette, un héraut et un serviteur ou ordonnance[15]. Deux de ces syntagmas composaient un corps de 512 hommes, appelé une pentakosiarchie ; qui était, dit-on, du temps de Philippe, le régiment ordinaire, agissant ensemble sous un commandement séparé ; mais plusieurs de ces corps furent doublés par Alexandre quand il réorganisa son armée à Suse[16], de manière à former des régiments de 1.024 hommes, chacun sous son chiliarque, et chacun comprenant quatre syntagmas. Toute cette distribution systématique des forces militaires macédoniennes à l’intérieur, paraît avoir été arrangée par le génie de Philippe. Dans le service actuel à l’étranger, aucune précision numérique ne pouvait être observée, un régiment ou une division ne pouvait pas toujours avoir le même nombre fixe d’hommes : Mais quant à l’ordre de bataille, une profondeur de seize, pour les files des phalangites, paraît avoir été regardée comme importante et caractéristique[17], peut-être essentielle pour donner de la confiance aux troupes. C’était une profondeur beaucoup plus grande qu’il n’était ordinaire aux hoplites grecs, et qui ne fut jamais surpassée par aucun Grec, à l’exception des Thêbains. Mais la phalange, bien qu’elle fût un article essentiel, n’en était cependant qu’un, entre beaucoup d’autres, dans l’organisation militaire variée introduite par Philippe. Elle n’était ni destinée, ni propre à agir seule, n’étant pas habile à changer de front pour se protéger soit en flanc, soit par derrière, et hors d’état de s’adapter à un terrain inégal. Il y avait une autre sorte d’infanterie organisée par Philippe, appelée les hypaspistæ, — hommes armés d’un bouclier ou gardes[18], peu nombreuse dans l’origine et employée à la défense personnelle du prince, — mais se développant plus tard et formant plusieurs corps d’armée distincts. Ces hypaspistæ ou gardes étaient de l’infanterie légère de ligne[19] ; c’étaient des hoplites gardant un ordre régulier et destinés au combat corps à corps, mais armés plus légèrement, et plus propres aux diversités de circonstance et de position que la phalange. Ils semblent avoir combattu avec la pique dans une main et le bouclier dans l’autre, comme les Grecs, et ne pas avoir porté la pique phalangite tenue avec les deux mains ou sarissa. Ils occupaient une sorte de place intermédiaire entre l’infanterie, pesamment armée de la phalange proprement appelée ainsi, et les peltastes et les troupes légères en général. Alexandre, clans ses dernières campagnes, les avait distribués en chiliarchies (de quel temps datait cette distribution, c’est ce que nous ne savons pas distinctement), au moins au nombre de trois, et probablement plus[20]. Nous les trouvons employés par lui pour des mouvements en avant et offensifs : d’abord, ses troupes légères et sa cavalerie commencent l’attaque, puis les hypaspistæ viennent pour la continuer ; en dernier lieu, on fait avancer la phalange pour les appuyer. On se sert aussi des hypaspistæ pour les assauts à donner aux places garnies de murs et pour de rapides marches de nuit[21]. Quel en était le nombre total, nous l’ignorons[22]. Outre la phalange et les hypaspistæ ou gardes, l’armée macédonienne, telle que l’employèrent Philippe et Alexandre, comprenait un nombreux assemblage de troupes décousues ou irrégulières, en partie Macédoniens indigènes, en partie étrangers, Thraces, Pæoniens, etc. Ces soldats étaient de différentes sortes : peltastes, akontistæ et archers. Les meilleurs d’entre eux semblent avoir été les Agrianes, tribu pæonienne habile dans l’usage de la javeline. Alexandre les tenait en mouvement pour agir avec vigueur sur les flancs et sur le front de son infanterie pesamment armée, ou il les mêlait à sa cavalerie, — et il les employait encore à poursuivre les ennemis défaits. En dernier lieu, la cavalerie de l’armée d’Alexandre était également admirable, — au moins égale, et vraisemblablement même supérieure en efficacité, à sa meilleure infanterie[23]. J’ai déjà mentionné que la cavalerie était la force indigène d’élite de la Macédoine longtemps avant le règne de Philippe, qui l’avait étendue et perfectionnée[24]. La grosse cavalerie, entièrement ou surtout composée de Macédoniens indigènes, était connue par sa dénomination des Compagnons. Il y avait, en outre, une variété de cavalerie nouvelle et plus légère, introduite apparemment par Philippe, et appelée les sarissophori ou lanciers, employée, comme les cosaques, dans les postes avancés ou pour battre le pays. La sarissa qu’elle portait était probablement plus courte que celle de la phalange, mais elle était longue, comparée au xyston ou pique, faite pour percer, que la grosse cavalerie employait pour le choc d’un combat corps à corps. Arrien, en décrivant l’armée d’Alexandre à Arbèles, énumère huit escadrons distincts de cette grosse cavalerie — ou cavalerie des Compagnons, mais le nombre total compris dans l’armée macédonienne à l’avènement d’Alexandre n’est pas connu. Parmi ces escadrons, plusieurs du moins (sinon tous) étaient nommés d’après des villes particulières ou districts du pays : — Bottiæa, Amphipolis, Apollonia, etc.[25] ; il y en avait un, ou plus, distingué comme l’Escadron Royal — l’Agêma ou corps d’élite de cavalerie, — à la tête duquel Alexandre chargeait généralement, en personne parmi les premiers des combattants[26]. La distribution de la cavalerie en escadrons fut celle qu’Alexandre trouva à son avènement, mais il la changea quand il refondit les arrangements de son armée (en 330 av. J.-C.) à Suse, de manière à subdiviser l’escadron en deux letchi, et à établir le loches pour sa division élémentaire de la cavalerie, comme il l’avait toujours été de l’infanterie[27]. Ses réformes allaient ainsi à réduire le corps primitif de cavalerie de l’escadron au demi escadron ou loches, tandis qu’elles tendaient à rassembler l’infanterie en corps plus considérables, — de cohortes de 500 hommes chacune à des cohortes de 1,000 hommes chacune. Parmi les hypaspistæ ou gardes aussi, nous trouvons un agêma ou cohorte d’élite, qui était appelée plus souvent que les autres pour commencer le combat. Une troupe plus choisie encore était les gardes du corps, petite compagnie d’hommes éprouvés et de confiance, connue individuellement d’Alexandre, toujours attachés à sa personne, et agissant en qualité d’adjudants ou de commandants pour un service spécial. Ces gardes du corps paraissent avoir été des personnes choisies, tirées des jeunes gens royaux ou pages, institution établie d’abord par Philippe, et prouvant la peine prise par lui pour amener les principaux Macédoniens à entrer dans une organisation militaire, aussi bien qu’à dépendre de sa personne. Les jeunes gens royaux, fils des principaux personnages de toute la Macédoine, étaient pris par Philippe en service, et tenus en résidence permanente pour servir sa personne et lui tenir compagnie. Ils montaient perpétuellement la garde dans son palais, se partageant tour à tour les heures de service de jour et de nuit ; ils recevaient son cheval des mains des écuyers, l’aidaient à y monter, et l’accompagnaient quand il allait à la chasse ; ils introduisaient les personnes qui venaient solliciter des audiences, et faisaient entrer ses maîtresses la nuit par une porte particulière. Ils jouissaient du privilège de s’asseoir à table avec lui, aussi bien que de celui de n’être jamais fouettés que par son ordre spécial[28]. Nous ne connaissons pas le nombre exact de la compagnie, mais il ne doit pas avoir été petit, puisque cinquante de ces jeunes gens furent envoyés de Macédoine à la fois, par Amyntas, pour rejoindre Alexandre et être ajoutés à la compagnie à Babylone[29]. En même temps, la mortalité parmi eux était probablement considérable, vu qu’en accompagnant Alexandre ils enduraient même au delà des prodigieuses fatigues qu’il s’imposait à lui-même[30]. L’éducation dans ce corps était une préparation d’abord pour devenir garde du corps du roi, — ensuite, pour être nommé à de grands et importants commandements militaires. En conséquence, ç’a été le premier degré d’avancement pour la plupart des diadochi ou grands officiers d’Alexandre, qui, après sa mort, se découpèrent des royaumes dans ses conquêtes. Ce fut ainsi que les forces macédoniennes indigènes furent agrandies et diversifiées par Philippe, comprenant à sa mort : — 1° La phalange, compagnons de pied, ou masse générale de l’infanterie pesamment armée, exercée à l’usage de la longue pique ou sarissa tenue à deux mains. — 2° Les hypaspistæ, ou troupes de gardes à pied légèrement armés. — 3° Les Compagnons, ou grosse cavalerie, l’ancienne armée indigène composée des Macédoniens plus opulents ou plus aisés. — 4° La cavalerie plus légère, lanciers ou sarissophori. A ces troupes furent joints des auxiliaires étrangers de grande valeur. Les Thessaliens, que Philippe avait en partie subjugués et gagnés en partie, lui fournirent un corps de grosse cavalerie non inférieure à la cavalerie macédonienne indigène. De diverses parties de la Grèce il tira des hoplites, volontaires pris à sa solde, portant le bouclier de dimension ordinaire d’une main et la pique de l’autre. Chez les tribus guerrières des Thraces, des Pæoniens et des Illyriens, etc., qu’il avait réduites autour de lui, il leva des contingents de troupes légères de diverses espèces, peltastes, archers, akontistæ, etc., tous excellents à leur manière, et éminemment utiles à ses combinaisons, conjointement avec les masses plus pesantes. En dernier lieu, Philippe avait complété ses arrangements militaires en organisant ce qu’on peut appeler un équipage réel de siége pour des siéges aussi bien que pour des batailles ; quantité de projectiles et de machines à battre en brèche, supérieure à tout ce qui existait à cette époque. Nous voyons Alexandre faire usage de cette artillerie la première année même de son règne, dans sa campagne contre les Illyriens[31]. Même dans ses marches en Inde les plus éloignées, il l’emmena avec lui, ou bien il eut le moyen de construire de nouveaux engins pour l’occasion. Il n’y eut aucune partie de son équipement militaire plus essentielle à ses conquêtes. Les siéges victorieux d’Alexandre sont au nombre de ses plus mémorables exploits. A tout cet appareil varié, considérable et systématisé de forces effectives, il faut ajouter les établissements civils, les dépôts, les magasins d’armes, les mesures prises pour les remontes, les officiers instructeurs et les adjudants, etc., indispensables pour maintenir ces forces constamment en exercice et en activité. A l’époque de l’avènement de Philippe, Pella était une place sans importance[32] ; à sa mort non seulement elle était forte comme lieu fortifié et de dépôt pour le trésor royal, mais encore elle était le centre permanent des plus grandes forces militaires alors connues ; là se trouvaient les bureaux de la guerre, là se formaient les soldats. Les registres militaires aussi bien que les traditions de la discipline macédonienne y furent conservés jusqu’à la chute de la monarchie[33]. Philippe avait employé sa vie à organiser ce puissant instrument de domination. Ses revenus, quelque considérables qu’ils fussent, fournis par des mines et par des conquêtes tributaires, avaient été épuisés dans ce travail, de sorte qu’il avait laissé à sa mort une dette de cinq cents talents. Mais son fils Alexandre trouva l’instrument tout prêt, avec d’excellents officiers, et de vieux soldats exercés pour les premiers rangs de sa phalange[34]. Cette organisation scientifique des forces militaires, sur une grande échelle, et avec toutes les variétés d’armement et d’équipement propres à concourir à une seule fin, est le grand fait de l’histoire macédonienne. Jamais on n’avait rien vu auparavant du même genre ni d’aussi grand. Les Macédoniens, comme les Epirotes et les Ætoliens, n’avaient pas d’autres aptitudes ou qualités prononcées que celles de l’état militaire. Leurs tribus grossières et éparses ne présentent pas d’institutions politiques déterminées et elles offrent peu de sentiment de fraternité nationale ; leur union était principalement celle d’une association en armes à l’occasion sous le roi comme chef. Philippe, fils d’Amyntas, fut le premier qui organisa cette union militaire en un système fonctionnant d’une manière permanente et efficace ; et grâce à ce système il fit des conquêtes telles qu’il créa dans les Macédoniens un orgueil commun de supériorité dans les armes, qui leur tint lieu d’institutions politiques ou de nationalité. Cet orgueil fut encore porté beaucoup plus — haut par la carrière réellement surhumaine d’Alexandre. Le royaume macédonien ne fut plus qu’une machine militaire bien combinée, qui prouva la supériorité irrésistible des hommes les plus grossiers, exercés dans les armes et conduits par un général habile, non seulement sir- des masses sans discipline, mais encore sur des citoyens libres, courageux et disciplinés, doués d’une haute intelligence. Ce fut pendant l’hiver de 335-334 avant J.-C., après la destruction de Thèbes et le retour d’Alexandre de Grèce à Pella, que se firent ses derniers préparatifs pour l’expédition d’Asie. L’armée macédonienne, avec les contingents auxiliaires destinés pour cette entreprise, fut réunie au commencement du printemps. Antipater, l’un des plus anciens et des plus habiles officiers de Philippe, fut nommé pour remplir les fonctions de vice-roi de Macédoine pendant l’absence du roi. Des forces militaires, qu’on dit avoir été de douze mille hommes d’infanterie et de quinze cents de cavalerie[35], furent laissées avec lui pour tenir dans le respect. les cités de la Grèce, résister aux agressions de la flotte persane, et réprimer les mécontentements à l’intérieur. Il était vraisemblable que de pareils mécontentements seraient provoqués par des Macédoniens de haut rang ou par des prétendants au trône, surtout vu qu’Alexandre n’avait pas d’héritier direct ; et on nous dit qu’Antipater et Parmeniôn proposèrent d’ajourner l’expédition jusqu’à ce que le jeune roi pût laisser derrière lui un héritier de sa race[36]. Alexandre ne tint pas compte de ces représentations ; cependant il ne dédaigna pas de diminuer les périls à l’intérieur en mettant à mort les hommes qu’il craignait ou dont il se défiait principalement, surtout les parents de la dernière épouse de Philippe Kleopatra[37]. Les chefs les plus énergiques des tribus dépendantes d’alentour accompagnèrent son armée en Asie, soit de leur propre choix, soit à sa requête. Après ces précautions, la tranquillité de la Macédoine fut confiée à la prudence et à la fidélité d’Antipater, qui furent encore plus assurées par le fait que trois de ses fils accompagnèrent l’armée du roi et sa personne[38]. Bien qu’il fût impopulaire dans sa manière d’être[39], Antipater s’acquitta avec zèle et talent des devoirs de sa position si pleine de responsabilité ; nonobstant la dangereuse inimitié d’Olympias, contre laquelle il envoya maintes plaintes à Alexandre en Asie, tandis que de son côté elle écrivit des lettres fréquentes mais inutiles en vue de le ruiner dans l’estime de son fils. Après une longue période d’une entière confiance, Alexandre commença dans les dernières années de sa vie à éprouver de l’éloignement et de la défiance à l’égard d’Antipater. Il traita toujours Olympias avec le plus grand respect ; tout en essayant de l’empêcher de se mêler d’affaires politiques, et se plaignant quelquefois de ses exigences impérieuses et de sa violence[40]. L’armée destinée pour l’Asie, ayant été réunie à Pella, fut conduite par Alexandre lui-même d’abord à Amphipolis, où elle traversa le Strymôn ; puis par la route près de la côte jusqu’au fleuve du Nestos et aux villes d’Abdêra et de Maroneia ; ensuite par la Thrace, où elle franchit les fleuves de l’Hebros et du. Melas ; en dernier lieu, par la Chersonèse de Thrace jusqu’à Sestos (avril 334 av. J.-C.). Là, elle fut rejointe par la flotte, qui comprenait cent soixante trirèmes, avec un grand nombre de bâtiments marchands en outre[41], et était composée en proportions considérables de contingents fournis par Athènes et par d’autres cités grecques[42]. Parmeniôn surveilla le passage de toute l’armée, — infanterie, cavalerie et machines, sur des vaisseaux, à travers le détroit de Sestos en Europe, à Abydos en Asie, — et ce passage s’accomplit sans difficulté ni résistance. Mais Alexandre lui-même, se séparant de l’armée à Sestos, se rendit à Elæonte à l’extrémité méridionale de la Chersonèse. Là se trouvaient la chapelle et l’enceinte, sacrée du héros Protesilaos, qui fut tué par Hectôr ; il avait été le premier Grec (suivant la légende de la guerre Troyenne) qui toucha le rivage de Troie. Alexandre, dont l’imagination était alors remplie de réminiscences homériques, offrit un sacrifice au héros, et demanda par des prières que son débarquement pût s’opérer sous de meilleurs auspices. Ensuite il traversa le détroit dans la trirème de l’amiral, gouvernant de sa propre main, vers le lieu de débarquement voisin d’Ilion appelé le Port des Achæens. Au milieu du détroit il sacrifia un taureau en l’honneur de Poseidôn et des Néréides, sacrifice qu’il accompagna de libations faites avec une coupe d’or. Lui-même aussi complètement armé, il fut le premier (comme Protesilaos) à fouler le rivage asiatique, mais il ne trouva pas d’ennemi comme Hectôr pour lui tenir tête. De là, gravissant la colline sur laquelle Ilion était placée, il sacrifia à la déesse protectrice Athênê ; et il déposa dans son temple sa propre armure, prenant en échange quelques-unes des armes qui, disait-on, avaient été portées par les héros dans la guerre Troyenne, et qu’il fit porter par des gardes avec lui dans ses batailles subséquentes. Entre autres monuments réels ou supposés de cette intéressante légende, les habitants d’Ilion lui montrèrent la résidence de Priam avec son autel de Zeus Herkeios, où ce vieux et infortuné roi avait, affirmait-on, été tué par Neoptolemos. Comme il comptait ce héros parmi ses ancêtres Alexandre se crut l’objet de la colère non encore apaisée de Priam ; et en conséquence il lui offrit un sacrifice au même autel, comme expiation et en vue d’une réconciliation. Sur la tombe et la colonne monumentale d’Achille, près de Neoptolemos, il plaça non seulement une couronne comme oralement, mais encore il accomplit la cérémonie habituelle en se frottant d’huile et en courant tout nu jusqu’à cette colonne : et il s’écria combien il enviait le sort d’Achille, qui avait eu le bonheur d’avoir pendant sa vie un ami fidèle, et après sa mort un grand poète pour célébrer ses exploits. Finalement, en commémoration de son passage, Alexandre éleva des autels permanents en l’honneur de Zeus, d’Athênê et d’Hêraklês, tant sur le point de l’Europe que son armée cavait quitté que sur celui de l’Asie où elle avait débarqué[43]. Les actes d’Alexandre, sur l’emplacement à jamais mémorable d’Ilion, sont intéressants en ce qu’ils révèlent un côté de son imposant caractère, — la veine de sympathie légendaire et de sentiment religieux qui seule constituait son analogie avec les Grecs. Le jeune prince macédonien n’avait rien de ce sens de droits et d’obligations corrélatifs qui caractérisait les Grecs libres d’une communauté municipale. Mais il était sous bien des points une reproduction des Grecs héroïques[44], ses belliqueux ancêtres de la légende, Achille et Neoptolemos, et d’autres de cette race Æakide qui n’avaient pas leurs pareils dans les attributs de la force ; — c’était un homme de mouvement violent dans toutes les directions, quelquefois généreux., souvent vindicatif, plein d’ardeur dans ses affections individuelles tant d’amour que de haine, mais dévoré surtout d’une disposition inextinguible à combattre, d’un désir de conquêtes, et d’une soif d’établir à tout prix sa supériorité de force sur les autres, — Jura negat sibi nata, nihil non arrogat armis, — se faisant gloire, non seulement du talent de général et de la direction donnée aux bras des soldats, mérites couronnés par la victoire, mais encore de l’ardeur personnelle d’un chef homérique, le premier de tous à affronter et le danger et la peine. Aux dispositions qui ressemblaient à celles d’Achille, Alexandre dans le fait ajoutait un attribut d’un ordre beaucoup plus élevé. Comme général, il était au-dessus de son époque en combinaisons prévoyantes et même à longue portée. Avec tout son courage exubérant et son caractère ardent, rien ne fut jamais négligé sous le rapport des précautions militaires systématiques. En cela il emprunta beaucoup, bien qu’avec de nombreux perfectionnements qui lui furent personnels, à. l’intelligence grecque en tant qu’appliquée à l’état militaire. Maïs le caractère et les dispositions, qu’il possédait en par tant pour l’Asie avaient les traits, à la fois frappants et repoussants, d’Achille, plutôt que ceux d’Agésilas ou d’Epaminondas. L’armée, passée en revue sur le rivage asiatique, après qu’elle eut franchi le détroit, présenta un total de trente mille homme d’infanterie et de quatre mille cinq cents de cavalerie, distribués ainsi :
Telle semble être l’énumération la plus croyable de la première armée d’invasion d’Alexandre. Il y eut toutefois d’autres rapports, dont le plus élevé portait le chiffre à quarante-trois mille hommes d’infanterie, avec quatre mille chevaux[45]. Outre ces troupes, il a dû y avoir aussi un train puissant de machines à projectiles et d’engins, pour ALEXANDRE EN ASIE 85 batailles et sièges, que nous verrons bientôt en opération. Quant à l’argent, la caisse militaire d’Alexandre, épuisée en partie par des dons accordés en profusion à ses officiers macédoniens[46], était aussi pauvrement garnie que celle de Napoléon Buonaparte quand il entra pour la première fois en Italie, pour ouvrir sa brillante campagne de 1796. Suivant Aristobule, il avait avec lui soixante-dix talents ; suivant une autre autorité, il n’avait de ressources pour nourrir son armée que pendant trente jours. Et il n’avait même pu réunir ses auxiliaires ni compléter l’équipement de son armée sans faire une dette de huit cents talents, en plus de celle de cinq cents contractée par son père Philippe[47]. Bien que Plutarque[48] s’étonne de la faiblesse de l’armée avec laquelle Alexandre méditait l’exécution de si grands projets, cependant le fait est qu’en infanterie il était beaucoup au-dessus de toutes les forces que les Perses avaient à lui opposer[49], sans parler de la discipline et de l’organisation comparatives, qui surpassaient même celles des Grecs mercenaires, formant la seule bonne infanterie au service de la Perse ; tandis que sa cavalerie, bien qu’inférieure en nombre, était supérieure en qualité et pour le choc d’un combat corps à corps. La plupart des officiers qui exerçaient un commandement important dans l’armée d’Alexandre étaient des Macédoniens indigènes. Son ami personnel, intime, Hephæstiôn, aussi bien que ses gardes du corps Leonnatos et Lysimachos, étaient natifs de Pella ; Ptolemæos, fils de Lagos, et Pithôn étaient Eordiens de la haute Macédoine ; Krateros et Perdikkas, du district de la haute Macédoine, appelé Orestis[50] ; Antipater, avec son fils Kassandre, Kleitos, fils de Drôpidês, Parmeniôn, avec ses deux fils Philôtas et Nikanor, Seleukos, Kœnos, Amyntas, Philippe (ces deux derniers noms étaient portés par plus d’une personne), Antigonos, Neoptolemos[51], Meleagros, Peukestês, etc., semblent tous avoir été des Macédoniens indigènes. Tous ou la plupart d’entre eux avaient été exercés à la guerre sous Philippe,-dans le service duquel Parmeniôn et Antipater, en particulier, avaient occupé un rang élevé. Des nombreux Grecs qui servaient sous Alexandre, nous en voyons peu qui eussent un poste important. Medios, Thessalien de Larissa, était an nombre de ses compagnons familiers ; mais le plus capable et le plus distingué de tous était Eumenês, natif de Kardia, dans la Chersonèse de Thrace. Eumenês, combinant une excellente éducation grecque avec de l’activité corporelle et un esprit entreprenant, avait attiré, étant jeune homme, l’attention de Philippe et avait été nommé son secrétaire. Après avoir rempli ces fonctions pendant sept ans, jusqu’à la mort de Philippe, il fut maintenu par Alexandre dans le poste de premier secrétaire pendant toute la vie de ce roi[52]. Il dirigeait la plus grande partie de la correspondance d’Alexandre et le journal de ses actes, qui était tenu sous le nom d’Éphémérides royales. Mais, bien que ses devoirs spéciaux eussent ainsi un caractère civil, il n’était pas moins éminent comme officier sur le terrain. Chargé à l’occasion d’un commandement militaire élevé, il reçut d’Alexandre des récompenses et des marques d’estime signalées. Malgré ces grandes qualités — ou peut être à cause d’elles, — il était l’objet d’une jalousie .et d’une aversion marquées[53] de la part des Macédoniens, — depuis Hephiestiôn, l’ami, et Neoptolemos, le premier écuyer d’Alexandre, jusqu’aux principaux soldats de la phalange. Neoptolemos méprisait Eumenês comme un calligraphe peu belliqueux. L’orgueil plein de mépris avec lequel les Macédoniens en étaient venus alors à regarder les Grecs est un trait caractéristique remarquable de l’armée victorieuse d’Alexandre, aussi bien qu’un nouveau trait dans l’histoire ; il répondait à l’ancien sentiment hellénique auquel Démosthène, peu d’années auparavant, s’était livré à l’égard des Macédoniens[54]. Bien qu’on eût laissé Alexandre débarquer en Asie sans opposition, une armée était déjà réunie sous les satrapes persans à quelques journées de marche d’Abydos. Depuis que l’Égypte et la Phénicie avaient été reconquises, environ huit ou neuf années auparavant, par le roi de Perse Ochus, la puissance de cet empire avait été rétablie à un point égal à ce qu’elle était à toute époque antérieure depuis l’échec de Xerxès en Grèce. Les succès persans en Égypte avaient été obtenus principalement grâce aux armes des Grecs mercenaires, sous la conduite et par l’habileté du général rhodien Mentor, qui, secondé par l’influence prépondérante de l’eunuque Bagôas, ministre de confiance d’Ochus, reçut non seulement d’amples présents, mais encore le titre de commandant militaire sur l’Hellespont et le bord de la mer Asiatique[55]. Il, obtint le rappel de son frère Memnôn, qui, avec son beau-frère Artabazos, avait été obligé de quitter l’Asie à la suite d’une révolte malheureuse contre les Perses, et avait trouvé asile chez Philippe[56]. De plus, il réduisit, par force ou par fraude, divers chefs grecs et asiatiques sur la côte d’Asie, entre autres, le remarquable Hermeias, ami d’Aristote et maître du poste fortifié d’Atarneus[57]. Ces succès de Mentor semblent avoir été remportés vers 343 avant J.-C. Lui et son frère Memnôn après lui soutinrent avec vigueur l’autorité du roi persan dans les régions voisines de l’Hellespont. Ce fut probablement par eux que des troupes furent envoyées de l’autre côté du détroit, tant pour délivrer la ville de Perinthos assiégée par Philippe que pour agir contre ce prince dans d’autres parties de la Thrace[58] ; qu’un chef asiatique, qui intriguait pour faciliter l’invasion projetée de Philippe en Asie, fut arrêté et envoyé prisonnier à la cour de Perse, et que des ambassadeurs d’Athènes, qui sollicitaient du secours contre Philippe, furent dirigés sur le même endroit[59]. Ochus, bien qu’il réussît à rendre à la domination persane toute son étendue, fut un tyran sanguinaire, qui versa à flots le sang de sa famille et de ses courtisans. Vers l’an 338 avant J.-C., il mourut empoisonné par l’eunuque Bagôas, qui plaça sur le trône Arsês, un des fils du rai, en tuant tous les autres. Toutefois, après deux ans, Bagôas eut de la défiance d’Arsês et le mit aussi à mort avec tous ses enfants ; il ne laissa en vie aucun descendant direct de la famille royale. Alors il éleva au trône un- de ses amis nommé Darius Codoman (descendant d’un des frères d’Artaxerxés Mnemôn), qui avait acquis de la gloire dans une guerre récente contre les Kadusiens, en tuant en combat singulier un champion formidable de l’armée ennemie. Toutefois, Bagôas tenta bientôt d’empoisonner aussi Darius ; mais ce dernier, découvrant le piége, le força à boire lui-même le breuvage mortel[60]. Malgré ces meurtres et ce changement dans la ligne de succession, qu’Alexandre reprocha plus tard à Darius[61], l’autorité de celui-ci semble avoir été reconnue, sans opposition considérable, dans tout l’empire persan. Succédant au trône dans la première partie de 336 avant J.-C., alors que Philippe organisait l’expédition projetée en Perse, et que la première division macédonienne, sous Parmeniôn et Attalos, faisait déjà la guerre en Asie, — Darius prépara des mesures de défense à l’intérieur et essaya d’encourager des mouvements anti-macédoniens en Grèce[62]. Lors de l’assassinat de Philippe par Pausanias, le roi de Perse déclara publiquement (faussement sans doute) qu’il avait été l’instigateur du meurtre, et il fit allusion en termes méprisants au jeune Alexandre[63]. Croyant le danger passé du côté de la Macédoine, il se relâcha imprudemment de ses efforts et arrêta ses subsides pendant les premiers mois du règne d’Alexandre, quand ce dernier aurait pu être sérieusement embarrassé en Grèce et en Europe par l’emploi efficace des vaisseaux et de l’argent de la Perse. Mais les succès récents d’Alexandre en Thrace, en Illyria et en Bœôtia convainquirent Darius que le danger n’était point passé, de sorte qu’il reprit ses préparatifs de défense. On donna l’ordre d’équiper la flotte phénicienne ; les satrapes en Phrygia et en Lydia réunirent une armée considérable, composée surtout de mercenaires grecs, tandis qu’on fournit à Memnôn, sur le bord de la mer, le moyen de prendre cinq mille de ces mercenaires sous son commandement séparé[64]. Nous ne pouvons retracer avec aucune exactitude le cours de ces événements, pendant les dix-neuf mois qui s’écoulèrent entre l’avènement d’Alexandre et son débarquement en Asie (d’août 336 av. J.-C. à mars ou avril 334 av. J.-C.). Nous apprenons en général que Memnôn fut actif et même agressif sur la côte nord-est de la mer ragée. S’avançant au nord de son propre territoire (la région d’Assos ou d’Atarneus, bordant le golfe d’Adramyttion)[65], au delà de la chaîne du mont Ida, il arriva soudainement près de la ville de Kyzikos, sur la Propontis. Toutefois, il échoua, quoique de peu seulement, dans la tentative qu’il fit pour la surprendre, et fut forcé de se contenter d’un riche butin, qu’il enleva au district environnant[66]. Les généraux macédoniens Parmeniôn et Kallas s’étaient rendus en Asie avec des corps de troupes. Parmeniôn, agissant en polis, prit Grynion ; mais il fut forcé par Memnôn de lever le siége de Pitanê ; tandis que Kallas, dans la Troade, fut attaqué, défait et obligé de se retirer à Rhœteion[67]. Nous voyons ainsi que, pendant l’hiver qui précéda le débarquement d’Alexandre, les Perses avaient des forces considérables, et que Memnôn était à la fois actif et heureux même contre les généraux macédoniens ; sur la région nord-est de la mer £Égée. Cette circonstance peut nous aider à expliquer cette fatale imprudence par laquelle les Perses permirent à Alexandre de transporter sans opposition sa grande armée en Asie, dans le printemps de 334 avant J.-C. Ils possédaient d’amples moyens de garder l’Hellespont, s’ils avaient voulu amener leur flotte, qui, comprenant les forces des villes phéniciennes, était décidément supérieure à tout armement naval dont disposait Alexandre. La flotte persane vint réellement dans la mer 1Egée quelques semaines plus tard. Or les desseins, les préparatifs et même le temps projeté de la marche d’Alexandre ont dû être bien connus non seulement de Memnôn, mais encore des satrapes de l’Asie Mineure, qui avaient rassemblé des troupes pour s’opposer à lui. Ces satrapes, par malheur, se croyaient en état de lui tenir tête en rase campagne, et méprisaient l’opinion prononcée que Memnôn avait du contraire ; et même ils repoussaient son sage avis par des imputations méfiantes et calomnieuses. Au moment où Alexandre débarqua, une puissante armée persane était déjà rassemblée près de Zeleia, dans la Phrygia hellespontine, sous le commandement d’Arsitês, le satrape phrygien, appuyé par plusieurs autres Perses de distinction, — Spithridatês (satrape de Lydia et d’Iônia), Pharnakês, Atizyês, Mithridatês, Rheomithrês, Niphatês, Petinês, etc. Quarante de ces hommes étaient de haut rang (appelés parents de Darius) et distingués par leur valeur personnelle. Le plus grand nombre de l’armée consistait en cavalerie, comprenant des Mèdes, des Baktriens, des Hyrkaniens, des Kappadokiens, des Paphlagoniens, etc.[68] En cavalerie, ils surpassaient beaucoup Alexandre ; mais leur infanterie était fort inférieure en nombre[69], composée toutefois, en proportion considérable, de mercenaires grecs. Le total persan est donné par Arrien comme étant de 20.000 hommes de cavalerie et de 20.000 fantassins mercenaires environ ; par Diodore, comme étant de 10.000 hommes de cavalerie et de 100.000 d’infanterie ; il est même porté par Justin à 600.000. Les chiffres d’Arrien sont les plus croyables ; dans ceux de Diodore, le total de l’infanterie est certainement beaucoup au-dessus de la vérité, — celui de la cavalerie probablement au-dessous. Memnôn, qui était présent avec ses fils et avec sa propre division, dissuada fortement les chefs persans de hasarder une bataille. Leur rappelant que les Macédoniens étaient non seulement supérieurs de beaucoup en infanterie, mais encore encouragés par l’habile direction d’Alexandre, — il insista sur la nécessité d’employer leur nombreuse cavalerie à détruire les fourrages et les provisions, et, s’il était nécessaire, les villes elles-mêmes, afin de rendre impraticable tout progrès considérable de l’armée d’invasion. Tout en restant strictement sur la défensive en Asie, il recommandait de porter la guerre offensive en Macédoine ; d’amener la flotte, d’embarquer une puissante armée de terre et de faire d’énergiques efforts, non seulement pour attaquer les points vulnérables d’Alexandre dans son royaume, mais encore pour encourager des hostilités actives contre lui de la part des Grecs et de ses autres voisins[70]. Si ce plan eût été énergiquement exécuté, au moyen des armes et de l’argent des Perses, nous ne pouvons guère douter qu’Antipater en Macédoine ne se fût trouvé bientôt pressé par des dangers et des embarras sérieux, et qu’Alexandre n’eût été forcé de revenir et’ de protéger son propre empire, et peut-être empêché par la flotte persane de ramener toute son armée. En tout cas, ses plans d’invasion en Asie auraient été suspendus pour le moment. Mais il fut tiré de ce dilemme par l’ignorance, l’orgueil et les intérêts pécuniaires des chefs persans. Incapables d’apprécier la supériorité militaire d’Alexandre et ayant en même temps conscience de leur propre valeur personnelle, ils repoussèrent la proposition de retraite comme déshonorante, insinuant que Memnôn désirait prolonger la guerre, afin d’exalter sa propre importance aux yeux de Darius. Ce sentiment de dignité militaire fut encore fortifié par ce fait, que les chefs militaires persans, qui tiraient du sol tous leurs revenus, auraient été appauvris en détruisant les produits de la terre. Arsytês, dans le territoire duquel se trouvait l’armée et qui devait le premier souffrir de l’exécution du plan, déclara avec hauteur qu’il ne permettrait pas qu’on y brûlât une seule maison[71]. Occupant la même satrapie que Pharnabazos avait possédée soixante ans auparavant, il sentait qu’il serait réduit à la même gêne que Pharnabazos pressé par Agésilas, — de ne pouvoir se procurer un dîner dans son propre pays[72]. La proposition de Memnôn fut rejetée, et il fut résolu qu’on attendrait l’arrivée d’Alexandre sur les rives du Granikos. Ce cours d’eau peu important, célébré dans l’Iliade et immortalisé pour être lié au nom d’Alexandre, sort d’une des hauteurs du mont Ida près de Skêpsis[73], et il coule vers le nord pour se jeter dans la Propontis, qu’il atteint à un point un peu à l’est de la ville grecque de Parion. Il n’a pas une grande profondeur ; près du point où les Perses étaient campés, il semble avoir été guéable en bien des endroits ; mais sa rive droite était quelque peu élevée et escarpée, offrant ainsi un obstacle à une attaque d’un ennemi. Les Perses, s’avançant de Zeleia, prirent position près du côté occidental du Granikos, où les dernières pentes du mont Ida descendent jusque dans la plaine d’Adrasteia, cité grecque située entre Priapos et Parion[74]. Cependant Alexandre se dirigea vers cette position, en partant d’Arisbê (où il avait passé son armée en revue) ; — le premier jour il marcha jusqu’à Perkôtê, le second jusqu’au fleuve du Praktios, le troisième jusqu’à Hermôtos ; en route il reçut la reddition spontanée de la ville de Priapos. Sachant que l’ennemi n’était pas à une grande distance, il lança en avant un corps d’éclaireurs sous Amyntas, composé de quatre escadrons de cavalerie légère et d’un de la grosse cavalerie macédonienne (celle des Compagnons). D’Hermôtos (le quatrième jour depuis Arisbê), il marcha droit au Granikos, en ordre régulier, avec la masse de sa phalange en doubles files, sa cavalerie sur les deux ailes et le bagage à l’arrière. En approchant du fleuve, il fit ses dispositions pour une attaque immédiate, bien que Parmeniôn conseillât d’attendre jusqu’au lendemain matin. Sachant bien, comme Memnôn, que les chances d’une bataille rangée étaient toutes contraires aux Perses, il résolut de ne pas leur laisser l’occasion de décamper pendant la nuit. Dans l’ordre de bataille d’Alexandre, la phalange ou infanterie pesamment armée formait le corps central. Les six taxeis ou divisions dont elle se composait étaient commandées (en comptant de droite à gauche) par Perdikkas, Kœnos, Amyntas fils d’Andromenês, Philippe, Meleagros et Krateros[75]. Immédiatement à la droite da la phalange étaient les hypaspistæ, ou infanterie légère, sous Nikanor, fils de Parmeniôn, — ensuite la cavalerie légère ou. lanciers, les Pæoniens, et l’escadron apolloniate de la cavalerie des Compagnons commandé par l’ilarque Sokratês, tous sous Amyntas, fils d’Arrhibæos, en dernier lieu tout le corps de la cavalerie des. Compagnons, les archers et les akontistæ agrianiens, tous sous Philôtas (fils de Parmeniôn), dont la division formait l’extrême droite[76]. Le flanc gauche de la phalange était également protégé par trois divisions distinctes de cavalerie ou de troupes légères, — d’abord par les Thraces, sous Agathôn, — ensuite par la cavalerie des alliés, sous Philippe, fils de Menelaos, — en dernier lieu par la cavalerie thessalienne, sous Kallas, dont la division formait l’extrême gauche. Alexandre lui-même prit le commandement de la droite, donnant celle de la gauche à Parmeniôn ; la droite et la gauche signifient les deux moitiés de l’armée, chacune d’elles comprenant trois taxeis ou divisions de la phalange avec la cavalerie sur son flanc, — car il n’y avait pas de centre reconnu sous un commandement distinct. De l’autre côté du Granikos, la cavalerie persane bordait la rive. Les Mèdes et les Baktriens étaient à leur droite, sous Rheomithrês, — les Paphlagoniens et les Hyrkaniens au centre, sous Arsitês et Spithridatês, — à la gauche étaient Memnôn et Arsamenês, avec leurs divisions[77]. L’infanterie persane, tant asiatique que grecque, était tenue en arrière en réserve ; car on comptait sur la cavalerie seule pour disputer le passage du fleuve. C’est dans cet ordre que les deux parties restèrent pendant quelque temps, s’observant l’une l’autre dans un silence plein d’anxiété[78]. Vu qu’il n’y avait ni feu ni fumée comme dans les armées modernes, tous les détails de chaque côté étaient clairement visibles pour l’autre ; de sorte que les Perses reconnurent facilement Alexandre lui-même à l’aile droite macédonienne à l’éclat de son armure et de son costume militaire, aussi bien qu’à la tenue respectueuse de ceux qui l’entouraient. En conséquence, leurs premiers chefs affluèrent à leur propre gauche, qu’ils renforcèrent de la principale force de leur cavalerie, afin de s’opposer à lui personnellement. Bientôt Alexandre adressa quelques mots d’encouragement à ses troupes, et donna l’ordre d’avancer. Il voulut que la première attaque fût faite par l’escadron de la cavalerie des Compagnons dont c’était le tour ce jour-là de prendre la tête — l’escadron d’Apollonia, dont Sokratês était capitaine (commandé en ce jour par Ptolemæos, fils de Philippe) —, appuyé par la cavalerie légère ou lanciers, par les archers pæoniens (infanterie), et par une division d’infanterie régulièrement armée, vraisemblablement des hypaspistæ[79]. Il entra alors lui-même dans le fleuve, à la tête de la moitié de droite de l’armée, cavalerie et infanterie, qui s’avança au son des trompettes et avec les cris de guerre habituels. Comme les creux que l’eau présentait à l’occasion empêchaient une marche directe avec une seule ligne uniforme, les Macédoniens allaient de biais conformément aux espaces guéables, en maintenant leur front étendu de manière à approcher de la ligne opposée autant que possible en ligne, et non en colonnes séparées avec les flancs exposés à la cavalerie persane[80]. Non seulement la droite sous Alexandre, mais encore la gauche sous Parmeniôn avança et franchit le fleuve d’un mouvement semblable et avec les mêmes précautions. Le premier détachement sous Ptolemæos et Amyntas, en arrivant à la rive opposée, rencontra une vigoureuse résistance, concentrée comme elle l’était là sur un seul point. Il trouva Memnôn et ses fils avec les meilleurs des cavaliers persans immédiatement devant lui ; quelques-uns sur le haut de la rive d’où ils lançaient en bas leurs javelines, — d’autres en bas sur le bord de l’eau prêts à en venir à un combat corps à corps. Les Macédoniens firent tous leurs efforts pour arriver à terre et se faire jour de vive force à travers les cavaliers persans, mais en vain, Ayant à la fois un terrain plus bas et un pied mal assuré, ils ne purent produire aucun effet ; mais ils furent rejetés en arrière avec quelques pertes, et se retirèrent sur le corps principal qu’Alexandre amenait alors à travers le fleuve. Quand il approcha du rivage, la même lutte se renouvela autour de sa personne avec un redoublement d’ardeur des deux côtés. Il était lui-même parmi les premiers, et son exemple animait tous ceux qui étaient auprès de lui. Les cavaliers des deux côtés se serrèrent les uns contre les autres, et ce fut une lutte de force physique, et de pression d’hommes et de chevaux ; mais les Macédoniens avaient un grand avantage en ce qu’ils étaient accoutumés à l’usage de la forte javeline propre au combat corps à corps, tandis que l’arme des Perses était la javeline qu’on lançait. A la fin, la résistance fut surmontée, et Alexandre, avec ceux qui l’entouraient, refoulant graduellement les défenseurs, finit par gravir la haute rive jusqu’au terrain uni. Sur d’autres points, la résistance ne fut pas aussi vigoureuse. La gauche et le centre des Macédoniens, franchissant le fleuve en même temps à tous les endroits praticables le long de toute la ligne, triomphèrent des Perses postés sur la pente, et gagnèrent le terrain uni avec une facilité relative[81]. Dans le fait, il n’était possible à aucune cavalerie de rester sur le bord pour s’opposer à la phalange avec sa rangée de longues piques partout où celle-ci pouvait parvenir au bord en un front quelque peu continu. Le passage aisé des Macédoniens à d’autres points servit à forcer ceux des Perses, qui luttaient avec Alexandre lui-même sur la pente, à se retirer sur le terrain uni au-dessus. Ici encore, comme au bord de l’eau, Alexandre fut le premier à lutter en personne. Sa pique ayant été brisée, il se tourna vers un soldat près de lui, — Aretis, l’un des gardes à cheval qui l’aidaient en général à se mettre en selle, — et lui en demanda une autre. Mais cet homme, qui avait aussi brisé sa pique, en montra le fragment à Alexandre, le priant de s’adresser à un autre ; alors le Corinthien Demaratos, qui faisait partie de la cavalerie des Compagnons tout près de là, lui donna son arme à la place. Ainsi armé de nouveau, Alexandre lança son cheval en avant contre Mithridatês (gendre de Darius) qui amenait une colonne de cavalerie pour l’attaquer, mais qui lui-même était considérablement en avant de sa colonne. Alexandre lança sa pique dans le visage de Mithridatês, et le renversa sur le sol ; il se tourna ensuite vers un autre des chefs persans, Rhœsakês, qui le frappa a la tète d’un coup de cimeterre, fit sauter une portion de son casque, mais ne pénétra pas au delà. Alexandre se vengea de ce coup en perçant Rhœsakês, avec sa pique, de part en part[82]. Cependant un troisième chef persan, Spithridatês, était à ce moment derrière Alexandre et tout près de lui, la main et le cimeterre levés pour l’abattre. A cet instant critique, Kleitos, fils de Dropidês, — l’un des anciens officiers de Philippe, haut placé dans le service macédonien, — frappa de toute sa force le bras levé de Spithridatês, et le sépara du corps, sauvant ainsi la vie à Alexandre. D’autres Persans de marque, parents de Spithridatês, se précipitèrent en désespérés sur Alexandre, qui reçut beaucoup de coups sur son armure et courut un grand danger. Mais les Compagnons qui étaient à ses ôtés redoublèrent d’efforts, tant pour défendre sa personne que -pour seconder sa hardiesse aventureuse. Ce fut sur ce point que la cavalerie persane fut rompue pour la première fois. A la gauche de la ligne macédonienne, la cavalerie thessalienne combattit aussi avec vigueur et succès[83], et les fantassins armés à la légère, généralement mêlés à la cavalerie d’Alexandre, firent beaucoup de mal à l’ennemi. La déroute de la cavalerie persane, une fois commencée, ne tarda pas à devenir générale. Elle s’enfuit dans toutes les directions, poursuivie par les Macédoniens. Mais Alexandre et ses officiers arrêtèrent cette ardeur de poursuite, en rappelant leur cavalerie pour achever la victoire. L’infanterie persane, Asiatiques aussi bien que Grecs, était restée sans mouvement ni ordres, considérant la bataille de cavalerie qui venait de se terminer d’une manière si désastreuse. C’est sur elle qu’Alexandre tourna immédiatement son attention[84]. Il fit avancer sa phalange et les hypaspistæ pour l’attaquer de front, tandis que sa cavalerie attaqua de tous côtés ses flancs et ses derrières que rien ne protégeait : il chargea lui-même avec sa cavalerie et eut un cheval tué sous lui. Son infanterie seule était plus nombreuse que l’infanterie ennemie ; de sorte que contre une pareille inégalité le résultat ne pouvait guère être douteux. La plus grande partie de ces mercenaires, après une vaillante résistance, fut taillée en pièces sur place. On nous dit qu’il n’en échappa aucun, à l’exception de deux mille qui furent faits prisonniers et de quelques-uns qui restèrent cachés sur le champ de bataille au milieu des cadavres[85]. Dans cette défaite complète, et signalée, les pertes de la cavalerie persane ne furent pas très sérieuses, à ne considérer que le nombre, — car il n’y eut que mille hommes tués. Mais le massacre des principaux Persans, qui s’étaient exposés avec une extrême bravoure dans le conflit personnel contre Alexandre, fut terrible. Non seulement Mithridatês, Rhœsakês et Spithridatês, dont les noms ont été mentionnés déjà, furent tués, — mais encore Pharnakês, beau-frère de Darius ; Mithrobarzanês, satrape de Kappadokia ; Atizyês, Niphatês, Petinês et autres : tous Perses de rang et de conséquence. Arsytês, le satrape de Phrygia, dont la témérité avait surtout causé le rejet de l’avis de Memnôn, se sauva du champ de bataille ; mais il périt peu après de sa propre main, accablé de douleur et d’humiliation[86]. L’infanterie persane ou gréco-persane, bien que probablement il s’en soit échappé plus individuellement que ne l’implique l’exposé d’Arrien, fut un corps irréparablement ruiné. Il ne resta pas d’armée en campagne, et il ne put dans la suite en être réuni dans l’Asie Mineure. Les pertes du côté d’Alexandre furent, dit-on, très peu considérables. Vingt-cinq hommes de la cavalerie des Compagnons, appartenant à la division sous Ptolemæos et Amyntas, furent tués dans la première tentative malheureuse faite pour passer le fleuve. De l’autre cavalerie, il y eut soixante hommes tués en tout ; de l’infanterie, trente. Voilà ce qu’on nous donne comme la perte entière du côté d’Alexandre[87]. C’est seulement le nombre des tués. Celui des blessés n’est pas donné ; mais en admettant qu’il soit dix fois le nombre des tués, le total des deux réunis sera mille deux cent soixante-cinq[88]. Si cela est exact, la résistance de la cavalerie persane, excepté près du point oh Alexandre lui-même et les chefs persans en vinrent aux prises, ne peut avoir été sérieuse ni prolongée longtemps. Mais si nous ajoutons encore la lutte avec l’infanterie, la faiblesse du total assigné pour les Macédoniens tués et blessés paraîtra plus surprenante encore. Le total de l’infanterie persane est porté à près de vingt mille hommes, pour la plupart mercenaires grecs. Il n’y en eut que deux mille faits prisonniers ; presque tout le reste (suivant Arrien) fut tué. Or, les Grecs mercenaires étaient bien armés, et il n’est pas probable qu’ils se soient laissés tuer impunément ; en outre, Plutarque affirme expressément qu’ils résistèrent avec une valeur désespérée, et que la plus grande partie des pertes macédoniennes furent subies dans le conflit contre eux. Il n’est donc pas aisé de comprendre comment on peut faire rentrer le nombre total des tués dans celui qu’affirme Arrien[89]. Après la victoire, Alexandre manifesta la plus grande sollicitude pour ses soldats blessés, qu’il visita et consola en personne. Il fit faire en airain, par Lysippos, les statues des vingt-cinq Compagnons tués, statues qui, par son ordre, furent dressées à Dion en Macédoine, où elles étaient encore debout du temps d’Arrien. Il accorda aussi aux parents survivants de tous ceux qui périrent une exemption de taxes et de service personnel. Les corps des hommes tués furent honorablement ensevelis, ceux de l’ennemi aussi bien que de ses propres soldats. Les deux mille Grecs qui étaient devenus ses prisonniers furent chargés de chaînes, et transportés en Macédoine pour y travailler comme esclaves, traitement auquel Alexandre les condamna, sur le motif qu’ils avaient pris les armes en faveur de l’étranger contre la Grèce, en contravention au vote général rendu par le congrès à Corinthe. En même temps, il envoya à Athènes trois cents armures choisies parmi le butin, pour être consacrées à Athênê dans l’Acropolis, avec cette inscription : — Alexandre, fils de Philippe, et les Grecs, à l’exception des Lacédæmoniens — consacrent ces offrandes — des dépouilles des étrangers qui habitent l’Asie[90]. Bien que le vote auquel Alexandre faisait appel ne représentât aucune aspiration grecque réelle, et accordât seulement une sanction qui ne pouvait être refusée sans danger, cependant ce fut pour lui une satisfaction de revêtir son propre désir d’agrandissement personnel du nom d’un dessein panhellénique supposé, ce qui était en même temps utile en fortifiant son empire sur les Grecs, qui étaient les seules personnes capables, soit comme officiers, soit comme soldate, de soutenir la domination persane contre lui. Ses conquêtes furent l’anéantissement du pur hellénisme, bien qu’elles en répandissent un vernis extérieur, et, en particulier, la langue grecque, sur une grande partie du monde oriental. Les véritables intérêts grecs étaient plutôt du côté de Darius que de celui d’Alexandre. La bataille du Granikos, livrée par Arsitês et les autres satrapes, contrairement à l’avis de Memnôn, fat en outre si peu habilement soutenue par eux, que la vaillance de leur infanterie, le corps le plus formidable de Grecs qui et jamais été au service de la Perse, fut rendue presque inutile. Ce fut, à proprement parler, la cavalerie persane qui combattit dans la bataille[91] ; l’infanterie resta, pour être entourée et détruite ensuite. Aucune victoire ne pouvait, être ni plus décisive ni plus terrifiante que celle d’Alexandre. Il ne restait pas de forces en campagne à lui opposer. L’impression produite par une si grande catastrophe publique était augmentée par deux circonstances accessoires : d’abord, parle nombre des seigneurs persans qui périrent, réalisant presque les plaintes d’Atossa, de Xerxès et du Chœur dans les Persæ d’Æschyle[92], après la bataille de Salamis ; — ensuite, par la vaillance chevaleresque et heureuse d’Alexandre lui-même, qui, rivalisant avec l’Achille homérique, non seulement se précipita le premier dans la mêlée, mais tua deux de ces seigneurs de sa propre main. De pareils exploits, frappants même quand nous en lisons aujourd’hui le récit, ont dû, au moment où ils s’accomplirent, agir très puissamment sur l’imagination des contemporains. Plusieurs des montagnards mysiens du voisinage, bien que sujets mutins à l’égard de la Perse, descendirent de leurs montagnes pour se soumettre à lui, et il leur fut permis d’occuper leurs terres en payant le même tribut qu’auparavant. Les habitants de Zeleia, cité grecque voisine, dont les troupes avaient servi avec les Perses, se rendirent et obtinrent leur pardon, Alexandre admettant l’excuse qu’ils alléguaient de n’avoir servi que par contrainte. Il envoya ensuite Parmeniôn attaquer Daskylion, la forteresse et la principale résidence du satrape de Phrygia. Cette place elle-même fut évacuée par la garnison, et livrée sans doute avec un trésor considérable qu’elle renfermait. Toute la satrapie de Phrygia tomba ainsi au pouvoir d’Alexandre, et Kallas fut chargé de l’administrer au nom du roi, en levant le même tribut que celui qui avait été payé auparavant[93]. Il se dirigea lui-même, avec ses principales forces, dans la direction du sud, vers Sardes, — la capitale de la Lydia et le poste le plus important des Perses en Asie Mineure. La citadelle de Sardes, — située sur un rocher élevé et escarpé s’avançant du mont Tmolos, fortifiée par une triple muraille avec une garnison suffisante, — était regardée comme imprenable, et, en tout cas, elle n’aurait guère pu être prise que par un long blocus[94], qui aurait donné du temps pour l’arrivée de la flotte et les opérations de Memnôn. Cependant, la terreur qui accompagnait alors le vainqueur macédonien était telle, que quand il arriva à huit milles (près de 13 kilom.) de Sardes, il rencontra non seulement une députation des principaux citoyens, mais encore le gouverneur persan de la citadelle, Mithrinês. La ville, la citadelle, la garnison et le trésor lui furent livrés sans coup férir. Heureusement pour Alexandre, il n’y eut en Asie aucun gouverneur persan qui déployât le courage et la fidélité qu’avaient montrés Maskamès et Bogês, après que Xerxès avait été chassé de Grèce[95]. Alexandre traita Mithrinês avec courtoisie et honneur ; il accorda la liberté aux habitants de Sardes et aux autres Lydiens, en général, avec l’usage de leurs propres lois lydiennes. Sardes livrée par Mithrinês fut une bonne fortune signalée pour Alexandre. En montant à la citadelle, il en contempla avec étonnement la force prodigieuse ; il se félicita d’une acquisition si aisée et donna l’ordre d’y construire un temple de Zeus Olympien, sur l’emplacement où avait été situé l’ancien palais des rois de Lydia. Il nomma Pausanias gouverneur de la citadelle, avec une garnison de Péloponnésiens d’Argos ; Asander, satrape de la contrée, et Nikias, percepteur du tribut[96]. La liberté accordée aux Lydiens, quelle qu’en fût la somme, ne les exonéra pas de payer le tribut habituel. De Sardes, il ordonna à Kallas, le nouveau satrape de la Phrygia hellespontine, — et à Alexandre, fils d’Aeropos, qui avait été promu à la place de Kallas au commandement de la cavalerie thessalienne, — d’attaquer Atarneus et le district appartenant à Memnôn, sur la côte asiatique, en face de Lesbos. Dans l’intervalle, il dirigea lui-même sa marche vers Ephesos, où il arriva le quatrième jour. Tant à Ephesos qu’à Milêtos, les deux principales forteresses des Perses sur la côte, comme Sardes l’était à l’intérieur, la catastrophe soudaine subie sur les bords du Granitos avait répandu une terreur inexprimable. Hegesistratos, gouverneur de la garnison persane (mercenaires grecs) à Milêtos, envoya une lettre à Alexandre pour lui offrir de rendre la ville à son approche, tandis que la garnison à Ephesos, avec l’exilé macédonien Amyntas, s’embarqua sur deux trirèmes qui étaient dans le port et s’enfuit. Il parait qu’il y avait eu récemment une révolution politique dans la ville, dirigée par Syrphax et autres chefs, qui avaient établi un gouvernement oligarchique. Ces hommes, bannissant leurs adversaires politiques, avaient commis des déprédations dans le temple d’Artemis, renversé la statue de Philippe de Macédoine, qui y était consacrée, et détruit le sépulcre de Heropythos le libérateur, élevé dans l’agora[97]. Quelques membres du parti, bien qu’abandonnés par leur garnison, essayaient encore de demander du secours à Memnôn, qui cependant se trouvait à quelque distance. Alexandre entra dans la ville sans rencontrer de résistance, rappela les exilés, établit une constitution démocratique, et ordonna que le tribut payé jusqu’alors aux Perses le fût désormais à Artemis éphésienne. Syrphax et sa famille cherchèrent un refuge dans le temple, d’où ils furent tirés par le peuple et lapidés. Un plus grand nombre des membres du même parti auraient été mis à mort si la vengeance populaire n’eût été arrêtée par Alexandre, qui déploya une modération honorable et prudente[98]. Ainsi maître d’Ephesos, Alexandre se trouva en communication avec sa flotte, sous le commandement de Nikanor, et il reçut des propositions de reddition des deux cités voisines dates l’intérieur des terres, Magnêsia et Tralleis. Pour occuper ces cités, il envoya Parmeniôn avec cinq mille fantassins (la moitié Macédoniens) et deux cents hommes de la cavalerie des Compagnons, tandis qu’il expédia en même temps Antimachos, avec des forces égales, dans la direction du nord, pour délivrer les diverses cités des Grecs æoliens et ioniens. Cet officier reçut pour instructions de renverser dans chacune d’elles l’oligarchie régnante, qui agissait avec une garnison mercenaire comme instrument de la suprématie persane, — de remettre le gouvernement entre les mains des citoyens — et d’abolir tout payement de tribut. Lui-même, — après avoir pris part à une fête solennelle et à une procession dirigée vers le temple d’Artemis éphésienne, avec toute son armée en ordre de bataille, — s’avança au sud vers Milêtos, sa flotte sous Nikanor s’y rendant pare mer[99]. Il s’attendait probablement à entrer dans Milêtos et à y trouver aussi peu de résistance que dans Ephesos. Mais ses espérances furent trompées : Hegesistratos, commandant de la garnison danse cette ville, bien : que, sous l’impression immédiate de terreur causée par la défaite subie au Granitos, il eût écrit pour offrir de se soumettre, avait à ce moment changé de ton et avait résolu de tenir bon. La formidable flotte persane[100], forte de quatre cents vaisseaux de guerre phéniciens et cypriens avec des marins bien exercés, approchait. Cette armée navale qui, quelques semaines plus tôt, aurait empêché Alexandre de passer en Asie, offrait actuellement le seul espoir d’arrêter ses conquêtes rapides et faciles. Quelles mesures les officiers persans avaient-ils prises depuis la défaite du Granitos, nous l’ignorons. Beaucoup d’entre eux avaient fui à Milêtos, en même temps que Memnôn[101], et ils étaient probablement disposés, dans les circonstances désespérées actuelles, à accepter le commandement de Memnôn, comme leur seul espoir de salut, bien qu’ils eussent méprisé son conseil le jour de la bataille. Les villes de la principauté d’Atarneus, soumises à Memnôn, essayèrent-elles de résister aux Macédoniens, nous ne le savons pas. Toutefois, ses intérêts étaient si étroitement identifiés avec ceux de la Perse, qu’il avait envoyé sa femme et ses enfants comme otages, afin d’amener Darius à lui confier la direction suprême de la guerre. Bientôt ce prince envoya des ordres à cet effet[102], mais la flotte, à, son arrivée, ne semble pas avoir été sous le commandement de Memnôn, qui cependant était probablement à bord. Elle vint trop tard pour aider à défendre Milêtos. Trois jours avant son arrivée, Nikanor, l’amiral macédonien, avec sa flotte de cent soixante vaisseaux, avait occupé l’île de Ladê, qui commandait le port de cette cité. Alexandre trouva la portion extérieure de Milêtos évacuée, et il s’en empara sans rencontrer de résistance. Il était en train de faire des préparatifs pour assiéger la cité intérieure, et il avait déjà transporté quatre mille hommes de troupes dans l’île de Ladê, quand la puissante flotte persane arriva en vue, mais se trouva exclue de Milêtos, et obligée de s’amarrer sous le promontoire voisin de Mykale. Ne voulant pas renoncer sans une bataille à l’empire de la mer, Parmeniôn conseilla à Alexandre de combattre cette flotte, s’offrant à partager le danger à bord. Mais Alexandre désapprouva sa proposition, affirmant que sa flotte était inférieure non moins en habileté qu’en nombre ; que la parfaite éducation militaire des Macédoniens ne servirait de rien à bord, et qu’une défaite navale serait le signal d’une insurrection en Grèce. Outre ces raisons de prudence, objet du débat, Alexandre et Parmeniôn différaient encore au sujet de ce que les dieux promettaient dans la circonstance. Sur le bord de la mer, près de la poupe des vaisseaux macédoniens, Parmeniôn avait va un aigle, ce qui lui avait inspiré le ferme espoir que les vaisseaux seraient victorieux. Mais Alexandre soutint que cette interprétation était inexacte. Bien que l’aigle lui promît sans doute une victoire, cependant il avait été vu à terre, — et par conséquent ses victoires seraient sur terre : — aussi, le résultat annoncé était-il qu’il triompherait de la flotte persane au moyen d’opérations sur terre[103]. Cette partie du débat, entre deux militaires pratiques de talent, n’est pas ce qu’il y a de moins intéressant, en ce qu’elle explique, non seulement les susceptibilités religieuses de l’époque, mais encore la flexibilité de ce procédé d’interprétation, qui se prêtait également bien à des conséquences totalement opposées. La différence entre un prophète sagace et un prophète lourd d’esprit, adaptant des présages ambigus à des conclusions avantageuses ou funestes, avait une importance très considérable dans l’antiquité. Alexandre se prépara alors à attaquer vigoureusement Milêtos, en repoussant avec dédain une offre que lai fit un citoyen milésien nommé Glaukippos, — à savoir que la cité fût neutre et ouverte à lui aussi bien qu’aux Perses. Sa flotte, sous Nikanor, occupa le port, bloqua son entrée étroite contre les Perses, et fit des démonstrations menaçantes du bord de l’eau, tandis que lui-même amena contre les murs ses engins à battre en brèche, les ébranla ou les renversa en plusieurs endroits, et ensuite prit la cité d’assaut. Les Milésiens, avec la garnison mercenaire grecque, se défendirent vaillamment, mais l’impétuosité de l’attaque triompha de leur résistance. Un nombre considérable d’entre eux furent tués, et il n’y eut pas pour eux d’autre moyen de s’échapper que de sauter dans de petits bateaux. ou de flotter sur le creux d’un bouclier. La plupart même de ces fugitifs furent tués par les marins des trirèmes macédoniennes, mais une division de trois cents mercenaires grecs gagna un rocher isolé près de l’entrée du port, et s’y disposa à vendre chèrement sa vie. Alexandre, aussitôt que ses soldats furent complètement maîtres de la cité, alla lui-même, monté sur un vaisseau, pour attaquer les mercenaires sur le roc, prenant avec lui des échelles afin d’y effectuer un débarquement. Mais quand il vit qu’ils étaient résolus à faire une défense désespérée, il préféra leur accorder une capitulation, et il les reçut à son propre service[104]. Aux citoyens milésiens qui survivaient il accorda la condition de cité libre, tandis qu’il fit vendre comme esclaves tous les autres prisonniers. La puissante flotte persane du promontoire voisin de Mykale fut forcée de voir, sans pouvoir l’empêcher, la prise de Milêtos, et bientôt elle fut conduite à Halikarnassos. En même temps, Alexandre en arriva à prendre la résolution de licencier sa propre flotte qui, tout en lui coûtant plus qu’il ne pouvait y dépenser à ce moment, n’était néanmoins pas en état de lutter avec l’ennemi en pleine mer. Il comptait, en concentrant tous ses efforts dans des opérations sur terre, en particulier contre les cités de la côte, exclure la flotte persane de tout empire efficace sur l’Asie Mineure, et s’assurer cette contrée. En conséquence, il congédia tous les vaisseaux, ne conservant qu’une escadre de force médiocre pour les besoins du transport[105]. Probablement avant ce temps, toute la côte asiatique au nord de Milêtos, — comprenant les cités ioniennes et æoliennes, et la principauté de Memnôn, — ou avait accepté volontairement la domination d’Alexandre, ou avait été réduite par ses détachements. En conséquence, il dirigea alors sa marche art sud de Milêtos, vers la Karia, et surtout vers Halikarnassos, la principale cité de ce territoire. En entrant en Karia, il rencontra Ada, membre de la famille princière karienne, qui lui offrit sa ville d’Alinda et ses autres possessions eu l’adoptant comme fils, et en lui demandant sa protection. Il n’y avait pas beaucoup d’années, sous Mausôlos et Artemisia, que les puissants princes de cette famille avaient été formidables à toutes les îles grecques. C’était l’usage en Karia que les frères et les sœurs de la famille régnante se mariassent entre eux : Mausôlos et son épouse, Artemisia eurent pour successeurs Idrieus et son épouse Ada, tous les quatre étant frères et sœurs, fils et filles d’Hekatomnos. A la mort d’Idrieus, sa veuve Ada fut chassée d’Halikarnassos et des autres parties de la Karia par son frère survivant Pixodaros, bien qu’elle conservât encore quelques villes fortes, qui furent une addition heureuse aux conquêtes d’Alexandre. Pixodaros, au contraire, qui avait donné sa fille en mariage à un grand de Perse nommé Orontobatês, épousa avec chaleur la cause persane, et fit d’Halikarnassos un point capital de résistance contre l’envahisseur[106]. Mais il n’était pas le seul à défendre cette cité. La flotte s’y était retirée en venant de Milêtos ; Memnôn, actuellement investi par Darius du commandement suprême sur la côte asiatique et sur la mer figée, s’y trouvait en personne. Il y avait là non seulement Orotonbatês avec beaucoup d’autres Asiatiques, mais encore une garnison considérable de Grecs mercenaires, commandés par Ephialtês ; exilé athénien plein de bravoure. La -cité, forte tant par la nature que par l’art, entourée d’un fossé large de treize mètres et demi, et profond d’un peu plus de six mètres et demi[107], avait encore été fortifiée davantage sous la surveillance prolongée de Memnôn[108] ; en dernier lieu, il y avait deux citadelles, un port fortifié avec son entrée faisant face au sud, d’abondants magasins d’armes et une bonne provision d’engins de défense. Le siége d’Halikarnassos était l’entreprise la plus difficile qu’Alexandre eût encore tentée. Au lieu de l’attaquer par terre et par mer à la fois comme Milêtos, il fit ses approches seulement par terre, tandis que les défenseurs étaient puissamment aidés du côté de la mer par les vaisseaux persans avec leurs nombreux équipages. Ses premiers efforts, dirigés contre la porte au nord ou au nord-est de la cité, qui conduisait vers Mylasa, furent interrompus par des sorties fréquentes et par des décharges des engins placés sur les murs. Après quelques jours dépensés ainsi sans beaucoup de résultat, Alexandre passa avec une section considérable de son armée, au côté occidental de la ville, vers la partie avancée : de la langue die terre en saillie, sur laquelle étaient situées Halikarnassos et Mindos (la dernière ville plus loin à l’est). Tout en faisant des démonstrations de ce côté d’Halikarnassos, il tenta en même temps une attaque de nuit sur Mindos, mais il fut obligé de se retirer après quelques heures d’efforts inutiles. Il se borna alors au siège d’Halikarnassos. Ses soldats, protégés contre les traits par des appentis mobiles (appelés tortues), comblèrent insensiblement le fossé large et profond qui entourait la ville, de manière à pratiquer une route unie pour que ses engins (tours de bois roulantes) arrivassent tout près des murailles. Les engins y ayant été amenés, l’œuvre de démolition se poursuivit avec succès, nonobstant de vigoureuses sorties faites par la garnison, repoussées, bien que non sans pertes et difficultés, par les Macédoniens. Bientôt les coups de machines à battre en brèche eurent renversé deux tours du mur de la cité, avec deux largeurs intermédiaires de murs, et un troisième mur commençait à menacer ruine. Les assiégés étaient employés à élever un mur intérieur de briques pour couvrir l’espace ouvert, et une immense tour de bois de quarante-cinq mètres de hauteur dans le dessein de lancer des projectiles[109]. Il parait qu’Alexandre attendait la démolition complète de la troisième tour avant de juger la brèche assez large pour qu’il pût donner l’assaut ; mais il en fut donné un prématurément par deux soldats téméraires de la division de Perdikkas[110]. Ces hommes, échauffés par le vin, s’élancèrent seuils pour attaquer le poste de Mylasa, et tuèrent les plus avancés des défenseurs qui vinrent pour s’opposer à eux, jusqu’à ce qu’enfin des renforts arrivant successivement des deux côtés, un combat général s’engageât à une faible distance du mur. A la fin, les Macédoniens furent victorieux, et refoulèrent les assiégés dans la cité. La confusion fut telle que la cité aurait pu être emportée, si l’on avait pris à l’avance les mesures nécessaires. La troisième tour fut bientôt renversée ; néanmoins, avant que cela pût se faire, les assiégés avaient déjà achevé leur demi-lune, contre laquelle conséquemment Alexandre fit pousser le lendemain ses engins. Toutefois, dans cette position avancée, étant pour ainsi dire en dedans du cercle du mur de la cité, les Macédoniens étaient exposés à des décharges non seulement des engins qu’ils avaient en face, mais des tours encore debout de chaque côté d’eux. De plus, à la nuit, une nouvelle sortie fut faite avec tant d’impétuosité qu’une partie de l’ouvrage d’osier destiné à couvrir les machines, et même le boisage de l’une d’elles, furent brûlés. Ce ne fut pas sans difficulté que Philôtas et Hellanikos, les officiers de garde, sauvèrent les autres, et les assiégés ne finirent par être refoulés que quand Alexandre parut lui-même avec des renforts[111]. Bien que ses troupes eussent été victorieuses dans ces combats successifs, cependant il ne pouvait enlever ses morts qui étaient tout près des murs sans solliciter une trêve afin de les ensevelir. Une pareille requête était habituellement regardée comme un aveu de défaite ; néanmoins Alexandre sollicita la trêve, qui fut accordée par 1VIemnôn, malgré l’opinion contraire d’Ephialtês[112]. Après quelques jours d’intervalle, consacrés à ensevelir les morts et à réparer les machines, Alexandre renouvela une attaque contre la demi-lune, sous sa surveillance personnelle. Parmi les chefs à l’intérieur, la conviction que la place ne pourrait tenir longtemps gagnait du terrain. Ephialtês, en particulier, déterminé à ne pas survivre à la prise, et voyant que la seule chance de salut consistait à détruire les engins de siége, obtint de Memnôn la permission de se mettre à la tête d’une dernière sortie désespérée[113]. Il prit immédiatement près de lui deux mille hommes de troupes d’élite, une moitié pour attaquer l’ennemi, l’autre avec des torches pour brûler les engins. Au point du jour, toutes les portes étant soudainement et simultanément ouvertes, les soldats, opérant la sortie, se précipitèrent hors de chacune d’elles contre les assiégeants, les machines de l’intérieur les appuyant par des décharges multipliées de traits. Ephialtês, avec sa division, marchant droit contre les Macédoniens de garde au point principal d’attaque, les assaillit impétueusement, tandis que ses soldats qui portaient les torches essayaient de mettre le feu aux engins. Distingué lui-même non moins par sa force personnelle que par sa valeur, il occupait le premier rang, et il était si bien secondé par le courage et le bon ordre de ses soldats chargeant en colonne profonde que pendant un moment il eut l’avantage. On réussit à incendier quelques machines, et la garde avancée des troupes macédoniennes, consistant en jeunes soldats, lâcha pied et s’enfuit. Elle fut ralliée en partie par les efforts d’Alexandre, mais plus encore par les vieux soldats macédoniens, qui avaient fait ensemble toutes les campagnes de Philippe, et qui, étant exempts des veilles de nuit, étaient campés plus en arrière. Ces vétérans, parmi lesquels le plus remarquable était un soldat nommé Atharrias, faisant honte à leurs camarades de leur lâcheté[114], prirent leur ordre de phalange accoutumé, et dans cet état résistèrent à la charge de l’ennemi victorieux et le repoussèrent. Ephialtês, au premier rang des combattants, fut tué, les autres furent refoulés dans la cité, et les machines incendiées furent sauvées avec quelque dommage. Pendant le même temps, un conflit opiniâtre s’était engagé à la porte appelée Trypilon, par laquelle les assiégés avaient fait une autre sortie, sur un pont étroit jeté en travers du fossé. Là les Macédoniens étaient sous le commandement de Ptolemæos (non le fils de Lagos), l’un des gardes du corps du roi. Ce général, avec deux ou trois autres officiers distingués, périt dans la lutte acharnée qui s’ensuivit ; mais les soldats qui avaient effectué la sortie furent enfin repoussés et rejetés dans la ville[115]. Les assiégés, en essayant de rentrer dans les murs, firent des pertes sérieuses, étant vigoureusement poursuivis par les Macédoniens. Par ce dernier et malheureux effort, la force défensive d’Halikarnassos fut détruite. Memnôn et Orontobatês, convaincus qu’il n’était plus possible de défendre la ville, profitèrent de la nuit pour mettre le feu à leurs engins à projectiles et à leurs tours de bois, aussi bien qu’à leurs magasins d’armes, ainsi qu’aux maisons voisines du mur extérieur, tandis qu’ils emmenaient les troupes, les provisions et les habitants, en partie à la citadelle appelée Salmakis, — en partie à l’îlot voisin nommé Arkonnesos, en partie à l’île de Kos[116]. Cependant, tout en évacuant ainsi la ville, ils maintinrent encore de bonnes garnisons bien approvisionnées dans les deux citadelles qui en dépendaient. L’incendie, stimulé par un vent violent, se répandit au loin. Il fut seulement éteint par ordre d’Alexandre quand il entra dans la ville et mit à mort tous ceux qu’il trouva avec des brandons. Il ordonna que les Halikarnassiens trouvés dans les maisons fussent épargnés, mais que la cité elle-même fût démolie. Il assigna toute la Karia à Ada, comme principauté, sans doute sous condition d’un tribut. Comme les citadelles occupées par l’ennemi étaient assez fortes pour demander un long siége, il ne jugea pas nécessaire de rester en personne dans le dessein de les réduire ; mais, les entourant d’un mur de blocus, il laissa Ptolemæos et trois mille hommes pour le garder[117]. Après avoir achevé le siége d’Halikarnassos, Alexandre renvoya son artillerie à Trallês, et ordonna à Parmeniôn, avec une partie considérable de la cavalerie, l’infanterie alliée et les chariots des bagages, de se rendre à Sardes. Il employa les mois de l’hiver suivant (334-333 av. J.-C.) à la conquête de la Lykia, de la Pamphylia et de la Pisidia. Toute cette côte méridionale de l’Asie Mineure est montagneuse, la chaîne du mont Taurus descendant presque jusqu’à la mer, de manière à laisser peu ou point de largeur intermédiaire de plaine. Malgré une situation d’une aussi grande force, la terreur inspirée par les armes d’Alexandre était telle, que toutes les villes lykiennes, — Hyparna, Telmissos, Pinara, Xanthos, Patara et trente autres, — se soumirent à lui sans coup férir[118]. Une seule parmi elles, appelée Marmareis, résista jusqu’à la dernière extrémité[119]. En atteignant le territoire nommé Milyas, la frontière phrygienne de la Lykia, Alexandre reçut la reddition de la cité maritime grecque Phasêlis. Il aida les Phasêlites à détruire lin fort dans la montagne, élevé et muni d’une garnison contre eux par les montagnards pisidiens du voisinage, et il rendit un hommage public à la sépulture de leur concitoyen décédé, le rhéteur Theodektês[120]. Après cette courte halte à Phasêlis, Alexandre dirigea sa course vers Pergê en Pamphylia. La route ordinaire par la montagne, par laquelle il envoya la plus grande partie de son armée, était si difficile qu’il fallut la faire niveler en quelques endroits par des troupes légères thraces envoyées en avant dans ce dessein. Mais le roi lui-même, avec un détachement d’élite, prit une route plus difficile encore, appelée Klimax (échelle), au pied des montagnes, le long du bord de la mer. Quand le vent soufflait du sud, cette route était couverte par une eau si profonde qu’elle devenait impraticable ; avant qu’il parvint à cet endroit, le vent avait soufflé violemment du sud pendant quelque temps, — mais quand il en approcha, la providence spéciale des dieux (c’est ainsi que lui et ses amis le crurent) fit tourner le vent au nord, de sorte que la mer se retira et laissa un passage dont il put profiter, bien que ses soldats eussent de l’eau jusqu’à la ceinture[121]. De Pergê il marcha sur Sidê, et il reçut en route des députés d’Aspendos, qui offrirent de livrer leur cité, mais le supplièrent de ne pas y mettre de garnison, ce qu’ils obtinrent en promettant cinquante talents en espèces, en même temps que les chevaux qu’ils menaient comme tribut au roi de Perse. Après avoir laissé une garnison à Sidê, il avança droit vers une place forte appelée Syllion, défendue par des indigènes braves avec un corps de mercenaires qui les soutenait. Ces hommes tinrent bon, et même repoussèrent un premier assaut qu’Alexandre ne s’arrêta pas pour répéter, étant informé que les Aspendiens avaient refusé d’exécuter les conditions imposées, et avaient mis leur cité en état de défense. Revenant rapidement, il les força à se soumettre, et il retourna ensuite à Pergê, d’où il dirigea sa course vers la grande Phrygia[122], à travers les montagnes difficiles et la population presque indomptable de la Pisidia. Après être resté dans les montagnes pisidiennes assez longtemps pour réduire plusieurs villes ou forts, Alexandre s’avança au nord en Phrygia, passant par le lac salé appelé Askanios, jusqu’à la forteresse escarpée et imprenable de Kelænæ, qui renfermait une garnison de mille Kariens et de cent Grecs mercenaires. Ces hommes, n’ayant aucun secours à espérer des Perses, offrirent de rendre la forteresse, si un pareil secours n’arrivait pas avant soixante jours[123]. Alexandre accepta la proposition, resta dix jours à Kelænæ, et laissa Antigonos (plus tard le plus puissant parmi ses successeurs) comme satrape de Phrygia avec quinze cents hommes. Il se dirigea ensuite au nord, vers Gordion, sur le fleuve Sangarios, où Parmeniôn avait ordre de le rejoindre, et où se terminait sa campagne d’hiver[124]. APPENDICESUR LA LONGUEUR DE LA SARISSA OU PIQUE MACÉDONIENNE Les renseignements donnés ici au sujet de la longueur de la sarissa portée par le phalangite, sont empruntés de Polybe, dont la description est en tout point claire et conséquente avec elle-même. La sarissa (dit-il) est longue de seize coudées, Suivant la théorie originelles et de quatorze coudées, telle qu’elle est adaptée à la pratique actuelle. (XVIII, 12). On peut probablement comprendre que la différence indiquée ici par Polybe entre la longueur en théorie et celle en pratique signifie que les phalangites, dans les exercices, se servaient de piques plus longues ; et en service, de plus petites ; précisément comme les soldats romains étaient habitués dans leurs exercices à faire usage d’armes plus lourdes que celles qu’ils employaient contre l’ennemi. Parmi les écrivains modernes sur la Tactique, Léon (Tact., VI, 39) et Constantin Porphyrogénète répètent la double mesure de la sarissa telle que la donne Polybe. Arrien (Tact., c. 12) et Polyen (II, 29, 2) portent sa longueur à, seize coudées, — Ælien (Tact., c. 14) donne quatorze coudées. Tous ces auteurs suivent Polybe, ou quelque autre autorité s’accordant avec lui. Aucun d’eux ne le contredit, bien qu’aucun n’expose le cas aussi clairement qu’il le fait. MM. Rüstow et Koechly (Gesch. des Griech. Kriegswesens, p. 238), auteurs du meilleur ouvrage que je connaisse relativement aux affaires militaires dans l’antiquité, rejettent l’autorité de Polybe telle qu’elle est ici. Ils soutiennent que le passage doit être corrompu, et que Polybe a dû vouloir dire que la sarissa avait seize pieds (anglais) de longueur, — non seize coudées. Je ne puis souscrire à leur opinion, et je ne crois pas que la critique qu’ils font de Polybe soit juste. D’abord ; ils raisonnent comme si Polybe avait dit que la sarissa du service réel avait seize coudées de long. Calculant le poids d’une telle arme par l’épaisseur nécessaire pour le manche, ils déclarent qu’elle ne serait pas maniable. Mais Polybe donne la longueur réelle comme n’étant que de quatorze coudées : différence très considérable. Si nous acceptons l’hypothèse de ces auteurs, à savoir qu’une corruption du texte nous a fait lire des coudées là où nous aurions dû lire des pieds, — il s’ensuivra que la longueur de la sarissa, telle que la donne Polybe, devait être de quatorze pieds, non de seize pieds. Or cette longueur n’est pas suffisante pour justifier divers passages dans lesquels il est parlé de sa prodigieuse longueur. Ensuite, ils imputent à Polybe une contradiction quand il dit que le soldat romain occupait un espace de trois pieds, égal à celui qu’un soldat macédonien occupait, — et cependant que dans le combat, il avait daim soldats macédoniens et dix piques, opposés à lui (XVIII, 13). Mais il n’y a ici aucune contradiction : car Polybe dit expressément que le Romain, bien qu’il occupât trois pieds quand la légion était rangée en ordre, avait besoin, quand il combattait, d’une expansion des rangs et d’un intervalle plus grand jusqu’à la mesure de trois pieds derrière lui et de chaque côté de lui afin d’avoir libre jeu pour son épée et son bouclier. Il est donc parfaitement vrai que chaque soldat romain, quand il s’avançait réellement pour attaquer la phalange, occupait autant de terrain que deux phalangites, et avait affaire à dix piques. De plus, il est impossible de supposer que Polybe, en parlant de coudées, voulût réellement dire pieds ; vu que (c. 12) il parle de trois pieds comme étant l’intervalle entre chaque rang dans la file, et que ces trois pieds sont évidemment présentés comme égaux à deux coudées. Son calcul ne sera pas juste, si à la place de coudées l’on substitue pieds. Nous devons donc prendre l’assertion de Polybe telle que nous la trouvons ; à savoir que la pique du phalangite avait quatorze coudées ou vingt et un pieds (anglais) de longueur. Or Polybe avait tous les moyens possibles pour être bien renseigné sur ce point. Il avait plus de trente ans à l’époque de la dernière guerre des Romains contre le roi macédonien Perseus, guerre dans laquelle il servit lui-même. Il connaissait intimement Scipion, fils de Paul Emile, qui gagna la bataille de Pydna. En dernier lieu, il avait donné une grande attention à la tactique, et avait même écrit un ouvrage exprès sur ce sujet. On pourrait croire à la vérité que l’assertion de Polybe, bien que vraie pour son temps, ne l’était pas pour celui de Philippe et d’Alexandre, Mais il n’y a rien à l’appui d’un pareil soupçon, — qui de plus est expressément désavoué par Rüstow et Koechly. Sans doute vingt et un pieds est une prodigieuse longueur, maniable seulement par des hommes spécialement exercés, et incommode pour toute évolution. Mais ce sont précisément les termes avec lesquels on parle toujours de la pique du phalangite. C’est ainsi que Tite-Live dit, XXXI, 39 : Erant pleraque silvestria circa, incommoda phalangi maxime Macedonum ; quæ nisi ubi prælongis hostis velut vallum ante clypeos objecit (quod ut fiat, libero campo opus est) nullius admodum usûs est. Cf. encore Tite-Live, XLIV, 40, 41, oie, entre autres choses qui fout comprendre l’immense longueur de la pique, noirs trouvons : Si carptim aggrediendo, circumagere immobilem longitudine et gravitate hastam eogas, confusa strue implicatur ; et XXXIII, 8, 9. Xénophon nous dit que les Dix Mille Grecs dans leur retraite eurent à se frayer un chemin de vive force à travers le territoire des Chalybes, qui portaient une pique longue de quinze coudées avec une courte épée : il ne mentionne pas de bouclier ; mais ils avaient des jambières et des casques (Anabase, IV, 7, 15). C’est une longueur plus grande que celle que Polybe assigne à la pique du phalangite macédonien. Les Mosynœki défendirent leur citadelle avec des piques si longues et si grosses qu’un homme pouvait difficilement les porter (Anabase, V. 4, 21). Dans l’Iliade, quand les Troyens pressaient fort les vaisseaux grecs, et cherchaient à y mettre le feu, Ajax est représenté comme se plaçant sur la poupe, et tenant les assaillants à distance au moyen d’une pique propre à percer de vingt-deux coudées ou trente-trois pieds de longueur — ξυστόν ναύμαχον έν παλάμησιν, — δυωκαιεικοσίπηχυ, Iliade, XV, 678 —. La lance d’Hectôr a dix ou onze coudées de longueur, — elle est destinée à être lancée (Iliade, VI, 319 ; VIII, 494), — la leçon n’est pas fixée, soit έγχος έχ̕ ένδεκάπηχυ, soit έγχος έχ̕εν δεκάπηχυ. L’infanterie suisse et les lansquenets allemands, au seizième siècle, étaient à bien des égards une reproduction de la phalange macédonienne : rangs serrés, files profondes, longues piques, et les trois ou quatre premiers rangs composés des hommes les plus forts et les plus braves du régiment, — soit officiers, soit soldats d’élite recevant une double paye. La longueur et la rangée impénétrable de leurs piques leur permettaient de résister à la charge de la grosse cavalerie ou gens d’armes : on ne pouvait leur résister de front, à moins que l’ennemi ne pût trouver le moyen de pénétrer entre les piques, ce qui se faisait quelquefois, bien que rarement. Leur grande confiance était dans la longueur de la pique. — Machiavel dit d’eux (Ritratti dell’ Alamagna, Opere, t. IV, p. 159 ; et Dell’ Arte della Guerra, p. 232-236) : Dicono tenere tale ordine, che non é possibile entrare tra loro, né accostarseli, quanto é la picca lunga. Sono ottime genti in campagna, à far giornata : ma per espugnare terre non vagliono, e poco nel difenderlo ; ed universalmento, done non possano tenere l’ordine loro della milizia, non vagliono. |
||||||||||||||||||||||||||||