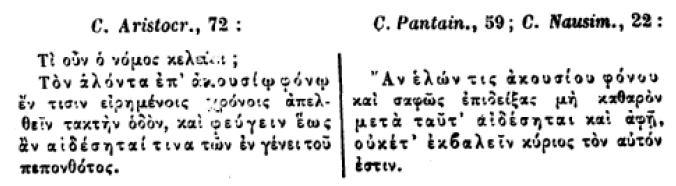SOLIDARITÉ DE LA FAMILLE DANS LE DROIT CRIMINEL EN GRÈCE
LIVRE DEUXIÈME. — PÉRIODE DE TRANSITION — LA CITÉ CONTRE LA FAMILLE.
CHAPITRE VI. — DRAGON ET LES DROITS DE LA FAMILLE.
|
Nous voici amenés par l’étude de la cojuration au seuil de la législation athénienne. Bien souvent déjà nous avons eu citer le nom de Dracon à propos d’idées et d’institutions archaïques. Jamais nous n’avons eu l’occasion d’invoquer son témoignage au sujet de la responsabilité collective. Constamment, au contraire, nous avons pu, en faisant l’histoire de la solidarité active, suivre certaines conceptions depuis leur origine lointaine jusqu’à l’époque du législateur athénien, ou même, faute de documents, remonter de la législation à sa source première. Le moment est venu de nous arrêter en race de Dracon, de rechercher la provenance, la valeur et l’exacte signification de ses lois criminelles, de nous demander jusqu’à quel point les θεσμοί φονικοί ont miné ou préservé le droit de la famille. Le premier code d’Athènes ne parut qu’après un laborieux enfantement. Une banne partie du VIIe siècle y fut consacrée. Quelque temps après l’établissement de l’archontat annuel (683/2), le peuple nomma des thesmothètes chargés de transcrire les actes judiciaires et de les conserver pour le jugement des infractions à venir[1]. Quelles sources les thesmothètes trouvèrent-ils à consulter ? Il existait déjà dans certains γένη de l’aristocratie, les Eumolpides et les Eupatrides, des exégètes qui conservaient dans leur mémoire, comme en des archives, le coutumier et le rituel de leur petite communauté. Plus tard, quand l’État aura donné à sa juridiction une compétence presque universelle, ces personnages ne seront plus qua des docteurs ès-sciences théologales, des magistrats de la liturgie et de la casuistique, des prêtres consultants[2] : ils se borneront à réparer les omissions voulues ou forcées du législateur[3]. Mais alors même, on voit à quelques attributions de leur ministère[4], qu’avant la sécularisation des lois, les jurisconsultes des grandes familles tenaient le dépôt de la sagesse divine et humaine : ils trouvaient dans les πάτρια[5] des réponses toutes prêtes à toutes les questions de droit sacré, de droit privé et de droit criminel. Il est donc assez vraisemblable que les thesmothètes mirent à contribution les trésors de documents non écrits que possédaient les exégètes. Comment ? A-t-on élevé dès cette époque les exégètes à une situation officielle dans la république ? Les γενή se sont-ils laissé séduire par la gloire avantageuse de marquer à leur sceau la législation future ? En tout cas, une partie, la plus importante, de la jurisprudence traditionnelle, servait déjà depuis longtemps aux juges de l’Aréopage, Les thesmothètes eurent avec les Aréopagites des rapports intimes, qui ont laissa des traces jusque dans le droit public du IVe siècle[6]. Par conséquent, au moyen d’emprunts au moins indirects, les thesmothètes purent mettre à la disposition de t’État le patrimoine juridique des γενή. Celui qui mit la dernière main à l’œuvre collective des thesmothètes et lui laissa son nom, ce fut Dracon. Il est bien difficile aujourd’hui de démêler la part du célèbre législateur de celle de ses précurseurs dans des lois qui ont presque complètement disparu. La critique, qui s’est justement acharnée à démolir la constitution attribuée à Dracon par la Πολιτεία d’Aristote, ne s’est pas arrêtée à mi-chemin : elle a été jusqu’à revendiquer intégralement pour la série anonyme des thesmothètes le mérite du travail législatif, jusqu’à faire de Dracon une figure légendaire à l’instar de Lycurgue[7]. Mais il faudrait des raisons bien sérieuses pour nier l’existence d’un personnage sur qui l’antiquité avait des renseignements précis, quoique rares[8], et une opinion bien arrêtée. Sous l’archontat d’Aristaichmos, en l’année 621 qui vit promulguer les θεσμοί en préparation[9], Dracon était peut-être un des six thesmothètes ; peut-être aussi avait-il reçu, dans une crise politique, des pouvoirs extraordinaires comme thesmothète unique[10]. En tout cas, avant lui, on avait colligé bien des textes, on n’en avait pas fait un ensemble logique et l’on n’avait rien publié[11]. Des manœuvres avaient réuni les éléments d’un code ; pour l’achever, il fallait une intelligence. Dracon fut, par surcroît, une volonté. Il ne s’est pas borné à une rédaction de coutumes : s’il les a codifiées, il les a modifiées. Nous en savons assez sur son œuvre pour y discerner l’empreinte d’une personnalité, en même temps que les signes de temps nouveaux[12]. Dans les lois sur l’homicide, apparaît pour la première fois la distinction du meurtre prémédité et du meurtre involontaire. Evidemment il ne s’est pas trouvé là un homme qui, seul, par un coup de génie et un miracle de moralité, ait fait surgir de sa conscience un principe aussi bienfaisant. Ce principe, lentement élaboré dans la justice familiale, s’était peu à peu introduit dans la justice sociale : les juges avaient été amenés à établir des catégories de cas où ils abandonnaient le coupable à la partie lésée et de cas où ils recommandaient une transaction. Ce qui appartient en propre à Dracon, c’est d’avoir donné une valeur absolue à cette distinction, d’en avoir fait la base des φονικοί νόμοι et d’avoir ainsi, à côté de l’Aréopage, retranché dans sa mission de sévérités implacable, installé les éphètes dans des tribunaux de miséricorde. Mais ce n’est pas en philanthrope qu’agissait le premier législateur d’Athènes, c’est en homme politique. Il voulait substituer le régime de la répression sociale à celui de la vengeance privée, afin de refréner le goût du sang[13]. Voilà pourquoi, lui qui se montre si humain dans les dispositions sur le meurtre involontaire et admet même le meurtre excusable, il a dû déployer une si grande rigueur contre le plus grand nombre d’infractions. Dans ses lois sur le vol, il ne connaissait qu’une peine, et c’était, dût l’objet dérobé n’être qu’un légume ou un fruit, la mort. On se fait une conception incomplète du rôle joué par Dracon, quand, par reconnaissance pour la douceur dont témoigne la fondation du Palladion et du Delphinion, on tient pour nulles et non avenues les déclarations des anciens sur ces sanctions écrites en lettres de sang[14]. Mais on a tort de se récrier sur tant de cruauté. La législation criminelle, à ses débuts, est nécessairement impitoyable : l’offensé ne consent à suspendre l’exercice de son droit qu’à condition de sentir à son service toute la puissance de la société, Dracon voulait rendre obligatoire le recours aux tribunaux de la cité. Comment exiger du demandeur qu’il soumit à un jugement public ses droits à la vengeance ? Dans certains cas, la loi lui assurait une ποινή[15]. Mais le plus souvent les juges, s’ils se prononçaient contre l’accusé, le déclaraient par cela même hors la loi, le livraient à son adversaire, ce qui était une condamnation capitale[16]. Même dans ses fameuses lois sur le vol, que fait Dracon[17] ? Il dénie au volé le droit de vie et de mort sur le voleur, hormis le cas où celui-ci est surpris de nuit[18] ou résiste par la force[19] ; il oblige la partie lésée à mener le coupable devant les magistrats (άπάγειν) ; il reconnaît aux seuls représentants de la cité le droit de le faire mourir. Est-ce là de l’inhumanité ? Non certes. En dirigeant le glaive de, l’État contre l’offenseur, Dracon opposait à l’offensé le bouclier de l’État. La mansuétude de Dracon et sa sévérité ne se contredisent pas : elles se complètent, comme la juridiction des Aréopagites s’harmonise avec celle des éphètes ; elles s’expliquent l’une et l’autre par le même principe, celui de la juridiction sociale ; elles sont la double face d’un progrès décisif. Mais il n’y aurait pas eu lieu d’expliquer à maintes reprises le passé par des allusions à Dracon, il aurait été superflu de chercher dans les recueils des exégètes les origines de ses lois, si le vieux droit des γένη, n’avait pas réussi à se réserver une bonne place dans le code nouveau. L’État ne tolère plus la vengeance privée. Mais est-ce une raison pour qu’il dénie à la famille lésée le privilège exclusif de demander vengeance à la justice ? S’il lui reconnaît ce privilège, lui fera-t-il une obligation étroite d’en user, et s’opposera-t-il à toute transaction ? Enfin, non content d’intervenir entre les familles, osera-t-il s’immiscer dans leurs affaires intérieures et châtier les crimes commis de parent à parent ? Pour répondre à ces questions, on a la loi authentique sur l’homicide involontaire, conservée dans le plaidoyer contre Macartatos et la transcription épigraphique de 409/8[20]. On peut y joindre plusieurs autres lois insérées dans le discours de Démosthène contre Aristocratès. Enfin, comme les φονικοί νόμοι n’ont jamais été abolis, il est permis d’antidater maints passages des auteurs classiques. Puisque Dracon voulait par la rigueur des pénalités montrer aux offensés le chemin des tribunaux, il ne pouvait pas remettre à des tiers le soin des poursuites. Il dut se borner à suivre les règles coutumières de la cojuration[21]. Pour faire la πρόρρησις dans l’agora, pour lancer contre le meurtrier présumé la déclaration de guerre entraînant l’excommunication, il désigne les parents en deçà du degré de cousin (έντός άνεψιότητος καί άνεψιοΰ). Le père, le frère et les fils sont donc seuls à se présenter en justice comme accusateurs officiels ; mais ils peuvent compter, pour concourir à la poursuite (συνδιώκειν) : 1° sur les parents éloignés, cousins et fils de cousins, sans distinction de ligne masculine et de ligne féminine[22] ; 2° sur les alliés, gendres, beaux-pères et beaux-frères ; 3° sur les membres de la phratrie[23]. Le groupe privilégié comprend les parents du même οΐκος, ceux qui sont appelés dans l’épopée φίλοι κατά δώματα ou έν μεγάροισιν[24] : ce groupement se formait pour la vengeance du sang avant de se former pour l’accusation[25]. De même, si les auxiliaires doivent établir leur parenté par un serment[26], ce qui rappelle la cojuration, si l’affinité sortit les mêmes effets que la parenté, ce qui est contraire à toutes les notions du droit classique, enfin, si les parents et les alliés sont suppléés par les phratères, c’est qu’un lien risible, continu, rattache cette législation à la coutume homérique. Seulement, d’Homère à Dracon, tandis que s’est accrue la puissance publique, les grands γένη se sont désagrégés, et dans chacun d’eux se sont détachées l’une de l’autre des familles de plus en plus restreintes. Les Grecs des siècles épiques ont au beau admettre pour la vie ordinaire des distinctions de parentés dans le γένος ; obstinément fidèles à la vieille coutume, ils conservaient le principe juridique de l’égalité dans la solidarité une et indivisible. Depuis, les parents se sont séparés plus nettement des έται et se sont classés par parentèles plus ou moins rapprochées : de là vient le régime que Dracon laisse subsister dans ses lois sur l’homicide, le régime de la diversité dans la solidarité ou, si l’on peut ainsi parler, de la solidarité par faisceaux successifs[27]. Mais, malgré les différences résultant d’une évolution plusieurs fois séculaire, c’est dans l’Iliade et l’Odyssée qu’on surprend les origines des φονικοί νόμοι[28]. Ce que la famille lésée demandait à l’État, d’après la loi de Dracon, c’était la permission de se venger. Il fallait donc que son droit fût reconnu, non seulement au moment des poursuites, mais, si elle l’emportait, au mutilent du supplice ou de l’expulsion. A l’origine de la juridiction sociale, comme dans la période antérieure de l’arbitrage, le tribunal, pour faire exécuter ses arrêts, n’avait que les armes de celui qu’il déclarait vainqueur. C’était le principe universel en droit grec, que l’exécution du jugement fût abandonnée à la partie gagnante. Ce principe resta toujours en vigueur dans les matières civiles[29]. Pour les condamnations au criminel, l’application en fut bien restreinte et mitigée dans ta période classique ; elle l’était peu au temps de Dracon. Qu’à la suite d’un meurtre, les parents de la victime, une fois leur droit reconnu par la justice, puissent l’exercer de leur propre main sur la personne du meurtrier, cela est constamment admis dans les législations d’États naissants ou même d’États déjà fortement organisés[30]. Chez les Juifs, le goël s’adressait au tribunal, pour faire légaliser la vengeance qu’il allait accomplir, et le principal accusateur jetait la première pierre au criminel condamné à la lapidation[31]. Les Aryens ne diffèrent pas sur ce point des Sémites. On relève la même coutume chez les Romains[32]. Sur les Parthes et les Arméniens un auteur ancien nous dit : Παρά Πάρθοις καί Άρμενίοις οί φονεΐς άναιροΰνται, ποτέ μέν ύπό τών δικαστών, ποτέ δέ ύπό τών συγγενών τών φονευνομένων[33]. D’après les vieilles lois des Slaves, la fille séduite et le séducteur sont, après condamnation, livrés au père, qui est tenu de leur trancher la tête, tandis que le ravisseur est décapité par la victime du rapt[34]. Les Germains n’avaient pas de bourreau, et l’an constate qu’en. Allemagne, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, le criminel condamné à mort pouvait être exécuté par un parent de la victime ou par la personne offensée[35]. En plein XIXe siècle, les coutumes rurales de la Sardaigne abandonnent purement et simplement le meurtrier à la famille de la victime, pourvu qu’elle justifie ses soupçons devant un tribunal arbitral[36]. A en croire les journaux, on voit assez souvent des spectacles analogues dans la patrie du lynch[37]. En maints pays, le droit de la partie accusatrice sur la vie du coupable est si hautement reconnu, que le souverain rte peut exercer le droit de grâce qu’avec le consentement de la famille lésée[38]. Il en est ainsi dans la Perse[39] et la Tunisie[40] actuelles ; il en fut ainsi longtemps en Autriche[41] et en Flandre[42], où l’un restait fidèle à la règle : De voluntario convictus parentibus vel cognatis occisi tradatur occidendus[43]. Il n’est pas douteux qu’en Grèce aussi, à l’origine de la juridiction sociale, l’accusé déclaré coupable de meurtre qualifié n’ait été livré aux parents de la victime. Cette coutume resta toujours vivace dans un cas exceptionnel, quand le meurtrier exilé était pria en rupture de ban[44]. Sous sa forme la plus générale, elle persista en Macédoine au moins jusqu’à la fin du IVe siècle : la reine Olympias fut encore livrée, après condamnation, aux parents de ceux qu’elle avait fait tuer[45]. Mais dans Athènes, pour se perpétuer, elle s’adoucit. L’exécution étant faite au nom du peuple par le δήμιος, le parent qui avait engagé la poursuite contre le meurtrier assistait à son supplice[46]. Le sens de cette formalité ne se perdit jamais. Eschine en parle encore comme un homme familiarisé avec l’idée de la vengeance privée : Ah ! ce n’est pad la mort, dit-il, qui est terrible. Ce qui est affreux, c’est l’outrage subi au moment suprême. Quel pitoyable sort, de voir un visage d’ennemi que le rire épanouit, d’entendre de ses propres oreilles les insultes de la haine ![47] Si les éphètes siégeant au Palladion déclaraient l’homicide involontaire, le condamné n’en tombait pas moins au pouvoir des accusateurs. On lui accordait seulement un délai pour gagner l’étranger par une route déterminée. Il devait rester en exil jusqu’à ce qu’il eût obtenu sa grâce de la famille, représentée par un membre au moins, Φεύγειν, ϊως άν αίδέσηταί τινα τών έν γένει[48]. Cette disposition se retrouve presque textuellement dans la législation des Francs : Wargus sit (hoc est expulses), osque dum parentibus satisfaciat[49]. Ainsi, les premières lois dictées par l’État conformément aux coutumes ne fixent pas de durée pour l’éloignement imposé au meurtrier. C’est aux parents du mort d’autoriser le retour de l’offenseur quand il leur plait. Les Athéniens non plus n’ont pas figé légalement l’άπενιαυτισμός ; mais ils ont sur d’autres cette supériorité, de faciliter la réintégration de l’expulsé en la faisant dépendre d’une autorisation unique. Cette interprétation d’un texte emprunté an discours contre Aristocrate semble en contradiction avec, la loi authentique rie Dracon, qui demande l’acquiescement unanime des parents à l’αΐδεσις[50]. Aussi a-t-on violenté de toutes les façons le passage de Démosthène pour le mettre d’accord avec la règle αίδέσασθαι άπαντας. On n’a pas voulu du mot αίδεΐσθαι, sans se rendre compte qu’il a par son origine le sens de transiger et convient à l’une et à l’autre des parties contractantes. On a rejeté le mot τινά, en l’attribuant à la négligence du scribe[51] ou à l’ignorance de Démosthène. Mais on verra que la règle αίδέσασθαι ζάπαντας s’applique à l’αΐδεσις consentie sans jugement, et non pas à l’a ?’8eatç consécutive à un jugement. Il ne s’agira pas du même acte, et la procédure pourra différer. Elle devra différer. Dracon le déclare lui-même, lorsqu’il impose deux fois de suite la condition d’unanimité aux parents qui transigent sans aller en justice, et ne l’impose plus aux φράτερες qui reçoivent le meurtrier au retour d’exil[52]. Ainsi, les différences signalées entre le discours contre Aristocratès et l’inscription de 409/8, loin d’être attribuables à une corruption de texte, s’expliquent et sont nécessaires. Il y a plus. Ce passage, qu’on voudrait défigurer, a tout l’air d’être ni plus ni moins qu’une citation de Platon. Qu’ordonne donc la loi ? commence par demander Démosthène. Et, pour énumérer les prescriptions annoncées, il emploi, cette forme du commandement par l’infinitif qui caractérise la loi athénienne : άπελθεΐν..φεύγειν[53]. Les dispositions relatives à l’exil du condamné sont trop longues pour qu’il les cite textuellement : il en fait un résumé à l’appui de son argumentation. Mais lorsqu’il arrive à l’αΐδεσις, il recopie ce qu’il lit, ou peu s’en faut. De là cette précision des termes et cette série d’archaïsmes[54]. Il est bon, d’ailleurs, pour fixer l’origine de ce passage, de le rapprocher d’un autre où Démosthène parle également de l’αΐδεσις après condamnation en φόνος άκούσιος. Il s’agit d’un de ces lieux communs que les rhéteurs tenaient tout prêts dans leur mémoire ou sur leurs tablettes. il se retrouve sans changement dans les plaidoyers contre Pantainète et contre Nausimaque[55] : on en peut doue croire Iliaque syllabe mûrement pesée. Démosthène examine cette fois les effets de l’αΐδεσις au point de vue de la partie lésée : dès lors, il ne peut citer littéralement la loi de Dracon ; mais il s’en inspire, il en prend les mots importants et les accommode à sa démonstration. La loi dit άλών, φευγειν, en parlant du condamné, de l’exilé ; Démosthène, en parlant de l’accusateur qui a obtenu la condamnation, la sentence d’exil, dit έλών, έκβαλεΐν. La loi considère l’αΐδεσις comme un acte futur par rapport à l’exil présent, et dit : έως άν αίδέσηται ; Démosthène considère l’αΐδεσις comme un acte présent par rapport à l’exil passé, et dit μετά ταΰτ' αίδίσηται. Mais les deux mots essentiels restent les mêmes : celui qui exprime la réconciliation obtenue ou accordée et celui qui indique la personne qui se réconcilie. Voici, l’un en regard de l’autre, les deux documents à comparer :
La première de ces phrases se résume ainsi : ό άλών έπ' άκουσίω αίδέσηται τινα. Elle est confirmée par la seconde qui dit : έλών τις άκουσίου φύνου αίδέσηται. Ce rapprochement suffirait à résoudre la question de l’αΐδεσις consécutive à un jugement de condamnation pour homicide involontaire. Dracon a donc voulu hâter le retour du meurtrier plus malheureux que coupable. Il le condamne à partir, mais le recommande à l’αΐδεσις et à la φιλανθρωπία de ses adversaires. La puissance publique abdique devant les champions de la victime, mais intercède en faveur de l’exilé avec une autorité qui s’accroîtra de siècle en siècle. Démosthène ira jusqu’à dire que le maître, le κύριος du condamné, c’est la loi, et non plus l’accusateur[56]. Il est vrai qu’il aura intérêt en la circonstance à enfler les droits de l’État : moins partial, il représentera le vengeur du sang comme κύριος du meurtrier jusqu’à l’αΐδεσις[57]. Niais, dans son erreur voulue, il ne fera qu’exagérer la vérité. Dracon veut que la famille, κύριος du condamné en droit strict, le soit le moins possible en fait. Il lui fait subir la pression morale de l’État. Avant le jugement, elle n’avait à prendre conseil que d’elle-même. Mais elle a permis à la justice d’intervenir : elle n’a plus la même plénitude de souveraineté. L’État lui a donné raison, mais lui demande d’oublier au plus tôt le tort qu’elle a subi, et tâche d’y pourvoir. Reconnaître le privilège de la famille en matière de poursuite et d’exécution, c’était pour Dracon admettre le principe de la vengeance privée, sauf opposition de l’État[58]. Les φονικοί θεσμοί avaient pour objet d’assurer la paix publique bien moins en châtiant le meurtrier qu’en prévenant les excès de la partie adverse : c’est ce qui fait four ressemblance frappante avec la rhètra contemporaine, d’Olympie- Dracon n’avait aucun motif et l’État n’aurait pus eu la force nécessaire pour empêcher les parties de s’entendre directement. A la famille lésée de voir si elle veut renoncer à son droit de poursuite ; à elle de décider si les offres qu’on lui fait sont acceptables. Qu’elle consente à la réconciliation, et nul ne peut relever l’action qu’elle a laissé tomber. Elle est maîtresse unique et absolue (κύριος) du pardon et de l’accusation. Cette faculté de s’arranger à l’amiable n’est pas seulement impliquée par la faculté d’agir en justice ; elle est encore spécifiée par la loi. La transaction n’est pas seulement tolérée ; elle semble plus naturelle, elle est plus conforme aux coutumes et reste peut-être plus usitée dans les cas peu graves que le recours en justice. C’est l’hypothèse que le législateur envisage d’abord dans ses dispositions sur l’homicide involontaire. Dès qu’il a indiqué la pénalité et la juridiction compétente, il détermine les personnes admises à conférer l’αΐδεσις, avant de dire celles qui peuvent accuser[59]. Il n’énumère pas dans l’ordre inverse deux actes successifs, deux opérations judiciaires ; il pose une alternative. Il examine les deux voies qui s’ouvrent dans le même moment à la famille lésée : la voie de droit privé et la voie de droit public[60]. Pour la transaction, comme pour la poursuite, Dracon trace des cercles de parentèles. Il appelle en premier lieu le père, le frère et les fils de la victime, en spécifiant que le consentement de tous est nécessaire et que le refus d’un seul doit prévaloir[61]. Comme jadis le γένος au complet, ce premier groupe, démembrement du γένος, doit agir solidairement, selon la règle άπαντας ή τόν κωλύοντα κρατεΐν. Au cas où il n’existe aucun de ces proches parents, on a recours aux parents plus éloignés jusqu’au degré de cousin. Ce second groupe doit fournir des garanties qui ne sont pas exigées du premier : pour en faire partie, on doit confirmer son titre, justifier de sa parenté par serment. Mais les droits de ce second groupe, bien qu’il agisse subsidiairement, sont identiques à ceux du premier, et sa décision n’est également valable que prise à l’unanimité[62]. S’il n’existe aucune de ces personnes, la situation devient tout autre. Il n’y a plus lieu à compromis, et le recours en justice est de droit. A défaut de la famille, la loi fait bien intervenir au nom de la victime la phratrie : dix φράτερες choisis dans les γένη, les plus purs par les éphètes ou chefs d’έται s’érigent en champions de troisième ligne[63]. Mais leur fonction est très limitée. Ils n’ont pas la faculté, qu’ont les parents, de recevoir en grâce le meurtrier à n’importe quel moment et, par conséquent, de refuser l’affaire aux juges par une transaction préalable ; ils ont seulement le droit de recevoir le meurtrier à son retour d’exil et de faire la paix avec lui. Pour eux, la loi ne dit plus αίδέσασθαι ; elle emploie un autre verbe, έσέσθων[64]. Tandis que par deux fois elle exige ici l’unanimité des parents, elle ne la demande pas plus aux qu’aux parents eux-mêmes pour le recours en grâce après exil temporaire. Enfin elle déclare expressément que l’action des φράτερες doit suivre un jugement de condamnation, et reconnaît par là que l’action des parents n’est pas subordonnée à cette condition. Si l’État ne force jamais la famille de la victime à lui demander justice, il revendique une de ses attributions essentielles dans le cas où la victime ne laisse pas d’héritiers. Il oblige les φρέτερες à s’adresser d’office à ses tribunaux avant toute réconciliation, sans interdire une réconciliation immédiate à la famille. On pourrait douter, en l’absence de documents authentiques et positifs, flue Dracon ait admis le droit de transaction même pour le meurtre prémédité. Il est bien possible cependant que, sinon dans la transcription de 409/8, du moins dans l’original, l’article sur l’αϊδεσις ait porté, comme plusieurs autres articles, à la fois sur le φόνος άκούσιος et le φόνος έκούσιος. En tout cas, il est improbable que la réconciliation ait été explicitement interdite, et le silence de la loi valait une permission. Par autorisation formelle ou par tolérance, ouvertement ou tacitement, l’État devait consacrer dans tous les cas le privilège de la famille. Deux textes donnent une grande force à cette hypothèse. — Le premier est un passage de Démosthène[65] : Théocrinès demande satisfaction pour son frère, victime d’un meurtre prémédité ou prétendu tel ; il menace Démocharès d’un procès à l’Aréopage, puis accepte de l’argent. Pour Philippi[66], la conduite de Théocrinès n’est pas plus légale lorsqu’il se laisse acheter que lorsqu’il s’adjuge sans autre formalité le sacerdoce laissé vacant par le défunt. Mais qu’est-ce donc qui retient Démosthène de flétrir un tel pacte comme illicite ? L’usurpation d’une charge religieuse est une illégalité, il le dit catégoriquement (παρά τούς νόμους) ; s’il avait pu englober dans le même reproche la convention passée pour le fait d’homicide, il ne se serait pas refusé ce plaisir. Voit-on Démosthène accusa ironiquement son adversaire de cupidité, de manquement aux devoirs envers un mort, s’il lui avait été loisible d’incriminer une violation formelle de la loi ? — L’autre texte, qui a échappé à Philippi, définit clairement le droit des parents. Dans la scène des Grenouilles où Eschyle et Euripide se disputent la palme de la tragédie, Euripide se moque d’un vers qu’Eschyle met dans la bouche d’Oreste. Alors commence une discussion vétilleuse de juristes philologues[67]. Il s’agit du savoir si le parricide rentré dans son pays peul dire ήκω γάρ ές τήν γήν τήνδε, καί κατέρχμαι. Simple tautologie, prétend d’abord Euripide. — Bavard toi-même, réplique Eschyle : ήκω n’est pas κατέρχομαι ; il y a une nuance entre l’arrivée du citoyen investi de tous ses droits et la réintégration du proscrit. Et Euripide ne perd pas contenance : il se reprend, il examine l’espèce, il distingue le fait et le droit. Il ne veut pas qu’Oreste puisse dire κατελθεϊν, et pourquoi ? Parce que le retour du meurtrier est clandestin et illégal, tant qu’il n’a pas obtenu la permission de ceux dont il dépend λάθρα γάρ ήλθεν, ού πιθών τούς κυρίους. Ainsi Euripide, rusé sophiste, dialecticien pressant, cherche des arguments pour établir l’infraction qu’il attribue à Oreste, et il ne songe pas à dire qu’il n’est point d’αϊδεσις possible dans son cas. Il insinue, au contraire, qu’Oreste pourra rentrer dans sa patrie en plein jour, la tête haute, quand il aura reçu l’autorisation indispensable. Or, le meurtre commis par Oreste est sûrement un φόνος έκούσιος ; aux yeux d’Aristophane : à l’époque de la vengeance privée, il a pu être considéré Comme un homicide légitime ; à l’époque de la justice sociale, l’excuse disparaît et la préméditation reste. D’autre part, les termes employés pour définir la condition du retour sont d’une précision technique. Le meurtrier revient πιθών τούς κυρίους : il doit amener la partie lésée à composition ; les parents de la victime sont ses maîtres, ses seuls juges en premier et en dernier ressort. Même la plainte une fois déposée, les accusateurs pouvaient dessaisir l’Aréopage ou le Palladion et faire leur paix avec l’accusé[68]. C’était conforme à la coutume. On ne voit pas comment l’arbitre homérique eût pu retenir une affaire malgré les parties, puisque sa compétence se fondait sur leur consentement. Maintenant encore, si le meurtrier parvenait à s’arranger avec tous les ayants droit, si personne ne se présentait au tribunal comme demandeur, le tribunal n’avait pas à se prononcer. La paix étant faite, il ne restait rien à pacifier. Donc, après un meurtre prémédité ou non, la famille lésée peut exploiter comme elle veut son pouvoir sur le meurtrier elle peut le traîner devant les juges compétents ou, par une décision unanime, accepter une transaction. Les parents de la victime n’ont fait qu’hériter d’un droit qu’avait, avant de trépasser, la victime elle-même. D’un mot, ordre inviolable, elle pouvait soustraire le coupable à la vindicte des lois ou exiger d’implacables poursuites[69]. Si elle a rendu le dernier soupir sans rien dire, ses parents agissent en son nom ; ils se chargent d’exprimer ses intentions et d’exécuter ses volontés d’outre-tombe. Les vivants se substituent au mort[70]. Cependant, tout en autorisant les transactions privées, Dracon y met peut-être d’autres conditions que ce consentement unanime des demandeurs qu’exigeait déjà la coutume. Nous avons à nous demander si ces transactions tuaient, comme jadis, débattues en toute liberté par les parties et si l’offenseur pouvait encore se prémunir contre toute vengeance, contre tout châtiment, par le paiement d’une ποινή. Deux cas sont à considérer, selon que la loi pose comme alternative de la transaction le droit exceptionnel de se faire justice sur-le-champ ou l’obligation plus générale des poursuites judiciaires[71]. Comme toutes les cités des temps épiques et peut-être des temps historiques, Athènes reconnaît au mari outragé le droit de vengeance privée. Une loi de Dracon permet à tout homme de tuer le séducteur surpris en flagrant délit avec son épouse, sa mère, sa sœur, sa fille ou sa concubine[72]. C’est de cette autorisation qu’excipe un client de Lysias, le petit bourgeois Euphilètos, pour s’excuser d’avoir tué Eratosthène. Il avait trouvé le galant dans une posture qui ne laissait aucun doute sur sa culpabilité ; il se jeta sur lui, lui attacha les mains derrière le dos, et, malgré ses supplications, froidement, devant témoins, lui donna le coup de grâce. Mais la loi lui conférait l’autorisation de se faire justice dans sa maison[73], sans lui en imposer le devoir. Le droit de tuer l’offenseur résultait d’un droit plus général, celui d’en faire sa volonté[74] : il impliquait le droit de transiger à prix d’argent[75]. Eratosthène eut le temps d’offrir une grosse somme comme dommages-intérêts et comme rançon[76]. Si le mari acceptait une ποινή, il prenait à l’égard de l’offenseur les mêmes précautions qu’Hiphaistos à l’égard d’Arès : il retenait son prisonnier sous bonne garde, jusqu’à ce qu’il eût obtenu des cautions suffisantes[77]. Sur la composition en cas d’homicide, les renseignements ne manquent pas. Négligeons une note de Suidas[78] qui définit άποινα rançon payée pour homicide ou lésion corporelle ; l’auteur renvoie à une loi de Solon, probablement à la loi qui justement interdit dans un cas spécial l’acte d’άποινάν[79]. Mais nous pouvons nous adresser aux auteurs du IVe siècle. Dinarque dans deux plaidoyers et Théophraste dans le XVIe livre des Lois parlaient de prix du sang payés sous le nom d’ύποφόνια[80]. Le fait que les Athéniens employaient le mot ύποφόνια est attesté par l’unanimité des grammairiens[81], et le mot porte avec lui son explication : il s’agit bien des sommes données à la suite d’un homicide aux parents de la victime. Vieillerie juridique, pourrait-on croire, conservée dans la loi par un respect scrupuleux jusqu’à l’anachronisme, mais démentie par les faits. Bien au contraire. Le législateur n’ordonne jamais la transaction, ni à prix d’argent ni autrement. L’άϊδεσις n’est pas un acte judiciaire, mais un acte légal. Ce n’est pas une paix imposée aux particuliers par l’État tout-puissant, tuais un accord quelquefois blâmé par l’opinion publique[82], toujours librement conclu par des familles qui agissent dans leur pleine indépendance. La loi autorise donc les ύποφόνια, elle ne les prescrit pas. Mais les autorise-t-elle partout et toujours ? Une des lois citées dans le discours contre Aristocratès fixe le sort du meurtrier qui, après condamnation, revient indûment d’exil : il est permis de le mettre à mort ou de le faire exécuter par le magistrat ; mais défense est faite de le blesser ou de le rançonner[83]. Mais ce texte ne vient pas tout entier de Dracon. La première prescription, celle qui permet de tuer net ou d’appréhender le meurtrier en rupture de han, est certainement une coutume très ancienne[84] : elle figurait sans contestation possible (jusqu’au mot άπάγειν) sur la loi originale de Dracon, comme sur la copie de 409/8[85]. La dernière partie (depuis είσφέρειν), avec la γραφή donnée à tout citoyen et la juridiction des héliastes, est évidemment un amendement postérieur, ainsi que les mots ώς έν τώ άξονι άγορεύει[86]. Reste à déterminer l’origine de la disposition intermédiaire, celle qui prohibe les mauvais traitements et les rançons (de λυμαίνεσθαι à καταβλάψη). Les auteurs du Recueil des inscriptions grecques[87] veulent qu’elle soit de Dracon, comme la prescription dont elle est la suite et la restriction. Ils donnent pour preuve l’inscription de 409/8. Il est vrai qu’une forte lacune (l. 31-33) y fournit la place nécessaire pour la prohibition, et même le second ο du mot δσον. Mais cette lacune conviendrait encore à tout le reste de la loi donnée par Démosthène, et, par conséquent, il n’est pas démontré que l’inscription de 409/8 ait porté les θεσμοί primitifs sans modifications ultérieures. Une restitution faite dans ces conditions est une hypothèse, et non pas une preuve. Dès lors : 1° La série λυμαίνεσθαι... καταβλάψη, intercalée entre deux séries de date relativement récente, ώς... άγορεύει et είφέρειν... διαγιγνώσκειν, est vraisemblablement contemporaine de ces deux séries. voilà pour la forme. 2° La loi de l’État a dû admettre le droit de vengeance privée sans réserve avant de le diminuer par des restrictions philanthropiques, et les restrictions elles-mêmes sont inséparables de la procédure qui les sanctionne et qu’on ne peut pas concevoir sous une autre forme que celle de l’action publique : voilà pour le fond. 3° Une loi attribuée à Solon et observée encore au Ive siècle, loi dont l’objet lut manifestement d’adoucir une coutume plus cruelle, permettait à n’importe qui de frapper la femme adultère en rupture de ban[88], et il est bien difficile d’admettre que, par des dispositions contraires, le meurtrier en rupture de ban ait été protégé contre les coups dès l’époque de Dracon : voilà pour l’analogie. L’État n’a donc interdit de rançonner les meurtriers qu’après Dracon, en un temps où, déjà fort et désireux d’accroître encore son autorité, il jugeait à propos de réduire le domaine du droit privé. En s’abstenant d’imposer la juridiction de l’État aux deux familles intéressées par l’homicide έμφύλιος, Dracon déniait toute compétence à l’État en matière d’homicide commis à l’intérieur d’une famille. Bien plus, en organisant la juridiction facultative dey, cinquante et un chefs d’έται pour prononcer entre les deux familles en guerre, Dracon admettait que l’arbitrage public n’avait pas sa raison d’être, si L’accusé était parent à un degré quelconque de la partie accusatrice. Conforme à la coutume, le premier code des Athéniens reconnaissait à la famille le droit exclusif de juger les siens. Et ce droit, pour être valable, n’avait pas besoin d’être spécifié. Il existait de temps immémorial, il continuait d’exister, par cela même qu’il n’était pas et ne pouvait pas être supprima explicitement. Plus tard, quand on eut perdu le souvenir des juridictions familiales, on fut frappé de constater que certains crimes, les plus énormes de tous, n’étaient pas réprimés par les φονικοί νόμοι. On ne connaissait plus que des pénalités infligées par la justice sociale : il sembla que tout acte qui n’était pas puni par le code de Dracon fût réellement impuni de son tempe. Comme on ne voulait pas admettre que des hommes eussent jamais autorisé le fils à tuer le père, on expliqua le silence de la loi sur le parricide en disant que le législateur ne prévoyait pas l’impossible : la morale était sauve. On forgea même une anecdote pour faire exprimer par Solon en personne la pensée qu’on lui attribuait[89]. Mais l’histoire du droit n’est pas un recueil d’historiettes édifiantes. En réalité, Dragon n’édictait aucune sanction contre le parricide, parce que l’État n’avait pas à s’occuper de cela[90]. La juridiction de la famille subsistait sur tous les points où elle n’était pas abolie par une disposition expresse. La loi ne parlait donc pas du parricide pour la même raison qu’elle ne définissait en aucune circonstance la puissance du mari sur sa femme, du père sur ses enfants, du maître sur ses esclaves : toutes ces questions échappaient à sa compétence. Sans qu’elle en dît un mot, le chef de famille gardait le droit de vie et de mort sur ses enfants nouveau-nés ou coupables. Elle abandonnait à l’époux ou au κύριος outragé le μοιχός surpris en flagrant défit : il allait de soi qu’il pouvait tuer aussi la complice, sa femme ou sa concubine, sa fille ou sa sœur. S’il est vrai (comme on l’a soutenu non sans vraisemblance) que, dès le VIIe siècle, la loi renfermait une disposition sur le meurtre de l’esclave[91], cela signifie que l’État protégeait la vie de l’esclave, non pas contre la toute-puissance de son maître, mais contre la violence d’un tiers, non pas pour proclamer la valeur absolue de la personnalité humaine, mais pour défendre la propriété des familles[92]. La cité offrait son arbitrage aux γένη en lutte ; elle ne faisait pas d’incursion sur le domaine privé du γένος. Elle n’interdisait pas le parricide, c’est certain ; mais elle n’interdisait pas non plus le châtiment du parricide : il n’en fallait pas plus[93]. Devant l’énormité des concessions faites par Dracon au principe de solidarité familiale, on s’arrête surpris. Où est dans toutes ces prescriptions de condescendance pure, dans ces tolérances tacites ou non, la part de l’État ? Dracon nous semblait devoir augmenter ou pour le moins consolider la juridiction sociale. Et voilé qu’en regardant son œuvre de plus près, nous avons observé partout que la coutume recevait force de loi, que la puissance de la cité se mettait au service de la vengeance privée et de la justice familiale. La première impression était-elle à ce point trompeuse ? Non. Pour que les lois criminelles de Dracon aient pu durer autant que la république athénienne, il faut qu’à l’avance elles se soient mises en accord avec les principes de droit public qui prévaudront. Avant tout et malgré tout, c’était un résultat considérable de mettre en plein jour le secret juridique des γένη, de réduire en code des règles si diverses, de fixer enfin un droit dont la mobilité avait jusqu’alors favorisé l’arbitraire de la force. C’était pour la civilisation et pour l’État une conquête d’un prix inestimable, que la famille offensée, si elle ne s’entendait pas avec l’offenseur, pût et dût s’adresser à des juges, au lieu de courir aux armes. Un autre progrès, préparé depuis longtemps, est désormais acquis. Le γένος a irrévocablement perdu sa vigoureuse, unité pour les revendications. Il ne forme plus ce tout indivisible et presque homogène, qui comprenait avec tous les parents d’un degré appréciable une multitude immense d’έται. La phratrie peut à l’occasion se substituer à la famille, mais de façon à remplir un service public. La famille elle-même est répartie en deux troupes. l’ourles poursuites, les parents éloignés prêtent encore aux proches un appui mural, rangés en seconde ligne ; pour la transaction, ils restent à l’écart des proches et n’interviennent qu’à leur défaut. La solidarité active n’est plus indéfectible qu’entre le père, les fils et les frères. Et même, pour la, première fois, par-delà le droit collectif de la famille réduite est évoqué, au profit de la juridiction sociale, le droit de l’individu. C’est une application nouvelle de la coutume familiale qui a produit ce grand résultat. Une des plus vieilles règles que contint le droit des γένη exigeait un consentement unanime pour toute décision touchant aux intérêts de la communauté. L’adage άπαντας ή τόν κωλύοντα κρατεϊν fut répété par Dracon dans deux circonstances où il pouvait servir la cause de l’État En effet, ces deux procédures d’αϊδεσις qui semblent s’opposer l’une à l’autre, la procédure de transaction pour laquelle il faut l’unanimité et la procédure de pardon pour laquelle suffit la bonne volonté d’un homme, sont identiques au regard de la justice sociale. Dans les deux cas, le législateur pousse à la solution la plus favorable à l’autorité des tribunaux et à la paix, dans les deux cas, pour restreindre les droits de la famille, il étend ceux de l’individu. La famille, déjà démembrée en deux groupes qui ne s’unissent guère dans une action commune, doit encore reconnaître à chaque membre de ces groupes un veto absolu. Une seule voix peut faire échec au compromis et forcer aux poursuites ; une seule peut autoriser le retour de l’exilé et faire exécuter le jugement qui a déclaré y avoir lieu à prompte réconciliation. Dracon a éparpillé le droit à accusation et le droit de grâce. L’action judiciaire s’individualisait dans les limites de la famille, avant d’en sortir. Dracon annonçait Solon. |