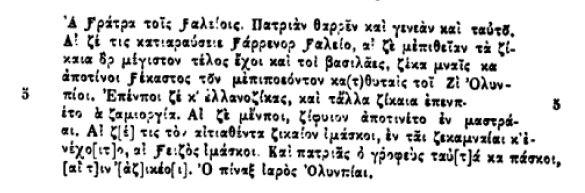SOLIDARITÉ DE LA FAMILLE DANS LE DROIT CRIMINEL EN GRÈCE
LIVRE DEUXIÈME. — PÉRIODE DE TRANSITION — LA CITÉ CONTRE LA FAMILLE.
CHAPITRE II. — MESURES SOCIALES CONTRE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE.
|
Un des premiers besoins qui se fassent sentir dans un Etat conscient de sa force, c’est celui d’empêcher les pires effets de la solidarité familiale, de mettre un terme aux représailles exercées contre tout un groupe. La coutume n’avait pas suffi à contenir le ressentiment des offensés dans les limites du talion, et, en combattant le goût du sang par l’amour de la richesse, elle n’avait libéré les personnes qu’aux dépens de laure biens. Elle avait essayé de réglementer la responsabilité collective ; elle ne l’avait pas supprimée. Aussi, pendant un temps plus ou moins long, selon lais pays, la législation sociale eut-elle à protéger dans leur vie et dans leur fortune les parents des accusés et des condamnés. Elle commença par restreindre la vengeance du sang. Quand on lit aujourd’hui les lois où pour la première fois la puissance publique s’opposait à l’abus des représailles, on est surtout frappé d’en voir autoriser l’usage. Quelques-unes de ces formules font frissonner : lex horrendi carminis. On ne songe pas assez, en présence des cruautés permises formellement, à celles qui, ne l’étant plus, étaient par cela même interdites d’une famille à l’autre. On s’attendrit sur le sort toujours réservé au coupable, et l’on ferme les yeux sur le salut enfin assuré aux innocents. Quand le grand législateur des Juifs pron0fice lu parole fameuse : Sang pour sang, œil pour œil, dent pour dent, il n’excite pas la passion de la vengeance, il la réprime. Il oblige le goël à demander aux jugea le droit de se venger[1], et le Décalogue, qui admet encore la responsabilité collective et héréditaire[2], n’en prépare pas moins la grande réforme demandée par les prophètes et réalisée par le Deutéronome, la suppression des peines réversibles. Pas plus que Boise, Mahomet ne pouvait défendre aux parents de la victime de verser le sang du meurtrier ; mais, lui aussi, il les obligeait à se contenter du meurtrier seul[3]. Chez les Aryens, on retrouve constamment, à l’origine de la juridiction sociale, cette restriction de la vendetta légalisée. Une foule de dispositions sont dictées aux peuples slaves, celtes et germaniques par celte même préoccupation[4]. La loi des Saxons et une lui anglaise d’Edmond l’Ancien défendent de toucher aux parents de l’homme libre convaincu d’homicide[5]. La loi des Burgondes[6] porte cette disposition remarquable : Interfecti parentes nullum nisi homicidam persequendum esse cognoscant, quia, sicut criminosum jubemus exstingui, ita nihil molestiæ sustinere patimur innocentem. Ce fut plus long, en général, pour l’État d’exonérer la famille de la responsabilité matérielle. N’était-ce pas pousser l’offensé à la vengeance du sang, que de lui enlever toute garantie pour le paiement de la composition ? Les parents de l’offenseur ne se faisaient-ils pas un devoir de lui venir en aide ? D’ailleurs, tant que les familles aimaient à vivre dans l’indivision, était-il si aisé de distinguer la part de chacun ? On observe très bien dans la législation franque comment, de collective, la responsabilité pécuniaire est devenue individuelle. Déjà la loi Salique n’oblige plus les parents à concourir tous ensemble au paiement d’une composition quelconque. Ils ne peuvent être appelée Ies uns après les autres, dans un ordre déterminé[7]. Pour qu’ils soient appelés, il faut d’abord que le wehrgeld soit à cause d’homicide, ensuite que le meurtrier prouve son insolvabilité doublement, par un serment prêté avec assistance de doute cojureurs et par une renonciation solennelle à tous objets compris dans la haie du domaine familial. Cette responsabilité fragmentée, subsidiaire, exceptionnelle, n’est même pas inévitable. Il est permis à chacun, en rompant publiquement trois baguettes d’aune au-dessus de sa tête, de sortir de sa famille[8]. Encore est-il que la loi Salique laisse subsister les charges de la solidarité primitive. C’est la Decretio Childeberti qui, en 595, abolit complètement et par principe le concours de la famille à l’acquittement de la composition[9]. Mais maints peuples de l’Europe restèrent très longtemps encore sans faire cette réforme. Dans la première moitié du XIIIe siècle, Waldemar II de Danemark la tenta inutilement[10]. En Russie, elle fut réalisée, vers la fin du même siècle, par les fils de Jaroslaw[11] ; chez les Suédois, en 1335, par Magnus Erickson[12] ; chez les Polonais, en 1368, dans le statut de Wislica[13]. En Hollande, il fallut attendre la seconde moitié du XVe siècle, pour que les parents du condamné fussent affranchis de l’obligation délictuelle[14]. Dans les cités de la Grèce antique, l’Etat accomplit la même œuvre que dans les sociétés sémitiques ou européennes en voie de formation. Malheureusement le Moyen Age hellénique ne nous a pas laissé une masse de documents comparables soit à la Bible et au Coran, soit aux législations galloises, germaniques et slaves. Sans doute, les preuves indirectes ne manquent pas, Pourquoi les lois de Dracon étaient-elles si rigoureuses, qu’on a pu les dire écrites avec du sang ? C’est que le seul moyen de sauver la famille de l’offenseur était de le livrer lui-même implacablement à la famille offensée. Pourquoi le code de Gortyne[15] demande-t-il que le fils de famille, pour exécuter une condamnation pécuniaire, se fasse apportionner dans les limites de sa part légitime ? C’est qu’on a voulu jadis préservé de toute revendication les lote des innocents et que, pour obtenir ce résultat, il a fallu exiger par avance d’hoirie le lot du coupable. Tout cela est assez clair. On aimerait cependant pouvoir constater par un document direct l’intervention d’un État hellénique en faveur de la responsabilité personnelle. Peut-être n’est-ce pas impossible. Il y a eu dans le Péloponnèse un canton qui, grâce à des nécessités économiques et à des convictions religieuses, a toujours été en retard sur le reste de la Grèce : c’est l’Elide. La population, dispersée sur de grands espaces, demeurait dans des hameaux, κωμηδόν. Elle ne sentait même pas le besoin d’avoir une capitale : la première ville de l’Elide fut fondée après la révolution de 472[16]. Ces campagnardes, dans un pays sanctifié par Zeus Olympien, restaient obstinément attachés à la vie sacrée des ancêtres. Les siècles passaient, la Grèce se transformait : eux, dans la mesure où les fils peuvent être identiques aux pères, paraissaient immuables. Polybe, dans un passage bien intéressant et dont chaque ligne mériterait un commentaire, déclare relever les vestiges du passé le plus lointain dans la vie sociale, et particulièrement dans la vie judiciaire, des Eléens[17]. On peut donc avoir l’espérance de retrouver, chez un peuple qui a conservé plus longtemps que tout autre, les institutions primitives des γένη et des κώμαι[18], quelqu’un de ces actes officiels qui ont été les premières manifestations de la puissance sociale. Ailleurs, ces actes se perdent dans la nuit des temps. Il se peut qu’ici, à l’aurore de l’ère historique, nous voyions l’Etat encore occupé à son œuvre de destruction systématique, et son attitude à ce moment, dans cette partie de la Grèce, nous fera juger de l’action qu’il exerçait depuis des siècles dans la Grèce entière. Le document que nous cherchons existe. C’est une inscription gravée sur une plaque de bronze et découverte à Olympie. Publiée dans un grand nombre de recueils épigraphiques[19], elle a fait l’objet de bien des commentaires[20], sans que l’irritante obscurité qui en enveloppe les mots essentiels ait été définitivement dissipée. Voici ce document, accentué et ponctué ainsi qu’il convient à l’interprétation que nous tâcherons de justifier :
Nous avons montré ailleurs[21] que cette inscription remonte aux confins du VIIe et du VIe siècle, qu’elle est contemporaine de Solon, sinon de Dracon lui-même. Nous pouvons maintenant nous occuper d’en déterminer le contenu. Toutes les difficultés de ce texte, mais aussi son grand intérêt, résident dans les premiers mots (depuis πατρίον jusqu’à Ϝσλείο). Le reste est assez clair. Avec les αί ζά μέπιθεΐαν, commence une série de dispositions ayant pour objet d’obliger les magistrats à faire justice et de réprimer les mauvais traitements infligés à l’accusé. J’en donne la traduction : Si le magistrat suprême et les rois[22] n’appliquent pas les moyens de droit[23], que chacun de ceux qui tant forfait paie dix mines au trésor sacré de Zeus Olympien. Que l’Hellanodike prononce contre eux[24], et, quant au reste (quant au fond), que la démiurgie[25] prononce selon le droit. S’il ne se prononce pas (l’Hellanodike), qu’il paie au double[26], dans la reddition des comptes. Si quelqu’un[27] se livre à des voies de fait sur l’homme accusé en justice[28], qu’il soit passible de l’Amende de dix mines s’il se litre aux voies de fait en connaissance de cause (sachant l’affaire pendante en justice), Que le greffier de la Patrie subisse la même peine, s’il commet une illégalité au préjudice de quelqu’un. Voilà donc une rhètra qui est formulée en moins de huit lignes (si l’on déduit les courtes indications du préambule et de la clausule), et dont sept lignes à peu près sont consacrées à régler l’intervention de l’Etat dans les différends entre particuliers et à protéger la personne des prévenus. Il serait bien étrange que des mesures aussi longuement détaillées et d’une application aussi générale fussent prises à propos d’un crime particulier et rapidement défini par les mots αί ζέ τις κατιαραύσειε Ϝάρρενορ Ϝαλείο. Toutes les tentatives pour trouver l’infraction qui serait ainsi désignée viennent se briser contre cette objection. Qu’il s’agisse du sacrilège[29], des maléfices[30], ou des sacrifices humains[31], pourquoi les Eléens ont-ils pris prétexte d’un attentat aussi spécial, pour imposer la juridiction sociale et accorder des garanties aux accusés ? La bizarrerie demeure presque aussi criante, et l’on écrit : αί ζέ τις κατιαραύσειε, Ϝέρρεν[32], ός[33] Ϝαλείο, c’est-à-dire si à la définition du crime on joint la pénalité. On évite bien alors cette hérésie philologique et juridique qui consiste à dire que Ϝάρρενορ est mis pour άνδρος[34] et à déclarer non punissable le crime non commis contre un Eléen mâle ; mais un laisse subsister l’invraisemblable disproportion entre la réforme et la circonstance d’où elle est sortie. Il n’y a qu’un moyen d’échapper à la difficulté : il faut renoncer à chercher ici la définition d’un crime, par conséquent à voir dans ζέ τις κατιαραύσειε la désignation d’un accusé. Si c’est, au contraire, l’acte même de l’accusation en général qui est exprimé par κατιαραύσειε, si le sujet τις est l’accusateur dans toute espèce de poursuite judiciaire, alors l’inscription présente une parfaite unité, une suite absolue dans les idées. Sans doute, ni la littérature ni l’épigraphie ni le droit ne présentent un autre emploi de καθιεροΰν avec une signification analogue, excepté toutefois dans une seconde inscription d’Elide[35]. Mais, grammaticalement, none n’avons pas seulement le droit, nous sommes forcés de chercher à ce mot une signification nouvelle, parce que nulle part ailleurs il n’est construit avec un régime au génitif, C’est le sens ordinaire de consacrer ou le sens spécial de dévouer aux dieux infernaux qui se heurte à une impossibilité, puisqu’il veut, suivant les règles logiques et l’usage, le régime à l’accusatif[36]. On emploie le génitif, a dit Madvig[37], avec les verbes composés de κατά qui expriment une action dirigée sur ou contre quelqu’un..., avec les verbes qui expriment condamnation ou accusation. Il faut donc expliquer καθιεροΰν avec le génitif par analogie avec κατηγορεΐν. L’histoire des institutions juridiques est d’accord avec la philologie vernale pour confirmer cette hypothèse. Que les Eléens aient pu dire καθ-ιεροΰν au lieu de κατ-ηγορεΐν, cent n’a rien que de conforme au caractère formaliste et religieux de la procédure antique. Dans les poèmes homériques, la justice se rendait sur l’agora[38] : on voit donc pourquoi agir contre un offenseur, c’est κατ- ηγορεΐν. Mais, sur cette agora où ils vouaient s’asseoir, les anciens se réunissaient dans le cercle sacré[39], en vue d’un temple[40]. Si, dans Athènes, les Aréopagites ont siégé près de l’autel des Euménides et les éphètes devant le Palladion ou le Delphinion, les Eléens, célèbres par leur fidélité à la justice et à la vie sacrée des vieux temps[41], ont dû avec prédilection mêler la religion à la procédure. On pourrait donc songer, pour expliquer le terme καθ-ιεροΰν, à la διωμοσία, cette prestation de serment qui marque le début de toute instruction et qui, pour les affaires de sang, ce fait en grande solennité sur les débris calcinés d’un triple sacrifice. Mais la διωμοσία n’est pas spéciale à l’accusateur[42] : après avoir été un contrat bilatéral, véritable règlement d’arbitrage confirmé par serment, elle est devenue un acte de procédure par lequel les adversaires lient partie et déterminent ne varietur l’objet de débat[43]. Il faut donc chercher ailleurs. Ce qui ressemble le plus à l’acte de καθιεροΰς, c’est cette déclaration de guerre à forme d’imprécation que les Athéniens appelaient πρόρρησις ou προαγόρευσις[44]. Πραγορεύειν, c’est κατηγορεϊν selon les formes. Voilà précisément ce que c’est aussi que de καθιεροΰν[45]. Ce maïs est le seul qui puisse expliquer les mots Ϝάρρενορ Ϝαλείο. Pourquoi l’incantation ou le sacrifice humain ne seraient-ils puni4 que si la victime est du sexe masculin ? Du bien les Eléens ont-ils rédigé deux lois, celle que nous possédons, et une autre, pour la protection des femmes, qui se serait perdue ? Que tout cela est invraisemblable ? Rien de plus naturel, par contre, rien de plus juridique pour les anciens, que de réserver les formalités de l’accusation solennelle et la plénitude de la protection sociale aux citoyens majeurs, à l’exclusion des étrangers et des esclaves, des mineurs et des femmes. La rhètra éléenne est donc une espèce de loi d’habeas corpus. Encadrée entre ces deux expressions presque synonymes κατιαραύσειε et αίτιαθέντα, elle a d’un bout à l’autre pour objet de prévoir les conséquences d’une accusation intentée devant les tribunaux de l’Etat et peut-être spécialement devant les tribunaux de sang. C’est cet ensemble qu’il ne faut pas perdre de vue, quand on veut interpréter la première disposition : πατριάν θαρρέν καί γενεάν καί ταύτό. La loi destinée à donner des garanties à la personne même de l’accusé commence par en donner à tous ceux de sa patrie et de sa famille, ainsi qu’à ses propriétés. Mais nous avons à justifier ce sens sur trois points. 1° Qu’est-ce que πατριάν ? Blass a écrit Πατρίαν et a déclaré que c’est un nom propre, le même que Πατρέας, qui se présente plusieurs fois sur les inscriptions de Delphes[46]. La rhètra devient ainsi un simple privilège. Cette hypothèse a encore obtenu l’approbation de Dittenberger-Purgold et de Michel. Elle nous parait insoutenable. Elle met au compte des Eléens un document qui serait certes le plus extraordinaire de l’épigraphie grecque, un décret d’άσφαλεία et d’άσυλία qui serait conféré à un citoyen[47] et qui, par-dessus le marché, renfermerait des règles de droit publie et de procédure criminelle. D’ailleurs, que fait-on de πατριάς ό γροφεύς ? Si l’on écrit encore Πατρίας, on a un décret honorifique dont le bénéficiaire est menacé d’une peine[48], un décret qui nomme deux fois le même personnage et n’indique sa position sociale que la seconde fois. Si, au contraire, on écrit πατριάν à la ligne 8, alors il faut se décider aussi à mettre πατριάν à la ligne 1. Cette patrie qui a son greffier, cette patrie qui est rapprochée de la γενεά est un γένος au sens antique, une petite phratrie dont fait partie la famille[49], comme à Milet[50], à Delphes[51] et à Trézène[52]. La πατριά à côté de la γενιά est en Elide ce que dans la société homérique les έται sont à côté des κασίγνητοι[53]. 1° Qu’est-ce que θαρρέν ? Ce verbe n’est pas aussi énigmatique, qu’on l’a dit[54]. Seulement, il faut en chercher le sens avec méthode. Pourquoi θαρρέν ne serait-ce pas tout simplement θαρρεΐν ? Il faut commencer par là, si l’on ne veut pas expliquer obscurum per obscurius. Les commentateurs ont déjà signalé dans Sophocle[55], un passage d’où l’on pourrait conclure que θαρρεΐν se dit d’un offensé qui se tient tranquille, dans l’attente d’une intervention supérieure, et renonce à prendre lui-même sa vengeance. Sans doute, on aurait alors un sens très clair : il serait interdit à la πατριά, à la γενεά et à la famille de la personne lésée de bouger, et toute réparation devrait venir des tribunaux publies. Mais comment rendre compte de ταύτό ? D’ailleurs, est-il possible qu’à l’époque même où, en Attique, Dracon reconnaissait encore à la famille de l’accusateur le droit de concourir à la poursuite, la législation de l’Élide, pays arriéré, ait supprimé ce droit de συνδιώκειν ? En réalité, à ce document, composé vers la fin du VIIe siècle par un peuple figé dans le passé, il convient d’appliquer les nuances du vocabulaire homérique, et non celles de la littérature athénienne. Il n’y a ni dans l’Iliade ni dans l’Odyssée un seul exemple de θαρρεΐν n’impliquant pas l’idée d’un homme qui craignait pour lui ou pour autrui un grand danger, mais qui se rassure[56]. Sauf de rares exceptions[57], le danger encouru, c’est la mort[58]. Dire à quelqu’un : θαρστεϊ, c’est lui garantir ou garantir à un tiers la vie sauve. Cette garantie est souvent donnée par une divinité[59] ou un chef[60] ; mais, d’où qu’elle vienne, elle met l’offenseur à l’abri de la vengeance[61]. Quand Dolon, surpris en flagrant délit d’espionnage, ou le héraut Médan, impliqué dans les crimes des prétendants, supplient Ulysse de leur faire grâce, à cette demande éplorée : αΐδεο correspond cette promesse de salut : θαρστεϊ[62]. Donc, à s’en rapporter à la langue homérique, une loi qui commence par πατριάν θαρρεΐν καί γενεάν accorde des sûretés à toutes les personnes d’une πατριά et d’une γενεά, et, s’il faut choisir entre le clan d’un accusé et celui d’un accusateur, pas de doute possible ; l’immunité est conférée à la πατριά et à la γενεά de l’accusé. L’obligation que la loi de Dracon imposa aux ayants droit de l’offensé dans l’article sur l’αΐδεσις a pour pendant le droit que la loi à peu près contemporaine d’Elis reconnaît aux partisans de l’offenseur. De même que son corrélatif αίδεΐσθαι, le terme θαρρεΐν, qui désignait un sentiment, a pris une valeur objective, juridique : c’est la valeur qu’on donne à l’άδεια du droit public athénien, lorsqu’on la définit vacuitatem a metu accusationis[63], ou qu’on la présente comme une sorte de sauf-conduit, de garantie contre les mauvais traitements[64] ; en un mot, c’est l’inviolabilité[65]. 3° Dès lors, ταύτό n’offre plus la moindre difficulté[66]. Ceux pour qui θαρρεΐν signifie se tenir en repos sont réduits à expliquer ταύτό comme s’il y avait τούς αύτοΰ et à placer ainsi la famille à côté de la γενεά et de la γενιά, groupes de plus en plus étendus[67]. Mais il n’y a pas d’exemple d’une pareille violence faite à fa langue grecque[68]. De plus, dans tous les cas analogues, la γενεά n’est autre chose que la famille[69], et la πατριά un groupe analogue au γένος athénien[70]. A côté de la πατριά, il ne reste donc pas de place pour un γένος (au sens large), et, si γενεά désigne les parents, il n’en saurait être de même pour ταύτό. Ainsi, par τά αύτοΰ[71] on ne peut entendre que ταύτοΰ, les biens de l’accusé. Θαρρέν ταύτοΰ est l’équivalent de Θά(ρ)ρος κ' εΐε τοϊς χρεμάτοις, expression employée dans une autre inscription d’Elide[72]. En résumé, le commencement de la rhètra doit se traduire ainsi : Paix et salut à la patrie, à la famille et aux biens de l’accusé. Si quelqu’un a lancé la proclamation sacrée contre un Étéen mâle et jouissant de ses droits civiques... Ce document se tient donc d’un bout à l’autre, il est capital dans l’histoire des institutions judiciaires en Grèce. Il nous montre comment la juridiction sociale est intervenue pour limiter le droit de l’offensé et protéger contre les abus de la vengeance la personne de l’offenseur, ses biens, sa famille, son clan. Comme la loi criminelle d’Athènes, la rhètra éléenne interdit l’abus des voies de fait et des rançons[73]. Mais elle se rapporte à une civilisation plus ancienne encore, lorsqu’elle déclare abolie dans les affaires criminelles la responsabilité collective des parents et des έται. L’accusateur, la main sur l’autel, terminait la déclaration de guerre en s’écriant, selon quelque formule consacrée d’imprécation : Άπόλλυσθαι καί αύτόν καί πατριάν καί γενεάν καί ταύτό. Mais non, l’Etat n’admet pas qu’il en soit ainsi ; il riposte : Πατριάν θαρρέν καί γενεάν καί ταύτό. En Grèce, comme en Judée, le législateur a lutté contre la solidarité passive de la famille et déclaré que les pères ne mourront pas pour les enfants, ni les enfants ne mourront pour les pères[74], mais que tout acte de justice sera mis au compte du juste et de lui seul, tout acte d’iniquité au compte de l’inique et de lui seul[75]. L’inscription d’Olympie est d’un prix inestimable, non seulement pour l’étude de la législation grecque, non seulement pour l’étude de la législation comparée, mais encore dans l’histoire des idées fondamentales sur lesquelles reposent les sociétés modernes. Quand l’historien d’Israël[76] en arrive aux réformes accomplies par le code hébreu de 622, après avoir montré l’importance capitale de la règle qui supprimait la réversibilité des peines, il se tourne vers la Grèce, pour lui demander ce qu’elle peut à ce moment opposer à la lumière de justice qui vient de se lever sur Jérusalem. Eh bien f la Grèce peut affronter la comparaison sans trop d’inégalité. Elle n’a pas seulement à présenter le code de Dracon, qui a été, lui aussi, une lui de progrès. Voici, de plus, un document authentique où, peut-être la même année que les hommes de l’Orient, des hommes de l’Occident disent qu’ils ne veulent plus voirie fils puni pour le père et proclament le grand principe de la responsabilité individuelle. Ό πίναξ ΐαρός Όλυνπίαι. Oui, cette tablette est sacrée. Car la rhètra d’Élide forme avec le Deutéronome un double anneau de la chaîne d’or qui se termine par la Déclaration des droits de l’homme. |