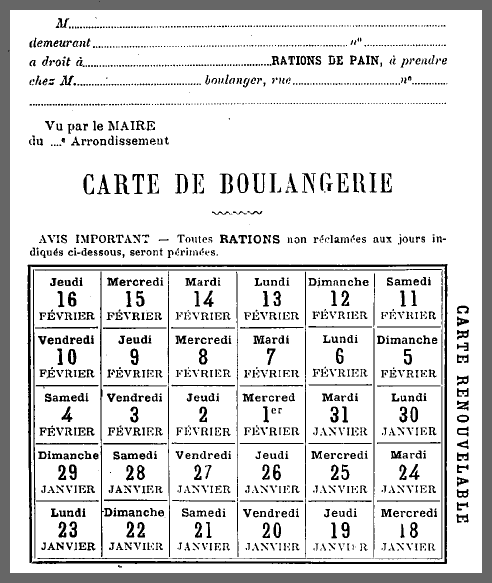PARIS SOUS LES OBUS
19 Septembre 1870 - 3 Mars 1871
CHAPITRE XIX. — LA CAPITULATION.
L'effort suprême. — Le 19 janvier : Buzenval. — De Montretout à Garches. — L’enlisement. — Deux dépêches. — Les 300 grammes. — Le gouverneur ne capitulera pas. — Le gouvernement capitule. — L’échauffourée du 22 janvier. — Inventaire après faillite.L’appel aux armes placardé dans Paris traduisait les sentiments qui débordaient de tous les cœurs : CITOYENS, L’ennemi tue nos femmes et nos enfants ; il nous bombarde jour et nuit ; il couvre d’obus nos hôpitaux. Un cri : aux armes ! est sorti de toutes les poitrines. Ceux d’entre nous qui peuvent donner leur vie sur le champ de bataille marcheront à l’ennemi ; ceux qui restent, jaloux de se montrer dignes de l’héroïsme de leurs frères, accepteront au besoin les plus durs sacrifices comme un autre moyen de se dévouer pour la patrie. Souffrir et mourir, s’il le faut, mais vaincre. Vive la République ! Les membres du Gouvernement, JULES FAVRE, JULES FERRY, JULES SIMON, EMMANUEL ARAGO, ERNEST PICARD, GARNIER-PAGÈS, EUGÈNE PELLETAN. Les ministres, Général LE FLÔ, DORIAN, MAGNIN. Les secrétaires du Gouvernement, HÉROLD, LAVERTUJON, DURIER, DRÉO. Avec un entrain magnifique, soldats et gardes nationaux se préparaient au grand combat. On savait par les immenses préparatifs accumulés depuis quarante-huit heures qu’il s’agissait cette fois d’une tentative à mener jusqu’au bout. Tous les régiments étaient appelés, toutes les batteries achevaient de remplir leurs caissons ; toutes les voitures, tous les chevaux restés dans Paris étaient mis en réquisition pour le transport des cartouches et des vivres. Le personnel entier des diverses ambulances était sur pied ; les compagnies de brancardiers, instituées depuis quelques semaines, avaient reçu leur matériel et prenaient leurs dispositions. Le 18 au soir, 130.000 hommes avaient franchi les portes et s’en allaient camper ou se cantonner dans les villages de la zone neutre, échelonnés de Saint-Denis à Billancourt. Le 19 au matin, vers six heures, l’action commença. L’armée était partagée en trois colonnes principales. Celle de gauche, sous les ordres de Vinoy, devait enlever la redoute de Montretout — inachevée au moment du siège, — et le terrain avoisinant. Celle du centre, commandée parle général de Bellemare, avait pour objectif le plateau de la Bergerie. Enfin, la colonne de droite, avec Ducrot, opérerait sur le parc de Buzenval. Le 2e régiment de guerre, composé des 6e, 7e, 34e et 36e bataillons de la garde nationale, formait avec le 139e de ligne la tête de la colonne lancée à l’assaut de Montretout. Un grand nombre de ces hommes voyaient le feu pour la première fois. Animés par l’ardeur de leur patriotisme, ils allaient bravement droit devant eux ; mais leur inexpérience avait besoin de guides, de conseils ; leurs frères d’armes du 139e furent bientôt pour eux l’un et l’autre. On était parti du Mont-Valérien à cinq heures du matin, pour arriver au petit jour au bas de la colline que couronne la redoute. Les routes étaient mauvaises, ou plutôt il n’existait pas de route ; il fallait se diriger par les terres labourées, traverser des fondrières, enfoncer jusqu’à mi-jambe dans des sillons boueux. Tout à coup, le long des crêtes qui dominent, éclate la fusillade. Assaillie par le feu de la redoute et des maisons crénelées qui l'avoisinent, la brigade se déploie en ordre dispersé jusqu’à une villa située à mi-côte, et tandis que le génie pratique des meurtrières à chaque étage, les hommes se répandent dans les vignes et prennent à leur tour l’offensive. Vers neuf heures, enfin, l’ordre arrive de monter à l'assaut. Les rangs des tirailleurs se resserrent. Sur tout le front de bandière retentit le cri : En avant !.. Sensation indicible que celle de nos volontaires : à la fois le bonheur de combattre, la conscience d’être utile à la cause nationale, la haine contre l’ennemi, l’attente du succès. — S’élançant au pas gymnastique avec une furie irrésistible, la colonne, soutenue sur les flancs par quelques compagnies de ligne et de mobile, déloge dans son premier choc les Prussiens ; ceux-ci reculent devant les baïonnettes françaises. En moins d’une demi-heure, la redoute est occupée, et le 7e bataillon s’y installe avec le 139e. Le Mont-Valérien expédie de l’artillerie. Avec une peine extrême, on amène quatre pièces de 12 jusqu’au plateau. Une fois là, impossible de les mettre en batterie ; dans la terre argileuse et détrempée, les affûts enfoncent jusqu’au moyeu. Pendant l’assaut victorieux, le général de Bellemare atteignait les crêtes de la Bergerie ; en attendant d’être appuyée, une partie de sa réserve s’y développait. À la droite, Ducrot allait cette fois être Grouchy. Sa colonne, mal dirigée, so butait dès la première heure contre un train d’artillerie engagé lui-même dans une fausse voie. Durant l’instant de désarroi, des batteries en amphithéâtre sur la rive opposée de la Seine ouvrirent un feu meurtrier auquel on ne pouvait répondre de chez nous. On télégraphia, on amena sur le remblai du chemin de fer de Saint-Germain deux, locomotives canonnières pour soutenir la diversion. Mais après midi seulement, Ducrot entrait en ligne. L’action s’engagea vivement sur le parc de Longboyau. En arrière des murs et des maisons qui le bordent la résistance avait préparé à loisir tous ses moyens. A plusieurs reprises, le général Ducrot ramena à l’attaque les troupes de ligne et la garde nationale sans gagner un pouce de terrain. Mais quelle sincérité la plupart des généraux apportaient-ils dans l’action ? Après les imposants préliminaires auxquels nous avions assisté la veille et qui avaient jeté hors les murs plus de cent régiments, à peine, dans le cours de la journée, vingt cinq mille hommes se trouvèrent-ils engagés ! Pour ne citer qu’un exemple, la brigade Lespiau, formée des 96e, 144e, 145e, 228e bataillons de guerre de la garde nationale et du 121e de ligne, perdue pendant la moitié de la nuit à la recherche de son campement, cantonnée à la Garenne, c’est-à-dire à 8 kilomètres du théâtre de la lutte, atteignait, après quatre heures de repos et dix heures de marche, les approches du parc de Buzenval. Au delà, un mur crénelé arrêtait depuis midi notre front étroit ; les assauts se succédaient infructueux contre 'un obstacle que six coups de canon eussent démoli ! Où était donc l’artillerie ? — Égarée, ou perdue dans les fondrières. Les chefs de corps s’étaient dispensés de fournir à leurs subordonnés des ordres de marche. L’état-major s’étant croisé les bras, les régiments, abandonnés à eux-mêmes, se jetaient vers l’objectif par la première route venue, sans souci des régiments voisins. De lamentables encombrements barraient chaque voie. Les civières et les cacolets chargés se frayaient à grand’peine un passage à travers les rangs de la troupe. Çà et là, des têtes de colonne parcourant le terrain en sens inverse se heurtaient. Ailleurs, d’autres venaient confondre leurs files au confluent de deux artères. Les charrois, cahotant pêle-mêle à travers la colonne ou embourbés en pleine route derrière le piétinement de leurs attelages exténués, mettaient le comble à la confusion. Par instant, une avant-garde, dégagée enfin, poussait devant elle pour donner presque aussitôt contre une queue de colonne également en détresse. Toutes ces masses profondes, compactes, se mouvant avec effort dans la vase épaisse du dégel, s’immobilisaient réciproquement. Quelques désespérés avaient, un jour, prononcé le mot de sortie torrentielle. Pour ceux-là, sans doute, on avait mis en scène ce dernier acte de la tragédie sanglante jouée sous les murs de Paris. Les troupes étant suffisamment harassées par douze heures d’action et par les marches des nuits précédentes, on recula, entre la Malmaison et le Mont-Valérien. Dans ce combat, humiliant pour les généraux, glorieux pour les officiers et les soldats, on aurait eu peine à compter les traits de courage. Le commandant de Roche- brune était tombé pour ne plus se relever ; le colonel Langlois, au premier rang malgré ses soixante-six ans, avait le bras traversé par un coup de feu ; un autre vieillard, un septuagénaire, le marquis de Coriolis, succombait à côté de son fds : tous deux faisaient partie du même régiment de marche ; le peintre Henri Régnault, une des jeunes illustrations de la France, était frappé au cœur par une balle ; et Séveste, l’artiste plein d’avenir, et Gustave Lambert, l’apôtre de la science, et tant de compagnons d’armes de ces nobles champions qui arrosaient de leur sang les chemins où sombrait le dernier espoir de délivrance ! A la population anxieuse, le général Trochu avait offert dans la journée cette consolation : Gouverneur à ministre de la guerre et à général Schmitz. Mont-Valérien, 10 h. 50, matin. Un épais brouillard me dérobe absolument les phases de la bataille. Les officiers porteurs d’ordres ont de la peine à trouver les troupes. C’est très regrettable, et il me devient difficile de centraliser l’action, comme je l'avais fait jusqu'ici. Nous combattons dans la nuit. Voici comment, le lendemain, le gouverneur de Paris résumait la bataille : Gouverneur à général Schmitz, au Louvre. Mont-Valérien, 20 janvier, 9 h. 30 du matin. Le brouillard est épais. L’ennemi n’attaque pas. J’ai reporté en arrière la plupart des masses qui pouvaient être canonnées des hauteurs, quelques-unes dans leurs anciens cantonnements. Il faut à présent parlementer d’urgence à Sèvres pour un armistice de deux jours, qui permettra l’enlèvement des blessés et l’enterrement des morts. Il faudra pour cela du temps, des efforts, des voitures très solidement attelées et beaucoup de brancardiers. Beaucoup de brancardiers ! Deux jours pour enterrer nos morts ! Un instant, le bruit courut que le gouverneur était subitement devenu fou. Non. L’bomme qui avait traité de folie la résistance prouvait, au contraire, qu’il possédait bien toute sa lucidité d’esprit : il sonnait lui-même, discrètement, la première note du glas de la capitulation. En regagnant le foyer où attendaient, pâlies par l’angoisse, nos mères, nos femmes et nos sœurs, une dernière désillusion achevait de détruire l’espérance qui, pendant si longtemps, nous avait soutenus. Le pain manquait. Le pain, — c’est dire mal, — il y avait trois mois que le pain avait commencé à faire défaut ; mais cet atroce mélange, ce lourd et noir cataplasme qui formait à peu près le total de notre nourriture ne pouvait plus être distribué qu’à la ration de 300 grammes par tète, pour vingt-quatre heures ! Depuis cinq mois, on demandait aux gouvernants : Rationnez le pain ! Depuis cinq mois, les ministres répondaient : A quoi bon ? nous en avons plus qu’il n’en faut. Pour n’avoir pas voulu rationner le pain en temps utile, on se voyait obligé, sans transition, de n’en plus délivrer à chacun qu’une quantité dérisoire, — pesée dans les boulangeries sur la présentation d’une carte spéciale. C’était tout une comptabilité que la confection et la répartition de ces billets, douloureux comme des lettres de faire part. Les municipalités y employaient des légions de scribes supplémentaires. Un service était organisé, exactement comme pour les cartes électorales aux veilles de scrutin. Chaque chef de famille avait à déclarer le chiffre des bouches à nourrir que contenait le logis. Des inspecteurs vérifiaient, au besoin, la sincérité des déclarations.
Précaution rarement utile. Jamais les Parisiens ne s’étaient montrés plus solidaires que dans cette fraternité du malheur. L’aggravation apportée par les derniers évènements avait jeté les âmes dans un état violent de surexcitation. Chacun comprenait le péril. Les physionomies étaient sombres. Tous avaient trop présagé des suprêmes apprêts..On sentait dans l’air, maintenant, l’approche de la crise suprême. L’exaspération se manifestait surtout dans les faubourgs, parmi la population que les souffrances du siège avaient plus particulièrement éprouvée. Le parti qui avait fait le 31 octobre commençait à se remuer de nouveau. Cette agitation allait se traduire, durant la nuit du 21 au 22 janvier, par deux attaques dirigées presque simultanément contre la mairie de Belleville et contre la prison Mazas. Ici étaient détenus les inculpés du 31 octobre. Les geôliers furent contraints d’ouvrir leurs cellules. Pendant ce temps, le Gouvernement délibérait. Autour de la table du conseil, le mécontentement éclatait contre le général Trochu. Le gouverneur de Paris qui ne capitulerait pas semblait atterré. Pour la seconde fois on refusait sa démission. Après avoir discuté une partie de la nuit, le gouvernement de la Défense nationale tombait d’accord sur une résolution. Au matin, des afficheurs en tapissaient les murailles : Le gouvernement de la Défense nationale a décidé que le commandement en chef de l'armée de Paris serait désormais séparé de la présidence du Gouvernement. M. le général de division Vinoy est nommé commandant en chef de l’armée de Paris. Le titre et les fonctions de gouverneur de Paris sont supprimés. M. le général Trochu conserve la présidence du Gouvernement. Ainsi s’accomplissaient les prophéties ; le gouverneur de Paris ne capitulerait pas... Lugubre quiproquo ! On s’attendait à une manifestation à l’Hôtel de Ville. Des mesures étaient prises. Vers trois heures, deux cents gardes nationaux venus en armes, suivis d’un cortège qu’avait amené l’éternelle curiosité de la foule, voient subitement les grilles de l’édifice s’ouvrir, deux rangs de mobiles faire feu. En quelques minutes, la place est balayée. Une quinzaine de morts, dont deux femmes, restent étendus. Bientôt, devant l’appel de forces considérables, devant l’arrivée des nombreux bataillons sous le commandement du général en chef Clément Thomas, la tranquillité se rétablit. La nuit, tout est rentré dans le calme. Le 23, Paris semble sortir d’un mauvais rêve. La guerre civile est conjurée. L’assiégé revient à son idée fixe : la victoire ; à son cri : Sus aux Allemands ! Mais déjà ce cri semble ne plus trouver d’écho parmi ceux qui, naguère, le jetaient à tous les vents, dans leurs allocutions au peuple et dans leurs proclamations à l’armée. Les rapports militaires se raréfient ; les mouvements de troupes sont comme paralysés ; le bruit de la canonnade se ralentit sur tout le périmètre. On dirait qu’une torpeur engourdit le bras et le cerveau des dirigeants. Puis, tout à coup, avec la rapidité d’une traînée de poudre, une rumeur se répand et gagne de proche en proche tous les quartiers. Sur la foi d’un article du Moniteur de Seine-et-Oise, ce triste journal prussien imprimé à Versailles, on annonce que Chanzy vient d’essuyer une irrémédiable défaite, que Faidherbe a subi un échec dans le Nord, que Bourbaki, battu, acculé à la frontière suisse, a dû se replier hâtivement. Tous les commandants de la garde nationale ont été, dit-on, convoqués chez Clément Thomas pour recevoir communication de ces nouvelles. On ajoute que Jules Favre est à Versailles où il débat les conditions d’une capitulation. On ne s’aborde plus qu’avec contrainte ; on échange à voix basse des paroles qu’en vain on cherche à revêtir d’une apparence de confiante fermeté ; on jette vers l’horizon des regards chargés de doute ; on lente mille efforts pour pénétrer le mystère qui enveloppe l’avenir. Une calamité immense plane sur la ville. Vers le dehors, les détonations de l’artillerie et le crépitement des explosions semblent diminuer d’intensité. Le bombardement est entré dans une phase d’apaisement que parviennent seules à justifier les rumeurs de négociations. D’instant en instant, elles acquièrent plus de consistance. Soudain, le 25, la canonnade prussienne reprend avec fureur. Des maisons déjà ébranlées s’écroulent. Saint-Denis d’une part, Auteuil de l’autre, sont écrasés d’obus. On n’est plus en sûreté dans les caves. Paris allait avoir bientôt l’explication de cette recrudescence, qui coïncidait singulièrement avec la cessation des feux, ordonnée de notre côté. Tandis que nos pièces se taisaient, en effet, pendant les pourparlers dont tout le monde s’entretenait et dont nul n’osait affirmer l’existence, les armées ennemies, comme si elles eussent voulu ne perdre ni une charge de poudre ni un projectile, épuisaient contre nous leurs stocks de coups de canon. Mais elles ne pouvaient être éternelles, ces conférences. La dernière ligne des conventions devait être le signal de la dernière bordée. Le 27 au matin une note paraissait dans l’Officiel. Les feuilles de toutes nuances la reproduisaient encadrée de deuil. Elle soulevait avec une désolante franchise le voile qui cachait encore les allées et venues des jours précédents : Tant que le
Gouvernement a pu compter sur l’arrivée d’une armée de secours, il était de
son devoir de ne rien négliger pour prolonger la défense de Paris. En ce moment, quoique
nos armées soient encore debout, les chances de la guerre les ont refoulées,
l'une sous les murs de Lille, l'autre au delà de Laval ; la troisième opère
sur les frontières de l’Est. Nous avons dès lors perdu tout espoir qu’elles
puissent se rapprocher de nous, et l’état de nos subsistances ne nous permet
plus d’attendre. Dans cette situation,
le Gouvernement avait le devoir absolu de négocier. Les négociations ont lieu
en ce moment. Tout le monde comprendra que nous ne pouvons en indiquer les
détails sans de graves inconvénients. Nous espérons pouvoir les publier
demain. Nous pouvons cependant dire dès aujourd’hui que le principe de la souveraine nationale sera sauvegardé par la réunion immédiate d’une Assemblée ; que l’armistice a pour but la convocation de cette Assemblée ; que, pendant cet armistice, l’année allemande occupera les forts, mais n’entrera pas dans l’enceinte de Paris ; que nous conserverons notre garde nationale intacte et une division de l’armée, et qu’aucun de nos soldats ne sera emmené hors du territoire. A la lecture de ces lignes, les yeux s’obscurcissent de larmes, une invincible prostration paralyse les cœurs. La vérité implacable se fait jour — et cependant personne lie veut se résigner à croire ! Quoi ! ce serait donc vrai ? Quoi cela est possible ? Nous sommes arrivés à une telle fin ! Comment ! nos murs sont debout, nos canons braquent toujours sur la campagne leurs gueules menaçantes, nos arsenaux sont pleins de boulets et de cartouches, nos soldats gardent, invaincus, leur arme à la main, et notre résistance s’arrête ! Elle était donc vraie, cette affirmation que depuis huit jours l’on murmurait : Plus de pain ! Plus de pain ! Cela dit tout, et cela termine tout. Le courage n’est rien ; le sang versé reste infécond, du jour où, derrière les combattants en armes, les femmes et les enfants se tordent dans les affres de la faim. Personne n’ose plus élever la voix. Les discoureurs de place publique eux-mêmes se taisent. Ils comprennent que l’on n’épilogue pas sur la fatalité. Le 27 janvier, il restait en magasin 11.000 quintaux de blé, 31.000 quintaux d’orge, de riz et d’avoine ; en tout, défalcation faite du déchet, 3S.000 quintaux de farine à attendre. — A attendre, car les meules écrasaient chaque jour la quantité de grain strictement nécessaire au lendemain. Un seul projectile tombant sur l’usine Cail, et l'alimentation de la cité entière était compromise. Trente-trois mille chevaux survivaient sur les cent mille que comptait Paris cinq mois auparavant. — Sept jours de pain et de viande, puis sept autres jours de viande sans pain : ainsi se résumait la situation. |