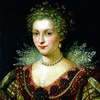GABRIELLE D'ESTRÉES
ET LA POLITIQUE DE
HENRI IV
XIII. — Vie politique de Henri IV (1695-1698).
|
Rien ne s'améliorait hélas! dans la situation politique de Henri IV ; il s'était fait peu d'amis parmi les Ligueurs, et le nombre des mécontents augmentait. On ne convertit personne dans les partis profondément convaincus ; ils tolèrent un système qui n'est pas le leur, et ne lui pardonnent jamais d'avoir renversé leur idée ; il vaut mieux être chef d'un parti, que souverain au milieu d'opinions hostiles. Le roi de France, toujours placé entre deux factions extrêmes, ne contentait personne ; il avait hérité, pour ainsi dire, de la situation difficile de Catherine de Médicis[1], morte à la peine. Les Catholiques ne pouvaient pardonner à Henri IV son extrême partialité pour le prêche, et l'édit de pacification donné par le roi, à Nantes, suscitait les récriminations les plus vives. Le parlement, quelque dévoué qu'il fut alors au système de modération, n'avait accepté cet édit qu'après les plus vives remontrances. Ceux qui ont tant exalté cet édit comme un acte populaire
n'ont pas assez tenu compte des oppositions, des remontrances qu'il rencontra
partout. Le parlement tout entier se transporta auprès de Sa Majesté, à
Saint-Germain, pour lui dire les plaintes des Catholiques ; le roi répondit :
Vous me voyez en mon cabinet où je viens vous parler
non point en habit royal, ni avec l'épée et la cappe, comme mes
prédécesseurs, ni comme un prince qui vient recevoir des ambassadeurs, mais
vêtu comme un père de famille, en pourpoint, pour parler familièrement à ses
enfants. Ce que j'ai à vous dire c'est que je vous prie de vérifier l'édit
que j'ai accordé à ceux de la religion. Ce que j'en ai fait c'est pour le
bien de la paix, je l'ai faite au-dehors, je veux la taire au-dedans de mon
royaume. Vous devez m'obéir quand il n'y aurait d'autres considérations que
de ma qualité et de l'obligation que m'ont tous mes sujets et principalement
vous, de mon parlement ; j'ai remis les uns dans vos maisons dont vous étiez
éloigné, et les autres en la foi qu'ils n'avaient plus ; les gens de mon
parlement ne seraient plus en leur siège sans moi. Ceux qui empêchent que mon
édit passe, veulent la guerre ; je la déclarerai demain à ceux de la
religion, mais je ne la ferai pas ; je les y enverrai : J'ai fait l'édit, je
veux qu'ils l'observent, ma volonté devrait servir de raison ; on ne la
demande jamais au prince d'un état obéissant, je suis roi maintenant, je veux
parler en roi, je veux être obéi[2]. Ainsi parlait Henri IV : il régnait une volonté triste quoique impérative dans les paroles du roi : On sent les oppositions qu'il rencontrait partout dans la vivacité haineuse des partis en cette occasion plus qu'en tout autre ; l'édit de Nantes blessait l'opinion de la majorité ; Henri IV se croyait plus de forces qu'il n'en avait dans la réalité. Le roi pouvait avoir sa politique à lui, mais les parlements voyaient dans l'édit de Nantes la consécration de la guerre civile ; car, en ce moment, les Huguenots gardaient peu de respect et de mesure à l'égard de l'Église ; ils ne se contentaient pas d'avoir obtenu la liberté du prêche et leurs prières publiques, ils déclamaient hautement contre les mystères et les dogmes catholiques. Le livre publié par Duplessis Mornay sur T Eucharistie causa une longue agitation au sein de l'Épiscopat français ; moyen d'opposition au gouvernement de Henri IV. Ce livre dirigé contre le sacrement eucharistique attaquait non-seulement le dogme de la présence réelle, mais encore la forme et la force du sacrement, telle que l'Église la comprenait. Duplessis Mornay soutenait que la cène huguenote était la seule et véritable manifestation eucharistique par le partage du pain entre les fidèles[3]. Au lieu de protester hautement contre de tels principes hérésiarques, Henri IV, avec son indifférence affectée, déclara, malgré les protestations du Pape[4], qu'il serait aise d'entendre sur ce point une discussion impartiale et savante entre les docteurs catholiques et les ministres protestants ainsi qu'il avait été fait dans le colloque de Poissy. D'après le récit du journal l'Étoile, œuvre d'un catholique bien tiède, la victoire resta aux docteurs de l'Église de Rome ; Duplessis Mornay fut convaincu de falsification des saintes Écritures et dans le texte même des premiers Pères ; Henri IV, comme s'il était désintéressé dans ce débat, indiqua un nouveau colloque à Chartres pour entendre lui-même les docteurs et se prononcer ensuite en pleine connaissance de cause ; Duplessis Mornay ne vint qu'à une séance de ce colloque, il n'avait pas la parole aisée, il s'embarrassait à chaque phrase ; tandis que son contradicteur était le savant Duperron, une des vives éloquences du catholicisme. Duplessis Mornay resta plusieurs fois sans parole, ce qui excita l'hilarité goguenarde du roi qui attendait mieux de celui qu'il appelait le Pape des calvinistes[5] ; il en parla même chez sa sœur, Catherine d'Albret, en signalant l'impuissance de Duplessis Mornay ; ce qui ne l'empêcha pas d'entonner de sa voix nasillarde un psaume en français de Clément Marot avec sa douce mélodie. Il se tenait alors chez la princesse de Navarre une cérémonie religieuse dans le rite réformé, à laquelle Henri IV s'unit dévotement, sincèrement comme s'il était resté huguenot. Les politiques du conseil censuraient vivement cette indifférence religieuse. L'édit de Nantes paraissait à tous, un acte de la plus haute imprudence, car il légitimait la persistance de la guerre civile : Ce n'était pas seulement la liberté de conscience et de culte qu'obtenait le parti huguenot, mais encore une sorte de gouvernement à part avec ses places de sûreté, ses précautions de guerre ses assemblées particulières, en un mot, un État dans l'État[6]. Oh ! que Henri IV avait raison de songer à se donner un successeur ! quel poids énorme il lui laissait, en présence du parti calviniste organisé en guerre, prêt à prendre les armes, si l'on manquait à une seule des concessions convenue à son égard ; et un parti puissant croit qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on lui doit. Les catholiques de leur côté, à peine sortis de la ligue, étaient impatiens de ces concessions multipliées faites à leurs ennemis ; le roi avait beau aller à la messe, on le croyait favorable au prêche, il se tenait mal à l'église, on le voyait rire, se moquer des cérémonies. Faisait-il ses pâques ? bien des catholiques le niaient[7], car on ne l'avait jamais vu accomplir son devoir pascal à sa paroisse. Si pour quelques fêtes solennelles il allait à Fontainebleau, à Poissy, à Saint-Germain, on disait qu'il profitait de ces absences pour se dispenser d'accomplir son devoir de confession et de communion et qu'il allait faire la cène dans les appartements de Madame Catherine sa sœur. Ainsi Henri ne contentait personne ; chacun était plein de méfiance à son endroit et telle est un peu la condition de tout pouvoir de juste milieu. Il n'était nulle vie de labeur qui pût se comparer à celle de Henri IV, en lutte avec toutes les exigences, tous les caprices des partis, et jugé par eux tous avec une sévérité cruelle. Ses seules distractions il les trouvait dans son amour extrême pour les femmes. Henri IV aimait à bâtir, à construire, à embellir ses châteaux, ses demeures royales, le Louvre, Fontainebleau, Saint-Germain ; s'il se refusait le moindre luxe pour sa personne, s'il quittait rarement son pourpoint gris perle souvent déchiré et rapiécés, il avait la main large, facile, pour les comptes de bâtiments et pour le luxe de ses maîtresses[8] : il répétait les larmes aux yeux : que c'était bien le moins qu'après tant de soucis et de peines prises pour le peuple, il put trouver quelques distractions dans la vie facile. Il écrivait à l'avare Sully, qui tout en faisant ses propres affaires lui adressait d'amers reproches sur ses prodigalités : Les uns me blâment d'aimer les bâtiments et les riches ouvrages ; les autres, les dames, les délices de l'amour, en tous lesquels reproches je ne nierais pas qu'il y ait quelque chose de vrai ; mais dirai-je qu'en ne passant pas la mesure, il devrait m'être plutôt dit en louange qu'en blâme, et, en tous les cas, devrait-on excuser la licence de tels divertissements qui n'apportent ni dommages, ni incommodités à mes peuples, par forme de compensation, à tant d'amertumes que j'ai goûtées et de tant de déplaisirs, fatigues, périls et dangers par lesquels j'ai passé depuis mon enfance jusqu'à 50 ans. L'Écriture n'ordonne pas de ne pas avoir de péchés ni de défauts, d'autant plus que telles infirmités sont attachées à la nature humaine, mais bien de ne pas s'en laisser dominer, ni les laisser régner sur nos volontés, qui est ce à quoi je me suis étudié ne pouvant mieux faire, et vous savez beaucoup de choses qui se sont passés touchant mes maîtresses qui ont été les passions les plus puissantes du monde ; si je n'avais souvent maintenu vos opinions contre leurs fantaisies jusqu'à leur avoir dit, quand elles faisaient les acariâtres : j'aimerai mieux avoir perdu dix mille maîtresses qu'un serviteur comme vous qui m'étiez nécessaire pour les choses utiles[9]. C'était faire le plus grand éloge de Sully et même de sa politique générale. Il y avait plus de bonne volonté que de force de caractère dans le roi Henri IV retombant toujours dans son péché favori, l'amour. Le roi allait en avant, malgré son âge, avec audace, sans tenir compte des obstacles ; il trouvait plus d'une fois des résistances imprévues et il ne s'en fâchait pas ; roi tout grisonnant il en prenait son parti. La marquise de Guercheville née Antoinette de Pons avait
épousé le comte de La marquise toujours avec ses formes respectueuses le conduisit jusque dans ses appartements afin que le roi put se débotter et s'habiller ; la marquise se retira comme pour le laisser libre de ses commandements après une profonde révérence. Le roi croyait qu'elle allait donner des ordres pour imprimer plus d'éclat à la fête et aux mystères du soir quand, tout à coup, il se fit un grand bruit de caresses et d'équipages, Henri entendit la voix de la marquise qui faisait atteler ses chevaux. Abandonnant tout, Henri IV courut aussitôt vers la cour d'honneur, et, comme il vit que la marquise se disposait à monter en voiture, il s'écria : quoi, madame, je vous chasserai ainsi de votre maison ? Sire, répondit la marquise avec autant de dignité que de fermeté : Un roi doit être maître partout où il est, et pour moi je suis bien aise de conserver quelque pouvoir dans les lieux où je me trouve, pour la garde de mon honneur. Et aussitôt malgré les insistances de Henri IV, elle monta dans son carrosse et s'éloigna pour chercher asile sous la protection d'une châtelaine de ses amies[14]. Cette noble résistance fit grand bruit, elle releva l'honneur
de la marquise et le roi ne put s'en fâcher ; il proclamait partout qu'il
avait été vaincu par l'esprit, la grâce et la galanterie. Il n'était point
habitué aux obstacles dans les questions d'amour ; il avait pour ces sortes
d'infidélités le pardon de Gabrielle d'Estrées qui visait à une destinée plus
haute que celle de maîtresse du roi, malgré l'opposition de tous et la triste
situation de |