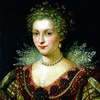GABRIELLE D'ESTRÉES
ET LA POLITIQUE DE
HENRI IV
XII. — Les derniers rejetons des Valois et des Guises (1505-1508).
|
Lorsque Henri IV délibérait sur les moyens d'assurer l'hérédité à sa race, Marguerite, sa femme (la reine Margot), restait seule pour représenter la famille légitime des Valois. Retirée dans son bel apanage d'Auvergne, elle se consolait par la culture des lettres et les distractions d'esprit et de cœur, des tristesses qui avaient accablé sa maison ; elle avait tendrement aimé ses frères, les rois Charles IX et Henri III, morts si jeunes, si magnifiques parmi les gentilshommes ; elle voyait avec un secret dépit l'avènement de cette race du Béarn, demi huguenote, si éloignée des élégantes mœurs des Valois ; elle écrivait ses mémoires[1], avec une impartialité calme et charmante, et se livrait à l'art des vers, à la poésie qui console. Toujours en correspondance avec Henri IV, son époux, ce caractère soudard et railleur allait peu à ses sentiments, elle aurait volontiers consenti à la nullité de son mariage, si elle ne s'était sentie profondément humiliée par le choix qu'il avait fait de Gabrielle d'Estrées pour lui succéder sur le trône. Ce qui la consolait et la soutenait, c'est qu'elle savait Henri IV très-hâbleur et fort en promesses de mariage, et sans doute il briserait spontanément cette liaison indigne de la majesté royale. Dans une lettre qu'elle écrivit en réponse à Sully elle
dit : qu'elle acceptait son entremise pour la
question de la nullité du mariage et qu'il ne tiendrait point à elle que le
succès ne fut tel qu'il le souhaitait, mettant à un si haut prix les vertus
héroïques du Roi et les moyens qui lui seraient présentés pour lui faire
trouver quelque part en ses bonnes grâces, mais qu'eUe ne donnerait jamais
son consentement pour parvenir à la dissolution ou nullité du mariage, tant
qu'elle estimerait qu'on voulut en donner l'honneur à cette P..... de Gabrielle[2]. Expression
colère et fière qui supposait autant d'indignation que d'orgueil. Marguerite de Valois, fort enivrée de sa race ne pouvait accepter cette idée qu'on lui préféra la fille d'un simple gentilhomme qui n'avait pas même pour elle cette pureté de vertus qui pouvait l'ennoblir et l'élever aux yeux du Roi. Un peu mauvaise langue, Marguerite disait et écrivait : que Gabrielle d'Estrées n'était que l'ancienne maîtresse du duc de Bellegarde qui avait obtenu son cœur, même durant sa liaison avec le Roi, et la femme de ce Liancourt qui s'était déshonorée en se prêtant à une façon de mariage pour favoriser les amours du Roi[3], et ce n'était pas pour une telle femme que Marguerite consentirait à briser son union avec Henri IV. Cependant, pressée par Sully, elle avait consenti à confier la discussion de ses intérêts matrimoniaux au conseiller Edouard Molé[4], l'un des membres le plus élevé et le plus populaire de la cour du parlement, et à François Langlois[5], maître de requêtes de l'hôtel ; Henri IV avait pris Marguerite par son faible ; très-prodigue, comme tous les Valois, elle avait contracté des dettes considérables, et on lui promettait de les payer en bon deniers comptants si elle consentait à la séparation, et cette promesse la ravissait, moins pour assurer son repos que pour en contracter de nouvelles, car elle avait la main percée pour les écus, comme Charles IX et Henri III, ses frères. Jamais les vassaux d'Auvergne n'avaient été plus heureux que sous Marguerite de Valois ; elle embellissait les villes, les châteaux de sa résidence, où l'on ne voyait que fêtes et pompes royales, comme autrefois au Louvre, à la belle époque des Valois. Quand on lit attentivement les Mémoires de Marguerite de Valois et avec ces Mémoires le portrait que Brantôme a tracé de cette noble princesse, on ne peut s'empêcher de croire qu'il existât un grand parti qui voulait maintenir la race des Valois contre le Béarnais et qu'au besoin pour cela on eut changé la loi salique. Brantôme aborde nettement la question ; après une apologie enthousiaste des qualités, des talents de Madame Marguerite, il déclare que pour le gouvernement, les femmes valaient mieux que les hommes, et qu'il est absurde de les exclure de la couronne par une coutume qui n'a aucun fondement même historique[6]. Brantôme restait l'homme des temps et de la race des Valois ; les goûts de la cour nouvelle n'allaient pas à ses habitudes du passé. A côté de Marguerite était son brave neveu naturel, le comte
d'Angoulême, issu de Charles IX et de la gracieuse fille d'un
chirurgien-apothicaire de la ville d'Orléans du nom de Marie Touchet[7]. Charles IX
l'avait beaucoup aimée ! elle était si belle et comptait si bien sur le
crédit de sa beauté, que lorsque la politique calviniste eut imposé à Charles
IX son mariage avec Elisabeth, fille de l'empereur d'Allemagne[8], Marie Touchet
s'était écriée : cette rousse allemande ne me fait
pas peur. Elle conserva en effet toute l'affection de Charles IX. Charles
de Valois, né de Charles IX et de Marie Touchet, enfant, avait été destiné à l'ordre
de Malte, et il avait obtenu avec les ordres, l'abbaye de Les Guises étaient encore plus fatalement frappés que les
Valois dans leur lignée, et la maison de Lorraine subissait bien des
tristesses depuis Le Roi, de son côté, avait tout à gagner en se rattachant
les Guises, les débris d'une maison puissante et populaire. Dès son entrée à
Paris, le Roi était allé visiter Mesdames de Nemours et de Montpensier[10] ; il les avait
invitées à ses jeux ; sans abdiquer tout à fait son caractère goguenard et
railleur, le Roi les avait traitées avec respect, confiance et amitié. Pour
sceller son rapprochement avec les catholiques, il avait nommé Henri de Guise
le noble orphelin, le représentant de l'illustre maison, gouverneur de
Provence, un des actes les plus habiles de son règne. Le duc de Mayenne faisait aussi sa soumission avec une
loyauté égale à celle des jeunes enfants des Guises ; d'une bravoure
incontestée, d'une capacité militaire hors ligne, quoique fort lourd de
corps, il avait tenu longtemps la campagne contre l'armée de Henri IV, et il
se rendait pour ainsi dire l'épée à la main ; mais dès qu'il eut accepté les
conditions delà paix, le duc de Mayenne se montra fort dévoué au Roi ; d'une
grande indolence à cause de son embonpoint extrême, le duc de Mayenne aimait
les fêtes les plaisirs, et Henri IV les lui prodiguait d'une façon très-chevaleresque
et très-royale. Dans son habitude de hâbleries burlesques, le Roi se vengeait
pourtant d'une certaine manière : comme le duc de Mayenne avait une grande
difficulté à marcher, le Roi l'entraînait à de longues promenades à plusieurs
lieues dans ses parcs et forêts jusqu'à lui faire perdre haleine ; le soir il
en gaussait avec ses courtisans : J'ai mal mené
aujourd'huy mon cousin le duc de Mayenne. Le duc dévorait cette sorte
d'humiliation sans dire mot ; ses vieux amis disaient que le sanglier était
pris[13]. Le cadet de la
maison de Lorraine, le duc de Mercœur, plus fier, plus heureux et plus libre,
à la tête de A considérer le côté moral et les poignantes douleurs des
humiliations, les duchesses de Nemours et Montpensier subissaient une situation
bien triste ; elles ne pouvaient aimer le prince de Béarn, devenu roi de
France, qu'elles avaient tant combattues à la tête de Plus fière et mieux à sa place était Louise de Lorraine,
fille de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, veuve de Henri III, roi de
France ; justement orgueilleuse du double sang des Valois et de Lorraine, à
la mort de son mari, die avait passé une partie de son veuvage au château de Chenonceaux,
et ensuite elle s'était retirée dans son apanage du Bourbonnais, à Moulins,
où elle menait la vie religieuse la plus méritante, au milieu des communautés
de capucines, dentelle s'était faite la protectrice ; elle avait retrouvé
dans l'humble ordre des Capucins et dans une vie bien méritante, le plus
élégant, le plus dissipé, le plus brave des amis de Henri III : le nom de
frère Ange et le capuchon de bure cachaient le brillant Henri, duc de
Joyeuse, l'époux de la noble Catherine, la digne sœur du duc d'Épernon ; voué
au cloître après la perte d'une femme aimée, le duc de Joyeuse avait repris
les armes sous Les aspects du cloître allaient seuls à la fierté résignée devant Dieu de la veuve de Henri III ; elle les préférait aux bals du Louvre, aux folles danses de la cour de Henri IV, à ces chasses où ses frères et ses tristes cousines étaient obligés de suivre Gabrielle d'Estrées, vêtue en habit d'homme. La veuve de Henri III eut baissé les yeux déboute devant de telles humiliations. Il est des situations quoique perdues, tellement élevées dans la vie, qu'elles ne permettent plus que le service de Dieu. Par son testament[16] celle qui était naguère reine de France fonda un couvent de Capucines ; et tout en respectant l'esprit de la fondation, Henri IV fit transporter les saintes filles, près de la porte Saint-Honoré, dans un vaste terrain qui s'étendait du côté des Tuileries[17]. C'est là que s'éleva ce beau couvent avec jardins, tout peuplés de fleurs que les Capucines consacraient à la parure des autels. Vouées aux macérations les plus austères, elles n'avaient d'autre luxe que celui des églises : ce n'était pas l'or et l'argent qui brillaient dans leurs sanctuaires, mais les fleurs suaves, l'œillet, le jasmin, la tubéreuse. Les capucines vouées à l'adoration du Saint-Sacrement paraient l'autel de Dieu de tout ce que la nature produisait de plus brillant. A cette époque, il ne faut pas oublier que le dogme le plus attaqué dans le symbole catholique était celui de la présence réelle. Toute l'école protestante le discutait avec une persévérance amère ou railleuse. Le livre de Duplessis Mornay avait produit une certaine impression. Pour lutter contre cette doctrine, les fervents catholiques avaient multipliés les fêtes eucharistiques, les processions de la fête Dieu, les honneurs rendus à la présence réelle, à ce point qu'en Espagne, les rois descendaient de leurs voitures ou carrosses pour y faire monter le prêtre qui portait le saint viatique au malade, pieux hommage d'égalité devant Dieu. Les Valois et les Guises, malgré leurs dissensions accidentelles, appartenaient également à ce parti catholique qui avait pour symbole la présence réelle dans l'hostie consacrée ; c'était un acte habile de Henri IV que de protéger et de grandir les démonstrations religieuses ; ces moyens seuls pouvaient lui assurer la paisible possession de la couronne, et depuis sa réconciliation avec l'Église, il n'épargnait pas ces témoignages. Les tristesses de son temps étaient si profondes et les nécessités de sa politique grandissaient encore les difficultés de son règne ! |