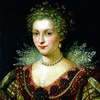GABRIELLE D'ESTRÉES
ET LA POLITIQUE DE
HENRI IV
IV. — Mariage de Marguerite de Valois avec le prince de Béarn (1571 - 1572).
|
Dans cette agitation sanglante de la guerre civile, quelques esprits calmes, fatigués, espéraient toujours une transaction. Catherine de Médicis, à la tête de cette opinion modérée, voulut apaiser la guerre civile, loyalement, de bonne foi, surtout par des mariages[1]. La reine-mère aimait les noces, les bals, les festins qui adoucissent les âmes ; Charles IX, son fils bien-aimé, épousait Elisabeth, fille de l'empereur Maximilien, prince favorable à la réformation ; et, marchant encore plus hardiment dans cette idée, Catherine de Médicis osait un mariage mixte, celui de Marguerite, sa fille (Margot, si spirituelle, si aimable), avec le prince de Béarn, chef des Huguenots. Ces noces devaient être faites sans exiger l'abjuration de Henri ; le prince resterait calviniste. Grave innovation que ce mariage mixte ; il disait tout le progrès qu'avait fait la réformation sur l'esprit des Valois. Henri de Béarn, devenu roi de Navarre, depuis la mort de son père, avait alors 19 ans ; sa taille était moyenne, sa figure portait le type de Gascogne, le nez démesurément long, le front haut, les cils épais, les yeux pétillants, la bouche à la fois bonne et ricaneuse, charmant esprit, au reste plein de bravoure, de reparties et de courage ; il s'était déjà mêlé vaillamment aux troupes calvinistes ; on l'avait vu tout jeune homme, à Jarnac, porter de vaillants coups d'épée d'estoc et de taille ; peu élégant de sa personne, fort négligé dans son costume, sentant le roussin, la sabre dache, et l'ail du midi, il avait les cheveux noirs, gras et luisants, la moustache mal peignée ; Marguerite qu'il épousait, la noble fille des Valois, au contraire, était la plus mignonne des femmes, accoutumée à tous les luxes de la cour, vivant au milieu de gentilshommes vêtus de soie, gantés, parfumés, aussi brave que Henri de Béarn, et plus que lui propres et musqués, détestant l'austérité du prêche, les ministres puritains, ennemis des fêtes et distractions de la cour. Un tel mariage, que la politique seule faisait, ne devait
pas être heureux. A peine les noces avaient-elles été célébrées à Notre-Dame,
que les Guises arrivèrent à Paris, demandant compte du sang de leur père que
Poltrot avait frappé. Quand la poursuite légale fut refusée, les princes de
la maison de Lorraine appelant la loi du talion, sang pour sang, comme au
moyen-âge, firent arquebuser Coligny[2] comme l'amiral
avait fait frapper le premier des Guises[3]. Le peuple de
Paris servit leur vengeance dans la sanglante nuit de réaction, le 24 août
1572, et Henri de Béarn, sauvé du carnage par Charles IX lui-même, embrassa
le catholicisme avec le prince de Condé, son frère ; soumission accomplie
avec une humilité profonde et une apparente sincérité ! A cette nuit
terrible de Ce naïf récit de la reine Marguerite constate la spontanéité populaire de l'insurrection du 24 août 1572, dirigée contre les Huguenots[5] ; si Charles IX, qui aimait si tendrement sa sœur Margot, avait commandé les massacres de la nuit sanglante, il eut au moins prévenu sa sœur, et celle-ci n'eut pas été surprise. Tout fut donc fait par le peuple, sous l'impulsion des quarteniers, chefs des halles : le peuple par réaction, les Guises par esprit de vengeance féodale pour atteindre Coligny, qui avait fait frapper François de Guise. Ceux qui ont vécu au milieu des excès des partis politiques, peuvent s'expliquer comment l'action des masses est supérieure à celle des pouvoirs dans les agitations publiques ; quand les vengeances du peuple sont accomplies, il faut bien que le pouvoir qui veut rester maître, les accepte, comme un fait qu'il a aidé et commandé lui-même[6]. Henri de Navarre, admis depuis ses abjurations au sein de la société catholique, vécut dans l'intimité la plus galante avec les Valois ; jeune, ardent, méridional, il se plut au milieu des fêtes, des joyeuses nuits et des amours, à cette cour si galante du Louvre et de Fontainebleau. Catherine de Médicis s'était donné pour but l'apaisement de tous ces cœurs irrités par l'oubli de la vie et le plaisir[7]. La chronique du temps dit que Marguerite de Valois, spirituelle, galante, imita la conduite de Henri de Navarre, et, parmi tous ses adorateurs, on cite le fier et jeune duc de Guise, le chef alors du parti catholique. Était-ce instinct du cœur, était-ce politique de la reine-mère, qui voulait attirer à* elle tous les chefs de parti ? Le duc de Guise, de race lorraine, était de belle et haute stature, noble cœur trempé dans un mâle courage ; il se plaisait avec Marguerite de Navarre, spirituelle, joyeuse, aimant les fêtes, les beaux habits de soie, les vêtements de velours et d'or, les toques relevées de pierreries. Cette vie d'enchantements et de plaisirs, Henri de Navarre et le prince de Condé l'avaient pleinement acceptée ; la réaction catholique fut trop puissante après la nuit du 24 août pour ne pas chercher à se faire oublier. Charles IX et Henri de Navarre partageaient les mêmes plaisirs, les chasses bruyantes, les bals, les banquets. Entre eux était née la plus tendre amitié ; le roi était si joyeux, si abandonné ; il ne pouvait se passer de son Henriot, pas plus que de Margot, qui vivaient en très-bonne harmonie, sauf quelques amers reproches sur leur mutuelle légèreté. A mesure que le parti huguenot revenait de sa première
terreur, il cherchait un chef ou roi, et il le voyait toujours dans Henri de
Navarre, jeune, brillant, courageux : il ne s'agissait que de l'enlever à
cette vie de dissipation et de péché, comme le disaient les austères ministres.
Le plan des Huguenots était habilement conçu et pouvait s'exécuter. D'après
la doctrine de Luther et dé Calvin, le mariage était dissout par le divorce,
et même par la répudiation. Luther était allé plus loin dans cette facile
doctrine[8] ; en cas de nécessité,
il avait permis la polygamie. Le consistoire de Genève avait donc déclaré que
Henri de Navarre, afin de rompre tout à fait avec l'iniquité, pouvait briser
son mariage avec Marguerite de Valois, coupable d'ailleurs d'adultère ; on
devait s'entendre avec le duc d'Alençon, fort soupçonné de huguenoterie, avec
quelques fidèles gentilshommes, placés sous les ordres de Cette nouvelle conjuration fut éventée ; Henri, une fois encore, montra cette habileté de discours, cette puissance de dissimulation qui le préserva dans plus d'une circonstance de sa vie ; il nia toute complicité (ce qui était un mensonge) ; jamais il ne montra une plus grande tendresse pour Charles IX. Au lit de mort du jeune roi, il reçut ses dernières pensées. Charles IX n'aimait pas les Guises ; et peut-être eût-il restauré le prêche sous l'influence de Henri de Béarn qu'il aimait tendrement pour les gentillesses de ses manières, la grâce de son esprit, son goût pour les exercices ; ils ne s'étaient pas quittés un moment. Henri pleura sa mort ; il craignit de nouveau pour son avenir, car pouvait-il compter sur une égale confiance de la part de Catherine de Médicis et du roi de Pologne, qui recevait la couronne de France sous le nom de Henri III ?[10] Jamais Henri de Béarn n'avait renoncé au projet d'aller rejoindre ses gentilshommes huguenots qui l'attendaient dans les provinces soulevées : la guerre civile était dans ses habitudes ; il appartenait de cœur à un parti et il désirait le servir ; en général on n'est jamais à l'aise qu'avec les hommes qui sentent et pensent comme vous. Henri de Béarn- avait bien pu entendre la messe au Louvre, sa pensée de nuit et de jour était avec le prêche, sa confiance pour les ministres de Calvin ; il n'avait accepté que la galanterie des Valois ; avec sa tête du midi il avait pu aimer les femmes, comme on les aimait à la cour de Charles IX, mais il restait Béarnais par ses formes, ses gros mots, son langage goguenard et Gascon. Les chasses lointaines, ses voyages faciles à Fontainebleau, à Blois, à Saint-Germain, lui donnaient une grande aisance pour s'enfuir ; il ne manqua pas l'occasion et s'en saisit avec une résolution que rien ne pouvait changer[11]. Ce fut la première séparation sérieuse avec Marguerite de
Valois, sa femme qui ne le suivit pas d'abord dans sa fuite. Dès qu'il eut
atteint |