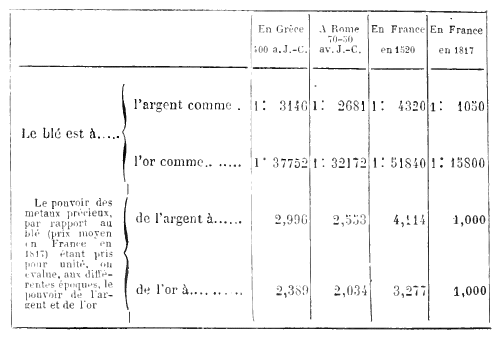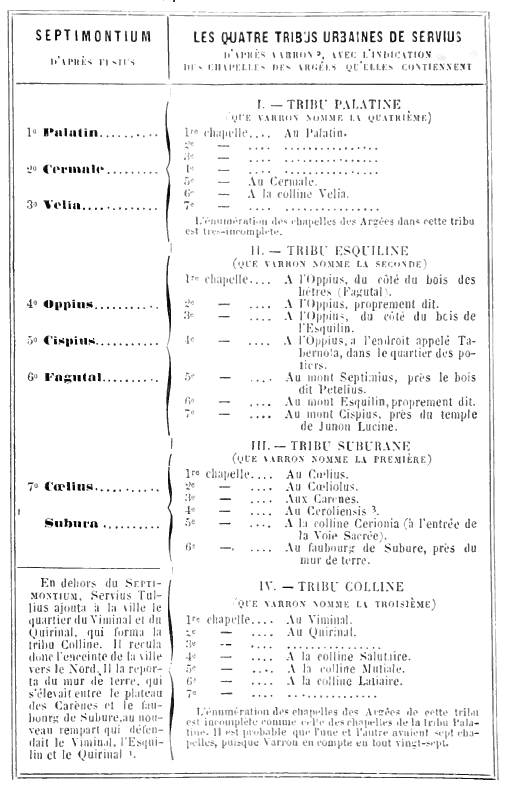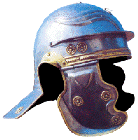HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME I
LIVRE II. HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS DE 400 À 133 AVANT JÉSUS-CHRIST.
NOTES AU LIVRE PREMIER.
|
1. SUR LE TEXTE DE TITE-LIVE, DU LIVRE I, CH. 36. Le texte de Tite-Live, I, 36 : Ita ut MILLE AC DECENTI equites in tribus centuriis essent, est controversé, et, dans les anciennes éditions, notamment dans celles de Drakenborch et de Lemaire, on lit : mille et octingenti. Cette leçon est fausse. Pour l'admettre, on est obligé d'imputer à Tite-Live, ou une faute d'arithmétique, ou la plus étrange inadvertance. Tite-Live a compté, après l'arrivée des Sabins, sous le règne de Romulus et de Tatius, trois cents chevaliers (liv. I, ch. 13), et sous Tullus, six cents chevaliers en tout (I, 30). Il dit (I, 36) que Tarquin l'Ancien doubla le nombre des chevaliers (numero alterum tantum adjecit). Il n'a donc pu arriver qu'au nombre de douze cents. La leçon vraie est celle qui met l'écrivain d'accord avec lui-même, et qui nous dispense de croire que Tite-Live ait, à l'intervalle de quelques pages, avancé des faits contradictoires. Voici l'inadvertance que M. Marquardt (Historiæ equilum Romanorum, Berlin, 1840, liv. Ier, ch. Ier, note 7, page 3), et M. Lange (Antiquités romaines, tome Ier, p. 327) prêtent à l'historien latin : 1° Il aurait compté, au temps de Romulus : 300 chevaliers. 2° Il aurait ajouté mentalement (car il a écrit le contraire aux chapitres 13 et 30 du livre Ier), après l'arrivée de Tatius et des Sabins : 300 chevaliers. 3° Enfin, il compte encore, après l'arrivée des Albains : 300 chevaliers. Total du nombre des chevaliers sous Tullus : 900. et ce nombre, doublé par Tarquin, aurait porté la chevalerie à 1.800 hommes. Pour rendre cette supposition vraisemblable, on ajoute que c'est là le calcul qu'a fait Plutarque (Vie de Romulus, ch. 13 et 20), et que, probablement, Tite-Live oubliant qu'il avait fait, dans les ch. 13 et 30 de son livre Ier, un tout autre compte, se serait mis à compter, au chapitre 36, comme on suppose que le fit Plutarque. Mais tout ce raisonnement tombe devant ce fait que ni Plutarque ni Tite-Live n'ont fait le calcul qu'on leur prête. Plutarque admet, il est vrai, qu'après l'admission de Tatius et des Sabins, le nombre des chevaliers fut doublé ; mais il ne parle nulle part des chevaliers Albains de Tullus. De son côté, Tite-Live place sous Tullus le doublement de la cité et de la chevalerie, que Plutarque place sous Tatius, et il ne croit pas que trois cents chevaliers Sabins aient été introduits dans les centuries. Car c'est après la réconciliation de Romulus et de Tatius qu'il décrit l'organisation des trois cents premiers chevaliers, par Romulus. Ajouter trois cents chevaliers Sabins à trois cents chevaliers Albains, c'est donc répéter cieux fois le même fait, sous deux formes différentes ; c'est confondre deux hypothèses historiques, méconnaître la pensée des anciens, et mettre Tite-Live en contradiction avec lui-même, afin de le mettre d'accord avec Plutarque. Le chiffre de dix-huit cents n'est, du reste, nullement établi par l'autorité des manuscrits. La plupart portent MCCC (Niemeyer, De equitibus Romanis commentatio historica, Gryphiæ, 1851, p. 29) ; mais c'est une erreur évidente des copistes. Les manuscrits de Worms et de Florence portent MDCCC ou dix-huit cents ; mais les plus savants critiques condamnent cette leçon comme inconciliable avec les ch. 13 et 30 du liv. Ier de Tite-Live ; et ils expliquent ainsi l'introduction de ce chiffre faux : le copiste aura lu un à pour un A, et écrit MDCCC au lieu de M AC CC (mille octingenti pour mille ac ducenti). Telle est l'opinion de Niebuhr (Histoire romaine, 4e éd., t. Ier, p. 377, note 892), de Forcellini (Sub verbo, Equites), d'Angelo Maï (Ad locum Ciceronis de Republica, II, 20), de Becker (Antiquités romaines, II, p. 242), de Zumpt (Über die Römischen Ritter, Berlin, 1840, S. 75), de Niemeyer (De equitibus Rom., p. 27-29). Nous avons suivi l'avis de ces critiques et admis, pour le véritable texte de Tite-Live, I, 36 : Ut MILLE AC DUCENTI equites in tribus centuries essent. 2. SUR LE PASSAGE DE FESTUS : S. V. SEX SUFFRAGIA. Aux passages de Tite-Live, I, 1-3, et I, 36, oit les six centuries sont représentées comme étant les mérites que les trois centuries instituées par Romulus, sous les noms consacrés de Rhamnes, de Tities et de Luceres, et dédoublées en six par Servius. ou a opposé un passage de Festus (s. v. Sex suffragia), d'après lequel les six centuries ou les six suffrages auraient été an contraire les nouveaux corps de chevaliers institués par Servius. On lit dans Festus (éd. d'Amsterdam, 1689, p. 503) : Sex suffeagia appellantur in equitum centuriis quæ sunt ADJECTÆ ei numero centuriarum quas Priscus Tarquinius rex constituit. Mais le texte de l'édition de M. Egger, corrigé d'après l'ancienne édition d'Orsini, porte advectæ au lieu d'adjectæ (p. 225 du vol. de M. Egger, et p. 144 de la pagination d'Orsini). Au numéro 7 de cette page, on peut voir que le mot adjectæ avait été écrit en marge par Orsini, comme une simple conjecture, et que les éditeurs hollandais de Dacier l' ont mal à propos introduit dans le texte. M. Egger, dans sa préface, XVI, avertit que les conjectures d'Orsini sont souvent trompeuses et quelquefois inutiles. L'observation du savant éditeur nous semble ici applicable. Du reste, on lit de même advectæ dans l'édition de Müller. Si ce mot est obscur, au moins ne présente-t-il aucun sens contradictoire avec le récit de Tite-Live. M. Rein (Quæestiones Tulliunæ, p. 9) propose de lire : effectæ eo numero, ce qui mettrait Festus d'accord avec Tite-Live, et M. Marquardt (Historiæ equitum Romanorum, liv. Ier, ch. II, p. 5, note 13) approuve aussi cette correction. Dans tous les cas, on ne peut opposer un passage aussi peu explicite du grammairien Festus, au témoignage précis de Tite-Live. M. Mommsen (Römische Forsehungen, Berlin, 1864, S. 139, N. 12) reconnaît que le manuscrit porte advectæ. Mais il n'en cite pas moins sans hésiter le texte avec le mot adjectæ, et il ajoute : le changement n'est pas douteux. Nous ne pouvons partager cette certitude. 3. SUR LE SENS DU MOT : ÆRA EQUESTRIA, DANS LE DISCOURS DE CATON, DONT UN FRAGMENT EST CITÉ PAR PRISCIEN. On lit dans l'édition de Priscien par Putsch (Hanoviæ, 1605), p. 350 : Cato in oratione qua suasit in senatu ut plura æra equestria fierent : Nunc ergo arbitror oportere restitui, quo minus duobus millibus durentis sit ærum equestrium. Cette leçon a été reproduite dans l'édition de Krehl (Priscien, VII, 8, p. 317 Leipsick, 1819-1820). H. Meyer la trouve inexplicable (Oratorum Romanorum fragmenta, rééd. par M. Fr. Dübner, Paris, 1837, fragm. 81 de Caton. p. 190). Il préfère l'ancienne leçon donnée par Gronovius (De pecunia veteri, p. 123) : Nunc ego (EGO pour ERGO dans l'édition de Venise) arbitror oportere institui ne quo minus duobus millibus ducentis sit rum equestrium ; et il explique ainsi : ne quo, id est, ne qua ratione, à moins qu'on n'aime mieux lire ne quoi pour ne cui. Quant aux æra equestria, il les prend pour des as payés comme solde aux cavaliers. Selon lui, la solde du fantassin étant fixée à mille as, celle du cavalier était double. Caton proposerait d'établir qu'en aucun cas la solde du cavalier, qui était tombée à deux mille as, ne fût de moins de deux mille deux cents as. Toutefois Meyer reconnaît que lorsque le trésor n'était pas obéré, la solde du cavalier était triple de celle du fantassin (Niebuhr, Histoire romaine, t. II, p. 196). Nous admettons le texte que Meyer emprunte à Gronovius ; mais son explication nous semble fausse. Æra equestria est le pluriel d'æs equestre, dont Gaius nous donne le sens (Institutes, IV, éd. Goschen, Berlin, 1842). Ea pecunia quæ stipendii nomine dabatur, æs militare dicebatur : EX QUA EQUUS EMENDUS ERAT, ÆS EQUESTRE ; ex qua hordeum equis erat comparandum æs hordearium. L'æs equestre était donc la somme de dix mille as qui, selon Tite-Live (I, 43), était donnée à chacun des cavaliers equo publico pour acheter le cheval payé par l'État. La solde du cavalier se disait en latin stipendium equestre (voir Festus, s. v. Vectigal), et l'on ne peut prendre les mots æra equestria dans le sens de asses stipendii equestris. Quand même la langue latine ne se refuserait pas à cette interprétation, nous devrions la rejeter à cause du sens qu'elle donnerait à la phrase de Caton ; car sa pensée se trouverait en contradiction avec les faits les mieux établis. Polybe (VI, 39, n° 12)
dit que la solde du fantassin était de deux oboles, c'est-à-dire d'un tiers
de drachme par jour. Elle était donc par an de 120 drachmes ou deniers,
c'est-à-dire de 1.200 as de deux onces et non pas de mille as ; car Pline,
dans son Histoire naturelle (XXXIII,
13), nous apprend que, lorsque le Sénat coupa les as de deux onces en
as d'une once valant la seizième partie du denier, il ordonna que la solde
fût calculée en as anciens et payée en deniers d'argent, sur le pied d'un
denier pour dix as. Quand même le trésor eût été obéré au temps de Caton, et
qu'on eût réduit la solde du cavalier au double de celle du fantassin, elle
eût été de 2.400 as, et la fixer à 2.200 c'eût été la réduire et non
l'augmenter. Mais la solde du cavalier fut toujours triple de celle du
fantassin ; elle l'était déjà au second siècle de Les faits historiques, comme le sens grammatical du mot æs equestre, nous obligent donc à voir dans les æra equestria les allocations faites par l'État aux chevaliers equo publico, pour acheter leurs chevaux. Caton demande que jamais le nombre de ces allocations et des chevaliers qui les recevaient ne soit au-dessous de 2.200. Il parait qu'il était tombé à 2.000 ; car Priscien et Charisius (I, 97) citent cet autre fragment de Caton : De æribus equestribus, de duobus millibus actum. Ces paroles semblent avoir été une transition employée par l'orateur pour passer à une autre partie de son discours : J'ai parlé des deux mille subventions allouées par l'État pour acheter des chevaux. 4. SUR LE SENS DU MOT : CURIATIM, DANS LE PASSAGE DE FESTUS : S. V. PRÆTERITI. On pourrait se demander si le texte de Festus, s. v. Præteriti : Censores optimum quemque CURIATIM in senatum legerent, ne signifierait pas que les censeurs devaient choisir les meilleurs citoyens de chacune des trente curies pour en composer le Sénat. Cette interprétation du mot curiatim est impossible, à cause du sens général du passage de Festus. Ce grammairien y explique la loi Ocinia. Avant cette loi, dit-il, le droit d'entrer au Sénat n'était déterminé par aucune règle ; car les magistrats choisissaient pour sénateurs qui ils voulaient, parmi les patriciens ou même parmi les plébéiens ; ce n'était donc pas une honte de n'être pas choisi. Mais lorsque la loi Ocinia eut réglé les conditions de l'entrée au Sénat, et obligé les censeurs à inscrire sur la liste des sénateurs tous ceux qui appartenaient aux ordres d'anciens magistrats (anciens édiles, anciens préteurs, anciens consuls), à moins qu'ils ne fussent exclus pour cause d'indignité personnelle, ne pas titre inscrit à son tour par les censeurs sur la liste sénatoriale, quand on avait exercé une magistrature curule, c'était perdre son rang, et cette omission (prteritio) équivalait à une note d'infamie. Puisque l'ordre du tableau des anciens magistrats déterminait le droit de chacun d'eux à siéger dans le Sénat, pour que les censeurs eussent été en même temps astreints à choisir les sénateurs dans les trente curies, il aurait fallu qu'une loi obligeât l'assemblée centuriate à répartir les magistratures curules également parmi les candidats des trente curies. Autrement, la liberté des élections du Champ-de-Mars eût rendu impossible la mission que la loi Ocinia eût confiée aux censeurs. Mais les élections ne furent jamais assujetties à une condition qui eût découragé les hommes de mérite, et réduit les grandes luttes électorales à une insignifiante loterie où les candidats de chaque curie eussent attendu patiemment leur tour avec la certitude d'arriver. Curiatim signifie donc, que le censeur, en inscrivant mi ancien magistrat sur la liste du Sénat, le classait en male temps parmi les dix chefs d'une curie. Les trois cents sénateurs, primitivement chefs des gentes (patres majorum et minorum gentium), étaient naturellement répartis, comme les gentes elles-mêmes, entre les trente curies. Par le fait seul de devenir sénateur, on devenait chef de gens ; on était inscrit en tête d'une des
trente curies dont les cadres étaient reproduits dans ceux du Sénat des trois
cents membres. C'est pour cela que celui qui arrivait à une magistrature
curule, c'est-à-dire qui acquérait le droit de siéger au Sénat, était délié
de toutes les obligations de la clientèle, s'il avait été client[1]. De client, il
devenait patron. C'est pour cela que le lieu réunion du Sénat s'appelait 5. TABLEAU DE
M. Letronne évalue, dans le même ouvrage, la livre romaine
au poids de Le poids moyen des deniers des deux derniers siècles de Le denier était donc, à peu près, de M. Letronne évalue la capacité du modius, usité au temps de Cicéron, à Il évalue la capacité du médimne,
usité en Attique au temps de Socrate, à Il établit que le médimne
de blé valait, en Attique, deux drachmes et demie, à l'époque de Socrate,
quand la drachme pesait 82 grains 1/7,
c'est-à-dire Il établit encore que le blé de Sicile, an temps de Verrès, valait trois sesterces le malins, tandis qu'en 1817, en France, le prix moyen du blé était de 24 francs 88 centimes le setier, ou 16 francs centimes l'hectolitre. En nous servant des évaluations de M. Letronne, rions
arrivons à des résultats qui ont une vraisemblance intrinsèque, par exemple :
que la ration d'orge donnée au cheval romain était de Nous avons préféré, pour ces raisons, l'autorité de M. Letronne à celle d'autres savants en métrologie. 6. QU'IL N'Y EUT QUE QUATRE TRIBUS ET NON TRENTE SOUS
SERVIUS. DESCRIPTION DE Il n'y eut, sous Servius, que quatre tribus et non pas trente, comme on le dit ordinairement. Tite-Live[4] et Aurelius Victor[5] ne connaissent que les quatre tribus urbaines au temps des Rois, et le silence de Tite-Live sur les tribus rustiques, au passage où il décrit si complètement la constitution de Servius Tullius, ne s'expliquerait pas, s'il avait cru qu'elles eussent existé sous son règne. L'idée qu'il y avait trente tribus, dont vingt-six rustiques, au temps de Servius, est contradictoire avec les faits les plus connus de l'histoire romaine. S'il y en avait eu trente sous l'avant-dernier roi, comment ne s'en trouverait-il plus que vingt ou vingt-et-une au temps du procès de Coriolan, qui eut lieu en 490 av. J.-C., moins de vingt ans après l'expulsion des Tarquins ? Niebuhr[6] a essayé de
résoudre cette contradiction en imaginant que Porsenna aurait, après la prise
de Rome[7], gardé le tiers
de l'ancien territoire romain, et enlevé ainsi à Tite-Live[8] dit que Romulus, vainqueur des Véiens, leur accorda une trêve de cent ans, en les privant d'une partie de leur territoire ; que Porsenna, par le traité du Janicule, obtint d'eux que ce territoire fût restitué aux Véiens[9] ; mais, qu'après sa défaite à Aricie, Porsenna le rendit aux Romains[10]. Denys est encore plus précis que Tite-Live : Romulus, dit-il, après sa victoire sur les Véiens, leur imposa, comme conditions de paix, de livrer aux Romains le territoire voisin du Tibre que l'on appelle les Sept-Bourgs (έπτά πάγους), et d'abandonner les salines qui sont à l'embouchure du fleuve[11]. Porsenna vainqueur demanda pour prix de son amitié ce même territoire des Sept-Bourgs, qui dépendait primitivement de l'Étrurie[12]. Mais, en échange de l'hospitalité que les Étrusques, vaincus à Aricie, reçurent à Rome, dans le vicus Tuseus, Porsenna rendit aux Romains tout leur territoire au-delà du fleuve, c'est-à-dire les Sept-Bourgs[13], qu'ils avaient perdus par le traité. Ce territoire, conquis au-delà du Tibre par Romulus sur les
Véiens, n'est donc pas resté entre les mains de Porsenna. Il s'étendait, sur
la rive droite du Tibre, depuis le voisinage de Rome jusqu'à la mer. Il n'a
jamais formé dix tribus sous les Rois, mais une seule tribu sous La raison, aussi bien que les textes, s'oppose à ce qu'on
admette qu'une petite partie du territoire véien ait pu jamais former dix
tribus ; car, lorsque le territoire véien fut tout entier conquis, on n'en
ajouta que quatre nouvelles[18]. Enfin, les
chiffres du cens prouvent clairement la fausseté de la supposition de
Niebuhr. Si le territoire romain eût été diminué d'un tiers par Porsenna, le
nombre des citoyens, aux premières années de En 493 av. J.-C., le nombre redescend à cent trente mille[23] ; en 475, il n'est plus que de cent dix ou cent vingt mille[24]. Le nombre redevient ensuite plus considérable[25]. Quel que soit celui de ces chiffres que l'on admette, il
faut reconnaître que la population du territoire romain a augmenté, depuis
Servius jusqu'aux premières années de Il reste à expliquer par quelle erreur on a pu admettre qu'il y avait trente tribus sous Servius. Un texte de Denys d'Halicarnasse, fort altéré, à ce qu'il semble, par les copistes, et encore davantage par les critiques qui ont voulu le corriger, semble la cause de cette erreur. Voici le texte de ce passage de Denys, dans les plus anciennes éditions[26] : Διεῖλε δὲ καὶ τὴν χώραν ἅπασαν, ὡς μὲν Φάβιός φησιν, εἰς μοίρας ἕξ καὶ εἴκοσιν, ἃς καὶ αὐτὰς[27] καλεῖ φυλὰς, καὶ τὰς ἀστικὰς προστιθεὶς αὐταῖς τέτταρας, καὶ τριάκοντα φυλάς ἀμφοτέρων. Κάτων μέν τοι τούτων ἐπὶ Τυλλίου τὰς πάσας γενέσθαι λέγει ὡς δὲ Οὐεννώνιος ἱστόρηκεν, εἰς μίαν καὶ τριάκοντα φυλάς, ἀξιοπιστότερος ὢν, οὐχ ωρίζει τῶν μοιρῶν τὸν ἀριθμόν. Le manuscrit du Vatican, celui de Lapus, que nous ne connaissons plus que par la traduction latine très-littérale qu'il en a faite, enfin un manuscrit du cardinal Bessarion, cité par Sigonius, portent, après les mots : ὡς δὲ Οὐεννώνιος ἱστόρηκεν, εἰς μίαν καὶ τριάκοντα φυλάς, le membre de phrase suivant, qui ne se trouve pas dans les anciens textes imprimés : ὥστε σὺν ταῖς κατὰ πόλιν οὔσαις ἐκπεπληρῶσθαι τὰς ἔτι καὶ εἰς ἡμᾶς ὑπαρχούσας τριάκοντα καὶ πέντε φυλάς. Enfin la traduction de Lapus nous indique quelques variantes dans le membre de phrase suivant. Voici comment il traduit le passage de Denys, à partir des mots Κάτων μέν τοι... Cato tamen horum sub Tullio omnes fuisse dicit ; ut autem Venonius narrat in unam et triginta tribus ; ita ut cum urbanis expletæ sint hæ quæ adsunt adhuc quinque et triginta tribus, FIDE IPSE DIGNIOR SEGREGAT NUMERUM. Le texte de Lupus devait donc porter, après les mots τριάκοντα καὶ πέντε φυλάς, la phrase suivante : αύτος πιστότερος ὢν οὐ χωρίζει... τὸν ἀριθμόν, au lieu de : ἀξιοπιστότερος ὢν οὐχ όρίζει... τὸν ἀριθμόν. Le mot αύτος séparé de πιστότερος, dans le texte de Lupus, indique assez que le mot ἀξιοπιστότερος, des autres textes, a dû être formé de deux mots fondus ensemble par un copiste inintelligent. D'un autre côté, αύτος n'ayant pas de sens ici, puisque ce pronom ne pourrait représenter que Venonius et que cet historien définissait le nombre des tribus et distinguait celles de la ville de celles de la campagne, on est forcé d'admettre que le mot αύτος avait été écrit à la place d'un nom semblable de quelque autre historien, comme Άττιος ou Αίλιος, transformé en Άξιο, dans la plupart des textes. Nous proposerons donc la leçon suivante du passage de Denys (IV, 15) : Διεῖλε δὲ καὶ τὴν χώραν ἅπασαν, ὡς μὲν Φάβιός φησιν, εἰς μοίρας ἕξ καὶ εἴκοσιν, ἃς καὶ αὐτὰς καλεῖ φυλὰς, καὶ τὰς ἀστικὰς προστιθεὶς αὐταῖς τέτταρας, καλεϊ[28] τριάκοντα φυλὰς ἀμφοτέρων. (Κάτων μέν τοι τούτων Τυλλίου τὰς πάσας γενέσθαι λέγει) ὡς δὲ Οὐεννώνιος ἱστόρηκεν, εἰς καὶ τριάκοντα φυλὰς, ὥστε σὺν ταῖς κατὰ πόλιν οὔσαις ἐκπεπληρῶσθαι τὰς ἔτι καὶ εἰς ἡμᾶς ὑπαρχούσας τριάκοντα καὶ πέντε φυλάς. Αίλιος[29] πιστότερος ὢν, οὐχ όρίζει τῶν μοιρῶν τὸν ἀριθμόν. Διελὼν δ´ οὖν ὁ Τύλλιος εἰς ὁπόσας δήποτε μοίρας τὴν γῆν. Cette leçon est conjecturale sans doute, et, pour se transformer en une restitution vraiment scientifique de ce passage, elle aurait besoin d'être contrôlée par une étude technique des manuscrits, qu'il nous a été impossible de faire. Mais, telle qu'elle est, elle se rapproche beaucoup plus du texte connu des manuscrits du Vatican, de Bessarion et de Lapus, que toutes les leçons admises jusqu'ici. Elle n'exige que deux changements de mots : celui du mot αύτος, du manuscrit de Lupus, en Αίλιος, et celui de καὶ en καλεϊ ; elle fournil un sens très-clair sans aucune transposition de phrases, tandis que Sigonius[30] et Niebuhr[31] ont bouleversé le texte pour l'expliquer. La leçon que nous proposons se traduirait ainsi : Tullius divisa la campagne entière, si l'on en croit Fabius, en vingt-six parties, que Fabius nomme aussi tribus, et, en y ajoutant les quatre tribus urbaines, il appelle trente tribus la somme des unes et des autres. (Pourtant Caton dit que, sous Servius, le nombre total des tribus se composait de ces dernières[32]). Si l'on s'en rapporte à Venonius, il aurait divisé la campagne en trente-et-une tribus, de sorte qu'avec les quatre tribus de la ville, le nombre définitif des trente-cinq tribus qui existent encore aujourd'hui aurait été complété. Ælius, écrivain plus digne de confiance, ne cite pas le nombre des circonscriptions. Tullius ayant donc partagé le territoire de la campagne en un nombre quelconque de parties.... Quelle que soit la leçon que l'on admette, il ressort des paroles mêmes de Denys qu'à ses yeux Fabius u eu tort de confondre sous le même nom de les quatre tribus urbaines et les vingt-six circonscriptions rurales, que Denys appelle μοϊραι ou πάγοι, pagi. Car cet historien ajoute[33] : Tullius ayant partagé la campagne en un nombre quelconque de circonscriptions, sur les montagnes ou sur les collines qui pouvaient offrir le plus de sécurité aux laboureurs, il fit fortifier des places de refuge, qu'il appelle d'un nom grec pagi (πάγοι). Là, venaient chercher asile les habitants des campagnes, lorsque l'ennemi faisait invasion, et, le plus souvent, c'est là qu'ils passaient la nuit. Les vingt-six circonscriptions rurales étaient donc, selon Denys, non des tribus, mais des districts, ayant chacun sa citadelle appelée pagus, et ses fêtes religieuses, les Paganalia. Si on lit le passage controversé de Denys comme Sigonius ou comme Niebuhr, on doit croire que Caton n'avait pas détermine le nombre des districts ruraux du temps de Servius, et que Denys ne le détermine pas davantage. Si l'on admet la leçon proposée plus haut, il faut admettre que Caton réduisait à quatre, comme Tite-Live, le nombre total des tribus primitives. Un passage de Varron[34], qu'un a cité à l'appui de l'opinion qu'il y avait trente tribus sous Servius, n'en donne pas la preuve : Extra urbem in regiones XXVI agros viritim liberis attribuit. Il n'est pas ici question de tribus, mais de vingt-six régions ou districts ruraux, ayant chacun pour centre militaire et religieux un pages. Tite-Live prend aussi le mot de région dans le sens de district rattaché à un pagus, lorsqu'il dit que la ville de Servius fut divisée en quatre quartiers d'après les régions el les collines, et qu'on appela tribus les quartiers où était répartie la population[35]. Il y avait dans les quatre tribus urbaines, outre les sept collines de la ville antique du Septimontium, plusieurs pagi ou lieux de refuge pour les habitants des régions suburbaines, qui furent renfermées dans l'enceinte de Rome. Cicéron mettait encore de son temps des Pagani à côté des Montani
dans la plèbe urbaine[36], c'est-à-dire
les habitants des faubourgs avec ceux de la cité. On peut distinguer les
quartiers de Rome où habitaient les Montani
de ceux où les Pagani avaient
autrefois établi leurs lieux de refuge. La fête des Agonalia ou d'Acca Larentia s'appelait Septimontium. On y célébrait, le 10 décembre,
un sacrifice dans le Vélabre, au coin de la rue Neuve, en dehors de la ville
antique, et à quelque distance de la porte Romanula,
située à l'angle nord, ouest du Palatin, auprès de la descente qui menait à
la rive gauche du Tibre. Ce n'était pas la fête de tout le peuple de la
ville, mais seulement des Montani ; de
même que les Paganales étaient jour de fête pour ceux qui étaient d'un pagus[37]. Le nom de Septimontium venait des sept montagnes sur
lesquelles était bâtie Pour se convaincre que la ville antique du Septimontium correspondait à ce qui forma depuis les trois tribus Suburane, Palatine et Esquiline de Servius, il suffit de comparer la description du Septimontium, par Festus, et celle des quatre tribus urbaines de Servius, par Varron[41].
De la porte Esquiline à la porte Colline, sur une étendue de six ou sept stades, les Romains creusèrent un fossé de trente pieds de profondeur et de cent pieds de large. Devant le talus formé par la terre rejetée à l'intérieur et large de cinquante pieds[42], ils élevèrent un mur très-haut. Ces travaux, commencés par Servius[43], furent achevés par Tarquin-le-Superbe[44], qui augmenta la hauteur du mur, la profondeur du fossé et le nombre des tours. Cette fortification ferma, vers le nord, le seul accès facile de la ville de Rome, lorsqu'elle se fut agrandie en dehors du Septimontium. On peut, d'après ces observations, distinguer facilement, dans la plèbe urbaine, les Montani des Pagani : 1° Les Montani, qui
célébraient la fête du Septimontium, habitaient le Palatin, le Cermale, 2° Les Pagani de la ville habitaient le Capitole, le Vélabre, l'Aventin, le Viminal et le Quirinal, c'est-à-dire les deux forteresses de Rome, une partie de la rive gauche du Tibre et l'emplacement de la tribu Colline. M. Mommsen[45] a essayé de prouver que le compte faux de trente tribus, au temps de Servius, venait de ce qu'on avait ajouté aux six districts religieux du Septimontium (dont il retranche le Clius et le faubourg de Subure) vingt-quatre districts ruraux, entre lesquels les chapelles des Argées auraient été réparties. Mais cette démonstration pèche en deux points : Varron compte vingt-sept chapelles des Argées et non vingt-quatre, et il place ces chapelles sur les collines du Septimontium. Il n'y a que les chapelles de la tribu Colline qui soient en dehors de la ville primitive. Les chapelles des tribus Palatine, Esquiline et Suburane n'ont donc jamais été les centres de districts ruraux. Mais la conclusion de M. Mommsen a plus de valeur que sa preuve. De même que dans la ville furent renfermés plusieurs pagi, dont l'un, le pagus sucusanus, donna son nom à la tribu Suburane, le territoire rural était aussi subdivisé en pagi. Le pays conquis par les Romains, sur la rive droite du Tibre, qui forma plus lard la tribu Romilia, s'appelait primitivement les Sept-Bourgs (septem pagi). Sur la route de Gabies, au temps de Tarquin-le-Superbe, tous les districts ruraux avaient leur pagus[46] fortifié. Au sud de Rome, le pagus Lemonia commençait hors de la porte Capène, sur la voie Latine[47], et il donna plus tard son nom à la tribu Lemonia, une des seize premières tribus rustiques. Enfin, le territoire donné aux clients d'Atta Clausus, sur la rive droite de l'Anio, et qui devint plus tard celui de l'ancienne tribu Claudia[48], dut aussi, en 503 av. J.-C, former un pagus. Quel était le nombre de ces districts ruraux ou pagi qui entouraient Cette symétrie explique aussi comment, sous les rois et
même aux premiers siècles de M. Mommsen croit que toute la campagne était partagée entre les quatre tribus[55] urbaines : Pour faciliter les levées, la ville et la banlieue furent partagées en quatre quartiers ou tribus.... Ostie, par exemple, appartient au Palatin[56]. Il est plus vraisemblable qu'il y avait quatre cantons ruraux, qui, sans porter encore le nom de tribus, étaient subdivisés chacun en six ou sept papi. On conçoit alors par quelle inexactitude d'expression, Fabius Pictor, qui écrivait en grec, est arrivé au compte de trente tribus, an temps de Servius. Les vingt-six papi de la campagne, qui avaient pour analogues les vingt-sept districts religieux de la ville, il les a ajoutés aux quatre tribus urbaines, et a composé un total de trente circonscriptions qu'il appelait toutes tribus (φυλαί), bien que ce nom convint seulement à quatre d'entre elles. 7. SUR Denys (IX, 27) raconte que le fils de Menenius Agrippa fut (en 476 av. J.-C.) condamné à une amende de deux mille assarii. L'assarius, ajoute-il (άσσάριον), était une monnaie de cuivre du poids d'une λίτας (Βάρος λτριαΐον), de sorte que toute la dette était de 16 talents en poids de cuivre. En niellant le talent au poids de quatre-vingts livres
romaines, seize talents sont un poids de Denys n'avait qu'un mot, pour désigner la livre romaine et
la livre de Sicile. Au fragment 1er de son livre XX, il traduit dix livres
romaines par δέκα
λίτρας, et, en cet endroit, il en évalue
bien le poids à un peu plus de huit mines attiques (plus de Cependant, nous n'imputerions pas à Denys cette erreur, si nous n'avions trois preuves directes pour montrer que l'assarius a toujours été identique à l'as romain et a suivi les variations de sa valeur. 1° Charisius (p. 58, éd. Putsch) nous dit : Assarius ab antiquis dicebatur, none dicitur as. L'autorité de ce grammairien et celle de Festus sont plus grandes qu'on ne l'a supposé ; car, trop éloignés de l'antiquité pour la connaître par eux-mêmes, ils se contentent, le plus souvent, de faire des extraits des grammairiens anciens, par exemple de Varron et de Vervins Flaccus. 2° Varron (De lingua latina, VII, 38) écrit : Debet
igitur dici ut Vatiniorum. Manliorum, sic denariorum, et NON
EQUUM PUBLICUM MILLE ASSARIUM ESSE, SED MILLE ASSARIORUM ; AB UNO
ENIM ASSARIO MULTI ASSARII ; AB EO ASSARIORUM. Nous avons montré, suivant en cela l'opinion de M. Zumpt, que de ce passage on peut conclure que le prix du cheval, avant les guerres puniques, était de mille assarii. Or, nous avons décrit (liv. II, ch. III) une révolution économique, qui, dans l'intervalle des deux premières guerres puniques, décupla tontes les valeurs nominales marquées en as ; et nous trouvons, à l'époque d'Annibal, que la valeur du cheval était, à Rome, de, dix mille as de deux onces. Donc, elle était de mille as d'une livre avant l'an 264 av. J.-C., et ces mille as se confondent avec les mille assarii dont parle Varron. 3° Enfin l'assarius et le semi-assarius étaient encore en usage au temps de Caton. Plutarque, dans la vie du vieux censeur, emploie le mot άσσαριον (assarius) pour désigner la valeur d'un as, ch. IV. ὄψον παρασκευάζεσθαι πρὸς τὸ δεῖπνον ἐξ ἀγορᾶς ἀσσαρίων τριάκοντα..... κἂν ἀσσαρίου πιπράσκηται, πολλοῦ νομίζειν. Polybe (liv. II, ch. XV, n°
6) nous apprend que, de son temps, dans une hôtellerie de Ώς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ παρίενται τοὺς καταλύτας οἱ πανδοκεῖς, ὡς ἱκανὰ πάντ´ ἔχειν τὰ πρὸς τὴν χρείαν, ἡμιασσαρίου (τοῦτο δ´ ἔστι τέταρτον μέρος ὀβολοῦ) σπανίως δὲ τοῦθ´ ὑπερβαίνουσι. On le voit, la carte à payer ne se montait pas liant dans ces hôtelleries. L'obole était la sixième partie du denier, et le demi-assarius le quart de l'obole ; on donnait donc douze assarii pour un denier, à l'époque où Polybe écrivait, c'est-à-dire vers 150 av. J.-C. Or, on peut suivre l'augmentation graduelle de la valeur du cuivre par l'apport à l'argent, à mesure que l'argent devient plus abondant à Rome, de 269 à 131 av. J.-C. En 269 av. J.-C., un denier de En 211, le denier de 8 là la livre romaine, pesant 3 gr. 88 cent., vaut dix as, dont charnu pèse, 13 ; de la livre. Le rapport de la valeur du cuivre à celle de l'argent est donc : 1 / ((84 * 10)/6) c'est-à-dire 1/140. En 217 av. J.-C., on taille douze as d'une once à la livre de cuivre, el le denier d'argent de 84 à la livre vaut seize de ces as. Le l'apport de la valeur du cuivre à celle de l'argent est donc : 1 / ((84 * 16)/12) c'est-à-dire 1/112. Mais la conquête de Carthage, de En supposant que l'assarius du temps de Polybe ne soit autre chose que l'as uncial, qu'on fabriquait depuis 217 av. J.-C., nous arrivons à cette conséquence, si conforme aux faits économiques de l'époque, que, vers l'an 130 av. J.-C., au lieu de seize as d'une once, on n'en donnait que douze pour un denier d'argent, La valeur du cuivre, par rapport à celle de l'argent, s'était donc élevée à 1 / ((84*12)/12) ou à 1/84. L'argent continua, après la prise de Carthage et de Corinthe, et à l'époque où les Romains héritèrent des richesses d'Attale de Pergame, à affluer et à s'avilir sur le marché romain. L'écart entre la valeur usuelle de l'as uncial, et sa valeur légale qui était beaucoup moindre, devint de plus en plus marqué. En 131 av. J.-C., le tribun C. Papirius Carlson, pour mettre la légalité it peu près d'accord avec l'usage, lit couper en deux l'as d'une once, et, désormais l'as d'une demi once valut autant que l'as uncial de 217 av. J.-C., la seizième partie du denier. La supposition que lassarius du temps de Polybe était identique à l'as uncial, est donc conforme à toute l'histoire des variations progressives de la valeur du cuivre, entre 269 et 131 av. J.-C. Elle explique la loi Papiria, dont nous parle Pline (Hist. mundi, XXXIII, 13). |