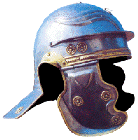|
§ I. RESSEMBLANCES DES DOUZE CENTURIES ÉQUESTRES ET
DES SIX CENTURIES SÉNATORIALES. LEUR RAPPROCHEMENT DANS LA FÊTE ANNUELLE
DU 15 JUILLET ET DANS LA REVUE QUINQUENNALE. LES ÆRARII.
N° 1.
Cicéron considère les douze centuries equo publico et les six centuries sénatoriales
de chevaliers comme deux moitiés d'un même corps constitué sous Tarquin[1]. Denys groupe
toujours ensemble les dix-huit centuries sans indiquer entre elles aucune
distinction[2]
Les ressemblances entre les douze centuries militaires et les six centuries
consacrées étaient donc plus sensibles au siècle de Cicéron et de Denys que
les différences qui les séparaient. Depuis l'an 400 av. J.-C., les centuries equo publico, n'étant plus attachées à des
corps utilitaires distincts, chacun de leurs membres faisait dans le cortège
des chefs de guerre le même service. Enfin, les six et les douze centuries
figuraient dans la procession du 15 juillet et, dans la revue quinquennale
comme deux parties d'un même tout, organisées d'après les mêmes principes et
soumises aux mêmes lois.
Au temps de la République, le défilé des chevaliers, la fête
du 15 juillet (transvectio
equitum), et la revue que les censeurs leur faisaient
passer tous les cinq ans étaient deux cérémonies entièrement distinctes. Auguste
les réunit en une seule[3] en exerçant
souvent les fonctions de censeur pendant le défilé du 15 juillet[4]. Aussi les
trouvons-nous confondues dans les auteurs qui ont efrit après le règne d'Auguste,
dans Suétone et dans Valère Maxime[5]. Mais nous
distinguerons pour l'époque qui s'est écoulée entre le siège de Véies et le
tribunat du second des Gracques (400-123)
deux cérémonies bien différentes : le défilé des ides de juillet (transvectio equitum),
fête militaire et religieuse en l'honneur de la chevalerie ; et la revue
quinquennale (census,
probatio, recognitio
equitum), sorte d'inspection qui tournait souvent à la
confusion de quelques-uns des chevaliers.
N° 2. FÊTE DES IDES DE JUILLET.
Le dictateur Postumius, avant la bataille du lac Régille (15 juillet 496 av. J.-C.), fit vu, s'il était
vainqueur, d'instituer des sacrifices et des jeux magnifiques qui seraient
célébrés tous les ans[6]. La victoire des
Romains fut décidée par le courage de la chevalerie[7], et plus tard on
raconta que deux cavaliers, d'une taille plus qu'humaine, avaient paru à la
tête des escadrons romains et mis les Latins en déroute. Le soir même, les
deux jeunes guerriers se montrèrent sur le Forum, le visage encore tout animé
du feu du combat, et ils lavèrent dans l'eau de la fontaine de Juturne, près
du temple de Vesta, leurs chevaux blancs trempés de sueur. Ils annoncèrent le
gain d'une grande bataille. Mais quand le préfet de la ville voulut les voir
et les questionner, ils avaient disparu. Les Romains reconnurent Castor et
Pollux, et bâtirent, à l'endroit où ils s'étaient montrés, le temple des
Dioscures. Aussi tous les ans, aux ides de juillet, jour anniversaire de leur
victoire, les chefs de la chevalerie venaient offrir au nom du peuple romain
de magnifiques sacrifices. Le Sénat avait acquitté le vu de Postumius : le
temple des cieux héros, devenus les patrons célestes des chevaliers romains,
avait été dédié par le fils même de ce dictateur, le 15 juillet 484[8]. Tous les ans, à
pareil jour, jusqu'au temps de la guerre punique, le trésor dépensa cinq
cents mines[9]
pour les frais des jeux et des cérémonies religieuses. La partie la plus
ancienne et la plus intéressante de cette fête était la procession militaire
des jeunes Romains qui, rangés les uns par tribus et par curies[10], les autres par
classes et par centuries, se rendaient du Capitole, à travers le Forum,
jusqu'an grand Cirque où allaient commencer les jeux. C'est seulement en 302
av. J.-C. que le censeur Q. Fabius Rullianus[11] ajouta à ce
défilé des enfants le défilé des chevaliers equo
publico, qui s'appelait transvectio
equitum. Après les sacrifices et les jeux, les chevaliers
revenaient du grand Cirque au Capitole par le chemin qu'avait suivi le matin
la procession des jeunes gens. Ils se réunissaient sur la voie Appienne, en
dehors de la porte Capène, entre les temples de Mars et de l'Honneur. Ils
traversaient le grand Cirque et le Forum en passant auprès du temple des
Dioscures[12].
Dans cette marche, tous ceux qui avaient reçu un cheval
payé par l'État s'avançaient en ordre de bataille comme s'ils revenaient de
la guerre. Ils étaient rangés par tribus et par curies.
Montés sur des chevaux blancs[13], ils étaient
vêtus de ces robes de pourpre rayées de bandes rouges qu'on appelait trabées. La richesse de leur costume était
rehaussée par les ornements militaires dont ils avaient été décorés pour prix
de leur courage, et leur chevelure était couronnée de branches d'olivier[14]. Dans cette
troupe brillante de deux mille quatre cents chevaliers equo publico, on eût difficilement distingué ceux
qui étaient membres des six centuries consacrées, de ceux qui appartenaient
aux douze dernières centuries enrôlées par Servius ou par Tarquin. Car tous
étaient répartis dans les six turmæ
qui représentaient les six demi-tribus anciennes des Rhamnes, des Tities
et des Luceres.
Tous les chevaliers equo
publico avaient trouvé place dans les trente curies, d'oit les
chevaliers equo privato n'étaient pas
exclus[15]. Chacune des six
turmæ[16] equo publico, composée de quatre cents
chevaliers, devait donc être subdivisée en cinq curies, dont chacune en
contenait quatre-vingts ; et chaque curie comprenait deux groupes : quarante
chevaliers des six anciennes centuries et quarante des douze dernières. Mais
cette dualité de la curie disparut. Les différences religieuses, militaires,
politiques, sociales qui avaient séparé les six centuries des douze dernières
s'effacèrent au temps de César et d'Auguste. Les nombres mêmes furent
changés. Au lieu des deux mille quatre cents chevaliers quo publico, dont les
cadres étaient restés immobiles depuis Tarquin jusqu'à Scipion Emilien, Denys
en compta près de cinq mille au temps d'Auguste[17]. Au lieu de
dix-huit centuries divisées en deux groupes de douze cents hommes, on ne
connut plus, au temps de l'Empire, que les six turmæ
equo publico représentant les six demi-tribus de la Rome primitive, et ses
trente curies ; et chaque turma était
conduite par un sevir dans le défilé
solennel des ides de juillet.
N° 3. REVUE QUINQUÉNALE DE LA CHEVALERIE (CENSUS, PROBATIO OU RECOGNITIO EQUITUM).
Les censeurs faisaient passer tous[18] les cinq ans une
revue aux chevaliers equo publico. Ces
magistrats, dont le pouvoir durait dix-huit mois[19], terminaient
l'opération du recensement général la seconde année de leur magistrature[20]. Le sacrifice
expiatoire d'un porc, d'une brebis et d'un taureau célébré au Champ-de-Mars
par l'un des deux censeurs[21], à l'imitation
de Servius Tullius[22], annonçait que
la liste des citoyens romains était close, et le lustre de cinq ans terminé (lustrum conditum).
Le recensement et la revue (census, recognitio)
des chevaliers equo publico[23] étaient une
opération à part qui n'avait lieu qu'après le sacrifice des suovetaurilia, et après la clôture du lustre[24].
Après l'an 240 av. J.-C., chacune des trente-cinq tribus
se trouva partagée en cinq classes dont la première se composait de tous ceux
qui avaient le cens équestre[25]. Sur les listes
des censeurs, les chevaliers equo publico
devaient donc être inscrits dans chaque tribu en tête des citoyens de la
première classe. Aussi les appelait-on un à un en suivant l'ordre des trente-cinq
tribus[26], devant le
tribunal des censeurs dressé sur le Forum. Celui que le héraut avait cité
arrivait devant ces magistrats en conduisant son cheval par la bride[27]. S'il avait fini
les dix ans de service exigés par la loi, le censeur le lui demandait, et le
chevalier répondait en énumérant ses campagnes avec les noms des généraux
sous lesquels il avait servi[28] : puis il
rendait[29]
au censeur le cheval appartenant à l'État, qu'un autre censeur lui avait confié.
Le censeur lui décernait l'éloge ou le blâme qu'il avait mérité, et le
chevalier devenait apte à briguer la première des charges politiques, la
questure[30].
Si le service du chevalier n'était pas fini et qu'il n'y
eut aucun reproche à lui faire, les censeurs lui ordonnaient de défiler
devant eux (prterire,
traducere equum[31]). Mais il pouvait encourir leur blâme pour
plusieurs raisons : s'il avait mis peu de soin à entretenir sou cheval, il
était noté pour incurie (impoliti notatus[32]) et pouvait être privé de la subvention de l'æs hordearium[33].
Sa conduite personnelle lui attirait quelquefois des notes
plus sévères. Les censeurs, pour punir une faute grave, ôtaient au chevalier
le cheval donné par l'État, et l'obligeaient à le vendre pour en rembourser
le prix au trésor, ce qui était à la fois une perte d'argent et un
déshonneur. Ils pouvaient annuler les années de service du chevalier equo publico et les lui faire recommencer avec
un cheval acheté à ses frais : enfin, ils le privaient souvent d'une partie
de ses droits électoraux.
Mais quelle que fût la sévérité d'un censeur, sa note
n'était le plus souvent qu'une punition toute morale. Tite-Live dit qu'au
temps de la seconde guerre punique elle était déjà sans effet[34] (iners nota)
; et au temps de Cicéron, elle n'avait pas acquis plus de force[35]. Car il nous dit
que le châtiment infligé par un censeur s'appelle ignominie
parce que le jugement prononcé par le censeur est purement nominal, et que le condamné en est presque
toujours quitte pour la honte[36]. Cette note,
déjà si faible par elle-même, était souvent effacée par le collègue de celui
qui l'infligeait, et elle l'était presque toujours par un de ses successeurs[37]. Aussi, pour un
censeur comme Caton l'Ancien qui poursuivait d'amères invectives les
chevaliers qu'il privait du cheval donné par l'État[38], combien ne s'en
trouvait-il pas qui préféraient imiter l'habile modération de Scipion Émilien[39] ?
Un jour qu'étant censeur, il
passait en revue les centuries de chevaliers, il vit s'avancer vers son tribunal,
à l'appel du héraut, C. Licinius Sacerdos. Il déclara qu'à sa connaissance, ce
chevalier avait manqué à un serment fait solennellement ; et que, si
quelqu'un voulait l'accuser, il prêterait à l'accusateur l'appui de son
témoignage. Personne ne s'approchant pour se charger de cette tâche, Scipion
dit à Sacerdos : Fais passer ton cheval. Je te fais
grâce de la note du censeur, de peur de paraître avoir cumulé contre toi les
fonctions d'accusateur, de témoin et de juge.
Quand on citait un chevalier devant le tribunal du
censeur, un accusateur pouvait donc se présenter et provoquer contre lui les
sévérités du magistrat de même que le magistrat pouvait provoquer contre lui
une accusation[40].
N° 4. LES ÆRARIIS.
La punition la plus fréquente infligée par le censeur au
chevalier qu'il effaçait de la liste des dix-huit centuries equo publico ; était de l'inscrire au nombre
des ærarii :
Publius Scipion Nasica et M.
Popilius faisant le recensement des chevaliers, aperçurent un cheval maigre
et fatigué dont le cavalier était d'un embompoint remarquable. Comment se fait-il, dirent les censeurs au
cavalier, que vous soyez mieux soigné que votre
cheval ? C'est, répondit-il, que je me soigne moi-même, et que mon cheval est soigné
par Stace, mon esclave. La réponse parut peu respectueuse, et le
chevalier fut, selon l'usage, mis au nombre des ærarii[41].
Pour nous rendre compte de cet usage, nous devons
expliquer ce que c'était que cette classe de citoyens ærarii, et cette explication ne nous entraîne
pas hors de notre sujet ; car il n'est presque pas une revue de chevaliers equo publico, mentionnée par les anciens, où
cette peine n'ait été appliquée par les censeurs à quelques-uns d'entre eux.
Asconius[42] nous dit que le
citoyen marqué par les censeurs sur les tables des Crites et devenu rarius,
était par là effacé du tableau de sa centurie, et ne restait citoyen que par
l'obligation de payer au trésor sa part du tribut, ut pro capite suo tributi nomine ra penderet. On a cru que l'rarius était privé du droit de voter. Mais
Tite-Live[43]
nous apprend qu'un censeur ne pouvait enlever au moindre citoyen le droit de
suffrage ; que l'exclure du nombre des votants des trente-cinq tribus, c'eût
été lui enlever le droit de cité et la liberté même ; et qu'il fallait pour
cela un ordre du peuple, c'est-à-dire une sentence d'exil. Cicéron va plus loin[44] : il déclare que
le peuple lui-même ne peut ôter le droit de cité à un homme que de son
consentement ; que le citoyen, pour devenir étranger à la cité, doit s'exiler
lui-même, et qu'afin de ne pas rester désarmé devant ce droit de l'individu,
le peuple procédait contre celui qu'il voulait exiler, non par l'abolition
directe de sa qualité de citoyen ; mais par l'interdiction du toit, du feu et
de l'eau qui le forçait à changer de patrie (mutare solum).
Un censeur ne pouvait donc ôter à un citoyen le droit de
suffrage, que Tite-Live regarde comme inséparable du droit de cité. En le
faisant rarius, il l'effaçait
seulement du tableau de sa centurie, mais il le laissait inscrit dans une des
trente-cinq tribus. L'rarius n'était
plus un des citoyens des cinq classes, mais il était rangé dans une des
sous-classes (infra
classem[45]). Il ne votait plus dans l'assemblée
centuriate ; mais il votait dans celle des trente-cinq tribus où les
sous-classes étaient comprises et où les différences de fortune étaient
effacées[46].
Par là s'explique le fait le plus bizarre de l'histoire romaine, la vengeance
du censeur Livius qui, en l'an 204 av. J.-C., voulut punir tout le peuple
romain de l'avoir nommé consul et censeur, après l'avoir condamné et de s'être
montré par là, à son égard, injuste et inconséquent[47]. Il mit au
nombre des ærarii le peuple romain
presque tout entier, trente-quatre tribus sur trente-cinq. Si les ærarii eussent été privés du droit de voter,
Livius eût détruit la constitution romaine. Mais cette boutade violente ne
provoqua aucune réclamation. Livius avait fait un usage peu sensé, mais
légal, de son pouvoir[48]. Il n'avait
privé complètement personne du droit de voter. L'assemblée des tribus, où il
n'y avait pas de distinction de classes, ne recevait aucune atteinte d'une
mesure qui déclassait presque tous les citoyens. Quant à l'assemblée
centuriate, Livius, en la réduisant beaucoup, la laissait aussi subsister, du
moins en principe. Il avait épargné une seule tribu, la Mcia.
Or, depuis l'an 240 av. J.-C., chaque tribu contenait cinq
classes, dont chacune était divisée en deux centuries, une de seniores, une de juniores.
Au gré de Livius, et si son collègue Claudius, qui était son ennemi, ne s'y
fût opposé, l'assemblée centuriate de l'art 203 n'eût été composée que des
dix centuries de la tribu Mcia.
Essayons de déterminer, pour les diverses époques de
l'histoire, le cens des ærarii et le nombre des sous-classes où ils étaient
répartis.
Le dictateur Mamercus Æmilius avait fait passer une loi
qui réduisait la durée de la censure de cinq ans à dix-huit mois. Pour s'en
venger, les censeurs de l'an 432 av. J.-C. le rangèrent en dehors des cinq
classes et en firent un[49] rarius à cens octuple.
Le chiffre inférieur du cens (le la cinquième classe, limite
supérieure de celui des ærarii, était
alors de 12.500 as[50], et cette somme
était la huitième partie des 100.000 as, qui formaient le cens de la première
classe. Les censeurs, en infligeant à Æmilius une dégradation politique, ne
voulaient pas y attacher un dégrèvement d'impôt. Ils le mirent donc au nombre
des ærarii comme votant, en le
maintenant dans la première classe comme contribuable.
Dans ces temps anciens, les ærarii
ne formaient qu'une seule sous-classe, et même, selon Tite-Live, une seule
centurie[51].
Il est vrai que cette centurie était aussi nombreuse que toute la première
classe[52], ou même, si
l'on en croit Denys[53], que tout le
reste du peuple. Mais lorsque la fortune privée eut augmenté, et que le cens
de chaque classe se fut élevé, il se forma trois sous-classes d'ærarii.
Festus[54] dit que l'on
désignait par le nom de sous-classe (infra classem) les citoyens dont le cens
était moindre que la somme de 120.000 as. Cette indication doit se rapporter
à l'époque de la loi Voconienne[55] (168 av. J.-C.). Car c'est dans un discours
de Caton en faveur de cette loi qu'Aulu-Gelle trouve les mots classici et infra
classem dont le sens précis était devenu une question obscure pour
les grammairiens de son temps[56]. Il nous apprend
que le premier de ces mois désignait les citoyens qui avaient au moins 125.000
as de cens, et les deux derniers, ceux dont la fortune était moindre. Mais,
trompé par les chiffres du cens de Servius, Aulu-Gelle a cru que 125.000 as
représentaient la fortune des citoyens de la première classe, et que
l'expression infra classem
s'appliquait à tous ceux des classes suivantes. Cette interprétation ne peut se
concilier avec les dispositions de la loi Voconia. Les citoyens nommés
censi étaient seuls soumis à cette loi[57] ; et Asconius[58] nous apprend que
l'on appelait de ce nom ceux qui avaient au moins 100.000 sesterces,
c'est-à-dire 250.000 as de cens. Si, au temps oit la loi Voconia fut
faite (168 av. J.-C.), 125.000 as
eussent formé le cens de la première classe, la loi n'eût été applicable,
pour ainsi dire, à personne.
Aulu-Gelle s'est donc trompé[59]. Classici a la signification naturelle de
citoyens des cinq classes, et les infra classera sont ceux qui sont placés en
sous-classe, c'est-à-dire les ærarii.
125.000 as étaient, en 168 av. J.-C., la limite inférieure du cens, non de la
première, mais de la cinquième classe. C'était le chiffre du temps de Servius
(12.500 as) multiplié par dix, comme le
fut le prix de l'equus publicus[60], comme le furent
toutes les valeurs nominales entre la première et la seconde guerre punique[61].
S'il en est ainsi, le cens des sous-classes d'ærarii a dû être défini, au temps des guerres
puniques, par des chiffres un peu inférieurs à celui de 125.000 as. C'est en
effet ce que nous trouvons dans les auteurs anciens.
Tite-Live[62] raconte qu'en
l'an 214 av. J.-C., l'État n'ayant pas de quoi payer et nourrir des matelots,
s'adressa aux particuliers, qui les procurèrent et fournirent à leur
entretien. Les ærarii durent, selon
l'usage[63],
payer leur part de ce tribut. La manière dont il fut réparti ne permet pas de
supposer qu'ils en aient été exemptés. Car les fortunes des riches furent
plus ménagées que les fortunes moyennes. Un citoyen qui avait cinquante mille
as et fournissait un matelot, donnait beaucoup plus à l'État,
proportionnellement, que le citoyen riche d'un million d'as qui n'en
fournissait que sept.
Or, sur les registres des censeurs de l'an 220 av. J.-C.,
qui servirent de base à la répartition, le cens le moins élevé de ceux qui
étaient sujets à la contribution, était de cinquante mille as. C'était donc
celui de la dernière sous-classe des ærarii[64].
Les mêmes censeurs de l'an 220 av. J.-C., Æmilius et
Flaminius, avaient réuni, dans les quatre tribus urbaines, tous les
affranchis. Ils avaient fait quelques exceptions, dont l'une en faveur des
affranchis qui auraient au moins pour trente mille sesterces ou
soixante-quinze mille as de propriétés rurales. Ils leur permirent de se
faire inscrire dans les tribus rustiques[65]. Il y avait donc
une seconde sous-classe composée de ceux qui avaient au moins 75.000 as de
cens, et les affranchis riches y étaient inscrits. Enfin, Polybe[66] nous parle de
légionnaires ayant dix mille drachmes ou cent mille as[67] de cens et qui,
dans le rang des hastats, se distinguaient des légionnaires plus pauvres par
une cotte de mailles complète.
A l'époque des dernières guerres puniques, lorsque 125.000
as composaient la moindre fortune d'un citoyen de la cinquième classe, il y
avait donc trois sous-classes d'ærarii
dont le cens inférieur était fixé à 50.000, 75.000 et 100.000 as de deux
onces.
M. Mommsen[68] le premier, a
indiqué l'existence de trois sous-classes. Il a prouvé que les centurions
civils des classes de Servius, qui conduisaient les centuries au
Champ-de-Mars[69]
les jours de vote, passèrent dans la constitution réformée vers l'an 240, sous
le nom de curatores tribuum[70]. Alors la
centurie devint une partie de la tribu[71]. Chaque tribu se
partagea en cinq classes, et chaque classe en deux centuries : une pour les juniores, une pour les seniores. Il y eut donc dix centuries et dix
centurions civils ou curateurs dans les classes de chaque tribu, après l'an 240 a.v. J.-C. Mais si, au
temps des guerres puniques, il s'était formé dans chacune des trente-cinq
tribus trois sous-classes d'ærarii,
qui devaient leur contingent à l'armée comme leur tribut au trésor, elles ont
dû être divisées, pour la répartition du contingent et du tribut[72], en six
centuries qui ne votaient pas dans l'assemblée centuriate. Une tribu a dû
compter en tout seize centuries et seize curateurs ou centurions civils, huit
pour chacun des deux âges.
C'est précisément ce que nous révèlent les monuments
épigraphiques. M. Mommsen cite[73] deux
inscriptions trouvées en 1547, dans le Forum, au pied de l'arc de Sévère[74]. Dans l'une,
nous lisons les noms de huit curateurs de la demi-tribu Suburana ou Sucusana
juniorum. Cinq des noms sont sur une face du monument ; ce sont
ceux des curateurs des cinq classes de la demi-tribu. Trois sont sur une
autre face ; ce sont ceux des curateurs des trois sous-classes dont la
seconde a pour curateur un affranchi.
La seconde inscription donne les noms de huit magistrats
de la même demi-tribu, Suburana juniorum,
accompagnés du signe 7 qui représente
le cep de vigne, symbole du pouvoir du centurion romain. Ce sont les noms des
huit curateurs ou centurions civils d'une autre année.
Ainsi, les ærarii
étaient des citoyens rangés en dehors des cinq classes de l'assemblée
centuriate. Lorsque le cens de la cinquième classe était au moins de 12.500
as d'une livre de cuivre, ils formaient une seule[75] sous-classe,
dont le cens était inférieur à cette somme. Mais, au temps de la seconde
guerre punique, lorsque le cens de la cinquième classe se trouva décuplé
comme toutes les valeurs nominales, et porté à 125.000 as de deux onces, les ærarii étaient déjà répartis dans trois
sous-classes (infra
classem), dont le cens était de 50.000, de 75.000 et de 100.000
as. Le chevalier equo publico qui,
dans la revue quinquennale, était privé du cheval donné par l'État, et mis au
nombre des ærarii ou crites[76], n'était pas pour
cela privé du droit de suffrage. Un censeur qui eût ôté à un citoyen la
faculté de voter dans l'une des trente-cinq tribus, eût commis un attentat
contre la liberté et une usurpation sur le peuple romain, seul investi du
pouvoir d'exclure un citoyen de la cité.
Le chevalier devenu rarius
était seulement privé des droits qu'on exerçait dans l'assemblée centuriate[77]. Il était
inscrit dans l'une des trois sous-classes d'une tribu, et dans l'assemblée
des tribus il conservait son suffrage. Mais, pour annuler en fait ce droit
politique qu'en principe il ne pouvait détruire, le censeur inscrivait
souvent celui dont il faisait un rarius
dans l'une des dix-sept dernières tribus, qui étaient moins souvent appelées
à voter, parce que la majorité pouvait être formée avant que leur tour fût
venu[78].
On comprend par là le sens politique de cette double
punition si souvent infligée aux chevaliers par les censeurs : rarios fecerunt, tribuque moverunt[79]. Par la première
de ces mesures, ils les excluaient des cinq classes de l'assemblée centuriate
; par la seconde, ils réduisaient à une sorte de faculté abstraite leur droit
de voter dans l'assemblée des tribus, qui était inséparable de la qualité de
citoyen[80].
Les chevaliers equo publico
des dix-huit centuries figuraient à la fête du 15 juillet, rangés dans les
mêmes cadres et sous les mêmes noms. Ils étaient exposés, dans la revue
quinquennale, aux mêmes sévérités de la part des censeurs. Ces deux
cérémonies effaçaient peu à peu les différences qui séparaient à l'origine
les six premières des douze dernières centuries équestres.
§ II. HISTOIRE MILITAIRE PARTICULILRE AUX SIX
CENTURIES SÉNATORIALES EQUO PUBLICO, DE 400 A 123 AV. J -C. DIFFÉRENCES QUI
DISTINCUAIENT ENCORE LES SIX CENTURIES DES DOUZE DERNIÈRES CENTURIES ÉQUESTRES,
AU SIÈCLE DES GUERRES PUNIQUES. L'ANNEAU D'OR.
Malgré la tendance des dix-huit centuries à se rapprocher
sous une loi commune dans la revue quinquennale, et à se confondre dans les
six turmæ de la fête des ides de
juillet, les six centuries sénatoriales étaient encore très-distinctes des
douze autres, de 400 à 123 av. J.-C.
La corrélation[81] qui existait dès
l'origine entre le Sénat des trois cents, les trente curies, et les six
centuries des Rhamnes, des Tities et des Luceres,
se maintint plus longtemps que les privilèges des patriciens. Lorsque la loi
de Licinius Stolon, 366 av. J.-C., eut rendu le consulat accessible aux plébéiens,
et que la loi Ovinia[82] eut déterminé
l'ordre dans lequel les anciens magistrats seraient inscrits sur la liste des
sénateurs, les plébéiens anoblis par les magistratures curules[83], prirent peu à
peu dans les cadres immobiles de la constitution une partie des places
autrefois réservées au seul patriciat.
Les anciens consuls, préteurs, édiles, que la loi appelait
à composer l'assemblée du Sénat[84], furent admis en
même temps dans les centuries consacrées de la chevalerie. Les six centuries
des Rhamnes, des Tities et des Luceres
représentaient, comme le Sénat, les trente curies dont les sénateurs étaient
les chefs. En s'ouvrant aux nobles plébéiens, elles restèrent donc, comme
elles l'étaient à l'origine, les centuries sénatoriales. Pour s'en
convaincre, il suffit de remarquer la ressemblance des expressions par
lesquelles Cicéron désigne les six suffrages et les centuries équestres où
votaient les sénateurs[85]. Cette
ressemblance des mots est le signe de l'identité des pensées dans deux
passages assez rapprochés des livres sur la République.
Depuis l'an 400 av. J.-C., les six centuries n'étant plus
obligées de servir en corps dans les légions, les chevaliers qui en étaient
membres prirent l'habitude de conserver, après leurs dix ans de service le
cheval que l'Etat leur avait donné (equum publicum). Même en devenant
sénateurs ils ne cessaient pas d'être chevaliers equo
publico.
En 184 av. J.-C., Caton le Censeur[86], passant la
revue de la chevalerie, privait de son cheval Scipion l'Asiatique, qui avait
été consul six ans auparavant. En l'an 204 av. J.-C., les deux censeurs, M.
Livius Salinator et C. Claudius Néron se trouvaient tous deux chevaliers equo publico[87]. Valère Maxime,
qui a vécu dans un temps où les centuries équestres ne contenaient plus que
des jeunes gens, cherche à expliquer ce fait en supposant que les deux
censeurs étaient dans l'âge de la force[88]. Il est vrai que
les chevaliers sénateurs ne se contentaient pas de former une chevalerie
purement honoraire. Souvent ils accompagnaient comme volontaires les légions
qui faisaient campagne ; et Tite-Live compte parmi les morts de la bataille
de Cannes[89]
vingt-et-un tribuns militaires dont quelques-uns avaient été consuls,
préteurs ou édiles, et de plus quatre-vingts sénateurs ou anciens magistrats
honorés de charges curules, qui étaient partis volontairement.
Mais les sénateurs avaient aussi une raison politique pour
conserver le cheval payé par l'Etat : c'est qu'ils conservaient en même temps
leur droit de vote et leur influence dans les six centuries équestres. C'est
cet avantage politique que Scipion Emilien[90] regrettait de
voir compromis par le désir imprudent de quelques sénateurs, qui demandaient
un plébiscite pour leur ordonner de rendre aux censeurs les chevaux que
l'Etat leur avait confiés. Le droit de garder ces chevaux était devenu pour
les sénateurs un honneur coûteux. Outre que le chevalier equo publico n'était pas soldé, il était
moralement obligé à faire, de temps en temps, une campagne. Les subventions
de l'æs equestre et de l'æs hordearium, qui n'avaient pas varié depuis
la seconde guerre punique, devaient être insuffisantes, en 129 av. J.-C.,
pour l'achat et pour l'entretien d'un cheval[91]. Des sénateurs,
probablement ceux du parti de Metellus et de P. Mucius, rivaux de Scipion
Emilien[92],
demandaient la faveur de ne plus faire partie des six centuries équestres, et
ils sacrifiaient ainsi l'intérêt politique du Sénat à un intérêt pécuniaire (largitionem quærunt).
Mais, jusqu'à la mort de Scipion Émilien, les sénateurs, en conservant le
cheval donné par l'État, s'étaient réservé le droit de vote clans les six
centuries et le moyen de diriger les suffrages des jeunes chevaliers qui les
composaient. Ces jeunes gens étaient eux-mêmes, le plus souvent, des fils de
sénateurs, et Tite-Live nous en montre plusieurs dans le cortége des
questeurs et des tribuns militaires que fournissait l'ordre équestre,
c'est-à-dire le corps des dix-huit centuries[93]. On distinguait
ces fils de sénateurs, aussi lien que leurs pères, par la qualification d'equites illustres[94], tandis que les
chevaliers equo publico des douze
dernières centuries étaient plutôt désignés par le nom d'equites splendidi[95] ; car le mot
latin splendor s'applique plutôt à
l'éclat de la fortune qu'a l'illustration de la race[96].
La composition des six centuries nous fait comprendre un
mot que Tite-Live prêle à Persée, vainqueur, en l'an 171 av. J.-C., dans un
combat de cavalerie[97] : Vous avez vaincu, dit le roi de Macédoine à ses soldats,
la partie la plus forte de l'armée ennemie, cette
cavalerie romaine qui se prétendait invincible. Les chevaliers sont en effet
le corps où se recrute le Sénat. C'est là qu'on va chercher, après les avoir
mis au nombre des sénateurs, les généraux et les consuls.
Ce langage est d'autant plus étonnant que Tite-Live, dans
l'ordre de bataille qu'il nous décrit[98], ne nous montre
en ligne, du côté des Romains, que la cavalerie italienne à droite, la
cavalerie grecque à gauche, et au centre, l'élite de la cavalerie
extraordinaire, c'est-à-dire la cohorte prétorienne, formée d'un tiers de la
cavalerie des alliés[99] latins.
Comment Persée peut-il se vanter d'avoir vaincu cette
chevalerie romaine qui était la pépinière du Sénat, s'il n'a eu affaire qu'à
des cavaliers grecs et latins ? Mais Tite-Live, ici, ne nous a pas tout dit.
Il nous a dissimulé, dans la description du combat, des détails fâcheux pour
le patriotisme romain. Il nous montre le roi Persée se portant sur le centre
de l'armée romaine, et y rencontrant la cavalerie grecque que Tite-Live
lui-même a placée à l'aile gauche. Persée a dû rencontrer au centre ceux qui
s'y trouvaient, c'est-à-dire l'élite de la cavalerie extraordinaire. Quel
sentiment a pu porter Tite-Live à nous cacher la défaite de ce corps de
l'armée des alliés ?
Polybe, dans la description du camp romain[100], nous dit que
des deux côtés du prétoire, et sur une ligne perpendiculaire à celles des
tentes des tribuns, campaient l'élite de la cavalerie extraordinaire et quelques-uns de ceux qui servent volontairement pour faire
plaisir aux consuls. Ces derniers étaient précisément les
chevaliers illustres des six
centuries, les fils de sénateurs qui s'attachaient aux chefs de guerre en
qualité de compagnons ou de contubernales[101]. Campés avec
l'élite de la cavalerie extraordinaire, ils devaient se placer sur le champ
de bataille à côté d'elle, et former au milieu de cette garde prétorienne,
une sorte d'état-major autour du chef de guerre. Persée, en attaquant le
centre de l'armée romaine, a certainement eu à combattre non des Grecs, mais
ces brillants chevaliers qu'il se vanta plus tard d'avoir vaincus. Mais il
plaisait à l'orgueil des Romains d'oublier dans leur histoire cette déroute
de leur jeune noblesse, et de faire tomber sur des Grecs la charge
victorieuse du roi de Macédoine.
La pépinière du Sénat, ce n'était donc pas toute la
chevalerie, mais le corps des six centuries equo
publico où les fils des sénateurs étaient inscrits avec leurs
pères, en attendant que, nommés édiles, ils vinssent s'asseoir auprès d'eux
sur les bancs de la curie. Ces jeunes nobles des six centuries, après avoir
porté dans leur enfance la bulle d'or, distinguaient, comme leurs pères, des
autres chevaliers equo publico, par
l'insigne de l'anneau d'or.
LA BULLE D'OR.
Plutarque[102] fait remonter
jusqu'à Romulus l'usage de la bulle d'or que les enfants de la noblesse
portaient suspendue à leur cou. Le premier roi de Rome aurait accordé cette
distinction aux fils des Sabines, qui, selon une tradition recueillie par
Plutarque et par Tite-Live[103], donnèrent
leurs noms aux trente curies. Les trois cents sénateurs ayant été dés le
temps des rois les chefs des curies, cette tradition n'a qu'un sens, c'est
que la bulle d'or était l'ornement des fils de famille sénatoriale. Macrobe[104] rapporte à
Tarquin l'Ancien l'établissement de l'usage de la bulle d'or. Mais le roi
étrusque en aurait réservé le privilège aux enfants de ceux qui auraient
exercé les magistratures curules. Il est inutile (le chercher une chronologie
dans l'histoire de l'époque des rois et de relever l'anachronisme contenu
dans la mention des charges curules sous le règne de Tarquin. Au temps où
certaines magistratures furent distinguées des autres sous ce nom, c'est-à-dire
après le partage du consulat et la loi d'Ovinius, ceux qui les avaient
exercées entraient de droit au Sénat. La tradition rapportée par Macrobe
signifie donc comme la première, que la bulle d'or appartenait aux fils des
sénateurs. En effet, Tite-Live en parle[105] comme d'une
distinction qui leur était encore réservée au temps de la seconde guerre
punique. Mais les progrès de la richesse privée et surtout ceux de la vanité
en eurent bientôt rendu l'usage commun à tous les enfants de famille équestre[106]. Pour les
écrivains de la fin de la République, la bulle d'or mise au cou d'un
enfant était le signe que son père possédait une assez grande fortune[107] ; enfin au
temps de l'Empire[108], tous les
enfants de race libre la portaient.
L'ANNEAU D'OR.
L'histoire de l'anneau d'or ressemble à celle, de la
bulle. C'était d'abord une marque de distinction réservée aux sénateurs et
aux personnes de leurs familles ; et, à l'époque dont nous nous occupons,
entre 400 et 123 av. J.-C., il n'était porté dans la chevalerie que par les
membres des six centuries sénatoriales equo
publico. Plus tard, le goût de l'ostentation en répandit l'usage,
et, au temps de l'empire, lorsqu'on voulut en faire le signe distinctif de la
qualité de chevalier, tout le monde le prit, et il ne distingua plus personne[109].
En l'an 210 av. J.-C., la République
n'ayant pas de quoi armer une flotte, le consul Levinus vint proposer au
Sénat de donner l'exemple du désintéressement[110] : Il faut, dit-il, que nous
tous sénateurs nous allions demain porter au Trésor public ce que nous avons d'or,
d'argent et de cuivre monnayé. En or, chacun pourra conserver son anneau,
celui de sa femme et de ses enfants, et la bulle de son fils. Ceux qui
ont une femme ou des filles, garderont de plus une once d'or pour chacune
d'elles. En argent, ceux qui ont siégé sur la chaise curule, conserveront les
ornements de leur cheval (les phalères), et une livre d'argenterie, afin qu'ils puissent avoir la
salière et le plat nécessaires pour faire les offrandes aux dieux. Les autres
sénateurs[111] conserveront seulement la livre d'argenterie. En cuivre,
chaque famille gardera cinq mille as.
Pendant la seconde guerre punique, l'anneau d'or était
donc porté par tous les sénateurs et par les personnes de leur famille ; les
sénateurs, qui avaient exercé les charges curules, et qui conservaient le
cheval donné par l'État, se distinguaient des autres chevaliers par les
phalères d'argent qui ornaient la tête de leur cheval. Sur le champ de
bataille de Cannes, où il périt une centaine de sénateurs, Annibal ne trouva
d'argent que dans les plaques dont ces ornements se composaient[112].
Les écrivains anciens s'accordent à dire qu'entre les
années 400 et 123 av. J.-C., l'anneau d'or était le signe distinctif de la
noblesse. Or, depuis le partage du consulat (366
ans av. J.-C.), et depuis la loi d'Ovinius, qui doit être du même
temps[113],
le mot latin nobilitas ne désigne plus
seulement le patriciat, mais toutes les familles patriciennes ou plébéiennes
dont les chefs avaient exercé les charges curules[114], et, par
conséquent, obtenu une place au Sénat. L'anneau d'or appartenait donc aux
sénateurs et à leurs fils, et l'usage n'en était pas encore permis aux autres
familles. Lorsqu'en l'année 304 av. J.-C., le scribe Flavius fut élevé à,
l'édilité curule, les nobles s'indignèrent d'être obligés d'admettre un tel
homme dans leurs rangs. Presque toute la noblesse,
dit Tite-Live, déposa les anneaux d'or et les
phalères[115]. Pline,
rapportant le même fait, est encore plus explicite[116] ; il dit
qu'après l'élection de Flavius, ce furent les sénateurs qui déposèrent leurs
anneaux d'or, non pas tous les sénateurs, mais ceux-là seuls qui étaient
nobles, c'est-à-dire ceux qui avaient exercé les magistratures curules[117]. On se trompe, ajoute-t-il, en
supposant que l'ordre équestre s'associa à cette démonstration, parce que les
Annales portent que les phalènes furent aussi déposées.
L'anneau d'or n'était donc pas plus que les phalères
d'argent une distinction commune à tout l'ordre équestre. Comme il n'était
porté que par la noblesse sénatoriale, il n'a dû servir d'insigne, dans la
chevalerie, qu'aux membres des six premières centuries, composées des
sénateurs et de leurs fils. Lorsque Auguste,
dit encore Pline[118], organisait les décuries de juges, la plus grande partie
des juges portait l'anneau de fer, et on les nommait juges et non chevaliers
; le nom de chevaliers ne se conservait que dans les escadrons qui avaient
les chevaux donnés par l'État (in turmis equorum publicorum). Bien
plus, avant l'an 23 ap. J.-C., la vanité de porter l'anneau d'or n'était pas
généralement répandue, parce qu'on reconnaissait dans des personnes qui
portaient l'anneau de fer, des chevaliers aussi bien que des juges[119].
Il est vrai qu'en réservant l'anneau d'or aux six
premières centuries equo publico, on
ne peut guère admettre la tradition qui nous montre Magon versant devant, le
Sénat de Carthage trois mesures de ces anneaux, recueillis sur le champ de
bataille de Cannes[120]. Pline, qui
accepte cette tradition, croit y voir une preuve que l'usage de l'anneau d'or
était général au temps de la seconde guerre punique ; mais, alors, comment
était-il devenu si rare sous le règne d'Auguste ? Ici, Pline se contredit
lui-même, et le fait qu'il rapporte, loin de rien prouver, aurait besoin de
preuve. Florus[121] réduit les
trois mesures d'anneaux à deux, et Tite-Live trouve que le récit où l'on n'en
compte qu'une mesure est plus vraisemblable. Nous pouvons bien imiter les
anciens, et tenir pour exagérée même cette dernière évaluation. Pour remplir
une seule mesure (modius)
ayant une capacité de plus d'un décalitre[122], avec des
dépouilles aussi légères, il eût fallu que les Carthaginois eussent tué les
2.400 chevaliers romains des huit légions qui combattaient à Cannes, et que
tous eussent porté l'anneau d'or. Mais Tite-Live nous dit que cet insigne
n'appartenait qu'aux plus illustres des chevaliers[123], et un grand
nombre d'entre eux échappèrent aux coups des Carthaginois. L'anecdote qui
nous représente les Carthaginois mesurant au décalitre[124] les anneaux des
chevaliers romains dans le vestibule de leur Sénat, a donc toute l'apparence
d'une mise en scène imaginée il plaisir. Tite-Live a pu en tirer un argument
dans le discours qu'il prèle à Magon ; mais on n'en peut tirer aucune
conséquence pour l'histoire réelle.
CONCLUSIONS.
Les six centuries equo publico
étaient donc, au temps des guerres puniques, encore distinctes des douze
dernières. Comme par le passé, elles représentaient les trente curies, et se
composaient de chevaliers de famille sénatoriale. Les sénateurs avaient même
pris l'habitude de conserver le cheval donné par l'État, après la fin de
leurs dix ans de service ; non qu'ils trouvassent aucun avantage matériel à
rester chevaliers equo publico,
puisque cet honneur était déjà dispendieux de 186 à 129 av. J.-C. ; mais ils
gardaient par ce moyen la direction politique des six centuries, appelées
aussi les six suffrages ou les suffrages du Sénat. Les chevaliers-sénateurs,
lorsqu'ils avaient exercé une magistrature curule, ornaient la tète de leur
cheval de plaques d'argent, appelées phalères. Tous les chevaliers des six
centuries, sénateurs ; fils ou parents de sénateurs, se distinguaient de ceux
des douze centuries par la qualification d'illustres.
Ils avaient encore, en 210 av. J.-C., pour insigne particulier l'anneau d'or.
Tous ceux qui dans leur enfance avaient porté la bulle d'or, avaient droit à
l'anneau ; mais ces distinctions sénatoriales furent usurpées d'abord par les
simples chevaliers, puis par les hommes libres, enfin par les affranchis.
§ III. HISTOIRE MILITAIRE PARTICULIÈRE AUX DOUZE
DERNIÈRES CENTURIES EQUO PUBLICO, DE 400 A 123 AV. J.-C.
Les douze cents chevaliers des douze dernières centuries equo publico, depuis l'an 400 av. J.-C.,
servaient individuellement comme attachés à la personne des chefs de guerre.
Choisis par les censeurs parmi les familles équestres les plus riches, ils
étaient désignés souvent par le nom d'equites
splendidi[125] ; mais ils ne
portaient pas l'anneau d'or comme les chevaliers illustres
des six centuries sénatoriales. Ils ne gardaient pas, comme les sénateurs, le
cheval que l'État leur avait confié. Au bout de leurs dix ans de service, ils
le rendaient au censeur[126]. Il n'y aurait
eu pour eux aucun avantage politique qui pût, comme pour les sénateurs,
servir de dédommagement aux frais qu'entraînait le service equo publico. Les plus riches des chevaliers equo privato, les publicains, étaient assez
nombreux pour qu'un corps de douze cents chevaliers pût se recruter
facilement parmi leurs fils sans changer d'esprit politique. Ils tenaient
assez à leur intérêt pour ne pas ambitionner un honneur coûteux, et pour
regarder comme une faveur la dispense de servir dans la chevalerie equo publico[127].
Le procès des censeurs de l'an 169 av. J.-C. va nous faire
voir comment les douze centuries étaient composées, et dans quels rapports
elles se trouvaient placées, soit vis-à-vis des chevaliers equo privato, soit vis-à-vis des six centuries sénatoriales[128]
Dans la revue quinquennale des
chevaliers equo publico, les censeurs C. Claudius et Tib. Sempronius avaient
montré beaucoup de rigueur et de dureté ; ils enlevèrent à beaucoup de
chevaliers le cheval donné par l'État. Ayant offensé par là l'ordre équestre[129], ils rendirent les haines qu'ils inspiraient plus
ardentes par un édit où ils défendirent à quiconque, sous la censure de Q.
Fulvius et d'A. Posturnius, était devenu fermier des impôts ou entre- preneur
de travaux publics, de prendre part aux enchères qu'ils allaient ouvrir, ni
comme sociétaire ni comme intéressé dans une compagnie. Les anciens
publicains réclamèrent, et ils demandèrent en vain au Sénat d'ordonner que
les enchères leur fussent ouvertes. Ils finirent par confier leur cause au
tribun Rutilius, qui proposa de recommencer les adjudications, en admettant
tous les enchérisseurs. Un jour, dans une assemblée bruyante oit cette
question s'agitait, le censeur C. Claudius fit ordonner le silence par le
héraut. Le tribun Rutilius prétendit qu'on l'avait empêché de parler à la
plèbe, et, pour cette au, teinte à son inviolabilité, il intenta à C.
Claudius une accusation capitale. Un autre prétexte servit à faire
comparaître aussi l'autre censeur devant l'assemblée centuriate. Claudius fut appelé le premier à se défendre, et déjà, sur
les douze centuries de chevaliers, huit avaient condamné le censeur, et
avaient été imitées par beaucoup d'autres centuries de la première classe,
lorsque, tout d'un coup, les plus nobles citoyens[130], en présence du peuple, déposèrent leurs anneaux d'or, et
prirent le deuil, pour solliciter en suppliants l'indulgence de la plèbe.
On peut se demander pourquoi Tite-Live n'a parlé ici que de douze centuries
équestres. Les six premières centuries avaient-elles donc été abolies ou ne
votaient-elles pas avec la première classe ?
Les six centuries existaient en 169 av. J.-C., puisque
Tite-Live en parle comme d'une institution qui durait encore de son temps[131]. Les dix-huit
centuries ont toutes et toujours fait partie de la première classe de
citoyens[132]
; mais l'historien aurait cru superflu d'écrire que les six centuries
sénatoriales avaient absous le censeur. Claudius ; puisqu'il nous montre les
nobles dont elles étaient formées, ou dont l'influence y dominait ; déposant
leurs anneaux d'or, prenant le deuil, et descendant aux supplications pour
sauver l'accusé. Une telle démarche, faite par les chefs des six suffrages ou
des suffrages du Sénat, indiquait assez le sens de leurs votes pour qu'il fût
inutile de l'expliquer à un Romain. Les six suffrages furent au nombre des
centuries de la première classe qui votèrent pour Claudius, et dont Tite-Live
ne parle pas. La pensée de l'auteur était de montrer de combien peu il s'en
fallût que le censeur ne fût condamné[133]. Il ne s'est
donc occupé dans ce passage que des centuries qui avaient voté contre
Claudius.
Huit des douze dernières centuries équestres prononcèrent
la sentence d'exil contre le protégé du Sénat. Il est donc fort probable que
la sévérité des censeurs de l'an 169 av. J.-C. s'était exercée sur des
chevaliers de ces centuries, et qu'elle avait épargné les chevaliers qui
portaient l'anneau d'or. Les membres des douze centuries portaient l'anneau
de fer comme les chevaliers equo privato
parmi lesquels ils étaient le plus souvent choisis. Les publicains, qui
formèrent plus tard l'ordre judiciaire, portaient aussi l'anneau de fer ; ils
étaient chevaliers equo privato[134]. Blessés dans
leur orgueil de corps, les membres des douze centuries associaient leur
vengeance politique à celle des publicains, blessés dans leurs intérêts. Les
griefs des mis contre les censeurs irritaient les autres, et ils se
montraient également animés d'un esprit d'opposition contre le Sénat. Si les
fils des sénateurs étaient rangés à côté de leurs pères dans les six
premières centuries équestres, les fils des publicains devaient tenir une
grande place dans les douze dernières.
C'est ce qui explique l'antagonisme politique qui séparait
les deux moitiés de la chevalerie equo publico,
et l'injuste sévérité que le Sénat, les censeurs, les chefs militaires
déployaient contre les chevaliers des douze centuries, tandis que leur
indulgence pour les fils des sénateurs allait jusqu'au scandale.
Après la bataille de Cannes, quatre mille fantassins et
deux cents cavaliers[135] s'étaient
sauvés du grand camp à Canouse. Là se trouvaient quatre tribuns militaires, Fabius
Maximus, Publicius Bibulus, P. Cornélius Scipion, qui fut plus tard le
vainqueur d'Annibal, et Appius Claudius Pulcher, avec plusieurs fils de
consulaires. Quelques-uns de ces nobles, à l'instigation de L. Cæcilius
Metellus, formèrent un complot pour abandonner l'Italie ; ce fut le jeune
Scipion qui les arrêta. Tons les chevaliers equo
publico qui avaient pris part à la déroute ou à la conspiration de
Metellus, furent privés du cheval donné par l'État, mis au nombre des ærarii et chassés de leur tribu[136]. C'étaient là
des punitions légères : mais pour ceux d'entre eux qui n'étaient ni sénateurs
ni fils de sénateurs[137], on en trouva
de plus rigoureuses ils furent transportés en Sicile avec les fantassins qui
avaient échappé au désastre de Cannes[138]. Un sénatus-consulte
les obligea à servir à pied, et plus tard, en 210 av. J.-C., les nouveaux
censeurs qui durent inscrire ces chevaliers sur les rôles de la cavalerie,
effacèrent les années de service qu'ils avaient faites avec les chevaux payés
par l'État, et les obligèrent à recommencer leurs dix campagnes avec des chevaux
achetés à leurs frais (equis privatis[139]). Ces chevaliers, qui n'étaient pas nobles,
furent privés de congés et de décorations militaires[140], enfin relégués
pour tout le temps de la guerre à Lilybée, loin des champs de bataille, où
ils auraient pu réparer leur honneur[141].
Mais les sénateurs et fils de sénateurs, les chevaliers
illustres qui portaient l'anneau d'or et appartenaient aux six centuries
sénatoriales, quoiqu'ils eussent commis les mêmes fautes, échappèrent à tant
de rigueurs. Ils en furent quittes pour voir leurs noms inscrits sur les
registres du cens dans des catégories peu honorables ; mais cette note sans
force[142],
cette dégradation purement nominale, ne les empêcha pas d'arriver aux
honneurs. Le consul Varron reçut les félicitations du Sénat pour n'avoir pas
désespéré de la
République, et il fut envoyé comme proconsul dans le
Picenum. O. Fabius Maximus, le fils du Temporiseur, un des tribuns militaires
qui s'étaient sauvés de Cannes, fut nommé consul en l'an 213 av. J.-C. ; P.
Scipion alla remplacer en Espagne son père et son oncle ; et L. Cæcilius
Metellus, l'auteur du complot de Canouse, nommé questeur en L'an 215 et
tribun de la plèbe en 214, cita devant le peuple les censeurs qui l'avaient
privé de son cheval et noté d'infamie[143].
Justement indignées de l'inégalité dont elles étaient
victimes, les légions de Lilybée envoyèrent à M. Marcellus, proconsul dans la Sicile orientale, les
premiers de leurs chevaliers et de leurs centurions pour demander qu'on les mît
au moins en face de l'ennemi[144]. Celui qui
porta la parole était un ancien chevalier des douze centuries équestres ; car
il rappela le sénatus-consulte qui avait forcé les chevaliers equo publico, privés par les censeurs du cheval
donné par l'État, à servir à pied dans les légions de Sicile[145]. Voici le
langage fort naturel que Tite-Live lui prête :
Nous avons entendu dire que ceux
qui ont échappé comme nous au désastre demandent et exercent les honneurs, et
gouvernent des provinces. Est-ce donc, sénateurs, que vous réservez toute
votre indulgence pour vous et pour vos enfants, et que vous nous méprisez
trop pour n'être pas cruels envers nous ?
A cette réclamation si juste, à cette demande si
honorable, le Sénat fit répondre avec une sécheresse orgueilleuse : Qu'il ne voyait aucune raison de confier les intérêts de la République à
ceux qui, sur le champ de bataille de Cannes, avaient abandonné leurs
compagnons d'armes ; que, si le proconsul M. Claudius en jugeait autrement,
il fit ce qu'il croirait conforme à l'intérêt public, mais sous sa responsabilité[146].
On reconnaît à ce langage l'aristocratie insolente et trop
vantée des magistratures curules, composée eu grande partie de plébéiens
anoblis[147],
qui dédaignèrent la plèbe du jour où les patriciens cessèrent de les
mépriser.
De même que la noblesse de Venise, mais avec moins de
succès, elle essaya toujours de fermer son livre d'or et d'empêcher les
hommes nouveaux d'y inscrire leurs noms. A cette race de parvenus
appartenaient les Cæcilius Metellus, qui, fiers de ce que Preneste, leur
patrie, était plus voisine de Rome qu'Arpinum, voulurent barrer le chemin des
honneurs à Marius et à Cicéron.
Dès l'époque de la seconde guerre punique, pour se venger
d'un vers satirique, ils menaçaient le poète Nævius de la bastonnade[148], et ils
faisaient arriver aux magistratures leur fils coupable d'une trahison,
pendant que les quatorze mille légionnaires et chevaliers de Cannes expiaient
cruellement le tort d'avoir survécu à une armée de quatre-vingt mille hommes.
Animée d'un orgueil nobiliaire si partial, l'aristocratie
sénatoriale maintint longtemps encore la ligne de démarcation qui séparait
les six premières centuries équestres des douze dernières, les fils des
sénateurs des fils des publicains, la jeune noblesse que l'anneau d'or
destinait au Sénat, des chevaliers qui, ayant la richesse (spiendorem equestrem)
sans l'illustration, portaient seulement l'anneau de fer.
|