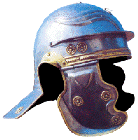HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME I
INTRODUCTION.
|
TROISIÈME ÉPOQUE. 509-493 AVANT JÉSUS-CHRIST. Tarquin-le-Superbe avait été un conquérant. Entre autres territoires ajoutés à celui de Rome, il avait soumis tout le pays de Gabies. Il avait achevé les travaux de ses prédécesseurs, le grand égout et le Capitole. Mais il fatigua de sa tyrannie cruelle l'aristocratie de Rome, dont il employait les clients à faire ses corvées. Le peuple des Quirites huit par chasser des murs de la ville cette famille ambitieuse des Tarquins, et, pour s'assurer le secours de la plèbe de la campagne, les patriciens qui faisaient la révolution, promirent de lui donner des droits politiques. Depuis Servius les Romains des vingt-six pagi n'avaient connu de la cité romaine que les charges et les devoirs. Ils payaient les tributs, ils servaient dans les légions. Mais, après 509, ils furent assimilés aux Romains de la ville. Leurs pagi dont Servius et les Tarquins avaient augmenté le nombre, furent groupés en seize tribus rustiques. Le peuple des curies les convoqua à se réunir avec lui dans une plaine située hors de la ville, pour former une assemblée politique commune. Les centuries votèrent pour la première fois au Champ-de-Mars pour l'élection des consuls. Mais cette concession faite par l'aristocratie urbaine aux paysans romains, était bien illusoire. Les paysans avaient le droit d'élire ; mais les patriciens avaient seuls le droit d'être candidats. La première des six classes, celle où dominait le patricial, comptait à elle seule 99 centuries sur 193, c'est-à-dire deux voix de plus que la majorité ; et chacune des centuries des riches était quatre fois moins nombreuse qu'une des centuries des classes moyennes. C'était un principe tout romain, et que Cicéron recommande aux politiques, d'empêcher la domination du grand nombre. Aussi serait-ce une erreur de croire que la répartition inégale des voix entre les classes fût la seule précaution prise par le patriciat contre le danger de la démocratie. Les votes législatifs ou électoraux des centuries n'avaient rien de définitif. Il fallait que la loi, l'élection à laquelle la plèbe extérieure avait été appelée à concourir dans l'assemblée tenue hors des murs, fût consacrée sur le Comitium, par les trente curies de la ville. Des deux votes nécessaires autrefois pour conférer le pouvoir royal, le premier seul avait été transféré à l'assemblée centuriate. Le consul désigné au Champ-de-Mars, n'avait pas le droit de donner le mot d'ordre aux légions, ni même de monter à cheval, avant d'avoir reçu l'imperium du peuple quiritaire. Or, les membres des trente curies, réunis sous leurs chefs patriciens, se tenaient dans l'enceinte religieuse du Comitium, au bas des degrés de la curie Hostilienne, où délibéraient les trois cents chefs des gentes. Ils attendaient patiemment qu'un augure eût pris les auspices, et qu'un magistrat patricien leur apportât la proposition du Sénat (auctoritatem senotus)[1] sans laquelle, les curies ne pouvaient rien voter. Il eût suffi au Sénat, pour annuler ce qui s'était fait an Champ-de-Mars, de s'abstenir d'en proposer aux curies la confirmation, et, si jamais[2] on ne voit les sénateurs user de leur initiative toute-puissante auprès des curies, pour faire casser une élection ou une loi centuriate, c'est moins par leur modération qu'ils évitaient ce conflit, que par l'art qu'ils mettaient à le prévenir en dirigeant les votes du Champ-de-Mars. Lorsque les centuries étaient assemblées, le magistrat patricien qui les présidait avait seul le droit de mettre une loi aux voix ; souvent il éliminait de son plein pouvoir un candidat, ou faisait recommencer le vote d'une centurie mal inspirée. Dans l'enceinte où se recueillaient les votes (septa ou ovile), étaient appelées d'abord les dix-huit centuries de chevaliers equo publico, qui formaient comme des comices préliminaires et séparés, ceux du peuple noble. On les nommait primo vocatæ centuriæ ; mais cette désignation s'appliquait quelquefois dans un sens restreint aux douze centuries militaires, parce que les six centuries sacrées étaient spécialement appelées prérogatives. Dans la réunion de la chevalerie, ces six centuries composées de fils de sénateurs, étaient consultées les premières, parce qu'il fallait que le premier votant (auctor) de l'assemblée centuriate, aussi bien que de l'assemblée curiate, fût un patricien. Les six centuries de chevaliers portaient les noms des six demi-tribus des Ramnes, des Tities et des Luceres. Elles représentaient le peuple patricien de la ville primitive, divisé en ses trente curies. Le vote de ces six prérogatives était donc pour l'assemblée centuriate, ce qu'était pour l'assemblée curiate, l'initiative du Sénat[3]. Elles votaient comme mandataires des tribus sacrées et des curies, et les augures prenaient les auspices au même titre. C'est pourquoi le vote des six prérogatives, qui suivait immédiatement la cérémonie augurale, était considéré par les Romains comme un signe de la volonté des dieux (omen). Il entraînait presque toujours celui des douze autres centuries équestres. Le vote des dix-huit centuries était annoncé à l'assemblée, et les quatre-vingts centuries îles fantassins de la première classe, qui étaient ensuite appelées par le héraut, refusaient rarement d'y adhérer. A quoi bon choisir d'autres consuls que ceux que le vote des six prérogatives avait désignés à la plèbe de la campagne, comme les candidats préférés du Sénat ? Les sénateurs n'avaient-ils pas le droit, ou de faire annuler une élection qui leur aurait déplu, pour le moindre vice de forme dans la cérémonie augurale, ou de la faire casser par l'assemblée curiate qu'ils dirigeaient ? Les 99 centuries de la première classe ayant voté d'accord, ce qui arrivait presque toujours, la majorité légale était formée, et rarement, nous dit Tite-Live, on consultait la seconde classe. Pour décourager toute tentative d'opposition, le sénat avait encore trouvé un procédé politique plus efficace : au lieu de diriger les votes des plébéiens de la campagne, il s'en passait. Les jours de ceux où les hommes des tribus rustiques se réunissaient à Rome, avaient été déclarés néfastes[4] par les augures patriciens. Cette loi qui dura jusqu'à l'an 286 avant Jésus-Christ, on la justifiait par un beau prétexte : c'est qu'on aurait craint de déranger de leurs affaires, par une convocation politique, les paysans qui venaient vendre leurs denrées au marché. On espérait qu'ils se dérangeraient encore moins de leurs travaux pendant la semaine, et que l'assemblée, oit ils étaient convoqués pour la forme, se tiendrait en l'absence de la plupart d'entre eux. Aussi les plébéiens de la campagne s'abstinrent-ils souvent[5] de venir figurer au Champ-de-Mars, dans des assemblées oit leur concours était jugé si peu nécessaire, et on, pour les quatre cinquièmes d'entre eux, tout était, décidé, avant que leur tour de voter fût venu. Ils laissaient alors les patriciens et leurs clients, c'est-à-dire les hommes de la ville, arranger entre eux comme ils l'entendraient, les élections des consuls. Telle était la constitution, qu'on a souvent représentée comme un progrès de la démocratie dans Rome, et dont on a voulu, bien à tort, faire honneur au roi populaire Servius Tullius. Denys y voit au contraire un stratagème habile pour tromper la plèbe sur sa nullité réelle. Mais les hommes ne s'attachent guère qu'aux droits sérieux. Il est difficile de leur persuader qu'ils ont de la puissance, quand ils n'en ont pas. L'indifférence politique, ou la demande de droits nouveaux, étaient les seules réponses possibles aux promesses mensongères de la constitution aristocratique de 509 avant Jésus-Christ. Cicéron, qui la juge en homme d'état, disait à son frère Quintus, pour lui faire comprendre la nécessité de l'établissement du tribunat de la plèbe : Ou il ne fallait pas chasser les rois, ou il fallait donner à la plèbe une liberté réelle, et non pas nominale[6]. Nous avons essayé de ressaisir le sens de cette révolution de 493 avant Jésus-Christ, d'où sortit le tribunat de la plèbe, d'en retrouver la couleur vraie et vivante, altérée par les retouches peu adroites de la rhétorique de Tite-Live et de Denys d'Halicarnasse. Des fragments du récit primitif qu'ils ont noyés dans leurs développements oratoires, et surtout les indications de Pison, de Salluste et de Cicéron, qui avaient l'avantage (Vôtre des hommes d'état, et plus anciens que Tite-Live et Denys, nous ont permis de donner pour la première fois une description de ce mouvement politique si célèbre et si mal compris, qu'on a appelé improprement la retraite au Mont-Sacré. Il faut écarter d'abord l'idée d'une émigration en masse de la plèbe romaine, quittant ses habitations de la ville et de la campagne, pour aller séjourner sur une montagne inhabitable pour elle, dans l'hiver de 493 à 492 avant Jésus-Christ. Nous montrerons que cette retraite était impossible, qu'elle eût été sans but et sans résultat, et que le tableau qu'un en fait ordinairement, d'après Tite-Live, et surtout d'après Denys d'Halicarnasse, n'est qu'une amplification de rhétorique sur le mot de secessio mal compris. La supposition d'un campement de six ou de dix légions sur une colline qui existe encore, et oit cinq mille personnes auraient peine a se loger, est tout aussi inadmissible. La partie du récit de Tite-Live on il nous décrit ce campement des légions, n'est qu'un tissu de faits imaginaires, et dont le témoignage de l'historien même qui nous les raconte suffit à prouver la fausseté. Le serment militaire qui, selon Tite-Live, retint au drapeau les légionnaires de 493 avant Jésus-Christ, après une campagne victorieuse, ce serment que le Sénat. d'alors aurait fait entrer dans les combinaisons de sa politique, et que les plébéiens auraient cherché à éluder sans v parvenir, n'a été institué qu'en 216 avant Jésus-Christ, la troisième année de la seconde guerre punique ; et c'est Tite-Live qui nous l'apprend. II est beaucoup plus croyable dans cette dernière affirmation, que dans sa narration des événements de 493 avant Jésus-Christ : car nous avons la formule ancienne du serment militaire. Il y est question de monnaies d'argent, et les Romains n'en frappèrent pas avant l'an 969 avant Jésus-Christ. La formule du serment est donc de l'époque des guerres puniques, et tout ce que Tite-Live nous en dit à l'année 493 avant Jésus-Christ, est une fiction. La réalité est bien plus forte, bien plus saisissante que tous les tableaux de fantaisie par lesquels les historiens rhéteurs ont essayé de dramatiser l'histoire. Les .usuriers patriciens, après la bataille du lac Régille, qui les délivrait à jamais des Turquins, essayèrent d'appliquer aux plébéiens de la campagne les mêmes traitements que subissaient avec patience, depuis des siècles, les pauvres clients de la plèbe urbaine. Mais les propriétaires des tribus rustiques n'étaient pas hommes à se soumettre au régime de la prison pour dettes, ni aux coups de lanière du créancier. Quand on eut vu un ancien centurion, un homme d'une grande famille plébéienne, sortir d'un atelier d'esclaves, et montrer sur son corps les meurtrissures des coups de fouet à côté des plus honorables cicatrices un soulèvement éclata. L'indignation des paysans donna du courage aux affranchis de la ville. Les deux plèbes se coalisèrent. La plèbe urbaine tint ses conciliabules au quartier des Esquilies, sur la colline habitée cinquante ans auparavant par Servius Tullius, son libérateur ; la plèbe de la campagne, sur l'Aventin, forteresse des tribus rustiques, située aux portes de Rome. La mauvaise foi du Sénat, et la cruauté du consul Appius Claudius rendirent la révolution inévitable. Les légions plébéiennes se rendirent au Mont-Sacré, non pour y camper, ni pour y séjourner inutilement, mais pour y tracer l'enceinte d'un nouveau marché rival de celui du Forum, pour consacrer à Jupiter Tonnant une citadelle opposée à celle du Capitole. La sécession, si elle eût réussi, eût abouti à la fondation d'une ville plébéienne, qui serait devenue le rendez-vous des tribus rustiques pour le marché des nundines. En même temps les clients de la ville refusaient de cultiver les terres de leurs patrons situées dans le rayon d'un mille autour de Rome, et ils pillaient leurs granges. Le blé n'arrivait plus à Rome, et la cité patricienne, comme le ventre affamé dont parle Menenius Agrippa, n'était plus servie ni par les bras de la campagne, ni même par ceux de la ville. Pour échapper à ce blocus, les plus misérables clients des patriciens, ceux qui sortaient des prisons de leurs créanciers ou craignaient d'y être enfermés, se réfugièrent au Mont-Sacré sous la protection des deux tribuns et de la garde qu'y avaient établie les tribus rustiques. La ville du Mont-Sacré était destinée par ses fondateurs à supplanter Reine, et, comme elle, elle commençait par être un asile. Le nombre des réfugiés, selon Denys d'Halicarnasse, dont le récit est plein d'exagérations, ne s'élevait qu'a quinze ou dix-huit mille. En le réduisant à cinq mille, on le mettrait à peu près d'accord avec la grandeur actuelle de la colline qu'ils occupaient. Là, vécurent sous des tentes de branchages ou de toile, les réfugiés de la ville. La plèbe rustique, leur protectrice, leur apportait à manger, et elle fut personnifiée dans la tradition populaire sous la figure de la fée bienfaisante Anna Perenna, venant tous les matins du village de Bovillæ apporter aux habitants du Mont-Sacré des gâteaux cuits sous la cendre. Lorsque Menenius Agrippa eut fait comprendre à ces malheureux, qu'en s'associant à un plan pour affamer Rome, ils s'affamaient eux-mêmes, ils rentrèrent dans la ville, et élevèrent, dit-on, une statue à Anna Perenna. Tous les ans, à la fête de cette déesse, la plèbe de la ville se répandait dans les prés voisins des bords du Tibre. Elle y coupait de grands roseaux, que l'on plantait en terre, et que, chaque famille recouvrait d'une toge ou de quelques feuillages entrelacés ; l'on prenait un repas sur l'herbe en s'abritant sous ces tentes improvisées, qui rappelaient le séjour d'une partie de l'ancienne plèbe urbaine sur le Mont-Sacré. Les réfugiés ne revinrent avec Menenius qu'après s'être fait donner par les commissaires du Sénat l'assurance qu'ils ne seraient pas poursuivis par leurs créanciers, et, pour mieux assurer l'exécution du traité, ils rentrèrent en armes dans la ville et occupèrent l'Esquilin. La désertion du Mont-Sacré fit sentir aux plébéiens de la campagne la difficulté de créer sur la rive droite de l'Anio, assez loin du Tibre et de la mer, une ville de commerce rivale de Rome. Ils transportèrent leur nouveau marché et le séjour des deux tribuns de la plèbe sur l' Aventin, aux portes mêmes de la ville. Les patriciens, vaincus par la famine et par le ravage de leurs champs, dont on empêchait la culture, finirent par céder. Ils conclurent avec la plèbe rustique, comme avec une puissance étrangère, un traité sanctionné par les féciaux. Le pouvoir des deux tribuns de la plèbe rustique reçut des curies de la ville une homologation qui le fit reconnaître à l'intérieur même de Rome, et, jusqu'à la loi de Publilius Volero, de 470 avant Jésus-Christ, ce fut l'assemblée curiate qui choisit les tribuns parmi les candidats de la plèbe des campagnes. Le tribun était à Rome comme un fondé de pouvoirs d'une puissance étrangère : son inviolabilité était l'application d'une règle du droit des gens. Au Forum, le jour de l'assemblée des tribus, il n'était permis à aucun patricien ni de voter, ni de paraître, ni de troubler les délibérations. Un seul mot prononcé par un des chefs de la population urbaine contre le tribun était un crime de lèse-majesté, ou plutôt un attentat contre l'indépendance des paysans. Le perturbateur pouvait être puni immédiatement par les tribuns, qui avaient le droit de le faire saisir (jus prehensionis) par les édiles, et de le faire sans jugement précipiter de la roche Tarpéienne, comme un agresseur étranger (perduellis). Le tribun pouvait réclamer tout plébéien qu'on voulait mettre en prison, comme n'étant pas sujet à la loi patricienne. Il pouvait annuler tout sénatus-consulte contraire aux intérêts de la plèbe. En un mot, le tribunat n'était pas une simple magistrature. C'était bien plus : une souveraineté. La dictature elle-même, qui suspendait toutes les magistratures du peuple de la ville, ne pouvait suspendre l'action des tribuns. Seulement à dictateur personnifiait en lui la toute-puissance patricienne, comme le tribun, la majesté plébéienne, et, comme le tribun, le dictateur avait le droit de juger et de punir sommairement. C'est à condition de jouir de ces garanties, que les hommes des tribus rustiques rapportèrent leur blé au Forum, et vinrent reconnaître de nouveau le Jupiter Capitolin comme leur dieu national. Ils étaient armés quand ils descendirent de l'Aventin pour monter au Capitole, et bientôt ils firent sentir leur force. Ce qui irritait le plus les patriciens, c'est que les
tribuns s'interposaient même entre eux et leurs clients qui étaient les
plébéiens de la ville. Coriolan, au milieu de la disette qui suivit la grande
lutte de 493 avant Jésus-Christ, conseilla au Sénat de ne distribuer de blé à
la plèbe urbaine, qu'en exigeant d'elle qu'elle renonçât à la protection
tribunitienne. Mais les tribuns ne voulurent pas laisser si vite amoindrir
leur puissance. Ils convoquèrent au Forum les hommes des campagnes et les
plébéiens de la ville. Des cordes tendues sur le marché séparèrent les places
où devaient se réunir les vingt tribus, et Coriolan, menacé d'abord de la
roche Tarpéienne, finit par être exilé. Toutefois la séparation des deux
plèbes demandée par Coriolan était naturelle, et vingt ans après elle
s'accomplit. Les plébéiens des campagnes se lassèrent de voir leurs tribuns
choisis par les clients des patriciens assemblés avec leurs maîtres dans les
trente curies de la ville. En 470 avant Jésus-Christ, Publilius Volero fit
transporter l'élection des tribuns, de l'assemblée curiate à celle des
tribus, où les hommes de la ville n'avaient que quatre voix sur vingt ou
vingt et une. En même temps les clients de la plèbe urbaine tombèrent
au-dessous de la protection tribunitienne. Car, au lieu de deux tribuns, un
pour chacune des deux plèbes, on en nomma, depuis 470 avant Jésus-Christ,
cinq, dont chacun représentait une des cinq premières classes de l'assemblée
centuriate. Les hommes de la sixième classe, qui n'avaient pas une fortune
équivalente à Le souvenir de la révolution de 493 av. J.-C. remplissait
les chefs de la plèbe rustique d'une fierté égale à celle des patriciens de
Rome. Leurs regards se tournaient souvent avec une confiance menaçante vers
la citadelle de l'Aventin qui leur rappelait la conquête de la liberté
plébéienne. Au contraire, l'aristocratie urbaine et ses partisans ne
cessèrent jusqu'au dernier siècle de Une institution qui infligeait aux patriciens de telles
humiliations, ou les réduisait à de telles nécessités, était à leurs veux un
véritable monstre politique qui avait créé à Rome une cité dans la cité, et
fait de Vous voyez très-clairement, Quintus, les vices du tribunat. Mais c'est un procédé injuste, quand on se plaint d'une chose, d'en négliger les bons effets pour énumérer les maux qu'elle a produits, et pour mettre seulement en relief ce qu'elle a de vicieux. Par cette méthode, on pourrait blâmer même le consulat, en dressant la liste des fautes des consuls que je ne veux pas énumérer. Celui qui avait combattu dans Catilina et dans Clodius, non les chefs d'un parti plébéien, mais ceux du vieux parti syllanien, composé de patriciens, de soldats ruinés, de bravi qui remplissaient les corporations[8] urbaines et infestaient le pavé de Rome, savait bien par expérience que la plèbe romaine n'était pas ce ramas de soldatesque et de populace désuvrée, toujours au service et aux gages de l'aristocratie. La plèbe véritable, celle que les tribuns avaient représentée dans l'histoire, était celle des tribus rustiques, celle qui avait ramené Cicéron de l'exil, en fermant, comme il le disait, pour venir au Champ-de-Mars voter en sa faveur, non les échoppes du Palatin et du quartier de Subure, mais les municipes du pays des Volsques et des Sabins. Consulaire, mais homme nouveau sorti de l'obscur municipe d'Arpinum, Cicéron était traité par l'aristocratie des Manlius, des Sylla, des Sulpicius, des Catilina, des Catulus, de roi étranger, de citoyen nomade qui était venu louer une maison dans la ville de Rome, civis inquilinus urbis Romæ. Il comprenait que, pour mettre un frein à l'orgueil de cette noblesse urbaine, il avait fallu le tribunat. D'ailleurs, qu'eût été Rome sans les tribuns ? Si elle a été libérale de son droit de cité, si elle a augmenté le nombre et le territoire de ses tribus rustiques, si elle n'est pas restée emprisonnée dans les limites inflexibles que les augures patriciens lui avaient tracées, si elle ne s'est pas concentrée et desséchée en elle-même comme un germe qui n'a pu éclore ni percer sou enveloppe, c'est au tribunat qu'elle le doit. En introduisant violemment en elle l'élément étranger de la plèbe rustique, cette institution, comme une greffe puissante, a forcé Rome à sortir d'elle-même. Elle a fécondé ; en la corrigeant, son âpre sève aristocratique. Elle a transformé l'oligarchie étroite d'une cité qui, de bonne heure, comme celle de Venise, eût fermé son livre d'or, en une nation de conquérants et de législateurs, toujours renouvelée et agrandie par l'admission aux droits des citoyens de ceux que ses armes avaient vaincus et que ses lois ont civilisés. |