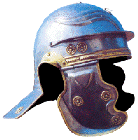HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME I
INTRODUCTION.
|
Malgré les recherches auxquelles se livre tous les jours l'infatigable érudition de l'Allemagne, malgré les travaux d'une critique sérieuse et discrète qui ont paru en France, l'histoire des constitutions politiques de Rome est encore fort loin d'être connue. En Allemagne ; on la croit achevée ou peu s'en faut depuis l'apparition du grand ouvrage de M. Mommsen ; en France, on est plutôt disposé à la croire impossible ; et un travail nouveau sur un tel sujet risque fort de paraître une hypothèse ajoutée à tant d'autres. Ce sont là les deux préjugés que nous essaierons de combattre ; pour éviter le reproche d'avoir fait une uvre inutile ou téméraire, en publiant ce premier volume de l'Histoire des Chevaliers Romains. On ne saurait être assez reconnaissant au zèle scientifique qui anime en Allemagne tant d'hommes profondément versés dans la connaissance des antiquités romaines. On doit convenir que sans le secours des observations critiques accumulées par la patience de MM. Schwegler, Mommsen, Bckh, Peter, Zumpft, Huschke, Becker, Drumann, Marquardt, Rein, Rubino, et de tant d'autres moins célèbres, dont le savoir se cache dans les rangs les plus modestes du professorat au sein des universités ou des lycées de l'Allemagne, il est impossible d'aspirer à aucun progrès dans l'étude de l'histoire de Rome. Un des plus nobles hommages qui aient été rendus à la science allemande, c'est la nécessité reconnue par l'auteur de l'Histoire de Jules César d'emprunter à l'ouvrage de M. Mommsen quelques-uns de ses résultats. Mais quelle que soit l'autorité de l'érudition allemande, elle n'est pas infaillible. Elle peut inspirer le respect sans produire aucune illusion. Nous avons essayé de profiter à la fois de ses découvertes et de ses erreurs. Nous avons cherché à démêler, parmi tant de travaux, les faits bien établis, des hypothèses inutiles et cette recherche nous a conduit à douter que les historiens de Renie se soient, après Niebuhr, approchés plus que lui de la vérité. Depuis Niebuhr, il ne s'est produit aucun système nouveau
qui explique l'ensemble de l'histoire et de la constitution romaines. Ce
grand génie critique avait ouvert une voie aujourd'hui délaissée même des
Allemands, et sa pensée est comme un héritage abandonné qu'il est bien permis
à Quand on lit les travaux des historiens allemands de Rome
qui sont venus après lui, en admirant la variété de leurs connaissances, on
ne peut s'empêcher de remarquer l'inconsistance de leurs idées, et souvent
même, le défaut de logique et d'enchaînement qui se trahit dans les
différentes parties d'un seul ouvrage. S'agit-il de fixer le sens du mol quirites ou curites,
qui désignait les citoyens des trente curies de Rome ? Sur la foi d'une
étymologie plus que suspecte, on le traduit par lanciers
ou porte-lances, et en même temps l'on
reconnaît que les quirites de la
cinquième classe ne portaient pas de lances et que ceux de la sixième
n'avaient aucune sorte d'arme ; ou bien, en rejetant avec raison la fable de
l'enlèvement des Sabines de Cures, on admet pourtant l'immigration des Sabins
à Rome, et l'on suppose que les Romains auraient, on ne sait pourquoi, pris
l'ancien nom des nouveaux venus, et que les habitants de Rome se seraient
entendus pour s'appeler tous habitants de Cures. Sur la grandeur de la ville
de Servius et de Tarquin et sur à nombre de ses citoyens, ou rencontre les
mêmes contradictions. Tantôt elle nous est décrite comme une riche et
puissante cité de commerce et de banque où les rois auraient élevé de
grandioses constructions, où la vie urbaine aurait pris de bonne heure un
développement considérable. Rome est la capitale et le marché de la
confédération des villes latines et volsques. Elle répand ses citoyens en
dehors de son territoire propre jusqu'aux colonies de Signia et de Circeii
à huit et quatorze lieues de ses murs. Tantôt elle n'est plus que le centre
d'un petit district d'onze lieues carrées ; ses patriciens, comme le bon
Laërte, vivent la plupart du temps à la campagne, et ses rois les plus
puissants ne peuvent mettre sur pied que seize mille hommes au plus, en
épuisant Mas les contingents de la ville et du territoire. Ce dernier chiffre
qui est celui de M. Mommsen, a le désavantage d'être en contradiction,
non-seulement avec celui du cens de Servius qui porte quatre-vingt mille
citoyens, mais avec tous ceux des dénombrements du premier siècle de On ne peut disconvenir que le patriciat romain ne fut dès l'origine une aristocratie d'usuriers prêtant à fort gros intérêts sa monnaie ou ses lingots de cuivre. Le capital métallique existait donc à Rome à côté de la richesse foncière. Il y avait même dans la langue romaine un vieux mot raudus ou rudus ; pour désigner le cuivre en barres dont il était tenu compte dans les estimations du cens. MM. Bckh et Mommsen n'en admettent pas moins que la fortune immobilière était seule représentée dans ces estimations jusqu'à l'an 312 avant Jésus-Christ, et ils s'appuient pour le prouver sur deux passages, l'un de Tite-Live[1], l'autre de Diodore[2], où il n'est nullement question de propriété mobilière ou immobilière, mais seulement de la répartition que fit le censeur Appius Claudius des affranchis et des pauvres dans toutes les tribus, jusqu'à ce qu'en 304 avant Jésus-Christ, un autre censeur, Fabius Maximus, les fit rentrer dans les quatre tribus urbaines. Sur cette base peu solide d'une prétendue distinction légale entre les propriétaires et les non-propriétaires, M. Mommsen étaie tout un système compliqué, qui est fort loin d'éclaircir ou de simplifier l'histoire romaine. Depuis Niebuhr on s'était demandé si les patriciens faisaient partie de l'assemblée des tribus ou s'ils en étaient exclus. S'ils en faisaient partie, pourquoi refusèrent-ils jusqu'à la loi du dictateur Hortensius, en 286 avant Jésus-Christ, de se soumettre aux plébiscites ? Celui qui prend part à un vote ne s'engage-t-il pas d'avance à en respecter le résultat ? D'un autre côté, s'ils en étaient exclus, comment se fait-il que l'on trouve le dictateur de l'an 431 avant Jésus-Christ, Mamercus Æmilius, et plus tard le dictateur Camille, inscrits dans les tribus ? et pourquoi les tribus rustiques portent-elles, dès l'origine, les noms des plus grandes familles patriciennes ? M. Mommsen a senti la force de ce dilemme, et pour y échapper il a imaginé deux sortes d'assemblées par tribus avant l'an 312 avant Jésus-Christ : 1° l'assemblée où n'auraient été admis que les propriétaires du sol plébéiens et patriciens, et où l'on n'aurait point fait de plébiscites ; 2° celle où la plèbe se réunissait seule sans les patriciens, et où l'on faisait les plébiscites ; M. Mommsen réserve à cette seconde assemblée, le nom de concilium plebis. Enfin, à partir de 312 avant Jésus-Christ, le censeur Appius Claudius aurait introduit dans la première de ces deux assemblées les citoyens non-propriétaires ce qui aurait formé une troisième sorte de réunion plus complète que les précédentes, appelée, non conseil de la plèbe (concilium plebis), mais peuple (populus), ou comices des tribus (comitia tributa). De ces distinctions entre trois sortes d'assemblées par tribus, on ne découvre pas la moindre trace dans les auteurs anciens. Tite-Live dans un seul passage[3], appelle indifféremment une même assemblée des plébéiens populus, plebs, concio, concilium et comitia, et la première fois que cet historien nous parle des comices des tribus (comitia tributo), c'est pour les identifier avec cette assemblée plébéienne (concilium), d'où il nous dit que les patriciens furent exclus (Tite-Live, II, 60). Afin d'enrichir de quelques détails la révolution qu'il suppose entre 312 et 30i avant Jésus-Christ, M. Mommsen attribue an censeur de 304, Fabius Maximus, une réforme qui appartient aux censeurs L. Æmilius et C. Flaminius, de l'an 220 avant Jésus-Christ[4] et par laquelle les affranchis avant trente mille sesterces de propriétés rurales, furent inscrits dans les tribus rustiques. Sans parler de l'anachronisme de plus de quatre-vingts ans. que M. Mommsen introduit par lit dans l'histoire, n'a1-on pas le droit de s'étonner qu'un savant, qui a si bien établi que les Romains connurent seulement la monnaie de cuivre jusqu'à la guerre de Pyrrhus, ait pu croire que les censeurs de 304 avant Jésus-Christ, estimaient les propriétés en sesterces, c'est-à-dire en monnaie d'argent ?[5] La distinction entre les trois sortes d'assemblées par tribus, fondée sur le principe d'une différence légale entre les propriétaires et les non-propriétaires[6], rentre donc dans le vaste domaine des hypothèses sans preuves et qui n'ont même pas le mérite de la simplicité. La question posée par Niebuhr, reste toujours sans solution : Comment les patriciens, s'ils étaient comptés dans les tribus, refusaient-ils obéissance aux plébiscites ? Peut-on se flatter de milieux connaître, d'après les travaux de l'Allemagne, à constitution des centuries de Servius ? Il faudrait pour cela que M. Mommsen se mit d'accord avec lui-même : mais il nous dit dans sort Histoire Romaine[7] que dans les institutions de Servius, on ne trouve rien qui n'ait trait à l'arrangement des centuries en vue de la guerre, et qu'il serait vraiment absurde d'y aller découvrir l'introduction de la timocratie dans Rome ; et dans ses Recherches Romaines[8], adoptant comme vraie l'opinion qui lui avait paru absurde, il affirme que cette organisation des centuries n'avait dès l'origine fait aucune différence entre les plébéiens et les patriciens, et que le but politique et militaire en était d'effacer cette différence et de fondre ensemble ces deux classes, aussi bien dans l'assemblée des citoyens que dans les rangs de l'armée. La constitution des centuries de Servius avait-elle à l'origine un caractère et un sens politique ? Après des assertions aussi contradictoires, la question reste encore entière. L'organisation de la primitive armée romaine, telle
qu'elle nous est décrite par M. Mommsen, laisse encore dans l'esprit bien des
doutes. Que la légion ancienne ait été composée de huit rangs, dont les quatre
premiers auraient été remplis seulement par les citoyens de la première
classe, c'est une supposition qui nous obligerait à croire que les riches
seuls ont pu composer la moitié de toute la population militaire de Rome. A
cette invraisemblance, s'en joint une autre non moins grave : Exposée sans
cesse aux premiers coups dans des guerres continuelles, la première classe
n'eût pas tardé à disparaître, et c'est elle qui s'est le mieux conservée.
Enfin, cette phalange romaine à huit rangs ne figure dans aucune bataille
connue. et, dès les premières années de Mais un des points les plus importants à éclaircir et
encore aujourd'hui les plus obscurs de la constitution romaine, c'est la
valeur de la fortune des citoyens des cinq classes, aux diverses époques de Nous n'avons pas la prétention de résoudre en peu de mots des problèmes si difficiles : mais les exemples que nous avons choisis, et que nous pourrions multiplier, suffisent pour montrer qu'en présence des conclusions où est arrivée la critique allemande sur l'histoire romaine, la critique française pourrait trouver de fortes raisons pour se renfermer dans un scepticisme presque absolu. Ce ne sont pas des détails qui restent à trouver, des points secondaires qu'il s'agit de fixer, ce sont les grandes ligues de l'histoire romaine qui ne sont pas tracées. Ce qu'on n'a pas encore mis en lumière, c'est la loi qui régit l'ensemble et lui imprime un caractère de puissante unité. L'histoire des chevaliers romains est inséparable de celle
de l'ensemble de la constitution de Rome. Elle y tient par tant de liens
qu'il faut avoir exploré toutes les questions qui s'y rattachent, pour s'en
former une idée juste et en démêler la complexité. Les chevaliers romains ont
porté à l'origine les noms des trois tribus primitives de Rome. Leurs
centuries étaient consacrées par les augures. Leurs escadrons formaient les
ailes de l'infanterie, et s'adaptèrent de bonne heure aux cohortes de la
légion. Comme corps politique, les chevaliers étaient organisés sur le mente
plan que le sénat et les curies, et cependant on retrouvait parmi eux, dès le
règne de Servius Tullius, la grande opposition du patriciat et de la plèbe.
Sous Pour faire l'histoire des chevaliers, il faut donc avoir étudié toute la constitution militaire, politique, religieuse, judiciaire, financière, économique de Rome depuis les rois jusqu'à Dioclétien, et si, malgré des travaux spéciaux très-nombreux et pleins d'érudition, cette histoire n'est pas encore faite, c'est une preuve que les révolutions les plus générales qui ont transformé l'État romain sont encore peu connues. La lecture d'un grand nombre d'ouvrages critiques, qu'il nous a fallu comparer, était la préparation indispensable au travail que nous avions entrepris. Il n'y a peut-être pas dans tout ce volume une seule idée particulière qui ne se trouve déjà autre part ou dans tout son développement on au moins à l'état d'indication. La méthode seule et le choix de l'idée dominante nous appartiennent. MÉTHODE.La méthode est sévère, et elle donne à tout ce livre l'aspect d'un bilan hérissé de chiffres : c'est la méthode arithmétique. Nous ne nous sommes cru en droit de changer ni un chiffre porté dans les écrivains classiques, ni un mot de leur texte. Lorsqu'il y avait incertitude sur la leçon, nous avons eu recours aux textes les plus anciens, débarrassés alitant que possible des hypothèses des commentateurs. Car ou ne corrige guère les anciens qu'à défaut de les comprendre. Sur les questions que nous avons étudiées, nous avons trouvé tous les anciens d'accord, et les contradictions qu'on a prétendu découvrir entre eux ne sont autre chose que les contresens des modernes ajoutés à ceux d'Aulu-Gelle qui disserte sur l'antiquité sans la connaître. Les chiffres donnés par les historiens anciens non-seulement concordent pour la même époque, mais ils sont conséquents entre eux pour deux époques successives. L'histoire des chevaliers romains nous en fournira bien des exemples : Tite-Live nous dit que sous Servius Tullius il y eut 2.400 chevaliers equo publico partagés en deux groupes de chacun 1.200 hommes ; Cicéron ajoute que ce nombre se conservait encore l'année de la mort de Scipion Émilien ; Caton le censeur, à l'époque des grandes guerres d'Orient, se plaignait qu'il n'y eût plus que 2.000 chevaliers equo publico et demandait que le nombre n'en fût dans aucun cas inférieur à 2.200. L'effectif complet du corps restait donc fixé à 2.400. Si l'on prétend corriger ce dernier chiffre dans un de ces trois auteurs, on se met dans la nécessité de le corriger aussi dans les deux autres, et on se prive en meule temps d'un moyen sûr d'arriver à connaître la constitution primitive de Servius. Comme il y avait toujours trois cents cavaliers romains dans chaque légion complète, l'existence d'un corps de 2.400 chevaliers à une époque où Renie ne possédait pas d'autre cavalerie indique certainement l'existence de huit légions. La légion primitive étant de 5.000 hommes, huit légions devaient contenir 40.000 hommes, et c'est précisément le nombre de jeunes gens que nous trouvons marqué dans le cens de Servius. De plus la chevalerie étant alors divisée en deux corps égaux de 1.200 hommes chacun, dont le premier représentait le patricial de la ville, et dont le second contenait les fils des riches plébéiens de la campagne, une division analogue doit se retrouver dans les cadres de l'infanterie. En effet, Denys nous dit que, trente ans après l'expulsion des rois, en 479 av. J.-C., dans une levée générale, la ville seule fournit quatre légions, et la campagne et les colonies en arment alitant. Cette symétrie nous explique encore la division de la ville et du territoire sous le roi Servius. Varron distingue dans les quatre tribus urbaines vingt-six ou vingt-sept districts religieux. Denys compte aussi sous le même roi vingt-six districts religieux dans la campagne. Fabius Pictor les nomme improprement tribus ; mais Denys leur restitue leur vrai nom, celui de Pagi. Il avait donc autant de circonscriptions en dehors qu'en dedans de la ville de Servius, et chacune d'elles fournissant un nombre égal de soldats, on recrutait des deux côtés le même nombre de légions. Si l'on veut modifier par des calculs hypothétiques une seule de ces données, on dérange tout l'ensemble et l'on commet une erreur semblable it celle d'un architecte qui, pour reconstruire un monument en ruines, s'aviserait de changer arbitrairement les intervalles des colonnes dont il verrait encore quelques bases fixées à leur place auprès de leurs fûts renversés. Dans ces rapports numériques que nous établissons, ne
faut-il voir qu'une invention complaisante pour les erreurs des anciens, une
méthode facile pour nous dispenser de la critique épineuse des textes ? Le
lecteur qui voudra bien nous suivre dans les sentiers un peu rudes qui nous
ont conduit à la vérité s'apercevra de lui-même que les discussions de textes
ne nous ont pas plus rebuté que les calculs de l'arithmétique. D'un autre
côté, imputer sans cesse aux Romains des erreurs sur leurs comptes publics,
c'est plus qu'une témérité d'érudition : c'est un oubli entier du génie
propre à cette race. Pour le Romain, le chiffre est sacré. Il y a eu dans la
vieille Rome trois tribus, trente curies, trois cents sénateurs, trois mille
hommes de lourde infanterie par chaque légion. Toutes les institutions
romaines, qui ont la solidité des Pyramides en ont aussi les antes nettes et
anguleuses. Que les généraux romains aient, par orgueil militaire et national, diminué le chiffre de leurs pertes et exagéré celles de leurs ennemis, c'est ce qu'on a toujours fait dans les bulletins datés d'un champ de bataille ; mais que les chefs politiques de ce peuple calculateur qui, depuis Servius jusqu'à Auguste, n'a cessé de dresser des statistiques et des cadastres, qui avait fait de la censure le couronnement de tous les honneurs et mis ses archives sous la garde des tribuns et des édiles, aient sans raison commis des erreurs énormes dans les comptes publics ; ou que ses historiens, qui étaient pour la plupart des hommes d'État, en soient venus au temps de Cicéron à ignorer quel avait été le cens des citoyens de chaque classe, et le nombre des chevaliers et des soldats romains, au moins jusqu'à la première guerre punique, c'est ce que l'autorité meule de M. Bckh n'a jamais pu nous persuader. Eu cherchant bien, on trouve que l'invraisemblable n'est pas non plus vrai. Les historiens anciens étaient naturellement plus instruits que les modernes de leur histoire nationale, et pour longtemps encore il nous faudra sur ce sujet leur demander des leçons, au lieu de prétendre à leur en donner. IDÉE DOMINANTE - SYSTÈME DE NIEBUHR.Toutefois, un seul homme a eu dans ce siècle le privilège réservé au génie de comprendre Rome mieux que les Romains, et de deviner, par une sorte d'intuition, ce qu'elle était à son origine. Niebuhr a vu le premier que la nation romaine s'était formée non de deux ordres, de deux classes de citoyens, mais de deux peuples distincts, le peuple de la ville (populus), composé des races patriciennes et de leurs clients, et le peuple de la campagne (plebs), composé de petits propriétaires des tribus rustiques. Cette dualité, qui est le secret de toute l'histoire de Rome, explique seule la formation du tribunat de la plèbe, sorte de magistrature indépendante de tout le reste de la constitution romaine ; seule, elle peut l'aire comprendre la loi qui, jusqu'en 240 avant Jésus-Christ, interdit aux patriciens d'entrer dans l'assemblée plébéienne des tribus. C'est bien assez pour la gloire de Niebuhr, d'avoir mis en lumière cette grande vérité, qu'il a éclairée de tous côtés par des comparaisons empruntées à l'histoire des républiques du moyen âge et des temps modernes. Il n'a pas eu le loisir de tirer toutes les conséquences de sa découverte, et, après lui, la critique, s'attachant à des points secondaires de son ouvrage, a cru le dépasser en relevant chez lui quelques erreurs de détail, et en renversant quelques-unes de ses hypothèses mal fondées ; niais l'idée vraie et si proton le qui anime tout son système, on l'a négligée, et même dans ces derniers temps l'Allemagne en est venue à le renier. Nous essaierons donc de montrer quel jour nouveau elle jette sur l'histoire entière de Rome. Les tribuns étaient non des magistrats du peuple de la ville de Rome, mais des représentants de la plèbe, c'est-à-dire du peuple extérieur. Dans Rome et jusqu'à un mille de ses murs, ils étaient inviolables, comme envoyés d'un État étranger, lié seulement à l'État romain par un traité que les féciaux avaient garanti. La protection accordée par les tribuns aux plébéiens dans Rome était celle dont les ambassadeurs modernes couvrent. leurs nationaux dans une ville étrangère. La plèbe formée surtout des paysans réunis sur le marché de Rome dans l'assemblée des tribus, n'y admettait aucun patricien ; et, si un magistrat de la ville osait frapper le tribun, l'interrompre pendant qu'il parlait ou faire le moindre acte d'autorité dans cette assemblée, la souveraineté indépendante de la plèbe (majestas) était violée, le pacte de la loi sacrée, le seul qui unissait les hommes de la campagne aux hommes de la ville, était rompu, et, toute communauté civile étant méconnue, leurs rapports n'étaient plus réglés que par le droit des gens. Le violateur de la majesté plébéienne était déclaré par les tribuns ennemi de la plèbe (perduellis), saisi, jeté en prison, ou même précipité sans jugement de la roche Tarpéienne. Ce qu'on a nommé jugement de perduellion était une vraie déclaration de guerre, faite en plein Forum par les dix chefs de la plèbe à un patricien de la ville, et, pour en éviter les effets, il pouvait recourir en grâce à la plèbe elle-même qui, le plus souvent, se contentait de l'exiler. Jusqu'à la fin de la première guerre punique, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où les patriciens entrèrent dans l'assemblée des tribus, et toute la plèbe dans .les curies de la ville, les tribuns n'étaient pas admis au sénat, c'est-à-dire dans l'assemblée des trois cents chefs du peuple quiritaire. Ils restaient, comme étrangers à la ville, dans le vestibule de la curie. Leur admission au nombre des sénateurs est le signe de cette fusion du peuple de la ville et de la plèbe de la campagne, qui eut lieu seulement vers l'an 240 avant Jésus-Christ. Si l'on se figurait la plèbe rustique unie, avant cette époque, avec le peuple de la ville par les liens indissolubles de la nationalité politique, un grand nombre de faits des premiers siècles de la république deviendraient incompréhensibles. Les secessions, qu'on a improprement appelées retraites de la plèbe, ne présentent qu'une série d'invraisemblances ou d'impossibilités, si l'on y veut voir des émigrations périodiques d'un peuple tout entier quittant ses maisons de la ville ou ses maisons des champs, pour aller séjourner inutilement sur une montagne. Pour avoir raison d'une démonstration politique aussi peu sensée, le Sénat n'aurait eu qu'à laisser agir la faim, l'ennui, les privations qui eussent ramené plus sûrement les émigrants à leurs foyers que l'éloquence de Menenius Agrippa. Mais les secessions étaient tout autrement redoutables. C'était la menace du peuple de la campagne de se séparer de la ville, et de transporter le marché des Nundines autre part qu'au Forum. Le mont Sacré, l'Aventin, le Janicule furent successivement désignés pour remplacer Rome comme centre commercial de la région agricole que les plébéiens cultivaient et les patriciens, réduits par une sorte de blocus, durent, pour ramener chez eux les convois de blé et les agriculteurs, garantir les plébéiens contre la violence des usuriers de la ville par un sauf-conduit général et permanent, qui fut la puissance tribunitienne. C'est pour cela que les tribuns de la plèbe se faisaient seconder dans leurs fonctions par les édiles, c'est-à-dire par les inspecteurs du marché. Les secessions furent possibles jusqu'à la réforme de l'an 240 avant Jésus-Christ, qui unit intimement la plèbe et le patricial, la campagne et la ville ; et nous trouvons une dernière sécession de la plèbe au Janicule en 286 avant Jésus-Christ. C'est jusqu'à cette même année de la dictature d'Hortensius que les patriciens refusèrent obéissance aux plébiscites et aux tribuns, parce qu'ils ne votaient pas les uns et n'élisaient pas les autres. Il faut donc croire que jusqu'au milieu du troisième siècle avant Jésus-Christ, il y avait dans l'État romain deux peuples en un, ou plutôt deux zones de populations concentriques. La population de la zone extérieure, c'est-à-dire les plébéiens de la campagne, avaient au milieu de la zone intérieure, au centre de la ville, une enclave oui, les jours d'assemblée ils exerçaient une souveraineté exclusive : c'était le marché ou Forum sur lequel ils venaient, les jours de nundines, vendre les produits de leurs champs. L'union nationale des populations de ces deux zones n'avait rien de définitif tant que chacune d'elles eut ses lois et ses magistrats particuliers, et Rome, jusqu'à la fin de la première guerre punique, fut menacée, par représailles de la cruauté de ses patriciens, d'un véritable schisme des tribus rustiques. Il est vrai que Niebuhr fait cesser la dualité de la plèbe rustique et du peuple de la ville à l'époque de la loi des Douze Tables, c'est-à-dire deux siècles trop tôt, et il a cru que ces deux éléments s'étaient combinés sous l'influence d'une même législation ; niais, quelle que soit la valeur de cet aperçu, en ce qui concerne la vie civile des Romains, il est certain que la dualité politique subsista jusqu'à la grande réforme des assemblées par centuries et par tribus, qui coïncide, comme nous le montrerons, avec la révolution économique et monétaire de la fin de la première guerre punique. Dire que Niebuhr a manqué non de génie ni de prudence, mais de logique et de hardiesse, c'est une assertion qui, au premier abord, peut sembler étrange ; mais nous prions qu'on ne la condamne point d'avance, et qu'on nous attende aux preuves. En nous avouant, si on nous permet cette expression, plus niebuhrien que Niebuhr, nous n'avons point cherché le piquant d'une originalité paradoxale ; nous avons obéi aux nécessités rationnelles qui s'imposent à quiconque vent mettre d'accord toutes les parties d'un système. C'est aux hommes de génie qu'il appartient de trouver en toute science les principes féconds de la vérité ; c'est aux simples chercheurs de fouiller ces mines profondes dont les grands inventeurs d'idées ont ouvert le premier filon. La portée de la découverte de Niebuhr s'étend bien plus
loin qu'il ne l'a cru lui-même, et la distinction marquée entre les hommes de
la ville de Rome et ceux de la campagne est le trait principal de toute
l'histoire de C'est sous la double garantie d'une méthode empruntée aux sciences exactes, et d'une idée empruntée à un grand critique que nous plaçons les résultats de nos recherches. Nous décrirons les révolutions romaines depuis les rois jusque vers le milieu du troisième siècle après Jésus-Christ, en nous attachant à mettre en relief le rôle que les chevaliers y ont joué. Dans ce premier volume, nous nous arrêterons au tribunat des Gracques, parce qu'entre les années 133 et 123 avant Jésus-Christ, commence une ère de discordes violentes, qui fut comme le long et douloureux enfantement de la monarchie. De 753 à 133 avant Jésus-Christ, six époques méritent de fixer l'attention de celui qui étudie les phases de la constitution romaine. 1° Époque des premiers rois. 2° Époque des Tarquins et de Servius Tullius. 3° Époque de 509 à 493 avant Jésus-Christ. 4° Époque de 400 à 366 avant Jésus-Christ. 5° Époque de 6° Époque de la grande réforme de 240 à 220 Jésus-Christ. |