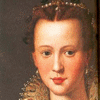|
Marie de Médicis a aimé les uvres d'art plutôt par esprit de
magnificence que par goût d'amateur délicat. Ses commandes. Elle n'a
exercé aucune influence sur les artistes de son temps. Sa passion pour les
joyaux ; ses joailliers préférés ; elle se ruine en achats de diamants ;
parures variées et élégantes qu'elle fait faire. Les uvres d'orfèvrerie
exécutées pour elle ; son orfèvre Nicolas Roger. Relations avec les
architectes. Son principal architecte Salomon de Brosse ; elle le fait
travailler au château de Montceaux et lui fait construire le Luxembourg. Le
palais du Luxembourg, uvre purement française. Relations avec les peintres
; abondance de tableaux et de portraits commandés par Marie de Médicis. Les
peintres de la reine ; François Porbus ; nombreux portraits des enfants.
Les tapisseries ; Marie de Médicis fait une pension à Decomans et la Planche : le tapissier
de la reine, Antoine Mesnillet, chargé d'aller lui rechercher au loin des
tentures de prix. Les sculpteurs ; Marie fait travailler Pierre de
Franqueville et commande pour le Pont-Neuf la statue d'Henri IV. Histoire
de cette statue d'après la correspondance de la reine. Protection accordée
par Marie de Médicis à divers artistes ; les gens de métiers ; pensions à des
jeunes gens allant en Italie.
Elevée dans le goût des arts au milieu des richesses dont
son père avait rempli le Pitti, Marie de Médicis aima les belles choses. Elle
ne fut jamais une artiste proprement dite. Elle n'a jamais rien laissé qui
puisse la faire comparer à des amateurs éminents rapprochés comme elle du
trône ou placés sur le trône même. Un peu épaisse de nature et sans finesse
intellectuelle, elle a manifesté pour les arts ce goût très large de
princesse aimant la magnificence et s'entourant sans compter d'objets
confusément riches, plutôt que l'attrait délicat d'une femme distinguée qui
choisit. Elle s'est montrée héritière des Médicis en conservant d'eux le désir
de paraître mécène, de bâtir, de faire travailler les artistes ; mais de goût
vraiment personnel elle n'en a eu que pour les pierreries, lesquelles durant
son enfance elle avait appris à discerner avec science. Le désir de témoigner
dans les cadeaux qu'elle faisait ce qu'elle appelait notre
grandeur et libéralité a contribué également à multiplier les
commandes qu'elle adressait aux artistes. Avoir autour d'elle des uvres de
toutes sortes, tableaux, statuettes, tapisseries, tentures de soie, pièces
d'argent, aiguières ; dans ses coffres quantité de diamants ; puis distribuer
aux principales dames de sa maison, à ses amies, à ses connaissances proches
ou lointaines, aux étrangers de passage à Paris, aux princes et princesses
d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'infinis objets analogues à
ceux qu'elle avait accumulés au Louvre, telle fut la double raison qui donna
naissance à ses relations avec les artistes de son temps.
Elle n'a exercé aucune influence sur eux ; l'art du XVIIe
siècle ne lui doit rien. Trop peu douée pour imprimer une direction, elle a
été la femme riche qui commande et paie ce qu'on lui donne. Une seule fois
elle a songé à dicter l'imitation d'un genre : ce fut lorsqu'elle émit
l'intention d'avoir dans le Luxembourg un monument inspiré du palais Pitti de
Florence qu'elle aimait tant. L'architecte ne tint pas compte de ses idées et
construisit un édifice français[1].
Il serait difficile de trouver reine de France qui ait
apporté une passion aussi ardente que Marie de Médicis pour tout ce qui était
joaillerie et orfèvrerie. Assurément le goût en était répandu dans les cours
de l'Europe à ce moment, et Marie avait été à bonne école à Florence où les
portraits de sa famille ruisselants de perles et de diamants attestent encore
la mode prédominante du jour. A une réception de 1612 au Louvre, le rédacteur
du Mercure français notait que la reine Marguerite de Navarre et la
comtesse de Soissons étaient si couvertes de
pierreries, qu'on ne pouvoit presque pas discerner l'étoffe sur laquelle
elles estoient. D'autre part l'achat de pierres précieuses constituait
alors une manière de placement de capitaux. En cas d'aventure fortuite, de
fuite obligatoire précipitée, et l'événement est fréquent à ces époques de
trouble, il était plus aisé d'emporter dans quelque coffret une somme
considérable sous forme de collier de diamants, que d'entasser et de compter
de lourds écus encombrants. Marie de Médicis a passé la mesure et des
précautions et des nécessités princières[2].
Il serait aisé de reconstituer la liste des principaux
orfèvres-joailliers du Pont-aux-Changeurs de ce moment rien qu'avec les
quittances, les comptes et les ordres échangés entre la reine et eux : Louis
de la Haye, à l'enseigne du Moulinet, François Dujardin, Pierre
Courtois, Jean Subtil, ouvrier particulièrement habile et heureux, Mathieu
Lescot, Claude Bourdon, Claude Couturier Jean Chancel, Nicolas Chrestien,
Paul Louvigny, Paris Turquet, Claude de Cambrai, Martin Bachelier... La
plupart, au temps de la foire de Saint-Germain, s'installaient au faubourg,
et c'était la brillante saison pour la vente, la reine achetant beaucoup pour
elle, pour ses amies et mettant en loterie des objets d'art dispendieux. Elle
ne se bornait pas aux boutiquiers du Pont-aux-Changeurs ; elle s'adressait
encore à Corneille Roger, joaillier de la rue Saint-Honoré, à François le
Prestre, qui vendait à la galerie du Palais ; et apprenant même qu'il y avait
à Châtellerault certain adroit orfèvre du nom de Luc Roiset, elle l'attachait
à sa maison par un titre honorifique[3]. Les Français
enfin ne lui suffisant pas, elle entre en relations avec des marchands de
tous les pays, parce qu'elle veut avoir les plus beaux diamants qui pourront
se trouver à vendre sur un point quelconque de l'Europe : le Flamand Hélie Fruit,
à qui vont les plus fortes commandes ; puis les Allemands Georges Langraf,
Jean Pitten, Gilbert Hessing, Hottman, l'Anglais Nicolas James, les Italiens
Andréa Fioravanti et Jean Castruccio, lequel demeure à Prague. Les uns et les
autres ont d'ailleurs correspondants ou boutiques à Paris. Enfin, non
contente d'aller quotidiennement examiner les nouveautés ou de recevoir dans
ses appartements les marchands qui lui apportent leurs créations, elle a près
d'elle, à demeure, avec la qualité de valet de chambre, un des plus habiles
orfèvres-joailliers du temps, Nicolas Roger, qui travaille pour elle sans
discontinuer, entretient les innombrables pièces qu'elle possède et garde les
clefs des meubles où les objets d'art sont conservés. Homme de confiance,
s'il en fut, donnant des conseils, à demi familier, Nicolas Roger se verra
chargé par la reine de missions semi-politiques, et sa place dans la famille
royale est telle que Louis XIII se l'attachera en 1616 comme premier valet de
garde-robe en lui confiant aussi la clef des coffres,
et qu'Henriette, la future reine d'Angleterre, voudra l'avoir en qualité de
son orfèvre-joaillier[4].
Bien que sur les portraits du début du XVIIe siècle les
perles soient la pierre précieuse qui figure le plus fréquemment et avec une
abondance presque excessive, il en est beaucoup moins question dans les
papiers de Marie de Médicis que de diamants. Le diamant est son joyau de
préférence, celui pour lequel elle se ruine. Un jour Hélie Fruit vient lui
offrir deux diamants de 21.000
livres : elle les accepte ; le lendemain il en apporte
quatre autres taillés à facettes pour servir de
pendeloques, à 30.300
livres ; le trésorier général de la maison de la
reine, M. Florent d'Argouges, fait observer que la Chambre des comptes
soulèvera des difficultés au sujet de cette dépense anormale ; Marie prend
les diamants, signe un acte à M. d'Argouges constatant qu'elle a bien ordonné
cet achat, et commandant à Messieurs des comptes de s'incliner. Il est vrai
qu'un an après l'achat des premiers diamants n'était pas encore payé.
Jean Subtil vend ses diamants montés. Son ingéniosité lui
fait trouver des formes diverses pour les présenter de façon élégante : il
offrira à la reine trois douzaines de petits boutons d'or garnis de diamants
du prix de 1.953 livres,
une chaîne de diamants de 1.350 livres, un bouquet de diamants de 300 livres ; il
imaginera des pendants d'oreille simulant des raisins, une guirlande de
fleurs émaillées à placer dans les cheveux, un bouquet de fleurs d'or
émaillé, le tout piqué de diamants. Il collaborera même avec la reine et
celle-ci combinant des pendants d'oreille lui fournira deux grands diamants à
mettre au milieu[5].
Marie tient d'ailleurs à une extrême variété dans les
objets qu'elle achète. A côté d'une autre paire de pendants d'oreilles de 2.000 livres, montés
par le joaillier Charles Godin et composés de deux grands diamants avec plusieurs autres petits diamants à l'entour,
puis une troisième paire garnie et enrichie de diamants que le joaillier
Paris Turquet livre à madame de la Châtaigneraie, elle commandera une belle boîte de portraits enrichie de diamants
et une bague portant un gros diamant pour un de ses aumôniers. Elle a deux
bagues que nous connaissons : l'une est un diamant très gros enchâssé,
Fioravanti, qui l'a présenté, l'estimait 18.000 livres ;
Marie désirant vivement l'acquérir, mais n'osant y mettre le prix, le
marchand, d'un geste inattendu, et vraisemblablement calculé, lui en a fait
cadeau. L'autre bague, en or, achetée en 1613 à Gilbert Hessing pour 1.050 livres, offre
les portraits de Louis XIII et de l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche,
recouverts d'un large diamant taillé à facettes.
Les parures dont elle dispose sont d'une richesse extrême.
Nous ne parlons pas de ce fameux collier de perles dont Henri IV lui a fait
cadeau au moment de son mariage et qui a coûté au roi 150.000 écus ; elle a
un très beau collier qui lui vient du joaillier flamand Melchior Dagières,
composé de huit pendeloques en forme d'amandes, le tout en diamants de
diverses grandeurs. Son bracelet d'or, garni de soixante-douze petits
diamants, uvre de François le Prestre, lui a coûté près de mille livres et
un autre bracelet d'elle, fantaisie extraordinaire de femme qui ne sait pas
compter, se compose d'un ovale de diamants entouré de quatre pierres de même,
avec la devise, au milieu : Titani lumina vesper
; il a coûté 360.000
livres[6] !
Marie affectionne les croix ; elle en a une de 18.000 livres en
or, garnie de dix grands diamants ; une autre, plus modeste, ornée de deux
cents cinquante diamants en roses, qui lui vient de Corneille Roser,
l'orfèvre de la rue Saint-Honoré. Les chapelets ne sont pas moins somptueux.
Jean Subtil lui en a livré un à gros grains d'or, relevé de diamants, muni
d'une petite croix d'or émaillée couverte de petits diamants, objet d'art qui
est revenu à 3.630
livres. Le marchand anglais James lui en a fourni un
second beaucoup plus riche et coûtant plus du double en raison de la qualité
supérieure des diamants.
Ce qu'elle donne est aussi brillant. Elle envoie par exemple
à la princesse de Mantoue une grande enseigne,
manière de large pendeloque qu'on pose sur la poitrine, couverte de diamants,
avec un rubis au centre, travail de Pierre Courtois qui revient à 14.400 livres ; à
la princesse d'Espagne, sa fille, une chaîne d'or garnie de cent petits
diamants ; à un gentilhomme castillan, retournant en Espagne, une montre d'or
garnie de diamants. Les montres, rehaussées de pierres précieuses, sont un
bijou qu'elle aime à donner. Elle-même en a plusieurs attachées à des chaînes
d'or piquées de diamants : Pierre Courtois lui en a vendu une ovale, 2.100 livres, la
boîte s'entend, car le mouvement vient de Blois. Blois est célèbre alors pour
la confection des montres sonnantes, et la
famille royale ne se sert que là. Le maître horloger blésois qui a les
faveurs de Marie de Médicis est Salomon Chesnon, lequel expédie un mouvement d'orloge sonnante à mettre dans une boîte
d'or garnie de diamants pour 180 livres. Avec
Chesnon, Nicolas Norry, également maître horloger de Blois, à l'honneur, en raison de sa grande expérience en son art,
d'être appelé horloger de la reine[7].
Marie de Médicis n'a pas recours qu'aux marchands pour se
procurer des diamants. Dès qu'elle apprend que quelque particulier possède
une pièce intéressante, elle n'a de cesse qu'elle n'ait obtenu la remise de
la pierre rare, à quelque prix que ce soit. Le banquier Jean André Lumagne se
trouve, en 1612, avoir entre les mains un magnifique diamant taillé. La reine
se le fait livrer moyennant la somme de 18.000 livres. Il
est vrai que ledit banquier devra attendre deux ans pour être péniblement
payé d'un peu plus de la moitié de cette dette. Sébastien Zamet est obligé,
en 1615, d'abandonner un grand diamant de 15.000 livres. Dix
ans plus tôt, le même avait vendu à la reine un autre diamant contre la somme
énorme de 75 900
livres. Henri IV et les gens de sa Chambre des comptes
n'ayant pas voulu accepter cette folie, Marie de Médicis dut attendre d'être
reine régente pour contraindre le Trésor à régler. Il y eut des cas où, pour
satisfaire sa passion de diamants, elle en fut réduite à des expédients plus
pénibles. Certain gentilhomme allemand de l'archiduc Maximilien d'Autriche,
M. François de Grimberg, possédait deux beaux diamants montés en bagues que
Marie voulait lui acheter et dont, après discussion, on avait fixé le prix à 28.800 livres. La
reine n'avait pas le premier écu. Le gentilhomme ne paraissant pas croire à
la solvabilité de la princesse, celle-ci fut contrainte d'ordonner à l'intendant général de sa maison, M.
Barbin, et à son trésorier général, M. Florent d'Argouges, de répondre
personnellement de cette somme et de signer avec elle l'engagement ! Et elle
était reine régente[8] !
C'est enfin un chapitre célèbre de l'histoire des joyaux
de la couronne que l'affaire des diamants de M. Harlay de Sancy et surtout de
celui d'entre eux dénommé encore le Sancy. Henri IV lui-même désirait
vivement garder la fameuse pierre. Très riche en diamants remarquables et
obligé, pour payer ses dettes, d'en vendre, M. de Harlay avait cherché
acquéreur dans les différentes cours de l'Europe. Le roi d'Angleterre avait
pris l'un des diamants pour 192.000 livres ; Sully, un second, moyennant 25.000 livres ;
Marie de Médicis, un troisième, pour 75.000 livres. Il
n'y eut pas moyen de traiter pour le Sancy. M. de Harlay offrait des
arrangements : Henri IV, très près regardant, reculait. Le diamant fameux
n'entrera dans les collections de la couronne que beaucoup plus tard : ce fut
une grande mortification pour Marie de Médicis[9]. A côté et après
les diamants, toute la gamme des autres pierres précieuses captive, mais à un
moindre degré, le goût de la reine. On rencontre dans ses achats nous
l'avons dit très peu de perles, tout au plus deux grosses rondes payées à
Fioravanti 4.200
livres en 1614, et six autres achetées à Martin
Bachelier 1.800
livres. Mais le Florentin Gastruccio, de Prague,
fournit trois tableaux carrés de diverses grandeurs,
faits de pierres fines rapportées, à façon de diaspre de Bohème, représentant
des paysages avec autres diverses figures ; Nicolas Roger monte en
bague un très beau rubis de 600 livres ; Jean Pitten ajuste dix émeraudes
sur une croix d'or émaillée et Jean Subtil met sur un anneau d'or un
remarquable saphir. Une fois, désirant se procurer ample provision de
turquoises afin de faire faire des chapelets et des chaînes, Marie de Médicis
écrira à l'ambassadeur de France à Constantinople, le baron de Salignac, de
lui en chercher de bruttes dans le pays, où
on dit qu'elles se trouvent facilement et à bon compte, et de lui en expédier
deux ou trois livres. Elle paiera à un joaillier allemand 240 livres une pierre
de jacinthe taillée. Quant à l'agate, très employée à cette époque et au XVIe
siècle, elle la fait travailler soit pour avoir des vases d'agate garnis d'or,
soit pour se faire monter par le joaillier Mathieu Lescot une chaîne de
soixante et onze grains encadenassés d'or[10].
L'attrait de Marie de Médicis pour les uvres d'art
d'orfèvrerie, moindre que celui qu'elle manifeste à l'égard de pièces de
joaillerie, est encore très vif. La princesse est peut-être peu touchée de
certaine vache d'or massif, donnée par le Béarn à la famille royale, portant
des devises en vers latins et béarnais, et ayant coûté 12.000 livres. En
revanche elle sait commander à l'orfèvre Pierre Lepoivre une statuette
finement ciselée de sainte Anne, de petites boîtes d'argent élégantes ; aux
orfèvres Jean Chancel et Nicolas Chrétien, ses principaux fournisseurs, et
qui ont boutique à la foire de Saint-Germain, une véronique d'or émaillé, un
saint Jérôme également d'or émaillé, formant petit reliquaire, une aiguière
d'argent ciselé, des fruitiers d'argent à jour[11]. Nicolas Roger,
plus orfèvre encore que joaillier, est celui qui lui fournit le plus,
c'est-à-dire celui dont les notes sont les plus multipliées et les
réclamations, résultats de non-paiements, les plus fréquentes ; elle lui fait
exécuter des chaînes, des bagues, des reliquaires ; trois cents soldats
d'argent, une fois, pour les étrennes du jeune roi Louis XIII ; un petit
ménage d'argent, autres étrennes pour le frère de Louis XIII, le duc
d'Orléans ; des chandeliers d'argent en vermeil ; des chenets d'argent. C'est
l'artiste universel, au talent varié et délicat. Hélas ! en 1612, il présente
un bordereau de près de trente articles non soldés depuis longtemps et un an
après, malgré plusieurs ordonnances de paiement, rien n'est encore acquitté.
Bien mieux, Marie de Médicis lui emprunte de l'argent, et ce ne sont pas des
avances faites pour objets d'art fournis, ce sont des prêts d'écus comptants,
afin de payer des dettes quelconques. L'uvre de Nicolas Roger serait
intéressante à étudier de près, s'il était possible de l'identifier, et
certaine chaîne d'or très belle portant une médaille sur laquelle étaient
ciselés les portraits de Marie et de Louis XIII en 1612, pesant dix marcs une
once, et ayant coûté 2
835 livres, nous renseignerait particulièrement sur le
genre et le talent de cet orfèvre peu connu. Mais nous n'avons rien de cet
artiste[12].
Il faudrait ajouter aux achats de la reine : toute la
vaisselle d'argent fournie en quantité par madame Hotmann, vermeil pour le
service personnel de la princesse : une fois, en 1615, celle-ci en reçoit une
valeur de 10 700
livres, les bibelots d'argent ciselés nombreux
achetés à la foire de Saint-Germain ; les fantaisies même de choses anciennes
telles qu'une médaille d'or en laquelle est d'un
côté l'empreinte des roynes d'Aragon et de Castille, et une devise de l'autre
; voire certain chapelet de perles fausses montées sur or et garni de six croix
d'or, acheté à Mathurine de Valois ; on aura une idée de la variété et de la
richesse des goûts de Marie de Médicis à l'égard des productions des
orfèvres-joailliers. Le souci qu'elle avait de faire ajouter à toute pièce
ciselée pour elle des diamants, manifeste combien en définitive la joaillerie
proprement dite demeure l'objet de ses préférences décidées[13].
Le début du XVIIe siècle et le règne de Louis XIII, en
particulier, ont été marqués par une activité considérable dans l'art de
l'architecture. Le supplément mis en 1639 au Théâtre des antiquités de
Paris de 1610 de Du Breul témoigne, par la longue liste des édifices
nouveaux construits, de cette activité. Marie de Médicis a contribué au
mouvement architectural de son temps : en aidant d'abord nombre de
communautés à édifier ; puis en bâtissant elle-même.
Elle n'a pas touché au Louvre dans lequel Henri IV avait
dépensé tant d'argent. Les sept années de son règne réel, 1610-1617, ont été
trop troublées pour qu'elle ait eu le loisir de s'adonner à une uvre de
longue haleine telle qu'eût été celle de réaliser la pensée du roi défunt en
rasant l'espace compris entre le Louvre et les Tuileries et en joignant les
deux palais des deux côtés de cet espace. Elle n'a même guère trouvé le temps
de faire travailler activement les architectes qu'avant le crime de Ravaillac
ou après le meurtre de Concini et sa propre chute du pouvoir. A peine faut-il
faire exception pour quelques uvres comme le tombeau d'Henri IV à
Saint-Denis, dont elle chargea l'architecte Métezeau ; encore ce tombeau,
auquel on était occupé en 1613, n'était-il pas terminé en 1618[14] !
Son principal titre de gloire est d'avoir attaché à sa
personne l'architecte le plus éminent de l'époque, Salomon de Brosse. C'est
vers la fin de 1608 que Salomon de Brosse reçut le titre d'architecte et conducteur des bastimens du roi et de la
reine. Successeur de son oncle Jacques Androuet du Cerceau, lequel,
après avoir élevé son neveu à Verneuil-sur-Oise, au milieu des plans du
magnifique château du lieu, qu'il construisait en collaboration avec le père
de Salomon, Jean, architecte comme lui, avait introduit le futur auteur du
palais du Luxembourg- dans la maison royale, Salomon était préparé par de
longues traditions familiales aux grandes uvres. Marie de Médicis lui fit
bâtir en 1613 l'aqueduc
d'Arcueil afin de capter les eaux de Rongis et de fournir de l'eau potable à
Paris en arrêtant les inondations désastreuses de la Bièvre. Elle
le chargea ensuite de travailler au château de Montceaux-en-Brie[15].
Bâti par Catherine de Médicis qui l'aimait beaucoup et en
fit une demeure somptueuse, le château de Montceaux-en-Brie, uvre du
Primatice, avait été acheté par Henri IV en 1596 dans la succession de cette
reine, saisie, mise en vente, et royalement donné par lui à Gabrielle
d'Estrées. Celle-ci meubla magnifiquement sa résidence l'inventaire du
château fait après son décès l'atteste. Gabrielle morte, Henri IV reprit le
domaine moyennant indemnité aux héritiers de la marquise, enleva les meubles
; puis Marie de Médicis étant devenue reine de France et ayant mis au monde
le 27 septembre 1601 le dauphin qui devait être Louis XIII, Henri IV, tout
heureux, et pour la peine, lui avait fait cadeau de Montceaux. Marie trouva
le monument du Primatice très beau et extrêmement à son goût. Mais malgré ses
dimensions, au dire de Bassompierre, en dehors de quelques appartements
royaux, il n'était pas logeable, au moins pour une suite nombreuse. La
première préoccupation de la reine fut de le meubler. L'argent faisant
défaut, Henri IV eut recours à des expédients ; il créa des offices de
conseillers dans les parlements du royaume. Marie, qui aima dès le premier
jour Montceaux, s'appliqua à l'orner avec luxe. On la voit y installer des
tapisseries auxquelles elle attache un grand prix ; puis elle appela à
l'uvre architectes et maçons afin de réparer le reste de Montceaux, dès 1602[16].
Ce furent les du Cerceau, alors architectes du roi et de
la reine, qui dirigèrent les travaux. Il n'est pas aisé de déterminer leur
part dans les réfections, le château ayant disparu. Ils l'ont remis en état
sans en modifier les lignes générales et ont construit dans le domaine. Marie
de Médicis avait agrandi celui-ci, acheté une ferme de 130 arpents. Elle fit
refaire la basse-cour, la capitainerie, les terrasses, creusa un grand fossé
entre le château et la basse-cour, répara les remises. En 1609 Salomon de
Brosse ayant pris la direction des ouvriers, édifia un jeu de paume,
complément nécessaire de toute résidence princière et même seigneuriale sous Henri
IV, bâtit dans la ferme de la seigneurie une grande écurie susceptible de
recevoir 50 ou 60 chevaux, le chiffre des chevaux de la maison de la reine,
répara la chapelle de la basse-cour, et construisit une chapelle neuve au
château. La reine a beaucoup dépensé à Montceaux. Le budget de 1612 prévoit 30.000 livres pour
les travaux. De 1613 à 1617 elle y aurait employé une centaine de mille
livres, ce qui fait une proportion annuelle équivalente. A maintes reprises,
par surcroît, elle dépassa les crédits et son trésorier général dut, de ses
deniers, faire des avances. Salomon de Brosse mena les affaires avec
activité. Au bout d'un an, en 1610, Marie de Médicis pouvait écrire à la
reine Marguerite : Vous trouverez à Montceaux tant
de changements depuis que vous n'y êtes venue que vous ne le recognoistrez
plus. Mais, vieille demeure, le château semble surtout n'avoir en
somme réclamé que des réparations ; tout l'office de Brosse paraît s'être
appliqué à cette occupation moins relevée, et on le voit qualifié de sieur de Brosse, entrepreneur des bâtimens de Sa Majesté,
vérifiant surtout des mémoires de charpentiers ou de couvreurs. Il est, dit
Marie de Médicis dans ses papiers de comptabilité, spécialement affecté à
Montceaux[17].
La reine venait souvent au château ; elle y résidait de
longues semaines pendant lesquelles, entourée de sa petite cour, elle faisait
bonne chère, jouait gros jeu, donnait comédies et ballets. Les jardins, dans
lesquels elle aimait à se promener, et qu'avaient dessinés en 1593 Claude
Mollet, étaient entretenus par les jardiniers Louis de Limoges, Jean
Marchant, et Santi Vallerani, Italien qu'elle avait amené avec elle d'Italie
et auquel elle donne un jour de quoi se marier et bâtir un moulin. Elle
invitait ses amis à venir la voir. Elle s'intéressait aux palissades qu'on
élevait, aux plantes qu'on cultivait et faisait venir de Florence semences et graines, afin de les y utiliser. Elle
avait une ménagerie. Ce fut sa demeure préférée de propriétaire amateur[18].
Elle songea à en avoir d'autres. Le calme de Montceaux ne
lui suffisant pas, sans doute, elle eut l'idée, en 1614, pour posséder quelque lieu un peu éloigné du bruit et
tracas de Paris afin de m'y retirer lorsque les affaires le pourront
permettre, d'acheter le château d'Anet. S'agissait-il d'une résidence
passagère ou vraiment pensait-elle à quitter le pouvoir ? Le château d'Anet
et la baronnie d'Ivry étaient alors à vendre aux enchères : on les lui
disputa ; elle demanda à mademoiselle d'Aumale qui avait sur les domaines le
droit de retrait lignager, de le lui abandonner. L'affaire n'eut pas de
suite.
Mais après la mort de la reine Marguerite elle acheta à
Issy la maison appelée l'Olympe, avec les parcs,
jardins et autres héritages et dépendances sis au village d'Issy qui
appartenoient à défunte la royne. Ce fut pour elle un souvenir ; elle
arrivait en carrosse ou à cheval, goûtait, chassait et rentrait la nuit. But
d'excursion voisin facile à faire en quelques heures, le domaine coûtait peu
d'entretien, 300 livres
par an ; le vieux garde et concierge, déjà là du temps de Marguerite, Etienne
de Bray de la Haye,
assurait cet entretien, soignait les cygnes des bassins ; il ne paraît pas
que la reine ait rien bâti ici et nous ignorons si les peintures qu'on voyait
dans les bâtiments encore debout il y a peu d'années, avaient été commandées
par elle[19].
Mais l'uvre architecturale la plus considérable qu'elle
ait entreprise, on le sait, c'est la construction du Luxembourg.
Lorsqu'elle arriva à Paris en 1601, Marie de Médicis était
d'abord descendue à l'hôtel de Gondi, situé dans la partie élevée du faubourg
Saint-Germain-des-Prés, quartier fort agréable,
disent les écrivains du temps, par le mélange de vastes jardins et de grands
hôtels réunissant les plaisirs de la ville à ceux de la campagne. La
maison de M. de Gondi passait pour la plus belle de Paris après le Louvre et
c'était là que le roi faisait loger les princes étrangers ou les ambassadeurs
extraordinaires. Marie de Médicis s'y plut, elle y revint souvent se
promener. Après la mort d'Henri IV le prince de Condé qui trouvait l'hôtel à
son goût demanda et obtint de la régente, obligée de se concilier les grands,
qu'on le lui achetât et qu'on le lui donnât. Afin de loger à l'avenir les
ambassadeurs, la reine jeta alors les yeux sur une maison toute voisine,
celle du duc François de Luxembourg, qui se trouvait rue de Vaugirard, en
face de la rue Garancière, hôtel assez récent, du XVIe siècle, et assez
important. Le duc consentit à le louer. La reine vint visiter fréquemment
cette demeure ; l'édifice lui plut : elle l'acheta finalement pour son usage
personnel en 1611 au prix de 90.000 livres. Appréciant les conditions de
salubrité de l'endroit, dans un lieu aéré, élevé, elle l'utilisa pour ses
enfants malades qu'elle envoyait avec leurs suites rue de Vaugirard.
Malheureusement la maison était insuffisante ; il fallait louer de petites
chambres insalubres dans le voisinage[20]. Est-ce pour
avoir plus de place, est-ce, comme on l'a dit, parce que Marie de Médicis
prévoyant la majorité de Louis XIII ou plutôt le futur mariage du prince qui
allait l'obliger à céder son appartement du Louvre à la reine régnante, tint
à posséder dans Paris une demeure à elle et digne d'elle ?
Ce qui est certain c'est qu'elle projeta dès 1611 d'élever
à la place de l'hôtel du Luxembourg une vaste construction, et en même temps,
ou pour retrouver ses souvenirs d'enfance, ou parce que le plan et les
dimensions des pièces au Pitti lui avaient particulièrement plu, elle conçut
le dessein de faire reproduire au faubourg- Saint-Germain-des-Prés le palais
de Florence. Elle écrivit à la grande-duchesse de Toscane, sa tante, de lui
envoyer le plan en son entier avec les élévations et
perspectives du monument florentin, et d'impatience fit même partir
l'architecte du roi Clément Métezeau, alors âgé de trente ans, pour relever
lui-même les desseings du palais de Pitti[21].
En attendant, elle acheta des terrains autour de son hôtel
du Luxembourg : la maison de Champrenart, au bout de la rue de Tournon,
celle sur l'emplacement de laquelle a été effectivement édifié le palais de la reine-mère ; la maison portant pour
enseigne A la ville de Bresse ; une ferme
appartenant à l'hôtel de Dieu de Paris, qui coûta 50.000 livres ;
différentes terres ; elle fit dessiner le plan des jardins par Nicolas Descamps,
qu'elle nomma jardinier ordinaire des jardins et
parterres de ma maison et hôtel du Luxembourg ; elle envoya partout
chercher, pour constituer ses allées et quinconces, des ormes, des ypreaux, à
Doullens, à Orléans, à Clermont[22].
Il fallut quatre ans pour achever les plans. La question
d'argent surtout retarda. On a répété longtemps que l'auteur du Luxembourg a
été Jacques de Brosse ; ce fut Salomon de Brosse, l'architecte de la reine
depuis 1608, qui entreprit le monument sur un traité formel conclu entre
Marie de Médicis et lui. On a dit encore et on redit que Salomon de Brosse a
imaginé le palais du Luxembourg en s'inspirant du palais Pitti. Nous venons
de voir ce qui donna naissance à cette opinion, l'intention première, en
effet, de Marie de Médicis de voir reproduire à Paris le monument de
Florence. En réalité, l'architecte ne tint aucun compte du plan rapporté par
Métezeau, ni des idées de la souveraine. On ne trouve rien du Pitti dans le
Luxembourg. Mais si l'on compare les vues du château de Verneuil avec celles
du Luxembourg, on est frappé de la similitude des deux monuments. Salomon de
Brosse s'est inspiré de l'édifice construit par son oncle Androuet du
Cerceau, édifice auquel son père avait travaillé et que lui-même tout enfant
avait eu constamment sous les yeux, lorsqu'il vivait à Verneuil. Verneuil est
une uvre française. Le Luxembourg est une uvre française. Tous les détails
où l'on croit voir l'imitation de l'Italie, la coupole, le bossage, étaient
couramment employés en France au XVIe siècle. Bon architecte et habile
praticien, Salomon de Brosse n'a été qu'un continuateur, du reste, non exempt
de défauts, des artistes français qui l'ont précédé[23].
Les plans du Luxembourg terminés, Pierre Le Muet ayant
exécuté le modèle et relief des bastimens,
Marie de Médicis posa la première pierre du palais le 2 avril 1615, puis les
travaux commencèrent sous les ordres des maçons Gamard et Biterne, du
charpentier Scellier, du couvreur Regnauld. Le sculpteur Guillaume Berthelot
s'occupa de faire les statues prévues pour les façades[24].
En raison des troubles politiques, surtout du défaut
d'argent, les travaux furent poursuivis avec une certaine lenteur. La Topographie
historique du vieux Paris dit que le Luxembourg était presque achevé en
1620. Le procès-verbal des visites et mesures des
ouvrages du palais du Luxembourg commencé le 26 juin 1623 en vertu d'une
ordonnance rendue entre le procureur général de la reine-mère et l'architecte
entrepreneur des bastimens dudit palais, Salomon Brosse, montre qu'au contraire,
à cette date, le grand corps de logis qui
était couvert n'avait que ses quatre murs, une des ailes n'était pas
commencée et le total des dépenses s'élevait déjà à 700.130 livres, 6
sols, 6 deniers. Marie de Médicis s'occupera de continuer et d'achever le
monument plus tard[25].
Dans les relations de la reine avec les peintres, ridée
d'art pour elle-même, telle que nous la concevons aujourd'hui, fait un peu
défaut. Ce que la princesse désire c'est un tableau qu'elle puisse décemment
donner : si c'est un portrait il faut qu'il soit ressemblant ; si c'est une
scène de genre, sujet religieux pour les couvents et les chapelles, qu'il
soit convenable. Parfois, rarement, s'avise-t-elle de vouloir que le tableau
soit très beau et bien fait, d'ailleurs,
d'une façon vague. Elle s'est cependant piquée de s'adresser aux meilleurs
artistes du temps.
Jacob Bunel, le peintre valet de
chambre du roi, qui a travaillé à la petite galerie notre galerie
d'Apollon et qui compte parmi les plus en vogue du moment, lui peint, en
1612, d'après sa commande, un grand tableau sur
toile représentant l'Annonciation, aussi
grand que le naturel, contenant huit pieds de haut sur six pieds de large,
avec un ciel ouvert d'où sort le Saint-Esprit en forme de colombe et de
nuages, sur lesquels il y a quantité de petits anges, tableau estimé 600 livres par M.
Donon, contrôleur général des bâtiments du roi et qui est donné au couvent
des Capucins de Paris[26].
A part Bunel, Marie de Médicis utilise peu les peintres ordinaires du roi, tels que Marin le
Bourgeois et Ambroise Dubois, l'auteur des peintures de la chambre ovale de
Fontainebleau, qualifié cependant de premier peintre
de la reine en 1606. Elle a ses artistes à elle, qu'elle met dans sa
maison avec un titre et des appointements : Claude Bourcier, Jacques Berthelot,
François Pulinat, Louis Beaubrun, lequel appartient à toute cette dynastie
qui commence avec Mathieu et Claude Beaubrun, déjà attachés à la suite
d'Henri III, en 1589, en qualité de valets de chambre, et se continuera sous
Louis XIII et Louis XIV par Henri et Charles Beaubrun. Elle donne à Pierre
Courtois le titre de peintre émailleur ordinaire
de la reine, puis de valet de chambre aux gages de dix livres. Elle va
chercher des étrangers, tels que David Baudringhien, hollandois
de nation, dont elle a reconnu par les
ouvrages de peinture que David a fait par son commandement et pour son
service, la grande expérience en cet art, elle les nomme ses peintres ordinaires ; elle emploie enfin des
peintres anglais, comme Pierre Olivier, entre autres pour sept portraits, en
1611, qu'elle paie 45
livres pièce[27].
Ce sont des portraits, en effet, qu'elle commande de
préférence. Le portrait est une mode à cette date. On en échange presque
annuellement entre cours, surtout avec les cours d'Angleterre et les maisons
princières d'Italie. En 1603, le portrait de Marie de Médicis est envoyé à
Londres ; en 1604, un autre est confié aux soins de l'ambassadeur, M. de
Beaumont ; en 1605, la reine d'Angleterre fait cadeau du sien et Marie répond
que pour remercier elle donnera prochainement un nouveau portrait d'elle avec
ceux de son mari et de ses enfants quand ils seront terminés. Généralement la
famille entière est envoyée ensemble. Tableaux figurant les personnages en
pied ou en buste, simples miniatures, toutes les variétés se rencontrent. En
1606, Concini faisant un voyage en Italie emporte une boîte dans laquelle,
écrit Marie de Médicis à une cousine, sont nos
portraits que je vous envoie afin de vous en rafraîchir la mémoire.
On pourrait dresser une liste assez longue de portraits de
Marie de Médicis. Peu de reines ont plus fréquemment posé devant des peintres
et il y a peu de peintres de mérite du temps qui ne se soient essayés à cette
tâche. Un des plus remarquables, François Porbus, dont les uvres si précises
et si soignées fournissent pour l'iconographie des documents de premier
choix, n'a malheureusement travaillé pour la reine, sauf pendant un court
passage à Paris en 1606, qu'à une époque où les embarras financiers et
politiques commençaient à restreindre chez Marie de Médicis la passion des
portraits, multipliés jusqu'en 1610. Avec le très beau portrait fait ainsi en
1606 lorsque Porbus vint de Mantoue, où il était peintre du duc, accompagnant
la duchesse au moment du baptême du dauphin, les comptes ne fournissent la
date que d'un petit nombre de tableaux de cet artiste la représentant. Le 31
décembre 1616, il reçoit 1635
livres pour six portraits dont quatre de la
reine-mère. Le n décembre 1617, Marie de Médicis ordonne de payer 1.500 livres à François Porbus, peintre entretenu par le roy, notre
très honoré sieur et fils, pour trois portraits de notre personne, l'un en
grand, pour envoyer à notre très chère fille la princesse d'Espagne, et un
petit à mettre dans une boeste[28].
Nombreux sont les portraits qu'elle a fait faire de ses
enfants. Elle a voulu avoir à peu près chaque année et plusieurs fois par
année les images des petits princes et princesses élevés dans le château de
Saint Germain, sous toutes les formes connues : peintures à l'huile, pastels,
crayons ; statuettes en cire, en bronze, en poterie ; médailles.
Le dauphin a été naturellement sous ce rapport un objet de
prédilection ; la famille royale envoyait son image partout. De 1602 jusqu'à
1611, par exemple, on relève les noms d'une dizaine d'artistes qui ont été
employés à ce travail. Le 16 janvier 1602, l'enfant est âgé de trois mois
et demi, Marie de Médicis charge Charles Decourt, peintre
du roi, de tirer un crayon de lui,
afin de l'envoyer à Florence à la grande-duchesse. Un mois après, un peintre
flamand on ignore son nom recommence ; puis un mois plus tard, le 27
mars, François Quesnel, le célèbre artiste dont nous avons gardé d'admirables
dessins, reçoit la mission de tirer le dauphin tout
de son long, pour le duc de Mantoue. Charles Decourt reprend ses
crayons le 25 juillet, et enfin le 7 novembre l'expérience est renouvelée par
un artiste que l'on ne connaît pas. En une année Marie de Médicis a fait
faire ainsi cinq fois le portrait de son fils[29]. Pour être moins
fréquentes, les occasions se répètent les années suivantes. Dans les lettres
qu'elle écrit en expédiant toiles ou dessins, la reine prête peu d'attention
à l'artiste ; son jugement sur l'uvre est court : Encore
qu'il me semble, écrit-elle à la duchesse de Mantoue d'un tableau, que le peintre a fait le visage un peu grossi et bouffi et
qu'il (le dauphin) est plus beau que ne l'est ledit portrait, je ne
laisserai pas de l'envoyer à Mantoue comme estant assez ressemblant.
L'artiste n'est pour elle qu'un manouvrier. Et cependant, en 1604, ce
manouvrier s'appellera Dumonstier, Daniel Dumonstier, fils de Côme, l'ancien
valet de chambre d'Henri III, comme tout à l'heure il s'appellera Dupré ou
Porbus.
En 1604, également, Charles Martin fait le portrait de
l'enfant, et aussi Decourt ; un certain Paolo, difficile à identifier, lequel
le tire en cire, évidemment en vue d'une
sculpture, toujours pour l'Italie ; Claude Mallery et enfin Guillaume Dupré.
On connaît les belles médailles que Dupré a gravées de la famille royale. Cet
artiste n'a pas exécuté que des médailles. Le 21 septembre 1604 il venait à
Fontainebleau afin de prendre les traits du dauphin et de les reproduire en
statuette de faïence émaillée. Le 10 mars 1605, le même Dupré revenait et
cette fois tirait le prince en cire pour
façonner une statuette de bronze. Entre temps un autre statuaire, celui-là
flamand, retiré à Florence, en faisait autant. 11 s'agit peut-être de Pierre
Franqueville, Flamand habitant l'Italie. En 1606, Marie de Médicis fait
dessiner le portrait de son fils de nouveau par Charles Martin, puis par
Fréminet, le professeur de dessin de l'enfant ; surtout par François Porbus,
en août ; et l'année suivante Decourt reprend le crayon, Dupré, à
Fontainebleau ; travaille à une nouvelle médaille[30].
Le vendredi 11 février 1611, écrit Jean Héroard dans son Journal,
à trois heures de l'après-midi, Pourbes, flamand,
peintre excellent, le tira de sa hauteur (le
dauphin). Porbus, alors âgé de quarante et un ans, était dans la force
du talent. Le portrait qu'il fit à cette occasion, actuellement au Musée des
Offices à Florence, est un des meilleurs du prince.
Pour n'avoir pas été aussi bien traités que leur frère le
dauphin, les autres enfants de Marie de Médicis n'en ont pas moins été souvent
peints, notamment Elisabeth, la fille aînée. Des ambassadeurs, tels que celui
de Londres, M. de Bressieux, se piquaient, retournant à leur poste, de
rapporter aux cours auprès desquelles ils étaient accrédités les images des
enfants de leurs souverains. C'est ainsi qu'en 1609 M. de Bressieux
suggère à Marie l'idée de faire faire le portrait d'Elisabeth pour la famille
royale anglaise, et la reine y consent. Elisabeth fut peinte par Porbus en
1611, en même temps que Louis XIIL Une lettre de la reine régente à madame de
Monglat, la gouvernante des enfants à Saint-Germain, nous apprend que c'était
le grand-duc de Toscane qui avait fait demander par le marquis de Botti, son
ambassadeur, le tableau en question. L'uvre du peintre flamand représentant
Elisabeth, aujourd'hui aux Offices de Florence, montre, comme le portrait de
Louis XIII, la précise habileté de cet artiste exact qui, à défaut de la
puissance d'un lan Dyck ou de la largeur d'un Rubens, possède les admirables
qualités techniques d'un ouvrier de premier ordre. L'archiduc et
l'archiduchesse, gouverneurs de Flandre, demandèrent, en 1611, également le
portrait d'Elisabeth[31].
Beaucoup d'autres uvres de peinture ont été assurément
commandées par la reine. Celles qui viennent d'être indiquées suffisent pour
attester l'activité de Marie de Médicis et son goût.
Ce goût fut le même à l'égard d'une autre forme de l'art :
la tapisserie, qui a joui d'une vogue extrême à cette époque. Nous voyons, écrivait le tapissier Pierre Dupont,
dans sa Stromatourgie, un chacun avoir sa maison
ou sa petite chambrette tapissée partout. Les tentures somptueuses,
pièces de haute lisse, souvent tissées de soie et d'or, présentant des scènes
bibliques ou mythologiques aux personnages figurés grandeur nature,
décoraient magnifiquement les pièces de réception des maisons royales. La
grande salle du Louvre, au premier, au plafond sculpté et doré, était tendue
de tapisseries. Les chambres à coucher royales l'étaient aussi généralement
et lorsque le roi, la reine ou leurs enfants partaient en voyage, on
transportait avec eux dans les charrois les tentures de la pièce, en même
temps que le lit démonté et les sièges nécessaires, pour tendre, le soir, au
gîte, la chambre de chacun. Marie de Médicis faisant restaurer son
appartement du Louvre avait préféré mettre sur les murs des panneaux de bois
sculptés et peints. Elle trouva moyen d'y installer des tapisseries ; elle en
avait beaucoup dans ses résidences[32].
Elle seconda les efforts que fit Henri IV pour développer
cette industrie jusque-là plutôt flamande. Henri IV avait fait venir des
tapissiers du Nord et avait pris une part importante au développement de la
maison du faubourg- Saint-Marcel, les premiers Gobelins ; il avait aidé les
Dubourg, auteurs de pièces excellentes en
rehaussement de fil d'or et d'argent, draps d'or et d'argent, toiles d'or et
d'argent, d'or frisé de toutes les façons. Marie de Médicis accorda
une pension de 9.000 écus à Marc Decomans et à François de la Planche, entrepreneurs de la manufacture de tapisseries de ce
royaume, façon de Flandre, dont M. Guiffrey a conté la fortune au
faubourg Saint-Germain, et qui tiennent une si grande place dans l'histoire
de la tapisserie en France au début du XVIIe siècle. Il est vrai que par
suite des embarras financiers du trésor, cette pension fut irrégulièrement
payée. Marc Decomans et François de la Planche doivent beaucoup à la reine qui leur
acheta nombre de pièces.
Marie de Médicis avait à sa disposition, dans sa maison,
sous le titre de tapissier de la roine, un
certain Antoine Mesnillet qui était chargé, nous l'avons déjà vu, de lui
rechercher des tentures. Fabriquait-il lui-même ? Toujours est-il que souvent
par monts et par vaux il courait à la recherche de tapisseries rares
annoncées comme étant en vente, et les apportait au Louvre où le roi et la
reine choisissaient. Ce Mesnillet devait également acheter et revendre à son
compte. Decomans et la
Planche lui achètent des tapisseries pour leur propre
collection[33].
Çà et là, dans sa correspondance, on voit Marie de Médicis
se préoccuper des tentures qu'elle fait voyager de châteaux en châteaux et
auxquelles elle tient : ce sont, pour elle, trésors précieux et lorsqu'elle
en enlève une de quelque maison, elle se croit obligée d'en donner décharge
signée de sa propre main au concierge ou gouverneur de la demeure dont la
pièce est retirée. Elle connaît si bien la valeur de ces objets que
lorsqu'elle organise la petite fête de Saint-Germain, à propos de la comédie
que doivent jouer ses enfants, elle écrira au surintendant des bâtiments de
faire enlever les tentures précieuses qui se trouvent dans la salle, et, en
cas d'accident, d'incendie, de n'en mettre que d'ordinaires tirées du garde-meuble
: c'est le temps détail caractéristique où ce surintendant, qui est le
duc de Sully (avant lui M. de Sancy, et après
lui M. de Fourcy), porte le titre officiel de surintendant
et ordonnateur des bastimens et tapisseries[34].
Les uvres de sculpture ne semblent pas avoir intéressé
Marie de Médicis à un égal degré, bien que, comme pour toutes les autres
manifestations de Fart, elle ait tenu à ne pas paraître indifférente. Il n'y
a pas lieu de s'arrêter à l'ouvrier tourneur qu'elle faisait venir dans son
cabinet pour lui voir exécuter des sculptures sur bois telles que des
chapelets de Saint-François, lesquels elle distribuait aux princesses et à
ses dames. Mais de même qu'elle se plaisait à envoyer des portraits de
membres de sa famille à l'étranger, de même, en moins grand nombre, elle
envoie bustes et statuettes. Nous avons fait allusion à des statuettes de faïence
émaillée, de bronze ou d'or de son fils le dauphin commandées par elle. Elle
commande également des bustes d'Henri IV, surtout le lendemain de la mort de
celui-ci, et les adresse à ses parents d'Italie par les auteurs eux-mêmes. Il
est fâcheux que le peu de cas qu'on fait à cette époque des artistes empêche
la plupart du temps le scribe qui rédige les lettres de la reine de nommer le
sculpteur, dont il se contente de dire qu'il est fort
excellent en son art. La seconde raison de ses commandes est, encore
ici, le désir de donner aux couvents. En 1611 les maistres
sculpteurs Nicolas de Cambrai et Georges Allemant reçoivent d'elle 1.470 livres pour leur façon et fourniture de dix figures de bois
qu'ils ont faites et dorées par notre commandement, dit Marie de Médicis, à
savoir : deux grandes et huit moyennes, desquelles nous avons fait don et
présent à l'église des Feuillans du faubourg Saint-Honoré de cette ville pour
l'ornement et décoration d'icelle[35].
Le sculpteur qui a joui de toute sa faveur la plus spéciale,
la plus attentive, est Pierre de Franqueville, un Flamand, né à Cambrai,
passé en Italie où il fut l'élève de Jean de Bologne, membre de l'Académie de
sculpture de Florence. Henri IV l'avait remarqué, l'avait appelé, lui avait
donné un logement au Louvre et l'avait fait travailler. Marie de Médicis
partagea les sentiments de son mari à l'égard de l'artiste, lui commanda
nombre d'uvres, notamment une statue équestre en bronze du dauphin,
aujourd'hui à Florence, et lui témoigna une sympathie allant jusqu'à la
tyrannie. Franqueville, ainsi, ayant désiré en 1607 entreprendre un voyage en
Italie, la reine le lui permit parce qu'il s'agissait de donner ordre à quelques affaires domestiques. Il emmenait
avec lui femme et enfants. Mais dans la lettre qu'elle écrit au grand-duc de
Toscane pour lui recommander le voyageur, Marie ajoute que surtout le
grand-duc donne ordre que Franqueville diligente son
retour le plus promptement que faire se pourra afin qu'il puisse travailler
aux ouvrages qu'il a commencés. Offrait-on à la reine quelque statue à
acheter et connaissant ses goûts on lui présentait toutes sortes d'uvres
d'art, c'était Franqueville qui était chargé d'aller sur place examiner la
pièce ; telle, cette statue de la
Vierge en marbre que le neveu de M. de Souvré, le baron de la Flotte, possédait dans
une de ses maisons, appelée Bellefille, près du Mans, et qu'il proposait à
Marie de Médicis comme une pièce rare, excellente et
eslabourée de personne de grande estime : Franqueville alla voir si
vraiment elle méritait le grand cas qu'on en
faisait. Nul mieux que lui n'était à même de faire apprécier à la reine les
statuettes en bronze de Jean de Bologne, son maître, que le grand-duc de
Florence, Côme, lui envoyait en 4614 pour elle et son fils. A cette occasion
vinrent à Paris avec Pesciolini, qui apportait ces statuettes, des artistes
florentins que Marie reçut gracieusement et auxquels elle distribua de larges
dons[36].
Florence, Jean de Bologne et Franqueville, ces trois noms
se trouvent associés pour l'épisode le plus important des relations de Marie
de Médicis avec les sculpteurs de son temps : l'histoire de la statue d'Henri
IV au Pont-Neuf.
Le Pont-Neuf, projeté dès 1577, mené par Henri III jusqu'à
l'achèvement des arches franchissant le petit bras de la Seine et l'émergement à
fleur d'eau des piles du grand bras, avait été repris par Henri IV qui
l'avait conduit, sous la direction de l'architecte Guillaume Marchand, à ce
point que le public, en 1604, pouvait passer la rivière. On construisait les
quais ; la Samaritaine,
machine et horloge, travail du Flamand Lintlaer, se montait. En vérité il y
avait encore à faire, puisque la généralité de Paris payait toujours, en
1607, la somme de 15
300 livres d'impôts destinés à l'achèvement du pont.
C'est vers 1604, 1603, que Marie de Médicis eut l'idée,
afin de le compléter au point de vue esthétique, de faire cadeau à la ville
de Paris d'une statue équestre d'Henri IV qui serait placée à l'extrémité de
l'île de la Cité,
sur le terre-plein séparant les deux parties du pont. L'idée venait d'Italie,
de Florence, surtout, où le grand-duc Ferdinand s'était fait faire une statue
en bronze par Jean de Bologne le représentant lui-même à cheval, et allait
l'ériger sur la place du Grand-Duc. Marie de
Médicis s'ouvrit de son projet à Ferdinand, son oncle, qui lui proposa
d'employer à ce travail le même Jean de Bologne.
La reine accepta avec empressement, puis, prise d'un
scrupule, écrivit au grand-duc que Jean de Bologne était bien vieux il
avait en effet quatre-vingt-un ans, qu'il était lent au travail et qu'il y
avait chance pour qu'elle ne vît jamais l'uvre qu'elle attendait de lui ;
cependant, désirant beaucoup que le monument qu'elle comptait faire poser sur la place que l'on accommode exprès sur le
Pont-Neuf de Paris, lequel s'en va être parfait, fût de cet artiste,
le plus fameux sculpteur du moment, elle proposait à Ferdinand la combinaison
suivante : c'était que le grand-duc donnât à Marie le cheval de bronze
actuellement existant, sur lequel était la propre statue de Ferdinand, qu'on
descendît cette statue, et qu'à la place, Jean de Bologne s'occupât de mettre
l'effigie d'Henri IV ; Jean de Bologne, ainsi, arriverait peut-être à temps,
et, la statue du Pont-Neuf terminée dans ces conditions, il pourrait à loisir
refaire un autre cheval pour le grand-duc[37].
Ferdinand ne goûta pas la proposition. Mais il suggéra un
moyen terme : utiliser les moules qui avaient servi à fondre le cheval et
faire couler une nouvelle statue. Marie de Médicis consentit. Le grand-duc,
pris de zèle, décida alors d'exécuter non un, mais deux chevaux de bronze et
d'envoyer au roi d'Espagne sa statue comme il envoyait au roi de France la
sienne.
Jean de Bologne avait très travaillé le cheval de la
statue équestre de Côme Ier, faite par lui précédemment, mais beaucoup moins
le cheval de la statue de Ferdinand. Sauval, plus tard, trouvera la
reproduction de celui-ci mise au Pont-Neuf peu estimable et jugera la bête
une manière de coursier de Naples trop gros et disproportionné. D'après
Germain Brice, le cheval d'Henri IV étant bien de Jean de Bologne, la statue
du roi serait de Guillaume Dupré : l'assertion est inexacte. Franqueville
fit, pour Jean de Bologne, un modèle de la tête du prince, et il dut s'en
acquitter avec talent, car on déclara, une fois la statue mise en place, le visage du roi vivant et ressemblant, une des figures
les plus ressemblantes que nous ayons de ce grand prince[38].
Marie de Médicis n'avait pas eu tort d'appréhender la
lenteur de Jean de Bologne : le travail n'en finit pas. La reine paraissait
pressée : le présent qu'elle voulait faire à la ville de Paris, disait-elle,
serait d'autant plus goûté qu'il arriverait plus à propos : il traîna près de
neuf années ! Elle réclama vingt fois. En 1606, elle envoyait son écuyer
Luigi Bracci à Jean de Bologne pour traiter du paiement du cheval comme si
celui-ci était déjà achevé. Mais Bracci fut disgracié, révoqué de ses
fonctions ; interdiction lui fut signifiée de revenir en France ; il fut même
jeté en prison, où il resta jusqu'en 1607, pour des raisons diverses. A sa
place Marie expédia Concini. Concini avait mission de
convenir du prix avec Jean Boulogne pour le cheval de bronze et que vous
avisiez, ajoutait la reine, au moyen de le faire apporter de deçà, et aussi
que vous donniez ordre de faire faire le plus promptement qu'il se pourra par
ledit Jean Boulogne l'effigie du roi monseigneur en bronze pour poser sur
ledit cheval. Au bout de deux ans, rien n'était terminé. M. d'Ocquerre,
fils de M. Blancmesnil, chancelier de la reine, partant pour l'Italie où il
allait faire un voyage, selon l'habitude des jeunes gens de famille du temps,
Marie de Médicis le chargea de voir où en était le travail, dont elle n'avait
aucune nouvelle, d'aller trouver le grand-duc et de s'entendre avec lui sur ce
sujet[39].
Entre temps on édifiait à Paris la place Dauphine et
l'architecte du Pont-Neuf, Marchand, disposait la terre-plein sur lequel devait
s'élever la statue attendue.
Puis Jean de Bologne mourut ; comme l'avait prévu Marie de
Médicis il n'avait pu mener son uvre à bonne fin. Avait-il même beaucoup
touché au projet, si tant est que le cheval fût terminé ? Il est difficile de
le dire. Un échange de lettres eut lieu entre la reine de France et le
grand-duc Ferdinand sur les suites que comportait cet événement et il fut
décidé de confier au sculpteur Pietro Tacca l'achèvement de la statue. Je ne doute pas, écrira ensuite Marie de Médicis à
cet artiste, qu'ayant mis la dernière main à cet
ouvrage, comme vous me le mandez, il ne soit digne de ce qu'il représente.
Il fallut attendre jusqu'en 1614 pour voir le terme de ce grand uvre. A son
tour Tacca, auquel on avait convenu de payer 700 écus, dut patienter deux ans
avant de voir régler son compte[40].
Le transport à Paris du monument fut une entreprise
mouvementée. Le grand-duc avait délégué à cette charge son agent
diplomatique, le chevalier Pesciolini que secondait l'ingénieur Guidi. On
embarqua la statue à Livourne sur un navire qui alla passer par le détroit de
Gibraltar pour gagner le Havre. Près d'arriver, le bateau fît naufrage sur un
banc de sable. On sacrifia le bâtiment et on repêcha la statue tombée au fond
de l'eau.
Le 2 juin 1614, à quatre heures de l'après-midi, le jeune
roi Louis XIII avait posé la première pierre du piédestal de la statue :
Franqueville devait s'occuper de tout ce qui concernait le piédestal.
Sollicités par les complications menaçantes de la politique, le roi et sa
mère partirent pour la
Bretagne presque aussitôt et c'est pendant leur absence, en
juillet 1614, que l'uvre de Jean de Bologne et de Tacca, enfermée dans des
caisses de bois, arriva. Marie de Médicis écrivit qu'il ne fallait pas
attendre son retour pour ériger la statue et l'inaugurer[41]. Le 23 août eut
lieu cette cérémonie solennelle qui ne consista qu'à dresser le monument, et
à laquelle assistaient : les commissaires chargés de la construction du
Pont-Neuf, les premiers présidents du Parlement, M. de Verdun, de la Chambre des comptes, M.
de Nicolaï ; le procureur général, M. de Bellièvre, le lieutenant civil, les
trésoriers généraux de Paris, le prévôt des marchands, M. Miron et ses quatre
échevins ; Pierre Franqueville, qualifié de premier
sculpteur de Leurs Majestés. On introduisit dans le ventre du cheval
une inscription peinte sur vélin, enfermée en un tuyau de plomb avec de la
poussière de charbon afin de la mieux conserver. Cette inscription, uvre de
M. Gilbert Gaulmin de la
Guyonnière, disait que le grand-duc de Toscane Ferdinand
avait commandé la statue à Jean de Bologne et l'avait fait achever d'élabourer par Pietro Tacca, son sculpteur, en mémoire d'Henri IV. La statue du
Pont-Neuf était-elle donc un présent du grand-duc ? On pourrait le croire : Sur ce que vous aviez su, écrivait Marie de Médicis
au début de l'affaire, en 1605, à son oncle, que je
désirois faire faire l'effigie du roi Monseigneur à cheval en bronze, vous
aviez l'intention de faire faire, par delà, ladite effigie par les mains de
Jean Boulongne et me l'envoyer ; vous me vouliez faire cette courtoisie.
Puis quelques jours après l'inauguration, la régente étant revenue à Paris et
ayant fort admiré la statue qu'elle disait voir de son appartement du Louvre,
écrivait au grand-duc de Toscane pour le remercier de
ce bel effet de votre courtoisie et bonne volonté. C'est un présent,
disait-elle, qui m'a été du tout agréable.
Pas très certaine probablement du cadeau lui-même, Marie de Médicis, nous
l'avons vu, avait envoyé à Florence afin de régler le prix de la fonte du
cheval et, deux ans après, l'envoyé florentin lui rappellera qu'elle n'a pas
encore payé Pietro Tacca. Dans ces limites l'intention courtoise de la cour
de Florence se trouve réduite à des proportions plus modestes[42].
Il restait à orner le piédestal : ce fut une uvre aussi
longue et difficile. Pierre de Franqueville y mit un temps interminable ou
même il se borna à donner les dessins et d'autres exécutèrent. Il projetait
de placer aux quatre coins des personnages figurant les quatre parties du
monde et autour des bas-reliefs en bronze représentant : les batailles
d'Arqués et d'Ivry, la réduction de Paris, le siège d'Amiens et de Montmeillan
avec des inscriptions, des lauriers, des oliviers, l'ensemble ne manquant
d'ailleurs ni d'élégance ni de distinction, à comparer surtout avec le
piédestal de 4818. Franqueville ne parvint pas à l'exécuter. Un instant,
avant même que la statue fût inaugurée, il avait été question de l'évincer.
Les commissaires et directeurs des bâtiments et
édifices du Pont-Neuf ne voulant pas de lui, réclamant un autre
artiste, pour sculpter les bas-reliefs, Franqueville écrivit à la reine, lui
envoya son gendre Bartolomeo Bordoni, et Marie de Médicis dut lui répondre
qu'il eût à se tranquilliser ; qu'elle ne voulait pas qu'autre que lui mît la main à cet ouvrage, puisqu'il en avoit déjà
fait les dessins et le modèle. Les commissaires eurent le dernier mot,
sinon en principe, au moins en fait, puisque Bordoni, le gendre, exécuta les
quatre statues du piédestal, lesquelles furent trouvées médiocres et maigres
comme des squelettes ; quant aux bas-reliefs qui n'étaient pas encore fondus
en 1635, Richelieu les commanda à Bordoni, à Michel Bourdin, et à Barthélemy
Tremblay : ils furent meilleurs que les statues[43].
La prédilection manifestée par Marie de Médicis à l'égard
des arts a su encore affecter d'autres formes et variées. Un certain Jean
Biot, dit Mercure, s'était signalé dans la confection d'émaux imitant les
marbres, jaspes, calcidoines. La reine voulant gratifier ledit Mercure et lui donner plus de
courage et d'affection à faire paraître quelques pièces de ses artifices et
inventions, lui permet de chercher à loisir dans toutes les terres de
son domaine du Bourbonnais les minières tant
métalliques que autres servant à l'effet ci-dessus, comme aussi de recueillir
les fougères et autres herbages inutiles ès bois et forêts en dépendances qui
y pourront servir ; elle lui donnait d'avance ce qu'il trouverait.
Un autre ouvrier, Etienne Sager, était habile dans l'art d'imiter les laques
de Chine. Marie de Médicis l'attache à sa personne avec un revenu fixe pour
lui faire faire avec gomme laque et peinture dorée,
en usage dans ledit pays, cabinets, coffres, boîtes, lambris, ornements
d'église, chapelets et autres meubles et ustensiles chinois. Elle
installe même un marchand d'articles chinois dans la galerie du Louvre, dans
cette galerie où elle avait également mis un artiste travaillant
remarquablement l'ébène, Laurent Septabre, le plus connu des ouvriers de ce genre
au début du XVIIe siècle[44].
A sa maison sont rattachés sous le nom de gens de métier un certain nombre d'ouvriers de tous
corps d'état ; la place est bonne, en raison des privilèges dont on jouit,
des commandes qu'on reçoit et du traitement fixe annuel qu'on touche. Chaque
reine de France avait eu de ces gens ; Marie
de Médicis en a augmenté le chiffre ; au lieu de douze que Louise de
Lorraine, femme d'Henri III, comptait près d'elle, elle en eut jusqu'à
quarante-trois. Il est sans doute de peu d'intérêt pour nous que dans ce
monde elle ait un vertugalier, un faiseur de porte-fraises, un cordonnier ou
un linger, une perruquière ou un passementier, mais il n'est pas indifférent
de savoir qu'elle a élargi la part des artistes. Nous avons déjà parlé de son
joaillier Nicolas Roger et de son architecte Salomon de Brosse ; dans la
liste figurent aussi deux graveurs : Danfrie et Pierre Turpin, auquel elle
confie le soin de graver ses sceaux ; deux horlogers, un libraire-imprimeur,
Jacques de Heuqueville ; quatre peintres : Ambroise Dubois, Daniel
Dumonslier, Guillaume Dumée, Nicolas Duchesne ; et nous en connaîtrions bien
d'autres si les commis rédigeant les comptes n'avaient pas cru négligeable de
donner les noms des quarante-trois privilégiés. Un des privilèges appréciés est
de pouvoir obtenir un logis dans la grande galerie du Louvre que vient de
construire Henri IV pour relier son palais aux Tuileries : le premier étage
demeurant à l'usage du roi, le rez-de-chaussée et la mezzanine servant aux
artistes. Sur les dix-huit personnages qui les premiers, par lettres patentes
de 1608, sont appelés à l'honneur de cette faveur royale, près de la moitié
sont des artistes chers à la reine : la proportion indique combien Marie
s'est associée à la mesure prise parle roi[45].
A l'égard des uvres étrangères, sa sollicitude est
curieuse. Il v avait un certain Flamand nommé Pierre de Brun dont le métier
consistait à vendre en France des rares peintures,
tableaux et autres bardes excellentes qu'il faisoit venir de provinces
étrangères et éloignées. Pierre de Brun s'installait particulièrement
à la foire de Saint-Germain, mais, ne voulant rien remporter de France, il ne
quittait pas le royaume, pour aller entreprendre une nouvelle campagne
d'achats au loin, qu'il n'eût débité tout son fond. Marie de Médicis
s'emploie dans de grandes villes, Bordeaux, Orléans, Rouen, à faciliter au
brocanteur la vente de ses marchandises rares.
De Brun mettait ses pièces en loterie. Les parlements, soucieux de défendre
les commerces locaux, interdisaient ces loteries ou blanques.
La reine sollicite du roi des lettres de jussion lesquelles ordonnent aux
cours judiciaires de cesser leur opposition et elle écrit à chacun des
premiers présidents des parlements pour leur demander, à titre personnel, de
favoriser gracieusement l'exécution des ordres que le roi a autoritairement
envoyés[46].
Marie de Médicis aima beaucoup les broderies. C'était
elle-même qui choisissait, par exemple, les broderies devant figurer sur les
hoquetons et casaques des archers de ses gardes. Elle avait dans sa maison
des brodeurs français attitrés : Nicolas de Vaudray, Jean le Boiteux, Jean
Michel, Louis Boucherot, Nicolas Desforses. Elle affectionnait les broderies
orientales et elle avait fait venir d'Orient tout un groupe d'ouvriers et
d'ouvrières formant près d'elle une singulière petite colonie exclusivement
appliquée à ce genre d'ouvrages : un Turc, d'abord, logé au Luxembourg ; M.
de Brèves, ambassadeur à Constantinople, revenant en France, lui avait
ensuite amené une levantine habile, Polonaise d'origine, nommée Anne Ossache,
qu'on maria avec un certain Laurent Cosson, déchargeur de l'artillerie ; la reine
avait encore trois dames turques de nation, que nous
avons fait venir en ce royaume, écrit-elle, pour travailler à plusieurs
ouvrages pour notre service, auxquelles on donnait 420 livres de gages
annuels et qui s'occupaient de broderies de soie fournies à elle par le
marchand Decreil ; leurs robes confectionnées passaient pour les choses du monde les plus belles, au dire de
Malherbe. Surtout Marie de Médicis comptait dans cet atelier deux Grecques,
Adrienne Theodoran et Marguerite Thamary, aux mêmes gages de 120 livres et
desquelles elle paraît s'être occupée avec une attention particulière ; elle
les nourrissait ; une fois l'argent ayant manqué dans les caisses de la
reine toujours à court, le trésorier général de la maison, M. Florent
d'Argouges, fut obligé, pendant trois ans, d'avancer les frais de cette
nourriture, en même temps que de payer les gages ; elle les logeait ; elle
les logea jusqu'en 1615, en raison sans doute de leur jeunesse, chez les
surs de Sainte-Ursule à la supérieure desquelles, sur Marie de Sainte-Croix
de l'Incarnation, étaient payées les 360 livres
représentant le prix de la pension des deux. Après 1615, elle les réunit à
Anne Ossache ; puis, celle-ci ayant épousé son déchargeur, Adrienne Theodoran
se maria de son côté en 4617 avec un fourrier des logis du corps d'Anne
d'Autriche nommé Jean Guillot, et reçut pour ses noces, de la reine, 2 400 livres de
gratification : toutes deux devant continuer à
exécuter des ouvrages de broderie façon du Levant ; quant à Marguerite
Thamary, elle se fit carmélite et devint sur de la Croix. C'étaient
le marchand Jean Henriot qui délivrait aux filles
grecques la toile claire sur laquelle
elles brodaient, et le peintre François Bénard qui traçait
les carrés de toile sur lesquels elles travaillaient[47].
Enfin Marie de Médicis s'employa volontiers à faciliter en
Italie le voyage de savants, d'artistes de toutes sortes désireux d'aller
compléter leur éducation dans la péninsule. Elle les recommandait à ses
parents princiers, à ses amis ; tels ce fils d'un
arboriste et simpliciste du roi monseigneur qui a, puis quelques années,
commencé par son commandement un jardin à Paris de plusieurs arbrisseaux,
herbes et simples rares et recherchées des provinces éloignées ; il s'en va
maintenant en Italie, écrivait-elle, pour voir ce qu'il trouvera de rare ; je
vous prie d'avoir pour agréable qu'il voye vos jardins et que s'il y a
quelque simple en iceux dont il puisse apporter de deçà du plan et de la
semence, de le lui permettre ; tel encore ce jeune homme de Blois,
Jean Mosnier, qui partait avec l'archevêque de Pise pour le pays de
Michel-Ange ; Marie de Médicis le défraya de son voyage et lui promit une
pension mensuelle de 45 livresque lui fera tenir le valet de chambre Nicolas
Roger, l'orfèvre, afin qu'il puisse estudier en
Italie son art de peintre. Il semble que Marie de Médicis n'ait voulu
négliger aucune des formes diverses qui désignent les protecteurs des arts à
l'estime de l'histoire[48].
|