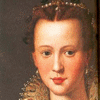|
Petit nombre des amies de Marie de Médicis. La vieille et joviale
duchesse de Guise. Sa fille, la princesse de Conti. La duchesse de Montpensier.
Madame de la Châtre,
amie de province. Peu d'hommes admis dans l'intimité. Léonora Galigaï.
Ce qu'elle est devenue depuis son départ de Florence. Son amour pour
Concini. Henri IV veut les chasser tous les deux. Leur adresse ingénieuse
; ils se tirent d'affaire et s'épousent. Léonora dame d'atour. Son
appartement au Louvre ; son intérieur ; ses visites à Marie de Médicis.
Elle vit isolée en femme maniaque et bizarre. Explication de l'influence
extraordinaire qu'elle a exercée sur la reine. Mot légendaire de l'habile
femme et de la balourde. Par quoi s'est manifestée cette influence.
Léonora choisit le haut personnel de la maison royale et désigne les
ministres : Richelieu lui doit les débuts de sa fortune politique. Exemple
du pouvoir de la dame d'atour : M. Allory. Léonora s'est surtout servie de
son influence pour s'enrichir : ses pots-de-vin ; ses indélicatesses ;
placements à l'étranger. Comment on l'accusera de sorcellerie. Sa
maladie, hystérie violente. L'impuissance des médecins. Recours aux
exorcismes ; liturgies étranges. On a prétexté la sorcellerie pour punir
l'amie de la reine de ses concussions sans atteindre Marie de Médicis.
Marie de Médicis a eu peu d'amies. Une reine de France est
trop haut placée pour que le sentiment de respect qui inspire les sujets et
les tient à distance puisse aisément se changer en une cordialité familière.
Il est des natures, ensuite, qui, par des qualités de sincérité, d'élan, de
chaleur de cur et de continuité intelligente, attirent les sympathies
dévouées : la femme d'Henri IV ne possédait pas ces qualités. Quatre ou cinq
personnes à peine furent admises dans son intimité, pour des raisons diverses
; elles appartenaient, en général, au plus haut monde de la Cour, tenaient même rang de
princesses. Une d'elles, en revanche, d'une origine plus humble, a joui d'une
faveur si exceptionnelle, si soutenue, que nulle favorite n'a inspiré passion
égale et n'a plus aveuglément conduit une souveraine à la ruine, contraste
singulier, phénomène bizarre qui demandera à être expliqué ou éclairci.
La vieille duchesse de Guise, la veuve du héros de la Ligue assassiné à Blois,
toujours admirablement reçue par le ménage royal au Louvre, est la première
des amies de la reine. Le roi l'aime beaucoup. Elle est libre, gaie, très
rieuse ; son rang, son âge, son passé lui donnent des licences de propos et
de manières que personne n'oserait prendre, que Leurs Majestés ne
toléreraient chez personne, mais qui les amusent chez la vénérable douairière.
Quand il est fatigué et n'a pas madame de Verneuil près de lui, Henri IV se
délasse l'esprit en compagnie de la duchesse. Bien des gens critiquent cette
confiance imprudente, non pas que la veuve de l'ancien adversaire d'Henri III
soit à craindre personnellement, mais à cause de ses enfants qui ne cessent point les plus dangereuses pratiques
étrangères, dit-on, plus à tort, du reste, qu'à raison[1]. Aimant
plaisanter aussi, la reine n'a pas eu de peine à partager le goût de son mari
pour la joviale princesse ; elle la voit avec plaisir, passe de longues
heures avec elle, se fait accompagner par elle. Ayant vécu sous plusieurs
reines et appartenu aux cours des derniers Valois, madame de Guise est pleine
de souvenirs piquants qu'elle conte. Jouit-elle d'une réputation intacte ? Il
ne faut pas trop poser la question et d'ailleurs ce sont détails auxquels
Henri IV n'attache qu'une importance secondaire. L'essentiel est qu'elle soit
de relations charmantes. Les lettres que Marie de Médicis lui adresse nous
donnent le ton de leur conversation habituelle, lettres pleines d'entrain,
vives, moqueuses, avec une pointe de familiarité caractéristique, mais aussi
affectueuses. Comme le veulent les usages, la reine dit à la duchesse : ma cousine, madame de Guise appelle Marie de
Médicis notre bonne reine. Afin de l'avoir
plus près d'elle, la reine lui a fait attribuer un appartement au Louvre,
au-dessus d'elle, au second, et la duchesse doit y séjourner le plus
possible. Elle a cependant un bel hôtel rue de Grenelle où elle donne de
superbes réceptions auxquelles se presse tout le monde de la cour et le plus
choisi de la ville. Elle invite la reine ; elle organise en son honneur des
soirées particulièrement brillantes et elle aime à se retrouver dans le cadre
élégant dont elle a fait un des centres mondains les plus réputés de Paris.
Mais les devoirs de l'amitié l'attachent étroitement à la Cour. La charge
comporte d'ailleurs suffisamment de faveurs, de privilèges et de pensions[2]. Cette amitié de
la reine n'a pas été sans nuage et lorsque quelque incident se produit il y a
lieu de redouter l'humeur emportée de la veuve du Balafré. Mais Marie de
Médicis passe les incartades. Elle les passe tant et si bien qu'Henri IV
finit par se demander si l'influence qu'exerce la vive princesse sur la reine
n'est pas plutôt pernicieuse. Il croit remarquer que les deux femmes parlent
un peu trop ; qu'à l'égard de madame de Verneuil la duchesse joue un jeu
double, faisant bonne mine aux deux partis et les trahissant tous les deux à
la fois ; qu'elle a l'air fort aimable pour Henriette d'Entraigues, puis,
devant la reine, jette feu et flamme contre elle.
Il avertit Marie de Médicis qui ne veut pas le croire ; pour qu'elle s'en
assure, il lui suggère d'inventer une histoire et de la conter à madame de
Guise sous le sceau du secret, afin de se rendre compte que le secret sera le
jour même éventé. Marie de Médicis confie en effet à la duchesse qu'elle a le
dessein de faire enlever la marquise de Verneuil au bac d'Argenteuil, de n'en
rien dire à personne et, le jour même, madame de Verneuil est prévenue[3] !
Ce n'était pas tant, il est vrai, madame de Guise,
elle-même, dont Henri IV incriminait la fausseté, que sa fille, la princesse
de Conti, non moins intime auprès de Marie de Médicis. Mademoiselle Louise-Marguerite
de Guise, future princesse de Conti, avait quelque vingt-quatre ou vingt-cinq
ans lorsque Marie arriva en France ; leurs âges respectifs n'étaient pas très
différents. Comme sa mère, elle était extrêmement gaie, même un peu plus
libre de propos. Douée d'infiniment d'esprit et de beaucoup de causticité, elle railloit de bonne grâce et divertissait sur le
compte d'autrui. Henri IV, un instant, avait eu quelque faible pour elle et
avait parlé de l'épouser ; le projet ne tint pas. Quand Marie de Médicis
débarqua à Marseille, soit mouvement spontané, soit calcul, la jeune fille
chercha à gagner les bonnes grâces de la princesse et y parvint. Elle n'avait
eu qu'à user des moyens qui assurèrent longtemps son succès : amabilité
constante, dévouement délicat et discret de tous les instants, art prudent
d'être toujours de l'avis de la reine et de prendre perpétuellement son parti
: la sympathie de Marie était gagnée. Elle s'abandonna à mademoiselle de
Guise : La princesse de Conti gouverne la reine,
écrira plus tard Malherbe, avec exagération, du reste. Mademoiselle de Guise
eut son appartement au Louvre, dans les entresols, près des appartements de
la reine. Elle ne quitta plus Marie de Médicis à laquelle elle servait de
dame de compagnie, et, suivant le cas, de secrétaire. C'était elle qui, le
soir, lisait tout haut un livre, une lettre, quand, dans le cercle de la
reine, l'occasion se présentait de faire quelque lecture. C'était elle qui
écrivait sous la dictée les missives les plus particulières. Elle était la
confidente de la princesse ; elle lui apportait les menues nouvelles de la Cour, les histoires, les on
dit. Charitable, notamment pour les gens de lettres, elle se montrait d'une
rancune inexorable à l'égard de ceux contre lesquels elle avait des griefs.
Sa réputation n'était pas très établie[4] ! Assez tard, en
1605, elle avait vingt-huit ans, on la maria avec un veuf de
quarante-cinq ans, le prince de Conti, cousin germain d'Henri IV, pauvre
homme sourd, affreusement bègue, stupide, qui, après avoir eu d'elle une
petite fille morte en nourrice, s'éteignit en 1614 à Saint-Germain-des-Prés,
dont il était abbé, et où il vivait obscurément des 10.000 écus de revenus du
monastère et de 20.000 écus de pension que lui faisait le roi. Dès lors
émancipée, la princesse de Conti se donna libre carrière : elle eut, entre
autres, pour amant, Bassompierre pendant trente ans : c'étoit la plus habile, haute et capable princesse que j'eus jamais
connue, dit celui-ci avec conviction. Henri IV ne lui refusait rien,
ou à peu près, lorsqu'il s'agissait de dons : il lui attribuait des finances
d'offices, telle la finance d'officiers du grenier à sel de Marseille,
spécialement créée pour elle : il la gratifiait, à Fontainebleau, d'une place et d'une ruelle situés près de l'hôtel Grand
Ferrare ; il lui assignait 20.000 livres sur
la recette générale de Bretagne, la princesse de Conti qui avait reçu une
belle dot devait, au surplus, hériter d'une opulente fortune. Mais, à la
fin de sa vie, le roi ne pouvait plus la souffrir ; il lui reprochait ses artifices incroyables auprès de Marie de
Médicis ; il prétendait qu'elle empoisonnait
l'esprit de celle-ci. Très faible en résolution, quand il s'agissait
de son ménage, il ne lui vint jamais à l'esprit cependant d'écarter la mordante
et dangereuse amie de sa femme[5].
Beaucoup plus calme et rassise est une autre intime de la
reine, la duchesse de Montpensier. Ici c'est Marie de Médicis qui a pris les
devants et entretient cette amitié avec un soin singulier. On en sait la
raison : madame de Montpensier a une fille unique, la plus riche héritière de
France, que la reine, en mère prudente, veut ménager pour son second fils. Le
duc de Montpensier est un Bourbon de la branche de Montpensier, du XVe
siècle, avec qui va s'éteindre cette lignée ; brave soldat, qui s'est battu
contre les ligueurs, et, par ailleurs, comme le prince de Conti, un imbécile.
Sa femme, Henriette-Catherine de Joyeuse, aimable et douce femme, toujours
malade, de sens posé et modeste, peu portée à la dissipation, n'aime pas
outre mesure le tumulte des cours. Elle a pour frère le cardinal de Joyeuse,
archevêque de Rouen, possesseur, à ce titre, du beau château de Gaillon,
uvre des d'Amboise, où il reçoit volontiers et souvent la duchesse. Marie de
Médicis écrit beaucoup à madame de Montpensier ; elle s'inquiète de sa santé
languissante ; elle lui demande de lui envoyer régulièrement des nouvelles ;
elle a hâte de la voir revenir à Paris. Est-ce intérêt joué ou sentiment
sincère ? Si la reine est sur le point d'accoucher, elle expédie son écuyer
Rubentel afin de presser madame de Montpensier, pour peu qu'elle se trouve
bien, à venir près d'elle. Au moindre incident, Marie de Médicis paraît
attacher la plus grande importance à tout ce qui la touche. Le feu se
déclare-t-il à Gaillon, elle n'a de cesse qu'elle ne sache ce qui en est. J'ai entendu avec un extrême déplaisir les nouvelles de
l'accident du feu qui vous est arrivé à Gaillon. Quel est le dommage de vos meubles et de vos bâtiments ?
Heureusement que le sinistre est insignifiant et que personne n'a couru le
moindre danger. La sollicitude de la souveraine n'est pas exempte d'un
certain manque de mesure[6]. Ce manque de
mesure on le retrouve dans ses sentiments pour la fille, la précieuse
héritière. Mademoiselle de Montpensier, née en 1605, précisément à Gaillon,
va être bien petite jusqu'en 1617 pour provoquer par ses seules grâces
enfantines la passion enthousiaste que la reine éprouve pour elle. Cette
passion, Marie de Médicis la ressent dès le premier jour. Elle aime tellement
cette enfant qu'elle l'appelle notre fille.
Elle n'écrit jamais une lettre sans demander ce qu'elle devient. Plus tard,
la fille de cette mademoiselle de Montpensier, qui sera elle-même
mademoiselle de Montpensier, le personnage si connu du temps de la Fronde, dira dans ses
Mémoires : La reine Marie de Médicis, ma grand'mère,
témoignoit beaucoup plus de tendresse pour moi qu'elle n'avoit jamais fait
pour ses propres enfants : écho et suite de la tendresse prodiguée à
la mère. Le contrat de mariage avec le duc d'Orléans, le premier duc
d'Orléans, si maladif, si misérable, fut dressé et signé le 44 janvier 1608,
la petite n'ayant que deux ans, mirifique contrat qui énumérait tous les
domaines de l'ancienne famille de Bourbon : le duché de Montpensier, le duché
d'Auvergne, la Combraille,
les Dombes, le Beaujolais, le duché de Saint-Fargeau,etc., sans parler du
reste de la fortune et des espérances. Un mois après, le père, M. de
Montpensier, mourait des suites d'une affreuse blessure reçue à la bataille
de Dreux. Trois ans encore et le duc d'Orléans, le futur mari, s'éteignait !
Mais Marie de Médicis avait de loin prévu cette dernière circonstance et la
même lettre qui annonçait aux oncles, tuteurs de mademoiselle de Montpensier,
le duc de Joyeuse et le duc d'Épernon, la mort du petit prince, contenait une
demande en mariage en règle au profit de Gaston, le troisième fils ! Préparé
depuis si longtemps, ménagé avec un soin si jaloux, ce mariage n'aura lieu
que lorsque mademoiselle Marie de Montpensier atteindra ses vingt un ans, en
1626, triste mariage, la jeune femme devant mourir un an après, en 1627, de
suites de couches[7]
!
Guise, Conti, Montpensier sont tous noms des plus hautes
familles princières de France, apparentées à la famille royale, voisines du
trône. En prenant des amies parmi elles, la reine demeure dans le cercle
ordinaire que l'étiquette lui impose et oîi il est bienséant qu'elle
choisisse ses intimes. Avec madame de la Châtre, le rang est déjà un peu inférieur.
Madame de la Châtre
est une Chabot, fille de ce Guy de Chabot, baron de Jarnac, qu'a illustré son
duel avec la Châtaigneraie. Mariée une première fois au
baron de Givry, comte de Tancarville, et bientôt veuve, elle s'est remariée,
en 1364, à Claude de la
Châtre, baron de la Maisonfort, que la Ligue a fait maréchal et
qu'Henri IV a confirmé. La famille de la Châtre est ancienne et respectable ; elle a
toujours eu place honorable à la
Cour. La maréchale on appelle madame de la Châtre la maréchale n'est plus toute jeune ; c'est une
vieille dame ; mais elle est aimable et bonne, serviable, excellente amie.
Elle n'a jamais goûté madame de Verneuil ; elle s'est même déclarée si
ouvertement contre elle avant la venue de Marie de Médicis en France, qu'à
l'instigation d'Henriette d'Entraigues Henri IV a dû la renvoyer de la Cour. Cette
circonstance n'est probablement pas étrangère à la faveur qu'elle trouve
auprès de la reine[8].
La reine a un fidèle attachement pour elle. M. de la Châtre étant gouverneur
du Berry habite presque généralement Bourges ou son château de la Maisonfort. C'est
à Maisonfort que la maréchale réside, surveillant en bonne ménagère ses
biens, ses bois, son poulailler. Elle est pour Marie de Médicis une de ces
bonnes amies de province avec lesquelles on échange des lettres affectueuses
et des cadeaux : celle qui habite Paris envoyant de riches objets, l'autre
expédiant de succulents produits de sa ferme. Si madame de la Châtre doit venir à Paris
elle ne descendra nulle part ailleurs qu'au Louvre : Je
donnerai ordre, lui mande la reine, que vous
ayez deux chambres dans le Louvre pour être auprès de moi avec plus de
commodité. Mais que de prières pour la décider à faire le voyage ! Il
n'y faut rien tant qu'une circonstance exceptionnelle telle qu'un
accouchement de la reine : Ma maréchale, lui
écrit affectueusement celle-ci, je m'acheminerai
vers Fontainebleau dans douze ou quinze jours pour y faire mes couches et je
fais bien état que vous m'y tiendrez compagnie. Je vous prie de vous y
résoudre et de vous préparer pour cet effet, afin que vous vous y rendiez
incontinent après que je serai arrivé ! Et quelle joie de se
retrouver, l'une, la princesse, heureuse, attentionnée, la seconde simple,
enjouée, affectueuse ! Lorsqu'elles sont loin, toutes occasions leur sont
bonnes pour se rappeler à leur souvenir. Marie de Médicis ne manque pas, à
l'ouverture de la foire de Saint-Germain, d'envoyer en Berry le présent
nécessaire : Je vous envoie votre foire. Au
jour de l'an elle n'oublie jamais sa maréchale.
Le reste de l'année elle paraît préférer l'envoi de pastilles
de senteur. Est-ce chose convenue entre les deux amies ? Les volailles
berrichonnes jouissent-elles en ce temps d'une réputation exceptionnelle ou
celles de la Maisonfort
sont-elles plus particulièrement au goût de la reine ? Madame de la Châtre n'adresse à Marie
de Médicis que des poulettes. Elle en adresse
à dates fixes et çà et là dans le courant de l'année. La reine est enchantée
; elle écrit : Vos poulettes sont si bonnes que je
me ressens engraissée ! Elle les trouve toujours grasses et très bonnes. Des pommes, aussi, des
lévriers, des fruits, madame de la
Châtre expédie les multiples produits de sa terre : c'est
une amitié substantielle[9].
On voit que les maris de ces dames n'ont aucune part à
l'amitié de Marie de Médicis : ils sont trop vieux, trop malades ou trop
sots. Il n'y a, pour ainsi dire, pas d'homme, du reste, dans ce cercle
intime, soit prudence de la part d'une jeune femme toujours l'objet d'une
attention publique éveillée, soit plutôt goût personnel ; à peine aperçoit-on
quelques familiers, peu engagés du reste dans une sympathie mesurée, tel
Bassompierre, ce type du gentilhomme brillant de l'époque, très beau garçon,
élégant, d'un esprit endiablé, parleur, plein d'entrain et de gaieté, hardi
avec les femmes, ne comptant pas les bonnes fortunes, joueur, duelliste,
spadassin émérite et brave comme pas un. S'il était homme qui eût pu
compromettre la reine, c'eût été lui : on n'a jamais rien dit de leurs
rapports. Bassompierre a été introduit dans le cercle royal par Henri IV
auquel il plaisait infiniment en raison de son humeur ardente, emportée et gaie,
en somme très française. Le roi l'aimoit si fort et
prenoit tant de plaisir en sa conversation qu'il le vouloit quasi toujours
avoir auprès de lui. Habile, en même temps que très en dehors, le
courtisan cultivait soigneusement cette amitié. Je
serai toujours paroissien de celui qui sera curé, écrit-il gaiement
dans son Journal, témoignant ainsi de son goût prononcé pour le côté du manche. Il s'y tint fidèlement. Cette
constance, appréciée plus tard par la reine en temps de trouble, lui valut la
sympathie fidèle de la princesse qui le soutient, entre autres, d'une façon
un peu surprenante dans un procès que le beau gentilhomme eut en 1613 devant
le Parlement de Rouen contre la sur de la marquise de Verneuil[10]. Bassompierre,
pour avoir raison de cette jeune personne qu'il aimait, lui avait promis, par
écrit, de l'épouser. Il ne l'épousa pas, et l'autre le cita devant le
Parlement de Normandie. Soit sincère amitié à l'égard du jeune homme, soit
rancune contre une famille dont elle n'avait pas à se louer, la régente exerça
sur les magistrats une pression inimaginable. Elle écrivit au premier
président M. Faucon de Ry, aux cinq présidents, au procureur général, aux
deux avocats généraux et aux vingt-deux conseillers, plusieurs lettres, à
chacun séparément ; elle envoya Marillac à Rouen porter ces lettres avec
charge de joindre des recommandations pressantes de vive voix ; elle ordonna
au maréchal de Fervaques, lieutenant général à Rouen, d'agir avec instance
auprès de chaque magistrat ; un exempt de ses gardes, Montbron, partit même
afin de lui rendre compte de ce qui se passerait et de réclamer auprès du
premier président le huis clos ; mais Bassompierre voulut l'audience
publique. D'autres personnages, l'évêque d'Évreux, furent invités par la
souveraine à joindre leurs instances aux siennes. Lorsque l'affaire fut
appelée au rôle, le procureur syndic des Etats de Normandie, M. de
Brétignières, avocat de Bassompierre, parla avec éloquence. On eût perdu
meilleur procès à moins : mademoiselle d'Entraigues fut déboutée. Je vous assure de ma bonne volonté, avait dit la
reine à Bassompierre, au début : elle avait bien tenu parole[11] !
A côté, et parmi ceux dont la reine s'occupe particulièrement
à titre amical, on trouve surtout des Italiens : un Strozzi, Octavio, lequel j'ai amené avec moi lorsque je vins en ce royaume
et qu'elle confie à M. de Vie, gouverneur de Calais pour qu'il apprenne à porter les armes ; puis qu'elle gratifie du prieuré de Solesmes, au pays du Maine ; des
Rucellaï : ceux-ci habitent surtout l'Italie jusqu'au jour où l'un d'eux
viendra jouer un rôle important auprès d'elle après 1617 ; elle recommande à
son oncle, le grand-duc de Toscane, Domenico Rucellaï, gentilhomme vieil et nécessiteux, même aveugle et chargé
de famille, pour qu'il soit élu à quelque magistrat ou charge en la ville de
Florence : ce sera uvre de charité. L'affection
qu'elle a toujours portée à la maison des Rucellaï la décide à faire
protéger toute la famille à Rome, par l'ambassadeur, M. de Brèves. Mais ceux
de ces Italiens pour lesquels son amitié a été le plus extraordinaire et qui
sont parvenus à remplir de leurs agissements et la vie intime de Marie de
Médicis et l'histoire politique de la régence, on le sait, ce sont les
Concini[12].
Lorsqu'il s'était agi de préparer à Florence la venue de
la princesse Marie de Toscane en France, la cour du grand-duc, qui avait
tâché de mettre dans la suite de la future reine le plus de Florentins
possible, au point que Sillery, l'ambassadeur, trop facilement entraîné,
s'était fait dire sévèrement de Paris qu'il outrepassait ses pouvoirs, avait
placé dans la fonction subalterne de cameriera,
au milieu des demoiselles italiennes de la
reine, la petite compagne fidèle qui depuis dix-sept ans n'avait pas quitté
Marie de Médicis, Léonora Galigaï. Venant dans un pays où elle ne connaissait
personne, dont elle ne pariait pas la langue, il était naturel que la
princesse ne se séparât pas de l'amie de sa jeunesse, confidente de ses
pensées, dévouée, affectueuse, pleine de ressources. Léonora n'avait guère
embelli ; un auteur du temps qui, il est vrai, ne l'aime pas, dépeint sa
personne maigre et son visage sec : cheveux de
Méduse, blonds comme geai, front poli comme une pierre ponce, yeux verts
comme feu, nez d'éléphant, dents en croc, mains de harpie, pieds de homard,
corps grêle comme un buffle, bouche petite comme l'entrée d'un four.
Elle était très brune avec des rides et de petites taches. Mais elle était
plus intelligente que jamais, d'entendement subtil,
dit quelqu'un qui l'a connue[13]. Marie de
Médicis avait avoué à M. d'Alincourt qu'au fond elle ne tenait qu'à elle et
le grand-duc Ferdinand, qui savait la force du lien unissant les deux amies,
projetant de faire de Léonora un instrument utile à sa politique, avait
appuyé le dessein de son voyage en France, expliquant à la petite qu'elle
devait garder la protection de Marie, ménager la princesse, épouser un
Français bien vu d'Henri IV. De fait les instances de Marie de Médicis
jointes à celles du gouvernement florentin avaient été telles que Léonora
s'était trouvée la première et la seule à qui Henri IV eût positivement
permis de venir en France avec la certitude d'une place à obtenir. Les
étrangers trouvaient que Léonora n'était pas très aimable : elle n'est pas flatteuse, jugeait Bassompierre ;
mais la modeste cameriera était encore trop effacée pour qu'on prêtât une
attention quelconque à son insignifiante personnalité[14].
Parmi les Italiens d'espèces diverses qui, à tout hasard,
s'embarquèrent avec Marie de Médicis afin de lui faire escorte jusqu'en
France, quitte à revenir si la fortune ne leur souriait pas, était Concino
Concini. Ce n'était pas, comme on l'a cru et répété, un homme de basse
naissance, quelque fils de menuisier ou de mercier. Il appartenait, au
contraire, à une des familles les plus considérables de l'État florentin. Son
aïeul, Bartolomeo, jurisconsulte distingué, d'abord membre de la rote de
Mantoue, puis ambassadeur auprès de l'empereur Maximilien II dont il avait
habilement obtenu le titre et le diplôme de grand-duc pour son maître, avait
été longtemps premier ministre et confident de Côme I" ; c'était un
homme très intelligent. Le père de Concini, Jean-Baptiste, ne s'était pas
montré moins remarquable : sénateur et auditeur suprême du grand-duc
François, c'est-à-dire grand maître des requêtes de la Toscane, un des plus
hauts postes du pays, il avait, lui aussi, été ministre et ministre de
valeur. Son propre beau-frère lui avait succédé, Belisario Vinta, un politique
de grand mérite : c'était Vinta, l'oncle de Concino, qui était secrétaire
d'État lorsque s'était décidé le mariage de Marie de Médicis. Depuis trois
générations cette famille de Concini menait donc la Toscane. Par des
mariages adroits elle s'était alliée aux bonnes races de Florence et elle
avait casé tous ses parents[15].
L'enfance de Concino et sa jeunesse ne donnèrent pas les
espérances qu'on eût pu attendre d'un descendant de lignée aussi éminente.
Après de médiocres études à l'université de Pise, où il avait appris peu de
chose, pas même l'art de tirer les armes il y fut
toujours fort maladroit et l'avouoit lui-même il devint un jeune
homme libertin et dépensier. En peu de temps il avait mangé sa fortune,
compromis son nom et s'était rendu si impossible à Florence que la société
refusait de le recevoir. Ne sachant plus que faire d'un tel mauvais sujet, la
famille allait se décider à le chasser de la Toscane et lui,
désespéré, parlait, dit-on, de se faire capucin, lorsque le mariage de Marie
de Médicis avec Henri IV donna l'idée à Vinta de se débarrasser de son neveu
en l'expédiant en France : Concino accepta. Le grand-duc Ferdinand sollicité
de présenter le jeune homme au gouvernement français manifesta une vive
répugnance. Il n'avait pas grande sympathie pour le personnage, qu'il
trouvait vantard, bellâtre, faux. L'envoyé florentin à Paris consulté donnait
un avis défavorable. Pour ce garçon dont on ne savait que faire en Italie, la
famille, qui ne doutait de rien, rêvait d'une place de gentilhomme servant
auprès d'Henri IV ! L'envoyé, au courant du caractère de Concino, expliquait
que celui-ci était efféminé, pauvre, avide, ignorant, que les gentilshommes ordinaires sont toujours sur les dents
et bottés ; qu'ils suivent le roi à la chasse et endurent les plus grandes
fatigues ; que la dépense est en outre énorme à la cour et que Concino n'y
serait estimé qu'autant qu'il se montrerait large ; en somme qu'il
était impropre à la fonction. Vinta tint bon. Il gagna à sa cause la
grande-duchesse qui seconda ses efforts. Que ne
puis-je excuser madame la grande-duchesse et Vinta, écrira plus tard
le grand-duc à Concini, de m'avoir fait consentir à
vous laisser passer en France, car ce n'a été que malgré moi : je connoissois
votre génie ! Ferdinand céda. Henri IV, qui ignorait ce qu'était
l'individu, Vinta, d'ailleurs, lui faisait un grand éloge du jeune homme
qu'il disait plein de qualités avait
répondu évasivement, ne promettant rien et ne refusant rien. Le départ de
Concini fut résolu[16].
Concini a des imperfections, mais
il n'est pas sot, disait Bassompierre. Le futur maréchal d'Ancre était
évidemment très intelligent, mais d'une intelligence agitée et inégale. Assez
bien de sa personne, une figure anguleuse, front large et haut, nez busqué,
légères moustaches élégamment retroussées, des yeux grands, surmontés de
sourcils arqués, lèvres régulières ; il avait une jolie figure qu'altérera
plus tard l'inquiétude permanente et l'irritation perpétuelle. C'était un
nerveux, un nerveux presque maladif, ardent, sec, volontaire, irritable.
Extrêmement aimable, d'ailleurs, en temps ordinaire, facile, plein de
bienveillance et de dévouement, disposé immédiatement à rendre service et de
formes affectueuses, il parviendra, par ses qualités, à se faire plus tard
une clientèle nombreuse, de même que ses colères constantes, à propos d'un
moindre détail qui n'est pas à son gré et il voyait ce moindre détail
finira par lui donner une manière d'autorité pressante et redoutée. En
apparence c'était un Italien bavard, léger, vain, intrigant ; Ferdinand lui
reprochera de ne parler à Marie de Médicis que de
bruits, de nouvelles, de bagatelles indignes de son rang, et, par là, de l'empêcher
de paroître prudente et réfléchie ; au fond, sous le méridional
tapageur, occupé de ses toilettes recherchées, se vantant constamment et
inconsidéré, se cachait une nature rusée, ambitieuse, souple, cynique et
avide. Son caractère est complexe ; la somme des défauts antipathiques est
supérieure aux qualités. De penser que, tout compte fait, cet homme n'a
cherché dans sa brillante carrière politique que le moyen d'amasser beaucoup
d'argent afin de se retirer fortune faite, et qu'il a pris cet argent par les
procédés les plus divers, avouables ou non, suffit à le classer dans la catégorie
des grands aventuriers[17].
Son départ pour la France, dans la suite qui accompagnait Marie de
Médicis, décidé, il se fit présenter à la reine par le diplomate Baccio
Giovannini, un ancien palefrenier de la maison de Concini, si remarquablement
doué que le père et le grand-père de Concino, devinant sa valeur, l'avaient
poussé et fait arriver. En homme prudent et bien au courant, Baccio présenta
aussi Concino à Léonora. Naturellement, le jeune homme, dont l'avenir était
encore incertain, déploya toutes ses grâces, cherchant à se faire bien venir,
multipliant les attentions, les flatteries, les amabilités. Sur Marie de
Médicis, qui fît à peine attention à lui, il ne produisit aucun effet. Il
n'en fut pas de même de la petite Léonora, qui, quoique intelligente, fut
étourdie par ce beau et brillant garçon. Elle l'aima. L'autre, pas assez
simple pour ne pas s'apercevoir de l'émotion qu'il causait, redoubla de
soins. A-t-il jamais éprouvé pour elle le moindre attachement ? La réponse ne
paraît pas douteuse. Il faisoit l'amour à Léonora,
écrit la princesse de Conti ; je ne dis pas qu'il en
fut amoureux (elle) estant telle qu'elle ne pouvoit estre seulement regardée
! Il ne s'arrêta pas à sa laideur ; il ne songea pas à son origine
inférieure par rapport à la sienne ; il ne vit que l'intérêt qu'il pouvait
retirer de cette aventure heureuse et il poussa aussi loin qu'il put. La
longueur du voyage en France et les interminables heures de la traversée
permettaient les conversations propices ; il mena si bien ses affaires, qu'à
Avignon les deux jeunes gens se promettaient de s'épouser. Marie de Médicis,
hésitante, laissa faire. A l'égard de Léonora, d'ailleurs, Concini n'était-il
pas un beau parti ? quelle objection la reine aurait-elle pu invoquer ? Elle
était trop jeune et pas assez expérimentée pour tirer argument de
l'inconduite du jeune homme et Léonora était assez intelligente pour savoir
ce qu'elle avait à faire. En réalité Léonora était folle de son fiancé ; puis
celui-ci lui donnait des conseils sur la façon future de prendre le roi, de
traiter habilement les ministres ; et l'Italienne devinait en lui un homme
adroit, susceptible de l'aider dans la fortune qu'elle rêvait, elle aussi, de
faire : cur et intérêt, tout se trouva d'accord. Elle l'aima tellement
qu'elle manqua se compromettre et faire crier au scandale. A Lyon, Concini
étant tombé malade, elle prétendit aller dans sa maison pour le soigner :
tout le monde jasa. Devant le public, se considérant comme fiancés, les deux
jeunes gens avaient ensuite des privautés telles qu'Henri IV, déjà excédé des
bruits qui étaient parvenus à ses oreilles, se mit en colère et fit dire à
Concini de s'en aller, ou plutôt d'épouser d'abord Léonora, puis de l'emmener
avec lui en Italie, à moins que Léonora ne consentît à épouser un Français.
C'était le premier orage. Les deux amoureux effrayés se firent petits.
Léonora avait demandé la place, auprès de la reine, de dame d'atour. A Paris
Henri IV déclara brusquement qu'il ne voulait pas de Léonora comme dame
d'atour ; il nomma la comtesse de l'Isle, et il fit signifier à l'Italienne
qu'il allait lui donner de l'argent, qu'elle eût à épouser Concini et à
partir avec lui sur-le-champ. La partie était-elle donc perdue au moment même
où le couple comptait entrer en jeu ? Un coup audacieux de leur imagination
fertile les sauva[18].
Léonora alla trouver la marquise de Verneuil. Elle lui
expliqua que la reine était très mal disposée contre elle en effet, à ce
moment, l'attitude de Marie de Médicis à l'égard de la maîtresse ne laissait
pas de doute sur ses sentiments, qu'il pouvait en résulter pour Henriette
de graves ennuis, mais qu'elle, Léonora, ayant une très grande influence sur
la princesse, se faisait fort de modifier ces dispositions ; elle offrait à
la marquise un marché : elle, l'Italienne, défendrait madame de Verneuil
auprès de la reine et changerait les idées de sa maîtresse ; en retour la
marquise obtiendrait du roi la nomination de Léonora comme dame d'atour,
l'autorisation de son mariage avec Concino, et la permission pour eux deux de
demeurer en France. Henriette d'Entraigues accepta. Le pis est que tout
réussit à merveille, ainsi que l'astucieuse cameriera l'avait combiné. Marie
de Médicis, un temps, parut faire quelque accueil moins froid à la marquise ;
Henri IV sollicité par madame de Verneuil et par sa femme, céda. Les gens au
courant étaient indignés, ils trouvaient le roi d'une faiblesse extrême
mais on sait que toutes les fois que l'intérêt d'une maîtresse était en jeu,
la claire intelligence du prince vacillait ; ils estimaient Marie de
Médicis au moins étrange, sinon inconséquente, en tout cas légère, douée de
peu de jugement et de volonté. Quant aux autres, leur conduite n'inspirait
que le mépris. Giovannini, en ce moment envoyé du grand-duc à Paris, et
d'ailleurs fort revenu sur le compte de Concini, écrivait à Vinta, son ministre,
qu'Éléonora Galigaï était vendue à madame de
Verneuil, et que, le voulût-on de Florence, on aurait de la peine maintenant
à rappeler le couple en Toscane[19].
Léonora fut nommée dame d'atour. Son mariage avec Concini
eut lieu à Saint-Germain, cette année 1601, dans la plus stricte intimité, et
le ménage de ceux qu'on appelait : le sieur Conchino
et madame Conchino, s'installa. La première chose qu'ils firent fut de
faire partir un à un les Italiens leurs compatriotes : gens gênants, qui les
connaissaient trop pour ne pas les mésestimer ; qui étant ensuite aussi
ambitieux qu'eux ne pouvaient voir que d'un mauvais il leur succès et
chercher à les contrecarrer ; qui enfin passaient leur temps à les dénoncer à
Florence. Grâce à de perfides rapports, ils eurent tôt fait de leur rendre la
vie impossible. Le grand-duc, fatigué des plaintes, des intrigues, des
disputes auxquels ces incidents donnaient lieu, écrivait à Concini des
reproches acerbes : Vous voulez expulser tous les
Italiens qui vous font ombrage ; vous inspirez de la méfiance contre eux par
vos trames ; vous avez chassé de France plusieurs personnes sans fortune et
qui estoient venus sous les auspices de la reine pour s'attacher sincèrement
à son service ! Mais Concini n'avait cure de ces remontrances : il
savait la force du lien qui retenait Marie de Médicis à Léonora et il allait
user de ses avantages avec une brusquerie imprudente, dangereuse, téméraire,
mais qui devait, heureuse fortune ! lui réussir[20].
Comme dame d'atour Léonora Galigaï avait droit à un
appartement au Louvre ; elle eut trois pièces au second étage, au-dessus de
l'appartement de la reine, une des meilleures situations du palais. Petit à
petit, l'argent arrivant, elle les meubla magnifiquement.
L'antichambre et la chambre à coucher étaient tendues de
belles tapisseries représentant les histoires de Lucrèce, de Jacob, de David,
de saint Paul, toutes uvres de choix valant de 1 800 à 2.000 écus. Le lit à
colonne était garni de broderies à petit point d'or
et de soie. Les chaises et chaises à bras
ou fauteuils étaient recouverts de velours cramoisi
avec des bandes de toile d'or. Contre les murs se dressaient de grands
cabinets de bois d'Inde ou cabinets d'Allemagne, des miroirs de bois de rose
ou d'ébène ; partout c'étaient des tapis de pied d'Orient, aux tons et aux
genres variés ; sur les tables, des tapis de prix : en
soie, façon de la Chine
de plusieurs couleurs, en velours plein
violet cramoisi, passementé d'un passement d'or, en velours jaune à fond d'argent. Sur des coussins,
ou oreillers de velours violet en broderie d'or,
et çà et là s'étalaient une profusion de riches étoffes : velours feuille morte bandé de passement d'or et d'argent,
toile d'argent en broderie d'or et d'argent avec
une bande à l'entour de velours tanné cramoisi aussi brodé d'or et d'argent,
étoffes de fleurance à bouquets, à fond tanné et
fleurs de lys jaune. On ne voyait que courtepointes brillantes de velours bleu aussi à fond d'argent doublé de taffetas
bleu ; couvertures rouges doublées de peluche
feuille morte. Vingt coffres alignés dans les dégagements contenaient
ce qui n'avait pu être étendu ainsi que de somptueuses garnitures de lit
destinées à changer souvent celles qui étaient en place : pantes,
cantonnières, fonds de ciel, soubassements, impériales, s'entassant dans les
garde-robes. Les bibelots et objets d'or et d'argent ne se comptaient pas :
chandeliers d'or, petits paniers et corbeilles d'argent, calices d'agate
garni d'argent doré, coquetiers d'argent doré, croix, reliquaires, bénitiers,
aiguières d'or et d'argent, vases de vermeil, assiettes d'or. A l'arrestation
de Léonora, en 1617, la maréchale d'Ancre estimait posséder de 15 à 16.000
écus d'objets d'or et d'argent[21].
Non moins fastueuse pour ses vêtements que pour son
mobilier, Léonora aura tout ce qui est nécessaire à une élégante richement
pourvue. Son linger, Jehan de Wolf, lui livrait un jour 77 aunes de toile de
Hollande à 4 livres
10 sous Faune, pour faire des draps ; deux douzaines de chemises à cent sols
pièce, deux autres douzaines à 6 livres pièce, d'autres à 12 livres ; plus 12
coiffes à passement, de 30 sols pièce. Lorsque après son incarcération on fit
l'inventaire des coffres qui contenaient ses costumes, on trouva : 14 robes,
9 manteaux, 13 jupes, 4 vestes, 3 cimarres, 2 pourpoints, 2 mantelets ; ce
n'était pas tout, la maréchale ayant encore d'autres installations que le
Louvre où ses vêtements étaient dispersés. Et quel luxe de toilettes : en satin cramoisi semé de perles et de diamants ;
en toile d'argent ; en soie brodé d'or et d'argent fourré
de panne grise ; en satin blanc, bleu, jaune, noir, toutes les
couleurs ; en gaze à fleurs d'or et d'argent[22] !
Mais prudente et avisée, au milieu de cette abondance de
richesses un peu tapageuses, Léonora vivait retirée. Elle quittait son
appartement aussi peu que possible. Soit qu'elle dédaignât les fêtes, soit
qu'elle voulût éviter de se montrer en public, étant donnée sa faveur peu à
peu trop connue et provoquant des envies, elle ne paraissait pas aux
assemblées. Nous verrons tout à l'heure qu'une raison, meilleure encore,
l'empêchait de se produire. Autant que possible elle n'aimait pas non plus
recevoir. Elle se dissimulait si bien que le parfumeur de la reine, souvent au
Louvre, pourra dire en 1617 qu'il ne l'a pas rencontrée depuis quatre ans !
Il en résulta qu'elle n'apprit jamais les usages de la cour de France. Elle ne savoit pas son monde, dit Tallemant, elle ne
savoit point vivre à la mode de la Cour.
Si elle sortait, elle
sortait en carrosse, ayant soin de suivre l'habitude des femmes de qualité du
temps qui était de se masquer. Elle avait un superbe carrosse garni de
velours rouge cramoisi brodé d'or avec impériale également de velours brodé
et, pour l'attelage, des caparassons de chevaux de velours rouge
cramoisi en broderie d'or et d'argent. Tous les jours elle
descendait voir Marie de Médicis, aux heures où elle savait la trouver seule,
le plus souvent tard, le soir, au moment du coucher. Elles causaient entre
elles, parfois du sujet qui eût dû nécessiter les entrevues régulières de la
souveraine et de la dame d'atour, les toilettes ; principalement de tout et
de chacun, surtout d'affaires et de choses d'Etat. La maladie, qui la prit de
bonne heure, commença par rendre les visites en bas moins fréquentes. D'abord
Léonora ne descendit que trois ou quatre fois par semaine, puis elle ne
descendit plus et Marie de Médicis dut monter elle-même dans le petit
appartement de la dame d'atour ; elle montait deux fois par semaine. Que
faisait donc Léonora la journée entière dans ces pièces qu'elle ne quittait
pas et à quoi employait-elle ses longs loisirs[23] ?
Elle y vivait en vieille femme dévote et maniaque. Servie
seulement par deux domestiques, la femme du maître d'hôtel de Concini, Marie
Brille, qui lui apprêtoit son manger et faisoit son
bouillon, puis une Italienne, Marcelle, qui s'occupait de sa chambre,
elle les faisait enrager toutes deux, étant prompte,
difficile à servir et d'humeur fâcheuse. Le matin elle allait à la
messe, et visitait les églises. Elle se confessait et communiait souvent,
ayant pour directeur un carme déchaussé nommé le P. César. Rentrée chez elle,
elle se faisait lire la Bible
ou s'occupait à enfiler des perles, des chapelets,
telles autres choses ; à prendre des bagues, à les manier, les
retourner. Après quoi, elle jouait du guitaron et chantait en s'accompagnant
de l'instrument : elle adorait la musique. Enfin elle s'occupait d'augmenter
et de développer ses biens[24].
Un instant elle avait eu l'idée d'avoir des terres et des
maisons. Mais son arrière-pensée étant de quitter un jour la France, elle se décida à
ne posséder strictement que maison de ville et maison des champs. Nous ne
parlons pas de la petite demeure qu'elle se fit octroyer, ou plutôt qu'elle
fit donner à Concini au coin de la rue d'Autriche la rue dans laquelle se
trouvait la porte du Louvre et le quai, modeste habitation prise sur le
petit jardin du palais. Concini n'avait pas le droit de coucher au Louvre,
l'appartement du second ne servant qu'à la dame d'atour ; le mari pouvait
venir voir sa femme, mais il ne devait pas résider chez elle : afin qu'il
n'eut pas trop à s'éloigner, Léonora lui avait fait avoir ce pied-à-terre que
gardait le concierge Fabien Cosme, un Italien[25].
A Paris, pour posséder un logis à elle, en dehors du
Louvre, elle loua à M. de Liancourt un hôtel situé rue de Tournon et appelé
l'hôtel de Picquigny, puis elle l'acheta 14.000 écus. Prise, ensuite, de la
fantaisie de construire, elle jeta bas la maison et chargea l'architecte et
sculpteur italien Francesco Bordoni de lui bâtir une belle demeure. Nous
n'avons pas de renseignements sur cet édifice. Nous savons qu'il contenait
une chapelle et que les pièces étaient parées de riches peintures ou de
sculptures. Elle n'y faisait pas de longs séjours ; quand la reine n'était
pas à Paris elle y venait passer une semaine. Mais c'était là qu'elle offrait
à la souveraine ses dîners, ses concerts, là qu'elle mettait les objets
précieux qu'elle ne pouvait garder au Louvre, là qu'elle avait son
coffre-fort. En 1616, à la suite de l'arrestation du prince de Condé, qu'on
attribuait à Concini, les domestiques du prince, lequel habitait tout auprès,
rue Neuve-Saint-Lambert, s'attroupant furieux devant l'hôtel jetèrent des
pierres dans les vitres, puis s'excitant, ameutant la foule, envahirent la
maison afin de la piller, enfoncèrent les portes au moyen de poutres
empruntées aux chantiers du Luxembourg-, alors en construction, et
saccagèrent ce logis où il y avait plus de deux cent
mille écus de meubles ; ils allaient même le démolir lorsque quelques
compagnies de gardes françaises arrivant opportunément arrêtèrent le désordre[26].
Léonora acheta à la campagne le domaine et le château de
Lésigny au baron de Lésigny et à sa sur madame de Réaux : prix de la terre
et dépenses de construction, il lui en coûta plus de 100.000 écus. Elle
devait encore moins jouir de cette terre que de l'hôtel de la rue de Tournon,
sa charge la retenant trop étroitement à Paris. Elle négocia encore, mais sans
y donner suite, l'acquisition de la terre de Chevry ; elle eut des
pourparlers à propos de Luzarches et une histoire de deux maisons à Bordeaux[27].
Afin de conduire ces différentes affaires et surtout ses
entreprises financières autrement compliquées et nombreuses nous allons le
voir dans un instant il lui fallait un personnel. Autour d'elle gravitait
un petit groupe de confidents, d'hommes de confiance retors qui lui rendaient
les plus grands services. Son secrétaire d'abord. Elle en avait eu un pour
commencer, insignifiant, M. Lecomte ; elle eut ensuite Raphaël Corbinelli,
homme adroit, discret, rompu aux questions d'argent, qui, venu en France de
bonne heure, en 1597, à quinze ans, avait été attaché à M. d'Attichy,
intendant de Marie de Médicis, était passé après à Léonora et redeviendra
secrétaire de la reine lorsque l'arrestation de la maréchale d'Ancre le
laissera sans place. Puis, Louis Dolé, l'avocat général de Marie de Médicis,
très influent auprès de la souveraine et des ministres, intelligent,
remarquablement entendu en tous problèmes de procédure. Il y a des raisons de
croire, si beaucoup de dessous de l'histoire n'échappaient pas aux
investigations les plus minutieuses, que Dolé a joué en ce temps un rôle
assurément plus important que les documents ne permettent de l'établir et
qu'il n'a pas été étranger à l'étonnante fortune politique de Concini par ses
négociations dissimulées, son jeu souple et double. C'était un homme
d'expérience et très fort. Mais celui qui a joui auprès de Léonora de la
confiance la plus absolue, celui dont elle était férue et qui a exercé sur
elle l'influence la plus déterminante, c'est un petit abbé italien joueur de
lyre ou de guitaron que son talent musical avait désigné à l'attention de la
dame d'atour, André de Lizza, abbé de Livry[28].
Né dans le royaume de Naples vers 1579, André de Lizza
était venu en France avec le cardinal du Perron, au service duquel il était
demeuré six ans comme aumônier. Après ce temps, il se préparait à retourner
en Italie, quand il fut recommandé fortuitement à Léonora à l'occasion d'une
soirée que donnait celle-ci rue de Tournon et où il joua. Léonora fut si
enthousiasmée de son jeu et de sa voix, qu'elle résolut de le garder près
d'elle. Afin de le retenir en France, elle dut faire agir la reine qui
insista, même commanda au jeune abbé de rester, et, sur une objection de
celui-ci, écrivit au cardinal du Perron pour lui demander la permission de
prendre son protégé. Finalement André fut attaché à la dame d'atour en
qualité d'aumônier. On lui donna l'abbaye de Livry, on le fit abbé de
Hautefontaine, en Champagne. Il disait la messe tous les matins, puis passait
de longues, de très longues heures seul avec Léonora, quatre, cinq heures de
suite, disaient les domestiques ; lui-même interrogé avouera qu'il demeurait
en effet enfermé dans la chambre de la future
maréchale jusqu'à onze heures et minuit le soir. Que faisaient-ils
ensemble ? Il faut écarter tout soupçon injurieux. L'idée n'en est venue à
personne, pas plus que personne n'a porté la moindre accusation au sujet de
la conduite de Léonora Galigaï, en général. Les juges de la marquise d'Ancre
questionnant l'abbé de Livry sur le sujet de leurs interminables conférences,
André répondra que leurs discours étaient des
affaires domestiques de la maréchale, du ménage de sa maison, de son argent,
de son bâtiment de Lésigny, dont lui, André, avait la charge ; et qu'ils
discouroient quelquefois de l'Italie où elle disoit qu'elle se vouloit
retirer. Il est certain que, pleine de confiance à son égard, Léonora
le consultait sur ses affaires, ses placements, le gouvernement de son monde.
Mais il est certain aussi qu'il avait acquis une telle influence, un tel pouvoir
sur elle, qu'il la séquestrait pour ainsi dire. On lui avait donné comme
logement un petit appartement dans la maison de Concini, sur le quai ; il venoit tous les jours, soir et matin, en la chambre de
ladite maréchale et ne se retiroit la nuit que lorsque l'on vouloit fermer
les portes du Louvre. Le personnel et les amis finissaient par ne plus
pouvoir être reçus sans sa permission, et ceux qui
hantoient en ladite maison murmuroient grandement. Il devint
tout-puissant ; il était l'objet de sollicitations ; des gens qui avoient affaire de la faveur de ladite maréchale s'adressoient
à lui. Le médecin Alvarez, indigné, assurait même que Concini, le
mari, avait dû lui escrire (à André) pour
obtenir ce qu'il désiroit de sa femme ! André était si bien parvenu à
éconduire tout le monde, qu'il s'était vu obligé, en dernière analyse, de
faire le métier des domestiques qu'il avait écartés : Sur la fin, il servoit à la maréchale de secrétaire, de maître d'hôtel,
de cuisinier, de toutes sortes d'officiers pour ce qu'elle les avait tous
chassés. Or, au dire il est vrai de ces domestiques, André était un
personnage plus que singulier. Quoique ecclésiastique, il se montrait esprit
fort ; il se moquait des cérémonies religieuses ; il tournait en ridicule les
jeûnes, les carêmes ; il aimait à aller dans les cuisines plaisanter avec les
valets et les filles, dire des histoires crues et
parler fort licencieusement. Un des familiers de Concini déclare qu'il
produisait l'impression d'un personnage vicieux.
C'est André de Lizza, l'homme le mieux au courant des faits et gestes de
Léonora Galigaï, qui nous renseignera le plus exactement grâce aux réponses
qu'il fit aux juges en 1617 sur la nature et le degré de l'influence dont
jouissait la maréchale auprès de Marie de Médicis[29].
Cette influence fut extraordinaire. L'histoire s'est
toujours demandé à quoi elle était due et elle répète un mot prêté à Léonora
dans son procès, pour l'expliquer, mot méprisant d'âme basse et ingrate : J'ai eu le pouvoir qu'a une habile femme sur une balourde
! Ce mot n'a jamais été prononcé ! A la question posée, Léonora a réellement
répondu : J'ai eu l'honneur d'être aimée de la reine
pour l'avoir suivie dès sa jeunesse ; j'ai acquis sa bienveillance en la bien
servant, comme j'ai fait, en me rendant très diligente à la suivre et faire
ce qui estoit de sa volonté. André de Lizza confirmait cette
explication : Enquis s'il sait d'où procédoit le
grand pouvoir que ladite maréchale avoit sur ladite dame reine et s'il n'a
point connu ou ouï dire qu'elle eût usé de sortilèges ou de quelques façons
extraordinaires pour posséder l'esprit et la volonté de ladite dame reine
mère, a répondu qu'il ne s'est jamais aperçu et n'a ouï dire qu'elle eût usé
d'aucuns sortilèges, et croit que cela procédoit de la grande et longue
familiarité qu'elle a eue avec ladite dame reine mère dès sa jeunesse et du
grand soin qu'elle a eu d'elle. Mais il ajoutait : La maréchale a un esprit qui a beaucoup de pouvoir sur les
esprits faibles : et c'est cette phrase qui a donné lieu au mot
légendaire, l'expression balourde provenant
d'un bruit qui courut alors que Léonora l'employait couramment lorsqu'elle
parlait de Marie de Médicis[30]. Pour tous ceux
qui approchaient Léonora, la raison d'être de l'influence de la maréchale
était la même. Je crois, déclarait le
secrétaire de Concini, Vincent Ludovisi, que le
grand pouvoir que la maréchale a sur la reine mère procède de la longue
créance et grande familiarité que ladite maréchale a eue dès l'âge de dix ou
douze ans avec ladite dame reine. Amitié d'enfance, adroitement entretenue
par un dévouement sans borne, un zèle de tous les instants et une obéissance
passive ; affection émue, simulée ou non ; gaieté surtout, rendant les
longues causeries agréables et nécessaires : Léonora était parvenue à créer
entre elle et la reine un de ces accords qu'une longue habitude rend
indestructible. Elle a été pour Marie de Médicis comme une ancienne
domestique de confiance qui, à force de demi-familiarité, finit par faire
partie de la famille ; à laquelle une vieille dame tient par-dessus tout et
dont elle ne se sépare jamais, qui peut même provoquer des brouilles et des
séparations de parents sans être menacée ni autrement compromise.
L'aveuglement de Marie de Médicis à l'égard de Léonora fut
entier. Quoi que celle-ci fît et dît, la reine ne voyait que par ses yeux et
n'agissait que dans son intérêt, donnant, à ceux qui étaient en mesure d'en
juger, une impression fâcheuse d'imprudence, de légèreté d'esprit, d'absence
de fermeté et de consistance. Le grand-duc de Toscane qui avait bâti de si
beaux projets sur le mariage de sa nièce et rêvé de combinaisons politiques à
réaliser dans cette alliance, constatant que la reine de France lui échappait
sur les conseils de l'égoïste créature qu'était l'ingrate cameriera, écrivait à Marie avec une vivacité
pleine de dépit, non exempte d'un sentiment de bourgeoise et un peu ridicule
déception : Jusqu'ici vous n'avez paru vous
intéresser qu'à la seule Léonora, comme si la fortune de cette femme de néant
avoit été l'unique but de cette alliance cimentée au milieu des plus grands
dangers, le fruit de tous mes travaux et que j'ai payée si cher de ma bourse
! Je pouvois vous faire duchesse de Bragance et vous reléguer dans un coin
obscur du Portugal. J'ai sacrifié une partie de mes trésors sans penser à mes
huit enfants ; et maintenant votre indolence et votre ingratitude ont changé
tout en France, pour moi, au moment où j'espérois recueillir le fruit de mes
sacrifices ![31]
Connaissant mieux que personne l'influence réelle qu'elle
possédait sur la reine, Léonora s'appliqua, avec une insistance singulière, à
affirmer autour d'elle la réalité de ce pouvoir, comme si celui-ci devait
grandir de l'opinion que le public était invité à s'en faire. Le médecin
Alvarez était frappé de l'entendre répéter en sa
présence et en la présence de quelques femmes de la royne mère que personne n'avoit
tant de pouvoir sur ladite dame royne qu'elle. M. Chalange, secrétaire
du roi, disait : Madame Conchine a voulu que l'on
sût qu'elle avoit tout crédit et qu'elle avoit de l'avantage pour obtenir
tout ce qu'elle vouloit de la royne. Peu à peu, en effet, le monde fut
convaincu qu'elle était l'influence prépondérante, la seule efficace, et
chacun lui fit la cour. Quiconque vouloit obtenir de
la royne mère quelque chose, affirmait son écuyer Desdiguières, il falloit qu'il s'adressât à elle. Pendant les trois
premières années de la régence elle fut visitée par toutes sortes de
personnes, princes, princesses, officiers du conseil et des cours souveraines.
On s'adressoit à la maréchale pour obtenir des
bénéfices et charges, confirme de son côté Ludovisi, et quiconque obtenoit
quelque grâce de la royne mère venoit remercier la maréchale. Louis
XIII ne semblait-il pas reconnaître lui-même l'influence de la dame d'atour
lorsque sollicité par sa nourrice d'intervenir auprès de la reine régente
afin d'obtenir la vie d'une malheureuse femme condamnée à mort sur des
conjectures, il répondait : Dites à la marquise
d'Ancre, Doundoun, qu'elle dispose la roine, ma mère, à lui donner sa grâce
? et il avait bien l'occasion de connaître cette toute-puissance quand Léonora,
gênée par le bruit qu'il faisait au-dessus d'elle en quelque jeu bruyant,
l'envoyait prier de cesser, au dire, il est vrai suspect, de Saint-Simon[32] !
Les juges, plus tard, voulurent connaître exactement la
portée de cette influence. Ils demandèrent à André de Lizza s'il ne savait
pas que toutes les affaires concernant l'État,
distributions des charges, dons et pensions, se fissent par l'avis et conseil
de ladite maréchale. André répondit que oui
et que l'on apportoit à Léonora Testât des pensions et que la dame royne ne
faisoit, ni disposoit d'aucuns dons et gratifications sans l'avis de ladite
maréchale. D'après l'abbé de Livry, la liste était longue de ceux qui
devaient leurs places à l'intervention de Léonora ; rien que dans les maisons
des souverains c'étaient : l'écuyer, M. de Mauny, le maître d'hôtel, M. d'Hocquincourt,
l'intendant, M. Feydeau, le secrétaire, M. Aimeras, les contrôleurs
Corbinelli, Francini et Zoccoli et, enfin, le plus illustre de tous, le grand
aumônier d'Anne d'Autriche, Armand Jehan du Plessis
de Richelieu, lequel ne se vante pas dans ses Mémoires de cette
compromettante protection. La duchesse de Bar en arrivait à écrire à Léonora
pour faire entrer quelqu'un dans le personnel de la reine. Lorsqu'il fut
question de monter la maison du duc d'Orléans, le petit frère du roi,
immédiatement l'évêque d'Angers, les présidents Miron, Chevalier et
Jambeville s'empressèrent de s'adresser à Léonora afin d'obtenir l'office de
chancelier de Monsieur, tellement ils
semblaient bien informés de la porte à laquelle il était utile premièrement
d'aller frapper. La dame d'atour déclara elle-même au médecin Alvarez, à
l'arrivée d'Anne d'Autriche en France, qu'elle s'était fait donner la mission
de constituer toutes les charges de la maison de la nouvelle princesse et de
les attribuer[33].
Si l'action de Léonora s'exerçait ainsi d'une façon
décisive dans des détails de nomination, que devait-elle être en ce qui
concernait la politique elle-même, les affaires de l'État, les changements de
ministère ? Sur ce point les réponses d'André de Lizza ne furent pas moins
explicites.
C'est Léonora, d'après lui, qui eut la part prépondérante
dans les négociations préliminaires de la paix de Loudun. Elle était informée
de tout ce qui se passait par Dolé et transmettait ses manières de voir au
moyen du secrétaire de Concini, Ludovisi : Il ne se
résolvoit rien, dit l'abbé de Livry, que par
son avis et elle se servoit du sieur Vincent (Ludovisi) secrétaire du maréchal qui
portoit ses avis et paroles de bouche à la dame royne mère[34]. Les ministres
ne pouvaient rien contre cette influence occulte ; quand ils protestaient ou
résistaient, leur disgrâce ne se faisait pas attendre : Sillery et Villeroy
l'apprirent à leurs dépens. Après avoir répété souvent à André qu'elle vouloit changer les principaux ministres et
officiers de l'Etat pour mettre à leur place des gens de bien, se plaignant
de M. le chancelier, de M. le commandeur (de
Sillery), de son frère et de M. de Villeroy,
qu'ils n'étoient pas de ses amis et qu'ils n'étoient pas bons serviteurs de
la dame royne mère, particulièrement mondit sieur de Villeroy, Léonora
finit par les faire chasser. Ceux qui les remplacèrent furent ses créatures :
Barbin, qu'elle avait poussé et fait nommer successivement intendant et contrôleur
; Mangot, Richelieu, Du Vair, tous du reste excellemment choisis et gens
remarquables, honorables, peut-être un peu contrariés au fond d'arriver au
pouvoir grâce à une influence aussi fâcheuse. Elle écrivit deux fois à Du
Vair, président au parlement d'Aix, pour lui offrir les sceaux, et André
ajoutait le bien savoir puisque c'était lui qui avait écrit les deux lettres
en question sous la dictée de Léonora ; elle lui envoya un homme de
confiance de Barbin afin de le décider. Eh bien, que
dit-on ? répétait-elle, les nominations faites, vous verrez que le conseil du roi ira beaucoup mieux
depuis l'établissement de nos nouveaux ministres ! Elle ne craignait
pas de révéler devant son écuyer, qui confirme ainsi le témoignage d'André de
Lizza, qu'elle avoit établi les ministres.
Pour un d'entre eux, au moins, le vénérable et honnête Du Vair, elle devait
s'en repentir, car elle avouait à quelque temps de là : Vous voyez la peine que j'ai eue à l'établir, et cependant
je ne saurois tirer de lui aucune courtoisie ; il est grandement
méconnoissant du bien qu'il a reçu de moi. Les autres furent plus
maniables. Elle fut seule à effectuer ces changements ministériels, sans la
moindre participation de Concini. Les témoignages des personnages les mieux
placés pour le savoir sont formels et concordants. André de Lizza affirme que
Léonora agit dans cette circonstance de son propre
mouvement et autorité ; qu'elle n'en écrivit rien au maréchal son mari
et que celui-ci ne fut pas au courant. André devait être informé puisqu'il lisoit, ajoutait-il, toutes
les lettres que Léonora recevoit dudit maréchal et escrivoit celles qu'elle
lui mandoit. De son côté le secrétaire de Concini interrogé sur le
même point répondait : que tout cela s'étoit fait
par le vouloir de la maréchale d'Ancre et non dudit maréchal[35] et que ladite maréchale ne voulut pas que son mari en sût
rien ! Elle était bien omnipotente. L'aventure qui arriva à M. Antoine
Allory, bourgeois demeurant rue Saint-André des Arcs,
montrera mieux que tout autre témoignage la situation exacte de Léonora
Galigaï dans l'Etat par rapport à Marie de Médicis, aux ministres et aux
particuliers. En octobre 1613 un M. Antoine Allory, seigneur de la Bornerie, s'était rendu
adjudicataire du bail des cinq grosses fermes du royaume ; le bail avait été
régulièrement adjugé au Louvre, en plein conseil du roi, présidé par la
reine, laquelle à l'extinction de la chandelle
avait, de sa propre bouche, attribué le bail en question à Allory pour 886.000 livres
devant un nombreux public. Le lendemain matin M. Allory arrivait au Louvre
accompagné de ses associés et cautions dont il avait donné les noms la veille
au président Jeannin, contrôleur général des finances, afin de signer le bail
au conseil des finances qui se tenait ce jour-là samedi, quand le président
Jeannin lui fit dire que le conseil n'aurait pas lieu, que le roi partait
pour Fontainebleau et que les ministres suivaient Sa Majesté. Le fermier se
rendit à Fontainebleau et là le contrôleur des finances un peu embarrassé
finit par lui avouer qu'il avoit pitié de lui, qu'on
vouloit de force lui oster l'adjudication du bail et que la reine mère
vouloit en faire gratifier un homme que la marquise d'Ancre lui avoit
présenté. Le chancelier, qu'Allory très surpris alla voir aussitôt,
s'écria en l'apercevant : Ah ! monsieur de la Bornerie, mon ami, je
vois bien qu'on veut vous traiter mal et vous oster ce que nous vous avons
adjugé. Mais il ne faut pas vous laisser faire ; il faut parler à la reine et
employer vos amis ! Très contrarié, l'adjudicataire s'entendit avec M.
de Guise afin de se faire présenter à Marie de Médicis, et, le mardi suivant,
la souveraine sortant du palais pour aller se promener dans les jardins
accompagnée de la princesse de Conti, de M, de Guise et de quelques
personnes, gagnant la fontaine du Tibre et s'étant appuyée sur la balustrade,
Allory s'approcha. Madame, dit le duc de
Guise à la reine, voici un de nos amis qui me prie
de le présenter à Votre Majesté ; je vous prie de l'ouïr ! Le fermier
se mit à genoux ; la reine le fit relever aussitôt ; il expliqua brièvement
l'objet de sa démarche : Voyez la marquise,
répondit distraitement Marie de Médicis, et accordez
cela avec elle ! M. Allory se rendit chez Léonora à qui, après avoir
développé ses raisons, il insinua devinant à qui il avait affaire qu'il venoit pour apprendre de la marquise ce qu'elle
pouvoit désirer. Léonora causa tranquillement du bail, de ce que les
cinq grosses fermes pouvaient rapporter de bénéfice et évaluant ce bénéfice à
200.000 écus par an, Allory se récria : Certainement la marquise avait été
mal informée ; les ministres avaient fait faire une enquête minutieuse aux
quatre bureaux de Paris, Lyon, Amiens et Nantes, et avaient fixé la somme du
bail en conséquence. Néanmoins, tout compte fait, il proposait à Léonora
40.000 écus pour ses épingles. Léonora fut
indignée ! C'étoit se moquer d'elle,
dit-elle, que de lui offrir un chiffre aussi dérisoire : et elle fit
reconduire le malheureux financier. Allory vint à Paris causer avec ses
associés sur ce qu'il y avait à résoudre, alla demander conseil à M. Jeannin
et sur son avis se fit à nouveau introduire auprès de Marie de Médicis, cette
fois par M. de Montbazon et dans la chambre de la souveraine. Aux
explications qu'il donna, avouant qu'il avait offert à Léonora 10.000 écus,
la reine lui répondit qu'elle verrait et qu'elle en
parleroit à la marquise. Allory insista avec force que la justice qu'il poursuivoit importoit grandement à
l'honneur du roi, à celui de son conseil et de la roine mère qui avoit
prononcé l'adjudication. Marie de Médicis répéta qu'elle verroit, qu'elle parleroit à la marquise.
Le jeudi suivant, Allory apprenait qu'on avait changé, d'autorité, dans le
bail le nom de l'adjudicataire et mis à la place du sien celui de M. Pierre
de la Sablière,
commis d'un M. Giovannini. Hors de lui, il résolut d'avoir recours à toutes
les voies légales afin de s'opposer à ce déni de justice. Il fit opposition
au conseil du roi contre le bail frauduleux. Le chancelier lui avait même
permis de paraître en personne à la séance afin que
chacun connût l'injustice qui se faisoit et à laquelle lui, chancelier, ne
pouvoit remédier. L'opposition fut signifiée au greffier, à Dolé,
comme grand audiencier de France, au contrôleur du grand sceau et transmise à
la Chambre
des comptes pour vérification. Allory alla revoir Léonora. Avant d'entrer,
causant avec le secrétaire de celle-ci, il apprit que Giovannini, son
remplaçant favorisé, avait promis à la marquise 20.000 écus, plus 40.000 livres de
pension annuelle pendant toute la durée du bail. Il se décida à offrir à la
dame d'atour 12.000 écus comptant et 20.000 sur les bénéfices qu'il pourrait
réaliser ; mais il était trop tard : ses propositions furent dédaigneusement
écartées. Alors il jeta feu et flammes ; il se répandit en menaces furieuses
; il répéta qu'il donneroit un coup de pistolet en
la teste de celui qui lui ostoit son bail, vu la justice qu'il y avoit et la
despence qu'il avoit faite, ayant fait informer et voyager sur les lieux des
bureaux pour cognoistre la valeur des fermes ! On fut un peu ennuyé
autour de Marie de Médicis de tout ce bruit. Sur ordre supérieur le président
Jeannin recommanda à Allory de tâcher de s'arranger avec Giovannini, d'accepter
un dédit de 4.000 écus et de s'apaiser de sa
poursuite. Allory refusa ; il voulait au moins la moitié du bail pour lui et sa compagnie et continuait à offrir de
payer à la marquise 10.000 écus, plus la moitié de la pension consentie à la
dame par Giovannini. Ces propositions ne furent pas acceptées. Alors il
poursuivit ses oppositions. Celles-ci admises par la Chambre des comptes, un
arrêt fut rendu et une délégation de la Cour, composée d'un président, du procureur
général et du rapporteur de l'affaire, se rendit à Fontainebleau afin de le
notifier au gouvernement. La reine répondit qu'elle commandait à la chambre
d'enregistrer le bail tel qu'il avait été modifié, et un arrêt du conseil du
12 décembre 1613 en forme de jussion manda à la
chambre de passer outre à la vérification du bail, nonobstant toute
opposition contraire. Léonora Galigaï avait eu raison des ministres,
d'une cour souveraine, du droit, de l'équité et de l'opinion[36] !
De cette influence qu'elle avait auprès de Marie de
Médicis, Léonora s'est surtout servie, on le devine par cet incident, pour
s'enrichir : ceci fut le but suprême, la raison d'être de sa conduite. Léonora, dit justement Michelet, n'a visé qu'à l'argent ! André de Lizza avouait que
sa maîtresse avoit fait ce qu'elle avoit pu par ses
conseils pour faire avoir à la reine une grande autorité afin qu'elle eût
plus de pouvoir ou de moyen de s'enrichir. L'accusation, plus tard, se
donnera comme tâche de montrer qu'estant venue en
France destituée de tous moyens, la maréchale n'avait pu acquérir tant de
biens que par des voies extraordinaires et illicites, tenant argent de tous
partis et pots-de-vin des baux aux fermes du domaine du roi ; exerçant toutes
sortes de corruptions. Ce fut une exploitation systématique dans des
proportions surprenantes ; une mise en coupe réglée de toutes les
administrations pour tirer le plus d'argent possible ; un véritable
brigandage de grand chemin[37].
Il y eut peu de dons, proprement dits, de la main à la
main provenant de la reine. Outre le traitement annuel et les gratifications
obligatoires de sa dame d'atour, Marie de Médicis faisait à Léonora une
pension de 4.000 écus. Elle lui donna pas mal de pierreries ; avec ce qui lui
était venu par cette voie, ce qu'elle avait acheté, ce dont les uns et les
autres lui avaient fait cadeau, Léonora estimait posséder pour 200.000 écus
de bijoux. Lorsque la maison de la rue de Tournon fut pillée, Marie de
Médicis consentit à octroyer à son amie 100.000 écus de dédommagement. A cela
près, les dons directs sont rares[38]. C'est par des
affaires que Léonora fit sa fortune. La maréchale
lui a dit par plusieurs fois, déposait Vincent Ludovisi, que les deniers qu'elle recevoit ne procédoient point des
libéralités de la roine mère, mais des affaires qu'elle faisoit avec son
crédit et des avis qu'on lui donnoit. Le pot-de-vin fut le procédé
souverain. Il ne s'est fait aucune affaire, quelle
que petite qu'elle ait été, déclara le secrétaire des finances Germain
Chalange, dont elle n'ait eu le tout ou partie, du moins son pot-de-vin.
Personne ne pouvait obtenir une place importante, une concession, un bail,
s'il ne payait Léonora. Pour les offices, soit de la
maison du roi, de la reine, de messieurs les enfants de France, soit même de
judicature et autres relevés, nul n'estoit pourvu qu'il ne payât tribut à la Galigaï. Le
public finit par appeler le système, en gaussant, cracher au bassin et il s'en fit des risées publiques et libelles imprimés contre elle qui
coururent tout le royaume[39].
Créer des offices nouveaux, dont elle aurait à toucher le
produit de la vente, rechercher les mille moyens ingénieux de gratter dans
les replis d'une organisation fiscale embrouillée pour en tirer profit
exigeait la collaboration d'hommes habiles experts en ces questions. Léonora
se servit de ce Germain Chalange, secrétaire des finances, de Dolé, de
Feydeau, très souvent de son frère, qu'elle fit abbé de Marmoutier et
archevêque de Tours, surtout de Vincent Ludovisi. Ludovisi était un Italien
de Trévise qui, venu en France pour voir le pays
en 1605, avait été placé comme secrétaire auprès de Concini par le maître
d'hôtel de celui-ci. Ce fut lui qui géra la fortune de Léonora pendant
plusieurs années jusqu'à ce qu'il se brouillât avec elle. Tous ensemble
passèrent leur temps à chercher des idées susceptibles de procurer des fonds.
Les hommes de finances de Marie de Médicis, MM. d'Argouges et d'Attichy,
indignés des agissements de cette bande, plusieurs
fois conférèrent ensemble pour imaginer un moyen d'avertir la reine de ce
qu'on la surprenoit et abusoit de son nom pour tirer tant de deniers ;
ils n'osèrent jamais[40]. Le nombre et la
variété des affaires qui prêtèrent à un gain furent considérables. Voulait-on
obtenir la survivance pour ses enfants de places qu'on occupait ? désirait-on
avoir des rabais sur des baux ? il n'était que de payer Léonora. Léonora
recevait pension du fermier général receveur des aides ; elle obligeait les
receveurs des traites à composer avec elle avant d'obtenir leurs charges ;
elle consentit à faire rétablir les offices des deux trésoriers de France
dans chaque généralité moyennant 54.000 livres et
fit marché, par-devant notaire, avec Chalange, qui paya immédiatement cette
somme et s'arrangea pour la percevoir ; elle gagna 120.000 livres à
faire rétablir deux offices de contrôleurs généraux des gabelles et greniers
à sel de France ; 200.000
livres à faire exempter de poursuites et de
restitution des élus, qui, dans certaines élections, percevant les impôts,
réclamaient 5 sols là où ils avaient à prélever seulement 2 sols 6 deniers et
empochaient la différence. Les fermiers des gabelles de Languedoc lui
versèrent 120.000
livres pour avoir la faculté de prélever à leur profit
8 deniers pour livre des deniers extraordinaires imposés
suivant ledit de décembre 1611. Lorsque au procès les magistrats
voulurent tirer au clair toutes ces pratiques suspectes, ils énumérèrent
quinze affaires diverses représentant un total de bénéfices de près de deux
millions ! Que voulait dire que Léonora eût reçu de M. Duret 100.000 livres
pour qu'on lui continuât le bail de l'ancien domaine de Navarre ? Pourquoi M.
d'Argouges lui avait-il payé, en 1613, 83.000 livres ? et
Barbin fait avancer par Feydeau 63 500 livres ? D'où venait que la maréchale
eût eu à toucher de M. d'Hureau 100.000 livres ?
de MM. Pillot et Garnier 30.000 ? de M. Jean de Lyon 104.000 ? de M. Martin
de Bordeaux 30.000 ? de MM. Tartier et Joly 84.000 ? de M. Choisy de Caen
100.000 ? Pour quels objets précis toutes ces sommes avaient-elles donc été
versées[41]
?
A ces questions Léonora, très embarrassée, répondit
qu'elle ne se souvenait plus ; que ce n'était pas exact ; qu'il s'agissait
d'affaires de la reine. Elle nia tout. Lorsqu'on la mettait au pied du mur et
qu'on prouvait la concussion, elle s'en tirait en invoquant un don gracieux
de Marie de Médicis. Sur l'affaire d'Antoine Allory, que nous venons de voir,
elle dit que : bien étoit-elle souvenante qu'un
nommé Giovannini lui avoit voulu donner huit mille escus pour les cinq
grosses fermes ; qu'elle avoit refusé ; qu'enfin elle les avoit pris par la
volonté de la dame royne mère. Elle avait d'abord commencé par nier
énergiquement l'histoire, jurant que cela étoit la plus
grande menterie que jamais eût été dite, que jamais elle n'avoit ouï parler
de cette affaire ; qu'elle pensoit bien que le président Jeannin et
Giovannini ne diroient point cela et que c'étoient toutes inventions qu'on
faisoit faire pour lui faire du mal ! Elle répéta qu'elle n'avoit jamais pris d'argent que ladite dame royne
ne le lui eût permis. Les juges conclurent qu'en somme elle avoit disposé des finances du roi comme des siennes
propres et pour payer ses affaires personnelles[42].
Que fit-elle de tout cet argent ? Le garda-t-elle
précieusement dans ce grand coffre-fort de la maison de la rue de Tournon
dont elle conservait la clé sur elle ? Elle le plaça et en femme prudente qui
savait l'instabilité d'une fortune venue par des moyens suspects, puis qui
attendait toujours le moment de se retirer au delà des monts, provision
faite, pour v jouir paisiblement du produit de ses rapines, elle le fit
secrètement passer à l'étranger. Elle avait pour banquier les Lumagne, la
grande maison de Lyon. Par eux, elle expédia son bien à Anvers, à Cologne, à
Francfort, surtout en Italie. Il fut avéré que les banquiers Doni, de Rome,
et Renuccini, de Florence, avaient reçu en dépôt sous son nom plus de 225.000
écus, 675.000
livres. Elle plaça sur les Monts-de-Piété
excellente opération qui rapportait du denier 20
jusqu'à 200.000 écus : elle l'avoua. La banque du grand-duc de Florence
avait à elle, en 1617, 200.000 écus. Elle fit aussi des affaires en France,
acheta des rentes à M. de Guise, négocia avec la comtesse de Soissons, le
maréchal de Souvré, la princesse de Conti. Elle jugeait que ce qui lui
restait de ce côté-ci des Alpes pouvait s'élever à la valeur de 100.000 écus.
Le Parlement de Paris ayant, avec sa condamnation, prononcé la confiscation
de tous ses biens, ce fut une complication, plus tard, que de ravoir l'argent
déposé en Italie, les gouvernements de la péninsule objectant aux demandes
formulées dans ce sens que les biens de coupables appartenaient à celui dans
le territoire duquel ils se trouvaient ; ou bien que les sentences des
tribunaux français n'étant pas exécutoires en Italie, les Concini pouvaient
être considérés comme morts intestats, ce qui faisait revenir leur fortune à
leurs parents et à leur souverain[43].
Il n'y eut pas que de l'argent envoyé à l'étranger, il y
eut aussi de nombreuses caisses mystérieuses d'objets. Lumagne avoua qu'il
avait, au compte de la dame d'atour, transporté des ballots et colis à
Amsterdam afin qu'ils fussent transportés à Livourne par mer. Que contenaient
ces ballots ? L'acquit de la douane portait simplement la mention : ustensiles de cuisine !
Spéculations, pots-de-vin, il n'y eut pas que ces procédés
d'employés pour développer une fortune aussi considérable. Au procès on parla
de vols caractérisés et d'escroqueries ! Antonin Mesnillet, tapissier ordinaire et garde-meuble du roi, vint se
plaindre qu'une fois il était revenu de Louvain avec son confrère Marcellot
pour offrir au roi Henri IV et à Marie de Médicis des tapisseries de Lorraine
qu'il avait achetées en Flandre. Ces tapisseries portées au Louvre et étalées
n'avaient pas plu à Leurs Majestés et il s'agissait de les remporter, lorsque
Léonora notifia qu'elle ne laisserait rien enlever si on ne lui donnait au
préalable une de ces tentures, représentant l'histoire de saint Paul.
Mesnillet et Marcellot furent obligés de se laisser rançonner. Du reste,
ajoutait le premier, il avait déjà eu l'occasion de vendre à la même dame neuf pièces de tapisserie de l'histoire de Lucrèce, haute
lisse de soie, or et argent, du prix de 24.000 livres :
Léonora lui avait payé 17.000
livres, puis fait dire qu'elle n'ajouterait rien de
plus. Gomme si ces questions de tapisserie eussent eu le privilège de
provoquer des indélicatesses de Léonora, à leur tour Decomans et La Planche, entrepreneurs de la manufacture des tapisseries de ce
royaume, vinrent déposer que la dame d'atour leur avait offert de
s'entremettre pour obtenir de la reine qu'elle leur payât certaine pension de
9.000 écus promis par la souveraine, à condition qu'ils fissent cadeau à
Léonora d'une tapisserie représentant l'histoire de Salomon ; les tapissiers
avaient fait leur cadeau : ils n'avaient rien vu de leur pension ; on les
avait escroqués[44].
Les juges, questionnant Léonora, parlèrent encore de certain livre d'heures
de Catherine de Médicis, curieux petit livre plein de miniatures
remarquables, donnant les portraits des princes et princesses de France du
x\f siècle et que nous avons conservé, livre d'heures qui avait été vu entre
les mains du roi et de la reine, puis avait disparu : tout le monde disait
que la dame d'atour seule savait où était le précieux volume. Léonora nia[45]. On lui soumit
nombre de lettres d'elle compromettantes sur beaucoup d'affaires plus que
louches ; elle nia si énergiquement leur authenticité qu'on en vient à se
demander si elle n'a pas été victime de faux. En ce qui concerne au moins
Concini, le fait n'est pas douteux, le mari ayant bien des fois contrefait la
signature de sa femme pour lui voler de l'argent !
Or cette femme d'affaires, si active, si intéressée, cette
personne qui tenait une telle place dissimulée dans l'Etat, cette dame
d'atour dont l'influence mystérieuse s'étendait sur tout, contrôlait tout,
réglementait tout, n'était qu'une malade, misérablement torturée tous les
jours d'une affreuse affection inguérissable la clouant des heures entières
sur son lit où elle hurlait et se contorsionnait : l'hystérie ! Léonora a été
hystérique à un très haut degré ! Les symptômes ne sauraient laisser aucun
doute : les domestiques la trouvaient dans sa chambre, assise sur une chaise, toute courbée à la renverse,
tellement malade qu'elle ne pouvoit parler : il lui semblait qu'une
boule la travailloit de telle façon que le mal
montoit à la gorge pour l'étrangler ; elle était prise de frénézies, et c'est parce qu'elle était frénétique de son mal, que les attaques la
prenaient partout et à n'importe quel moment qu'elle évitait de paraître en
public. Une chose l'affectait surtout, qu'on la regardât fixement : elle
éprouvait un malaise tel qu'elle croyait que les gens voulaient l'ensorceler.
Elle devint d'humeur fâcheuse et mélancolique.
Elle se plaignait de sa gorge, disant qu'elle était enflée. Pendant son
procès elle supplia la cour de considérer son
infirmité, estant enflée et en danger de s'hydropiser ; qu'elle estoit
toujours en fièvre, ce qu'elle nous a dit avec larmes. Elle parlait de
maux qu'elle avoit soit de teste, d'estomac ou de jambe.
Pendant quelque temps on la crut folle. Une de ses femmes de chambre lavait
vue, la nuit, aller toute nue par sa chambre,
portant de petites chandelles allumées. On craignit sérieusement pour
sa vie ; certain soir on la trouvait moribonde,
mais le lendemain matin elle se promenoit aux
Tuileries. La maladie qui l'avait prise de très bonne heure, dès
presque son arrivée en France, en 1601, ne devait jamais la quitter[46].
Les médecins n'y comprirent rien. On essaya de tout. Sur
les conseils de Marescot et Duret, deux femmes
nourrices lui donnèrent à téter ; puis elle se mil au lait de chèvre,
mais sans plus de succès. Elle changea d'air, allant passer quelques jours à
Chaillot dans une maison de la reine, louant rue de Tournon l'hôtel que l'on
sait, achetant Lésigny. Après avoir épuisé la science des médecins français,
elle voulut avoir recours à des praticiens juifs, convaincue qu'ils étaient
plus habiles. Le parfumeur de Marie de Médicis, Emmanuel Maren, qui avait
longtemps résidé en Portugal, la mit en relation avec deux juifs portugais,
Montalto, Alvarez. Alvarez reçut le titre de médecin ordinaire de la reine et
eut la mission de soigner Léonora. Il ne tarda pas à se persuader que sa
malade était insensée ; elle criait que tout
le monde voulait l'ensorceler ; elle chassait ceux qui rapprochaient et mit à
la porte son nouveau médecin trois fois. Un jour qu elle assurait qu'Alvarez
pouvait la guérir mais ne le voulait pas, Concini qui était présent suivit le
médecin dans l'antichambre et le prenant à la gorge, lui déclara, en fureur,
que si dans cinq jours il n'avait pas guéri la marquise, il le tuerait ;
l'autre, épouvanté, balbutiait que Concini n'avait pas le droit de lui parler
de la sorte ; l'Italien tira un poignard et renouvela la menace, ajoutant
qu'il le jetterait dans les fossés du Louvre. Le malheureux médecin rentra
chez lui malade, se mit au lit et quatre de ses confrères, MM. Petit, Duret,
Piètre et Seguin, vinrent en consultation. Le soir de ce même jour, sur les
neuf heures, Concini entra furibond dans sa chambre où se trouvaient madame
Alvarez, ses sept enfants et une dame de ses amies. Il tenait un poignard
sous son manteau. Affolée, madame Alvarez se jeta aux genoux de Concini, le
suppliant de ne pas tuer son mari et d'avoir pitié d'elle ainsi que de ses sept petits enfants. Le marquis d'Ancre se répandit
en imprécations et notifia qu'il fallait que le médecin se levât le lendemain
matin dès l'aurore pour venir guérir sa femme, sinon lui, Concini, avait
assez de crédit et de pouvoir pour le
retrouver partout et l'en faire repentir. Deux jours après, Alvarez se levait
afin de venir assister à une consultation auprès de Léonora, mais un des
médecins présents, M. Duret, lui dit qu'il avait si mauvaise mine qu'il
ferait beaucoup mieux d'aller se coucher. A quelque temps de là Léonora lui
demanda pardon de la scène qui avait eu lieu et le pria de vouloir bien lui
continuer ses soins. Il ne laissa pas, dans la suite, d'être encore chassé
deux fois[47].
Montalto eut plus de succès. C'est en venant de Flandre
pour aller en Italie que, passant par Paris, il fut présenté à la dame
d'atour. Il prescrivit un régime assez simple : la diète, jeûne et
abstinence, le calme et la solitude complète, l'éloignement du mari pendant
quarante jours, quelques médecines ordinaires
prises trois ou quatre fois par semaine, puis des prières et des aumônes. Il
résulta du traitement une amélioration sensible. Enchantée, Léonora voulut
garder le médecin près d'elle : malheureusement c'était le moment où des
mesures d'expulsion contre les juifs étaient renouvelées par le gouvernement.
Montalto dut s'en aller : il se retira en Italie. Quelques années après,
Léonora, retombée, l'envoya chercher à Venise, le fît nommer médecin de la
reine avec la permission du pape et ne put
plus se passer de lui. C'était un causeur aimable, instruit, philosophe, un très galant homme, disait la dame d'atour ; en
demeurant longtemps avec elle et en cherchant à la faire vivre dans
l'isolement, il ameuta tout le personnel contre lui. Lorsqu'il mourut en
1616, la maréchale le pleura et regretta avec des
façons extraordinaires et passions violentes et disoit qu'elle avoit perdu sa
vie, qu'elle aimeroit mieux avoir perdu tout son bien, voire ses deux enfants
; qu'elle ne vivroit pas six mois après sa mort ; qu'elle voudroit avoir
donné cent mille escus pour en trouver un autre qui en sût autant que lui,
et semblables exagérations[48] !
Elle ne trouva pas cet autre. Elle tenta n'importe quoi,
même des charlatans. On lui fit venir de Normandie certain maréchal ferrant qui se vantoit de guérir les fièvres
quartes ; il échoua et pour se tirer d'affaire assura à Léonora qu'elle estoit ensorcelée puisqu'il ne la pouvoit guérir,
vu qu'il en avoit guéri tant d'autres ![49]
Très sérieusement alors, Léonora se crut ensorcelée. Au
fond, elle en était convaincue depuis le premier jour. Devant l'impuissance
des médecins elle s'adressa à Dieu, afin d'avoir raison du diable ; elle alla
à l'église ; elle fit dire des messes partout, aux Cordeliers, aux Carmes,
aux Augustins ; elle eut ridée d'aller faire un pèlerinage à Notre-Dame de
Lorette, mais c'était trop loin : elle se contenta de se rendre aux
Bonshommes et à Chartres ; elle fit venir d'Italie, la sainte religieuse de
Sienne, la Passitea,
à qui Marie de Médicis, jeune fille, avait eu affaire. La Passitea multiplia ses
prières, un mieux se produisit, puis une rechute suivit[50]. Il existait au
couvent de Saint-Nicolas de Nancy des religieux ambrosiens dont les prières
avaient la réputation d'être plus particulièrement efficaces : le cardinal de
Lorraine s'en était très bien trouvé. Marie de Médicis proposa à son amie de
les faire venir et M. de Champvallon alla les prendre. Ils devaient rester à
Paris deux mois et ne servir qu'à compromettre Léonora par leurs façons
inattendues de prier. Ils allaient chercher des reliques au couvent de
Saint-Victor, les mettaient dans la chambre de Léonora sur une nappe blanche
avec deux cierges allumés, deux flambeaux de cire blanche, les portaient au
couvent des Augustins à la chapelle des Spifames et faisaient des neuvaines.
Ils chargèrent Concini d'aller demander au curé de Saint-Sulpice
l'autorisation de venir avec la malade, le soir, à sept heures, dans son
église, toutes les portes étant fermées et personne n'étant autorisé à
demeurer ; ils restaient là trois heures. Un peu intrigué, le sacristain de
Saint-Sulpice, Marin Poret, voulant savoir ce qui se passait, parvint à
pénétrer, quoique Concini gardât la porte, et aperçut derrière le
maître-autel Léonora toute décoiffée, les cheveux pendants, à genoux devant
le Saint-Sacrement, tandis qu'un des religieux était assis à côté de l'autel
et que l'autre lisait à haute voix. Cela dura Jeux heures. Poret surpris
questionna le curé, M. Lemarie, qui lui dit que c'étoit
à bonne fin : Concini lui ayant expliqué que sa femme était atteinte
de frénésie et que voulant faire des prières
aux heures où le public n'était pas là, afin de ne pas attirer l'attention et
d'éviter au monde le spectacle des crises, le ménage et les religieux venaient
à des heures un peu indues[51]. Les scènes qui
se passèrent à la chapelle des Spifames du couvent des Augustins furent
encore plus étranges. Le confesseur de Léonora, le P. Roger Girard, augustin,
avait obtenu de son prieur que les Concini pussent venir dans l'église du
couvent faire des prières, les portes fermées ; pour plus de sûreté les
séances se passant encore derrière le maître-autel, on fit entourer celui-ci d'ais de bois par un menuisier. Aucun religieux ne
devait approcher et la communauté disait ses offices dans le chapitre. Tantôt
les Concini venaient le matin à sept heures, jusqu'à dix, onze heures ;
tantôt ils venaient la nuit ; ils descendaient de leur carrosse à la petite
porte du cloître et renvoyaient le cocher. Les religieux augustins, non moins
intrigués que le sacristain de Saint-Sulpice, avaient seulement remarqué que
les Ambrosiens étaient hideux de visage au possible,
et qu'ils avaient demandé toutes les étoles de la maison. Un soir, le frère
Ambroise, sous-secrétaire, n'y tenant plus, trouva le moyen, sous prétexte de
sonner matines, de s'enfermer dans le clocher d'où il assista, la nuit, à la
scène. Il vit qu'on couchait Léonora sur des coussins en l'enveloppant
d'étoles ; elle paraissait débile ; les
Ambrosiens revêtaient des étoles, puis prenaient des livres, faisaient plusieurs oraisons mentales ; il entendit
ensuite des cris épouvantables, Léonora
hurlant, les Ambrosiens chantant. Le couvent entier fut convaincu qu'il y
avait là de la magie et de la sorcellerie. Les juges curieux, plus tard,
demanderont même si les Concini n'apportaient pas un coq afin de le tuer,
mais personne ne sera en mesure de les renseigner sur ce point essentiel.
Léonora eut beau expliquer aux magistrats qu'il ne s'agissait que
d'exorcismes et de petites liturgies
spéciales à l'Italie ; que ses cris provenaient de ses souffrances, que toute cette chanson de moines n'étoit que sottises, et
qu'elle n'avoit fait autre chose que prières, on ne voulut pas la
croire[52] ! Elle
était sorcière !
Sorcière ! C'était la terrible accusation qui devait la
faire envoyer à la mort ! Avec les scènes suspectes du couvent des Augustins,
les imprudences de Montalto constituèrent le principal argument de
l'accusation.
Montalto, esprit curieux et avisé, s'était préoccupé de
rechercher dans certains livres hébreux les symptômes et les remèdes de la
maladie de sa cliente. Il n'était pas satisfait de son traitement qu'il
n'estimait pas suffisamment efficace. Il s'aboucha avec un de ses anciens
coreligionnaires converti, Philippe Daquin, qui savait l'hébreu et l'avait
étudié en compagnie du savant M. Gaulmin de la Guyonnière,
lieutenant criminel de Moulins ; ensemble ils travaillèrent : ils
empruntèrent des livres à la bibliothèque du roi et, en effet, relevèrent des recettes belles et rares, que Montalto faisait copier
audit Daquin. Hélas ! on devait en 1617 mettre la main sur trois de
ces livres hébreux dans la maison de Léonora : l'un,
un fort petit volume, couvert de veau violet ; l'autre environ in-octavo,
couvert de basane rouge ; l'autre, in-quarto, couvert de basane rouge usée
: l'Arbaah Turim quatuor ordines du rabbi Jakob ben Ascher, la Synagoga
judaica de Johann Buxtorf. Les juges échafaudèrent sur ces éléments le
complot de magie[53]. Il fallait que
Montalto eût été magicien ! On questionna un Aragonais, Alonzo Lopez, ancien agent et négociant les affaires des Morisques
et qui avait été intime avec lui. Lopez répondit que si Montalto était magicien
il n'en avait rien su, ledit Montalto ayant été si
secret qu'il ne parloit que fort particulièrement et ne faisoit paroître
aucune de ses actions à qui que ce fût ! Un autre médecin aragonais,
Charles Garcia, avoua assez confusément que Montalto avait recherché des
magiciens habiles, qu'il lui avait demandé, à lui Garcia, s'il n'en
connaissait pas et que quelque temps après, le rencontrant rue Dauphine,
Montalto lui avait dit avoir trouvé son affaire dans un certain Alonzo Lopez,
More de nation. En réalité, aux yeux de la domesticité de Léonora, le juif
portugais était grand magicien parce qu'il se
servoit de caractères en lettres hébraïques, qu'il faisoit des choses
extraordinaires, admirables, et qu'il usoit de l'astrologie judiciaire pour
prédire l'avenir. Ce n'étaient là que des on dit. Lorsqu'on
l'interrogea, Léonora nia que son médecin lui eût jamais parlé de magie.
Peut-être Concini n'était-il pas si éloigné de croire que les études
qu'entreprenait Montalto dans les livres hébreux devaient fatalement le
conduire à demander à la
Kabbale les moyens magiques de guérir le mal de Léonora,
car, le savant médecin mort, il proposa à Daquin de continuer avec lui la
lecture des textes hébraïques afin de trouver le remède nécessaire à la
marquise, ajoutant qu'il savoit fort bien que les
juifs, par vertu de cette science que l'on appeloit Kabbale, ou magie,
pouvoient guérir les malades et avoient puissance d'apaiser les fureurs du
démon qui travaille et tourmente un homme. Daquin était hésitant. Un
jour qu'une violente crise tordait Léonora, à la renverse sur sa chaise,
Concini s'essaya. Il pria Daquin de lire tout haut des psaumes en hébreu,
puis croyant s'apercevoir que sa femme montrait du doigt un objet dans la
ruelle du lit, il alla prendre le crucifix qui était sur les courtines, ainsi
que le vase de nuit placé sous le châlit et les transporta dans la chambre à
côté. Cela fait, il fit laver les mains à Daquin, qui n'y comprenait rien, et
lui donna à lire un morceau de parchemin laissé par Montalto et sur lequel il
y avait des caractères hébreux : Daquin ne déchiffra pas. En attendant, Léonora
n'éprouvait aucune amélioration. Le juif, inquiet de la tournure que prenait
la scène, pria Concini de le dispenser de continuer, reçut dix pistoles pour
la peine et s'en alla, résolu à ne pas recommencer[54].
En somme tous ces détails ne signifiaient pas grand'chose.
Les juges en seront réduits à se rabattre sur des histoires un peu
fantastiques rapportées par des témoins pleins d'imagination. L'un d'eux,
Louis Dubois qui prit part en 1616 au pillage de la maison de la rue de
Tournon, assurera avoir vu dans une galerie située au haut de l'hôtel des
Concini et toute garnie d'armoires, une bière, en bois doré, recouverte d'un
drap de velours noir, la partie supérieure de la bière fermée par une plaque
de verre sur laquelle était étendu un linge grand comme un mouchoir, et, tout
autour, quatre chandeliers de bois doré portant des cierges blancs. Il avait
regardé à travers la plaque et aperçu un homme couché tout de son long, les
jambes l'une sur l'autre, la barbe et les cheveux noirs : ne sait si ce qu'il voyoit étoit cire, chair ou autre
matière. La galerie en question étant fermée par trois grandes barres
de fer, Dubois était entré dans la pièce par une
fenêtre, à l'aide d'une gouttière qui est près de la tuile[55]. On trouvera
dans le logis de Léonora : des parchemins portant des caractères ronds,
autour de lettres hébraïques ; des boulettes de cire de
la grosseur d'une grosse teste d'épingle ; une
petite boîte de sapin en forme de losange, dans laquelle il y avoit trois
rondeaux de velours à fond brodé d'argent et un autre en forme de cur,
lesquels, ayant été ouverts, offriront aux yeux étonnés des magistrats des morceaux d'Agnus Dei, des feuilles d'olivier, de
palme, un morceau d'encens, un morceau de crêpe. En vain André de
Lizza s'efforcera d'expliquer qu'en Italie on porte des feuilles d'olivier et
de palmier bénites, avec des Agnus Dei, pour se garantir du tonnerre ; on
n'écoutera pas son explication. En réalité Léonora n'a jamais fait de
sorcellerie. Le médecin Alvarez, qui l'avait bien connue, l'affirmait
énergiquement ; Léonora niait avec indignation les accusations ridicules
articulées contre elle disant : s'il estoit possible
qu'on inventât tant de méchancetés ! répétant : que Dieu la punît, si elle savoit ce que c'étoit que ces
histoires de boulettes de cire ; qu'elle
voudroit plutôt mourir que de voir une telle chose que cette affaire de
cercueil ! Malgré l'animosité violente qu'elle avait provoquée, le
public ne fut pas dupe du prétexte de magie invoqué : on n'a jamais cru qu'elle fût sorcière, dit Bassompierre, et n'y en a eu aucune apparence ![56]
Ce sont les prévarications, les concussions, et les abus
de son pouvoir occulte qui, au fond, ont causé en 1617 la condamnation de
l'amie de Marie de Médicis. Si les juges ne dirent pas trop ouvertement leurs
véritables raisons et mirent même quelque réserve prudente dans leurs interrogatoires,
c'est que derrière l'amie de la reine ils atteignaient plus haut et plus
loin. Nous verrons bientôt pourquoi.
|