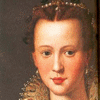LA VIE INTIME
D'UNE REINE DE FRANCE AU XVIIe SIÈCLE
CHAPITRE V. — FAMILLE ROYALE ET PARENTS D'ITALIE.
Tendresse médiocre de Marie de Médicis à l'égard de ses enfants remarquée par Henri IV. — Comment elle s'occupe d'eux ; les questions de maladie ; les corrections ; les cadeaux. — La gouvernante à qui elle s'en remet, madame de Monglat. — Le dauphin ; sa nature volontaire et opiniâtre ; peu d'action de la mère sur lui ; emploi du fouet ; froideur réciproque. — Le second fils, un duc d'Orléans mort de bonne heure ; pourquoi, d'après Richelieu, Marie éprouva du chagrin de sa perte. — Le troisième, le duc d'Orléans ; préférence marquée de la reine. — Les trois petites filles, plus effacées ; leur douceur, leur gentillesse ; bienveillance de Marie de Médicis. — Avec les enfants sont élevés les bâtards du roi. — Caractère insupportable des petits Vendôme ; natures charmantes des enfants de madame de Verneuil. — Les jeux en commun du troupeau royal, ballets, comédies. — La tante à héritage, la reine Marguerite de Valois, vieille, laide, mal famée, mais très bonne pour les enfants, très prévenante pour Marie de Médicis, maîtresse de maison accomplie ; ses fêtes brillantes. — Autre tante, la duchesse de Bar. — Abondance des parents de Marie de Médicis en Italie ; quémandeurs, obsédants. — Caractère bourgeois des lettres échangées avec eux, commissions, affaires. — La venue à Paris de Jean de Médicis ; froissements ; scènes. — Les cousins Sforza de Rome ; leurs exigences.Le cri poussé par Marie de Médicis le 14 mai 1610, lorsque l'annonce d'un malheur encore inconnu lui faisait brusquement supposer qu'un accident était arrivé au dauphin : Mon fils ! semblerait attester de la part de la souveraine une vive sollicitude maternelle. Plus d'un courtisan eût pensé qu'il s'agissait moins pour elle d'être préoccupée de la vie de son enfant, que d'être inquiète de l'existence du futur roi mineur dont elle allait avoir, dans un temps peu prolongé, selon toute apparence, à gouverner l'héritage. En effet Marie de Médicis n'a jamais manifesté à l'égard de ses enfants qu'une affection assez médiocre. Henri IV, qui avait au contraire pour eux une grande tendresse, en était frappé. Béthune racontait que devant lui le prince trouvant un jour l'indifférence de la reine étrange, l'accusoit de peu de sentiment envers ses enfants[1]. A peine, au début, Marie de Médicis fut-elle touchée de leur grâce et de leur gentillesse enfantine. Elle écrivait à la duchesse de Mantoue en 1603 : Vous avez par deçà un neveu et une nièce (le dauphin et sa sœur Elisabeth) qui sont tous deux si jolis pour leur âge qu'il n'est pas possible de plus. J'espère que quelque jour vous aurez avec nous le contentement de les voir. Et c'est à peu près tout ce qu'on trouve dans sa correspondance de plus affectueux. En revanche part-elle en voyage, s'absente-t-elle un mois, six semaines, ce qu'elle fait en 1603 pour aller en Normandie, elle n'écrit pas. La gouvernante des enfants, madame de Monglat, lui envoie des nouvelles ; elle ne répond pas, donnant un prétexte quelconque : Je ne fais point de réponse, à l'occasion de l'incommodité des lieux ; ou elle envoie de rares billets, secs, laconiques, purement de forme. Pendant tout son voyage de Metz, en 1603, qui dura plus d'un mois, elle n'adressa qu'une lettre courte et insignifiante[2]. Elle vient de temps en temps voir les petits princes au
château de Saint-Germain. On a l'impression, en feuilletant le journal
d'Héroard, d'une ombre qui passe, froide, un peu hautaine. Autant les enfants
ont de joie à retrouver leur père, qu'ils appellent papa,
à recevoir ses caresses pleines d'effusion tendre, à écouter ses propos
enjoués ; autant ils sont glacés par l'apparition de leur mère. Celle-ci
commande, punit ; elle ne fait rien pour se les attacher. Tallemant va même
jusqu'à dire qu'elle n'embrassait jamais son fils et l'affirmation paraîtrait
suspecte en raison de son exagération même, si Balzac n'écrivait : Durant les quatre années de sa régence elle ne baisa pas
une seule fois le roi son fils. Je l'ai appris d'un vieux courtisan de ce
temps-là qui se donna la liberté de le lui dire. C'était donc au moins
ce qu'on disait et ce qu'on croyait[3]. Elle s'occupait d'eux, cependant : il le fallait bien
puisque les enfants étaient entre les mains des
femmes et que celles-ci ne pouvaient avoir recours qu'à elle, non au
roi, pour tout ce qui concernait les questions de santé et de discipline ;
les autres, les questions matérielles de dépenses, ne comptant pas et étant
réglées par le personnel. Un enfant se trouvait-il souffrant, on l'informait :
c'était à elle à prendre des décisions. Elle tranchait les problèmes du
sevrage. Madame de Monglat, sur l'avis delà sage-femme, proposait-elle de
retarder le sevrage d'Elisabeth, la reine consultait Héroard, les grands
médecins MM. de Elle ne se tourmentait pas d'ailleurs outre mesure des indispositions qu'on lui annonçait. Elle les mettait sur le compte des dents : Ce que ma fille éprouve ne procède sans doute que de la douleur de ses dents qui sont prêtes à percer : cela se passera incontinent. Ou bien elle répondait philosophiquement que les petits enfants sont sujets aux maladies et qu'il n'est que de les soigner : L'on ne peut toujours éviter les maladies quand elles ont à venir, principalement aux enfants de l'âge de ma fille ; il faut prendre le soin de la guérison autant que l'on pourra[4]. C'était surtout dans les cas d'épidémies qu'elle était appelée à intervenir, les épidémies étant fréquentes alors, en raison de l'insalubrité des conditions d'habitation des gens et le bourg- de Saint-Germain, avec ses petites maisons entassées dans des rues étroites et sales, paraissant y être aussi sujet que les quartiers les plus grouillants de Paris. Sitôt qu'une contagion était signalée à Paris, Marie de Médicis prévenait la gouvernante : Je vous prie d'avoir l'œil à ce que cette maladie ne se loge point à Saint-Germain, et si elle s'y logeait je ne veux plus que personne venant du dehors habite dans le bourg, ni que qui que ce soit voie mes enfants : envoyez les enfants des nourrices et autres loger dans Saint-Germain, ailleurs, où bon leur semblera, vous tenant avec le moins de train que vous pourrez pendant que cette maladie durera. Et encore : Il couve force maladies de petite vérole, rougeole et contagion à Paris et aux bourgs et villages des environs de Saint-Germain, qu'on fasse attention ! Elle a un remède, qui est de changer d'air. Il est vrai que les déplacements ne sont pas considérables ; ils consistent à aller du vieux château de Saint-Germain au bâtiment neuf sur le haut de la colline. Elle redoute Paris et le Louvre — à cause des fossés malsains. — Pour éviter d'y mettre les enfants lorsqu'elle les fait venir en ville, elle les envoie dans un endroit élevé, un faubourg sain, entouré d'arbres, de champs et elle loue pour eux à M. de Luxembourg son hôtel, situé au haut de la rue de Tournon, hôtel qu'elle achètera ensuite et sur l'emplacement duquel elle créera la résidence que l'on sait[5]. Comme discipline, ses moyens sont simples : le fouet et les cadeaux. Quand un enfant a été bien sage et obéissant il reçoit : un petit coffret, par exemple, avec de petites besognes qui sont dedans ; et la reine annonce qu'elle garde encore quelque chose de plus beau. L'enfant a-t-il été opiniâtre, la mère écrit quelque billet sévère ; le plus souvent elle recommande à la gouvernante d'être inexorable. D'une façon générale, Marie de Médicis s'occupe peu de l'éducation de ses enfants. Jamais elle ne se mêle de ce qu'il faut leur apprendre ou leur interdire. Les mœurs du temps et celles d'Henri IV autorisent dans leur entourage une crudité de langage, une liberté de propos et de gestes déconcertants : elle ne fait jamais d'observation. C'est chez elle insouciance, difficulté peut-être à contredire le roi, indifférence surtout de ce qui touche la petite troupe de Saint-Germain, comme elle dit. Puis, surtout, elle s'en remet entièrement à quelqu'un qu'elle estime infiniment, la gouvernante, madame de Monglat[6]. Grande, sèche, horriblement maigre, madame de Monglat, femme du premier maître d'hôtel du roi, le baron de Monglat, un homme désagréable et violent, passait pour être autoritaire et fâcheuse, qualités nécessaires, sans doute, aux fonctions qu'elle remplissait et condition peut-être de la confiance que lui témoignaient le roi et la reine. Cette confiance est à toute épreuve. Elle résiste aux insinuations que des courtisans malintentionnés cherchent à suggérer aux princes : Je n'escouteroi point les mauvais offices que l’on vous voudroit rendre, je me repose entièrement sur vous, lui mande Marie de Médicis une fois ; et, dans une autre circonstance, sur le point de partir en voyage : Je sais que vous êtes si soigneuse des enfants qu'il n'est besoin que je vous les recommande davantage pendant notre éloignement ; envoyez des nouvelles à toute occasion. La famille entière la connaît : oncles, tantes, princes d'Italie ou de Lorraine ; chacun lui écrit : le dossier des lettres reçues par elle de hauts personnages et conservées forme un brillant recueil d'autographes royaux. Elle est même presque un peu de la famille par les sentiments qu'on professe à son égard ; les enfants l'appellent mamanga, abréviation de maman Monglat, et lui écriront plus tard, longtemps, jusqu'à sa mort, continuant, devenus rois, reines, cette appellation familière et enfantine. Henri IV la traite en amie, échange avec elle des recettes contre la peste et contre la goutte. Dans des circonstances particulières, telles que la mort de M. de Monglat, il sait lui adresser une missive extrêmement affectueuse, émue et qui fait honneur à l'un comme à l'autre, tandis que Marie de Médicis, plus pratique, écrit : Vous avez en votre garde et gouvernement ce qui nous est le plus cher en ce monde qui sont nos enfants, et parce qu'il est nécessaire de les entretenir en humeur gaie et ne leur donner aucun sujet de s'attrister, nous ne trouvons nullement à propos que vous fassiez votre quarantaine (deuil de veuve) et vous prions aussi de vous abstenir de pleurer et doléancer en leur présence. Vous avez assez de vertu et de constance pour en user ainsi et supporter cette affliction avec la modération et résolution convenables[7]. Le sentiment des enfants à l'égard de madame de Monglat est fait d'affection sincère, sans doute, mais une affection due surtout à l'estime, à l'habitude, à la conscience obscure qu'ils ont d'un dévouement réel de la part de celle qui en somme remplit le rôle de mère près d'eux. Madame de Monglat sait-elle bien les prendre, les uns et les autres ? Possède-t-elle un tact pédagogique suffisamment sûr ? A lire Héroard, la chose est douteuse. Elle affecte de brusquer le dauphin, qui a un caractère un peu entier, et de le contredire, de l'exciter, sans doute pour mater ce qu'on appelle son opiniâtreté. Le procédé ne réussit pas. L'enfant se regimbe contre la gouvernante, lui dit des injures, lève la main sur elle, et la scène finit généralement par une correction. Le petit dauphin manque de tendresse à l'égard de celle qui le traite si rudement, mais il la respecte ; lui aussi continuera plus tard à lui écrire, l'appelant également mamanga, roi, homme fait ; il l'estime ; il se rend compte qu'elle a rempli ses devoirs avec application consciencieuse et un dévouement qui mérite reconnaissance. Natures plus douces, les filles, gentilles enfants, bonnes et gracieuses, ont moins à pâtir des sévérités de la gouvernante et ont conçu pour elle un attachement plus affectueux que tempère seule ensuite la dignité obligatoire d'une princesse royale à l'égard d'une personne domestique de la maison[8]. Madame de Monglat est amplement entourée de tout le personnel nécessaire à la surveillance et à l'entretien des enfants. Chaque fille a une sous-gouvernante. Les maisons des princes ont été constituées avec l'abondance de fonctions propre aux dynasties royales. Elles se composent surtout de domestiques proprement dits, valets de chambre, femmes de chambre, nourrices, remueuses, qui ont chacun leur office. Il faut faire une place à part au médecin, le brave Jean Héroard, si dévoué, si simple et affectueux, que tout le monde aime et qui nous a laissé, dans son journal minutieux, la vie quotidienne de cette petite cour de Saint-Germain modeste, paisible et monotone[9]. Est-ce l'effet de sa nature un peu opiniâtre, c'est-à-dire volontaire, impérieuse et personnelle ?
Le petit dauphin paraît être celui qui inspire à sa mère le moins de passion.
Dieu sait, cependant, si sa naissance — Malheureusement son caractère se manifestait avec une personnalité singulière. Héroard a consigné dans son Journal les témoignages journaliers de cette nature impérieuse. Quoiqu'il aimât son père d'une tendresse ardente, le craignît beaucoup et lui obéît mieux qu'à nul autre, l'enfant faisait sentir à Henri IV lui-même ses prédispositions autoritaires. Richelieu raconte avoir entendu dire quelle fureur prit le roi, un jour où, à Fontainebleau, Henri IV voulant faire sauter un ruisseau à son petit garçon, celui-ci, à la vue delà cour, opposa une résistance si révoltée que le roi furieux allait, si on ne l'avait arrêté, tremper le dauphin dans l'eau. Une autre fois où il était nécessaire que l'enfant prît un clystère, six personnes s'employèrent sans résultat à le faire céder[12]. Quelle prise pouvait avoir sur une nature aussi volontaire, une mère n'ayant pour elle ni l'empire que donne une affection dévouée, ni l'ascendant d'une intelligence précise ? Henri IV était trop clairvoyant pour ne pas prévoir qu'il y aurait fatalement défaut d'entente entre la mère et le fils ; il le disait ; il annonçait leur mésintelligence future ! Fouet et cadeaux, le système fut appliqué au dauphin avec prédominance du premier. Les cadeaux, eux, revenaient à dates obligatoires, sans l'attrait de l'imprévu, ni la grâce de l'attention : montres d'horloge, petits couteaux, soldats d'argent pour les étrennes du jour de l'an. L'enfant s'amusait à faire en retour des présents à sa mère, à lui envoyer, par exemple de Saint-Germain, un petit panier de cerises, au moment de la saison, et la reine lui répondait de ce ton un peu haut, banal, dépourvu de toute caresse et de la moindre nuance de sensibilité : Mon fils, je vous remercie des cerises que vous m'avez envoyées ; elles m'ont été bien agréables, venant de votre part ; je vous aime bien parce que l'on m'a dit que vous êtes toujours bien sage ![13] Le fouet fut donné régulièrement. A chaque lettre de madame de Monglat signalant des résistances, des opiniâtretés, la réponse revenait invariable : Qu'on donne le fouet ! Jean Héroard finit par s'interposer, prétextant des raisons de santé. L'enfant était pris de rages telles qu'il tombait en syncope. La reine adoucit les ordres : Qu'on donne le fouet avec tant de circonspection, corrigeait-elle, que la colère qu'il pourrait prendre ne lui engendre aucune maladie. Tenant à la vie de son fils pour beaucoup de raisons diverses, elle recommandait de consulter le médecin. Elle se mit dans l'idée que les chaleurs rendaient les corrections dangereuses et, en été, le petit prince bénéficiait de ce préjugé. Faites tout avant d'en venir à l'extrémité du fouet en cette saison chaude, en laquelle il se pourroit esmouvoir. Pauvre dauphin ! Comme son cœur se serrait d'angoisse chaque matin lorsque après le lever et la toilette l'heure arrivait de régler les comptes de la veille, — car on punissait à heure fixe, le lendemain, les fautes du jour, — et que la sévère gouvernante s'approchant de lui avec des verges prononçait d'une voix sèche la formule redoutée : Ça, troussons ce c... ![14] Comment s'étonner que l'enfant n'éprouvât pour sa mère que des sentiments peu tendres ? Comment être surpris qu'il l'accueillît toujours assez mal à Saint-Germain et qu'on fût obligé de le menacer pour lui faire embrasser Marie de Médicis ? L'âge avançant n'y fit rien. Il n'y eut d'un côté et de
l'autre ni plus de dévouement, ni plus d'affection. 1609 fut l'année fixée
d'avance pendant laquelle l'on retira le dauphin des
mains des femmes, afin de confier son éducation à des hommes ; un
gouverneur et des précepteurs furent chargés de lui donner une nourriture conforme à sa haute naissance et à ce qu'il
devoit estre un jour. On prit pour gouverneur un vieux chevalier,
ancien ami d'Henri III et d'Henri IV, vénérable gentilhomme qui avait vécu
toute sa vie à Pour Marie de Médicis il continuait à être un enfant. Comme elle avait prescrit à madame de Monglat de fouetter, elle recommandait à M. de Souvré de donner le fouet : J'ai été bien aise, monsieur de Souvré, lui écrivait-elle, d'apprendre des nouvelles de la santé de mon fils ; mais je vous prie de le tenir toujours en son devoir, lui faisant faire ses exercices ordinaires ; et s'il se vouloit émanciper, vous savez le remède qu'il faut apporter pour le ramener à la raison ; vous le lui ferez ressentir, s'il vous en donne l'occasion ; je vous le recommande ! Rien n'était modifié dans son attitude : c'était toujours cette même froideur cérémonieuse et glacée : J'ai été bien aise, mon fils, lui mandait-elle, de voir que vous vous portez bien et de savoir que vous êtes toujours bien sage et que vous étudiez et faites bien vos exercices. Continuez toujours et obéissez à ce que vous dira M. de Souvré afin qu'il ait occasion de me confirmer toujours en ceste bonne opinion. Après la mort d'Henri IV et l'avènement de l'enfant au trône, un matin que, sur l'ordre formel de la reine, M. de Souvré avait, bien malgré lui, fouetté le petit roi, celui-ci entra dans la pièce où se trouvait sa mère. L'usage voulait que chaque fois que le roi régnant entrait quelque part, tout le monde, même celle-ci, se levât et s'inclinât. Marie de Médicis se leva et fit la révérence. Sur quoi Louis XIII dit brusquement : J'aimerais mieux qu'on ne me fît point tant de révérences et qu'on ne me fît point fouetter ! L'assistance se mit à rire et la reine un peu gênée sourit. Derrière le petit garçon qu'on corrigeait, il y avait Sa Majesté le roi. Marie de Médicis n'avait pas trop paru s'en apercevoir. Elle allait de jour en jour en faire l'expérience[16]. Elle pouvait bien se douter cependant que cet enfant
n'était pas comme tous les autres. Lorsque à Saint-Germain le lieutenant
général de Fontenay-le-Comte, vieillard octogénaire, admis devant le berceau
du dauphin, âgé de six mois, s'agenouillait, pleurait, puis s'en allait
disant en levant les bras au ciel : Dieu m'appelle
quand il lui plaira, j'ai vu le salut du monde ! ; lorsque pour la
fête de Il fallut bien, pour Marie de Médicis, s'en rendre compte quand l'assassinat d'Henri IV mit la couronne royale sur le front de l'enfant. Elle eut peur. Des avis lui venaient de tous côtés que les meurtriers en voulaient à la vie du fils comme à celle du père. Etait-ce manifestation inattendue d'un sentiment jusque-là peu expansif ? n'était-ce pas plutôt, comme l'insinuèrent les courtisans, souci de conserver une existence précieuse qui était la raison d'être de sa toute-puissance de régente ? Elle prit des précautions maternelles. Devenu roi, le dauphin eût dû occuper l'appartement du souverain, dont la chambre, d'ailleurs, était contiguë au petit cabinet de la reine. Marie de Médicis voulut que désormais l'enfant couchât dans sa propre chambre sur un petit lit qu'on dressait exprès le soir : elle augmenta le nombre des femmes de chambre qui passaient la nuit près d'elle et qui fut porté à trois : elle ne quitta plus son fils. A l'heure voulue l'enfant se déshabillait cérémonieusement dans la chambre royale de parade, comme le voulaient les usages traditionnels, les plus grands seigneurs l'assistant : le prince de Condé le desguilletant, lui tirant ses chausses ; puis le petit roi prenoit sa robe, ses bottines et s'en alloit coucher dans la chambre de la reine. Longtemps elle le couva, par appréhension. Les conseils, autour d'elle, confirmaient ses inquiétudes. Que fut devenu le royaume si un malheur était arrivé à un roi dépourvu d'héritier ? ou quelles complications n'étaient pas à redouter dans la transmission du pouvoir d'un aîné à un cadet ? Mais au fond c'était politique plus que tendresse[18]. Le premier jour qu'elle le quitta, — en 1613, la cour était à Fontainebleau et la reine allait voir à Paris un de ses autres enfants, le duc d'Anjou, malade, — pas plus émue de laisser le roi que d'être auprès du prince sérieusement atteint, elle écrivait joyeusement à M. de Souvré lui contant les péripéties de son voyage, lui disant qu'elle était arrivée à onze heures du soir après une journée de carrosse dans laquelle la princesse de Conti avait trouvé le coussinet bien dur parce qu'on lui avait mis quatre flambeaux dessous sans qu'elle s'en fût aperçu, et donnant avec sollicitude des nouvelles d'une petite chienne qu'elle avait emmenée avec elle. Dans une autre circonstance, Louis XIII étant pris de petite vérole — et on redoutait assez cette maladie en ce temps, — elle se contentait d'écrire froidement à la duchesse de Lorraine : Le roi, monseigneur mon fils, se trouva un peu indisposé de la petite vérole ; mais il en est si doucement traité qu'il y a espérance qu'avec l'assistance divine il en sera bientôt remis. Il devait effectivement s'en tirer et en rester très peu marqué[19]. Cette froideur et cette indifférence à l'égard de son fils, elle les gardera de plus en plus réels jusqu'au jour où le prince devenu subitement roi effectif, la chassera du pouvoir, en 1617, à sa grande surprise et à sa profonde indignation ! Le second fils, le premier duc d'Orléans, tient moins de place encore dans la vie de Marie de Médicis, pauvre enfant, venu après une année de disputes violentes et de chagrins répétés, malingre, chétif, dépourvu de santé et sans grande espérance de vie ! On l'avait appelé duc d'Orléans parce que c'était la coutume de donner ce titre au second fils du roi depuis que les aînés portaient le nom de dauphin. Sa naissance avait été accompagnée de quelques prodiges trompeurs. En réalité, doué d'une tête énorme sur un corps de squelette, il avait souffert dès ses premiers jours. Le roi ne faisoit pas estât qu'il dut vivre, écrivait la reine peu de jours après sa mort, cognoissant bien qu'il n'estoit de la forte et robuste complexion dont est, g'râce à Dieu, le roi. Monsieur mon fils. Il avait traîné, constamment souffrant. Les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient, se relayant, appelant des confrères étrangers à la maison du roi, M. Aimedieu, M. Hautin, qui allaient à Saint-Germain mettre des bandages, placer des cautères, discuter avec M. du Laurens et M. Lemaitre s'il était à propos de faire prendre les matins au malade, comme première nourriture, et auparavant les bains, qui lui ont été ordonnés, du lait de chèvre pour le rafraîchir. Lorsque l'état s'aggravait, les autres enfants quittaient Saint-Germain afin de lui laisser la place et qu'il fût tranquille. Il ne bougea guère du château les quatre années de sa pitoyable existence[20]. En novembre 1611 il fut pris de convulsions qui durèrent huit ou dix jours : le 14, Louis XIII, son frère, vint le voir : le malade était dans son lit, prostré, en proie à un endormissement profond, ce qui faisait croire à une fièvre léthargique ; le grand frère le contempla en pleurant : c'était la dernière fois qu'il le voyait : dans la nuit du 16 au 17 novembre, à minuit, le duc d'Orléans mourait au milieu de quelques convulsions : Comme je voyois qu'il avoit duré jusque-là, écrivait le lendemain Marie de Médicis au duc d'Épernon, je commençois à espérer qu'il eschapperoit avec le temps, qui me sembloit le fortifler. Néanmoins le mal est tout à coup survenu si grand qu'il n'a pas eu la force d'y résister ! On lui ouvrit le crâne, il avoit le cerveau rempli de catarrhes et tout gâté, plein d'eau noire et le cervelet s'esmioit aux doigts en le maniant. Marie de Médicis éprouva quelque chagrin. Elle était demeurée au chevet du mourant : Il a esté très bien secouru, écrivait-elle, car outre le soin qu'ont eu ceux qui estoient près de lui à Saint-Germain, je m'y suis trouvé moi-mesme et l'ai assisté tant que la douleur me le permit. Le maréchal d'Estrées observait qu'elle avait paru sentir un grand déplaisir et Richelieu parlait de sa grande affliction ; mais lui qui la connaissait si bien et avait recueilli les témoignages les plus sûrs sur ses sentiments réels, constatant qu'elle semblait auparavant assez indifférente au sort de cet enfant, ajoutait : Qui distinguera les temps connaîtra la cause de cette différence qui consista, à mon avis, en ce qu'elle avoit lors plus d'intérêt à la conservation de son fils que durant la vie du feu roi, pendant laquelle elle en pouvoit avoir d'autres. Elle fut plusieurs nuits agitée, puis, plus résignée, elle répondait à ceux qui lui adressaient des lettres de condoléances : Je m'en veux consoler avec Dieu et en cet accident me conformer à ses volontés ![21] Celui que l'histoire connaît sous le nom de duc d'Orléans
et qui a rempli le règne de Louis XIII des complications dues à sa nature
brouillonne, était né un an après le premier duc d'Orléans, en 1608, et avait
reçu le titre de duc d'Anjou. On l'appela Gaston, prénom assez inusité dans
la famille royale, parce qu'Henri IV avoit désiré
qu'il portast le nom d'un des plus valeureux de ses ancêtres de la maison de
Navarre, Gaston de Foix. Dieu sait si, lui, devait être plus tard le
préféré de Marie de Médicis ! Longtemps on répétera que la reine a le noir
dessein de détrôner Louis XIII, pas assez maniable, pour mettre à sa place
son frère, plus soumis et, après l’avènement de Richelieu, dans les luttes
perpétuelles de la mère déçue contre le fils qui aimait mieux écarter
l'ancienne régente au caractère trop difficile, Marie de Médicis et Gaston
tiendront constamment parties liées ensemble. Il semble que dès la première
enfance cette préférence instinctive se trahisse. Avec quel soin la reine
s'occupe-t-elle des détails qui intéressent Gaston, le choix d'une nourrice,
par exemple : M. Florent d'Argouges en a proposé une ; qu'on interroge cette
femme consciencieusement ; qu'on sache si son lait
est toujours bon, si elle en a en quantité ; si elle aime le vin ; la qualité
et condition de ses parents ; s'il ne se trouve rien à redire en elle. Et si
elle est telle qu'on s'y doive arrêter, faites-la habiller incontinent afin
qu'elle soit nette et propre et toute prête quand je l'enverrai quérir[22]. Lorsqu'il
faudra trouver un gouverneur au petit prince, il ne sera assez grand
personnage pour cette fonction ; la reine choisira l'ambassadeur du roi à
Rome, M. de Brèves. Elle constituera à l'enfant une maison fastueuse avec
surintendant, compagnie d'hommes d'armes, gentilshommes de Quant aux trois filles, Elisabeth, Christine, Henriette,
elles s'effacent un peu au second plan. Les deux dernières sont trop petites,
avant 1617, pour que leur personnalité s'accuse. L'aînée, Elisabeth, d'un an
moins âgée que le dauphin, la seconde des enfants et qui paraît davantage,
est une bonne nature, douce, aimable. Madame de Christine, la seconde, est plus pâle. Elle grandit doucement sous la direction de sa gouvernante, mademoiselle Passart, à qui succède, en 1610, madame de Saint-Georges, la fille de madame de Monglat. La dernière, Henriette, la future reine d'Angleterre, est plus effacée encore, toute petite qu'elle est, et d'un caractère indécis. Il n'est question d'elles, autour de Marie de Médicis, que lorsqu'elles sont malades ; car tous ces marmots, comme dit Henri IV, garçons et filles, ont souvent quelque chose, la petite vérole, principalement. Sitôt que Tune est prise, on l’isole, première mesure que sache ordonner la reine, en faisant quitter Saint-Germain au reste du petit monde. Les médecins les plus écoutés sont MM. Delorme, Hautin et Lemaitre, attachés à la maison royale. On nourrit Christine de lait d'ânesse, pour la fortifier ; Christine sera un jour duchesse de Savoie[25]. Est-ce là toute la petite troupe des enfants royaux ? Hélas ! Marie de Médicis a dû subir que les enfants naturels d'Henri IV fussent indistinctement élevés avec eux ! On a eu beau expliquer à la reine que la coutume est admise en France, où le moindre gentilhomme campagnard, riche en progéniture de sortes variées, héberge tout son monde sous le même toit ; on a eu beau lui dire que du temps de Catherine de Médicis il y avait à la cour une fille naturelle de Henri II ayant rang de princesse, maison constituée, place au soleil avec sa qualité de Madame la bâtarde — les gens de Madame la bâtarde ; — elle s'est révoltée, puis a obéi ! Que faire ? Les enfants naturels du roi sont marchandises de sa boutique, dit plaisamment Giovannini, mercanzia della sua bottega ! Henri IV les tient pour bel et bien ses fils. Il n'a pas voulu que ceux-ci l'appelassent Monsieur, comme il était d'usage que les enfants naturels appelassent le roi leur père, à la cour de Catherine de Médicis, mais papa. Il les adore. Complètement oublieux de la déclaration signée un jour par lui dans laquelle il prescrivait que les bâtards de gentilshommes ne pourraient jouir des privilèges de noblesse, il les a légitimés, les a créés ducs, princes, leur a fait un sort brillant et les impose[26]. Voici d'abord les trois enfants de Gabrielle d'Estrées César, duc de Vendôme, qu'on appelait, avant qu'il fût duc, César-Monsieur ; Alexandre de Vendôme, qui sera fait grand prieur de France ; Catherine-Henriette, plus tard duchesse d'Elbeuf. Par un contraste qui n'est pas rare, fils d'une douce et aimable créature, les Vendôme sont d'un caractère insupportable, lorsque au contraire les deux enfants de l'orgueilleuse madame de Verneuil sont faciles à vivre. César, légitimé bien avant le mariage de Marie de Médicis, en 1595, gratifié dans l'Etat du rang qui suit immédiatement celui des princes du sang, est le plus désagréable de tous. Henri IV s'illusionne sur son compte. Il le croit d'un bon naturel ; et toutefois dès ses premières années sa mauvaise éducation était visible à tout le monde et sa malice si connue que peu de gens en évitoient la piqûre. Le roi le comble de grâces, de distinctions : au Louvre, le jeune duc habite un appartement situé à l'entresol, sous la chambre même du roi, faveur plus qu'insigne. C'est un mauvais drôle, violent, moqueur, brutal. On manqua l'arrêter une fois sur le Pont-Neuf parce qu'un jour d'hiver, s'amusant à jeter des boules de neige, il s'avisa de mettre une pierre dans l'une d'elles et blessa grièvement un gentilhomme au visage. Cet odieux enfant, Henri IV a voulu que Marie de Médicis le considérât comme sien. Par un abus d'autorité excessif, il a exigé qu'elle l'appelât mon fils et que quand elle lui écrivit elle signât : votre bonne mère ! Marie s'exécute. Le lendemain de la mort d'Henri IV, modifiant les formules, elle dira : Mon neveu de Vendôme, mes nièces de Verneuil. Les relations apparentes de la reine et de ce jeune César sont froides et correctes. Le petit écrit à Sa Majesté des lettres dignes et polies ; il fait même quelques légers cadeaux et la reine lui répond en l'assurant de son amitié et bienveillance. Il faudra bien, en 1609, accepter son mariage, préparé par Henri IV depuis dix ans, avec une opulente héritière, Françoise de Lorraine, fille unique du duc de Mercœur. Qui eût dit, le jour de cette brillante fête, à laquelle la cour entière assistait, que cinq ans après Marie de Médicis ferait arrêter M. de Vendôme ! Louis XIII, dauphin, déteste ce demi-frère ; et il n'est humiliation qu'il ne lui fasse subir[27] ! Alexandre, le second, qui est fait chevalier de Malte en 1604, au cours d'une grande et fastueuse cérémonie et que le dauphin appelle féfé chevalier, n'est pas mieux traité par lui. Le dauphin le bouscule, le rudoie. L'autre, qui n'est pas d'humeur accommodante, provoque souvent les irritations. Encore plus indifférente à l'égard de celui-ci qu'à l'égard de son frère, la reine le confiera à un mentor nommé M. Prudent, et, sous prétexte de lui faire aller voir le grand maître de Malte à la religion duquel il appartient, puis de lui former l'esprit par les voyages, en réalité pour se débarrasser de sa personne, lui fera entreprendre un grand voyage en Italie et à Malte, dont elle paie tous les frais. Mademoiselle de Vendôme jouit d'un sort plus favorable. On est plus bienveillant envers elle ; les princesses jouent volontiers en sa compagnie et la reine, moins mal disposée, lui accorde de légères faveurs, telle que celle d'ordonner à M. Donon, contrôleur des bâtiments du roi, d'établir une communication au Louvre entre le petit appartement de la future duchesse d'Elbeuf et l'appartement des filles de Marie de Médicis, afin que les enfants puissent se joindre facilement[28]. Bien plus aimables et sympathiques, avons-nous dit, sont
les deux enfants d'Henriette d'Entraigues, petits êtres attristés, doux et
craintifs : un fils, qui est appelé le marquis de Verneuil, et une fille à
laquelle Henri IV a donné le nom de la maîtresse qui avait précédé la mère,
Gabrielle ! Tout le monde les aime, même le dauphin et ses sœurs. Le dauphin
a voulu être le parrain du garçon, surprenante distinction de la part d'un
prince qui, en général, ne peut pas souffrir ses frères naturels, et il a
décidé que sa sœur Elisabeth, Madame, serait la marraine de Gabrielle !
Ensemble, tous, — ni Henri IV, ni Marie de Médicis, ni madame de Verneuil ne
devant être là, — ils ont organisé la cérémonie du baptême à Saint-Germain
avec une élégance sobre — on baptise les enfants, en ce temps, lorsqu'ils ont
six ou sept ans. — Un beau cortège a été formé : trompettes, fifres et
tambours en tête ; gentilshommes dans leurs atours escortant ; la compagnie
des gardes-françaises du château faisant la haie ; le personnel domestique
suivant. M. de Verneuil et sa sœur, vêtue de satin blanc, sont conduits dans
la vieille chapelle du château, bâtie par saint Louis, où l'évêque de Paris
vient leur conférer le sacrement ; et le soir, un grand dîner, présidé par le
dauphin, termine cette fête intime et enfantine[29]. Marie de
Médicis a un faible pour féfé Verneuil :
c'est certainement celui de ses neveux
qu'elle préfère et auquel elle écrit le plus volontiers. Conscient ou non de
sa position fausse, et cherchant à se la faire pardonner, le pauvre enfant
multiplie les marques d'attachement et de respect. La reine revient-elle de
voyage avec Louis XIII, il lui écrit pour lu dire la joie qu'il éprouve à
apprendre son retour e lui demander la permission d'aller au-devant d'elle
afin de la voir plus tôt. La reine touchée lui répond qu'elle consent
volontiers à ce qu'il vienne jusqu'à Longjumeau. Il n'est attentions et
égards qu'il n'ait. Louis XIII, pénétré des devoirs que la qualité de parrain
lui impose, l'entoure de soins. De très bonne heure Henri IV a eu l'idée de
faire de cet enfant un évêque ; il le fait nommer à Metz à peine baptisé.
Louis XIII suivra le petit évêque de Metz, s'occupant affectueusement de lui,
s'intéressant aux incidents de sa vie, et, bien que du même âge, lui donnant
des conseils. L'intimité des deux enfants, l'un le maître, protecteur
affectueux, l'autre, obéissant et tendre, est touchante. Mademoiselle
Gabrielle de Verneuil épousera plus tard le marquis de Les enfants de madame de Verneuil appellent leur mère : maman mignonne. Ils la voient de temps en temps, avec des précautions. Lorsque le roi sollicité a permis qu'Henriette d'Entraigues allât rendre visite à son fils et à sa fille, tantôt un gentilhomme est chargé d'aller prendre ceux-ci et de les conduire auprès de leur mère, soit à Paris, soit à Passy, soit ailleurs, pour huit ou dix jours, temps que, le cas échéant, on prolongera de deux ou trois jours ; tantôt madame de Verneuil vient elle-même à Saint-Germain. Si l'ordre n'a pas été donné de l'empêcher de voir le dauphin et ses sœurs, elle se hasarde à leur dire quelques mots. Elle caresse le dauphin, observe Héroard, mais, ce dit-on, avec peine. Toujours, en cas de maladie de l'un de ses enfants, on l'appelle : on lui donne une chambre dans le château ; on a quelques égards. Quand il s'agit de l'inévitable petite vérole dont est atteint soit le garçon, soit la petite fille, on isole madame de Verneuil, par précaution, la laissant au vieux château et envoyant le reste du monde princier au château neuf. D'une manière générale Henri IV, pas plus que Marie de Médicis, ne tient beaucoup à ce que madame de Verneuil fréquente ses enfants légitimes. Est-ce appréhension véritable ou pudeur ? Cette raison fait que la marquise ne peut venir à Saint-Germain que sur autorisation expresse de Sa Majesté, qui n'en abuse pas et que, le plus souvent, il ne lui est pas possible de rencontrer le futur roi, si ce n’est par occasion, mais non par dessein[31]. Cinq enfants légitimes, pour ne pas parler du premier duc
d’Orléans, mort trop tôt, et cinq enfants naturels, tel est ce qu'un familier
de la cour appelle irrévérencieusement le troupeau
de Saint-Germain. Ils vivent tous ensemble, jouant aux mêmes jeux, suivant
les mêmes exercices, prenant les mêmes repas : les rangs seuls différent, puisque
le dauphin sait faire sentir aux autres qu'il est d'une race meilleure et
comprendre à ses sœurs que leur qualité est supérieure : ils mènent la même
existence. Avec des personnels divers, des gouverneurs ou précepteurs
distincts, des appartements séparés, ils vivent assez confondus. Ils
organisent en commun de petites fêtes et principalement des ballets, genre de
divertissement royal très en faveur et dispendieux : celui qu'organise le duc
de Vendôme en janvier 1608 revient à Avec les ballets, les comédies sont le grand sujet de
divertissement : répétitions à renouveler, costumes à combiner, mise en scène
à prévoir, ornementation de la salle, la grande salle de François Ier, à
imaginer. Ce sont les filles, Elisabeth surtout, qui adorent ce genre de
plaisir. En 1611, Elisabeth désirant monter le Bradamante de Garnier,
demande la permission à sa mère, qui consent : Je
veux bien volontiers accorder à ma fille aînée la permission qu'elle désire
pour réciter sa comédie, mais elle doit bien apprendre les vers ; j'ai
l'intention d'aller dans peu de jours à Saint-Germain pour voir si elle s'en
acquittera bien et si elle les aura bien retenus ; vous l'en avertirez de ma
part afin qu'elle se dispose à bien faire ; à une condition cependant,
c'est qu'elle emploie bien le temps à servir Dieu et
à faire ses exercices ordinaires afin qu'étant au delà je m'aperçoive qu'elle
ail bien profité. Les rôles sont donnés ; il y a beaucoup d'acteurs.
Elisabeth, Christine, — pas Henriette, trop petite, — Gaston, Vendôme, les
Verneuil, le comte de Moret ; puis de petites amies, mesdemoiselles de Renel,
de Vitry, de Frontenac, pour un rôle insignifiant de domestique, mademoiselle
Sauvât, la fille de la femme de chambre de la reine ; quelques jeunes
garçons, le baron de Palluau. La fête sera donnée l'après-midi, dans la salle
de bal de Saint-Germain, et comme on veut qu'elle ait lieu aux chandelles, on
requerra des tapisseries, afin de boucher les grandes fenêtres. Il en faut
beaucoup. Estant encore besoin, écrit Marie
de Médicis à M. Delafont, intendant des meubles du roi, de quelques pièces de tapisseries pour mettre devant
toutes les fenêtres de la salle où se doit jouer la comédie, lesquelles se
doivent boucher à cause des flambeaux qui s'allument en plein jour, je vous
prie d'en envoyer d'autres, douze ou quinze pièces, des moyennes et des plus
usées[33].
C'est la reine qui adressera les invitations en son nom et au nom de la
troupe : De ma part et de celle de toute la
compagnie des comédiantes, je vous prie de venir voir leur comédie ; elle
sera demain récitée à une heure après dîner. Le plaisir que vous aurez à les
entendre supassera la peine et l'incommodité que vous pourrez recevoir par
les chemins. La salle étant vaste, nombre de gens sont invités,
beaucoup d'autres veulent y venir : princes, princesses, seigneurs,
courtisans, jusqu'au vénérable chancelier, au grave président Jeannin, au
premier président du Parlement. Primitivement fixée au dimanche 31 juillet,
puis retardée au mardi 2 août, la fête a lieu en présence d'une salle comble.
Comme il convient devant si noble assemblée, la séance annoncée pour une
heure ne commence qu'à trois. Au dire de Malherbe, qui était présent, Gaston
débutait par un petit prologue de six vers : Il
tenoit une pique qu'il branla vers la compagnie de si bonne grâce que cette
action et un petit saut qu'il fit en achevant lui attira un monde de
bénédictions. Malheureusement il était tellement empêtré dans des
hauts-de-chausses auxquels il n'était pas habitué, qu'on dut les lui retirer
pour lui rendre ses jupes. Elisabeth, qui joue Brada, vêtue en amazone, est
charmante. Quant à la petite Christine, on lui a seulement donné un petit
bout de rôle lui permettant de paraître un instant et de dire un mot afin
qu'elle ne pleurât pas. La fête fut très réussie. Marie de Médicis écrivait
le lendemain à Léonora Galigaï : Je vous dirai comme
la comédie de ma fille fut bien récitée en bonne compagnie et fit si bien et
si gentiment et toutes les autres aussi qui en estoient que j'en demeurai
avec beaucoup de satisfaction et de contentement. Moins complaisant ou
plus exact, Tallemant écrira plus tard qu'à part le comte de Moret les
acteurs étaient pitoyables[34] ! Parmi les personnes qui assistaient à cette fête, une de celles qui suivaient avec le plus de bienveillance, d'un air enjoué et bon, était une dame très laide, grosse, richement habillée, fort entourée, la reine Marguerite de Valois, première femme d'Henri IV. Quoique n'étant à peu près rien maintenant dans la famille royale, la reine Marguerite y remplit un rôle important de manière de tante à héritage, très dévouée aux enfants de Marie de Médicis qu'elle appelle mes neveux. En réalité elle semble de la famille, et elle parait même le parent le plus rapproché. Tant qu'elle avait été mariée avec Henri IV, qu'elle ne
pouvait pas souffrir, elle avait vécu loin de son mari. Du jour où l'union
des époux fut rompue, leurs relations devinrent courtoises. Henri IV appelle
son ancienne femme ma sœur et il n'est
prévenance qu'il ne lui prodigue. Ils s'assurent l'un l'autre qu'ils
s'aiment. Marguerite, en tout cas, est dune correction parfaite à l'égard du
roi. Leurs rapports sont tels qu'en Qu'y avait-il de vrai dans ces racontars ? Tous ceux qui
ont approché Marguerite parlent d'elle en termes excellents. C'était une
femme d'esprit, agréable, instruite, ayant beaucoup lu. Elle avait des goûts
littéraires, lettere di umanita et
philosophiques. Elle parlait extrêmement bien aussi
bien que femme de son temps, et écrivoit plus élégamment que la condition
ordinaire de son sexe ne portoit. Maîtresse de maison accomplie, elle
recevait mieux que personne, vive, spirituelle, aimable, toute à tous. Elle
aimait à donner des dîners dans lesquels elle s'entourait de préférence de
littérateurs. Ses fêtes, soirées, concerts, bals, étaient les plus réussis de
Paris et nombreux. Petit à petit elle était parvenue à constituer autour
d'elle une cour intelligente d'écrivains et d'artistes au milieu desquels vivant à la royale, d'une façon magnifique, elle avait fini par faire appeler sa
demeure le palais d'Alcine. En somme elle eut
le premier salon en date du XVIIe siècle et
elle représente la première des princesses intelligentes qui sut devenir le
centre d'un monde distingué. Legrain, qui l'a beaucoup fréquenté, écrivait : elle estoit d'une conversation si douce et sérieuse qu'en
toutes ses actions et jusqu'à sa table elle estoit extraordinairement
environnée de gens fort accomplis en toutes sortes de sciences, des discours
desquels, joints avec les siens, les assistants emportoient toujours quelque
bonne instruction ; et Richelieu ajoutait : Elle
étoit le refuge des hommes, aimoit à les entendre parler : sa table en étoit
toujours environnée. Dans sa riche bibliothèque — comptant entre
autres plus de mille manuscrits ; nous en avons le catalogue, — auteurs
latins et grecs, chroniqueurs français, pères de l'Eglise, livres de
philosophes et de moralistes, ouvrages de science, de médecine, de
jurisprudence figuraient, témoignant de l'éclectisme de ses goûts. Tous les
écrivains connus du XVIe siècle étaient représentés, Montaigne, Elle n'eût pas été complète si elle ne fût devenue très
charitable et très dévote. Elle offrait le pain bénit à Saint-Étienne du
Mont, suivait, sous un dais, les processions dans les rues, il est vrai portée à dos d'hommes ; entendait la messe chaque
jour et communiait trois fois par semaine. Sa générosité était inépuisable :
d'aucuns l'accusaient de donner sans discernement. Elle
départoit si abondamment l'aumône à tous les nécessiteux, qu'il n'y avoit
maison religieuse, dans Paris, qui ne s'en ressentît, ni pauvre qui eût
recours à elle sans en tirer assistance. Aussi Dieu récompensa avec usure,
par sa miséricorde, celle qu'elle exerçoit envers les siens, lui donnant la
grâce de faire une fin si chrétienne que si elle eut sujet de porter envie à
d'autres, durant sa vie, on en vient davantage de lui en porter à sa mort.
Lorsqu'elle mourut, ce devait être un concert unanime de louanges. Celui qui
écrivait les Complaintes et regrets des pauvres sur le tombeau de la reine
Marguerite, duchesse de Valois, interprétait le sentiment public, car
après tout, comme disait Pontchartrain, elle n'avoit
fait mal qu'à elle-même[39]. Pour mener le genre de vie luxueuse qu'elle avait adopté,
il lui fallait beaucoup d'argent. Elle était riche. Ses domaines étaient
considérables. Héritière de Catherine de Médicis, sa mère, qui avait eu une
grande fortune, elle possédait des biens en quantité. Avec ses revenus
d'Auvergne, des pensions obtenues d'Henri IV, grâce aussi à des combinaisons
et des échanges fructueux, elle était parvenue à s'assurer un revenu de Mais point n'était besoin de cette donation pour rendre
cordiales ses relations avec Marie de Médicis. Les rapports des deux reines étaient
excellents. Moitié humeur personnelle de Marguerite, facile et accommodante,
moitié volonté arrêtée chez elle de rester bien avec la reine titulaire, ne
fût-ce que pour ne pas être obligée de quitter Paris, en cas de brouille, la
duchesse de Valois faisait tout ce qui dépendait d'elle afin de maintenir
l'entente. Marie de Médicis, reconnaissante de ces bonnes dispositions, se
prêtait de son mieux à conserver la bonne intelligence. Sitôt que quelque
mouche de Cour colportant un propos suspect pouvait réussir à provoquer un
nuage entre les deux femmes, Marie s'empressait d'écrire à sa chère sœur afin de dissiper le malentendu : elle
prenait les devants ; visiblement elle tenait même à cette amitié.
Marguerite, de son côté, était pleine de prudence et de précautions. Au lieu que les moindres femmes brûlent tellement d'envie
et de haine contre celles qui tiennent le lieu qu'elles estiment leur
appartenir qu'elles ne les peuvent voir, elle, au contraire, non seulement
allait voir souvent la reine, mais lui rendit jusqu'à la fin de ses jours
tous les honneurs et devoirs d'amitié qu'elle pouvoit attendre de la moindre
princesse. Il n'était petites attentions qu'elles n'eussent à l'égard
l'une de l'autre, Marie invitant Marguerite à venir la voir à Montceaux, Marguerite
faisant des cadeaux ; toutes deux se protestant réciproquement de leur entière affection mutuelle. Au baptême de
Gaston, en 4614, la duchesse de Valois consentit, avec empressement, à être
marraine du prince. Si Marguerite avait quelque affaire, qu'un M. de
Saint-Chamans se fût oublié à lui dire en son logis
des insolences avec grande indiscrétion, puis fût allé répéter partout
des paroles indiscrètes à son désavantage,
elle venait se plaindre à Marie de Médicis et celle-ci, prenant à cœur les
doléances de son amie, écrivait au chancelier de Sillery, au connétable, afin
qu'on poursuivît le coupable et qu'on le châtiât. Sujet plus délicat, la
duchesse de Valois avait-elle des embarras d'argent, — et il lui arrivait, en
raison de sa profusion, de connaître les heures difficiles, — elle
s'adressait à Marie de Médicis. Un jour que celle-ci, reine régente, était
sollicitée de donner ainsi N'ayant pas pu donner d'héritier au roi et ayant accepté l'annulation de son mariage, afin de permettre à Henri IV d'avoir des enfants, Marguerite se trouva des trésors de tendresse envers les petits princes dont elle eût voulu être la mère ! Elle les comblait de cadeaux : elle les emmenait avec elle à la foire de Saint-Germain pour leur acheter tout ce qu'ils pouvaient désirer : elle les gâtait. A Issy, propriété où elle aimait à aller, elle invitait les enfants et leur mère à venir goûter. Marie de Médicis, enchantée de ce dévouement, voulut que le dauphin appelât celle qu'il nommait jusque-là ma tante, maman ! Le petit fut un peu interloqué. Tout ce qu'il put faire fut de dire maman ma fille, on ne sait pourquoi ma fille[42] ! Ce fut par acte notarié du 10 mars 1606 que la reine
Marguerite fît donation entière de ses biens meubles
et immeubles au futur Louis XIII. Elle venait de gagner un gros procès
intenté, en revendication précisément de ces biens, à Charles de Valois,
comte d'Angoulême, fils naturel de Charles IX — lequel comte d'Angoulême
avait reçu d'Henri III de grands biens provenant de la succession de
Catherine de Médicis. — Le testament de Catherine de Médicis en faveur de sa
fille étant formel, Charles de Valois se trouvant en disgrâce à Du côté de Marie de Médicis, en Italie, les parents affluent. Oncles, tantes, sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, on en compte une vingtaine, à ne parler que des moins éloignés. Leurs lettres à la reine de France sont continuelles, accablantes. Ils jouent le rôle de modestes parents de province, fiers du succès d'un des leurs qui est arrivé et perpétuellement indiscrets à son égard. Il faut faire une place à part au grand-duc et à la grande-duchesse de Toscane, l'oncle et la tante de la reine. Le grand-duc tâcha longtemps de servir un peu de père à Marie de Médicis, lui donnant des conseils, des avertissements, des leçons. Tenu au courant de ce qui se passait à Paris par ses envoyés, il s'efforçait de mettre la paix dans le ménage royal, prodiguant les consolations à sa nièce, multipliant les invites au calme, à la patience, à la résignation, parfois se fâchant et disant des vérités. Au fond Marie l'aimait. A la fin, elle s'impatienta de ce rôle de mentor que prenait son oncle. Elle déclara à Guidi, pour que celui-ci transmît son sentiment à Florence, qu'elle était excédée d'être ainsi traitée par sa famille comme une petite fille, une enfant ; qu'elle était reine de France, mère de cinq enfants et qu'elle refusait de se soumettre plus longtemps à cette discipline. Le grand-duc un peu surpris se le tint pour dit. D'ailleurs ses relations avec Henri IV n'étaient rien moins que cordiales. Fatigué des intrigues, des disputes, des ennuis dont les Italiens entourant la reine étaient le motif ou le prétexte, à tort ou à raison, le roi en attribuait la cause initiale au grand-duc. Il ne pouvait pas le souffrir. Tout ce que faisait celui-ci était pris en mauvaise part. Le grand-duc envoyait-il, par attention gracieuse, des fruits d'Italie, Henri IV relevait aigrement que le grand-duc n'expédiait à Paris que des oranges et des limons, tandis qu'il faisoit en Espagne des présents de trente et quarante mille écus. Il ne lui écrivait jamais autrement que pour les affaires et de ces lettres officielles impersonnelles rédigées par des secrétaires. Néanmoins les apparences demeuraient convenables. Les deux familles échangeaient des présents, Marie de Médicis donnant à son oncle six chevaux de carrosse, ou bien plusieurs petites besognes avec quelques bardes dans une malle ; de Florence le grand-duc expédiant soieries, bijoux, comestibles, graines de choux-fleurs. Lorsque l’oncle mourut en 1609, Marie de Médicis fut réellement affligée ; Henri IV dut prendre des précautions pour lui annoncer la nouvelle, et la cour se mit en grand deuil[45]. Avec la grande-duchesse de Florence, sa tante, les rapports de Marie de Médicis sont plus faciles. La grande-duchesse, qui est presque du même âge que la reine, ne s'avise pas de la morigéner. Bien qu'il y ait eu jadis entre elles quelque sujet de froissement, on a oublié de part et d'autre. En bonne tante, la grande-duchesse s'intéresse surtout aux enfants ; elle demande à madame de Monglat de lui envoyer des nouvelles : c'est la bourgeoise tranquille et affectionnée, aux petits soins avec ses neveux et nièces auxquels elle adresse force cadeaux. Aussi la reine finit-elle par la tenir en grande sympathie : Je n'ai point eu de consolation, lui écrit-elle au moment de la mort d'Henri IV, en la grande douleur que j'endure, qui m'ait apporté plus d'allégement que celle que je reçois de vous[46]. Bourgeoises paraissent les lettres de la grande-duchesse
aux enfants ; encore plus bourgeoises semblent les relations de la reine avec
sa sœur Eléonore de Médicis, épouse du duc Vincent de Mantoue. Ce sont entre
les deux sœurs les mille détails ordinaires à des femmes qui échangent des
recettes, se font réciproquement des commissions, s'entretiennent d'enfants,
de questions de santé, de chiffons : Je vous envoie,
écrit Marie de Médicis, ces trois pièces de toile
que l'on appelle ici du quintin, qui est propre pour faire des rabats et
colets, mais non pour des fraises. Elle m'a semblé être quasi semblable au
fil d'Inde de Mantoue ; elle ne se met point à la lessive, mais on la lave
avec du savon. Si vous la trouvez belle et que vous en désiriez davantage,
faites-le-moi savoir et je vous en enverrai. De Mantoue on expédie à
la reine des fromages, des saucissons, des fruits,
sur deux mulets. La duchesse Eléonore est-elle malade d'une affection
dont les médecins italiens ne viennent pas à bout, après force échanges
d'observations, Marie de Médicis décide sa sœur à lui envoyer la description
détaillée de son mal et elle soumet le cas au premier médecin du roi, M. du
Laurens, au médecin de la reine, M. Martin, tous
deux très excellents, pour que ceux-ci donnent une consultation. Le
banquier de Marie de Médicis, chargé des affaires d'argent avec l'étranger,
Jean André Lumagne, touche Dans le courant de l'année 1608 arrivait également à Paris
un seigneur italien d'une quarantaine d'années nommé Jean de Médicis :
c'était l'oncle naturel de la reine, fils bâtard du grand-père de Marie de
Médicis. Militaire de valeur, ingénieur éminent, homme d'esprit distingué qui
a écrit des Aphorismes politiques, des Discours académiques, et
s'occupait de littérature, d'architecture, de sciences occultes, Jean de
Médicis avait brillamment servi les armées espagnoles en Flandre ; il venait
d'Angleterre où il était allé voir Ce ne fut pas le seul parent d'Italie qui causa des ennuis
à la reine. Bien d'autres cherchèrent à l'exploiter. On trouve chez certains
des exigences et des inconsciences déconcertantes. Marie de Médicis avait à
Rome une cousine qui avait épousé le duc de Sforza : le ménage n'allait pas.
La femme, prenant la reine pour confidente, lui contait ses malheurs, les
brutalités du mari, ses désespoirs. Un jour, le mari s'avisa de demander à
Paris une pension, à titre de parent, et après quelques impatiences Henri IV
consentit à lui accorder |