RÉCITS DE L’HISTOIRE ROMAINE AU Ve SIÈCLE
CHAPITRE VII — JULIUS NEPOS — AUGUSTULE.
Administration de Nepos. - Abandon de l’Auvergne aux Visigoths. - Révolte du patrice Oreste. - Romulus Augustus, surnommé Augustule, empereur. - Il refuse aux auxiliaires barbares le partage des terres de l’Italie. - Révolte des auxiliaires. - Ils prennent Odoacre pour roi. - Meurtre d’Oreste et déposition de son fils.474 - 476
Nepos, alarmé de la froideur publique, s’efforça d’effacer
par ses premiers actes la tache de son origine. Son naturel sérieux, son
maintien modeste et doux, contrastaient avec la folle inconsistance qui avait
caractérisé Glycerius. Il se montrait particulièrement respectueux envers le
sénat et désireux de lui plaire. Tous ces trafiquants d’emplois, tous ces
vieillards riches et incapables dont le dernier règne avait peuplé la haute
administration, cédèrent la place aux meilleurs citoyens appelés sans
distinction de rang ni de fortune. Un jeune homme pauvre et de naissance
médiocre, ruais d’un mérite reconnu, fut élevé d’emblée à la préfecture de la
ville, poste difficile et. le plus important de l’État après les grands
offices du palais. Cette nomination et d’autres encore, dictées par le même
esprit, concilièrent à Nepos les gens non prévenus : on y applaudit, mais
plus peut-être hors de Rome, qu’à Rome même, et dans les provinces qu’en
Italie. Sidoine à son cher Audax, salut. Je
voudrais savoir de toi où se cachent en ce moment ces hommes qui
s’applaudissaient hier d’avoir entassé trésor sur trésor et se pâmaient
d’aise devant les monceaux d’un argent si vieux qu’il en était noir. Je
voudrais savoir où sont allés ces gens qui écrasaient superbement leurs
cadets par le seul avantage de leur âge. Et ces autres dont l’extraction se
reconnaît tout de suite à l’aigreur des haines qu’ils fomentent, dis-moi, que
sont-ils devenus ? Leur règne vient de finir ; il n’y a place aujourd’hui que
pour les bonnes actions : la balance du prince ne pèse plus les écus, elle
pèse le mérite et les mœurs. Ceux qui s’imaginaient insolemment que le poids
de l’argent fait celui des hommes, et qui, couvrant leurs vices du manteau de
leur opulence, imputaient à la vanité et aux intrigues l’élévation des
autres, ceux-là sont heureusement restés à terre ; qu’ils y cuvent leur venin
! Ne t’inquiète point d’eux, marche sous les nouveaux honneurs qui te sont venus chercher, toi, qui as toujours travaillé, qui n’as voulu devoir ta préfecture qu’à tes services, et qui, fils de noble race, songes plus à l’éclat de ta descendance qu’à celui de tes ancêtres. Est-il rien de plus digne et de plus généreux que de vouloir effacer soi-même par ses actions les splendeurs d’un nom glorieux ! Il ne me reste plus qu’à prier le Seigneur de t’accorder encore cette grâce, que tu voies tes fils te surpasser à leur tour. Et puissent aussi les jaloux, que ronge le chagrin de tes prospérité, en éprouver longtemps le supplice ! C’est bonne justice quand, sous un équitable prince, on laisse croupir dans l’oubli des gens qui n’ont rien de grand que leur patrimoine, et dont la fortune, si haute qu’elle soit, ne compense ni la pauvreté d’esprit ni la bassesse de coeur. Adieu[3]. C’était bien pensé et bien dit ; malheureusement les réformes dictées par une si louable intention étaient pleines de dangers : ces hommes puissants et indignes que le prince chassait des places, allèrent grossir la phalange de ses ennemis. Tandis que Nepos, par la droiture de ses intentions, essayait de désarmer ses adversaires, une série de révolutions survenues à Constantinople absorbait l’attention des Orientaux, et leur faisait perdre de vue les affaires de l’Occident. Par une fatalité déchaînée contre lui dès son début, le neveu de Marcellinus perdit son protecteur au moment où mettant le pied en Italie, il avait. le plus besoin d’appui : Léon mourait au mois de janvier de cette même année 474, après s’être associé, comme César, son petit-fils, né de sa fille Ariadne, et de l’Isaurien Zénon, et nommé Léon comme lui. Cette mort ramena le jeune César, enfant débile et maladif, sous la tutelle d’un père, volontairement écarté du trône, pour son impopularité et ses vices ; car le vieil empereur, tout le monde le savait, n’avait appelé le fils qu’afin d’exclure le père. Toutefois, la possession d’un pouvoir précaire attaché à la courte vie d’un enfant ne contentait point Ariadne et encore moins sa mère Vérine, femme altière, ambitieuse, habituée à régner : elles s’entendirent pour faire passer la pourpre sur les épaules de Zénon. Il s’organisa, dans ce but, au palais impérial, une petite comédie de famille qui fut jouée plus tard au grand cirque, en présence du peuple et de l’armée, lorsque le jeune César reçut des mains du sénat l’investiture solennelle du manteau d’auguste. Au moment où Zénon, patrice et généralissime, vint à son tour fléchir le genou devant le prince et lui promettre fidélité, l’enfant, détachant de ses cheveux le diadème qui les ceignait, en entoura le front de son père[4]. Cet acte accompli avec une grâce étudiée fut couvert d’applaudissements. Des sénateurs gagnés par Vérine et les soldats largement repus remplirent l’air de cris enthousiastes, tandis que la foule restait ébahie au spectacle de tant de vertus domestiques. Dix mois après, l’enfant mourait, et Zénon restait seul empereur. La scène changea aussitôt. Maître absolu de la puissance souveraine, l’Isaurien se livra sans frein aux grossiers penchants de sa nature : il disait que celui-là ne régnait pas, à qui il n’était pas permis de tout faire. Le crime, la débauche, le ridicule marchaient de pair dans les vices de cet homme qui tenait à orgueil de braver tous les sentiments honnêtes : il se fit teindre les cheveux et la barbe, s’habilla comme un baladin, et s’entoura d’ignobles favoris. Ariadne rebutée fut chassée du palais ; Vérine elle-même, à qui il devait tout, perdit son crédit et son rang ; mais la redoutable impératrice, si experte en machinations, eut bientôt assuré sa vengeance. Elle avait, dans les murs d’Héraclée de Thrace, un frère exilé, ce lâche et avare Basilisque qui vendit, en 468, au roi des Vandales Genséric, l’inaction de la flotte romaine devant Carthage[5], et depuis ce temps-là dépensait le prix de sa trahison en complots impuissants, haï de l’empereur et méprisé du peuple : Vérine lui fit entrevoir la route du trône. Elle l’encouragea, elle l’aiguillonna sans relâche, se chargeant de préparer en sa faveur le sénat et l’armée, tandis que lui-même, à force d’argent, pousserait sur Constantinople les Goths de Théodoric le Louche. Cette trame s’ourdit entre Héraclée et Byzance avec une incroyable célérité et un secret plus inexplicable encore[6]. Zénon, plongé dans une torpeur léthargique, ne se doutait encore de rien, quand déjà il était perdu. Pour épargner à la comédie qui marchait si bien un dénouement tragique, Vérine alla trouver son gendre et lui révéla tout, excepté la part qu’elle avait prise au complot. C’en est fait de ta vie, ajouta-t-elle, mais il m’est possible de te sauver, si tu veux partir à l’instant ; dans quelques heures, il sera trop tard. Lorsque tu auras passé le Bosphore, tu apprendras par toi-même ce que tes ennemis te destinaient. Une barque était toute prête, Zénon s’y jette et court se cacher dans Chalcédoine[7]. A peine avait-il touché la rive asiatique, que des hommes apostés appellent le peuple aux armes : Constantinople est remplie de tumulte, des mutins assaillent le palais impérial, et les statues de Zénon sont traînées à travers les rues. Vérine hâtait la crise dans le but de faire élire empereur, avant l’arrivée de Basilisque, son favori Patricius, car elle jouait du même coup son frère et son gendre : un temps d’arrêt la perdit. Basilisque, survenant à l’improviste, sème l’or à pleines mains, gagne la populace et se fait proclamer dans un faubourg. Patricius est mis à mort, Vérine gardée à vue au fond du palais[8], et Basilisque affermit son usurpation par la terreur. Cette femme indomptable ne s’avoua point vaincue. Changeant de front dans ses manœuvres, elle se réconcilie avec son gendre, dont les Isauriens avaient embrassé la cause, et qui sut, avec des succès divers, se maintenir dans l’extrême Orient. Toute captive qu’elle était, elle ourdit de concert avec lui de nouveaux lacs pour envelopper son frère et le lui livrer, comme elle l’avait livré lui-même à Basilisque[9]. Ces intrigues mêlées de guerres et de révolutions religieuses dont je parlerai plus tard remplirent les années 474 et 475, et absorbèrent l’attention des Romains orientaux. D’ailleurs la disgrâce de Vérine sous Zénon d’abord, puis sous Basilisque, retomba naturellement sur Nepos dont elle avait été la protectrice près de Léon, et qui de plus avait épousé sa nièce ; de sorte qu’une entreprise, formée si péniblement et à si grands frais pour rétablir l’ascendant de l’empire d’Orient sur l’Italie, ne trouva plus à la cour de Constantinople qu’antipathie et répugnance. La flotte orientale rappelée sur ces entrefaites et
Domitianus parti, Nepos sentit qu’il n’avait à compter désormais que sur
lui-même. Il se mit à l’oeuvre avec courage, mais les difficultés de sa
position semblèrent s’accroître par les efforts mêmes qu’il faisait pour les
surmonter. Il avait à se défendre d’abord contre les illusions qu’il inspirait,
et ce n’était pas la tâche la moins périlleuse. Récompenser Ecdicius de son énergie patriotique, c’était presque déclarer la guerre au roi de Toulouse ; et Nepos, malgré toute son est.ime6pour les braves Arvernes, aurait peut-être hésité longtemps, si Euric n’eût, le premier, rompu la paix. Interprétant la chute de Glycerius précisément comme les Gallo-romains, il avait équipé une armée en toute hâte, et s’était jeté sur le Berry, sans l’ombre de provocation. D’effroyables ravages, toujours accompagnés de profanations religieuses, signalèrent son passage à travers le Limousin ; Bourges épouvantée ouvrit ses portes ; mais l’Auvergne, restée seule, ne faiblit point ; le roi goth fut contraint d’assiéger en règle la ville de Clermont. Ecdicius, hors d’état de livrer des batailles rangées, tint la campagne avec des bandes de montagnards composées en partie de ses clients. L’évêque, son beau-frère, accepta le soin de défendre la ville ; à eux deux, ces hommes héroïques saurèrent leur pays. Tandis que Sidoine, pasteur et général de ses ouailles, les conduisait de l’église au rempart et du rempart à l’église, les dirigeant par ses avis ou les réconfortant par la prière, Ecdicius harcelait l’ennemi, troublait ses travaux d’attaque et lui coupait les vivres. La faim sévissait arec force dans les deux camps, lorsque l’hiver arriva : Euric fit retraite vers Toulouse, vaincu, humilié, et jurant qu’il se vengerait bientôt d’Ecdicius et des Arvernes. On eût pu croire que l’exemple de La consternation fut grande, à cette nouvelle, dans le
conseil impérial. Que restait-il à essayer ? Licinianus avait, une réputation
incontestée d’expérience et d’habileté[14] : là où un tel
négociateur avait échoué, quel autre prétendrait réussir ? La guerre semblait
donc inévitable, et peut-être, avec sa dernière province, l’empire d’Occident
allait voir bientôt disparaître sa dernière armée. D’un autre côté, secourir La noblesse de Ligurie était alors considérée comme la tête
des populations italiques, par sa richesse et par son intelligence, et après
le sénat de Rome, le conseil de Milan pouvait passer pour la représentation
la plus solennelle de l’Italie. Tous les regards se tournèrent donc avec une
curiosité inquiète vers l’assemblée des cités liguriennes. Elle se réunit à
Milan, suivant l’usage, nombreuse, imposante, tous les hommes considérables
de la province s’étant fait un devoir d’obéir à l’appel du prince[15]. Les délégués
examinèrent de nouveau une situation qu’ils ne connaissaient que trop bien ;
ils en discutèrent un à un tous les remèdes ; et après une mûre délibération,
l’assemblée ne conclut point à la guerre ; elle vota pour une reprise des
négociations. Néanmoins, comme la politique semblait avoir épuisé toutes ses
ressources, l’assemblée conseilla de recourir à l’autorité de la religion, en
choisissant un négociateur ecclésiastique. Celui-là, Il n’y avait pas de temps à perdre ; dans quelques
semaines des milliers de Goths allaient envahir les provinces gauloises.
Épiphane passa les Alpes par le chemin le plus court, obligé souvent de
coucher en plein air[17]. Son entrée à
Toulouse ressembla presque à un triomphe. Le principal ministre d’Euric vint
au-devant de lui, jusqu’au delà des portes ; le roi, lui-même, soit calcul,
soit respect ou crainte superstitieuse, lui fit un de ces accueils qu’il ne
prodiguait pas aux Romains[18]. Il consentit
même à désarmer, si l’empereur lui cédait amiablement l’Auvergne[19] ; à cette
condition, et à celle-là seulement, il signerait la paix. Telle fut la
réponse qu’Épiphane rapporta de sa mission. Si dur que fût le sacrifice,
Nepos dut s’y résigner ; il abandonna l’Auvergne pour conserver Pendant le cours des négociations, l’Auvergne avait passé par toutes les alternatives de la confiance et du découragement. Il lui sembla d’abord que Dieu même lui venait en aide avec Épiphane. Toutes les souffrances réunies s’étaient appesanties sur elle. Comme les récoltes avaient été brûlées par les Goths l’été précédent, les habitants de Clermont mouraient de faim : on quêtait pour eux du blé dans les villes voisines et jusqu’à Lyon[23]. Ecdicius, dit-on, nourrit de ses deniers quatre mille personnes[24]. Cette malheureuse cité espéra jusqu’au bout, supportant avec une constance surhumaine des maux qui lui venaient de son dévouement à la foi catholique en même temps qu’au nom romain. Mais quand tout fut consommé, quand les Arvernes virent leur pays rejeté de l’empire et son sort débattu dans une commission de Gaulois Narbonnais qui ne songeaient qu’à eux-mêmes, ils furent saisis d’un violent désespoir. Tantôt ils demandaient qu’on leur rendît la guerre, plus sainte, à leurs yeux, qu’une pareille paix ; tantôt ils menaçaient d’émigrer tous en masse, à l’exemple des vieux Gaulois leurs ancêtres, avant de devenir les esclaves, ou suivant le mot énergique de Sidoine, les condamnés des Goths, car que seraient-ils sinon des criminels, pour des ennemis qu’ils avaient vaincus ? Quoi donc, écrivait l’évêque de Clermont à celui de Marseille, Græcus, un des commissaires du traité ; quoi ! la servitude des Arvernes est aujourd’hui le prix de la sécurité des autres ! Ô douleur ! la servitude des Arvernes. Voilà ce que nous ont valu la flamme, le fer, la famine, la peste si généreusement acceptés ! C’était en vue de cette belle paix que nous arrachions, pour la manger, l’herbe sauvage de nos remparts ! Plutôt un nouveau siège, plutôt les combats, plutôt les veilles et la faim ![25] Tandis que l’évêque de Clermont faisait entendre ces
plaintes éloquentes aux évêques chargés de la rédaction du traité, son
beau-frère, Ecdicius, déclarait hautement qu’il ne s’y soumettrait pas, qu’il
ne deviendrait pas hérétique et Goth ; et se jetant avec ses clients dans une
position inexpugnable hors de la province, il s’y retrancha et appela L’armée réunie sous les murs de Rome se composait des corps qui avaient pris parti pour Nepos, et de ceux qui, restés fidèles à Glycerius, s’étaient dispersés, lorsque leur chef leur avait donné, par sa retraite précipitée vers la mer, le signal de la déroute. Répandus dans la campagne de Rome, ils l’infestaient de leurs brigandages ; et une fois la guerre terminée, Nepos s’occupa de les rallier et de les refondre avec les premiers, afin de reconstituer sur son ancien pied l’armée italienne. Il semble qu’Oreste avait été chargé de ce travail. Soit que le Pannonien, voyant Glycerius s’abandonner lui-même, eût déserté sans scrupule pendant la lutte, entraînant avec lui la garde impériale, dont il était un des chefs influents ; soit qu’il eût attendu, suivant son habitude, que la fortune eût prononcé ; on le retrouve, après la victoire, à la tête de l’armée reconstituée, et le plus important des généraux de Nepos. Il avait son quartier général à Rome même dont il occupait le territoire, tandis que l’empereur était rentré dans Ravenne, véritable siége du gouvernement et métropole des affaires[28]. Ce voisinage de Rome, dangereux pour la discipline des soldats, l’était encore plus pour la fidélité des officiers. C’est là que se donnaient carrière, avec une liberté qu’ils n’eussent pas osé invoquer ailleurs, les partis ennemis de Nepos : fonctionnaires disgraciés de Glycerius, sénateurs oubliés par le nouveau prince, vieux Romains dont l’orgueil ne se mesurait pas à la vérité des choses, et qui voyaient de bonne foi, dans une intervention de l’empire d’Orient, un attentat contre Rome et une oppression pour l’Italie, ambitieux de toute classe, fauteurs de révolutions sous le masque du patriotisme occidental. Ni les bonnes intentions de Nepos, ni ses efforts pour les réaliser n’avaient réussi à le rendre populaire : la fortune semblait prendre un cruel plaisir à tout déjouer. Tandis qu’il eût fallu quelque grand service rendu ou quelque grand éclat jeté sur l’Occident., pour effacer dans le protégé de Léon la tâche de son origine orientale, son règne ne se signalait depuis treize mois que par des humiliations ou des malheurs publics. On eût dit que sa mauvaise fortune aggravait encore celle de l’empire. L’amère critique dont ses actes étaient l’objet dans la ville éternelle parut aisément à des généraux avides de pouvoir un appel à la révolte. L’histoire ne saurait affirmer, en l’absence de documents positifs, que le sénat ou une notable partie du sénat prit une part directe au complot qui ne tarda pas à s’organiser sous les murs de Rome ; mais l’attitude des sénateurs vis-à-vis de ce malheureux prince fut si ouvertement hostile, que l’empereur d’Orient put leur dire plus tard avec justice : C’est vous qui l’avez renversé ![29] Dans ce tourbillon de préjugés et de passions qui travaillaient pour lui, Oreste, clairvoyant et réservé, se tenait prêt à tout événement. Sans se compromettre par de vaines paroles, il aidait la désaffection à se glisser peu à peu parmi les soldats. La présence de Domitianus et des auxiliaires grecs dans les troupes de Nepos, pendant la dernière guerre, était une arme à deux tranchants, redoutable dans la main des provocateurs de désordre, qui sans doute ne la laissaient pas reposer. A ceux qui avaient fidèlement soutenu Glycerius, ils pouvaient dire : Vous avez été vaincus par des Grecs ; aux soldats de Nepos : Vous avez marché à la suite d’un Grec. Ce fait, présenté comme une injure, offensait ces esprits grossiers ; et la vanité barbare prenait parti pour l’orgueil italien. L’ordre reçu tout à coup d’aller en Gaule remettre la cité d’Auvergne aux Visigoths réveilla en outre dans ce ramas d’étrangers des idées qu’il eût été plus prudent de ne point exciter. Qu’iraient-ils faire au delà des Alpes ? Assister au partage de l’un des territoires les plus fertiles de l’Occident, le livrer à des barbares, et comprimer au besoin la résistance des provinciaux dépossédés. Quand Rome traitait si généreusement ses ennemis, pourquoi ses défenseurs étaient-ils réduits à une maigre paie pour prix de leur sang ? Le temps des auxiliaires ne viendrait-il pas aussi ? Les soldats de Rome ne demandaient qu’à être traités comme les Visigoths ! Des pensées de ce genre s’agitaient dans beaucoup de têtes, et sans les approuver ni les combattre, ou, pour mieux dire, en les combattant mollement, Oreste laissa se développer ce terrible ferment qui devait tout emporter. Ainsi se noua entre le compagnon d’ Attila et les anciennes bandes du roi des Huns on ne sait quel contrat bizarre ; un accord tacite, un complot sans engagement mutuel, mais qu’une des parties put invoquer après le succès. Si Nepos, instruit de ce qui se passait, crut porter remède à ces manoeuvres en éloignant Oreste avec une partie de son armée, il se trompait étrangement sur la gravité du mal et ne connaissait guère l’homme à qui il avait affaire ; car, après avoir résolu l’éloignement des troupes, il ne prit aucune mesure pour l’assurer. Aucune ne fut prise non plus, pour garantir Ravenne contre une attaque possible. L’armée d’expédition partit de Rome, au commencement de mars, par la voie militaire qui conduisait en Gaule à travers l’Étrurie, et, se bifurquant à Forum-Livii, se dirigeait de là sur l’Adriatique : c’était à la fois la route de Milan et celle de Ravenne[30]. Elle marchait silencieusement, à grandes journées, irritée au fond, mais ne dénotant par aucun de ses actes un état actuel de révolte : aussi la surprise de Nepos fut complète. Selon toute apparence, c’est à Forum-Livii qu’Oreste, maître de la route de Ravenne et tenant l’empereur sous sa main, leva le masque et déclara à sa troupe qu’il ne la menait pas hors de l’Italie déshonorer le nom romain, mais à Ravenne où elle aurait occasion de le venger. Chefs et soldats protestèrent qu’ils étaient prêts à le suivre. Quant à Nepos, il restait comme assoupi dans sa sécurité.
Lorsque des bruits vagues vinrent exciter tout à coup son attention, il
observa avec anxiété cette marche mystérieuse de son patrice, perdant en
conjectures et en hésitations un temps précieux pour agir. Il eût pu dès le
principe appeler à lui les corps disséminés en Ligurie, et se fortifier dans
Ravenne : bientôt il fut trop tard ; le passage se trouva fermé par
l’approche des colonnes ennemies et la mer seule lui resta. Dans cette
conjoncture, il rit appareiller un des navires du port, pour s’y jeter à tout
événement. Aucun effort ne fut tenté pour défendre la ville ; et au moment où
l’avant-garde d’Oreste attaquait la longue et étroite chaussée coupée de
ponts, qui reliait Ravenne à la terre ferme[31], Nepos gagna le
quartier de Classe, et s’embarqua[32]. Suivant toute
vraisemblance, sa petite flotte dalmate prit le large avec lui. Ainsi le
neveu de Marcellinus regagnait Salone qu’il avait quittée quatorze mois
auparavant, si plein d’espérances déçues, et où Glycerius l’attendait. Les
deux ennemis allaient se retrouver face à face dans une singulière parité de
destin : tous deux empereurs d’Occident dépossédés et exilés, tous deux
partageant l’administration de Oreste fit son entrée à Ravenne le 28 mars de l’année 475[33], et, contre toute attente ; il ne s’installa point, du moins comme empereur, dans le palais resté vacant ; 11 lie prit point la pourpre, et si les soldats la lui offrirent, il la refusa. Ce n’était pas là son jeu. Soit qu’il affectât clé suivre en tout la tradition des patrices barbares, plus confiant dans leur stabilité que dans celle des Césars ; soit qu’il craignît de payer trop cher ses complices, s’il acceptait la souveraineté pour lui-même, il déclara n’en point vouloir, et son refus rejeta l’Occident dans l’embarras des interrègnes. Celui-ci dura deux mois, pendant lesquels Oreste fut censé chercher un candidat qu’il ne trouvait pas, et pendant lesquels aussi, comme on le pense bien, aucun ne vint s’offrir à son choix. Le sénat, les villes, l’armée, se montraient impatients d’en finir, quand un coup de théâtre leva soudainement les incertitudes. J’ai dit, plus haut, qu’Oreste, venu en Italie après la
mort d’Attila, y avait amené sa famille composée de son père ou de son beau-père
le comte Romulus[34], de sa femme
jeune encore, et d’un frère nommé Paulus qui s’était attaché à sa fortune.
Depuis leur établissement au b la tête de cet enfant le double souvenir du fondateur de
Rome et du premier de ses empereurs. Ce rapprochement puéril passa plus tard
pour une prophétie. Suivant l’usage romain, le jeune fils d’Oreste fut
désigné par son surnom d’Augustus et plus familièrement par le diminutif
Augustulus, qui signifiait le petit Augustes. Il grandit près de son père, au
milieu des soldats, et comme il était gracieux et beau[35], (l’histoire a pris soin de
nous le dire), il devint l’idole de l’armée qu’Oreste commandait. Un
jour donc, c’était le 29 octobre[36], l’interrègne se
prolongeant trop au gré de tout le monde, une troupe, envoyée on ne sait par
qui, envahit la demeure du patrice, s’empara de l’enfant, le plaça sur un
bouclier ; et après l’avoir affublé d’un manteau de pourpre emprunté à la
garde-robe des Césars, et trop grand pour sa taille, elle le promena de rue
en rue, proclamant Romulus Augustus empereur de Arrivé ainsi par la ruse au but qu’il désirait[38], l’aventurier pannonien se crut bien plus sûr du pouvoir impérial que s’il l’avait possédé lui-même, car il restait patrice et généralissime de son fils : or l’intérêt du patrice et celui de l’empereur étant exactement les mêmes et se protégeant l’un par l’autre, rien ne pourrait les ébranler. Voilà ce que se disait Oreste ; tandis que d’un autre côté l’Italie et le sénat voyaient clans cette combinaison un gage de stabilité. Oreste était estimé des sénateurs, et généralement on s’accordait à reconnaître en lui une capacité applicable à beaucoup de choses. Il prit en main, comme tuteur de son fils, les rênes de l’administration publique[39]. Le petit Auguste, ainsi qu’on continua de l’appeler, ceux-ci par moquerie, ceux-là parce que c’était son surnom de famille[40], fut confié à la direction d’un prêtre italien[41] nommé Pirménius, homme de haute naissance et de grandes vertus qu’Oreste aimait à consulter sur les affaires d’État, et qu’il traitait comme un père. Au moyen de ce prêtre en relation avec les évêques, le patrice sut se ménager l’affection du clergé italien. En même temps il entra en négociation avec Genséric, pour mettre un terme à la guerre qui frappait de stérilité depuis vingt ans le commerce de l’Occident et promenait l’épouvante sur toutes ses côtes[42]. Enfin, pour n’être point en faute vis-à-vis de la constitution romaine, et sans se faire d’ailleurs illusion sur le succès, Oreste députa à Constantinople deux officiers de son palais, Latinus et Madusius[43], chargés de notifier à l’empereur d’Orient (c’était alors Basilisque) l’avènement de Romulus Augustus, lui envoyant, suivant la coutume, le portrait du jeune César entouré de lauriers. Mais lettre et portrait furent repoussés avec mépris : le successeur de Théodose, si indigne qu’il fût lui-même, refusa de reconnaître pour frère et collègue le fils du secrétaire d’Attila.
Ces hommes perdus, c’étaient les soldats de l’empire, et
le démon qui les agitait était celui de la cupidité. L’idée que Rome leur
devait bien, à eux ses défenseurs, la même faveur qu’à ses ennemis, Goths,
Burgondes et Francs à qui elle distribuait ou laissait prendre ici des
terres, là des colons et des villes ; cette idée, excitée tout naturellement
par l’exemple de ce qui se passait en Gaule et en Pannonie, avait fini par
s’enraciner dans la tête des auxiliaires barbares. Sans doute, Oreste ne leur
avait rien promis avant la révolte, il avait même décliné soigneusement, en
homme habile qu’il était, toute occasion de se prononcer pour ou contre de
semblables exigences ; mais l’engagement ne s’en trouvait pas moins dans la
révolte dont il recueillait le fruit. En favorisant l’ambition de cet homme
qu’elles regardaient comme un Barbare d’adoption, les bandes d’Attila
devaient penser qu’il les traiterait comme elles voulaient l’être. Elles
attendirent donc patiemment pendant quelques mois qu’il prît l’initiative
d’une distribution de territoire en Italie ; puis quand elles ne virent rien
arriver, elles se crurent frustrées. Lin vif mécontentement éclata ; les
cabales succédèrent aux murmures ; une partie de l’armée menaça de
s’insurger. Le foyer de l’agitation se trouvait dans le corps formé de Ruges,
de Scyres, de Turcilinges, qui occupait, en ce moment, les camps retranchés
de La fermentation des camps de Ligurie aboutit d’abord à une requête solennelle adressée au patrice, pour lui demander, au nom de l’armée, la concession du tiers des terres en Italie. On se flattait sans doute d’être très modéré dans la demande, lorsque les Visigoths et les Burgondes s’attribuaient en Gaule les deux tiers du territoire, et que d’autres Barbares prenaient tout. Oreste refusa courageusement. Au fond, il avait le cœur romain ; et flatté de la confiance que les Italiens lui témoignaient, il eût rougi d’attacher son nom à une si sauvage spoliation. Son refus, nettement exprimé, excita parmi les auxiliaires, comme il avait pu le prévoir, une tempête violente ; de la mutinerie ils passèrent à la révolte. Au premier rang des mécontents se distinguait un homme qu’à sa faute taille, à la hardiesse de ses discours, à l’entraînement qu’il exerçait sur ses grossiers compagnons, on reconnaissait tout d’abord pour l’ancien soldat d’Oreste, le Ruge Odoacre, arrivé dans le corps des domestiques à quelque grade encore subalterne. Il promit à ses compagnons de les mettre en possession de ce qu’ils demandaient, s’ils l’agréaient peur chef, et ceux-ci le nommèrent sans hésiter. La guerre dès lors commença. Odoacre, placé au pied des Alpes, en communication facile et prompte avec les peuples du Danube, appela à lui tout ce qui voulut s’enrôler parmi les Ruges, les Alains, les Turcilinges et les Scyres. Ces Barbares vinrent en grand nombre rejoindre leurs frères de Ligurie, et formèrent avec eux une armée redoutable. Il paraîtrait même, à la manière dont quelques historiens s’expriment, qu’Odoacre en personne alla présider à ces levées, et que lorsqu’il reparut en Italie, par les passages des Alpes Tridentines, il ressemblait beaucoup plus à un envahisseur barbare qu’à un officier de l’empire romain[46]. Pendant ce temps-là, Oreste, résolu à ne point céder, concentrait dans Ravenne tout ce qu’il restait à l’Italie de troupes fidèles ; et quoiqu’elles fussent clairsemées et travaillées elles-mêmes par des ferments de discorde, il prit l’offensive contre Odoacre. La première rencontre eut lieu dans la plaine de Lodi, appelée alors Laus Pompeia[47]. Affaibli par la désertion d’une partie des siens, le patrice dut se réfugier derrière le Lambro, afin de couvrir du moins les approches de Pavie, qu’on regardait dès ce temps comme la plus forte des villes liguriennes. Suivant une tradition en vigueur au moyen âge, et recueillie par les écrivains italiens, il se retrancha dans une position avantageuse, près des collines qui portent aujourd’hui le nom de S. Columbano[48]. Mais Odoacre, par une manoeuvre hardie, remonta le Lambro qu’il franchit à gué vers son cours supérieur[49], et revint lui-même par la rive droite couper à son ennemi le chemin de Pavie. A quelques milles du camp impérial, il s’arrêta, offrit la bataille pour le lendemain et fit les préparatifs d’usage. Ses bataillons serrés et sa nombreuse cavalerie, nous dit la tradition, débordaient au loin de la plaine sur la montagne. Oreste désespéra de la victoire, et décampa silencieusement pendant la nuit, se dirigeant sur Pavie[50]. Ses retranchements tombèrent au pouvoir d’Odoacre qui les occupa. On voyait encore dans ce lieu au XVe siècle les vestiges d’ouvrages romains indiquant le passage d’une grande armée, et le lieu lui-même se nommait le Camp ruiné[51]. Cependant Augustule se fortifiait dans Ravenne, ou pour
mieux dire, Paulus, son oncle, à qui Oreste avait confié la garde d’une si
chère tête, disposait tout pour empêcher l’accès de la ville[52]. Les troupes
italiennes en retraite sur Pavie avaient été reçues avec une faveur marquée
par Épiphane et son clergé[53] ; et de ce côté
aussi on se préparait à une défense vigoureuse. Pavie encore appelée Ticinum,
ainsi qu’on l’a dit plus haut, commençait à cette époque le rôle de métropole
militaire de L’armée d’Oreste, si bien traitée par l’évêque et le peuple de Pavie et contenue d’ailleurs par son chef, se conduisit d’abord vaillamment, et honnêtement pour les assiégés ; mais à mesure que le siège se prolongea et que l’ennemi gagna du terrain, le découragement vint, et la cupidité rentra dans le coeur de ces hommes féroces. Ils payèrent le bon accueil de la ville par un sac en règle : ses défenseurs voulurent lui donner un avant-goût de ce que l’ennemi lui destinait[57]. Un jour donc, sans provocation d’aucune sorte, les rues se remplirent d’une multitude armée de glaives et de torches, et folle de fureur. Ce n’était partout que deuil, nous dit dans ses réminiscences classiques un témoin oculaire de ce pillage fait par des amis ; ce n’était partout qu’épouvante et spectacles de mort[58]. Tout habitant qui connaissait un soldat, qui l’avait logé sous son toit, qui lui avait fait du bien, le voyait accourir vers lui l’injure à la bouche et le fer au poing ; l’hôte enfonçait la porte de son bute ou la brillait, et, menaçait le maître de le tuer, s’il ne livrait son argent[59]. Un second sac succéda au premier, quand la place eut été enlevée d’assaut. ; et les soldats d’Odoacre ravirent ce qu’avaient épargné ceux d’Oreste. Alors fut dévastée la maison d’Épiphane : tout y l’ut pris ou détruit ; on alla jusqu’à fouiller le sol pour y trouver les immenses richesses que faisaient supposer aux Barbares les prodiges de sa charité. Ces hommes grossiers, dit le vieil auteur que nous aimons à citer, demandaient à la terre, des trésors que le saint évêque avait déposés dans le ciel[60]. Le feu prit aux deux églises, et la ville entière ressembla à un brasier ardent. La perte des biens fut pourtant le moindre des maux pour cette population infortunée. Chassée des maisons par l’incendie, errante de rue en rue, mais traquée à tous les carrefours, elle n’échappait au tranchant du glaive que pour tomber en captivité, et pourtant au milieu de tant d’incertitudes et de souffrances, on n’entendait retentir qu’un seul mot : Où est l’évêque ? — Qu’est devenu Épiphane ? vit-il encore ?[61] se demandaient en fuyant ces malheureux inquiets pour leur vie, tant le salut de leur pasteur leur semblait préférable à tout le reste ! Épiphane n’avait point songé à fuir ; tandis qu’on saccageait sa maison, il courait à ce qu’il regardait comme le plus pressé, à la protection des enfants et des femmes qui ne peuvent point se défendre. Les Barbares, effectivement, faisaient main basse sur tout ce qu’il y avait à Pavie de jeunes filles riches et nobles, pour les échanger ensuite contre de fortes rançons : ils les emmenaient dans leur camp où elles étaient gardées à vue. Dans le nombre se trouvèrent la sœur cadette d’Épiphane, Honorata, qui, sur ses conseils, avait embrassé la vie religieuse[62], et une autre vierge consacrée, Luminosa, leur commune amie, femme distinguée par le savoir aussi bien que par la naissance[63]. Autour d’elles se groupaient, en nombre considérable, des mères, des épouses, des filles, séparées de tout ce qu’elles aimaient, troupe gémissante dont les larmes servaient de risée aux vainqueurs. La nuit approchait. Épiphane craignit qu’une soldatesque ivre de sang et de vin ne se portât contre elles aux derniers outrages[64] : il se rendit au camp, et par ses ardentes prières, par l’éloquence de ses discours, par l’autorité de son caractère, il obtint, d’Odoacre la liberté des captives. Fait prisonnier, dès les premiers moments du sac, et livré peut-être par les siens, Oreste fut mis dans un des bateaux en station sur le Tessin, et conduit par le Pô à Plaisance[65]. Le malheureux patrice ne trouva point grâce devant son protégé et son ancien soldat, devenu son maître. L’intérêt barbare parlait plus haut en ce moment que la reconnaissance ou la pitié. Il fut bientôt mis à mort. Par un raffinement de cruauté, on choisit pour son supplice le 28 d’août, jour anniversaire de son entrée à Ravenne, l’année précédente[66]. Ainsi finit cet aventurier dont le coeur valait mieux que la fortune. Grandi au milieu des Barbares et par leur moyen, le ministre d’Attila parut les avoir trahis dès qu’il cessa de les servir. L’homme qui était venu, une bourse au cou, demander à Théodose II, de la part du roi des Huns, la tête du grand eunuque Chrysaphius[67], perdit la sienne pour avoir voulu redevenir Romain. Le choix d’un pareil anniversaire pour le supplice d’Oreste disait assez haut que c’était là la revanche d’une espérance déçue. Avant de quitter Pavie, et sur ses ruines baignées de sang, les auxiliaires avaient proclamé. Odoacre roi : titre d’une nouveauté étrange de la part d’une armée de l’empire, ruais qui annonçait au fond la reconstitution de cette armée comme peuple barbare, et une sorte de main mise sur le pays. Tandis que ces choses se passaient sur les bords du Pô, le jeune Romulus Augustus se tenait renfermé dans Ravenne, que son oncle Paulus se préparait à bien défendre, malgré leur fortune désespérée. Une petite troupe de soldats dévoués, probablement enfants de l’Italie, résolue aussi à mourir pour une cause qui se liait à la nationalité italienne, composait sous le commandement du frère d’Oreste l’armée du dernier des empereurs. Odoacre, parti de Plaisance, arriva le 4 septembre devant Ravenne[68]. Cette ville immense se divisait alors en cinq grands
quartiers, formant comme autant de villes distinctes, séparées par des canaux
: d’où lui venait le surnom de Pentapole, ou de Quintuple-Ville. La
principale de ces cinq villes accolées dans une même enceinte était Ravenne
proprement dite, la vieille cité grecque et étrusque, restée le quartier de
la classe opulente. Ensuite venaient Césarea, séjour des empereurs et
des hauts fonctionnaires attachés à la cour ; Palatiolum, quartier des
jardins, où les césars possédaient une maison de plaisance située près d’un
petit lac ; Taurésium et enfin Classe, quartier du port
maritime, des artisans et du négoce. Une dérivation du Pô, des rivières et de
profonds marais traversés par la longue et étroite chaussée, percée d’arches,
qu’on appelait le pont Candidien, défendaient C’est donc de ce côté qu’Odoacre entra dans Ravenne, interceptant par sa marche toute communication entre le quartier impérial et celui du port. Augustule attendait avec une mortelle anxiété le résultat de la journée : en apprenant que la ville était prise, il détacha précipitamment son manteau de pourpre, le rejeta loin de lui, et essaya de se cacher[71]. Des soldats ruges le découvrirent dans la retraite où il s’était blotti. Amené devant son vainqueur, le pauvre enfant tremblait et pleurait. Odoacre eut pitié de son âge ; il eut aussi pitié de sa beauté, disent les historiens[72] ; il lui répugnait de verser le sang de ce jeune homme, dont il acclamait naguère, comme tant d’autres, la grâce enfantine sous le costume des césars. Non seulement, il ne lui fit aucun mal, mais il lui assigna une pension annuelle de six mille écus d’or, pour aller vivre librement, avec ce qui restait de sa famille, dans le château de Lucullanum, en Campanie[73]. Le prêtre Pirménius, son gouverneur, échappé sous quelque déguisement, gagna le Norique, et se retira près de saint Séverin[74]. Ce château de Lucullanum, lieu d’exil d’Augustule, était situé sur les pentes du cap Misène, en face du golfe de Baïa, dont il dominait au loin la mer et les îles verdoyantes. Cette villa des plus riches Romains avait subi, depuis sa fondation, d’assez bizarres destinées dont. Augustule n’arrêta point le cours. Modestement bâtie par Marius, et confisquée par Sylla[75], elle passa des mains des proscripteurs dans celles de Lucullus qui épuisa, pour l’embellir, le produit des pillages de l’Asie. Elle devint. grâce à lui, le plus insolent, exemple de ces défis jetés par l’opulence romaine à la nature, pour la dompter et la transformer. Des palais de marbre, des temples, des statues, des thermes couronnés de frais ombrages, entourés d’eaux jaillissantes, s’étendirent de terrasse en terrasse, le long de la montagne jusqu’à la mer. L’histoire nous entretient surtout des vastes piscines creusées sous le roc pour servir d’abri au poisson contre les ardeurs de la canicule, et qui faisaient dire orgueilleusement au maître de ces domaines : Je n’ai rien à envier au dieu Neptune[76]. Après la mort de Lucullus, les dépouilles d’autres provinces vinrent, sous d’autres possesseurs, entretenir la magnificence de ce beau lieu. Des maisons se groupèrent autour ; un village se forma, et dans la suite des temps, un château fut bâti pour défendre le village contre les incursions des pirates vandales[77]. Telle fut la retraite assignée par Odoacre au jeune fils d’Oreste. Des trois empereurs d’Occident dépossédés et encore vivants, l’un évêque, l’autre prince de Dalmatie, le troisième banni dans les jardins de Lucullus, celui-ci fut le plus résigné et le plus heureux. S’il remit le pied une fois encore sur la scène des révolutions politiques, ce fut pour déclarer au monde qu’il avait renoncé volontairement à ce trône des Césars, qui lui apparaissait dans ses rêves flanqué des têtes de son père et de son oncle, et demander que de si funestes aventures finissent avec lui. Qu’on ne croie pas au reste que cette chute de l’empire romain d’Occident fit chez les contemporains autant de fracas qu’elle en a fait depuis dans l’histoire. C’était un événement préparé par un siècle de revers constants, prédit par la religion, prévu par la politique, et attendu, pour ainsi dire, à jour fixe. Lune inexplicable fatalité plana sur Rome dès son berceau. La ville de Romulus, on ne peut le nier, connut presque en naissant ses futures destinées : elle sut qu’elle dominerait le monde, et que sa puissance s’éteindrait au bout de douze siècles. La légende des douze vautours, apparus à son fondateur dans l’augure du mont Palatin, fut l’expression de cette croyance instinctive, fortifiée de toute l’autorité de la science augurale. Les aruspices toscans avaient, en effet, déclaré que les douze vautours signifiaient douze siècles, de puissance, après lesquels le sort de Rome serait consommé. Cette foi politique, déjà en vigueur aux plus beaux temps de l’époque républicaine, se transmit de génération en génération, avec orgueil tant qu’on fut loin du terme, avec crainte quand on le vit approcher ; et comme on ne s’accordait point sur l’époque historique de la fondation de la ville, comme on différait également sur la durée du siècle, tel que le comprenaient les aruspices toscans, chacun supputait à sa guise, mais tous attendaient[78]. D’après la chronologie la plus généralement reçue, Rome avait dépassé le milieu de son XIe siècle, lorsque Alaric la prit et la saccagea. On put croire alors l’augure accompli[79], en négligeant une différence de quelques années. Après le départ des Goths, on se remit à espérer et à calculer encore. Lors du second sac de Rome par Genséric, en l’année douze cent septième depuis sa fondation, quatre cent cinquante-cinquième depuis Jésus-Christ, on déclara l’heure fatale définitivement arrivée. Le douzième vautour vient d’achever son vol ; ô Rome, tu sais ton destin ! s’écriait Sidoine Apollinaire[80], chrétien convaincu, mais imbu comme tout sujet romain, des traditions superstitieuses de la ville aux sept collines. Dès lors en effet commença la vraie agonie de l’empire, soumis à des maîtres barbares, passant des mains de Ricimer dans celles de Gondebaud, puis de Gondebaud à Odoacre, toujours plus faible, plus méprisé, plus abattu. Et lorsqu’on vit des noms depuis longtemps étrangers à la nomenclature des Césars, les noms de Jules et d’Auguste sortir des tombeaux de l’histoire, comme autant de spectres annonçant le dernier jour, et celui de Romulus expirer sur la tête d’un enfant, la frayeur publique n’eut plus de bornes. Ces rapprochements fortuits présentaient dans leur bizarrerie je ne sais quoi de surnaturel qui justifiait la crédulité, et troublait jusqu’aux plus fermes esprits : on baissa la tête et on se tut[81]. Les funérailles de Rome s’accomplirent donc au milieu d’un morne silence. Nous ne trouvons dans les écrivains contemporains ni accents de regrets ou de joie, ni déclamations en prose ou en vers ; quelques dates et une sèche mention du fait, voilà tout. On dirait qu’il ne s’était rien passé d’important en l’année 476. Le seul Jornandès, un peu plus tard, embouche sa trompette barbare sur le tombeau de l’empire, mais c’est pour chanter l’avènement des Goths[82]. |
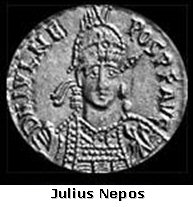 Maître de l’Italie par la guerre civile, mais les mains à
peu près pures de sang romain, Nepos entra dans Rome, où il fut proclamé
solennellement par le peuple et le sénat. L’investiture du manteau augustal
lui fut donnée, suivant toute probabilité, dans cette même plaine de Bontrote
où, sept ans auparavant, de si vifs transports de joie avaient accueilli
Anthémius, comme lui venu d’Orient. Toutefois les dispositions ne se
ressemblèrent point ; le temps des illusions était passé, et le sénat,
froissé dans son orgueil comme dans son droit, ne pardonnait pas au protégé
de Léon les procédés blessants du protecteur.
Maître de l’Italie par la guerre civile, mais les mains à
peu près pures de sang romain, Nepos entra dans Rome, où il fut proclamé
solennellement par le peuple et le sénat. L’investiture du manteau augustal
lui fut donnée, suivant toute probabilité, dans cette même plaine de Bontrote
où, sept ans auparavant, de si vifs transports de joie avaient accueilli
Anthémius, comme lui venu d’Orient. Toutefois les dispositions ne se
ressemblèrent point ; le temps des illusions était passé, et le sénat,
froissé dans son orgueil comme dans son droit, ne pardonnait pas au protégé
de Léon les procédés blessants du protecteur.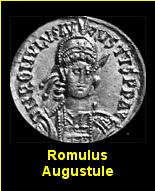 Quant à ces affaires de
Quant à ces affaires de 