|
I — LES SOUVERAINS DE LA
MAISON DE MACÉDOINE ET LA CONSOLIDATION DE
LA DYNASTIE.
De 867 à 1025, l’empire byzantin a connu cent cinquante
ans d’une incomparable splendeur. Pendant un siècle et demi il a eu cette
fortune d’avoir à sa tête une succession de souverains qui, presque tous,
furent des hommes remarquables. Basile Ier le fondateur de la dynastie (867-886), Romain
Lécapène (919-944),
Nicéphore Phocas (963-969),
Jean Tzimiscès (969-976),
usurpateurs glorieux qui gouvernèrent sous le nom des princes légitimes,
Basile II
enfin, qui régna tout un demi-siècle (976-1025), n’ont point été des empereurs de Byzance tels
qu’on se plait trop volontiers à les représenter. Ce sont des âmes énergiques
et dures, sans scrupules souvent et sans pitié, des volontés autoritaires et
fortes, plus soucieuses de se faire craindre que de se faire aimer ; mais ce
sont des hommes d’État, passionnés pour la grandeur de l’empire, des chefs de
guerre illustres dont la vie se passe dans les camps, parmi les soldats, en
qui ils voient et aiment la source de la puissance de la monarchie ; ce sont
des administrateurs habiles, d’une énergie tenace et inflexible, et que rien
ne fait hésiter quand il s’agit d’assurer le bien public. Ils n’ont point le
goût des dépenses inutiles, ils sont uniquement préoccupés d’accroître la
richesse nationale ; le faste éclatant du palais, la pompe vaine des cortèges
et des cérémonies ne les intéressent qu’autant qu’ils servent leur politique
et entretiennent le prestige de l’empereur et de l’empire. Jaloux de leur
autorité, ils n’ont point, en général, eu des favoris ; si l’on met à part
telle personnalité puissante, comme le parakimomène (grand chambellan) Basile, fils
bâtard de Romain Lécapène, qui fut pendant cinq règnes et durant plus de
quarante ans (944-988)
l’âme du gouvernement, leurs conseillers ont été le plus souvent des hommes
obscurs, qu’ils employaient et dont ils demeuraient les maîtres. Épris de
gloire, le cœur plein des ambitions les plus hautes, ils ont voulu faire de
l’empire byzantin la grande puissance du monde oriental, champion tout
ensemble de l’hellénisme et de l’orthodoxie ; et par l’effort magnifique de
leurs armes, par la souple habileté de leur diplomatie, par la vigueur de
leur gouvernement, ils ont réalisé leur rêve et fait de cette période une
époque de véritable renaissance, un des moments les plus glorieux de la
longue histoire de Byzance.
Au moment où Basile Ier montait sur le trône, la situation de
la monarchie était encore singulièrement difficile : tout l’État semblait à
reconstituer. Le rude paysan, que son crime haussait au pouvoir suprême,
avait toutes les qualités nécessaires pour suffire à cette lourde tâche : il était
intelligent, également désireux de rétablir l’ordre à l’intérieur de la
monarchie et de restaurer son prestige au dehors, bon administrateur,
excellent soldat, désireux par dessus tout d’asseoir solidement l’autorité
impériale. Pendant ses vingt ans de règne, il sut tout à la fois remettre sur
un bon pied les affaires de l’empire et, par le prestige des services rendus,
assurer la fortune de sa maison. Son fils Léon VI (886-912), dont le gouvernement a pour l’histoire
administrative de l’empire une importance essentielle, poursuivit — si
différent qu’il fût de son père par son humeur casanière, ses manies de
pédant et sa faiblesse en face de ses favoris — la consolidation de la
dynastie avec une semblable ténacité : pour assurer un héritier au trône, il
n’hésita pas à scandaliser ses contemporains par ses quatre mariages et à
entrer en conflit avec l’Église et son chef, le patriarche Nicolas. Mais, à
ce prix, on vit pour la première fois à Byzance, naître, au bénéfice d’une
famille princière, l’idée de la légitimité. Ce fut l’œuvre éminente des deux
premiers empereurs macédoniens de donner, comme
l’écrit un contemporain, à l’autorité impériale des racines puissantes, pour
en faire sortir les magnifiques rameaux de la dynastie. Désormais
il fut plus difficile de renverser l’arbre aussi fortement enraciné ;
désormais il y eut une famille impériale, dont les membres reçurent le nom de
porphyrogénètes (nés dans la pourpre),
et un attachement populaire, un dévouement loyaliste à cette famille.
C’était, dans cette monarchie troublée jusqu’alors par tant de révolutions,
une nouveauté heureuse et grosse de conséquences.
Sans doute, même pendant cette période, les révolutions ne
manquèrent point. Les troubles qui marquèrent la minorité agitée de
Constantin VII,
le fils de Léon VI
(912-959),
permirent à Romain Lécapène de s’emparer du pouvoir pour un quart de siècle (919-944). Un peu
plus tard, quand Romain II,
le fils de Constantin VII,
mourut après quatre ans de règne (959-963), la faiblesse du gouvernement, pendant la minorité
de ses fils Basile II
et Constantin VIII,
amena le soulèvement qui porta au pouvoir Nicéphore Phocas (963-969) et le coup
d’État tragique qui, par l’assassinat de Nicéphore, fit Jean Tzimiscès
empereur (969-976).
Mais aucun de ces usurpateurs n’osa écarter du trône la descendance légitime
de Basile Ier. Romain Lécapène, officiellement, partagea le pouvoir avec
Constantin VII, encore qu’il le reléguât dans les loisirs obscurs de sa
studieuse activité d’érudit. Nicéphore Phocas et Jean Tzimiscès laissèrent
régner nominalement les enfants de Romain II et s’efforcèrent, en épousant des
princesses de la famille impériale, de donner à leur usurpation un air de
légitimité. Et après eux, tout naturellement, le pouvoir revint au
représentant devenu majeur de la famille de Macédoine, au grand empereur
Basile II. La
dynastie était si bien affermie que, dans cette monarchie orientale, des
femmes mêmes purent régner, les nièces de Basile II, Zoé (1028-1050), qui partagea le trône avec ses
trois époux successifs, et Théodora (1054-1056) ; et ces princesses furent populaires, comme
l’attestent la révolution de 1042, où Michel V fut renversé pour avoir voulu détrôner
Zoé, et le mécontentement que rencontra Constantin Monomaque, quand on le
soupçonna de vouloir écarter les deux impératrices, Jamais encore on n’avait
vu rien de semblable à Byzance, et l’opinion publique professait ouvertement
que celui qui règne à Constantinople finalement
est toujours victorieux ; ce qui faisait de l’usurpation non pas
seulement un crime, mais, chose pire, une sottise.
Comme il se trouva, par ailleurs, que les usurpateurs
aussi furent des hommes éminents et des généraux remarquables, l’empire put
supporter sans accident l’incapacité politique d’un Constantin VII, les amusements
de viveur d’un Romain II,
et la longue minorité de ses fils, et trouver pendant un siècle et demi, pour
conduire ses affaires, une unité de vues, une fermeté de direction que
Byzance, depuis longtemps, ne connaissait plus. Grâce au concours, enfin, de
collaborateurs de haute valeur, généraux comme les Courcouas, les Phocas, les
Skléros, ministres comme le parakimomène Basile, les empereurs de la dynastie
de Macédoine ont pu donner à la monarchie une prodigieuse expansion et une
splendeur incomparable. L’offensive reprise sur toutes les frontières et
couronnée de succès éclatants ; l’œuvre diplomatique complétant l’œuvre
militaire et groupant autour de la monarchie un cortège de vassaux ;
l’influence byzantine se répandant à travers tout le monde oriental et jusqu’en
Occident ; un gouvernement fort, qui s’illustra pas de grandes œuvres
législatives ; une administration centralisée, habile et savante qui sut
assurer à l’empire, par l’empreinte commune de l’hellénisme, ;par la
profession commune de l’orthodoxie, l’unité que semblait lui refuser la
diversité des races : voilà ce que valurent à Byzance les cent,cinquante ans
durant lesquels les empereurs macédoniens la gouvernèrent. Et s’ils n’ont
point réussi à conjurer, malgré leurs efforts, les périls redoutables qui
menaçaient cette prospérité, à résoudre la question agraire et sociale qui se
posait avec une acuité inquiétante, à mater l’aristocratie féodale toujours
prompte à se soulever, à empêcher les chefs ambitieux de l’Église orientale
de déchaîner le schisme et, en séparant à jamais Byzance de Rome, d’ébranler
la solidité de la monarchie ; si la maison de Macédoine finissante a laissé
l’empire faible en face des Normands et des Turcs et ouvert la porte à une
longue anarchie (1057-1081),
il n’en demeure pas moins que, pendant un siècle et demi, la dynastie que
fonda Basile Ier
a donné à Byzance, un éclat merveilleux. Au Xe, au XIe siècle, Constantinople a été le centre
le plus brillant de la civilisation européenne et, comme on l’a dit, le Paris du moyen âge.

II — LA
POLITIQUE EXTÉRIEURE DES EMPEREURS MACÉDONIENS (867-1025).
La lutte contre les
Arabes. — Depuis qu’en 8n6 les Arabes avaient conquis la Crète, ils étaient devenus
le fléau des mers byzantines. Chandax, la capitale de l’île, était le repaire
de la piraterie musulmane et de là, comme de Tarse ou de Tripoli de Syrie,
les corsaires arabes ravageaient toute la mer Égée. Malgré les efforts de
Basile Ier
pour réorganiser l’armée et la flotte, les escadres ennemies dominaient
l’Archipel. En 904, Thessalonique était prise par Léon de Tripoli et sa
population presque entière emmenée en captivité. Malgré quelques succès de la
marine byzantine, en 907, en 924 surtout dans les eaux de Lemnos, les
expéditions dirigées contre la
Crète n’aboutissaient qu’à des désastres (911 et 949). Il
fallut envoyer contre l’île que Dieu confonde
le meilleur général de l’empire, Nicéphore Phocas (960). Il réussit à débarquer en
Crète, et après un siège de plusieurs mois il emporta Chandax d’assaut (mars 961). L’île
conquise fut convertie au christianisme. La maîtrise des mers orientales
revenait aux Byzantins.
En même temps, des circonstances heureuses permettaient de
reprendre l’offensive en Asie Mineure. Déjà Basile Ier avait reporté jusqu’au haut
Euphrate les limites de l’empire, repris Samosate (873), fait en Cappadoce et en
Cilicie des campagnes victorieuses (878-879). L’anarchie du monde musulman au Xe siècle facilita
encore les succès byzantins, surtout lorsqu’à partir de 927 l’empire se
trouva délivré du péril bulgare. Sous des généraux illustres, sous Jean
Courcouas qui, pendant vingt-deux ans, commanda en Asie Mineure (920-942), et mérita
d’être appelé un autre Trajan, un autre
Bélisaire, sous Bardas Phocas ensuite et ses fils Nicéphore,
Léon, Constantin, la lutte fut activement poussée. En 928, Théodosiopolis,
l’actuel Erzeroum, était prise ; en 934 Mélitène, en 944 Édesse, d’où on
rapporta triomphalement l’image, miraculeuse du Christ qui y était conservée,
en 949 Germanikia, en 957 Amida, en 958 Samosate ; la frontière byzantine
était reportée de l’Halys à l’Euphrate et au Tigre, et toute une série de
provinces nouvellement constituées (thèmes de Sébaste, de Mésopotamie, de Séleucie, de Lykandos)
attestaient l’importance des conquêtes byzantines. L’Arménie et l’Ibérie
secouaient le joug de l’Islam et entraient dans la sphère d’action de
Byzance. Durant tout le Xe
siècle, les Arméniens devaient jouer dans les affaires de la monarchie un
rôle considérable, et lui fournir des soldats, des généraux, des
administrateurs, des diplomates et jusqu’à des empereurs : Romain Lécapène et
Jean Tzimiscès étaient tous deux d’origine arménienne.
Un véritable mouvement de croisade emportait les Byzantins
contre les infidèles. En Cilicie et dans la Syrie du Nord, Nicéphore Phocas écrasait la puissance
des émirs Hamdanides d’Alep. Il emportait Anazarbe, Adana, Mopsueste (964), Tarse (965), Laodicée,
Hiérapolis, Émèse, Alep et enfin Antioche (968). Son successeur, Jean Tzimiscès,
conquérait en Mésopotamie Édesse et Nisibe (974), en Syrie Damas et Béryte (976), et poussait,
en Palestine, jus qu’aux portes de Jérusalem. Et
les peuples, dit un chroniqueur, étaient
en grande peur devant la colère de Tzimiscès, et l’épée des chrétiens
fauchait, comme la faucille lés infidèles. Basile II acheva cette reconquête
de l’Orient. En 995, il prenait Alep, Homs, Schaizar. Et des triomphes
magnifiques célébraient la ruine de la puissance musulmane, l’empire agrandi
en Orient et formidablement défendu contre toute agression nouvelle par une
série de puissantes forteresses. L’annexion — peut-être imprudente — des
principautés arméniennes par Basile II (1020)
et la soumission de l’Ibérie complétèrent ces glorieux résultats. Depuis le
temps de Justinien, l’empire n’avait plus étendu aussi loin son autorité en
Orient.
La lutte contre les
Bulgares. — Plus encore que la guerre arabe, la guerre bulgare
est le fait capital de l’histoire extérieure de Byzance au Xe siècle.
Au commencement du Xe siècle, la menace bulgare était plus
redoutable que jamais. Territorialement, l’État bulgare s’étendait des
régions situées au nord du Danube jusqu’au Balkan, et du côté de l’ouest il
allait jusqu’aux massifs du Pinde. Moralement, par la fusion maintenant
complète entre l’élément bulgare et l’élément slave, la Bulgarie formait un
État homogène, où le pouvoir monarchique s’était puissamment développé, où la
conversion au christianisme avait assuré l’unité de croyance, où, par le contact
avec Byzance, le pays s’était élevé à un assez haut degré de civilisation. Et
tout cela donnait aux souverains de la Bulgarie la tentation de disputer aux empereurs
byzantins l’hégémonie des Balkans. Pour réaliser ces rêves ambitieux, il
suffisait qu’un homme se rencontrât : ce fut le fils de Boris, le tsar Syméon
(893-927).
Elevé à Byzance, où il avait été détenu comme otage, très épris du luxe et de
la civilisation des Byzantins, il rêva de conquérir Constantinople et de
poser sur sa tête la couronne des successeurs de Constantin. Pendant plus
d’un siècle, une véritable guerre de races allait mettre aux prises Grecs et
Bulgares.
La lutte commença en 889, et, chose remarquable, les
raisons en furent d’ordre économique. Léon VI ayant ordonné de transporter à
Thessalonique les entrepôts que les marchands bulgares avaient à
Constantinople, Syméon déclara la guerre. Une invasion des Hongrois, soudoyés
par les Byzantins, contraignit finalement le roi bulgare à la retraite (893). Mais après la
mort de Léon VI,
les troubles qui marquèrent la minorité de Constantin VII lui fournirent l’occasion de
revenir. En 913, il paraissait devant Constantinople ; en 914, il prenait
Andrinople ; en 917, il écrasait à la journée d’Anchialos les armées
impériales. Et, tout glorieux de ses succès, Syméon se proclamait tsar des Bulgares et empereur des Romains ;
il installait, dans sa capitale de Preslav, un patriarcat bulgare indépendant
; Il ne lui restait plus qu’à emporter Constantinople. Il le tenta en 924.
Mais, pour enlever la capitale byzantine, il fallait l’attaquer par terre et
par mer, et Syméon n’avait pas de marine. Il semble aussi que, dans
l’entrevue qu’il eut avec Romain Lécapène, il subit, comme jadis Attila en
face de saint Léon, l’influence de tout ce qu’il y avait de prestige et de
civilisation dans cette antique majesté impériale. Il recula, il abandonna le
rêve doré qu’il avait caressé. Et quoique Syméon ait dans son royaume, dans
sa capitale surtout de Preslav-la-Grande, fait éclore une culture
intellectuelle et artistique qui lui a mérité le nom de Charlemagne de la Bulgarie, l’arrêt
devant Constantinople marqua la ruine des ambitions bulgares. Quand Syméon
mourut (927),
la décadence était déjà commencée.
Elle se précipita sous le long règne de son fils Pierre (927-968). Pendant
ces quarante années, de plus en plus la Bulgarie devint un satellite de l’empire ; et pendant
que Byzance se fortifiait, son ancienne rivale s’affaiblissait de jour en
jour davantage. En face du pouvoir royal fléchissant, la féodalité relevait
la tête ; l’unité religieuse était compromise par l’hérésie des Bogomiles ;
la nationalité bulgare se désagrégeait. L’heure de la revanche approchait
pour les Byzantins.
Elle sonna en 967. Nicéphore Phocas refusa le tribut que
l’empire payait toujours aux Bulgares et, avec l’aide des Russes de
Sviatoslav, grand prince de Kief, il attaqua la Bulgarie. Mais
Sviatoslav trouva le pays conquis à son goût ; il s’y installa et refusa d’en
sortir (968).
La mort du tsar Pierre, l’assassinat de Nicéphore (969), aggravèrent les difficultés de
la situation. Quand Jean Tzimiscès monta sur le trône, l’invasion russe menaçait
l’empire même ; Sviatoslav passait les Balkans, saccageait Philippopoli (970), semait la
panique jusque dans la capitale. Heureusement, les Russes furent battus à
Arcadiopolis, l’actuel Lulé-Bourgas (970), et l’empereur put organiser contre eux une grande
expédition (971).
Pendant que la flotte byzantine remontait le Danube, Tzimiscès franchissait
les Balkans, prenait Preslav, assiégeait Sviatoslav dans Dorostol (Silistrie) et
l’obligeait à faire sa soumission et à évacuer le pays. La Bulgarie fut annexée à
l’empire, le patriarcat autonome fut supprimé ; l’hellénisme victorieux
reportait jusqu’au Danube les limites de la monarchie.
Pourtant, dans la Bulgarie du Pinde, autour de Prespa et
d’Ochrida, l’élément national, sous la direction du comte Sischman et de ses
fils, s’obstinait dans sa résistance. A la faveur des troubles qui agitèrent
les débuts du règne de Basile II, l’un des fils de Sischman, le tsar Samuel (entre 977 et 979 — 1014)
reconstitua la
Bulgarie. En dix années, de 977 à 986, il libéra la Bulgarie danubienne,
conquit la Macédoine,
la Thessalie,
pénétra jusque dans le Péloponnèse. Pour abattre ce formidable empire, qui
allait du Danube à l’Adriatique, il fallut aux Grecs trente années de guerre (986-1018). Ce fut essentiellement
l’œuvre de l’empereur Basile II, à qui sa dure énergie et ses victoires cruelles valurent
le surnom terrible de Bulgaroctone, le tueur de Bulgares.
En 986, Basile II prenait l’offensive et pénétrait en Bulgarie ; mais il fut
sévèrement battu au défilé de la Porte Trajane dans les Balkans. Dix ans
passèrent avant que l’empereur prit recommencer la lutte et, pendant ces dix
ans, Samuel ne cessa d’agrandir son royaume,du Danube à l’Adriatique et à la
mer Égée. Mais en 996, le tzar était battu sur les bords du Sperchios ; la Grèce lui échappait ; il
échouait devant Thessalonique, une partie de la Bulgarie danubienne
tombait entre les mains des impériaux (1000). La Bulgarie de l’ouest,
pourtant, restait inexpugnable. En 1001, Basile II entreprit de la réduire. Progressivement,
il en conquit les abords, Berrhœa, Servia, Vodena. Cerné dans les montagnes, Samuel
se dégagea et vint saccager Andrinople (1003). Mais tenacement, l’empereur
poursuivait et resserrait le blocus, prenant Skopia, conquérant la basse et
la moyenne Macédoine (1007),
menant la guerre avec une atroce dureté. Samuel évitait les batailles rangées
; finalement, pourtant, ses troupes furent écrasées au défilé de Cimbalongou,
sur la route de Serrés à Melnik (29
juillet 1014). Le tsar ne survécut pas à cette défaite ;
il mourut peu de jours après (15
septembre 1014). C’était la fin de la Bulgarie.
Sans doute, pendant quatre ans encore, les successeurs du
grand tsar bulgare, tout en se disputant son trône, continuèrent la lutte. En
1018, le pays pourtant était entièrement pacifié et l’empereur, dans une
tournée triomphale, s’occupa de le réorganiser. Il le fit avec une prudence
habile, respectant les usages administratifs et les mœurs des vaincus,
s’efforçant d’attirer à lui la grande aristocratie féodale, conservant
l’ancienne organisation religieuse, qui eut à sa tête l’archevêque
autocéphale (indépendant)
d’Ochrida. Ainsi, après bien des années, Byzance redevenait maîtresse de
toute la péninsule des Balkans et, dans le voyage qu’à travers la Grèce il fit jusqu’à
Athènes, comme dans le triomphe qu’il célébra en grande pompe à
Constantinople (1019),
Basile II put
se glorifier justement d’avoir rendu à l’empire une puissance qu’il ne
connaissait plus depuis des siècles.
La reprise de l’Italie
du sud et la politique byzantine en Occident. — En même temps
qu’en Orient ils étendaient magnifiquement les frontières de l’empire, les
princes de la maison de Macédoine reprenaient en Occident les traditions
ambitieuses de la politique byzantine.
Jamais les Byzantins n’avaient renoncé aux droits de
l’empire sur l’Italie ; le souvenir de Rome, l’ancienne capitale du monde
romain, le souvenir de Ravenne, l’ancienne capitale de l’exarchat, hantaient
incessamment leurs rêves. La faiblesse des derniers empereurs carolingiens,
l’anarchie de l’Italie du sud divisée entre les princes lombards et la menace
croissante de l’offensive musulmane fournirent à Basile Ier l’occasion
souhaitée d’intervenir dans la péninsule et de tenter de réaliser ses
ambitions. L’empereur s’était donné pour tâche de restaurer dans toute la Méditerranée le
prestige byzantin, de chasser les corsaires musulmans de l’Adriatique et de
la mer Tyrrhénienne, de combattre les Sarrasins d’Afrique et de Sicile. Dès
son avènement, il poursuivit donc en Occident une action énergique. Sans
doute il ne réussit pas à reconquérir la Sicile, où Syracuse tombait en 878 aux mains
des infidèles. Mais il rétablissait l’ordre dans l’Adriatique, restaurait
l’alliance byzantine avec Venise, ramenait les Croates dans la vassalité
grecque. Surtout il réoccupait Bari (876) et Tarente (880), reconquérait la Calabre (885), imposait le protectorat byzantin aux
princes lombards. Deux thèmes nouveaux, ceux de Longobardie et de Calabre,
étaient constitués dans l’Italie méridionale : c’était une belle compensation
de la Sicile
perdue.
La faiblesse de Léon VI compromit un moment ces heureux
résultats. Après avoir, par la prise de Taormine (902), achevé la conquête de la Sicile, les Arabes purent
envahir la Calabre
et s’établir jusqu’en Campanie. Mais la victoire du Garigliano (915) assura à
nouveau en Italie la suprématie byzantine et, pendant un siècle entier,
malgré la persistance des invasions sarrasines, malgré la rivalité des Césars
allemands, les Grecs maintinrent leur autorité dans toute la moitié
méridionale de l’Italie. Là aussi le règne glorieux de Basile II consacra les
efforts de la dynastie de Macédoine. La victoire de Cannes (1018), remportée
par les troupes impériales sur les populations d’Apulie soulevées, rétablit
le prestige byzantin de Reggio et de Bari jusqu’aux portes de l’État
pontifical. Et sous l’administration impériale, habile à propager l’influence
de l’hellénisme, l’Italie du sud, grâce surtout à son clergé grec et à ses
couvents grecs, redevint une véritable Grande-Grèce : preuve remarquable de
la puissance d’expansion, de la force d’assimilation civilisatrice qui firent
au Xe et au XIe siècle la
grandeur de l’empire byzantin.
L’entrée en scène des Césars allemands vers le milieu du Xe siècle créa
pourtant quelques embarras à la politique byzantine. Quand Otton Ier
descendit en Italie, quand il prit le titre impérial, l’orgueil grec supporta
impatiemment ce qui lui parut une usurpation. Ce fut bien pis quand Otton
étendit sa suzeraineté sur les princes lombards vassaux de Byzance, quand il
envahit le territoire grec et attaqua Bari (968). Nicéphore Phocas riposta
énergiquement. Mais sa mort modifia la politique byzantine : un accord
intervint, que consacra le mariage d’Otton II et de Théophano (972). Pourtant l’entente dura peu :
les ambitions germaniques ne pouvaient se concilier avec les revendications
byzantines. Mais les empereurs allemands obtinrent de médiocres résultats.
Otton II
envahit la Calabre
et fut battu à Stilo (987)
; Henri II
soutint vainement la révolte apulienne et échoua dans ses attaques sur
l’Italie grecque (1022).
A la mort de Basile II,
comme en Asie, comme en Bulgarie, Byzance était toute-puissante en Italie.
L’œuvre diplomatique :
les vassaux de l’empire. — Grâce à ses grands succès
militaires, l’empire grec au Xe siècle s’étendait du Danube à la Syrie, des rivages
d’Italie aux plateaux d’Arménie. Mais une diplomatie habile devait porter
bien au delà de ces limites la sphère d’action de la monarchie. Tout autour
de l’empire se groupaient une série d’États vassaux, qui formaient en avant
de la frontière comme une première ligne de défense, qui surtout propageaient
magnifiquement à travers le monde l’influence politique et la civilisation de
Byzance.
En Italie, Venise, toute grecque par son origine et par ses
mœurs, était le plus fidèle et le plus docile des vassaux de l’empire. Aussi
les empereurs lui avaient confié le soin de faire la police de l’Adriatique
et, dès la fin du Xe
siècle (992),
ils lui avaient concédé ces larges privilèges commerciaux qui préparaient sa
future grandeur. Dans l’Italie du sud, les républiques de Naples, de Gaëte,
d’Amalfi surtout gravitaient dans l’orbite de Byzance ; enfin les princes
lombards de Salerne, de Capoue, de Bénévent, quoique d’une fidélité plus
incertaine, acceptaient en général le protectorat grec. — Dans le nord-ouest
de la péninsule des Balkans et sur tout le rivage de l’Adriatique, les États
slaves, Croatie, Serbie, ramenés par Basile Ier au christianisme et sous l’autorité de
Byzance, étaient pour l’empire des alliés utiles, en particulier contre les
Bulgares. — En Orient, sur le littoral de la mer Noire, Cherson, plus vassale
que sujette, était un poste d’observation précieux, un instrument d’action
politique et économique en face des peuples barbares, Khazars, Petchenègues,
Russes, qui habitaient la région des steppes voisines. — Au Caucase, les
princes d’Alanie, d’Abasgie, d’Albanie s’enorgueillissaient de porter les
titres et de recevoir les subsides de Byzance. Les états d’Arménie enfin,
arrachés au Xe
siècle à l’influence arabe, fournissaient par milliers à l’empire des soldats
et des généraux. Et le roi pagratide d’Arménie, comme les princes du
Vaspourakan, du Taron, d’Ibérie, étaient les clients et les serviteurs
fidèles de la monarchie, en attendant le jour où successivement leurs domaines
seraient annexés par Basile II.
L’œuvre religieuse : la
conversion de la Russie. — Mais au delà
de ces régions pincées sous le protectorat grec, l’action civilisatrice de
Byzance s’étendait plus loin encore : comme toujours, les missionnaires
secondaient l’œuvre des diplomates. La conversion des Russes au christianisme
en offre une preuve éclatante.
Depuis le milieu du ixe siècle, Byzance était en relations
avec la Russie. A
plusieurs reprises, depuis l’agression de 860, les aventuriers de Kief
avaient menacé Constantinople de leurs attaques (907 et 941) ; par ailleurs les empereurs
recrutaient volontiers des soldats parmi ces hardis guerriers, et les
marchands russes fréquentaient le marché byzantin. La visite de la tsarine
Olga à Byzance (957)
et sa conversion au christianisme rendirent plus étroites encore ces
relations. Mais c’est surtout à la fin du Xe siècle la conversion de Vladimir, grand
prince de Kief, qui fut l’événement décisif. En 988, pour abattre les
révoltes féodales, Basile II avait obtenu du prince de Kief un corps de 6.000
mercenaires ; en échange, Vladimir demanda la main d’une princesse byzantine,
et pour forcer la volonté hésitante de la cour impériale, il s’empara de
Cherson. Basile II
céda aux exigences du roi barbare, mais le persuada d’accepter le baptême.
Vladimir le reçut à Cherson (989), puis l’imposa à Kief à son peuple. Et la Russie désormais
chrétienne se modela sur la civilisation byzantine ; elle emprunta à Byzance,
avec l’orthodoxie, son art, sa littérature, ses mœurs. Après Vladimir, son
fils Jaroslav (1015-1054)
continua et acheva l’œuvre, et il fit de Kief, sa capitale, la rivale de
Constantinople et une des plus belles villes de l’Orient. Vladimir avait été le
Clovis de la Russie
; Jaroslav en fut le Charlemagne. Mais l’un et l’autre durent à Byzance tous
les éléments de leur grandeur.

III — LE GOUVERNEMENT INTÉRIEUR DE L’EMPIRE ET LA CIVILISATION BYZANTINE
AU Xe SIÈCLE.
Ainsi, dans le monde du Xe siècle, l’empire byzantin était vraiment
l’empire universel, dont l’influence et les ambitions s’étendaient sur la
presque totalité du monde civilisé. Son organisation intérieure, telle
qu’elle apparaît à cette date, n’assurait pas moins solidement sa puissance
et son prestige.
Le gouvernement de
l’empire. — L’empereur grec — le basileus,
comme on l’appelait officiellement — était en effet un très grand personnage.
Héritier des Césars romains, il était, comme eux, tout ensemble le chef
suprême des armées et l’ex-pression vivante de la loi. Au contact des
monarchies orientales, il était devenu le maître tout-puissant (despotès, autocrator),
l’empereur par excellence, émule et successeur du Grand Roi (basileus). Le christianisme lui avait donné une
consécration et un prestige de plus. Élu de Dieu, marqué par le sacre d’une
investiture divine, vicaire et représentant de Dieu sur la terre, il
participait en quelque manière à la divinité. Dans les pompes de la cour,
dans les complications de cette étiquette, fastueuse à la fois et un peu
puérile, dont Constantin Porphyrogénète, dans le Livre des Cérémonies, s’est
complu à codifier les rites, dans toutes les manifestations de cette
politique d’ostentation et de magnificence, par laquelle Byzance s’est
toujours flattée d’étonner et d’éblouir les barbares, l’empereur apparaissait
comme un être plus qu’humain. Et aussi bien tout ce qui touchait sa personne
était tenu pour sacré, et l’art
ceignait sa tête du nimbe, comme il faisait pour les personnes divines et les
saints.
Souverain de droit divin, absolu et despotique, l’empereur
concentrait en sa main toute l’autorité ; et on voit aisément tout ce que
gagnait l’empire à cette unité de direction, lorsque la main qui tenait les
rênes était ferme ; et elle le fut souvent. Rien dans la constitution
byzantine ne faisait équilibre à cette puissance suprême. Le Sénat n’était
plus qu’un conseil d’État, composé de hauts fonctionnaires dociles ; le
peuple n’était qu’une plèbe, turbulente souvent et factieuse, qu’il fallait
nourrir et amuser. L’Église, malgré la place qu’elle tenait dans la société
byzantine, malgré le danger qui naissait de sa richesse et de son ambition,
était, depuis la fin de la querelle des images, plus soumise que jamais à
l’État : Seule l’armée était une force, qui souvent s’était manifestée par des
soulèvements militaires et des révolutions. Sans écarter pleinement ce péril,
le progrès des idées de légitimité l’avait rendu pourtant moins fréquent et
moins redoutable pour la dynastie.
L’administration
byzantine et son œuvre. — Ce gouvernement despotique, aussi
absolu, aussi infaillible dans le domaine spirituel que dans le domaine
temporel, était servi par une administration savante, fortement centralisée
et admirablement disciplinée. Dans la capitale, autour du prince, les
ministres, chefs des grands services, dirigeaient de haut l’État,
transmettaient à travers la monarchie la volonté du maître. Sous leurs ordres
travaillaient des bureaux innombrables, où s’étudiait le détail des affaires,
où se préparaient les décisions. De même que Rome autrefois, Byzance a
gouverné le monde par la forte organisation de sa bureaucratie. Dans les
provinces, où le régime des thèmes était devenu la base unique de
l’organisation administrative (on comptait 30 thèmes vers le milieu du Xe siècle, 18 en Asie et 12
en Europe), tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains d’un
personnage tout-puissant, le stratège, nommé directement par
l’empereur et dépendant directement de lui. Ainsi, du haut en bas de
l’échelle administrative, tout le personnel des fonctionnaires dépendait
étroitement du souverain, et ce personnel, bien recruté, bien préparé, et
tout dévoué à sa tâche, encouragé à bien servir par l’avancement que lui
accordait le prince dans la hiérarchie savante des fonctions et des dignités,
s’acquittait avec un zèle attentif du double rôle que lui assignait la volonté
de l’empereur. La tâche de l’administration était d’abord de fournir de l’argent
au gouvernement : tâche lourde, car sans cesse il y eut à Byzance manque d’équilibre
entre les recettes du trésor et les dépenses innombrables de la politique et
du luxe impérial, disproportion entre les projets grandioses et l’insuffisance
des ressources. L’autre tâche de l’administration impériale était encore plus
difficile peut-être. La monarchie byzantine n’avait ni unité de race ni unité
de langue : c’était, comme on l’a dit, une création
artificielle, gouvernant vingt nationalités différentes, et les réunissant
dans cette formule : un seul maître, une seule foi. Ce fut l’œuvre
admirable de l’administration de donner à cet État sans nationalité la
cohésion et l’unité nécessaires par l’empreinte commune de l’hellénisme, par
la profession commune de l’orthodoxie. Le grec fut la langue de
l’administration, de l’Église, de la civilisation ; il prit dans l’empire
cosmopolite comme un faux air de langue nationale. Par son habileté à
propager la culture hellénique, par l’art ingénieux qu’elle apporta à ménager
et à assimiler les peuples vaincus, l’administration impériale marqua d’une
empreinte commune les éléments discordants dont se composait la monarchie ;
et rien n’atteste mieux la vitalité et la puissance d’expansion de l’empire.
Par la propagation de la foi orthodoxe, par l’ingénieuse façon dont elle
employa l’Église à faire la conquête morale des pays soumis par les armes,
l’administration acheva de rapprocher et de fondre les races diverses que
gouvernait le basileus. Elle fut vraiment la robuste armature qui soutint la
monarchie et en fit un corps homogène et fort.
L’œuvre législative.
— Les empereurs de la maison de Macédoine s’efforcèrent de fortifier encore
cette cohésion par une grande œuvre législative : ils restaurèrent, en
l’adaptant aux conditions nouvelles de la vie sociale, l’antique droit créé
par Justinien. Basile Ier prit l’initiative de cette grande entreprise en
faisant réunir dans le Prochiros Nomos
(879) les
principaux extraits du Corpus juris civilis
et en faisant préparer, sous le nom d’Épanagogè
(886), un
manuel du droit usuel. Son fils Léon VI acheva l’œuvre en faisant rédiger,
sous le titre de Basiliques, un code complet en soixante livres (887-893),
compilation et résumé des travaux juridiques publiés sous le règne de
Justinien. Les successeurs des deux premiers empereurs macédoniens ne
montrèrent pas une moindre activité législative, que couronna, en 1045, sous
Constantin Monomaque, la fondation de l’école de droit de Constantinople,
destinée à être tout ensemble une pépinière de juristes et de fonctionnaires.
Ainsi achevait d’être consolidée l’unité de la monarchie.
L’organisation militaire.
— Une armée excellente, admirablement entraînée par une tactique savante, et
qui trouvait dans l’élan religieux et le sentiment patriotique des motifs
puissants de vaillance et d’enthousiasme, une belle flotte, dont les
victoires avaient rendu à Byzance la domination des mers, et qui était, comme
le disait un écrivain du XIe siècle, la gloire des Romains,
augmentaient encore la force et le prestige de l’empire. Pour ces soldats, en
qui ils voyaient les meilleurs serviteurs de la monarchie, les grands
empereurs militaires de la dynastie macédonienne ont eu une attentive et
constante sollicitude : ils ont voulu leur assurer tous les privilèges, tous
les égards, les terres distribuées à titre héréditaire, aussi bien que la
considération due aux défenseurs de l’empire et de la chrétienté. Et
l’admirable épopée des guerres d’Asie, l’âpreté infatigable de la lutte
contre les Bulgares ont montré en effet tout ce qu’on pouvait attendre de ces
troupes incomparables, rompues au métier des armes, capables de supporter
toutes les épreuves, toutes les fatigues, toutes les privations. Assurément
ces troupes étaient en grande partie formées de mercenaires et elles avaient
tous les défauts des armées de mercenaires : elles n’en ont pas moins, sous
les chefs illustres qui alors les commandèrent, rendu à la monarchie
d’éclatants services et paré ses drapeaux d’une auréole de gloire.
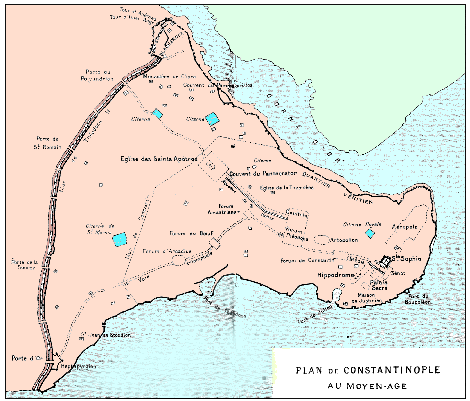
[Agrandir l'image]
La prospérité économique.
— Une bonne administration financière, un admirable développement de
l’industrie et du commerce donnaient à l’empire, avec la puissance, la
richesse. On a pu calculer qu’au XIe siècle les revenus de la monarchie s’élevaient à 650
millions, qui équivaudraient à plus de trois milliards or d’aujourd’hui ; et,
à la mort de Basile II,
il y avait en caisse une réserve de 220 millions, plus d’un milliard or de
notre monnaie. Malgré la réglementation minutieuse et tatillonne que l’État
imposait à l’industrie — Constantinople fut, on l’a dit, le paradis du
monopole et du protectionnisme — les chefs-d’œuvre qui sortaient des mains
des artisans byzantins, étoffes de soie aux couleurs éclatantes et tout
historiées de broderies, orfèvreries splendides rehaussées d’émaux
étincelants, bijoux éblouissants de pierreries et de perles, ouvrages
d’ivoire finement sculptés, bronzes niellés d’argent, verreries relevées
d’or, toutes ces merveilles d’une industrie de luxe valaient aux ateliers
grecs un prestige extraordinaire dans le monde entier. Malgré les erreurs de
la politique économique de l’empire et le système assez vexatoire qu’il imposait
aux transactions, le développement du commerce n’était pas moins admirable.
Par l’activité de ses négociants, par la puissance de sa marine, par les
centres d’échanges qu’offraient ses ports et ses grands marchés, Byzance
accaparait les richesses du monde entier. Par sa position entre l’Orient et
l’Occident, au débouché de toutes les routes du commerce mondial,
Constantinople était le grand entrepôt où affluaient tous les peuples, où
s’échangeaient tous les produits de l’univers. On a calculé que, dans la
seule capitale, les droits de marché et de douanes rapportaient annuellement
au trésor 7.300.000 sous d’or, plus de -5oo millions or d’aujourd’hui.
L’éclat des lettres et
des arts. — A ce développement de la vie industrielle et
commerciale correspondait un semblable épanouissement de la vie
intellectuelle. Dans l’Université de Constantinople reconstituée, des maîtres
éminents, sous la protection attentive des souverains, enseignaient la
philosophie, la rhétorique, les sciences ; et autour de leurs chaires les
élèves se pressaient, venus de tous les points de l’Orient byzantin ou arabe.
Au contact de l’antiquité retrouvée, au sortir de la crise iconoclaste, une
renaissance se produisait dans tous les domaines de la pensée, et les
empereurs eux-mêmes ne dédaignaient pas de faire couvre de lettrés. Sur
l’initiative de Constantin VII Porphyrogénète, le Xe siècle dresse l’inventaire des
richesses que lui a léguées le passé ; c’est le siècle des encyclopédies
historiques, juridiques, administratives, grammaticales, scientifiques,
hagiographiques. Sur ces bases, la pensée originale s’appuie pour aller plus
avant. L’époque des empereurs macédoniens a vu successivement fleurir, au ixe
siècle, un Photius, savant prodigieux, esprit hardi et puissant, au XIe siècle, un
Psellos, génie universel, l’esprit le plus curieux, le plus brillant, le plus
novateur de son temps, qui a remis en honneur la philosophie platonicienne
et, par son talent d’écrivain, mérité d’être égalé aux plus grands. Autour
d’eux, c’est une pléiade d’hommes de valeur, historiens comme Constantin
Porphyrogénète, Léon Diacre ou Michel Attaliate, chroniqueurs comme Syméon
Magistros ou Skylitzés, philosophes, théologiens et poètes. A côté de la
littérature savante et mondaine, la poésie populaire fait bonne figure, et
l’épopée de Digénis Akritas, comparable à la chanson de Roland ou au
romancero du Cid, fait passer dans la littérature byzantine un souffle
nouveau et inconnu.
Pour l’art aussi l’époque des empereurs macédoniens marque
un nouvel âge d’or. Basile Ier et ses successeurs ont été, comme Justinien, de grands bâtisseurs,
et les architectes qu’ils ont employés ont su, avec une fantaisie ingénieuse
et créatrice, renouveler en une série d’églises charmantes le type créé à
Sainte-Sophie. De même que la littérature, l’art de ce temps est tout dominé
par les influences de la tradition antique et profane retrouvée. Byzance
revient aux conceptions hellénistiques, aux ordonnances simplifiées, aux
attitudes sculpturales, auxquelles la connaissance plus intime de l’Orient
musulman mêle le goût de l’ornementation somptueuse et délicate et la
recherche des couleurs éclatantes. A côté de l’art religieux, un art profane,
travaillant pour les empereurs et pour les grands, apparaît, tout inspiré de
l’histoire et de la mythologie classiques, et qui se complait aux sujets de
genre, à la peinture d’histoire ou de portraits. Dans la décoration des
églises comme dans celle des palais, se manifeste un goût de luxe éclatant et
de prodigieuse splendeur. Des mosaïques comme celles du couvent de Saint-Luc,
comme celles surtout de Daphni, chef-d’œuvre de l’art byzantin, ou celles
encore de Sainte-Sophie de Kief, où s’atteste l’influence prodigieuse que cet
art exerçait par tout l’Orient ; des manuscrits admirables, enluminés pour
les empereurs, tels que le Grégoire de Nazianze ou le Psautier de la Bibliothèque
nationale de Paris, tels que le Ménologe basilien du Vatican ou le Psautier
de la Marcienne
à Venise ; les émaux éblouissants, comme le reliquaire de Limbourg ou les
icônes représentant saint Michel que conserve le trésor de Saint-Marc ; et
encore les ivoires, les étoffes, suffisent à montrer quels chefs-d’œuvre
l’art byzantin était alors capable de créer. Il créait quelque chose de plus
remarquable encore, cette ordonnance savante de la décoration, qui fait des
peintures un instrument d’édification au service de l’Église, et cette
iconographie nouvelle, si variée et si riche, qui correspond à la renaissance
du Ixe siècle. Et par tout cela, l’art byzantin exerçait puissamment son
influence dans le monde entier, en Bulgarie comme en Russie, dans l’Arménie
comme dans l’Italie du sud.
Constantinople était le foyer éblouissant de cette
floraison admirable, la reine des élégances, la capitale du monde civilisé.
Derrière les murailles puissantes qui la défendaient, la ville gardée de Dieu abritait d’incomparables
splendeurs, Sainte-Sophie, dont la beauté harmonieuse et les cérémonies
pompeuses frappaient d’étonnement tous ceux qui la visitaient ; le
Palais-Sacré, dont dix générations d’empereurs avaient mis leur orgueil à
accroître la magnificence inouïe ; l’Hippodrome, où le gouvernement
accumulait tous les spectacles qui pouvaient amuser le peuple, étaient les
trois pôles autour desquels gravitaient toute la vie byzantine. Auprès d’eux,
c’était la multitude des églises et des monastères, le faste des palais, la
richesse des bazars, les chefs-d’œuvre de l’art antique remplissant les
places et les rues et faisant de la ville le plus admirable des musées. A
elle seule, Constantinople au Xe siècle se vantait d’offrir sept merveilles — autant que le
monde antique tout entier en avait autrefois connues — dont elle se parait, selon le mot d’un
écrivain, comme d’autant d’étoiles.
Les étrangers, en Orient comme en Occident, rêvaient de Byzance comme d’une
ville unique au monde, toute rayonnante dans un miroitement d’or. Chez les
Slaves comme chez les Arabes, en Italie comme dans la France lointaine, la
hantise de Byzance et l’influence que sa civilisation exerçait étaient
profondes ; la monarchie grecque, sous les empereurs macédoniens, était, un
des plus puissants États qui existât ; et en même temps que l’admiration,
déjà elle excitait — danger grave pour l’avenir — la convoitise universelle.

IV — LES CAUSES DE FAIBLESSE DE L’EMPIRE.
D’autres dangers, plus immédiats, menaçaient cette
prospérité.
La question sociale et
les soulèvements féodaux. — A la fin du Ixe siècle et durant
tout le cours du Xe,
une question sociale redoutable troubla l’empire byzantin. Deux classes
étaient en présence, les pauvres (πένητες)
et les puissants (δυνατοί)
; et par les usurpations incessantes des seconds sur la propriété et la
liberté des premiers, peu à peu s’était constituée dans l’empire, surtout
dans les provinces asiatiques, une grande aristocratie féodale, possédant des
domaines immenses, des clients, des vassaux, et dont l’influence s’accroissait
encore des hautes fonctions administratives qu’elle remplissait, des
commandements qui plaçaient l’armée entre ses mains. Riche, puissante,
populaire, cette noblesse était un danger politique autant que social pour le
gouvernement. Les empereurs le comprirent et, de toute leur énergie, ils
luttèrent contre ces barons indisciplinés, qui se flattaient d’en imposer au
basileus, qui en tout cas, par les immunités qu’ils réclamaient, diminuaient
les ressources du fisc et, par leur usurpation des fiefs militaires attribués
aux soldats, tarissaient l’une des meilleures sources du recrutement de
l’armée.
Basile Ier, ici comme en toutes choses, inaugura la
politique de la dynastie et s’appliqua à limiter les empiètements des grands.
Ses successeurs poursuivirent son œuvre. Une série d’ordonnances, promulguées
par Romain Ier
Lécapène (922 et 934),
par Constantin VII
(947), par Romain
II, par
Nicéphore Phocas, eurent pour but d’assurer la protection de la petite propriété
et d’empêcher les féodaux d’engloutir les biens
des pauvres. Le constant renouvellement de ces mesures même prouve
que le danger allait toujours croissant. Les événements de la seconde moitié
du Xe siècle
devaient le montrer de façon éclatante.
Au lendemain de l’assassinat de Nicéphore Phocas, un
premier soulèvement féodal éclata en Asie Mineure (971), sous la direction de Bardas
Phocas, un neveu du défunt empereur. L’insurrection ne fut pas domptée sans
peine. Elle allait recommencer, plus redoutable, pendant les premières années
du règne de Basile II.
En 976, une véritable Fronde asiatique se produisait. Bardas Skléros, un
grand seigneur féodal, en prenait la tête et, groupant autour de lui tous les
mécontents, tous les aventuriers, tous ceux qui espéraient gagner quelque
chose dans une révolution, il se rendait en quelques semaines maître de
l’Asie et menaçait Constantinople (978). Contre le prétendant féodal le gouvernement fit appel à
une autre féodal. Bardas Phocas battit Skléros à la journée de Pankalia (979) et écrasa
l’insurrection. Mais quand le pouvoir affermi de Basile Il sembla menacer
l’aristocratie, un nouveau soulèvement éclata. Phocas et Skléros, les
adversaires de la veille, se réconcilièrent pour s’insurger contre l’empereur
(987).
L’admirable énergie de Basile II triompha de tout. Phocas battu, à Chrysopolis, en face de
Constantinople qu’il bloquait déjà (988), trouva la mort à la journée d’Abydos (989) ; Skléros dut
faire sa soumission. Mais l’empereur n’oublia jamais ces insurrections
féodales, et dans l’ordonnance de 996 il frappa avec une dureté farouche les
grands barons usurpateurs. Il semblait que la couronne eut pris une revanche
décisive sur les révoltés féodaux d’Anatolie.
En fait toutes ces mesures furent impuissantes. Le
gouvernement eut beau restreindre le développement de la grande propriété,
écraser d’impôts les barons, chercher à diminuer leur influence sur l’armée :
rien n’y fit. L’aristocratie féodale devait triompher du pouvoir impérial, et
dans la faiblesse et l’anarchie qui marquent la seconde moitié du XIe siècle, c’est
une famille féodale, celle des Comnènes, qui assurera le salut de la
monarchie.
L’aristocratie religieuse.
— A côté de la féodalité laïque, la féodalité religieuse n’était ni moins
puissante, ni moins dangereuse.
Au Xe
siècle, comme au VIIIe, une partie importante de la propriété foncière
s’immobilisait entre les mains des moines, au grand détriment du fisc et de
l’armée. Les empereurs du Xe siècle s’efforcèrent de restreindre le développement des
biens monastiques ; Nicéphore Phocas en vint même (964) à interdire toute fondation de
couvent nouveau, toute donation aux monastères existants. Mais, dans l’empire
byzantin, l’Église était trop puissante pour que de telles mesures pussent
être longtemps maintenues, et l’empire avait trop souvent besoin d’elle pour
ne point la ménager. En 988, Basile II abrogeait l’ordonnance de Phocas. Le parti monastique avait
vaincu.
En face du clergé séculier, l’empereur n’eut pas non plus
toujours le dernier mot. Par l’étendue de son ressort, par le rôle qu’il
jouait dans l’Église, par l’armée de moines qui lui obéissait, par
l’influence politique qu’il exerçait, par les vastes ambitions que lui
inspirait cette puissance, le patriarche de Constantinople était un
personnage redoutable Si un patriarche dévoué au gouvernement pouvait rendre
de grands services, un patriarche hostile était étrangement dangereux, et son
opposition pouvait tenir en échec l’empereur lui-même. Léon VI en fit
l’expérience en face du patriarche Nicolas ; et si finalement il contraignit
le prélat à abdiquer (907),
celui-ci n’en remonta pas moins, après la mort du prince, sur son siège (912) ; il fut,
durant la minorité de Constantin VII, le ministre dirigeant, il joua dans les révolutions
intérieures de l’empire, comme dans la direction de sa politique extérieure,
un rôle décisif ; et le tomus unionis (920) où fut réglée
cette question des quatrièmes noces, qui jadis avait mis le patriarche aux
prises avec l’empereur, fut pour lui une revanche éclatante sur l’autorité
impériale. Pareillement le patriarche Polyeucte brava Nicéphore Phocas ; et
s’il dut finalement céder, il n’en arracha pas moins ensuite à Tzimiscès (970) la révocation
de toutes les mesures défavorables à l’Église. Mais l’ambition des
patriarches de Constantinople devait avoir de plus graves conséquences encore
: elle allait amener la rupture avec Rome et le schisme des deux Églises.
Une première fois déjà, on le sait, l’ambition de Photius
avait provoqué cette rupture. L’avènement de Basile Ier inaugura une autre
politique religieuse ; le patriarche fut disgracié et le concile œcuménique,
tenu à Constantinople en 869, rétablit l’union avec Rome. Photius cependant
remonta sur son siège en 877 ; de nouveau, au concile de 879, il rompit avec
la papauté ; et si finalement il tomba en 886, si l’union fut en 893
solennellement restaurée, le conflit latent n’en subsista pas moins entre les
deux Églises, moins assurément pour les questions secondaires de dogme et de
discipline qui les séparaient que par le refus obstiné des Grecs d’accepter
la primauté romaine et par l’ambition qu’avaient les patriarches de
Constantinople d’être les papes de l’Orient. Dès la fin du Xe siècle
l’hostilité était extrême : il allait suffire, au milieu du XIe siècle, de
l’ambition de Michel Céroularios pour consommer la rupture définitive.

V — LA DÉCADENCE DE
L’EMPIRE AU XIe SIÈCLE (1025-1081).
Malgré les réels périls qui menaçaient l’empire, pourtant,
pour maintenir le prestige et la puissance de la monarchie, il eût suffi de
princes énergiques, continuant les traditions d’une politique habile et
forte. Malheureusement on eut des gouvernements de femmes ou de souverains
médiocres et négligents, et ce fut le point de départ d’une nouvelle crise.
Dès la mort de Basile II, la décadence commença, sous son frère
Constantin VIII (1025-1028)
et sous les filles de celui-ci, Zoé d’abord et les trois maris successifs,
Romain III (1028-1034), Michel IV (1034-1041),
Constantin Monomaque (1042-1054),
avec qui elle partagea le trône (elle mourut en 1050), et ensuite Théodora (1054-1056). Elle se
manifesta plus brutalement encore après la fin de la dynastie de Macédoine.
Un coup d’État militaire mit Isaac Comnène sur le trône (1057-1059) ; son
abdication appela au pouvoir Constantin X Doucas (1059-1067). Puis ce fut Romain IV Diogène (1067-1071), que
Michel VII
Doucas renversa (1071-1078)
; une nouvelle révolution donna la couronne à Nicéphore Botaniate (1078-1081). Et
durant ces courts règnes l’anarchie ne fit que s’accroître et la crise
redoutable, extérieure et intérieure, dont souffrait l’empire, ne fit que
s’aggraver.
Normands et Turcs.
— Sur toutes les frontières, maintenant Byzance reculait. Sur le Danube, les
Petchenègues, des nomades de race turque, passaient le fleuve, occupaient le
pays jusqu’aux Balkans. La
Bulgarie de l’Ouest se soulevait (1040), sous la conduite de Pierre
Deljan, un descendant du tsar Samuel, Thessalonique était menacée par les
révoltés et, malgré l’échec final du mouvement, le pays frémissant sous la
tyrannie byzantine demeurait tout prêt à se détacher. La Serbie de même
s’insurgeait et revendiquait son indépendance. Dans l’Adriatique, Venise recueillait
l’héritage de l’empire. Mais deux adversaires surtout apparaissaient
redoutables, les Normands en Europe, les Turcs Seldjoucides en Asie.
Établis vers le milieu du XIe siècle dans l’Italie méridionale et
soutenus par la papauté, les Normands, sous la conduite de Robert Guiscard,
enlevaient successivement à l’empire grec tout ce qu’il possédait encore dans
la péninsule. Vainement Georges Maniakès, le gouverneur byzantin d’Italie,
après de glorieux succès sur les Arabes de Sicile (1038-1040), avait un montent arrêté
les progrès des Normands (1042). Lui parti, tout s’effondra. Troja tombait en 1060,
Otrante en 1068, Bari, la dernière place byzantine, succombait en 1071.
Bientôt les ambitions du duc dé Pouille s’étendirent à l’autre rivage de
l’Adriatique ; il créait une marine, s’apprêtait à intervenir en Illyrie. En
1081, son fils Bohémond débarquait sur la côte d’Épire et Guiscard, avec 30.000
hommes, se préparait à le suivre.
En Asie la situation était semblable. Conduits par trois
hommes remarquables, Togrul beg, Alp-Arslan (1065-1072), Malek-Shah (1072-1092), les
Turcs Seldjoucides donnaient l’assaut à l’empire. Ils se brisèrent d’abord à
la solide ligne de forteresses créée par Basile II ; mais l’Arménie, mal rattachée à
Byzance, mécontente des persécutions religieuses qu’on lui infligeait, était
de fidélité incertaine. En 1064 les Turcs prenaient Ani, bientôt Césarée et
Chones. Vainement l’énergique Romain Diogène tenta d’arrêter leurs progrès.
Il fut défait à Mantzikiert (1071), au nord du lac de Van, et tomba aux mains des
infidèles. Jamais Byzance ne devait se relever complètement de ce grand
désastre. Désormais tout l’est de l’Asie Mineure, l’Arménie, la Cappadoce, toutes ces
régions d’où l’empire tirait ses meilleurs soldats, ses généraux les plus
illustres, étaient perdues sans retour. Désormais aussi, dans l’anarchie
croissante de l’empire, les Turcs eurent beau jeu : Iconium tombait entre
leurs mains, puis Nicée, où les Byzantins eux-mêmes les appelèrent ; et en
1079 ils s’emparaient de Chrysopolis, en face de Constantinople.
Est-ce à dire que les Normands et les Turcs fussent des adversaires
plus redoutables que tant d’autres que Byzance avait vaincus autrefois ? Non,
mais l’empire était plus faible. Tous les dangers qui s’annonçaient au Xe siècle avaient
réalisé leurs menaces.
Le schisme et l’anarchie
intérieure. — En 1054, l’ambition du patriarche Michel
Céroularios avait déchaîné un grave conflit. II s’était attaqué à Rome,
lorsque celle-ci prétendit rétablir son autorité sur les diocèses de l’Italie
du sud. Le pape Léon IX avait riposté avec une égale vigueur et les légats
pontificaux venus à Constantinople avaient par leur attitude arrogante choqué
violemment l’orgueil byzantin. On en vint donc vite à la rupture. Les légats
excommunièrent solennellement le patriarche. Céroularios imposa par l’émeute
à l’empereur Constantin IX
Monomaque le schisme qu’il désirait. La séparation des deux Églises était
accomplie. Cette rupture avec la papauté devait avoir pour l’empire de très
graves conséquences. Non seulement elle précipita la chute de la domination
grecque en Italie ; elle creusa surtout entre Byzance et l’Occident un abîme
que rien ne put combler. Aux yeux des Latins, les Grecs ne furent plus
désormais que des schismatiques, auxquels on ne devait ni égards ni
tolérance, et dont on avait les plus justes raison de se défier. Les Byzantins
d’autre part s’entêtèrent dans leurs rancunes et leur haine contre Rome. La
question des rapports entre la papauté et l’Église orthodoxe posera
lourdement désormais sur les destinées de la monarchie. Enfin, à l’intérieur,
les circonstances où s’était produit le schisme avaient montré de façon
éclatante, en face du patriarche tout-puissant, la faiblesse du pouvoir
impérial : Michel Céroularios ne devait point l’oublier.
Mais surtout le péril féodal devenait chaque jour plus
menaçant. Pour abattre l’aristocratie trop puissante, la politique impériale
crut habile de combattre l’armée sur qui s’appuyaient les féodaux et dont la
force se manifestait dangereusement, à ce montent même, par des soulèvements
comme celui de Georges Manialiès, le héros des guerres de Sicile et d’Italie (1043), ou celui de
Léon Tornikios (1047).
Un parti civil se forma, qui prit à tâche de témoigner sa défiance aux
soldats. Le règne de Constantin Monomaque en marqua le premier triomphe. Sous
cet empereur jouisseur et peu guerrier, l’armée fut notablement diminuée ;
les troupes nationales furent plus que jamais remplacées par des mercenaires,
Normands, Scandinaves, Russes, Anglo-Saxons, en qui on croyait pouvoir mettre
plus de confiance. On rogna sur le budget militaire, on négligea les
forteresses, on tint à l’écart ou disgracia les généraux. Le gouvernement fut
aux mains de gens de lettres, Psellos, Xiphilin, Jean Mauropous, etc. La
fondation de l’école de droit eut pour objet principal de fournir des
fonctionnaires civils à ce gouvernement. Entre la bureaucratie
toute-puissante, appuyée sur le Sénat, et l’armée le conflit fut bientôt inévitable.
Il fut violent. En 1057 un pronunciamiento, qu’appuya le patriarche
Céroularios, mit sur le trône un général illustre, Isaac Comnène. Mais quand
Isaac découragé abdiqua (1059)
l’avènement des Doucas marqua une réaction contre le parti militaire et
assura de nouveau, et plus que jamais, le triomphe de la bureaucratie. Un
moment, Romain Diogène rendit le pouvoir à l’armée. Il succomba sous l’attaque
forcenée de ses adversaires coalisés ; et le règne de Michel VII, dont
Psellos fut le premier ministre, sembla le triomphe définitif du parti civil.
Tout cela avait de graves conséquences. A l’extérieur,
l’empire partout reculait ; les populations, mal défendues par un
gouvernement trop faible, et d’ailleurs écrasées d’impôts, se détachaient de
Byzance et, comme dans l’empire romain finissant, elles appelaient les
barbares. A l’intérieur, dans l’anarchie universelle, l’aristocratie féodale
relevait la tête ; l’armée, mécontente de l’hostilité qu’on lui marquait,
était prête à toutes les insurrections. Les mercenaires eux-mêmes se
soulevaient, et les condottieri normands au service de l’empire, les Hervé,
les Robert Crépin, les Roussel de Bailleul, ne travaillaient que pour leur
intérêt propre. Les révolutions succédaient aux révolutions. Nicéphore
Botaniate se soulevait en Asie contre Michel VII, en même temps que Nicéphore Bryenne
s’insurgeait en Europe (1078).
Puis contre Nicéphore Botaniate devenu empereur (1078-1081), d’autres prétendants,
Basilacès, Mélisséne, s’insurgeaient. Et l’empire envahi, épuisé, mécontent,
réclamait à grands cris un sauveur. Ce fut Alexis Comnène, le meilleur des
généraux de l’empire. Le coup d’État qui le plaça sur le trône (1er avril 1081),
en mettant fin à trente ans d’anarchie, marqua le triomphe de l’aristocratie
féodale et de l’armée sur le parti civil, la victoire aussi de la province
sur la capitale. Mais il allait donner à l’empire un nouveau siècle de
grandeur.
|