ATTILA DANS LES GAULES EN 451
CHAPITRE PREMIER — HISTOIRE DE L’INVASION
|
En transférant le siège de l’empire à Byzance, CONSTANTIN avait moins un but religieux que politique ; il se proposait moins, par cette résolution extraordinaire, de fuir les honteuses superstitions du paganisme que de rétablir l’ascendant du nom Romain dans toutes les contrées où la victoire l’avait fait pénétrer. A la vérité sa grande âme devait se trouver mal à l’aise au sein d’une ville livrée à une corruption sans frein et comme enivrée d’un culte qui divinisait tous les genres de débauche ; au milieu d’hommes dont les goûts, les mœurs, les idées contrastaient d’une manière si étrange avec le langage élevé, la conduite noble, les maximes pures et austères des disciples de l’Évangile. Il devait surtout ressentir un vif chagrin des sentiments hostiles qui se manifestèrent contre lui à l’occasion de l’assassinat de l’infortuné Crispus, son fils ; de la mort violente de l’incestueuse Faustine, et du meurtre non moins odieux de plusieurs personnages illustres, condamnés sur de vagues rumeurs, ou dont tout le crime consistait à porter ombrage à un despotisme qu’importunait la plainte et qu’irritait la plus légère contradiction. Au milieu des regrets amers que lui arrachaient publiquement tant de funestes catastrophes, il ne pouvait que déplorer l’aveuglement fatal qui confondait dans la même condamnation le coupable et sa croyance ; qui semblait reprocher au nouveau culte, ennemi de toute violence, d’autoriser, en ne les prévenant pas, des actes aussi sanguinaires. Mais si ces pénibles circonstances durent lui inspirer de l’éloignement pour le séjour de Rome ; si, malgré la foule empressée des courtisans et des flatteurs, elles y attristèrent pour jamais son existence par un sombre isolement ; la raison d’État, l’intérêt de l’empire, parurent toujours plus haut à son cœur que des affections purement personnelles ; jamais ces grands mobiles ne furent balancés en lui par le sentiment d un étroit égoïsme, et les devoirs de l’empereur l’emportèrent constamment sur les goûts et sur les penchants du chef de famille et du simple citoyen. L’histoire doit proclamer à sa louange que des motifs d’une haute et généreuse politique lui inspirèrent seuls la grande résolution qu’il prit, après un séjour de près de vingt ans à Rome, de quitter cette reine du monde pour n’y plus revenir jamais. Le Bosphore, situé à peu près à égale distance des frontières de l’empire les plus menacées par les Barbares, avait fixé toute son attention. Tranquille sur l’occident et sur le Midi, c’était à l’Orient et au Nord que se trouvaient ses plus dangereux ennemis. En effet, par l’Espagne il contenait l’Afrique, et la Germanie par les Gaules où le nom de son père était toujours vénéré : l’Italie était à portée de peser également sur l’une ou sur l’autre de ces grandes provinces depuis longtemps façonnées au joug et au sein desquelles, depuis Jules César, le pouvoir de Rome n’avait plus été sérieusement contesté. Mais les Scythes et les Parthes inquiétaient sans cesse dans l’Orient une domination incertaine et mal assurée. Souvent vaincus, jamais domptés, ces barbares tenaient les armées romaines dans de perpétuelles alarmes, et ne laissaient ni paix ni trêve à leurs rudes travaux. Pis forts de leurs déserts et de leur manière de combattre, que de leur nombre et de leur vaillance, ils reparaissaient, le lendemain d’une défaite, plus audacieux et plus redoutables qu’auparavant. Byzance faisait face aux uns et aux autres ; c’était la clef de l’Europe et de l’Asie, du Pont-Euxin et de la mer Égée ; c’était comme une place d’armes et un centre naturel des opérations militaires destinées à conserver intactes les barrières de l’Euphrate et du Danube ; barrières sans cesse contestées, mais indispensables à la sécurité de l’empire, et que les Romains ne voulaient plus franchir, ne l’ayant presque jamais fait impunément. Cette position était trop belle ; trop importante pour échapper â l’œil exercé dé Constantin. Depuis la défaite de Licinius, elle n’avait pers cessé un seul .jour d’occuper ses pensées. Aussitôt qu’il est débarrassé de soins plus urgents, elle fixe irrévocablement son choix. CONSTANTINOPLE s’élève au lieu où fut Byzance. Cette magnifique rivale de Rome brille de toutes les richesses du luxe, de toutes-les merveilles des arts ; il en fait la dédicace en 330 Mais l’établissement de cette nouvelle capitale était à peine achevé, que la situation de l’empire ne tarda pas à changer. Les Gaules étaient toujours un objet de convoitise pour les peuples qui habitaient au-delà du Rhin. Plusieurs fois battus et repoussés, ils revenaient toujours à la charge. Le moment approchait où ce torrent allait déborder de toutes parts et ébranler l’empire jusque dans ses fondements. Ces menaces d’invasion, qui inondaient sans cesse comme un orage sur tous les points d’un horizon lointain, avaient fait sentir la nécessité de donner plusieurs chefs à l’empire. Ce grand corps énervé par le luxe et par la mollesse, passait sans intervalle de la virilité à la décrépitude ; cessant de croître il allait décliner rapidement. Sa puissance militaire s’affaiblit encore plus vite que la puissance civile ; moins d’efforts en effet sont nécessaires pour conserver que pour acquérir. Le goût des armes se perd avec l’habitude des combats ; un ennemi vigilant s’en aperçoit : c’est le moment favorable pour l’attaque, il le saisit. Celui qui se tient sur la défensive est rarement victorieux ; c’est à l’audace et à la rapidité de ses agressions que Rome avait dû tous ses succès. Les successeurs de Constantin en firent bientôt la triste expérience ; moins d’un siècle après ce règne glorieux, l’empire était inondé, dévasté, rançonné par un déluge de barbares, Francs, Sarmates, Goths, Saxons, Allemands, Bourguignons, Suèves, Alains, Vandales. Tant que les Romains dédaignèrent les richesses, ils, furent dignes de les posséder ; mais les vainqueurs de l’univers ne surent pas se vaincre eux-mêmes. La soif de l’or, irritée par l’enivrement d’un luxe insensé, d’une sensualité effrénée, eut bientôt fait disparaître toutes les vertus qui avaient fait la force et la grandeur de la république ; la perte des mœurs fut le tombeau de sa puissance. Rome victorieuse compta bientôt parmi ses citoyens moins d’hommes libres que d’esclaves ; les peuples vaincus conservèrent seuls le génie qui enfante la libéré. Taudis que le colosse, haletant de vices et de débauches, s’affaissait sous le poids de sa propre corruption, ses ennemis plus nombreux, plus habiles, plus implacables, croissaient en énergie et en audace, et allaient bientôt lui faire expier, par de sanglantes représailles, dix siècles d’injures, de rapines et de cruautés. L’impulsion était donnée : tout déclinait à Rome, tandis que tout prospérait dans les rangs des Barbares. La grande révolution morale opérée par le christianisme devait, dans un sens, contribuer à ce résultat. Une religion de paix et d’amour, qui a horreur du sang, qui rend l’homme à toute la dignité de son être, qui l’épure et l’ennoblit en lui révélant la grandeur de sec destinées, devait faire tomber les armes des mains de ceux qui s’animeraient de ses généreuses inspirations, qui s’élèveraient à la hauteur de ses dogmes par la pureté de son culte et la sainteté de sa morale. Son esprit de mansuétude et de tolérance s’infiltrait peu à peu dans les meurs et y jetait les bases du nouveau droit publie que tous les peuples allaient bientôt adopter. Ennemi des guerres d’ambition, le chrétien préférait une paix sans gloire, mais exempte de violences et d’injustices, aux plus brillantes victoires toujours souillées par les fléaux que la guerre, même la plus juste, fait peser sur l’humanité. Toute agression lui était odieuse, les barbares étaient à ses yeux des frères à éclairer et à convertir, non des rebelles à punir et à exterminer. Sous l’influence toujours croissante de ces diverses causes, l’empire n’était plus cet aigle au vol rapide, à la serre sanglante, qui lançait au loin la foudre sur tous les points d’un immense horizon ; ce lion terrible, impétueux, qui, d’un seul bond, d’un seul choc, atteignait, terrassait- sa proie ; ce géant formidable à la poitrine d’airain, aux jambes de fer, qui étreignait à la fois de ses bras puissants et le Rhin et le Danube, et l’Euphrate et le Nil, et les glaces du Nord et les sables du Désert : c’était un amas confus de membres disjoints, de lambeaux épars, de débris souillés, corrompus, imposants encore par leur masse, mais énervés ; brillants, nais sans vigueur ; jetant encore un reflet de grandeur sur la scène du monde, mais aux, prises avec le trépas et sentant déjà les étreintes du néant qui réclamait sa proie. D’affreux craquements annonçaient que les temps étaient proches, des chocs redoublés allaient faire crouler le colosse sur sa base d’argile ; ses traces même devaient disparaître et l’empreinte de ses pas ne serait plus marquée que par des débris. La barrière de l’Euphrate n’était plus respectée l’Afrique était envahie ; le Rhin et le Danube, secouant un joug odieux, échappaient à Rome et ne protégeaient plus que les incursions de ses ennemis les plus acharné. Parmi ces ennemis, les Huns se sont rendus célèbres par leurs ravages. La terreur que ces barbares répandirent longtemps en Europe et en Asie a fixée sur eux, sur leurs expéditions, sur leur origine, l’attention des historiens. L’espèce humaine est originaire des bords de l’Euphrate. C’est du centre de l’Asie méridionale que sont partis tous les essaims qui peuplent aujourd’hui les différentes contrées du globe. Chaque famille, chaque tribu prit une direction différente ; les uns reportant à l’Ouest, parcoururent successivement toutes les contrées de l’Asie mineure, traversèrent le Bosphore, et de proche en proche se répandirent dans les différentes parties de l’Europe. D’autres s’enfonçant au nord sur les rivages paisibles de la mer Caspienne et dans les vallées abruptes du Caucase, franchirent bientôt cette barrière, et faisant à l’Ouest le tour du Pont-Euxin, se rencontrèrent avec les premiers, au bout de plusieurs siècles, sur les bords du Danube. D’autres encore, après avoir marché constamment à l’Est, atteignirent les limites du continent oriental, et décrivant à gauche un demi-cercle au pied de l’immense plateau du Thibet, se répandirent clans les solitudes presque sans limites de l’Asie septentrionale, solitudes désolées, d’où la stérilité du sol, l’âpreté du climat, l’isolement, le besoin et l’espoir d’une existence moins misérable, les poussèrent sans relâche jusqu’aux lieux déjà occupés par les races caucasiques avec lesquelles ils entamèrent un conflit que quarante siècles n’ont pas vu terminer. Quelques-uns de ceux-ci, rappelés par la fertilité de la Chine, d’où ils s’étaient éloignés dans l’espoir, si cruellement déçu, de trouver mieux encore, retournèrent sur leurs pas et essayèrent à plusieurs reprises d’y rentrer. La grande muraille fut construite pour arrêter leurs incursions. Quelquefois vainqueurs, mais définitivement refoulés dans les plaines stériles de la Tartarie, resserrés entre la grande muraille, les déserts du Thibet et les mers du Nord, ils durent diriger leurs courses aventureuses vers l’Occident, seule issue désormais ouverte à leur turbulente et inquiète activité. Telle est l’origine des Huns, dont l’existence se révèle pour la première fois à l’histoire, vers le Ile siècle de l’ère chrétienne. Ce peuple, qui a acquis en Europe une si funeste célébrité, répandu d’abord vers les sources ignorées de la Léna, de l’Irtick et de l’Obi, occupait le pays des Baskirs, et se consuma longtemps dans de misérables luttes contre des peuplades sans nom, encore plus pauvres et plus barbares que lui. Attiré par les contrées fertiles et déjà populeuses que baigne le Pont-Euxin, il franchit plus tard le Jaïk, et chassant devant lui les Alains, peuple d’origine caucasique, il s’arrête pendant plusieurs siècles sur les confins de l’Europe et de l’Asie, entre le Volga et le Tanaïs, lieux où se sont vidées depuis tant de sanglantes querelles entre l’Orient et l’Occident, ces deux puissants rivaux de gloire, de richesse et de civilisation. Plus tard encore il fond sur les Ostrogoths, peuple venu à sa rencontre de la Scandinavie et des bords de la Vistule, et répandu en foule sur la rive septentrionale de la mer Noire. Après une lutte acharnée, il le chasse de ses plus riches domaines et le rejette au-delà du Dniester. Avançant toujours, le torrent des Barbares, comme une lave brûlante, renverse tous les obstacles, brise toutes les résistances et ne tarde pas à s’étendre enfin jusqu’au Danube. L’Ukraine, la Moldavie, la Valachie, étaient alors la proie d’un mélange de Sarmates, de Goths, d’Alains et de Huns, peuples d’origine et de mœurs différentes, souvent en guerre les uns contre les autres, mais toujours d’accord et rivalisant de haine et de fureur contre l’ennemi commun, les Romains. Plus rapprochés du Danube que leurs rivaux, les Goths engagent les premiers la lutte contre le colosse vieilli qu’ils voyaient chanceler et dont ils avaient conjuré la perte. Vainqueurs des Romains dans la sanglante bataille d’Andrinople, où Valens fut tué, ils appellent les Huns au pillage de l’empire d’Orient. Ceux-ci passent le Danube pour la première fois en 377, quarante ans après la mort de Constantin. Le grand Théodose les bat et les rejette au-delà de ce fleuve, dont il les force longtemps à respecter la barrière. Toujours armés et de plus en plus avides de pillage, les Huns, sur l’invitation du traître Ruffin, ministre d’Arcadius, se divisent en deux hordes ; l’une franchit le Caucase, envahit, bouleverse et ensanglante l’Asie ; l’autre, unie aux Goths, aux Sarmates et aux Alains, repasse le Danube sous la conduite d’Alaric, se précipite sur la Grèce, qu’elle trouve sans défense, et y exerce d’affreux ravages. Rejetés encore une fois au-delà du fleuve, mais menaçant toujours de le repasser, les Barbares vendaient aux empereurs, au poids de l’or, des paix honteuses qui n’étaient jamais que des trêves d’une courte durée. En 433, les Goths après avoir saccagé Rome, après s’être promenés en vainqueurs par toute l’Italie, s’étaient établis dans la Gaule Narbonnaise, du consentement des Romains qui n’avaient pas trouvé d’autres moyens de délivrer la mère-patrie de ce fléau. A la même époque, Roua, roi des Huns, qui était retourné au-delà du Danube, exemptait l’empire de ses pillages, moyennant un tribut annuel de trois cent cinquante livres d’or, que Théodose II lui payait exactement. Tel était l’état de l’Europe lorsque Attila et Bleda, son frère, succédèrent, à leur oncle Roua, dans le commandement de la nation formidable des Huns. Par suite de la grande migration des Goths, la domination des deux frères embrassait toutes les provinces qui séparent la mer boire de la Baltique. Bornée à l’ouest par la Vistule et le Danube, elle confinait â l’Orient avec la Scythie, c’est-à-dire, avec un pays sans limites. La capitale de ce vaste empire, si l’on peut donner ce nom au repaire d’où le chef s’élançait pour se repaître de sang et de carnage, et où il venait de temps en temps déposer le fruit de ses meurtres et de ses rapines, était située sur la Theisse, non loin de Tokay, à sept journées de marche au nord du Danube. Le premier usage que les nouveaux chefs font de leur puissance, est d’exiger que la rançon annuelle payée jusque-là par Théodose, soit portée à 700 livres d’or. L’empereur s’y soumet, et ce redoublement de faiblesse, et si l’on ose dire, de lâcheté, est pour ses ennemis un nouveau motif de redoubler leur arrogance et leur mépris. Après s’être assurés par ce honteux tribut de la neutralité de Constantinople, les deux frères semblent disparaître pendant quelque temps de la scène du inonde ; ils s’enfoncent dans les solitudes de l’Asie, et portent de concert la guerre en Orient. Cette guerre dure six ans. Tous les peuples qui habitent le revers septentrional du Thibet sont vaincus, leur pays ravagé. La terreur des Huns pénètre jusqu’en Chine, dont ils s’assurent l’alliance par un traité. C’est dans ces expéditions lointaines qu’Attila, qui en était l’aine et le chef, achève l’apprentissage de la guerre, et qu’il forge les fers dont A doit bientôt menacer l’Europe. A peine le retour sur le Danube, Attila, sous le plus frivole prétexte, reprend le cours de ses hostilités contré l’empire d’Orient ; il pénètre à cinq journées au-delà de ce fleuve, ravage toute la Thrace et ne pose les armes qu’après avoir dicté à l’empereur les conditions d’un traité honteux que des plénipotentiaires respectifs signent à Ordessus, sur le Pont-Euxin. Espérant, mais vainement, adoucir l’humeur féroce du barbare, Théodose le revêt du titre de général des armées romaines, titre qu’Alaric, le destructeur de Rome, avait déjà t porté quarante ans auparavant. L’empire était tombé à ce degré d’abaissement, que, ne pouvant plus expulser les barbares de son sein, il les adoptait, et que, renonçant à les vaincre, il les couronnait. Impatient de régner seul, Attila, à l’exemple de Romulus, se défait de son frère Bleda par un assassinat. Après une Crève de cinq ans, il passe derechef le Danube, bat tous les généraux qu’on lui oppose, met tout à feu et à sang dans la Mœsie, l’Illyrie, la Macédoine et la Thrace, et parait devant Constantinople. Andrinople et Héraclée seules lui résistent. L’année suivante il fait encore, mais inutilement, le siège d’Asemonte ; cette ville située sur les confins de la Thrace et de l’Illyrie, est sauvée par le courage de ses habitants. L’empereur conclut avec lui un nouveau traité aussi honteux et qui ne sera pas plus respecté que le premier. Ces hostilités n’étaient que le prélude de la guerre d’extermination qu’Attila se disposait dès lors à entreprendre contre l’empire d’Occident. Ce géant de la barbarie était né pour la guerre, pour cette guerre de meurtres, de rapines et d’incendie dont Rome avait donné le spectacle au monde depuis mille ans. Il avait vécu dès son enfance sur les champs de bataille ; le sang était son élément. Son oncle Roua lié d’une étroite amitié avec Ætius, le plus habile des généraux Romains, l’avait envoyé, jeune encore, à la cour, de Ravenne ; là son esprit fin et délié, son œil observateur avaient démêlé promptement le secret de la puissance des Romains. Accompagnant les troupes dans leurs marches, assistant à leurs évolutions, quelquefois même à leurs combats, il puisait à la meilleure source les leçons de tactique et de discipline militaires dont il était avide et qu’il brûlait déjà de mettre à profit. Avec une taille au-dessous de la médiocre et des traits peu réguliers, il imposait par un air de fierté mâle et une sorte de grandeur sauvage empreinte dans toute sa personne. Admis familièrement à la cour d’Honorius, où il était traité en quelque sorte comme un otage de haute distinction, une jeune princesse du sang impérial, Honoria, ne fut pas insensible à son mérite, et l’on verra bientôt comment il apprit qu’il avait su lui plaire et quel gage il reçut de sa folle passion. Le génie naturel d’Attila, ses succès, son audace, sa confiance dans ses forces, son habileté dans les conseils,son caractère indomptable, avaient fait de ce barbare, monté sur le trône, l’ennemi le plus redoutable pour la puissance romaine alors sur son déclin. Tous ses traits respiraient la cruauté ; il avait la démarche fière, les yeux petits et étincelants, la poitrine large, la tête volumineuse, peu de barbe, le nez écrasé, le teint basané. A l’exemple de Rome, dont il avait adopté les maximes, s’il se montrait inexorable à ceux qui lui résistaient, il se laissait fléchir par la prière et gardait sa foi à ceux qu’il avait reçus sous sa protection. Dans son. orgueil bizarre, il s’intitulait fils de Mendizès, issu de la lignée du grand Nemrod, natif d’Engade, par la bonté divine, roi des Huns, des Goths, des Mèdes et des Damiens, la crainte du monde et le fléau de Dieu. Au moment où il se disposait à porter ses armes en Occident, l’Italie était intacte, mais l’Espagne avait subi le joug de fer des Vandales, et Genseric, leur roi, opprimait l’Afrique. Les Gaules étaient morcelées par les Francs, les Alains, les Bourguignons et les Visigoths que Rome y avait admis successivement à titre d’alliés. La puissance romaine luttait avec des succès variés contre d’autres essaims de Barbares que le Rhin vomissait chaque année dans les Gaules, dont £tics avait alors le commandement. Ce guerrier justement célèbre était né en Mœsie, d’une mère Italienne, très noble et fort riche, et de Gaudence, originaire de Scythie, général de la cavalerie romaine. Il avait fait l’apprentissage de la guerre sous Alaric, près duquel il avait passé encore jeune trois ans en qualité d’otage. Sa femme descendait d’une famille royale des Goths. A la mort d’Honorius II, en 423, l’usurpateur Jean avait envoyé Ætius chez les Huns pour leur demander des secours contre Théodose II, qui se disposait à l’attaquer. Théodose avait sur l’empire d’Occident un droit qu’il céda bientôt à Valentinien III, son neveu, en lut donnant pour conseil et pour tutrice sa mère Placidie. Ætius, de retour à la tête de 60 mille barbares, livre à Valentinien un combat sanglant et sans résultat décisif, à la suite duquel ayant fait son traité avec Placidie, il renvoie les Huns dans leur pays. Bientôt il signale son courage dans les Gaules contre Théodoric ; mais presqu’au même instant, par ses perfides avis, il pousse Boniface à la révolte et devient ainsi la cause première de l’invasion des Vandales en Afrique. Battu plus tard par Boniface, qui avait reconnu son odieuse fourberie, il se réfugie chez les Huns et revient une seconde fois à leur tête pour ravager l’Italie. Ce sujet ambitieux, et redoutable, qui aspirait déjà à placer sur sa tête ou sur celle de son fils la couronne de l’empire d’Occident, était ainsi tour à tour la ruine et le salut de son pays. Rentré de nouveau en grâce et disposant de la puissance souveraine dans les Gaules, il force Théodoric à lever le siège de Narbonne ; marche ensuite contre les Francs conduits par Clodion, les bat près de Lens, puis leur abandonne, par un traité, la souveraineté du pays qu’ils venaient de conquérir. Il fait plus, il adopte le plus jeune des frères de Clodion, Mérovée, qu’il envoie en otage près de l’empereur Valentinien à Ravenne. Prêt à tous les événements, il entretenait avec Attila une correspondance secrète et probablement criminelle, et il avait poussé la prévoyance jusqu’à placer près de lui un gaulois, nommé Constance, pour lui servir de secrétaire et d’interprète. Du reste né avec un tempérament vigoureux, adroit à tous les exercices, actif avec circonspection, aussi habile négociateur que grand capitaine, ennemi de tout gain sordide, à l’épreuve des injures, aimant le travail, intrépide dans les dangers, souffrant gaîment la faim, la soif et les veilles, il réunissait toutes les qualités qui font les héros. Les Gaules fleurirent sous son gouvernement ; on le vit pendant 25 ans signaler le souverain pouvoir, dont il était revêtu, par la sagesse et la douceur de ses lois ; par ses soins les Barbares furent repoussés, ou admis, à titre d’alliés, à former en deçà du Rhin des établissements réguliers. La démarche inconsidérée d’Honoria fut le prétexte dont Attila se servit pour couvrir son injuste agression. Cette jeune princesse, dont il s’était fait remarquer comme on l’a vu, pendant son séjour à la cour de Ravenne, poussée par son aveugle passion, l’avait fait inviter secrètement à demander sa main et lui avait remis son anneau comme gage de sa foi. Cette folle et coupable intrigue ayant été découverte, Attila s’était enfui précipitamment de Ravenne, et Honoria avait été exilée en Orient. Elle y vivait depuis vingt ans dans l’oubli, lorsque Attila, parvenu à la souveraine puissance, et qui avait d’ailleurs à se venger d’une tentative récente d’empoisonnement ordonnée contre lui, songea à réclamer l’effet de sa promesse et la fit demander à Théodose par ses ambassadeurs. Le refus outrageant auquel il s’attendait, fut le signal de la guerre à mort qu’il déclara à l’instant même à l’empire romain. Il s’y préparait depuis six ans. L’armée qu’il rassembla était la plus nombreuse, la plus aguerrie et la mieux commandée qui eût jamais menacé la puissance romaine en Occident. Tous les peuples alliés ou soumis à la domination des Huns, avaient fourni leur contingent et armé, l’élite de leur jeunesse. Au premier rang, parmi ces peuples, figuraient, pour le nombre et pour la bravoure, les Ostrogoths, commandés par trois frères, fils de rois, Valamir, Théodemir, Widemir. Le célèbre Ardaric marchait à la tête de la cavalerie Slave et des légions innombrables des Gépides. Profitant de la mort de Théodose et de Placidie Attila se met en marche des bords de la Drave et du Danube, au printemps de l’an 450, à la tête de quatre cent mille hommes. Les Gaules étaient le véritable but de son expédition ; mais, afin de ne pas troubler leur sécurité, il feint de n’avoir en vue que la soumission complète de la Pannonie, et fait répandre partout le bruit qu’après s’être assuré de la fidélité de cette province, il se propose de parcourir la Germanie tout entière, afin de conclure de gré ou de force des traités d’alliance avec tous les peuples qui l’habitent ; après quoi il est résolu à s’y établir définitivement, le Rhin étant une barrière naturelle qu’il veut toujours respecter. Remontant le Danube, il pousse ses colonnes dans la Bavière, dans la Souabe et dans la Franconie, réduisant toutes les places fortes qui refusent de le reconnaître, y laissant des garnisons et organisant partout les moyens de contenir les habitants et de lever des subsides sur tout le pays. Une première campagne est employée à ces différents travaux. Aux approches de l’hiver, ses cantonnements occupaient sur le Mein, le Necker et le haut Danube, à cinq marches de distance du Rhin, une ligne de soixante-dix lieues d’étendue, et, afin de ne pas jeter l’alarme dans les Gaules, il avait établi son quartier général à Ratisbonne. Attila, pour remplacer les garnisons qu’il est obligé dé laisser sur le Danube, emploie tout l’hiver à grossir ses rangs des nombreux ennemis que le nom romain avait encore au-delà du Rhin. Malgré le torrent de Suèves, d’Alains, de Vandales, de Saxons, d’Allemands, de Bourguignons, que l’année 406 avait vomi sur les Gaules ; malgré la grande irruption des Bructères, des Chamaves, des Cattes, des Enchivariens et des Saliens, qui s’y étaient établis en 420, sous la conduite de Pharamond ; malgré les émigrations armées qui, chaque année, venaient grossir en deçà du Rhin, depuis un demi-siècle les vengeurs de la Germanie, si longtemps et si cruellement décimée par les généraux romains, cette contrée, telle qu’une pépinière inépuisable, ne cessait d’enfanter de nouveaux guerriers, toujours prêts à s’élancer, soit pour conquérir, sous un climat plus doux, une existence moins insérable, soit pour assouvir sur vies peuplés ennemis, la haine héréditaire, que Ies crimes de Rome avaient allumée dans leur sein. Ayants réparé et au delà les portés de sa première campagne, et les vides de ses garnisons, maître de l’Allemagne, et comptant sur l’appui de cette facile conquête ; Attila, après d’immenses préparatifs, se trouvé enfin, au printemps de 451, en mesure de frapper un grand coup. Plus confiant que : jamais dans ses forces, il n’hésite plus à marcher droit au but qui absorbait toutes ses veillés depuis dix ans, là ruine de l’empire d’Occident. Genseric, qui n’aspirait désormais qu’à jouir paisiblement de ses conquêtes, et qui craignait l’ambition et le ressentiment de Théodoric, dont il avait renvoyé ignominieusement la fille, après avoir longtemps sollicité sa main, excitait secrètement Attila à venir l’attaquer ; d’un autre côté, le fils aîné de Clodion, Clodomir, qui s’était réfugié dans son camp pour se soustraire à une mort violente, le pressait également de passer le Rhin, espérant, par son secours, remonter sur un trône auquel sa naissance lui donnait des droits, que son oncle et son tuteur, Mérovée, avait usurpés. Après s’être procuré des informations précises sur la situation des forces romaines et alliées, ainsi que sur la disposition des esprits dans les Gaules, Attila, au moment de lever le masque, cherche encore à endormir Valentinien, en lui insinuant qu’il n’en veut qu’à Théodoric ; et en même temps il annonce à celui-ci qu’il ne s’avance que pour l’affranchir de la tyrannie des Romains. Cependant Attila, à la veille de franchir le Rhin, délibère sur le choix du passage qu’il doit adopter ; ce choix est d’une haute importance pour le succès de l’expédition ; plusieurs s’offrent à lui ; maître de ses mouvements, il pèse les avantages et les inconvénients de chaque direction. Les Gaules qu’il va conquérir ne sont plus comme au tems de Julien et de Constantin, réunies en un seul faisceau dans la main puissante des Romains. Envahies au nord, à l’est et au midi, le moment approche où cette riche proie sera devenue tout entière le partage des peuples que Rome admet dans son alliance, et qui travaillent de concert depuis un siècle à s’enrichir de ses dépouilles. Les Allemands se sont rendus maîtres du cours du Rhin depuis Bâle jusqu’à Mayence, et toute la Germanie supérieure leur appartient ; les Francs établis depuis trente ans dans la Germanie inférieure, viennent de pousser leurs avant-postes jusque sur la Somme, réunissant ainsi à cette vaste province la moitié de la seconde Belgique ; l’Helvétie, la Grande-Sequanoise, partie de la première Lyonnaise, sont le partage des Bourguignons ; les Mains occupent le pays des Armoriques, et les Visigoths, établis au pied des Pyrénées, règnent paisiblement sur les plus belles et les plus fertiles provinces du Midi. Il est de l’intérêt d’Attila de ménager ces différents peuples publiquement alliés, mais secrètement ennemis des Romains ; et toujours prêtes à prendre leur part de nouveaux démembrements. Ses premiers coups doivent donc frapper sur les provinces restées fidèles â l’empire. La première et la seconde Belgiques, la Senonaise lui tracent le chemin qu’il doit suivre jusqu’à la Loire, car il prévoit déjà que c’est sur ce fleuve que les coups décisifs devront être portés. Les montagnes, couvertes d’épaisses forêts qui longent les deux rives du Rhin et qui en défendent l’approche depuis Bâle jusqu’à Coblentz, ne lui laissent le choix du passage qu’entre ces deux villes, et il reconnaît d’abord qu’il s’agit de pénétrer dans les Gaules par Trèves on par Béfort. La Franconie offrant beaucoup plus de ressources que les environs de Constance aux cantonnements d’une nombreuse année et plus de facilité pour préparer des moyens d’invasion, on a vu qu’Attila y avait pris ses quartiers d’hiver, et attendait au sein de l’abondance l’arrivée du printemps ; c’était déjà un motif pour tenter, à l’exemple des Vandales, le passage plutôt à l’embouchure du Klein et du Necker qu’au débouché des montagnes stériles de l’Helvétie, dont il savait d’ailleurs que l’approche était défendue par les Bourguignons ; d’un autre côté, le fertile bassin de la Moselle, Trèves, ville puissante, capitale d’une province, mais dépourvue de garnison, lui promettaient une plus riche proie et offraient moins d’obstacles à vaincre que les défilés des Vosges et du Hundsruch ; car une fois le Rhin franchi, il fallait s’avancer rapidement jusqu’au cœur du pays, frapper l’ennemi de stupeur et ne pas lui laisser le temps de se reconnaître, encore moins de rassembler toutes ses forces : c’est donc sur ce point que le passage est résolu[1]. Possesseurs paisibles depuis un demi-siècle de l’Helvétie et des deux Bourgognes, craignant pour leur conquête et devinant mal les projets d’Attila, les Bourguignons s’étaient préparés à repousser l’attaque dont ils se croyaient menacés. Ce peuple brave et aguerri, d’origine Vandale, mis ayant longtemps habite la vallée du Klein avant de s’établir dans les Gaules, savait, par les relions qu’il entretenait dans la Germanie, que les Huns se recrutaient, et que les dispositions d’Attila annonçaient d’autres desseins que ceux dont il avait fait répandre le bruit. Sachant par leur propre expérience que Bâle était le lieu le plus commode et le plus sûr pour effectuer le passage du fleuve, ils résolurent d’empêcher Attila de suivre leur exemple, ou, s’il l’emportait, de mettre tout en œuvre pour garantir leur pays de ses déprédations. Attila, qui n’ignorait pas leurs desseins, avait l’œil ouvert sur tous leurs mouvements. Il était loin de sa pensée de s’engager avec son immense cavalerie dans les défilés des Vosges et du Jura, de s’enfoncer à la tête d’une armée aussi nombreuse au milieu des solitudes arrosées par le cours supérieur du Doubs, de la Meuse, de la Moselle et de la Marne, pays pauvre, coupé, hérissé d’obstacles, où la faim et les fatigues l’auraient vaincu sans combat, tandis que le bassin inférieur de la Moselle lui offrait toutes les ressources imaginables et le conduisait au centre des deux Belgiques sans coup férir et sans lui imposer pour ainsi dire aucune privation. Cependant, afin de ne rien donner au hasard, au moment de se porter en avant ; il détache de son armée un corps d’observation de 56 mille hommes, qui a ordre de remonter le Danube et de marcher sur Bâle afin de contenir ou de battre, les Bourguignons, s’ils se présentent, aussitôt que l’armée principale aura passé le Rhin ; il confie le commandement de ce corps à Théodemir, l’un de ses plus braves généraux. Ces dispositions faites, Attila lève ses cantonnements. Il s’élance avec la rapidité de l’éclair et parait sur la rive droite du Rhin, entre Bonn et Coblentz, à la tête de 350 mille hommes, dans les derniers jours du mois de mars 451. Ses coureurs s’emparent de tous les passages ; saisissent toutes les barques et les rassemblent pour transporter en masse l’armée sur la rive gauche du Rhin. Plusieurs jours sont employés à cette opération aucune démonstration hostile ne l’interrompt, aucun accident ne la ralentit. En six jours toute l’armée a franchi cette barrière,’elle déborde comme un torrent. Coblentz qui n’avait qu’une faible garnison, Trèves qui en était totalement dépourvue, sont occupées sans résistance. Des colonnes d’éclaireurs s’avancent dans toutes les directions. Attila se porte de sa personne avec le centre sur blets, que les habitants refusent de lui livrer, et dont il forme aussitôt l’investissement. Après deux jours de sommations inutiles, Attila ordonne l’assaut ; la ville est emportée la veille de Pâques, le 16 avril 451 ; tous les habitants sont passés au fil de l’épée, un affreux incendie la dévore, le fer démolit ce que la flamme a épargné, rien ne trouve grave auprès d’un vainqueur irrité. Pendant ce temps, le corps d’observation du Haut-Rhin s’empare de Bâle et de Colmar, que les Bourguignons avaient vainement essayé de défendre. Il les bat, les poursuit jusqu’au delà de Béfort, et les force à rentrer dans leurs limites. Les Bourguignons s’éloignent, mais pour reparaître plus tard à côté d’Ætius et contribuer à la défaite d’Attila. Après s’être assuré qu’ils ne pouvaient plus l’inquiéter dans sa marche, Théodemir renonce à leur poursuite. Les Huns aussitôt se répandent dans toute l’Alsace ; Théodemir, qui s’était ménagé des intelligences parmi les Allemands, en reçoit des secours en vivres, en munitions et en argent : il occupe Strasbourg et Saverne de leur consentement, et se met aussitôt en communication avec Attila, dont il reçoit de nouvelles instructions. Après la prise de Metz et un repos de quelques jours, la grande armée se partage en trois colonnes. Celle de droite, guidée par Andagèse, se porte par Mosomague, sur l’Aisne, ayant son rendez-vous non lin des murs de Reims, dans les plaines de la Champagne. Celle de gauche, sous le commandement de Wolomir, est destinée à compléter la soumission de la première Belgique ; elle remonte la Moselle jusqu’à Toul, s’empare de cette ville, qui ouvre ses portes à la première sommation, et pousse des reconnaissances jusqu’aux sources de la Meuse et au pied des Vosges, au-delà d’Épinal et de Neufchâteau. Elle s’avance de Toul sur Nasium[2], ville importante située sur l’Ornain, à deux, lieues au-dessus de Ligny. Un accident cause la ruine de cette malheureuse ville. Sans garnison, sans remparts, les habitants avaient député au-devant du vainqueur pour se mettre sous sa protection ; la ville était paisiblement occupée depuis 24 heures, lorsqu’un habitant, exaspéré par la brutalité d’un soldat ivre, pour venger sone honneur outragé, a recours à la force et le tue ; ce fut le signal d’un massacre général ; un violent, incendie consomme la ruine entière de la ville qui est restée jusqu’à ce jour ensevelie sous ses débris. De là cette colonne descend l’Ornain, passe à Caturigas et s’avance vers Reims, ou Attila lui avait également donné rendez-vous. La colonne du centre, commandée par Attila en personne, se porte de Metz sur Verdun. Cette ville, qui défendait le passage de la Meuse, refuse pendant quelques jours de se soumettre au vainqueur. Elle aurait éprouvé le sort de Metz, si, reconnaissant l’inutilité d’une plus longue résistance, les habitants lie se fussent rendus à discrétion. L’armée, après avoir pris quelques jours de repos sur la Meuse, s’enfonce dans les défilés de l’Argonne, les franchit sans obstacle et débouche du 10 au 12 mai dans les plaines de la Champagne. Attila, qui y avait été prévenu par Andagèse, campe, en attendant l’arrivée de Wolomir, sur l’Aisne et sur la Suippe. Aussitôt que ce chef l’a rejoint, et avant de marcher sur Reims, il concentre toutes ses forces dans la plaine de Mauriac, entre la Vesle et la Suippe, à la jonction des routes de Toul et de Verdun, et en passe une revue générale. Dans cette revue, son œil exercé est frappé de la beauté de cette plaine immense dont il essaie en vain de mesurer l’étendue ; il admire la facilité que sa nombreuse cavalerie y trouve pour manœuvrer. il pense en lui-même que si jamais une grande bataille devenait nécessaire, nulle autre positionne serait plus favorable pour déployer toutes ses forces, pour faire mouvoir son immense armée et pour lui assurer une éclatante victoire sur son ennemi. Cette revue dure plusieurs jours ; tandis qu’Attila en est occupé, les habitants de Châlons[3] s’empressent de lui envoyer une députation ayant à sa tête leur évêque, Saint Alpin. Ils obtiennent que la ville sera respectée ; mais elle est obligée de recevoir garnison, et ses magistrats s’engagent à fournit, des vivres, des munitions et des effets d’habillements à l’armée, dont la plus grande partie doit, dès ce moment, tirer ses subsistances des bords de la Marne. Prise au dépourvu, et reconnaissant l’impossibilité de résister à cette nuée de barbares, Reims, qui se souvenait d’avoir été saccagée, quarante-trois ans auparavant, par les Vandales, et qui sortait à peine de ses ruines, ouvre ses portes à la première sommation, et subit sans coup férir la loi du vainqueur ; Attila y fait son entrée[4] solennelle le 15 mai, à la tête de deux cent mille hommes. De là, il envoie l’ordre au corps d’observation de l’Alsace de marcher sur Metz et de se tenir en mesure de venir le rejoindre sur la Marne au premier signal. Toutes les villes fermées de la Meuse, de la Marne et de l’Aisne reçoivent garnison. Le corps d’Andagèse, fort de quarante mille hommes, se porte sur l’Aisne, avec ordre d’observer les mouvements des Francs, qui commençaient à s’agiter. Le gros de l’armée campe sur, la Vesle et sur la Marne, tandis que des corps d’élite préposés à la garde d’Attila, veillent sur sa personne et remplissent les différents quartiers de la ville. L’expédition avait été préparée avec tant de secret les mouvements d’Attila avaient été si rapides, si imprévus et si bien combinés, que, depuis le Rhin jusqu’à la Marne ; sa marche n’avait été qu’une promenade militaire, arrêtée seulement quelques instants par les efforts inutiles des Messins. Ætius semble oublier les peuples dont la défense lui est confiée, une terreur générale s’empare de tous les esprits ; c’en est fait de la Gaule, s’il ne se hâte d’opposer une digue à ce torrent. Maître de la première Belgique, et ayant son quartier général dans la capitale de la seconde, dont il fait sa place d’armes, et le point de départ de nouvelles opérations qu’il va bientôt entreprendre, Attila délibère s’il achèvera d’abord la conquête de celle-ci, en passant l’Aisne et s’avançant vers le nord, pour combattre Mérovée, comme Clodomir ne cessait de l’y exciter ; ou si, poussant à l’ouest et prévenant Ætius, il se rendra, sans plus tarder, maître des passages de la Loire, au-delà de laquelle se trouvaient ses plus redoutables ennemis. Persuadé qu’il lui serait toujours facile de détourner les Francs de la pensée de l’attaquer, si lui-même ne les inquiétait pas dans les limites qu’une convention récent e leur avait imposées, et qu’ils paraissaient disposés à respecter ; sentant d’ailleurs que le succès de l’invasion était principalement attaché au passage de la Lohe5 dont chaque jour de retard augmentait les difficultés, il se décide pour ce dernier parti. Laissant à Reims une forte garnison, sur l’Aisne le corps d’observation d’Andagèse, et quelques détachements sur la Marne, son armée s’ébranle et passe la Marne sur trois points le 1er juin, savoir l’aile droite à la Ferté sous Jouarre, l’aile gauche à Châlons, le centre à Damery[5]. Elle se porte rapidement sur l’Aube et sur la Seine, dont elle occupe tous les passages, depuis Méry jusqu’à Montereau. Elle arrive sur la Seine, harassée par la difficulté des chemins et par la rareté des subsistances, et elle y prend position. Attila fait halte de sa personne entre Pont et Méry. Il accorde à l’armée quatre jours pour se refaire de ses fatigues, et pour renouveler ses approvisionnements. Pendant ce temps, sa cavalerie inonde le Sénonais et pousse des partis jusqu’aux portes de Lutèce[6] qui, à leur approche, tombe dans la consternation ; mais ces partis n’ayant pas ordre de pénétrer dans cette grande ville, se retirent dans une autre direction. Un détachement qui avait suivi la route d’Arcis, se présente le premier devant Troyes[7] ; il se disposait à employer la force, lorsque les habitants convaincus par l’exemple de Reims et de Châlons que toute résistance était inutile, ouvrent leurs portes et implorent la clémence du vainqueur. Le chef de ce détachement respectant mal ses promesses, accable les habitants de mauvais traitements. Sept clercs, ayant à leur tête le diacre Mémorius, députés par Saint Loup, évêque de Troyes, â Attila, se présentent devant lui, portant le livre des saints évangiles, et précédés par la croix. Ils lui annoncent la soumission de la ville et se plaignent des vexations qu’elle vient d’essuyer de la part de ses soldats. Attila les accueille d’abord favorablement ; avais, en ce moment, le cheval d’un de ses généraux, effrayé de l’appareil de cette scène extraordinaire, s’étant emporté et ayant jeté par terre son cavalier, Attila s’écrie que ce sont des magiciens, et les fait massacrer impitoyablement. Un seul s’échappe et porte à Saint Loup la nouvelle de ce tragique événement. Revenu de son aveugle colère, Attila ordonne que la ville soit épargnée et s’y transporte, lui-même aux instantes prières de ses magistrats. Dans l’audience qu’il accorde à une députation au nom de laquelle Saint Loup portait la parole, il est surtout frappé de l’air de dignité et de grandeur du saint prélat. Le calme et la sagesse de ses réponses achèvent de le subjuguer ; dès ce moment il conçoit pour lui une estime profonde et une véritable affection ; toutes ses demandes lui sont accordées, il prend le clergé sous sa protection. De même qu’il axât fait contenir les Francs par le corps d’observation de l’Aisne, Attila songe à prévenir par un moyen semblable, les démonstrations hostiles que les Bourguignons pourraient former sur son flanc gauche, tandis qu’il s’avancera vers Orléans. Il détache en conséquence, sous le commandement de Wolomir, un second corps d’observation qui a ordre d’éclairer la haute Seine, l’Yonne et tous les débouchés de la Bourgogne sur le Senonais. Ce corps s’empare de Bar-sur-Seine, de Pont-sur-Yonne et d’Auxerre, où il prend position. En même temps Attila fait avancer le corps de Théodomir, qui était resté sur la Moselle, et le place en réserve sur la Marne pour assurer ses communications. Ces dispositions faites, Attila lève son camp de, Pont-sur-Seine le 12 juin, passe l’Yonne à sens et à Pont-sur-Yonne, le Loing à Nemours et à Montargis, et arrive presque sans coup férir, le 24 juin, à la tête de cent cinquante mille hommes, devant Orléans. La première nouvelle de l’invasion d’Attila fut portée à Arles, où Ætius avait sa résidence, par un envoyé des Bourguignons. Calculant de suite le temps qui lui est nécessaire pour rassembler une armée capable de repousser les barbares, Ætius prévoit que leur marche ne peut être arrêtée que sur la Loire, où ils devront arriver dans les derniers jours de juin. Il ordonne de fortifier en grande hâte les principaux passages de ce fleuve et concentre toute son attention sur Orléans. Il fait augmenter les moyens de défense de cette grande ville, la remplit d’armes, de munitions et de, subsistances, et donne ordre à la 8e légion, toute composée de Gaulois, de s’y renfermer. La défense de cette place importante, la clef de la Loire, est confiée à Sangiban, qui s’y renferme lui-même à la tête de dix mille Alains. Sangiban a l’ordre de prolonger jour à jour la défense de la ville et de tenir ferme jusqu’à ce qu’Ætius arrive pour la délivrer. Ces ordres s’exécutaient encore lorsque Attila parut à la vue des habitants consternés. Ætius ne perd pas de temps, tous les moments sont comptés, des courriers voient dans toutes les directions. Les Francs ont ordre de se tenir prêts et d’attendre, sous les armes, le moment de marcher pour, former l’aile gauche de l’armée combinée ; les Bourguignons formeront la droite ; Théodoric et Ætius le centre. Théodoric part de Toulouse à la tête de soixante mille hommes, le 15 juillet ; il s’avance à marches forcées par Cahors, Périgueux et Poitiers, ayant pour instruction de passer la Loire à Tours, et de remonter par la rive droite de ce fleuve, jusqu’à la hauteur d’Orléans, tandis qu’Ætius remontera lui-même le Rhône, ralliant à lui toutes les troupes régulières et toutes les milices des Gaulois et des alliés ; si rien ne les arrête, ils doivent arriver l’un et l’autre au plus tard le 12 août devant Orléans. Cette ville était, comme on vient de le dire, la clef de la Loire. Une double muraille garnie de tours, des fossés profonds, des palissades, des chausse-trappes l’enveloppaient en forme de demi-cercle du côté de la campagne, et en défendaient l’approche à l’assiégeant. Un pont en bois entretenait sa communication avec la rive gauche du fleuve d’où elle tirait ses subsistances. Sangiban fait sortir de la ville toutes les bouches inutiles. Les habitants s’arment pour la défense de leurs foyers, et rivalisent de constance et d’ardeur avec les troupes les plus braves. St Aignan, leur évêque, leur donne l’exemple du dévouement ; sa présence, ses secours, ses pieuses exhortations enflamment leur courage : ils s’enseveliront tous sous les ruines de la ville, plutôt que de consentir à sa reddition. Les sommations d’Attila sont repoussées avec mépris ; l’investissement commencé le 25 juin, se transforme aussitôt en un siège régulier. Une tranchée profonde met les assiégeants à l’abri des projectiles de toute espèce que leur lancent sans relâche les assiégés ; au dedans comme au dehors, toutes les ressources de l’art de l’attaque et de lui défense des places soin mises en usage : tout présage un siège long et meurtrier. Les béliers, les balistes, les tours mobiles, les poutres armées de fer, les ponts volants, les dards enflammés, les machines incendiaires se multiplient dans les lignes d’Attila, s’avancent à travers les fossés, s’approchent des remparts, et portent le ravage et la mort parmi les assiégés. Ceux-ci travaillent nuit et jour à augmenter leurs moyens de résistance ; des sorties multipliées ralentissent les progrès du siège, la flamme consume les tours que le choc des projectiles n’a pas brisées et renversées. Un mois s’était écoulé dans ces rudes travaux, l’attaque faisait chaque jour de nouveaux progrès ; les secours promis par Ætius étaient loin encore, la ville pouvait succomber avant leur arrivée, Saint Aignan, inquiet de ce retard, se rend en toute hâte près d’.,Ætius et de Théodoric ; il les conjure, il les presse de faire diligence, leur représente l’état désespéré de la défense, que dans quelques jours il sera trop tard peut-être pour sauver la ville d’une entière destruction, L’absence de Saint Aignan avait duré douze jours ; à son retour, il trouve les bras fatigués, les munitions épuisées, les courages chancelants et abattus. Le nombre des combattants ne suffisait plus pour repousser les assauts qu’Attila furieux multipliait la nuit comme le jour avec une incroyable vivacité ; déjà quelques-uns parlaient de capituler. Sangiban feint de se prêter à leurs désirs, et, pour gagner du temps, entame des négociations avec Attila ; quelques jours suffisaient pour tout sauver. Déjà on réglait les conditions de la capitulation, des otages étaient échangés ; la ville allait ouvrir ses portes, du moins Attila s’en flattait, lorsque parut enfin au loin, à l’horizon, le Secours si longtemps et si vivement désiré. A cette vue, Sangiban rompt les négociations, Orléans se rassure et ne doute plus de son salut. Rien n’égale la rapidité des manœuvres d’Ætius. Attila, attaqué à l’improviste dans ses lignes, fait volte-face et se trouve tout à coup aux prises avec cent mille Romains, Gaulois, et Visigoths. En même temps les assiégés ranimant leur courage, font une sortie générale sur ses derrières ; les Huns sont obligés de faire face de tous côtés ; on se bat partout avec le plus grand acharnement. Cette bataille meurtrière d’Orléans[8], qui dura deux jours, est livrée le 13 août après quarante-neuf jours d’investissement. Enfin Attila se voit forcé à la retraite : son armée affaiblie de plus de cinquante mille hommes, tarit par les travaux du siège que par le combat qui vient de le terminer, n’est pas en état de se mesurer une seconde fois contre Ætius. Il se hâte donc de se rapprocher de ses renforts ; tous ses corps détachés ont ordre de se concentrer dans les champs Catalauniens ; il prévoit déjà que s’il n’a pas le temps de se couvrir par les défilés de l’Argonne, le son de la campagne devra se décider sur la Marne, et il combine tous ses mouvements sur ce plan. Il se retire cependant en bon ordre ; toujours placé à l’arrière-garde, il sait se faire respecter de son ennemi, et plus d’une fois les alliés, en le talonnant de trop près, ont à se repentir de leur témérité. Des Pyrénées jusqu’au Rhin, de l’Océan jusqu’au aura, tout s’ébranle pour l’envelopper ; Ætius est l’âme de ce vaste mouvement. Les Francs réunis aux Saxons, aux Belges et aux garnisons des places de la seconde Belgique, se concentrent sur l’Aisne et sur la Seine, occupant Paris, Laon et Soissons, et se tiennent prêts, à marcher sur Reims au premier signal. Dans cette position, ils menacent la retraite d’Attila, et, en tombant sur son flanc gauche, ils doivent contribuer puissamment à sa défaite. Après le mauvais succès de leurs efforts pour sauver l’Alsace, les Bourguignons s’étaient rapprochés de Besançon, et de Dijon. Leurs cadres s’y étaient remplis par de nouvelles levées et ils n’attendaient qu’un ordre pour concerter leurs mouvements avec ceux d’Ætius. Ils s’étaient concentrés peu à peu vers les sources de la Seine, de l’Armançon et de l’Yonne, impatients de marcher sur Troyes et sur Auxerre, et de tomber sur le flanc droit d’Attila, pour accélérer sa retraite ou pour l’intercepter. Toutes les populations d’au-delà de la Loire accourent en foule sous l’étendard des Romains et des Wisigoths. Trompé par de faux rapports, Ætius suspectait la fidélité de Sangiban ; ses pourparlers avec Attila, qui avaient si heureusement sauvé la ville, étaient attribués par les ennemis de ce brave guerrier, à la lâcheté et à la trahison. Ætius, en doutant de l’honneur de Sangiban, allait peut-être se priver de son habileté et de son courage ; cependant il l’encadre dans son armée avec les débris de la garnison d’Orléans ; mais, par une défiance indigne de l’un et de l’autre, il tient sans cesse l’œil ouvert sur tous ses mouvements. Aussitôt qu’Attila est en pleine retraite, Ætius se met en communication par sa gauche avec Mérovée, et, quelques jours plus tard, par sa droite avec Gondebauld, l’un des fils de Gondicaire, qui commandait les Bourguignons. La 17e légion qui tenait garnison à Lutèce, appuyée par dix mille Bellovaques, se porte à marches forcées sur Pont dont elle a ordre de s’emparer. Harcelé, poursuivi sans relâche et déjà débordé, Attila voulait se couvrir par la Seine et parla Marne, avant de s’arrêter et de prendre position. Mais Ætius, par une marche de flanc, arrive en même temps que lui à Pont. Le détachement de Gépides qui était chargé de garder cette importante position, après une opiniâtre résistance, avait été battu par la 17e légion, et Attila se trouve dans l’impossibilité d’effectuer le passage de la Seine sur ce point. Obligé de remonter plus loin, il se porte sur Méry[9], où le corps d’observation de la haute Seine s’était concentré. Il fallait défiler en présence d’un ennemi victorieux. L’armée, outre les chariots, les bagages et les machines de guerre, traînait à sa suite un butin immense qu’elle ne voulait pas abandonner : c’était le moment le plus critique de la retraite ; Attila y court les plus grands dangers. Les troupes fraîches du corps de Wolomir, réunies aux garnisons de Troyes et d’Arcis, se rangent en bataille près des Granges, entre Ocey et Romilly, et se dévouent pour donner le temps au reste de l’armée de défiler. Un combat furieux s’engage sur ces hauteurs ; il se renouvelle deux jours de suite. Plusieurs fois enfoncé, Attila revient toujours à la charge, la nuit seule interrompt le carnage et met fin au combat. Le matin du troisième jour, les blessés, les chariots, une partie du butin étaient abandonnés sur la rive gauche de la Seine. Tous les postes des Huns étaient trop liés, les ponts étaient rompus, et la rivière séparait Attila de son ennemi ; la perte des deux côtés dépassait trente mille hommes. Saint Loup, devenu suspect aux alliés et anémie à ses ouailles, par la bienveillance qu’Attila ne cesse de lui témoigner, croît devoir s’éloigner momentanément de son siège, et se retire sous la protection des Huns près de Saint Alpin, à Châlons, pour y attendre la fin des événements. Si la marche des Bourguignons n’eut pas été retardée de quelques jours au passage de l’Yonne, ils seraient arrivés sur la Seine avant Attila, et leur concoure pouvait amener un résultat décisif et terminer la guerre d’un seul coup dans les champs de Méry. Couvert par la Seine et par l’Aube, ayant un passage assuré sur la Marne à Châlons où Théodemir l’attendait avec une réserve nombreuse et en bon état, Attila tourne désormais toutes ses pensées vers la grande bataille qu’il est résolu de livrer à son ennemi. Le corps d’observation de l’Aisne, la garnison de Reims, tous les détachements qu’il a laissés sur ses derrières en se portant vers Orléans, viennent le rejoindre dans les champs Catalauniens. Rentré à Châlons de 28 août, il se trouvait dès le 1er septembre, à la tête de plus de deux cent mille combattants. Campé dans la plaine de Mauriac, ses flancs couverts par la Vesle et par la Suippe, avant derrière lui les deux routes de Toul et de Verdun, et plusieurs jours d’avance sur Ætius, il se voit dans la position la plus favorable pour l’attendre et pour lui présenter la bataille. Il s’y prépare avec la plus grande activité. Cette position lui était connue, c’était pour la seconde fois que son armée allait l’occuper ; mais, quoique parfaitement choisie, il veut encore ajouter à ses avantages naturels par toutes les ressources que l’art de la guerre et une longue expérience peuvent lui suggérer. Depuis quinze jours son armée s’était affaiblie de plus de quarante mille hommes harassée, manquant de tout, démoralisée par des marches qui ressemblaient plutôt à une dis ‹à une recale, il sent que pour combattre avec avantage un ennemi peut-être supérieur en nombre et enflé par quelques succès, deux choses sont nécessaires la première, fortifier sa position, afin de retremper le moral de ses soldats ; la seconde, leur accorder quelques jours de repos pour rétablir leurs forces épuisées. Des retranchements rétabliront l’équilibre entre les deux masses belligérantes, et rendront aux siens l’assurance qui les a presque abandonnés, des vivres abondants leur feront oublier les longues privations auxquelles ils viennent d’échapper, et rassurés sur leurs périls passés, ils iront gaiement au-devant des nouveaux hasards qui leur restent à courir. La ligne de bataille doit occuper un espace d’environ cinq mille toises mesurées en ligne droite, depuis la Suippe jusqu’à la Noblette. Les extrémités de cette ligne sont déjà couvertes par ces deux petites rivières, et ce double point d’appui rassure Attila sur les attaques de flancs qu’il aurait à redouter ; mais cela ne lui suffit pis, l’art va encore ajouter à ces moyens naturels de défense par deux grandes redoutes et par des inondations. La redoute de gauche[10] est comme un vaste camp retranché pouvant contenir une garnison de huit à dix mille hommes. Cette redoute s’appuie, à l’ouest, à la Noblette, qui en forme, de ce côté, l’avant-fossé ; sa forme est celle d’un cercle aplati, de trois cents toises de diamètre ; un fossé de quatre-vingts pieds de largeur et de vingt pieds de profondeur, dont les terres sont amoncelées en for le de parapets, complète, du côté de la campagne, son investissement. Trois issues sont ménagées à travers le fossé ; l’une à l’est, est destinée à maintenir la communication avec Mauriac, où est le quartier général de l’armée ; l’autre, à l’ouest, facilitera les sorties et assurera la défense des inondations ; la troisième, au nord, servira à lier la garnison dut camp avec le corps de bataille, et leur garantira une mutuelle protection ; enfin une quatrième issue, donnant sur la Noblette, servira aux besoins de la garnison. Une digue jetée à travers la Noblette, à l’extrémité nord de ce ouvrage, soulève ce ruisseau à six pieds au-dessus de son niveau ordinaire, et tend une inondation de cent pas de largeur en avant de l’enceinte du camp. Un cavalier, muni de nombreuses machines de guerre, bat au loin ses approches ainsi que celles de la digue dont il assure la conservation. C’est dans cette enceinte, regardée comme inexpugnable, qu’Attila rassemble les prêtres et les devins, les femmes, les otages, les prisonniers, la équipages, les munitions, le butin, les objets précieux, l’immense attirail, en un mot, qui accompagne toujours une armée aussi nombreuse que bien organisée. Tel est le camp retranché de Mauriac. La redoute de droite, nommée redoute de Nantivet[11], moins vaste que celle de Mauriac, présente également nue forme circulaire aplatie d’environ cent toises de diamètre. Elle est protégée au nord-est, par un double fossé, dans l’un desquels coule la Suippe. La profondeur et l’escarpement de ce fossé rendent l’approche de la redoute très difficile du côté de la campagne ; son enceinte est couverte, au nord, par un marais. Cette place d’armes est destinée à recevoir trois mille hommes de garnison. Non content de flanquer ses deux ailes par ces formidables ouvrages, Attila, prévoyant le cas où son centre serait forcé de plier et de rétrograder, lui prépare derrière la Noblette une seconde position, à l’abri de laquelle il pourra reformer ses rangs et rétablir la chance du combat. La Noblette, dont la source correspond à-peu-près au centre de la ligne de bataille, mais à trois mille toises en arrière, coule au-dessus de Mauriac dans une direction peu divergente avec cette ligne ; elle n’est pas guéable[12] entre Mauriac et Bussy, mais elle est faible et plus ou moins facile à franchir, entre Bussy et Saint-Rémy. Bussy est comme Mauriac un centre de communications ; il a également un pont sur la Noblette, et ce pont[13] est la clef de la seconde position. Une vaste demi-lune, ayant deux cent cinquante toises à la gorge, l’enveloppe et en défend l’approché du côté de la rive droite, tandis qu’elle se lie à dix-huit cents toises de distance, par la rive gauche, avec Mauriac et son camp retranché. Quinze cents toises plus loin, en remontant, d’autres ouvrages encore plus étendu, et non moins importants que la tête de pont de Bussy, sont établis à cheval sur le chemin de Saint-Rémy à Somme-Vesle, à l’effet de couvrir le gué de la Noblette, et d’intercepter ainsi cette troisième ligne de communication. Ce sont deux ouvrages distincts, mais liés entre eux par un même système de défense, dont l’un est comme le réduit ou la citadelle de l’autre, qui se flanquent et se protègent mutuellement. Celui de ces deux ouvrages qui commande le gué de la Noblette, a environ cent toises de diamètre ; ses remparts sont plus élevés que ceux de la seconde enceinte. L’étendue de celle-ci est d’environ deux cent vingt toises ; c’est comme une redoute fermée pouvant contenir trois à quatre mille combattants. Dans l’intervalle de Bussy et de Saint-Rémy, la Noblette est rapide et peu profonde ; mais les escarpements plus ou moins prononcés et les accidents de sa rive gauche offrent un grand avantage à celui qui s’y établit pour en défendre le passage, et doublent en quelque sorte la force de cette importante position. Tous ces ouvrages sont poussés avec une incroyable activité : on y travaille la nuit comme le jour. Attila est partout, sa présence électrise l’armée ; tous sentent le prix du temps : il faut que ces préparatifs soient terminés avant l’arrivée d’Ætius dont les colonnes commencent à déboucher dans la plaine, et qui, fort heureusement, ont éprouvé un retard imprévu. Après le passage de la Seine, si chèrement acheté par Attila, et la rupture des ponts de Méry, Ætius, n’entrevoyant plus la possibilité d’atteindre son ennemi en-deçà de la Marne, lui laisse continuer sa retraite sans plus chercher à l’inquiéter. Aussi tôt qu’elle a rendu les derniers honneurs aux braves qui ont succombé dans la dernière action, et élevé, sur les hauteurs de Pars, deux tombelles à leur mémoire, l’armée coalisée se rapproche de Pont, passe tout entière sur la rive droite de la Seine et se dirige par Villenoxe, Vertus et Épernay, en tournant les marais de Saint-Gond, dans la plaine qui s’étend en demi-cercle au pied de la montagne de Reims, où était son point de concentration. Cette marche à travers un pays désert et entièrement dévasté par les Huns, fut longue et hérissée de difficultés. Ætius avait dépêché vers les Bourguignons pour hâter leur arrivée, car il ne voulait rien entreprendre de décisif avant qu’ils ne l’eussent rejoint ; mais Wolomir, en se retirant, avait semé leur route de tant d’obstacles, qu’ils étaient encore à Troyes lorsque le reste de l’armée prenait position sur la Vesle en avant de Sillery. Ce contretemps était des plus fâcheux ; Ætius savait qu’Attila, décidé à lui livrer bataille, se fortifiait dans sa position de Mauriac, et que plus il différerait d’aller à sa rencontre, plus il lui ferait acheter cher la victoire qu’il espérait remporter sur lui ; d’ailleurs Attila tirait ses vivres de Châlons et ne manquait de rien, tandis que la campagne de Reims, épuisée, ne pouvait pas assurer les subsistances d’une armée aussi nombreuse, au-delà de quelques jours : le temps ne permettait pas d’ailleurs de compter sur les arrivages du Soissonnais. Le 3 septembre, quoique Gondebaud ne fut pas encore arrivé, Ætius se rapproche d’une marche de son ennemi ; il dresse ses tentes au pied de Fanum Minervæ[14], et pousse ses avant-postes jusqu’à dent mille toises de Mauriac. Dans une escarmouche, il s’avance de sa personne pour reconnaître la position d’Attila. Plusieurs attaques partielles sont dirigées contre le camp retranché et contre la redoute de Nantivet ; les travailleurs sont mis en fuite, mais de nombreux renforts surviennent qui les protègent et mettent les travaux à l’abri des insultes des Romains. Du 4 au 8 septembre, les armées n’étaient séparées que par un intervalle de deux à trois mille toises. Plusieurs affaires très meurtrières ensanglantent la plaine où leurs avant-postes se rencontrent ; les succès sont balancés. Clodomir périt dans l’un de ces engagements. Prévoyant la ruine prochaine d’Attila, et n’ayant désormais en perspective que les misères de l’exil, ce malheureux prince brûlait d’assouvir sa vengeance sur Mérovée. Aussitôt qu’il l’aperçoit, il se précipite sur lui avec toute à fureur de la haine et du désespoir. Un combat terrible, corps à corps, s’engage entre ces deux intrépides rivaux. Clodomir, plus impétueux, multiplie ses attaques, frappe au hasard, et ne porte à son adversaire que des coups mal assurés. Mérovée, plus calme, reçoit de pied ferme le choc de son ennemi, suit de l’œil tous ses mouvements, attentif à ses fautes, et également prompt à la saisir et à en profiter. Le fer croise le fer, il étincelle, le sang commence à couler ; les deux partis voient avec une pitié mêlée d’horreur cette lutte parricide. Un moment Clodomir se croit sûr de la victoire : il s’élance pour porter le coup fatal à son onde, à son tuteur, à l’usurpateur de ses droits ; déjà il le voit chanceler ; mais Mérovée, quoique grièvement blessé, rassemble toutes ses forces, et profitant du trouble de cette noble et déplorable victime, lui plonge son épée dans le sein et l’étend sans vie à ses pieds. Voyant leur chef mort et perdant avec lui tout espoir de retour dans la patrie, les quinze cents Ripuaires qui s’étaient attachés à la fortune de Clodomir, se jettent, tête baissée, à travers les plus épais bataillons des Saliens, et, après avoir fait des prodiges de valeur, sont tous tués jusqu’au dernier. Cette action se passe à l’aile droite d’Attila, sur les bords de la Suippe ; elle est la plus meurtrière de celles qui précèdent la bataille. C’est ainsi que les deux armées préludent à la grande action qui va décider du sort de la plus belle partie du monde et de cette formidable invasion. Enfin, le septembre, Gondebaud rejoint Ætius à la tête de trente mille hommes ; aussitôt Ætius fait cesser tous les combats d’avant-garde, il replie ses postes avancés et dispose son ordre de bataille en arrière d’un monticule qui le dérobe à la vue de l’ennemi. Attila, comme s’il eut agi de concert, fait le même mouvement et laisse un espace libre de deux mille quatre cents toises entre les deux armées. A peu près au centre de cet espace, s’élève la petite colline de Piémont, dont les flancs très allongés s’abaissent à l’est et au sud par une pente douce jusqu’au bord de la Noblette. C’est sur cette pente qu’Attila forme sa ligne de bataille. Le sommet de la colline ne permet à Ætius de découvrir aucuns de ses mouvements. La pente à l’ouest est brusque et rapide, mais peu élevée ; elle se termine à un vallon large et plat qui a été occupé les jours précédents par les avant-postes des Romains. Cette colline[15] dont les deux partis se sont disputé déjà plusieurs fois avec acharnement la possession, doit être d’un grand secours pour le gain de la bataille. Ætius, qui en sent tout le prix, feint cependant de l’ignorer et s’en éloigne avec une sorte d’indifférence ; Attila donne dans le piège et néglige lui-même de se tenir à portée de conserver cette importante position. L’armée d’Attila, rangée sur huit à dix de profondeur, ayant ses ailes appuyées au camp de Mauriac et à la redoute de Nantivet, présente, en première ligne, une masse effective de cent vingt mille combattants. La seconde ligne, formée en réserve derrière la Noblette, est composée de soixante-dix mille hommes ; le camp retranché, les redoutes, les places d’armes, la tête de pont en renferment vingt-cinq mille ; dix mille hommes environ occupent Châlons et forment l’escorte des convois qui alimentent l’armée. Le total est ainsi de deux cent vingt-cinq mille combattants, dont trente-cinq mille de cavalerie. La cavalerie, sous le commandement d’Andagèse, est placée en arrière de l’infanterie, dans la direction de Saint-Rémy à Somme-Suippe, seule partie de la plaine où elle puisse manœuvrer librement. Théodemir commande l’aile droite ; Volomir la gauche ; Ardaric et Wendemir sont au centre avec Attila. Par l’ensemble de ces dispositions, Attila diminue de moitié l’étendue vulnérable de son champ de bataille. Il est évident qu’il ne peut être attaqué avec avantage que dans le vide qui existe entre la Suippe et la source de la Noblette. Il rétablit ainsi la balance entre les deux armées, la sienne étant inférieure par la discipline, et peut-être (du moins il le suppose) par le nombre à celle des Romains. Ætius n’a pas plutôt reconnu la position de son adversaire, qu’il se décide à l’attaquer par sa gauche. Attila l’avait prévu : c’était son côté faible ; c’était aussi sur ce point qu’il avait réuni ses troupes les plus braves, disposé à en prendre lui-même le commandement. L’armée combinée, moins nombreuse que celle des Huns, était rangée dans l’ordre suivant : Le fils aîné de Théodoric, Thorismond, avec quarante-quatre mille Visigoths, formait l’aile droite, à cheval sur la route de Toul à Reims, ayant devant lui le camp retranché et le bourg de Mauriac. Au centre était Sangiban, à la tête de quatorze mille Alains, appuyés à gauche par les vingt-huit mille fantassins de Gondebauld ; venaient ensuite les légions romaines, formées en carré sous les ordres immédiats d’Ætius, et présentant une masse effective de cinquante-trois mille combattants ; à l’extrême gauche, étaient les Francs, au nombre de vingt-sept mille, guidés par Mérovée, leur roi. La cavalerie des Visigoths comptait six mille chevaux ; celle des Romains, sept mille ; celle des autres alliés, six mille ; ce qui formait en tout dix-neuf mille hommes de cavalerie. Elle prend position derrière le centre à la hauteur de celle d’Attila, ayant à sa tête Théodoric et le plus jeune de ses fils. Le 10 septembre, à six heures du matin, toutes les dispositions étaient faites de la part d’Ætius, pour donner la bataille, mais non de la part d’Attila pour la recevoir. Il lui restait quelques retranchements à terminer ; la tête de pont de Bussy se hérissait de palissades, les bords de la Noblette se couvraient d’abattis, on travaillait à produire une inondation au-dessus de la redoute de Nantivet ; vingt-quatre heures étaient nécessaires pour mettre la dernière main à tous ces travaux. Ætius, pour augmenter la sécurité d’Attila, évite toute démonstration hostile jusqu’à une heure après midi. Il regrettait toujours vivement que l’arrivée tardive des Bourguignons l’eut mis dans l’impossibilité d’attaquer Attila huit jours plus tôt dans le désordre de la retraite et lorsqu’il débouchait dans les champs Catalauniens ; mais n’ayant pu l’empêcher de commencer ses retranchements, il était du moins bien décidé à ne pas lui laisser le temps de les terminer. Des affidés lui rendaient compte, heure par heure, de leurs progrès. Il sentait l’importance de se saisir de la colline qui dominait toute la position, et il voulait y arriver avant Attila qui en était cependant plus rapproché que lui. En conséquence, il ne craint pas d’attaquer à une heure aussi avancée. Le ciel était pur, le temps magnifique, et la lune[16] dans son plein, ne laisserait pas même à l’ennemi la ressource de l’obscurité pour protéger sa fuite ou pour retarder sa défaite. Certain qu’Attila ne s’attend plus à être attaqué ce jour-là, Ætius fait circuler rapidement dans tous les rangs l’ordre de marcher en avant ; il espère que tous, Alliés et Romains, feront leur devoir. Il est temps de mettre un terme à tant de ravages ; ce jour doit être le dernier de cette guerre. C’est la valeur et non pas le nombre qui donne, la victoire ; les Barbares déjà battus deux fois, poursuivis pendant un mois l’épée dans les reins, cachés timidement derrière leurs remparts, tremblants à leur aspect, ne soutiendront pas le feu de leurs regards. En recevant les Visigoths, les Francs, les Bourguignons, les Alains dans son alliance, Rome les a élevés au rang de citoyens romains ; elle les reconnaîtra aux coups qu’ils vont porter ; l’honneur de son nom, la gloire de ses armes ce sont désormais entre leurs mains ; elle les confie avec un juste orgueil à leur discipline et à leur courage ; les Romains seront dignes d’eux mêmes, les Alliés dignes des Romains. A deux heures précises, l’armée s’ébranle et marche en ligne de bataille au-devant de l’ennemi. A trois heures, elle gravit la colline, s’en empare et y prend position. Ce mouvement était à peine commencé que des coureurs en portent la nouvelle à Attila. En un clin d’œil toute l’armée a pris les armes, et attend en silence le signal du combat. Attila monté sur un cheval rapide comme l’éclair, parcourt tous les rangs ; ses compagnons savent que sa voix ne leur a jamais fait de promesses vaines ; le monde entier a les yeux fixés sur eux, il appelle à grands cris ses libérateurs. Tous les peuples font des vœux pour le succès de leurs armes, tous sont las de la tyrannie des Romains. Qu’ils se rappellent leurs victoires ; l’Orient, les trois quarts de l’Europe rangés en courant sous sa loi. Un dernier effort va les couvrir d’une gloire immortelle ; Rome trouver enfin le châtiment de ses crimes, l’univers des vengeurs. Attila presse leur marche ; il espère encore arriver avec le centre au haut de la colline avant les Romains. Il n’avait que neuf cents toises à parcourir. Mais il est trop tard, Ætius l’a prévenu : il trouve le plateau couronné. Les deux armées s’approchent, elles s’entrechoquent, la terre tremble sous leurs pas. Le bruit des instruments de guerre, le cliquetis des armes, les cris de fureur de deux cent mille combattants ébranlent la voûte des cieux ; la plaine en retentit au loin, ils se propagent jusqu’à Châlons. Le combat s’engage sur toute la ligne ; on se bat corps à corps, la mêlée est furieuse, opiniâtre, horrible. Elle dure depuis une heure ; des monceaux de cadavres dérobent aux combattants la vue de leurs rangs respectifs. Chacun a fait vœu de mourir plutôt que de céder. Les chefs se multiplient et donnent l’exemple du courage. Cependant les plus braves, même parmi les Romains, inaccoutumés à une telle résistance, craignent de ne pas l’emporter ; Ætius lui-même semble douter un moment de la victoire, il s’étonne et s’irrite de leur hésitation. Accablés d’une grêle de traits, heurtés de front par les gardes d’Attila, les Belges de la 17e légion, les Celtes de la 6e, troupes braves s’il en fut jamais, semblent perdre contenance et auraient peut-être cédé du terrain si un corps de réserve de quatre mille Francs, l’élite des troupes de Mérovée, ne fut accouru, ayant ce chef intrépide à sa tête, pour rétablir la balance et donner une nouvelle face au combat. A ce moment un effort puissant, unanime, se communique comme l’étincelle électrique sur toute la ligne des Romains, tous s’élancent et frappent de concert. Les Huns étonnés de cette furie sont obligés de céder. L’impulsion donnée au centre se propage aux deux ailes. Toute l’armée gagne du terrain. Attila le dispute pied à pied et se rapproche en bon ordre de sa seconde position. Le centre et l’aile gauche de son armée pivotent sur le camp retranché, et se retirent en échelons par Mauriac, Bussy et Saint-Rémy derrière la Noblette ; là, couverts par les retranchements qu’il a fait élever, ses bataillons sont promptement reformés, et accueillis par des troupes fraîches, ils attendent de pied ferme les Romains. L’aile droite, par un mouvement inverse, vient s’adosser à la colline de Lacroix, laissant à découvert la redoute de Nantivet. La cavalerie des alliés inonde bientôt la plaine de Lacroix ; par cette manœuvre elle coupe à Attila sa retraite sur Verdun. En même temps un détachement de Francs cerne la redoute’ de Nantivet et promet de la forcer bientôt à capituler. Malgré cet échec, et quoiqu’ayant son flanc droit découvert, Attila fait bonne contenance et inspire une nouvelle ardeur à ses soldats. Il est près de cinq heures lorsque les Romains arrivent en bon ordre au pied de sa seconde position[17]. Jamais entreprise ne fut plus périlleuse et n’exigea plus d’audace que l’attaque de front et l’enlèvement de vive force du passage de la Noblette. L’assaut presque fabuleux que des braves vont livrer, les remplit de joie ; aucun ne s’en étonne ; un premier succès a enhardi les plus timides. Tous ferment les yeux sur le danger qui les menace et ne veulent que la gloire qui les attend, la gloire d’une belle mort ou d’un éclatant et dernier succès. Le combat recommence avec une nouvelle fureur. Les rangs se pressent, s’éclaircissent et se reforment tour à tour au pied des retranchements d’Attila. Les plus braves s’élancent pour franchir le ruisseau, ils sont plusieurs fois repoussés. Ce faible courant est teint et comme grossi du sang des blessés ; les cadavres amoncelés dans son lit, en suspendent le cours ; ils le refoulent vers sa source et le forcent à déborder comme un torrent. On voit des soldats, qu’irrite la douleur de leurs blessures, se disputer ce mélange d’eau et de sang pour étancher la soif qui les dévore. C’est aux abords de la tête de pont de Bussy que le combat est le plus acharné. La position avantageuse des Huns expliquerait seule l’opiniâtreté de leur résistance ; mais ce qui ajoute à leur énergie et à leur rage, c’est qu’ils combattent pour leur salut. Il ne s’agit plus désormais de courir à de nouvelles conquêtes, de se gorger d’un riche butin : il s’agit d’être ou de n’être pas ; vaincre ou périr est leur cri de ralliement. Cette position est leur dernier refuge ; Sils l’abandonnent, il rie leur reste plus aucun moyen de salut : c’est l’esclavage ou la mort qui les attend. Des efforts réitérés emportent le passage au-dessus de Saint-Rémy, là où le ruisseau, presqu’à sec, est le moins profond et le moins escarpé. Plus loin la cavalerie a gagné du terrain, et, par un mouvement de flanc, elle menace de prendre à revers la rive gauche de la Noblette, tandis que le centre continuera son attaque de front en avant de Bussy. Cette manœuvre imminente inquiète rutila, la défense en est décontenancée ; Ætius, qui s’en aperçoit, redouble ses efforts ; ses rangs, quoique fort éclaircis, se resserrent et renversent les derniers obstacles ; les bataillons qui résistent encore sont partout enfoncés, le ruisseau est franchi et sa main victorieuse saisit enfin cette rive qui lui était disputée depuis une heure avec tant d’acharnement. Vingt mille cadavres attestent la fureur de l’attaque et l’intrépidité de la défense. Il est six heures ; les Huns se retirent en désordre, à travers champs, dans toutes les directions. Théodoric débouche immédiatement à la tête de sa nombreuse cavalerie. Il presse les fuyards, pousse droit devant lui, et malgré l’heure avancée, les poursuit encore ce jour-là jusqu’à trois lieues au-delà du champ de bataille. Il se trouvait à neuf heures du soir à la hauteur de Poix. Dans une dernière charge, il tombe frappé à la tête par le javelot d’Andagèse. Les siens s’en aperçoivent trop tard ; il est foulé au pied des chevaux : on le relève, il ne donnait plus aucun signe de vie. Une mort prématurée lui ravit le fruit de la victoire et l’ensevelit dans son triomphe ; son fils lui succède dans le commandement. Le combat se prolonge sur tous les points fort avant dans la nuit : il est onze heures du soir lorsque les deux armées prennent position. Soixante mille morts[18] un nombre immense de blessés avaient cruellement éclairci les rangs des Barbares. La perte n’était pas moins sensible du côté des Romains. Quarante-cinq mille braves avaient succombé ; les blessés couvraient la plaine. Ces pertes laissaient un vide difficile à combler ; elles portaient principalement sur les Francs et sur les Romains. On n’avait pas fait de prisonniers. Le lendemain de la bataille, les forces d’Attila présentaient encore, indépendamment des garnisons de Nantivet, de Saint-Rémy et de Mauriac, trois masses principales de combattants. L’une, provenant des débris de son aile droite, occupait les hauteurs de Lacroix, essayant de communiquer avec la garnison de Nantivet ; l’autre, peu nombreuse et formée d’une partie du centre, avait battu en retraite dans la direction de Poix, ayant derrière elle la route de Toul et de Langres, et se trouvait entièrement séparée du reste de l’armée. La troisième, qui était la plus considérable, et celle qui avait le moins souffert, était massée en avant de Mauriac et au pied du camp retranché où Attila s’était retiré de sa personne avec l’élite de ses soldats. La cavalerie, éparse de différents côtés, avait ses principales forces au-delà de poix. Les Francs ont ordre d’observer et de contenir l’aile droite ; les Bourguignons et la cavalerie de Théodoric sont à la hauteur de Poix ; les Romains, les Alains et les Visigoths cernent Mauriac sur les deux rives de la Noblette, et interceptent les communications d’ Attila avec Châlons où sont ses vivres et ses magasins. Attila, retiré dans son camp, couvert par des inondations, ayant encore sous sa main cinquante à soixante mille de ses plus braves soldats, se prépare de nouveau à combattre et, sil le faut, à vendre chèrement sa vie. Les chances d’un nouvel engagement peuvent lui être favorables ; ces retours soudains ne sont pas rares à la guerre. Il juge par ses pertes de celles de l’ennemi, et le jour qui va luire peut éclairer la défaite des Romains. Plusieurs jours de suite Ætius renouvelle ses attaques : elles sont constamment repoussées. Deux fois Attila se fait jour, et élargit le cercle qui le presse de tous côtés. On se bat avec le même acharnement sur tous les points occupés en force par l’ennemi. C’est sur la hauteur de Lacroix, et en avant de Mauriac, que la mêlée est plus opiniâtre et les succès plus chèrement payés. Cependant Attila, resserré de plus en plus dans ses lignes, coupé de ses communications avec les bords de la Marne, voit avec désespoir que les vivres mont lui manquer. Ætius souffre aussi de la disette, mais il tient librement la campagne ; le marché de Châlons lui est ouvert, et les magasins d’Attila vont bientôt le ravitailler. Cette pensée trouble Attila : l’idée d’une catastrophe le rend furieux, mais quoique son orgueil souffre et s’irrite, son courage n’en pas ébranlé. Si Ætius, au lieu d’irriter inutilement son rival par des attaques réitérées, qui affaiblissent son armée déjà harassée de tant de fatigues et en proie depuis huit jours à tant de privations, se fût borné à bloquer de loin le camp de Mauriac, Attila, au bout de très peu de jours, eût été réduit à capituler. Coupé de sa retraite, sans communications avec ses renforts, sans munitions, sans subsistances, ayant devant lui les défilés de l’Argonne. Cette catastrophe était inévitable ; il était forcé de mettre bas les armes, pas un seul homme n’eût échappé. D’un autre côté, il ne faut passe dissimuler qu’Ætius avait de justes sujets d’inquiétude et que sa prudence pouvait à bon droits alarmer de l’avenir de sa position. Ses alliés n’étaient pas tous également dévoués ; il lui était permis de douter que tous lui restassent également fidèles. Les Bourguignons, qui avaient vu deux fois leurs rangs éclaircis par les Barbares, étaient impatients de rentrer dans leurs foyers ; les Alains, mécontents du peu de confiance qu’Ætius leur témoignait, murmuraient hautement de sa partialité, et n’attendaient qu’un prétexte pour l’abandonner ; les Visigoths, que préoccupait vivement la mort de leur roi, et qui voyaient déjà des partis se former en leur absence dans leur patrie, pour lui donner un successeur, tournaient des regards inquiets vers le midi ; les Francs seuls étaient résolus à achever leur ouvrage : tous, chefs et soldats, étaient prêts à porter les derniers coups aux Barbares et à suivre la fortune d’Ætius jusqu’au bout. Ces considérations, jointes à des motifs d’ambition que l’histoire ne révèle pas, et aux instances secrètes et peut-être corruptrices des émissaires d’Attila, déterminent Ætius à prêter l’oreille à un accommodement ; il se conclut après deux jours de négociations. Attila rend la liberté aux esclaves, renvoie les otates, abandonne l’immense butin qu’il avait amassé, à travers tant de périls, et, moyennant la promesse solennelle de ne plus faire aucune tentative d’invasion contre les Gaules et contre l’occident de l’Europe, il obtient la liberté de repasser le Rhin. Les Huns, réduits à moins de cent mille hommes en état de supporter les fatigues de la retraite, commencent leur mouvement le 20 septembre, dix jours après la bataille. Leur marche est tracée par Verdun, Metz, Trèves et la vallée de la Moselle jusqu’à son embouchure dans le Rhin. Ætius, à la tête d’une colonne de 20 mille Romains et de 15 mille Francs, les suit à une journée de distance ; il choisit chaque soir son campement de manière à être toujours en vue de l’ennemi[19]. Une multitude de feux allumés par ses ordres, simulent une armée beaucoup plus nombreuse, et le tiennent en respect Saint Loup[20], qui attendait à Châlons l’issue de la bataille, invité par Attila à le suivre dans sa retraite, acquiesce, avec la permission Ætius, à sa prière, et l’accompagne jusqu’au Rhin. Ses efforts pour lui rendre les populations favorables et pour calmer leur juste irritation, obtiennent un plein succès. Il parvient à lui épargner de nouveaux malheurs à travers un pays où son nom était abhorré. En attendant le retour d’Ætius, et avant de se séparer, les vainqueurs rendent les derniers devoirs à leurs morts et consacrent à l’envi, par des monuments funèbres, le souvenir de ce glorieux évènement. Une tombe immense[21] s’élève au lieu même où Théodoric a été frappé. Les Visigoths y déposent sa cendre et ne s’éloignent du théâtre des exploits de ce prince illustre qu’après avoir payé à sa mémoire un noble tribut de regrets. Les Francs, qui avaient payé du plus pur de leur sang la possession de la redoute de Nantivet[22], amoncèlent en une vaste pyramide la moitié de l’enceinte de cet ouvrage, et y rassemblent les restes des guerriers que le fer a moissonnés. Là sont déposés leurs titres à la possession des Gaules, et leurs droits à conquérir plus tard la patrie qu’ils viennent de sauver. A Bussy[23], où le combat avait été le plus long et le plus acharné, trois autres pyramides s’élèvent dans l’enceinte même de la Tête de pont. La première, à l’ouest, l’emporte sur les deux autres par sa masse et par sa hauteur : elle est l’ouvrage des Romains ; la seconde appartient aux Visigoths qui, secondés par les Alains, avaient, après les Romains, le plus contribué à la délivrance du pays ; la troisième est érigée par les Bourguignons. Les cendres des chefs morts au champ d’honneur, recueillies par des mains pieuses, sont déposées au, centre de ces pyramides, après que de vastes bûchers ont été allumés pour les consumer. La foule des combattants reçoit les honneurs de la sépulture vulgaire, sur les lieux mêmes où ils ont glorieusement succombé ; leur dépouille mortelle est confiée à la terre, à cette terre qu’ils ont affranchie en l’arrosant de leur sang. Les bords de la Noblette s’enorgueillissent de recevoir, avec le dépôt de tant de brava, le gage d’une impérissable célébrité. D’autres tombeaux retracent çà et là, en caractères ineffaçables, l’étendue de ce vaste champ de bataille. On en voit deux[24], voisins l’un de l’autre, s’élever à l’ouest de Mauriac ; deux autres[25] au pied des hauteurs de Lacroix ; un cinquième[26] près des sources de la Noblette. Jamais événement plus mémorable, plus important, ne fut signalé à la postérité avec plus d’appareil, ne fut immortalisé par de plus grands monuments. Après avoir consacré huit jours à ces pieux et tristes devoirs, l’armée se prépare, par un repos de quelques jours, repos si nécessaire, et qu’elle a si bien mérité, à sa complète dislocation. Au moment où Attila délivrait enfin les Gaules de sa présence[27], les Visigoths et les Bourguignons s’étaient déjà rapprochés de plusieurs marches de leurs foyers ; les Francs avaient repassé l’Aisne et l’Oise, et allaient se reposer de leurs fatigues sur les rives fertiles de l’Escaut. Quant à Ætius, aussitôt qu’il voit les Huns au-delà du Rhin, il licencie le corps Franc qui là accompagné ; ceux-ci descendent le fleuve et rentrent dans leurs provinces par Cologne, Aix, Maastricht et Louvain. Ætius suit une marche inverse ; il remonte le Rhin, rétablit l’ordre dans toute l’Alsace, punit les traîtres qui s’étaient vendus à Théodemir, récompense avec éclat ceux qui sont restés fidèles à l’alliance des Romains, et poursuivant sa marche vers le Jura, après avoir conféré longtemps avec Gondicaire sur la situation et sur les besoins de la Bourgogne, il s’arrête pour passer l’hiver à Lyon. L’année suivante, Attila, au mépris de ses serments, entre en Italie par le nord et ravage toute la Lombardie. Ætius, surpris et comme effrayé de cette nouvelle irruption, ne fait d’abord rien pour l’arrêter ; il se retire sur la rive droite du Pô et se contente de détruire les détachements qui osent le traverser. Attila, après avoir dicté à Ætius les conditions d’un traité, déshonorant pour les armes romaines, retourne en Pannonie. Deux ans plus tard, lorsque parvenu au comble de la gloire et des honneurs, chargé d’ans et de lauriers, Ætius aurait dû songer uniquement à goûter les douceurs du repos dans une retraite inaccessible aux tourments de l’ambition, ce guerrier dangereux et insatiable est convaincu de menées criminelles, et périt de la main de Valentinien III lui-même, qui le punit de sa trahison par un lâche assassinat. Attila termine sa carrière à peu près à la même époque. Retiré au-delà du Danube, adonné à tous les vices, plongé dans l’ivrognerie et dans la débauche, on doute encore s’il eut la fin de César ou celle d’Alexandre. Avec lui son empire se dissout et disparaît de la scène du monde ; plusieurs royaumes se forment de ses débris. De tant de grandeur il ne reste qu’un nom, un nom haï, détesté, que les peuples ne prononcent qu’avec effroi ; un nom qui sera à jamais parmi eux une malédiction, une injure. L’humanité, trop longtemps outragée par le barbare, le condamne à l’immortalité des brigands fameux ; l’histoire recueille ses arrêts et garde la mémoire de ce fléau, comme elle garde le souvenir d’un incendie ou de l’éruption du volcan. |

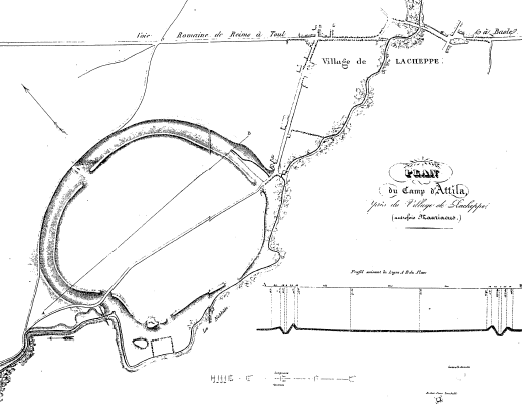
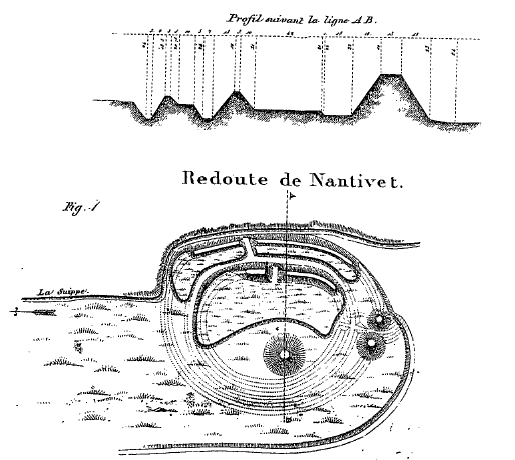 La redoute de Nantivet, dont personne que je sache ne soupçonnait
l’existence ou du moins la liaison avec le camp d’Attila, dont elle forme
cependant la contrepartie, est un ouvrage moins considérable que ce camp, mais
avant un but analogue, et qui ne mérite pas moins de fixer l’attention.
La redoute de Nantivet, dont personne que je sache ne soupçonnait
l’existence ou du moins la liaison avec le camp d’Attila, dont elle forme
cependant la contrepartie, est un ouvrage moins considérable que ce camp, mais
avant un but analogue, et qui ne mérite pas moins de fixer l’attention. La tête de pont de Bussy a disparu en
grande partie par suite de l’érection des pyramides dont il sera parlé plus
loin, avec les terres de son épaulement. Rais il en reste assez pour
reconnaître les lignes de son tracé, et dans l’ensemble dé ce trace quelle a dû
être sa destination. Elle enveloppe le pont de la Noblette, faisant face à
Reims, et ayant dans chaque flanc une ouverture pour l’entrée et la sortie des
troupes qui la défendaient ou qui se ralliaient sons sa protection. Elle était
donc disposée pour résister à une attaque venant du côté de Reims, et elle
avait évidemment à la fois polir objet d’assurer le passage de la rivière aux
troupes amies, et de l’intercepter à celles qui se seraient laissées entraîner
à leur Poursuite.
La tête de pont de Bussy a disparu en
grande partie par suite de l’érection des pyramides dont il sera parlé plus
loin, avec les terres de son épaulement. Rais il en reste assez pour
reconnaître les lignes de son tracé, et dans l’ensemble dé ce trace quelle a dû
être sa destination. Elle enveloppe le pont de la Noblette, faisant face à
Reims, et ayant dans chaque flanc une ouverture pour l’entrée et la sortie des
troupes qui la défendaient ou qui se ralliaient sons sa protection. Elle était
donc disposée pour résister à une attaque venant du côté de Reims, et elle
avait évidemment à la fois polir objet d’assurer le passage de la rivière aux
troupes amies, et de l’intercepter à celles qui se seraient laissées entraîner
à leur Poursuite.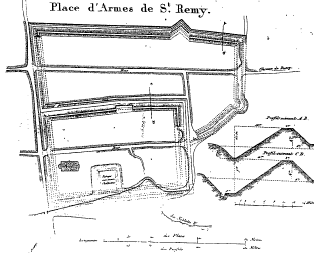 Les dispositions faites à Saint-Rémy sont
différentes. La redoute est couverte par le ruisseau, qui forme comme son
avant-fossé ; il est probable que le gué avait disparu sous une inondation.
Cette redoute était fermée de tontes parts, excepté à l’ouest, où elle
s’ouvrait sur la Noblette pour les besoins de la garnison ; mais depuis qu’elle
a servi à former l’enceinte d’un château qui n’existe plus et à l’établissement
de l’église et du cimetière du village, ses remparts sont en partie effacés et
aplanis. Cependant ce qui est resté intact présente encore un relief
considérable.
Les dispositions faites à Saint-Rémy sont
différentes. La redoute est couverte par le ruisseau, qui forme comme son
avant-fossé ; il est probable que le gué avait disparu sous une inondation.
Cette redoute était fermée de tontes parts, excepté à l’ouest, où elle
s’ouvrait sur la Noblette pour les besoins de la garnison ; mais depuis qu’elle
a servi à former l’enceinte d’un château qui n’existe plus et à l’établissement
de l’église et du cimetière du village, ses remparts sont en partie effacés et
aplanis. Cependant ce qui est resté intact présente encore un relief
considérable.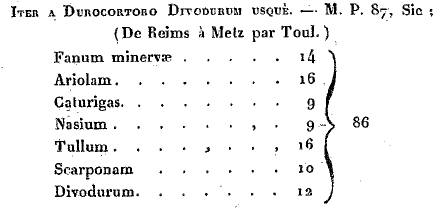


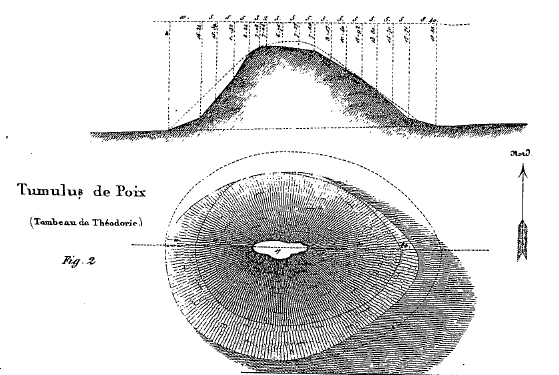 Le tumulus de Poix est autant par sa position que par sa forme et par sa
grandeur, l’un des plus remarquables qui existent.
Le tumulus de Poix est autant par sa position que par sa forme et par sa
grandeur, l’un des plus remarquables qui existent.