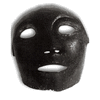L'HOMME AU MASQUE DE FER
APPENDICE.
|
Les chapitres XI, XII, XIII et XIV de ce livre ont été l'objet, au moment de leur publication dans le Correspondant, d'une attaque très-vive émanant du R. P. Turquand, de la Compagnie de Jésus, et publiée dans le numéro du 15 août 1869 de la revue des R. P. jésuites, les Études religieuses et littéraires. Cet article, je ne puis le publier ici, non pas à cause de sa vivacité, puisque j'en ai moi-même demandé et obtenu l'insertion intégrale dans le numéro du Correspondant du 10 septembre, mais parce que je n'en ai ni le droit, ni du reste la possibilité, vu son extrême longueur. Voici ma réponse, dans laquelle on retrouvera énoncés tous les griefs de mon contradicteur : Très-Révérend
Père, Vous avez cru devoir tenter
de disculper les jésuites de la part qu'ils ont eue dans l'enlèvement du
patriarche arménien Avedick, violemment arraché de son pays et conduit en
France, où il est mort. Loin de moi la pensée de contester votre droit
d'essayer une telle justification. Cette solidarité, que vous revendiquez
ainsi entre tous les membres d'un même ordre, et qui vous oblige à prendre la
défense de vos frères disparus depuis bientôt deux siècles, ni ne me
surprend, iii ne m'embarrasse. Vous vous sentez atteint par les coups qui les
frappent, et vous vous levez pour les représenter et répondre d'eux. Rien de
mieux. Vous ne me contesterez par pour moi-même un droit semblable, et, après
avoir eu la liberté de combattre mes conclusions, vous voudrez bien, je
l'espère, que j'aie celle de les maintenir. Je le ferai sans vous imiter,
partant sans irritation, ni acrimonie, et avec cette modération tranquille
dont se gardent bien de se départir ceux qui sont réellement convaincus et
impartiaux. Il est vrai que vous niez cette impartialité, que vous parlez de mes préventions contre vous, d'une sorte de fascination
qui m'obsède, d'un besoin instinctif de plier les faits à une hypothèse
préconçue, de ma constante préoccupation de vous trouver coupables, d'un
dénigrement systématique de l'Église catholique et des jésuites. Par
ce procès de tendance, vous espérez parvenir à me rendre suspect à vos
lecteurs, et à me présenter à eux en adversaire passionné et de la religion
et de votre Ordre, ce qui, à vos yeux, est identique. Mais ne craignez-vous
pas qu'en voulant me faire écarter comme un ennemi ardent de votre Compagnie,
on ne songe à vous récuser comme inclinant trop naturellement à l'indulgence
? Si vive que soit la prétendue animosité qui m'inspire, pourrez-vous
persuader qu'elle égale votre affection filiale et obligée pour un Ordre
auquel vous appartenez ? De nous deux enfin, si je vous parais céder au
penchant irrésistible qui me porte à vous voir coupables, n'obéissez-vous pas
à une propension bien plus impérieuse encore qui vous conduit à vous croire
innocents ? A vrai dire, je n'éprouve
aucun des sentiments que vous me supposez. N'est-il pas permis d'être
indifférent aux progrès comme aux revers de votre Ordre sans l'être aux
intérêts de la religion ? Sur la route que j'avais à parcourir dans mon étude
sur l'Homme au masque de fer, s'est rencontré l'épisode de
l'enlèvement d'Avedick. Je n'en ai ni recherché, ni évité le récit. Dans un
article de cinquante-six pages, vous blâmez la longueur de ce récit, qui n'en
a que trente-cinq. Combien plus étendu aurait-il été si, comme vous me
reprochez de ne l'avoir point fait, j'avais reproduit intégralement chacune
des nombreuses dépêches dont je l'ai étayé ! L'histoire ainsi écrite
n'offrirait aucun attrait au lecteur ; ce serait un procès-verbal sec, aride,
dépourvu de mouvement comme d'intérêt. Vous qualifiez mon article tantôt de
factum, tantôt, de réquisitoire, et ailleurs vous l'appelez un drame. Je
serais heureux qu'il eût mérité cette dernière qualification. L'histoire doit
être, en effet, un drame dont les personnages marchent, s'agitent, vivent. Vous
voulez bien me conseiller de me prémunir contre la
puissance d'imagination dont je suis doué. Elle vous aurait paru sans
doute moins dangereuse si elle ne m'avait aidé à exciter quelque pitié pour une
malheureuse victime de la passion religieuse. On ne saurait contester à
l'historien le droit et le devoir, après avoir exactement raconté un acte de
violence, de le condamner, et rester froid devant un crime n'est pas une des
conditions nécessaires de l'impartialité historique. J'espère démontrer,
sinon à vous-même, du moins à nos lecteurs, que la chaleur dont j'ai essayé
d'animer mon récit avait sa source dans une conviction sincère autant que
dans une indignation trop justifiée. Mais je suis forcé, avant
d'entrer dans le fond même du débat, de vous suivre dans une foule de points
secondaires par lesquels vous cherchez à en détourner l'attention, et qui
abondent en insinuations artificieuses, en confusions calculées et en graves
accusations adroitement mêlées à quelques éloges. Vous excellez, je dois le
dire, dans cette tactique, et vous y déployez à merveille cette habileté qui vous
est propre. Sans y prétendre, je vais tenter de ne laisser debout aucune de
vos attaques. IVous voulez bien prendre en
pitié la patience des lecteurs du Correspondant, depuis trop longtemps
désireux d'avoir enfin la solution du problème de l'Homme au masque de fer.
Je vous sais gré d'avoir abordé ce point, bien qu'il soit tout à fait
étranger à ce débat. Je suis, en effet, fort en retard avec mes lecteurs,
mais ils m'excuseront sans doute quanti ils sauront que, pour deux causes
aussi légitimes l'une que l'autre, j'ai momentanément interrompu mes travaux,
la première fois détourné d'eux par une longue maladie, la seconde par la
nécessité où vous m'avez mis de vous répondre. Vous me dénoncez ensuite comme
ayant donné dans une note de mon premier article deux dépêches italiennes où la crudité la plus révoltante le dispute à
l'invraisemblance. Vous auriez sans doute été plus indulgent, au moins
pour l'une de ces deux dépêches, si vous aviez lu qu'elle a été écrite par un
nonce et adressée à un pape. Continuant à vous occuper de questions aussi
étrangères au but que vous poursuivez, vous affirmez que, dans une note, je donne, comme étant de Saint-Simon, sur
la famille de Ferriol certains traits de haut goût. Vous semblez
ignorer qu'on ne cite un auteur que lorsqu'on guillemette ou souligne ses
paroles. On ne saurait donc m'accuser d'avoir voulu attribuer à Saint-Simon
ce que je dis de la sœur de madame de Ferriol. En la désignant par ces mots :
La célèbre religieuse, connue par ses désordres,
maîtresse de Dubois, je me suis contenté de résumer le passage des
immortels Mémoires qui la concerne. Vous paraissez regretter le texte
même de Saint-Simon. C'est imprudent, permettez-moi de vous le dire, et si
j'avais qualité pour vous donner un avis, je vous conseillerais de ne jamais
invoquer cette autorité. Vous n'avez pas, en effet, d'adversaire plus acharné
que cet écrivain de génie, ardent, impétueux dans ses aversions comme dans
ses amitiés, mais incontestablement parfait honnête homme, et dont il y a peu
de volumes qui ne renferment contre vous un réquisitoire. Mais enfin voici, puisque
vous le souhaitez, une citation plus complète : L'abbé de Tencin
avait deux sœurs : l'une qui a passé sa vie à Paris dans les meilleures
compagnies, femme d'un Ferriol assez ignoré, frère de Ferriol qui a été
ambassadeur à Constantinople, qui n'a point été marié. L'autre sœur religieuse professe pendant bien des années
dans les Augustines de Mont-Fleury, aux environs de Grenoble ; toutes les
deux belles et fort aimables, madame Ferriol avec plus de douceur et de
galanterie, l'autre avec infiniment plus d'esprit
et de débauche. Elle attira bientôt la
meilleure compagnie de Grenoble à son couvent, dont la facilité de l'entrée
et de la conduite ne put jamais être réprimée par tous les soins du cardinal
le Camus. Tant de commodités dont madame de Tencin abusa largement
ne firent que lui appesantir le peu de chaînes qu'elle portait. On la venait
trouver avec tout le succès qu'on dit pu désirer ailleurs... Plus tard, elle
devint maîtresse de l'abbé Dubois, et lorsqu'il fut cardinal, maitresse
publique, etc., etc. Avais-je donc tort de
nommer cet écrivain dans ma note et sont-ils de
mon cru, selon votre langage[1], ces traits de haut
goût, étourdiment attribués à Saint-Simon ? Ce mot étourderie revient plus d'une fois sous votre
plume. Il n'est ni dans mes convenances ni dans mes habitudes de l'employer ;
mais n'en aurais-je pas le droit quand je rencontre tant de contradictions
dans votre article ? Vous affirmez que l'étude sur Avedick était parfaitement
déplacée dans un travail sur le Masque de fer, et vous oubliez avoir
non moins dogmatiquement affirmé, deux pages auparavant, qu'il était essentiel au but que je me propose, la
révélation du Masque de fer, de détruire toutes les opinions qui avaient été
précédemment émises. Dois-je, sur la foi de la première affirmation,
conserver dans mon travail l'épisode d'Avedick, ou, d'après votre seconde
décision, suis-je tenu de le supprimer ? La protestation qui a
précédé votre article fait vivre le chevalier de Taules jusqu'en 1825, et
plus tard vous dites qu'il est mort en 1800. Ni l'une ni l'autre de ces dates
ne sont exactes. Vous avez trouvé la seconde dans les quelques lignes
consacrées à Taules par la Biographie Michaud, et rendues beaucoup moins
affirmatives dés la seconde édition de cet ouvrage, où se trouvent du reste
tant d'erreurs. N'est-il pas plus judicieux d'ajouter foi, au moins en ce qui
concerne les dates, à une notice très-longue, très-détaillée, fort bien faite
par quelqu'un qui a connu Taules, et placée à la tète de ses écrits au moment
de leur publication en 1825 ? Or, l'auteur de cette notice ne laisse aucun doute
sur ce fait, que Taules vivait encore sous le premier Empire, puisque : 1° il
le montre refusant du gouvernement impérial plusieurs
importants emplois ; 2° il affirme en 1825 que Taulès est mort depuis
peu d'années seulement. Le singulier est que vous citez avec complaisance, et
pour vous en servir contre Taulès, un passage de cette notice dont vous
refusez d'adopter les dates. De telle sorte qu'on serait fort embarrassé pour
connaitre votre opinion sur un document que vous repoussez et que vous acceptez
tour à tour, si votre vrai mobile n'apparaissait pas : vous teniez à ouvrir
votre article par la constatation d'une erreur grossière que j'aurais
commise. La question de la mort de Taulès ne touche en rien au débat. Peu
importe. Il y a un mois à peine, vous avez prolongé sa vie jusqu'en 1825. Peu
importe encore. Il vous faut, il vous faut à tout prix trouver dans mes pages
une de ces énormités qui justifient le sarcasme et qui vous rallient aussitôt
les lecteurs en m'enlevant toute leur confiance. Vous tuez Taulès en 1800, et
vous avez fort beau jeu ensuite de rire de moi, qui le montre traversant le premier Empire sans vouloir rentrer dans les
affaires. Ce sont là des succès de fort bon aloi. Vous portez contre moi une
accusation plus grave encore et non moins imméritée. Vous dites que je me suis donné le plaisir peu français de charger
un compatriote pour élever aux nues Avedick. Vous êtes très-fondé à
m'adresser ce reproche, faisant partie d'un Ordre si éminemment français, qui
a toujours défendu les libertés de l'Église gallicane, qui ne s'inspire que
des intérêts de notre pays et les soutient même à l'encontre des injonctions
qu'il reçoit de Borne, dont l'esprit, les actes, les obligations, les
tendances ont été constamment dirigés par le plus pur patriotisme. Sans
prétendre aimer autant que vous mon pays, je me suis prononcé, sur certains
épisodes de son histoire, avec une émotion prenant sa source, ce me semble, dans
un sentiment très-français. Quand j'ai eu à porter un jugement sur la
révocation de l'édit de Nantes, sur cet acte qui, vous le savez bien, a été
conseillé à Louis XIV, et dont les conséquences ont été si désastreuses, je
l'ai réprouvé avec toute l'énergie dont j'étais capable, et ce me semble, en
bon Français. Lorsque, dans la description d'une ville célèbre[2], j'ai rencontré une prison[3] où furent détenus tant de protestants dont on avait
confisqué les biens, incendié les demeures, et qui, entassés dans des
chambres étroites et obscures, étaient condamnés à y vivre, le fanatisme
religieux, cause de ces iniquités, et qui, vous le savez bien, était inspiré
à Louis XIV, je l'ai maudit, et, ce me semble, en bon Français. A vrai dire, je n'espère
pas que ces jugements vous persuadent de mon patriotisme. Mais je voudrais au
moins vous convaincre de la netteté habituelle de mes affirmations. Vous
semblez, en effet, la mettre en doute. Vous dites que
le libre penseur perce en moi sous le masque catholique ; que
j'essaye de parler comme pourrait le faire un catholique ; que j'ai glissé
dans le Correspondant mon étude sur Avedick. Il n'en est rien,
T. R. Père. Les insinuations, les sous-entendus, les timidités affectées de
langage, je ne les ai jamais connues. Après avoir longtemps étudié ce dont
j'ai à parler, j'affirme et je maintiens hautement mon opinion. Les nombreux
articles publiés depuis cinq années dans la revue où tous vos efforts tendent
à me rendre suspect, je les ai offerts et non glissés par surprise. La
direction du Correspondant n'est pas plus disposée à subir ce procédé que je
ne suis prêt à l'employer. Sa vigilance, que vous voulez armer contre moi,
n'a point été trompée, et, loin d'user de subterfuge, j'ai exposé, avant d'en
commencer la publication, le sens général de mes six articles sur l'Homme
au masque de fer. Il n'y a donc eu ni subterfuge, ni manœuvres, ni
surprise. Il faut vous y résigner. Tout s'est fait loyalement, ouvertement,
avant comme pendant celte polémique... de ce côté du moins ; car nous n'usons
point des mêmes procédés, pas plus que nous ne combatt6ns avec les mêmes armes,
et tandis qu'ici vous était offerte l'hospitalité la plus complète, ailleurs
mes plus légitimes réclamations étaient ou dénaturées ou repoussées avec
cette douce urbanité et cette évangélique mansuétude qui caractérisent
certains de vos alliés. Mais c'est assez m'occuper
après vous de points aussi étrangers à ce débat, et il est temps de ramener
la question à ses deux termes véritables : — Quel jugement faut-il
porter sur la conduite de Ferriol et de Louis XIV envers Avedick ? — Les jésuites ont-ils pris part à son enlèvement ? IIDans tous les temps et dans
tous les pays, la tactique des persécuteurs a été de salir leur victime. Je
ne me suis pas fait, je ne prétends pas me faire l'avocat d'Avedick.
Néanmoins il est essentiel, ce me semble, de remarquer que les dépêches de
Ferriol qui ternissent la réputation du patriarche sont postérieures à son
enlèvement. Le P. Griffet, un des vôtres, a dit très-judicieusement qu'avant
d'adopter l'opinion émise sur un personnage par un contemporain, il convient d'examiner
s'il n'avait pas un puissant intérêt à louer ou à blâmer. Par leur date donc,
ces dépêches seraient déjà suspectes, mais combien le sont-elles plus encore,
lorsqu'on voit l'exagération et l'énormité scandaleuses des actes que Ferriol
lui reproche, et quand celui-ci, plusieurs années après, reconnaît cette
exagération[4] ? Ces actes sont tels que vous avez reculé, et je
vous en approuve, devant l'insertion intégrale de ces dépêches. Pourquoi
m'accuser d'avoir fait par calcul, ce que vous vous êtes permis par une sage
prudence ? Au surplus, les profanations reprochées à Avedick par Ferriol
auraient-elles été réelles, se serait-il rendu coupable de crimes plus grands
encore, la violation du droit des gens commise sur sa personne par un
ambassadeur et sa longue détention dans un pays étranger, seraient-elles plus
excusables ? Vous donnez quelquefois au patriarche la qualification ironique de digne et respecté vieillard, d'innocent Avedick, tantôt en voulant bien
reconnaître que je n'ai jamais employé ces termes, tantôt en vous abstenant
de cette loyale et nécessaire observation. De telle sorte qu'ayant l'honneur
d'être le principal objet de vos attaques, c'est à moi, dans ce dernier cas,
que le lecteur attribue l'emploi de ces épithètes excessives. Je me suis
contenté de le nommer l'infortuné Avedick, ou
bien ce chef aimé des Arméniens, qualificatifs
que justifient assez, ce me semble, ses longs malheurs et les énergiques
efforts déployés par les Arméniens pour faire cesser une détention inique. Du reste, il y a, dans
votre article, un aveu qui aurait dû vous rendre plus indulgent pour le
patriarche, Vous ne niez pas la part que les
jésuites auraient prise à l'élévation d'Avedick au patriarcat, et,
parvenu au pouvoir, il aurait trompé les espérances que ces Pères fondaient
sur lui. Les jésuites auraient donc consenti à accepter les services de cet être repoussant. Vendu à eux, ce n'eut plus
été un homme vénal. Placé entre leurs mains, l'instrument aurait perdu tous
ses défauts. Ô mon Père, quelle distraction vous avez commise ! Il est vrai
que vous évoquez ensuite, à propos de l'échec qu'ont essuyé quelques-unes de
vos tentatives de ce genre, des souvenirs pleins de tristesse et d'amertume.
Vous constatez qu'il vous est arrivé de n'avoir pas
toujours la main heureuse. Vous rappelez l'exemple d'Henri de Gondrin,
élève des jésuites, appelé, grâce à
votre intervention, à l'archevêché de Sens, et devenant l'un des plus fougueux coryphées des jansénistes et le
persécuteur à outrance de ses anciens maîtres et bienfaiteurs. Je ne
sais si je me trompe, mais en épanchant ainsi les regrets causés par les
déceptions que vous avez parfois éprouvées, les ingratitudes dont vous ont
abreuvés quelques-uns de vos élèves, vous avez dû penser à Voltaire. Mais enfin, avec ou sans votre
participation, Avedick a été élevé au patriarcat. M. Topin, dites-vous, écrit
avec un calme olympien : Avedick exhorte ses
coreligionnaires à la paix, et durant plusieurs années les deux Églises se
maintiennent dans une concorde parfaite. Comment dois-je qualifier à
mon tour ce procédé de discussion par lequel vous citez cette phrase,
non-seulement en l'isolant à dessein de ce qui la précède et l'explique, mais
encore en supprimant toutes les dépêches de Ferriol que j'indique en note et
qui la justifient ? Celles-ci ne peuvent être suspectes, puisqu'elles
expriment sur Avedick une opinion si contraire aux desseins de celui qui les
a écrites. Les voici suivant l'ordre de leur date depuis le moment de la
nomination d'Avedick jusqu'à son enlèvement. Ai-je besoin de le faire
remarquer, là est le point essentiel du débat : premièrement, puisqu'il
s'agit des cinq années qui ont précédé l'enlèvement d'Avedick et son envoi à
Marseille ; secondement, puisque ces dépêches émanent de celui même qui a
ordonné cet acte de violence. Quels meilleurs éléments pouvons-nous réunir
pour apprécier, sinon l'acte de violence en lui-même, que vous consentez à
blâmer un peu, du moins les circonstances atténuantes que vous invoquez ? Ferriol
au comte de Pontchartrain. — 11 may
1702. Le patriarche Avedick
est encore à Andrinople. Il exhorte les Arméniens à la paix. Ferriol
à Pontchartrain. — 8 juin 1702. La persécution des
Arméniens catholiques est entièrement finie. Ferriol
au roy. — 2 octobre 1702. La persécution paraît
entièrement finie. Ferriol
au roi. — 1er may 1703. La liberté est si
grande pour nos Églises que tout le monde avoue qu'il n'y en aurait pas
davantage dans un pays chrétien. Les RR.PP. jésuites ont fait à Pâques la
procession de Sainte-Anne au milieu de Galata, portant la croix, les
bannières et les reliques avec une infinité de flambeaux allumés et un
concours de peuple prodigieux. On ne faisait auparavant cette cérémonie que
dans l'enceinte de la maison. Ferriol
à Pontchartrain. — 4 juillet 1703. Toutes les affaires
du commerce et de la religion vont ici fort bien. Nous y jouissons d'une
assez grande tranquillité. Remarquez que je cite toutes
les dépêches. Vous dites que celles de Ferriol présentent certaines lacunes,
vous fondant sur ce qu'il accuse Avedick d'avoir
intercepté ses courriers. Vous avez mal lu, mon père, la dépêche que
vous invoquez. Avedick, écrit Ferriol à
Torcy, avait eu la témérité d'intercepter les
lettres du roi, mais non celles de l'ambassadeur. L'eût-il fait du
reste, Pontchartrain eût aussitôt averti Ferriol que le courrier ordinaire
n'était point parvenu à la cour, et par le suivant, l'ambassadeur français
n'eût certainement pas manqué d'envoyer une copie de ses dépêches
interceptées. C'est ce qui se fait d'habitude, et l'existence de numéros d'ordre
autant que la mention dans les réponses, des dates des lettres auxquelles il
est répondu, révèlent aussitôt une soustraction et permettent de la réparer.
Or rien de semblable ne se remarque dans la correspondance de Ferriol. Elle
existe en son entier, et, si les diverses lettres ont des dates assez
éloignées les unes des autres, cela tient uniquement aux longueurs des
communications. Après avoir ainsi établi qu'il n'y a pas et qu'il ne saurait
y avoir de lacunes, je continue à citer. Ferriol
à Pontchartrain. —18 septembre
1703. Avedick est aux
Sept-Tours — prison de Constantinople —. Soupy travaille pour se faire de
nouveau patriarche. Il est en toute liberté. Les dépêches suivantes nous apprennent la cause de cette détention, et montrent Ferriol, après l'avoir provoquée, la rendant le plus dure possible. Ferriol
au kiaya du grand-vizir. — 14 may
1703. Je vous prie
très-instamment de faire punir très-sévèrement Avedick, patriarche des
Arméniens. Comme son crime est grand, ayant attenté à l'autorité des
souverains et intercepté par argent la lettre d'un grand empereur amy de tous
temps de la Porte, sa punition doit être exemplaire, et l'on ne peut pas dire
qu'il soit innocent, puisque son crime a été prouvé dans notre justice
suivant toutes les règles. Ferriol
à Louis XIV. — 9 novembre 1703. Le patriarche des
Arméniens Avedick, qui était aux Sept-Tours, a esté envoyé en exil dans un
château de Sirie, et Soupy, après avoir été mis en liberté, a voulu de
nouveau se faire patriarche ; mais il n'y a pas réussi. On doit l'envoyer en
Romélie pour y prescher. Kaisac, qui a esté fait patriarche, parait un homme
modéré. J'espère que nous aurons lieu d'en estre contents. Ferriol
à Pontchartrain. — 12 juin 1704. Les Arméniens ont
fait tout ce qu'ils ont pu pour retirer Avedick de son exil à Abratadas, qui
est un petit écueil près de Tripoly de Sirie, mais le vizir a toujours
déchiré les requêtes, et j'ay donné les ordres nécessaires pour rendre la
prison d'Avedick la plus dure qu'il est possible. Il est enfermé dans un
cachot plein d'eau et d'où il ne voit point le jour. Cependant, le patriarche
des Arméniens Kaisac a été déposé. Grâce au dévouement des
Arméniens, Avedick sort de prison et redevient patriarche. Nous approchons de
l'époque de l'enlèvement. Ferriol
au cardinal de Janson. — 11 mars
1705. Les affaires de la
religion sont icy fort tranquilles. Avedick est encore patriarche des
Arméniens, mais il se tient dans un grand respect. Je ne laisseray pas de
demander sa déposition au vizir, le connaissant pour un très-méchant homme et
capable d'une grande dissimulation. Ferriol
à Louis XIV. — 20 juin 1705. La religion est ici
dans une grande tranquillité. Ferriol
au cardinal de Janson. — 15 août
1705. Pour ce qui regarde
Avedick, il est encore en possession de la dignité, mais il ne donne aucun
chagrin aux catholiques. Ferriol
au cardinal de Janson. — 16
septembre 1705. Il reçoit dans son
palais le patriarche de Sissem, qui essaye de renverser Avedick. Ferriol
à Pontchartrain. — 27 décembre
1705. Le patriarche arménien
Avedick a eu la hardiesse de me venir voir. Comme je luy avais donné la
ceinture d'assurance, je ne l'ay pas fait arrêter. Il m'a promis qu'il ne
tourmenterait plus les Arméniens catholiques et qu'il défendrait de prononcer
dans leurs églises l'anathème qu'ils prononçaient ordinairement contre saint
Léon et le concile de Chalcédoine, et qu'on n'invoquerait plus Dioscore et
les autres hérétiques qu'ils honorent comme des saints, et je luy ai assuré
que lorsqu'il aurait exécuté toutes ces paroles, nous serions les premiers à
inviter les Arméniens catholiques à retourner dans leurs églises. Puis Ferriol annonce tout à
coup l'enlèvement à Louis XIV. Ainsi, quels qu'aient été les démêlés
antérieurs d'Avedick et des catholiques, quel qu'ait pu être le ressentiment éprouvé
par les jésuites de n'avoir pas réussi à l'acheter, il est incontestable
qu'avant comme après la dure détention à Abratadas, Avedick a vécu, tout au
moins, dans un apparent accord avec les catholiques. De mon récit de
l'enlèvement, vous voulez bien ne rien contester, sinon la part qu'y ont eue
les jésuites, question que j'examinerai tout à l'heure. Le récit des événements qui
ont suivi le départ d'Avedick, vous consentez de même à l'accepter, ainsi que
l'exactitude de toutes les dépêches d'après lesquelles je l'ai composé.
Seulement vous le jugez un peu dramatisé. Il est vrai qu'il est plus
développé que le vôtre, et qu'il ne m'a pas suffi comme à vous, de m'exprimer
ainsi : Avedick arriva à
Marseille, fut transféré au mont Saint-Michel, et de là à la Bastille. Il
finit par faire son abjuration. Rendu alors à la liberté, il se retira sur la
paroisse Saint-Sulpice, et mourut rue Férou le 21 juillet 1711. Ces quelques lignes ne sont
pas dramatisées, c'est indubitable. Mais, en revanche, elles, offrent un
précieux exemple de concision dans le style et de rapidité dans la marche. Vous
avez un don particulier pour écrire certaines parties de l'histoire, pour
glisser légèrement sur les scènes qu'il vous serait pénible de retracer.
C'est sans doute chez vous une grâce d'état, car un des vôtres s'est
immortalisé par une manière analogue de raconter l'histoire du premier Empire
; et je conçois que, comptant dans vos rangs un historien si justement fameux,
vous soyez si sévère pour ces fiertés indépendantes
qui sous le second Empire s'occupent d'études historiques. Avedick, dites-vous, fut transféré
de Marseille au mont Saint-Michel, et de là à la Bastille. De ses
protestations énergiques, des rigueurs appelées sur sa tête par Ferriol, dont
la haine était pourtant assouvie, de l'émotion universelle excitée dans tout
l'Orient, des efforts touchants tentés plusieurs fois par les Arméniens pour
retrouver leur chef, de l'alternative où se trouvait le prisonnier de renier
sa foi ou de mourir à la Bastille, des vives instances et des préoccupations
inquiètes de la cour de Rome, pas un mot. Ce dernier point cependant, vous
auriez dû au moins essayer de le détruire ; car l'immixtion du Saint-Office
dans cette affaire achève de lui imprimer un caractère incontestable de persécution
religieuse. Les démarches des Arméniens, vous
contentez-vous de dire, n'amenèrent aucun résultat,
par suite de l'habileté diplomatique de Ferriol et du cabinet qu'il
représentait. Ô euphémisme admirable ! vous m'accusez, R. Père, d'être
bien sévère pour les diplomates de mon pays. Je m'en voudrais beaucoup
d'avoir nommé habileté diplomatique cette suite de mensonges impudents, de
scènes burlesques, ces envois successifs des Arméniens tantôt à Messine,
tantôt à Rome, tantôt en Espagne, partout enfin où Avedick n'était pas ; cet
empressement à accuser de l'enlèvement les Anglais et les Hollandais ; ces
dépêches mensongères, contradictoires, passionnées, par lesquelles Ferriol
calomniait pour détourner les soupçons et demandait une répression cruelle
pour satisfaire sa haine ! Je m'en voudrais beaucoup, d'avoir nomme habileté diplomatique du cabinet français la
conduite de Louis XIV faisant dresser après la mort d'Avedick un acte,
honteux témoignage d'hypocrisie, dans lequel est attestée la douleur du roi ;
dans lequel Avedick est nommé un disgracié dont on a ignoré les infortunes, et qu'on a mis en liberté dès qu'on a su son nom et sa
qualité ! J'appelle habileté diplomatique — et celle-là, je l'ai
exposée, je l'ai louée avec joie — les efforts, couronnés de succès, d'un
Polignac, parvenant en Pologne à élever sur le trône le prince de Conti, ou
luttant, avec sa seule fermeté et son admirable présence d'esprit, contre les
insolentes prétentions de la Hollande et de l'Empire. De cette habileté
diplomatique, notre histoire compte, grâce à Dieu, de nombreux, de brillants
exemples, et il n'est point nécessaire d'excuser quelques tristes exceptions telles
que celle qu'offre la carrière de Ferriol. Les méconnaître serait
non-seulement mentir à toute vérité, mais encore justifier le reproche de
trop étroit patriotisme que nous adressent si souvent les étrangers. Vous
souhaitez qu'on retrace après moi le portrait de cet ambassadeur extravagant[5]. Mais qui, sinon vous-même, consentira à oublier
ses fautes, à cause de la protection efficace
dont il vous a entourés ? Comme jésuites,
dites-vous, nous ne perdrons jamais le souvenir de
ce qu'il a fait pour nous. Rien de mieux, et cette gratitude est fort
naturelle. Mais veuillez ne pas exiger que d'autres que vous la partagent, à
moins qu'avoir protégé les jésuites mette désormais un diplomate à l'abri des
sévérités de l'histoire. Le souvenir des bienfaits de Ferriol est même si
puissant sur vous, qu'il échauffe votre style et vous dispose aux
objurgations et aux apostrophes. Pauvre Ferriol !
vous écriez-vous, non sans éloquence, si au lieu de
vous en prendre à un schismatique, vous aviez fait mettre dans un cul de
basse-fosse le P. Braconnier, le P. Tarillon, le P. Hyacinthe, et autres
jésuites, on vous regarderait comme un bienfaiteur de l'humanité ! Le
mouvement est beau, mais la supposition fort invraisemblable ; car, pendant
le règne de Louis XIV du moins, je vous aperçois toujours du côté des
puissants et des persécuteurs. Par ce qui précède, nos
lecteurs ont déjà dû surprendre votre tactique. Elle consiste à présenter le
fait principal en quelques lignes, à qualifier par des euphémismes des actes que
tout esprit non prévenu flétrira avec indignation, puis à détourner
l'attention sur des points secondaires. Mais je veux vous suivre dans cette
voie, si tortueuse que vous l'ayez faite, et après avoir remis en lumière ce
que vous avez obscurci ou ce dont vous avez détourné la tête, montrer qu'il
n'y a rien dans votre article — rien, l'entendez-vous, mon père ? — à quoi je
ne puisse répondre victorieusement. Vous signalez le mot de
vieillard appliqué à Avedick, et vous m'opposez son extrait mortuaire,
indiquant l'âge de cinquante-quatre ans, ou environ. Ces derniers mots
autorisent à faire des recherches plus complètes sur son âge réel. Dans
l'Histoire de l'Empire turc d'Hammer, j'ai acquis la certitude que cet âge
était nécessairement plus avancé. C'est à Erzeroum, où il avait été cadi, que
le muphti Feizoulah-Effendi s'était lié avec Avedick, qui devint son protégé.
Or l'année assignée par Hammer au séjour du muphti dans cette ville m'a
conduit à conclure qu'Avedick était sexagénaire à l'époque de son enlèvement.
Puis-je maintenir le mot vieillard ? Vous me reprochez d'avoir
représenté Avedick disant la messe à Saint-Sulpice, et vous ajoutez : M. Topin cite à l'appui la déclaration authentique de
Pétis de la Croix[6]. Vous avez mal lu, R. Père, la note 5, p. 845, de
mon article, et là où j'invoque les Registres des
convoys et enterrements à l'église paroissiale à Saint-Sulpice, à Paris, extrait délivré par le sieur de la Chétardye, curé, le
14 août 1711, vous lisez : Déclaration
authentique de Pétis de la Croix. Or cet extrait porte : Durant les sept mois qui ont précédé sa mort, le sieur
Avedick a assisté à tous les offices de Saint-Sulpice, y a communié, y a
célébré la messe, etc., etc. Puis-je maintenir les mots :
Saint-Sulpice ? Non moins nettement vous
affirmez que je me sers de la déclaration authentique de Pétis de la Croix
pour établir les suggestions dont Avedick a été l'objet à la Bastille. Vous
avez encore mal lu, mon Père, et c'est au membre de phrase suivant : On lui donna des livres arméniens, que se rapporte
la note 2 de la page 843. Mais la page VII du tome II de la correspondance
administrative sous Louis XIV, publiée dans les Documents inédits sur
l'histoire de France, renferme ce qui suit : Avedick
fut conduit à la Bastille, toujours sous le plus grand secret. Là, cet
Arménien fit des réflexions, ou plutôt on lui en suggéra. Que Pétis de
la Croix ait dit le contraire, c'est possible. Louis XIV et son gouvernement
avaient un grand intérêt à faire raconter la conversion d'Avedick à leur
manière, et ce, acte mensonger dressé par d'Argenson, sur les ordres de
Pontchartrain, acte dont j'ai parlé tout à l'heure, et dont vous n'avez pas
dit un mot, cet acte, dis-je, prouve jusqu'à l'évidence l'hypocrite
dissimulation manifestée par Louis XIV après la mort d'Avedick. J'accorde une
bien plus grande confiance à l'affirmation d'un homme aussi consciencieux que
Depping, et dont l'opinion est fondée sur l'examen de toutes les dépêches
administratives sous Louis XIV. Or il déclare qu'il y a eu suggestion.
Puis-je maintenir le mot suggestion ? A propos du monophysisme,
d'Eutychès et de ses adhérents, vous vous livrez à une savante dissertation
sur une erreur de définition que j'aurais commise. Mais vous vous gardez bien
de dire que j'invoque l'opinion de M. Dulaurier, de l'Institut, si
universellement accepté pour sa parfaite compétence en ce qui concerne les
Églises arméniennes. Nous croirions faire tort à nos
lecteurs, vous écriez-vous, en les privant du
résultat inattendu auquel est parvenu M. Topin. Vous avez de nouveau
mal lu, mon Père. Le doute n'est pas possible. Après avoir nommé l'excellent
ouvrage de M. Dulaurier : Histoire, dogmes, traditions et liturgie de
l'Église arménienne et orientale, j'ajoute : Ce
livre combat l'opinion généralement admise, etc., etc. Mais c'est
moi-même qu'il fallait à tout prix surprendre en erreur, et vous n'avez pas
hésité. Une de vos plus dédaigneuses
attaques est celle qui a trait à l'ordination d'Avedick. Vous prenez en pitié
mon ignorance des choses ecclésiastiques, et vous comprenez dans vos
railleries Quesnel et le cardinal de Noailles, qui ne s'attendaient pas à se
trouver en pareille affaire. Ce qui prouve que cette maxime de l'oubli des
injures, que vous disiez tout à l'heure être propre aux jésuites, peut
souffrir, au moins de votre part, quelque exception. Tandis que vous
contestez la science théologique du cardinal, vous me renvoyez au catéchisme.
Je vous renvoie, avec moins de dédain que vous ne le faites, à l'excellente
collection de la correspondance administrative sous Louis XIV, dont la page
ix porte ce qui suit : Le 25 septembre 1710, Avedick
fit une abjuration publique entre les mains du cardinal de Noailles, et fut
même sacré prêtre dans l'église Notre-Dame de Paris. Que cette
ordination, si elle a eu lieu, ait été une monstruosité, une erreur capitale,
une violation flagrante des règles canoniques, liturgiques et théologiques,
je n'essaye pas de le nier, et je me félicite même de l'avoir appris de vous. En tout cela, très-révérend
Père, et de nous deux, qui a mal lu, qui a mal jugé ? J'ai fait le récit des
cinq années qui ont précédé et de tout ce qui a suivi l'enlèvement d'Avedick
; je l'ai composé d'après plus de cent dépêches émanant des ambassadeurs
français à Rome et à Constantinople, de Pontchartrain, de Torcy, du cardinal
Janson, de Louis XIV, et pour la plupart jusqu'ici inédites. Ces dépêches,
vous les avez eues entre les mains, et je m'en félicite en loyal
contradicteur. Vous les avez lues et relues après moi, et vous ne pouvez
adresser à mon récit que le reproche, reçu par moi comme un éloge, d'être un peu dramatisé. Mais où sont les altérations,
où les lacunes ? Je viens de faire justice de quelques-unes de vos
accusations secondaires, et je vais détruire les autres. Mais y a-t-il sur
l'enlèvement du patriarche possibilité d'émettre un autre jugement que le
mien ? Cet enlèvement a été un
crime, et un crime inutile, puisque Avedick vivait en paix avec les
catholiques quand on l'a déposé, et un crime désastreux pour ses auteurs,
puisqu'il a eu comme conséquences immédiates ce qu'entraîne toujours la
violence, des représailles terribles. Voyons maintenant quelle est dans cet
acte la part de responsabilité des jésuites de Constantinople. IIISi, le premier, j'ai pu
raconter jusqu'à la mort d'Avedick l'histoire de son séjour en France, je
suis loin d'être le premier qui ai parlé de l'enlèvement du patriarche.
L'historien allemand Hammer, Taulès, Dufey de l'Yonne, Depping, M. Ubicini,
M. E. Beauvoir et M. P. Lacroix ont eu tour à tour à se prononcer sur la
participation des jésuites à cet enlèvement. Trop
faible, dit Hammer[7], pour résister aux
instances des jésuites, et cédant à leur influence, Ferriol fit saisir Avedick, etc., etc. — Je n'ai
pas besoin de citer l'opinion de Taulès, que vous savez bien être la même. L'enlèvement d'Avedick, dit Dufey de l'Yonne[8], avait été conçu et
dirigé par le P. Braconnier, jésuite à Constantinople, et le P. Tarillon,
jésuite à Chio. — Le gouvernement,
dit Depping[9], avait sans doute ordonné
l'arrestation d'Avedick, dont M. de Bonnat, consul de France à Chio, et deux
Pères jésuites, les nommés Braconnier et Tarillon, eurent les premiers
l'idée, et dont M. de Ferriol, ambassadeur prés de la Porte ottomane, dirigea
l'exécution. — On soupçonna, non sans de fortes
apparences, dit M. Ubicini[10], les jésuites établis à
Chio et à Galata d'avoir dirigé ce coup de main avec la participation secrète
de l'ambassadeur de France. — A l'instigation
des jésuites, dit M. Beauvoir[11], Ferriol fit enlever à
Chio le patriarche arménien Avedick ; et l'auteur anonyme d'un article
sur Avedick, inséré dans la Biographie Didot[12], dit : Les jésuites le
firent enlever sur un bâtiment français. Enfin M. P. Lacroix s'exprime
ainsi : Le patriarche fut exilé et enlevé à la
sollicitation des jésuites[13]. Voilà donc huit écrivains,
les seuls qui se soient occupés de ce sujet jusqu'à ce jour, et qui tous font
participer les jésuites à l'enlèvement du patriarche. Mais Hammer est à vos
yeux un compilateur sans autorité ; Taulès un
pamphlétaire, et vous ne dites pas un mot des autres. Cette unanimité dans les
opinions de mes devanciers est, déjà, ce me semble, significative, et
beaucoup d'historiens, très-justement estimés, croient suffisamment établie
une affirmation qu'ils étayent d'aussi nombreuses et aussi diverses
citations. Je n'ai point voulu le faire, composant mon récit d'après des
pièces authentiques et manuscrites. Je vais donc les discuter avec vous. J'ai cité une dépêche de
Ferriol à Torcy dans laquelle l'ambassadeur se plaint des missionnaires
catholiques. La plupart des missionnaires,
dit-il, ne s'en tiennent point ici à leurs
fonctions. Ils veulent tous passer pour des ministres ; ils se croient plus
éclairés que les ambassadeurs, et l'ordre de chaque état est ainsi renversé.
Ces bons Pères, qui ne devraient aller qu'au bagne et chez les chrétiens
établis dans le pays, ne laissent pas de voir les puissances et d'imposer à
tout le monde en matière de politique. Lorsqu'un ambassadeur veut les réduire
dans les limites qui semblent leur être prescrites, ils le traitent d'homme
sans religion, qui sacrifie tout à son ambition. Vous essayez
d'expliquer cette dépêche, et comme toujours, vous en négligez le point
important. Vous dites, non sans vous rendre justice, qu'il
n'y a pas d'impossibilité manifeste à trouver des missionnaires plus éclairés
que les ambassadeurs. Au reproche de voir les puissances, vous objectez
que c'est fort naturel, quand les missionnaires
n'ont pas pu obtenir par l'intermédiaire du représentant de la France ce
qu'ils désirent. Et vous ajoutez : Où est
donc le crime si noir ? Il n'est pas là assurément ; mais vous vous
gardez bien d'expliquer la fin de la dépêche. Traiter
d'homme sans religion et plein d'ambition l'ambassadeur qui veut vous réduire
dans les bornes qui vous semblent être prescrites, n'est-ce point
là de la calomnie ? Il est vrai que les jésuites ne sont pas spécialement
désignés, mais ils ont tout au moins une part de ces reproches, puisqu'ils
faisaient partie des missionnaires catholiques d'Orient. Vous ne sauriez le
nier, et quand je vois que cette dépêche, nettement accusatrice, est
postérieure à un débat de Ferriol avec le P. Braconnier, jésuite, débat dans lequel l'ambassadeur a
rencontré chez ce Père une résistance invincible à de très-louables
tentatives de conciliation, ne suis-je pas fondé bien davantage encore à
croire que les jésuites ont eu au moins leur part dans les reproches de
Ferriol ? Cette résistance invincible
du P. Braconnier, jésuite, vous ne pouvez la contester. Ici surtout se
manifeste l'opposition radicale des points de vue auxquels nous nous plaçons.
Dans ce débat, Ferriol intervenait en personnage politique et l'historien doit
le considérer sous cet aspect. Le P. Braconnier restait théologien inflexible
dans sa foi, et c'est en théologien, aussi inflexible dans vos croyances, que
vous défendez sa conduite. Pour un théologien,
dites-vous, la position était claire : le P. Braconnier
devait maintenir les principes. Ce à quoi je ne saurais trop vous
objecter que, lorsqu'il s'agit d'une conciliation, les concessions doivent
être réciproques. Ferriol, vous le reconnaissez vous-même, cherchait, de la meilleure foi du monde, à établir un modus
vivendi entre des intérêts inconciliables, dites-vous. Mais
c'était vous seuls qui les rendiez inconciliables par votre opiniâtreté. La
concession n'eût pas été cependant bien compromettante, puisqu'il ne
s'agissait que de tolérer, comme cela s'était fait autrefois, la présence des
Arméniens catholiques dans les églises des Arméniens schismatiques. Vous
m'opposez M. Ubicini, dont vous acceptez ainsi, et avec raison, la
compétence. Mais vous vous êtes bien gardé d'en transcrire la page suivante : L'Église
arménienne de Constantinople[14] était alors (1700) en proie à de
violentes discordes que le zèle intolérant des missionnaires européens
avaient allumées. Aux voies de douceur et de persuasion que ces
missionnaires, dont le nombre allait croissant à Constantinople, avaient
suivies jusqu'alors et qui avaient ramené un grand nombre de dissidents,
succéda, par une déplorable erreur, une propagande furibonde dont l'effet
immédiat fut d'arrêter le mouvement qui commençait à se manifester vers
l'unité catholique. Ils choquèrent ouvertement les dissidents,
rapporte M. Boré[15], en interdisant aux catholiques l'entrée
de leurs églises, qu'ils représentaient comme le sanctuaire de Satan, et en
attaquant la liturgie et les pratiques de l'ancienne Église arménienne. On
refusa l'absolution à quiconque contrevenait à cet ordre. Les catholiques,
trop disposés à s'éloigner de leurs frères, prirent tellement en horreur
leurs églises, qu'en passant devant la porte ils détournaient la tête par
mépris comme si c'eût été une pagode d'idolâtres, On renouvela toutes les
disputes assoupies depuis plusieurs siècles touchant le pape Léon et le
concile de Chalcédoine. De leur côté, les partisans du patriarche
intriguaient vivement contre les missionnaires, qu'ils dépeignaient à l'autorité
civile comme des conspirateurs soudoyés par les cours d'Occident. Vous consentez à donner la
dépêche de Ferriol au P. Fleuriau, dans laquelle il se plaint très-vivement
de la conduite du P. Braconnier, jésuite. Mais le passage, que vous en citez[16], est incomplet. Le voici intégralement reproduit
avec vos omissions soulignées. Ce qui m'a
fasché dans cette-occasion est que le P. Braconnier n'a jamais voulu entendre
parler d'accommodement, disant que l'Église avait souffert de plus grandes
persécutions, que les Arméniens devaient souffrir, qu'ils en seraient quittes
pour de l'argent et que la persécution cesserait tost ou tard. J'ay eu beau
luy faire voir qu'elle estait générale dans tout l'empire ; que le Grand
Seigneur pouvait y ajouter des ordres plus sévères et qui pourraient porter
un coup mortel à la religion par le peu de fermeté des catholiques, et qu'il
estait permis d'arrêter une persécution quand on le pouvait sans intéresser
la religion et sans l'offenser ; qu'estant ici l'ambassadeur du roy, protecteur
de tous les chrétiens d'Orient, je devais les défendre et leur procurer le
repos ; que je n'avais rien à me reprocher sur la conduite que j'avais tenue
pour y réussir, et que si S. M. me donnoit des ordres plus forts, je les ferois
entendre à la Porte sans foiblesse et sans crainte[17]. Le P. Braconnier a
toujours esté du sentiment que les catholiques ne pouvaient plus retourner
dans les églises arméniennes, ny avoir aucune communication avec leurs frères
; qu'ils devaient plutôt souffrir toutes les persécutions du monde ; de
sorte que les autres théologiens ayant esté d'un sentiment contraire, on a
travaillé à un accommodement qui ne laisse pas de souffrir encore quelques
difficultés par tous les obstacles qu'on y apporte. Ainsi il est incontestable
que c'est un Père jésuite qui a fait avorter les louables efforts tentés par
Ferriol sinon pour amener l'union des deux Églises, du moins pour faire
disparaître des causes incessantes de querelles et d'animosité. Vous vous irritez de ce que
je constate à satiété que seulement de très-légères
divergences dans le dogme séparaient les Arméniens schismatiques de la
communion romaine. Ce n'est pas sans motif que je l'ai dit et que je
le répète. Il est certain, en effet, et c'est vraiment étrange, que, soit
dans la polémique soit dans les luttes religieuses, vous êtes d'autant plus
impitoyables et vifs que vos adversaires sont moins éloignés de vous. Je n'en
.veux pour preuve que la manière dont vos amis combattent cette fraction
libérale de catholiques dont vous ne pouvez cependant nier la foi
inébranlable, qui compte dans son sein des prêtres illustres, des évêques
éloquents, et, dans les lettres, tant d'illustrations éminentes, dont la voix
se fait entendre en ce moment en Allemagne et parviendra jusqu'à Rome, et à
laquelle appartient, il faut l'espérer, l'avenir du catholicisme ! Sauver des
idolâtres, dites-vous, M. Topin l'accepte, mais des schismatiques ! son cœur et
sa raison s'y refusent également. Y a-t-il, dans mon article, un seul
membre de phrase qui vous autorise à parler ainsi ? Quand, où, en quels
termes ai-je blâmé le Saint-Siège de vouloir ramener à la communion romaine
toutes les Églises d'Orient ? Ce que je réprouve, c'est la maladroite
opiniâtreté d'un P. Braconnier, jésuite, qui a rendu possibles de longues
persécutions. Ce que je réprouve, c'est la violence d'un enlèvement qui a
amené de terribles représailles. Nous voici parvenus à la
partie essentielle de ce débat. Une pièce irréfragable, le mémoire du marquis
de Bonnac, atteste la part que deux jésuites ont eue à cet enlèvement ; le P.
Braconnier, en le conseillant ; l'autre, le P. Tarillon, en en dirigeant
l'exécution. Ce mémoire étant la base fondamentale de l'accusation que je
porte, vous en niez l'authenticité, et vous le faites en essayant de
m'opposer à moi-même. A la suite d'un premier
article, dans lequel j'ai essayé d'établir que l'Homme au masque de fer ne
peut pas être un fils d'Anne d'Autriche, il m'a été demandé pourquoi je n'avais pas fait mention d'un Mémoire de M. de
Saint-Mars sur la naissance de l'Homme au masque de fer publié dans le
tome III des Mémoires de tous. Suivant ce document, qui aurait été copié
aux archives du ministère des affaires étrangères, M. de Saint-Mars avait
été le gouverneur du fils mystérieux d'Anne d'Autriche, à qui on cachait avec
soin sa haute origine. Je répondis que cette pièce est une copie de la
relation apocryphe de Soulavie, déjà réfutée, et j'ajoutai : Quant à la présence de ce document dans les archives des
affaires étrangères, il n'y a point lieu de s'en étonner. Elle s'explique
comme la présence dans nos archives de tant d'autres documents, par la saisie
de papiers de grands personnages faite après leur mort, ou plus ordinairement
encore, par l'envoi d'un des ambassadeurs français habitant le pays où
circulaient ces pièces apocryphes. Mais le lieu où elles se trouvent ne leur
donne aucune authenticité. De tout temps et aujourd'hui encore, les
ambassadeurs envoient à leur gouvernement la copie de mémoires anonymes, de
pamphlets, de pièces diverses, qui reste jointe à leurs dépêches, mais à
laquelle on ne saurait attribuer aucune valeur historique. Pour détruire
l'authenticité du mémoire du marquis de Bonnac, ambassadeur à Constantinople,
vous m'opposez aujourd'hui ces paroles, et comme elles vous semblent
favorables à votre cause, vous vous empressez de les
déclarer fort judicieuses et de reconnaître que je suis souvent aussi
heureux, quand je me trouve sur mon terrain. Sans vous savoir gré de
ces éloges fort intéressés, je vais essayer de les mériter. Ce prétendu mémoire de M.
de Saint-Mars est apocryphe, parce qu'il est écrit correctement, ce dont
était incapable Saint-Mars ; parce que tous les détails qu'il donne sont
infirmés par une foule d'autres documents ; enfin parce que Saint-Mars se
trouvait à Exiles, commandant du fort, à l'époque où on le montre gouverneur
du fils d'Anne d'Autriche. L'authenticité du mémoire
de Bonnac, au contraire, peut être établie par trois sortes de preuves : 1°
par la série où il est classé dans les archives du ministère des affaires
étrangères ; 2° par l'exactitude des faits qu'il retrace — autres, bien
entendu, que celui faisant l'objet du débat — ; 5° par l'impossibilité
matérielle où aurait été un faussaire de le rédiger. De tout temps il a été
d'usage, au ministère des affaires étrangères, de demander aux représentants
français des mémoires sur la situation politique des pays près desquels ils
étaient accrédités, ou qu'une courte mission les appelait à visiter.
Quelquefois encore, on les chargeait du soin de rédiger un rapport sur
certaines affaires délicates, entièrement terminées avant leur arrivée, et
qu'ils appréciaient d'autant mieux qu'ils n'y avaient joué eux-mêmes aucun
rôle. En outre, sous l'ancienne monarchie, plusieurs représentants du roi
avaient coutume, au moment de finir leur mission et de retourner en France,
d'envoyer au souverain un long mémoire fort détaillé sur les faits principaux
et saillants de leur ambassade. On comprend l'importance que donne aux
archives des affaires étrangères la réunion de ces mémoires en général fort
bien rédigés, impartialement écrits et dans lesquels on retrouve l'esprit,
les mœurs, les traditions, le mouvement et la vie de toutes les nations. A cause
de leur importance particulière, ces mémoires sont réunis en une catégorie
spéciale portant le titre de Mémoires et documents et ayant une série
de numéros distincte, et par pays. De cette manière, les directeurs peuvent,
selon qu'ils le jugent convenable, communiquer au public la série des dépêches
et ne pas montrer la série de mémoires et documents, quelquefois bien
plus curieuse, en ce qu'elle contient une expression moins réservée et plus
libre de la vérité. C'est à cette seconde série qu'appartient le mémoire du
marquis de Bonnac. Quant aux pamphlets, aux
factums, aux libelles publiés dans les pays étrangers contre le gouvernement
français, les ambassadeurs les joignent, en original ou en copie, à leurs
dépêches auxquelles ces pièces restent annexées. Isolées, elles pourraient
induire grossièrement en erreur. Demeurant jointes aux dépêches d'envoi,
elles conservent bien mieux encore leur caractère diffamatoire et n'offrent
plus aucun danger. C'est dans cette catégorie qu'a dû être placée, je le
suppose, la relation apocryphe attribuée à Saint-Mars, si tant est qu'elle ait
jamais existé au ministère des affaires étrangères, où personne ne l'a jamais
vue, à l'exception de celui qui a dit l'y avoir copiée. Quoi qu'il en soit,
c'est de ce genre de pièces que j'ai dit, et je le répète : Le lieu où elles se trouvent — à savoir les
Archives des affaires étrangères — ne leur donne
aucune authenticité. Mais vouloir appliquer
cette observation à la longue série de mémoires et documents qui contribue
presque autant que les dépêches officielles à faire l'importance
exceptionnelle de ces archives, c'est, je ne dirai pas aussi dédaigneusement
que vous, témoigner d'une étrange ignorance, — je la trouve au contraire fort
naturelle en ces matières spéciales, — mais c'est tomber dans une grande
confusion. En outre, en lisant avec soin, non-seulement tout ce qui, dans le mémoire du marquis de Bonnac, précède ou suit l'épisode de l'enlèvement d'Avedick, mais encore les circonstances de cet enlèvement, on s'aperçoit que l'exactitude du narrateur est confirmée par toutes les dépêches de Ferriol que vous n'avez pas .contestées. C'est le vice-consul Bonnal qui est le principal acteur de l'attentat, c'est à Chio qu'il a eu lieu, c'est sur un bâtiment français qu'Avedick est emmené. On voit ensuite, dans le même mémoire, le chiaoux qui a conduit Avedick à Chio, arrêté, mis à la question, avouant l'enlèvement ; puis un ordre envoyé au vice-consul Bonnal pour qu'il soit interrogé[18]. Et vous voulez que tous ces points étant exacts, celui-là seul ne le soit pas, qui fait participer à l'enlèvement deux jésuites ? Enfin, si ce document est
une pièce fausse, expliquerez-vous comment elle a pu être faite ? Taules est
le premier qui ait parlé en France de l'enlèvement d'Avedick, et il l'a fait
d'après une copie de ce mémoire, ou d'après ce mémoire lui-même. Mais, ce
secret d'État ayant été- jusque-là ignoré de tous, où un faussaire aurait-il
puisé les éléments nécessaires du récit ? où aurait-il appris tant de
circonstances qui, je ne saurais trop le répéter, sont exactes ? En supposant
qu'il ait eu l'intention de fabriquer un pamphlet contre votre Ordre, qui lui
aurait tout à coup révélé l'enlèvement d'Avedick et inspire la pensée de vous
y faire participer ? Mais ces considérations
décisives, vous les avez évitées, et vous essayez d'ébranler la solidité de
ce document, tantôt en disant qu'il n'est pas écrit de la main même du
marquis de Bonnac, comme si cela pouvaient infirmer les assertions[19] ; tantôt en le rapprochant d'une dépêche dans
laquelle Bonnac se prononce contre le retour à Constantinople du père
Tarillon, se fondant sur ce que l'enlèvement d'Avedick a eu lieu à l'instigation
de ce missionnaire, à ce qu'on prétend. Vous vous rattachez à ce doute ainsi
exprimé, et vous voudriez en triompher comme d'une certitude. Mais cette
dépêche a été écrite le 12 novembre 1716, c'est-à-dire un mois après
l'arrivée à Constantinople du marquis de Bonnac[20]. Y a-t-il lieu de s'étonner qu'alors il se soit
exprimé avec circonspection sur un événement qu'il n'avait pas encore assez
étudié ? A travers ces ménagements, indiqués par ces mots : A ce qu'on prétend, on voit déjà percer
toutefois l'opinion réelle de l'ambassadeur, 'puisque sa lettre est destinée
à empêcher d'une manière formelle le retour à Constantinople d'un des acteurs
du drame le Chio[21]. Mais, dans le mémoire, écrit ou dicté par lui peu
importe, le marquis de Bonnac a eu à se prononcer d'une manière définitive
sur un événement que seul il pouvait raconter avec impartialité, car son
prédécesseur, le comte Désalleurs, avait eu de longs démêlés avec Ferriol,
auquel il avait immédiatement succédé. Le mémoire du marquis de
Bonnac[22] est donc la base inébranlable de mon accusation, la
base indiscutable ; car il ne suffit pas de dire à la légère qu'un document
est un pamphlet : il faut expliquer comment a été écrit ce pamphlet. Or vous
ne le pouvez. En outre, ce document renferme tous les signes caractéristiques
de la vérité. Il porte ce qui suit : les Arméniens catholiques, à force d'argent, trouvèrent
moyen de faire exiler Avedick. Cela fait, par le moyen du père Braconnier,
jésuite, qui était à Constantinople, et par l'entremise du père Tarillon,
autre jésuite qui était à Scio, ils imaginèrent que, pour s'en défaire
entièrement, il fallait gagner le chiaoux, etc. etc. Outre ces deux coupables,
incontestablement jésuites, il est un autre missionnaire, le P. Hyacinthe,
qui a aussi conseillé l'enlèvement. Bien dans les pièces que j'avais à ma
disposition, ne me révélant l'Ordre auquel il appartenait, je l'ai toujours
prudemment désigné sous le nom générique de missionnaire catholique. Cette
prudence ne peut trouver grâce à vos yeux. Vous m'accusez d'avoir cru et
insinué que le P. Hyacinthe était un père jésuite, et vous vous donnez ainsi
un triomphe facile en proclamant que c'est un père capucin. Votre
raisonnement est si caractéristique que je crois devoir le citer : Dans cet épisode douloureux du règne de Louis XIV,
avais-je dit, les jésuites n'ont leur part de
responsabilité que par la pression qu'ils ont exercée sur Ferriol. — Or, ajoutez-vous, comme
dans la dépêche où Ferriol parle des conseils qu'il a reçus, le P. Hyacinthe
est seul nommé, le P. Hyacinthe est pour M. Topin un jésuite en chair et en
os. Cet argument serait acceptable, s'il n'y avait pas d'autre preuve
de l'intervention des jésuites que la dépêche de Ferriol qui nomme le P.
Hyacinthe. Mais le mémoire du marquis de Homme, ce mémoire accablant, cette
preuve irrécusable, vous la négligez, suivant toujours la même tactique, et,
plaçant sous mon accusation une base .que je ne lui avais pas donnée
moi-même, il vous est aisé de faire tomber l'une, en supprimant l'autre.
Bientôt aggravant ce que je me contenterai d'appeler une inadvertance, et la
poussant jusqu'à ses dernières limites, vous osez affirmer que j'ai nommément incriminé le P. Hyacinthe comme jésuite.
Mais comment lisez-vous donc, T. R. Père, et où avez-vous vu une pareille
chose ? J'ai incriminé le P. Hyacinthe sans jamais le désigner comme jésuite,
et si sur votre Ordre tombe ma principale accusation, c'est que le P.
Braconnier, conseiller, et le P. Tarillon, conseiller et complice de
l'enlèvement étaient deux jésuites. J'ai répondu à vos attaques
et j'ai montré qu'elles reposent sur ce que je peux continuer à nommer vos
inadvertances. En tout cela lequel de nous deux a mal lu pour mieux accuser ?
quel est le texte que j'ai faussé ? quelle est l'omission calculée ou
involontaire que j'ai commise ? Vous me reprochez de n'avoir donné
qu'incomplètement les instructions, adressées à Ferriol au moment de son
départ pour Constantinople, et vous vous contentez de parler de deux phrases
dont la première est l'éloge de votre Ordre, et je l'ai citée, et dont la
seconde est un blâme infligé aux missionnaires d'un zèle inconsidéré. Comment
pouvez-vous supposer que j'aie été assez inintelligent pour vouloir faire
retomber sur vous seuls le blâme, venant de citer une phrase élogieuse sans
réserve ? Comment pouvais-je donner tout entières des instructions que vous
reconnaissez être fort longues, et pourquoi négligez-vous de dire : 1° qu'au
commencement de mon travail j'en ai résumé quelques points : 2° que dans ce
que j'ai été contraint d'omettre il n'y a rien qui ait trait aux
missionnaires ? Vous me blâmez d'avoir
omis, dans la dépêche de Ferriol relative au P. Hyacinthe, la partie où
l'ambassadeur avoue qu'il est lui-même le principal auteur de l'enlèvement,
Votre reproche serait mérité si, dans mon article, j'avais disculpé Ferriol
au détriment des jésuites ; mais vous reconnaissez vous-même que je n'ai rien
dissimulé de la responsabilité qui lui incombe dans cet enlèvement. Dans quel
intérêt aurais-je donc négligé par calcul de citer le commencement de cette
dépêche qui corrobore l'accusation que j'ai nettement portée contre Ferriol ?
Je n'en ai donné que la fin, parce que la fin seule concernait le P.
Hyacinthe, et que le sens n'en était nullement modifié par les premières
phrases. Et puis c'est tout. Je
relis votre réponse et je vois qu'il n'en reste rien. De la prétendue erreur
commise sur la mort de Taules, et si longuement étalée par vous dans vos
premières pages, rien. De vos efforts pour justifier Ferriol et pour pallier
une incontestable violation du droit des gens, rien encore. De toutes ces
accusations secondaires habilement groupées et réunies en faisceau, rien non
plus. De vos essais de diversion et de votre tentative pour éloigner le débat
du point capital, c'est-à-dire du mémoire du marquis de Bonnat, rien,
absolument rien. Et maintenant, T. R. Père,
laissez-moi vous dire que je méritais mieux de vous. Vous voulez bien
reconnaître que je n'ai pas sciemment faussé l'histoire.
Mais votre article est tel qu'après l'avoir lu vos amis ont presque le droit
de m'adresser ce reproche, et ils en ont usé. Voici donc un écrivain à qui
ses premiers ouvrages devaient valoir tout au moins quelques égards, qui a
soutenu parfois des causes qui vous sont chères, non assurément pour ce
motif, mais parce qu'elles lui sont chères à lui aussi. Il l'a fait avec
conscience et honnêteté. Mais voilà qu'il touche à un événement auquel votre
Ordre a été mêlé. Aussitôt cet écrivain cesse d'être consciencieux, et vos
amis vont disant que sa réputation historique est fort compromise. C'est qu'à
vos yeux l'intérêt de l'Ordre est supérieur à tout. Eh bien, permettez-moi de
vous le dire, vous l'avez mal servi en cette circonstance. Je ne nie pas votre
droit de défense, mais j'en conteste l'opportunité. Cet épisode de
l'enlèvement d'un patriarche aurait passé inaperçu dans mon étude des
prisonniers d'État sous Louis XIV ; mais vous avez appelé l'attention sur
lui, et vous lui avez donné ainsi une importance qu'il n'aurait pas eue sans
vos attaques. Le silence eût donc été préférable. Vous terminez votre
réponse. en reconnaissant ma bonne foi ; je ne veux pas finir la mienne par
des récriminations. Vous me représentez en ennemi égaré parles préventions ; je
ne veux voir en vous qu'un contradicteur, sincèrement convaincu de
l'innocence de son Ordre, mais trop intéressé dans le débat pour rester
impartial, et réduit à des procédés de discussion qu'il eût sans doute
dédaignés si sa cause eût été meilleure. J'ai l'honneur, etc. MARIUS TOPIN. |