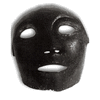L'HOMME AU MASQUE DE FER
CHAPITRE II.
|
Première hypothèse. — Portrait de Buckingham. — Causes de son voyage en France. — Empressement avec lequel il y est reçu. — Sa passion pour Anne d'Autriche. — Caractère de cette princesse. Voyage à Amiens. — Scène du jardin. — Quel est le souvenir qu'en conserva Anne d'Autriche. Le duc de Buckingham, chargé par Charles Ier de conduire à Londres la nouvelle reine d'Angleterre, Marie-Henriette, arriva à Paris le 24 mai 1625[1]. Ce brillant et audacieux gentilhomme, qui avait su devenir et rester le favori dominateur de deux rois très-divers de caractère et d'esprit, et qui, d'une situation très-humble s'était élevé aux plus hautes charges de l'État, jouissait dans toute l'Europe de la plus éclatante renommée. Il la devait moins encore aux faveurs dont l'avait comblé Jacques e et que lui continuait son fils, qu'à ses qualités séduisantes et à ses romanesques aventures. Tout ce que la nature peut donner de grâce, de charme, d'agréments, il l'avait reçu avec profusion. Dépourvu des dons plus précieux qui retiennent, il possédait tous ceux qui attirent. Il était bien fait, très-beau de visage[2], fier d'allures sans être hautain, et sachant affecter, selon les circonstances, l'émotion qu'il voulait communiquer à autrui, mais qu'il n'éprouvait pas lui-même. Durant un assez long séjour en France, il avait achevé de rendre exquises des manières naturellement délicates, et il était devenu accompli dans tous les arts où se déploie l'élégance du corps. Il excellait aux armes, se montrait adroit cavalier et il dansait avec une perfection rare. L'aventureux voyage fait eu Espagne avec le prince de Galles[3] avait accru sa réputation d'élégante frivolité, et les succès que lui avaient valus sa beauté et son audace faisaient oublier les échecs du négociateur inconsidéré. Déjà prodigue dans sa pauvreté première, il dissipait sa fortune comme s'il avait toujours vécu dans l'opulence pour laquelle il semblait né, étalant une magnificence et un faste avant lui inconnus à ce degré. D'ailleurs, léger et présomptueux, mobile autant que souple, sans profondeur dans les sues, sans suite dans les projets, ha- bile à se maintenir au pouvoir, mais funeste aux souverains qu'il gouvernait, tour à tour familier avec insolence et séducteur irrésistible, tantôt admiré de la foule pour sa distinction suprême, tantôt exécré pour son autorité fatale, point bas mais impétueux dans ses caprices, ne sachant ni prévoir ni accepter un obstacle et sacrifiant tout à sa fantaisie, il ne possédait aucune des qualités de l'homme d'État s'il avait tout ce qui caractérise le courtisan. Il était attendu, et il fut reçu à Paris avec un grand empressement de curiosité. M. de Buckingham, écrit Richelieu au marquis d'Effiat[4], trouvera en moi l'amitié qu'il saurait attendre d'un vrai frère qui lui rendra tous les services qu'il saurait désirer de qui que ce soit au monde, et Louis XIII lui faisait dire : Je vous assure que vous ne passerez pas ici pour étranger, mais pour vrai Français, puisque vous l'êtes de cœur et que vous avez témoigné, en cette rencontre du mariage, votre affection si égale au bien et au service des deux couronnes, que j'en fais, pour ce qui me regarde, le même état que le roi votre maître. Vous serez ici le très-bien venu et me connaîtrez en toutes occasions[5]. Dès son arrivée, en effet, Buckingham se montra vrai Français par ses façons d'agir, par l'aisance et la liberté de ses mouvements. Il entra dans la cour, dit la Rochefoucauld, avec plus d'éclat, de grandeur et de magnificence que s'il eût été roi[6]. Huit grands seigneurs et vingt-quatre chevaliers l'accompagnaient. Vingt gentilshommes et douze pages étaient attachés à sa personne, et sa suite entière se composait de six ou sept cents pages ou valets[7]. Il avait tous les trésors à dépenser et toutes les pierreries de la couronne d'Angleterre pour se parer[8]. Il descendit dans ce bel hôtel de Luynes de la rue Saint-Thomas-du-Louvre, qu'on nommait alors l'hôtel de Chevreuse, l'hôtel le plus richement meublé qui soit à présent en France, dit le Mercure, et pendant plusieurs jours le peuple de Paris fut ébloui par le luxe extraordinaire que déploya le fastueux étranger[9]. L'admiration fut aussi vive à la cour, et Buckingham y poussa la libéralité jusqu'à l'extravagance. Chacun de ses somptueux costumes était surchargé de perles et de diamants si habilement mal fixés qu'il s'en détachait un grand nombre, et le duc refusait de les recevoir quand on les lui rapportait. Une telle prodigalité, l'importance de sa mission, ce que son passé avait de séduisant et ce que sa personne offrait d'aimable ; son titre d'étranger qui rendait plus piquantes ses manières toutes françaises, cet art de plaire qui lui était si facile, tout contribua à en faire le héros de la ville et de la cour. Étourdi par un succès qui dépassait même son attente et s'éblouissant lui-même de l'éclat qu'il jetait autour de lui, il ne vit que la reine de France digne de ses hommages, et soudainement il conçut pour elle la plus véhémente passion. Trop léger pour refouler ce sentiment dans son cœur, il l'étala avec complaisance, et sa témérité s'aggrava de son ostentation. Anne d'Autriche était Espagnole et coquette. Elle comprenait la galanterie telle que ses compatriotes l'avaient apprise des Maures, cette galanterie qui permet aux hommes d'avoir sans crime des sentiments tendres pour les femmes, qui leur inspire les belles actions, la libéralité, toutes sortes de vertus[10]. Elle ne croyait pas, dit celle qui a le mieux connu Amie d'Autriche[11], que la belle conversation, qui s'appelle ordinairement l'honnête galanterie, où on ne prend aucun engagement particulier, pût jamais être blâmable. Aussi accueillit-elle avec indulgence et sans étonnement une passion conforme aux souvenirs de son pays et de sa jeunesse, et qui, en caressant son amour-propre, ne choquait nullement sa vertu. Cet hommage de la vanité, elle le reçut avec la complaisance de la coquetterie, se sachant la plus belle, la plus puissante, la plus digne enfin d'être aimée. D'un côté, l'indiscrète insistance de Buckingham, les marques multipliées d'une préoccupation amoureuse, son empressement à se trouver auprès d'elle ; de l'autre, des encouragements timides, de douces rigueurs, tour à tour la sévérité et le pardon dans le regard paraissaient à Anne d'Autriche les incidents naturels et ordinaires d'une galanterie où son honneur et même sa réputation ne lui semblaient exposés à aucun péril. Du reste, si de nombreuses fêtes rendirent fréquentes les occasions de se voir, la cour fut toujours présente aux entretiens de l'ambassadeur et de la reine, ce qui contenait et gênait l'audace entreprenante de l'un, mais justifiait entièrement la confiance de l'autre. Après une semaine qui fut remplie de ballets, de festins et de carrousels, la femme de Charles Ier s'achemina le 2 juin vers l'Angleterre, conduite par le duc de Buckingham, les comtes de Holland et de Carlisle et par le duc et la duchesse de Chevreuse. Louis XIII, malade, s'arrêta à Compiègne. Mais Anne d'Autriche, ainsi que Marie de Médicis, accompagnées d'un très-grand nombre de seigneurs français, se rendirent jusqu'à Amiens. Là, les réunions brillantes recommencèrent, et le duc de Chaulnes, gouverneur de la province, lit aux trois reines la plus magnifique réception. Pendant plusieurs jours, toute la noblesse des environs vint leur présenter ses hommages et augmenter l'éclat des promenades et des fêtes qui furent offertes par le gouverneur. La ville ne renfermant pas de palais assez vaste pour recevoir les trois reines, elles avaient été logées séparément, chacune suivie d'un cortège de familiers et de seigneurs qui lui formait une petite cour. Buckingham délaissa presque constamment sa nouvelle souveraine pour se montrer partout où était Anne d'Autriche. Dans la demeure de celle-ci se trouvait un grand jardin près duquel coulait la Somme. La reine et sa cour aimaient à s'y promener. Un soir, attirées comme d'habitude par la beauté du lieu et retenues par la douceur du temps, Anne d'Autriche que conduisait Buckingham, la duchesse de Chevreuse avec lord Holland, et toutes les dames de leur suite, prolongèrent leur promenade beaucoup plus tard que de coutume. Vivement épris et parvenu à ce degré de fatuité où tout parait possible, le duc fut fort tendre et osa être pressant. Le prochain départ de la reine Henriette rendait la séparation imminente. Cette perspective et le souvenir de ses anciens succès inspirèrent à Buckingham une folle hardiesse. A la faveur de la nuit qui tombe et profitant d'un instant d'isolement dû au tournant d'une allée, il se jette aux pieds de la reine et veut s'abandonner aux emportements de sa passion. Mais Anne, effrayée et apercevant le danger qu'elle court, a poussé un grand cri, et Putange, son écuyer, qui la suit à quelques pas, se précipite et arrête le duc. Toute la suite se présente à son tour, et Buckingham parvient à s'enfuir au milieu de la foule[12]. Deux jours après, Henriette-Marie quittait Amiens pour se diriger vers Boulogne. Marie de Médicis et Anne d'Autriche accompagnèrent leur fille et leur belle-sœur jusque hors des portes de la ville. Anne d'Autriche se trouvait en voiture avec la princesse de Conti. C'est là que Buckingham prit congé d'elle. En s'inclinant pour lui dire adieu, il se couvrit du rideau de la portière pour cacher ses larmes, qui coulaient abondamment. La reine fut émue de cette douleur, et la princesse de Conti, qui raillait de bonne grâce, lui dit, qu'elle pouvait répondre au roi de sa vertu, mais qu'elle n'en ferait pas autant de sa cruauté, et qu'elle soupçonnait ses yeux d'avoir regardé cet amant avec quelque pitié[13]. Trop passionnément épris pour que l'éloignement pût le guérir de son amour, et par le souvenir de sa grossière témérité, excité davantage encore à revoir Anne d'Autriche, le duc de Buckingham, que retenaient à Boulogne les vents contraires, revint tout à coup à Amiens, avec lord Holland, sous prétexte d'y remettre une lettre importante à Marie de Médicis, qui, un peu malade, n'avait pas quitté cette ville. Encore revenus ! dit Anne d'Autriche à Nogent-Bautru en apprenant cette nouvelle ; je pensais que nous eu étions délivrés[14]. Elle était au lit, s'étant fait saigner le matin, quand les deux gentilshommes anglais entrèrent dans sa chambre. Buckingham, que sa passion égarait, se mit à genoux devant le lit de la reine, embrassant ses draps avec transport et témoignant, au grand scandale des dames d'honneur, les impétueux sentiments qui l'agitaient. La comtesse de Lannoi voulut le contraindre à se lever, lui disant avec sévérité qu'une telle conduite n'était pas conforme aux usages de la France. Je ne suis pas Français, répliqua le duc, et il continua, mais toujours en présence de plusieurs témoins, à exprimer éloquemment sa tendresse à la reine. Celle-ci, fort embarrassée, ne trouva d'abord rien à dire ; puis elle se plaignit d'une telle hardiesse, mais sans trop d'indignation, et il est vraisemblable que son cœur ne fut pour rien dans les reproches qu'elle adressa au duc. Le lendemain ; celui-ci partit une seconde fois pour Boulogne. Il ne revit jamais plus la reine de France. Telle est cette fameuse scène d'Amiens, sur laquelle se sont exercées la verve grossière de Tallemant des Réaux et l'imagination libertine du cardinal de Retz[15]. Les affirmations de la Porte, qui y a assisté, de madame de Motteville, qui les a recueillies des témoins eux-mêmes, et celles de la Rochefoucauld, moins suspectes de complaisance, ne laissent aucun doute sur l'innocence d'Anne d'Autriche. Marie de Médicis, qui avait alors intérêt à lui nuire auprès de Louis XIII, et qui le fit souvent sans scrupule, ne put, en cette circonstance, s'empêcher, dit la Porte[16], de rendre témoignage à la vérité et de dire au roi que tout cela n'était rien ; que, quand la reine aurait voulu mal faire, il lui aurait été impossible, ayant tant de gens autour d'elle qui l'observaient, et qu'elle n'avait pu empêcher que le duc de Buckingham n'eût de l'estime et même de l'amour pour elle. Elle rapporta, de plus, quantité de choses de cette nature qui lui étaient arrivées dans sa jeunesse. Marie de Médicis aurait pu citer aussi des exemples choisis dans la vie d'Anne d'Autriche, qu'avaient auparavant aimée le duc de Montmorency et le duc de Bellegarde, sans que son honneur en eût été souillé[17]. Le souvenir de l'amour de Buckingham demeura plus profondément dans la mémoire de tous, parce que sa passion avait été plus emportée et s'était manifestée par des actes inconsidérés. Mais, jusqu'aux dernières années de la reine, même après la mort de Louis XIII et durant la, régence, ce fut autour d'elle un sujet de conversation qu'elle acceptait avec complaisance, parce qu'il flattait son amour-propre, et qu'elle n'aurait certainement pas toléré, eût-on osé le proposer, si ce souvenir eût été pour elle un remords. Loin de là. On l'en plaisantait familièrement, avec grâce, sans la choquer, car on savait lui rappeler ainsi un penchant assez vif, mais qui ne l'avait entraînée à aucune faute. Richelieu, présentant Mazarin à la reine : Vous l'aimerez bien, madame, lui dit-il, il a l'air de Buckingham[18]. Beaucoup plus tard, Anne d'Autriche régente, rencontrant, dans son jardin de Ruel, Voiture qui rêvait en se promenant, et lui demandant à quoi il pensait, celui-ci lui envoya pour réponse ces vers, qui ne l'offensèrent en rien : Je pensais que la destinée, Après tant d'injustes malheurs, Vous a justement couronnée De gloire, d'éclat et d'honneurs ; Mais que vous étiez plus heureuse, Lorsque vous étiez autrefois, Je ne veux pas dire amoureuse, La rime le veut toutefois. Je pensais (car nous autres poètes Nous pensons extravagamment) Ce que, dans l'humeur où vous êtes, Vous feriez si, dans ce moment, Vous avisiez en cette place Venir le duc de Buckingham, Et lequel serait en disgrâce De lui ou du père Vincent[19]. Tout concourt donc à absoudre Anne d'Autriche du crime dont on l'a accusée pendant les troubles de la Fronde et au milieu des passions injustes soulevées par la guerre civile. Seule, la conduite de Louis XIII à son égard et sa froideur persistante semblent la condamner. Mais cette froideur date-t-elle du séjour à Paris de Buckingham ? L'isolement dans lequel est souvent resté Louis XIII et son éloignement de la reine ont-ils été tels qu'on l'a cru jusqu'ici ? Faut-il y voir, Comme on l'a dit, l'effet et la preuve d'une infidélité criminelle de celte princesse, commise soit avec Buckingham en 1625, par amour, soit avec un inconnu, en 1630, par calcul et afin de pouvoir au moment de la mort de Louis XIII, qui paraissait alors imminente, régner au nom d'un enfant qu'elle aurait porté dans son sein, et qui, après le rétablissement inattendu du roi, serait devenu l'Homme au masque de fer ? |