|
Odoacre accueilli par Oreste entre dans la garde des
empereurs. - Quel était cet Oreste. - Glycerius, empereur. - Les Ostrogoths
quittent lu Pannonie. - Théodémir et son fils Théodoric l’Amale envahissent la Macédoine ; Vidémir, l’Italie.
- Glycerius fait passer en gaule les Ostrogoths. -Mécontentement des
Gaulois.- Népos arrive d’Orient, bat Glycerius, et le fait ordonner évêque de
Salone.
473 - 476
Odoacre et ses compagnons trouvèrent aisément en Italie l’emploi
de leurs bras. La mâle tournure et la haute taille des guerriers ruges
étaient faites pour attirer l’attention des recruteurs romains ; ils
rencontraient d’ailleurs, à la cour de Ravenne, un protecteur né de
quiconque, ayant appartenu aux bandes d’Attila, désirait entrer au service de
Rome. Ce protecteur n’était autre que le Pannonien Oreste, ancien secrétaire
du roi des Huns[1],
devenu officier supérieur dans la garde des empereurs d’Occident.
De tous les aventuriers romains ou barbares que produisit
le Ve siècle,
ce siècle des grands aventuriers de l’ancien monde, aucun n’offrit dans sa
vie de plus étranges contrastes que cet Oreste, sorti de la tente d’Attila,
pour aller fermer, sur le trône impérial d’Occident, en la personne de son
fils, la succession de hies César et d’Auguste. Né à Pettau, en Illyrie, d’une
famille honnête de provinciaux, il s’était allié à une plus illustre, en
épousant la fille du comte Romulus, personnage considérable, même hors de sa
province, et honoré de plusieurs missions par les Césars de Ravenne. Avec une
merveilleuse souplesse d’esprit, que n’embarrassaient guère les scrupules de
conscience, Oreste savait toujours accommoder son patriotisme aux
vicissitudes de sa patrie. Romain au temps où la Pannonie était romaine,
Barbare lorsque les Huns l’occupèrent, mais prêt à redevenir Romain au
premier retour de fortune, il servit loyalement, à mesure qu’elles se
présentèrent, toutes les causes que lui imposa la nécessité. Attila n’eut pas
de ministre plus fidèle, l’empire de plus dangereux adversaire, tant, que
dura la domination des Huns[2]. Mais à la mort
du conquérant, il regarda ses engagements comme rompus, et refusant de
prendre part aux luttes de ses compagnons d’armes, il vint avec sa famille et
ses trésors se fixer en Italie[3], où il dépensait
noblement la part qu’il avait touchée dans le pillage de l’empire. Ainsi
rendu à sa première situation, le secrétaire d’Attila se montrait un bon et
utile Romain. Sa profonde connaissance des moeurs et des intérêts barbares le
fit rechercher par les ministres des empereurs et par les empereurs
eux-mêmes. Il se glissa dans leur intimité, fut bientôt de tous leurs
conseils, et obtint un commandement dans le corps des domestiques, poste
envié et réellement important, en ce qu’il servait de marchepied à tout.
Par suite de ses aventures mêmes et des relations de sa
vie passée, Oreste pouvait rendre à l’empire des services de plus d’un genre
; mais le plus important de tous se trouvait, en quelque sorte, entre ses
mains. La question de vie ou, de mort, pour la Romanie occidentale,
était alors dans la composition de ses armées ; non pas qu’il s’agît encore,
comme sous Marc-Aurèle ou Probus, d’y combiner avec prudence l’élément
national et l’élément étranger, de manière à garantir toujours là prééminence
au premier ; le temps des simples tempéraments n’était plus, et le gouvernement
d’Occident se résignait à ne plus compter sous ses enseignes que des soldats
étrangers. La question était de décider si ces soldats étrangers formeraient,
au sein de l’Italie, une armée ou un peuple. Sans doute, le recrutement des
mercenaires barbares dans un seul peuple, par l’intermédiaire d’un chef ou
roi de ce peuple, généralissime romain, offrait de grands avantages de facilité
et de cohésion ; mais Ricimer en Italie, Aspar à Constantinople, avaient mis
à nu les inconvénients d’un pareil système, qui amenait comme conséquence
inévitable, la dépendance des empereurs et l’abaissement de l’autorité
impériale devant le patriciat barbare. Le remède à ce mal, remède bien
impuissant encore, consistait à. changer le mode de recrutement, au moins
pour une portion des troupes, à diviser les commandements, à créer entre les
chefs des rivalités de position, en un mot à détruire, au profit de l’empereur,
cette unité et souvent cette hérédité du gouvernement militaire, qui faisait
la force des patrices barbares, entrepreneurs d’armées romaines.
Dans la
Romanie orientale, Léon avait accompli ce travail avec
succès. Eu composant sa garde de recrues isauriennes opposées aux fédérés
goths de Théodoric le Louche et d’Aspar, et remettant le commandement de
cette garde à l’Isaurien Zénon, devenu son gendre, il avait su se préserver
lui-même, et chasser des abords du trône la dynastie militaire des Ardabures,
maîtresse de l’Orient depuis un demi-siècle. L’Occident, il est vrai, ne
comptait, parmi ses populations sujettes de l’empire, rien de comparable pour
l’énergie guerrière aux sauvages tribus de l’Isaurie ; mais à défaut de
Romains on pouvait opposer les barbares aux barbares, et combiner, pour la
garde clos empereurs, un système d’enrôlement qui échappât à l’action de
Ricimer. Il semble que ce fut là l’idée d’Anthémius, et peut-être la cause
immédiate de sa ruine. On voit en effet, vers cette époque, des corps entiers
et en particulier celui des domestiques se recruter de Ruges, d’Hérules, de
Scyres, de Turcilinges, d’Alains, enrôlés individuellement ou par petits
groupes isolé ; et ces bandes de race différente, soumises au commandement d’officiers
romains, formèrent, suivant toute apparence, ce qu’on appela les nations[4]. Ce ne fut plus,
comme l’armée de Ricimer, une masse homogène, un peuple que son roi louait à
l’empereur : mais une troupe stipendiée directement par l’empereur, et qui
lui resta fidèle quand la guerre éclata entre son patrice et lui. Telle est,
en effet, la transformation qu’on voit s’opérer sourdement dans la milice
romaine sous le règne d’Anthémius. Oreste semblait fait exprès pour la
diriger, lui qui connaissait si bien les intérêts, les moeurs, les alliances
ou les inimitiés des Barbares, et que ceux-ci regardaient presque comme un
homme de leur sang. On peut supposer qu’il fut d’abord employé par Anthémius
à des missions de ce genre, et que l’aventurier pannonien dut à cette utilité
toute particulière sa faveur marquée à la cour, et un poste dans le corps des
domestiques. Le scribe qui avait tenu le registre des armées d’Attila devint
le recruteur en chef de la garde des Césars.
Grâce à cette circonstance et à l’engouement dont les
recrues ruges, hérules et turcilinges furent dès lors l’objet, Odoacre entra
d’emblée dans le corps des domestiques, en qualité de doryphore ou porte
lance[5]. Oreste l’attacha
à son service personnel ; il le prit pour écuyer, nous dit la tradition[6]. Le fils d’Édécon
assista dans cette situation modeste aux guerres civiles qui amenèrent la
chute d’Anthémius, suivie si promptement de la mort, de Ricimer et de celle d’Olybrius,
son digne protégé. Ces guerres durent offrir au doryphore plus d’une occasion
de montrer sa vive intelligence et sors audace : il s’acquit dans la milice
palatine, ennemie des Suèves, une popularité qui faisait déjà de lui un
personnage important, quand il n’était encore que simple soldat.
Le nouvel interrègne ouvert par la mort d’Olybrius trouva
l’Italie plus faible et plus découragée qu’elle n’avait jamais été. Le neveu
de Ricimer, Gondebaud, devenu patrice d’Occident par succession, homme sans
crédit comme sans mérite, et presque inconnu des Italiens, n’avait ni le
talent de les gouverner, ni même l’ambition de le vouloir. Tout son désir
était de prendre une bonne revanche de ses frères, par sa rentrée triomphante
dans le petit royaume galloburgonde d’où ceux-ci l’avaient chassé. L’œil
attaché sur la Gaule,
qu’il tourmentait de ses intrigues après l’avoir déchirée par ses armes, il
épiait l’occasion d’y reparaître, se repaissant à l’avance d’idées de
vengeance et de sang. Tel était le dictateur chargé par Olybrius des
destinées de la Romanie
occidentale, et pour le moment en quête d’un empereur. Il n’était guère fait
pour inspirer confiance aux prétendants ; et plus de quatre mois s’écoulèrent
sans qu’il s’en présentât un seul, dans ce pays où le plus obscur non moins
que le plus illustre se croyait prédestiné au rôle de César. Gondebaud, à
bout de patience apparemment, finit par prendre le commandant des gardes du
dernier empereur, le comte Glycerius[7], qui reçut la
pourpre comme un avancement de grade. Proclamé d’abord à Ravenne par ses
soldats, il le fut successivement par tous les autres corps militaires, sans opposition
ni hésitation[8],
soit indifférence politique, soit plutôt que l’absence de tout concurrent eût
prévenu les cabales et les divisions dans l’armée.
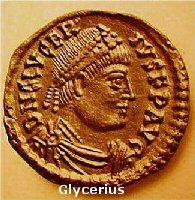 Glycerius était Italien, et, suivant toute vraisemblance,
de la province de Ligurie, où une famille de ce nom avait marqué dans les
charges publiques. Un Glycerius, cinquième successeur de saint Ambroise,
gouvernait en 438 l’Église de Milan avec une double réputation de beauté et,
de sainteté. Son portrait placé dans la galerie des évêques de cette
métropole, offrait le bizarre spectacle d’une figure de vierge candide et
rosée, coiffée d’une tiare et armée d’un sceptre en guise de bâton pastoral[9]. Pavie paraît
avoir été le berceau de cette maison des Glycerius ; et lors de l’avènement
du nouveau prince, sa mère résidait sur les terres de cette cité,
probablement au milieu des domaines de la famille. Quant à lui, l’histoire et
les contemporains l’ont jugé diversement : les uns lui reconnaissent un
certain mérite[10]
qui eût pu suffire dans une situation modeste, les autres en parlent comme d’un
usurpateur et d’un tyran misérable[11]. Au fond,
Glycerius était un personnage médiocre, instrument d’un plus médiocre encore.
L’assentiment unanime de l’armée en sa faveur entraîna le sénat et la ville
de Rome, mais des protestations s’élevèrent de plusieurs villes,
particulièrement de celles de Ligurie. Pavie se distingua entre toutes par son
ardente opposition qui prit, sur quelques points du diocèse, les allures d’une
guerre civile. La mère de l’élu de Gondebaud fut insultée dans sa résidence,
et probablement le domaine des Glycerius mis au pillage. Glycerius était Italien, et, suivant toute vraisemblance,
de la province de Ligurie, où une famille de ce nom avait marqué dans les
charges publiques. Un Glycerius, cinquième successeur de saint Ambroise,
gouvernait en 438 l’Église de Milan avec une double réputation de beauté et,
de sainteté. Son portrait placé dans la galerie des évêques de cette
métropole, offrait le bizarre spectacle d’une figure de vierge candide et
rosée, coiffée d’une tiare et armée d’un sceptre en guise de bâton pastoral[9]. Pavie paraît
avoir été le berceau de cette maison des Glycerius ; et lors de l’avènement
du nouveau prince, sa mère résidait sur les terres de cette cité,
probablement au milieu des domaines de la famille. Quant à lui, l’histoire et
les contemporains l’ont jugé diversement : les uns lui reconnaissent un
certain mérite[10]
qui eût pu suffire dans une situation modeste, les autres en parlent comme d’un
usurpateur et d’un tyran misérable[11]. Au fond,
Glycerius était un personnage médiocre, instrument d’un plus médiocre encore.
L’assentiment unanime de l’armée en sa faveur entraîna le sénat et la ville
de Rome, mais des protestations s’élevèrent de plusieurs villes,
particulièrement de celles de Ligurie. Pavie se distingua entre toutes par son
ardente opposition qui prit, sur quelques points du diocèse, les allures d’une
guerre civile. La mère de l’élu de Gondebaud fut insultée dans sa résidence,
et probablement le domaine des Glycerius mis au pillage.
Un pareil attentat, punissable en tout pays d’un châtiment
exemplaire, appelait ici la peine capitale, une mère d’empereur étant, comme
l’empereur lui-même, protégée par la loi de Majesté. Déjà le magistrat de la
province, après avoir rétabli l’ordre, faisait la recherche des coupables,
pour les livrer au bourreau, lorsque Épiphane intervint. Effrayé des sévices
qui allaient, fondre sur son troupeau, car beaucoup avaient trempé dans le
crime, l’évêque de Pavie se mit en route pour Ravenne, dans l’appareil d’un
suppliant. Il alla trouver le prince, et, au nom du pardon des injures, il demanda
au fils irrité la grâce de ceux qui avaient outragé sa mère. Les paroles du
prêtre et la solennité de sa démarche touchèrent Glycerius qui se laissa
fléchir, et dépêcha au magistrat un ordre de suspendre l’enquête[12] : mesure que
suivit de près une amnistie des coupables. Cet acte de clémence inaugurait heureusement
un règne que la faveur publique n’encourageait guère ; mais tout l’honneur en
fut reporté à l’évêque Épiphane, dont l’autorité protectrice grandissait avec
les malheurs de l’Italie. Glycerius ne gagna donc rien ou presque rien à sa
mansuétude vis-à-vis de ses, sujets, tandis qu’au dehors il éprouvait tous
les déboires attachés à une position illégitime. L’empereur d’Orient refusa
de le reconnaître, comme il avait refusé de reconnaître son prédécesseur.
Depuis la chute d’Anthémius, il n’y avait plus d’empereur d’Occident aux yeux
de la chancellerie byzantine. L’unanimité rompue devenait de plus en plus
difficile à rétablir ; Constantinople accusait Rome de violer à plaisir la
constitution romaine, et de vouloir tout abîmer dans sa ruine.
Cependant, une des prédictions de Séverin semblait sur le
point de s’accomplir, celle qui avait annoncé au roi Flaccithée le prochain
départ des Ostrogoths. Une grande agitation régnait dans leurs cantonnements,
de la Save au
mont Cettius, et du moyen Danube aux Alpes Juliennes : hommes, chevaux,
bétail se croisaient en tout sens sur les routes encombrées de chariots ; on
rassemblait des vivres ; on réparait les tentes ; tout, en un mot, décelait
le projet d’une émigration générale. En présence de ces préparatifs, les
peuples voisins se demandaient avec appréhension sur quel point de l’Orient
ou de l’Occident la terrible tempête irait s’abattre ; et Flaccithée, contant
dans les paroles du saint qui lui avait promis un règne paisible et une mort
naturelle, se tenait prêt à tout événement. L’émotion gagna jusqu’aux tribus
sarmates campées de l’autre côté du Danube. Hais avant d’aborder le récit de
cette émigration dont les suites furent si considérables pour l’Italie et
pour la Gaule,
j’exposerai le plus brièvement que je pourrai les raisons qui, après avoir
amené les Ostrogoths en Pannonie, les poussèrent à quitter ce pays, et à se
mettre en recherche de nouvelles demeures.
J’ai déjà dit comment cette nation, séparée des fils d’
Attila et victorieuse des Huns à la journée du Nétad, était venue, sous la
conduite de ses trois rois Théodémir, Valémir et Vidémir, planter ses tentes
en Pannonie. Elle ne s’inquiéta alors ni du droit qu’elle avait de s’établir
ainsi sur les terres d’autrui, ni de ce qu’en pouvait penser l’empereur d’Orient,
maître de cette province. Les scrupules lui arrivèrent plus tard, lorsque
ayant épuisé la contrée et manquant d’argent, elle convoita les subsides
annuels dont jouissaient les Barbares alliés de l’empire et admis dans sa
fédération. Un jour donc, les rois Ostrogoths s’avisèrent qu’ils ne
possédaient pas légitimement les provinces de Haute et Basse Pannonie, et
envoyèrent une ambassade à Constantinople[13] pour demander,
avec une concession régulière des deux territoires, ce titre de fédérés du
peuple romain, auquel’ se joignait d’ordinaire l’octroi d’une bonne pension.
La demande’ eut peu de succès près de l’empereur Marcien, qui régnait alors
en Orient. Déjà résigné à la perte de ses deux provinces, il se montra peu
soucieux de pensionner encore ceux qui les lui avaient enlevées, et
déclinant, sous divers prétextes, la soumission tardive des Ostrogoths, il
promena leurs envoyés de délais en délais, et finit par les congédier.
Malheureusement pour lui, ceux-ci avaient appris à
Constantinople comment se traitaient ces sortes d’affaires. Ils y avaient
rencontré un homme de leur nation, chef d’une mince peuplade cantonnée en
Thrace depuis un siècle, lequel, louant ses armes à l’empereur ou aux ennemis
de l’empereur, suivant l’occasion, vivait grassement de l’argent des Romains,
et se posait à la cour en personnage important. Ce chef ostrogoth n’avait
point, comme Théodémir et ses frères, l’honneur d’appartenir à la race royale
des Amales ; ce n’était qu’un aventurier, créature et soutien d’Aspar, dont
il avait épousé une parente éloignée. Son nom était Théodéric ou Théodoric,
fils de Triar, et on le désignait habituellement par le sobriquet de Louche, à cause d’un œil crevé qui le
rendait difforme. Le Louche, au service de l’empereur, pour le moment,
recevait du trésor impérial un très fort subside. Placé aux portes de la
métropole, dont il tenait pour ainsi dire la clef, il y faisait le calme ou l’orage,
mêlé aux intrigues et aux complots, leurrant de son appui tous les ambitieux,
et tirant plus de profit encore de ses trahisons que de sa fidélité.
Il se peut que Théodoric, fils de Triar, prenant en pitié
ces ambassadeurs qui venaient solliciter humblement par faveur ce qu’il
possédait par violence, eût contribué à les faire éconduire comme des gens
stupides et de peu de valeur ; en tout cas, Théodémir et ses frères,
tombèrent clans un véritable accès de rage au récit de leurs envoyés. L’infériorité
où on les plaçait vis-à-vis du fils de Triar fut ce qui les blessa le plus,
dans les procédés de la politique romaine. Se voir refuser, à eux, les
descendants des rois amales, ce qu’on accordait bénévolement à un pareil
aventurier, leur parut le comble de l’injure ; et prenant aussitôt les armes,
ils se jetèrent sur la Mésie
qu’ils ravagèrent, et de là passant en Thrace, ils menacèrent jusqu’aux
approches de Constantinople. En supputant ce que leurs dévastations coûtaient
à l’empire, la chancellerie byzantine pensa qu’on gagnerait davantage à les
pensionner, et Léon, successeur de Marcien sur le trône impérial, entra en pourparlers
avec eux. On négocia sur les ruines qu’ils venaient de faire. Non seulement
ils furent admis pour l’avenir aux subsides des fédérés, mais on donna à leur
admission un effet rétroactif antérieur à leur demande, en faisant courir
leur pension du jour de leur établissement sur le Danube. C’est ainsi que les
Ostrogoths devinrent fédérés de l’empire. Ils s’engagèrent de leur côté à ne
plus sortir de leur cantonnement, à ne prendre les armes que pour le service
de l’empereur, à n’avoir d’amis que ses amis, d’ennemis que ses ennemis :
toutefois, ils stipulèrent une exception en faveur de Genséric[14] qui, après avoir
été l’instigateur d’Attila dans sa guerre contre les Romains, reportait ses
efforts sur les rois goths, espérant faire renaître, par leur moyen, l’occasion
qui avait failli au roi des Huns.
A ces conditions ordinaires des traités de fédération,
Léon joignit une clause spéciale essentielle à ses yeux. C’est que Théodémir,
l’aîné des Amales, et le représentant de la royauté ostrogothique au dehors,
lui livrerait son fils en garantie de la foi jurée[15]. Théodémir n’était
point marié légitimement suivant la loi des Goths, mais il avait eu de sa
concubine favorite Ereliéva, outre plusieurs autres enfants, un fils nommé
Théodoric, qui entrait alors dans la huitième année de son âge[16]. C’était l’otage
que réclamaient les Romains. Théodémir aimait tendrement cet enfant ; et sa
tendresse faillit tout remettre en question. Il allait répondre par un.
refus, quelles qu’en pussent être les conséquences, lorsque les Ostrogoths
alarmés lui députèrent son frère Valémir qui, des bords de la Save où il résidait, se
transporta au quartier royal du lac Pelsod. Dans les conseils de sa famille,
comme dans ceux de l’armée, Valémir exerçait une influence décisive par la
sagesse (le ses idées unie au don de persuader, et la confiance dont l’avait
jadis honoré Attila augmentait son autorité personnelle. Il fit valoir
énergiquement près de son frère l’intérêt du peuple ostrogoth, son désir et
leur propre responsabilité comme rois : l’intérêt du peuple ne devait-il pas
parler plus haut à leurs cœurs que les sentiments de famille, même les plus
chers[17] ? Théodémir,
cédant à ses remontrances, lui remit l’enfant, que celui-ci courut
immédiatement livrer aux délégués impériaux[18]. Cette circonstance
consignée sur les registres publics, donna lieu à une erreur des écrivains
grecs qui prirent le jeune Théodoric pour un fils de Valémir : la plupart, en
effet, attachent à son nom cette qualification. au moyen de laquelle ils le
distinguent de l’autre Théodoric, fils de Triar. L’enfant était aimable et
gracieux, disent les historiens ; il plut à Léon, qui le fit élever dans son
palais, comme un membre de la famille impériale[19]. C’est là que le
futur roi d’Italie apprit des Romains eux-mêmes l’art de les vaincre avec
celui de les gouverner.
Le traité de fédération fut, dans la main des Ostrogoths,
une arme à deux tranchants qui les rendit également redoutables aux Barbares
et aux provinciaux romains. Les peuples barbares, voisins de leurs quartiers,
mettaient-ils le pied en Pannonie, en Dardanie, en Mésie, ou s’aventuraient-ils,
comme les Suèves, dans quelque course lointaine en Dalmatie : les Goths les
laissaient d’abord piller, puis fondant sur eux à l’improviste, ils les
dispersaient et leur enlevaient leur butin, qui passait dans le trésor des
Annales ; c’est ainsi qu’ils défendaient l’empire. Pareillement quand les
guerriers ruges, hérules ou alamans, partaient pour quelque longue expédition
hors de leurs villages, les Goths accouraient incontinent, surprenaient le
camp mal gardé, emmenaient captifs les enfants et les femmes, puis venaient
pour ces services signalés, réclamer de l’argent aux provinciaux. Si l’argent
tardait, ils se payaient eux-mêmes par le sac de quelque ville. Plus ce
prétendu patronage devint lucratif, plus les Goths se montrèrent chatouilleux
sur l’honneur romain. Germains, Huns, Sarmates, en un mot tous les Barbares
des deux rives du Danube eurent affaire à eux, les uns après les autres. Les
Alamans et les Ruges subirent plus d’un désastre ; les Suèves virent leur
puissance brisée, les Hérules furent presque détruits[20]. Le tour des
Sarmates arrivait, dès que le Danube, gelé profondément, pouvait donner
passage aux chariots et aux cavaliers[21]. Plus d’une
fois, leurs tribus furent pourchassées et traquées dans les hautes vallées
des Carpates. Ce métier enrichit grandement les Goths ; mais leurs richesses
restaient stériles, et la débauche dissipait bientôt ce qu’avait procuré la
violence.
Tous ces peuples, poussés à bout, se coalisèrent enfin, et
entrèrent en Pannonie où ils rendirent à leurs persécuteurs ravages pour
ravages. Le sort fut souvent égal entre eux et les Goths. Dans une bataille
livrée non loin des bords de la
Save, comme le roi Valémir parcourait le front de ses troupes
pour les animer, le cheval qui le portait s’abattit et l’entraîna dans sa
chute. Il n’eût pas le temps de se relever ; les escadrons ennemis lui
passèrent sur le corps, et il resta à terre, écrasé sous le sabot des chevaux
et transpercé de coups de lances[22]. Déjà les Goths,
rompus dans leurs lignes, se dispersaient, quand la vue du cadavre de leur
roi, leur rendit le courage ; ils se rallient, reprennent pied, et par un
effort désespéré, rentrent en possession du champ de bataille. Cette journée,
célèbre dans les fastes des Barbares danubiens, fut marquée par l’extermination
des Scyres : il ne survécut de ce peuple qu’un faible débris qui, honteux de
se montrer encore au nord des Alpes, finit par émigrer en Italie[23]. Une nouvelle
coalition de Suèves, de Ruges, de Gépides et de Sarmates, revint l’année
suivante en Pannonie, appelant les Amales à une dernière lutte qui se décida
près de la rivière Bollia. La victoire resta aux mains des Goths. La plaine, inondée du sang des ennemis, dit l’historien
Jornandès[24]
dans un style presque aussi sauvage que les exploits de ses héros, ressemblait à une mer de pourpre, au-dessus de laquelle s’élevaient,
comme autant de collines, des monceaux d’armes et de cadavres. On compta plus
de dix mille morts. Ce spectacle remplit les Goths d’une joie inexprimable,
car ils avaient vengé, par un massacre sans pareil, le meurtre de leur roi et
l’injure de leur nation.
La mort de Valémir apporta une sorte de révolution chez
les Goths. Valémir était l’homme héroïque parmi les Amales, et quand ses
frères se furent partagé les tribus dont il était chef, Théodémir, à qui
échut la plus grosse part, sentit le besoin d’un auxiliaire jeune et actif. D’ailleurs
la perte du frère qu’il avait le plus aimé laissait un grand vide dans ses
affections. Il voulut revoir ce fils, dont il s’était séparé avec tant de regrets,
et qui vivait depuis dix ans, loin de lui, à Constantinople ; il le redemanda
avec instance à Léon. Celui-ci, occupé de ses armements contre Genséric (il préparait alors la malencontreuse
expédition que fit échouer la vénalité de Basilisque), ménageait avant
tout les Ostrogoths dont il connaissait l’alliance étroite arec les Vandales,
et qui pouvaient créer, au sein de l’empire, une diversion funeste à ses
projets. Quel que fût donc son désir de garder sous sa main, à tout
événement, un otage aussi précieux que Théodoric, il n’osa rejeter la prière
du roi Amale, et faisant contre fortune bon cœur, il lui renvoya son fils
chargé de présents.
Le premier-né d’Ereliéva avait grandi loin d’elle et de
son père ; parti enfant, il revenait homme, accomplissant déjà, nous dit Jornandès,
sa dix-huitième année[25]. Si nous en
croyons la tradition conservée clans les poèmes germaniques du moyen âge.
Théodoric avait des yeux d’un bleu verdâtre auxquels ses sourcils noirs
donnaient un singulier éclat, une figure agréable et riante, une épaisse
chevelure rousse retombant en boucles sur ses épaules, un visage lisse et
sans barbe[26].
Sa taille, sans être celle d’un géant, dépassait la stature habituelle des hommes
; et on pouvait comparer à des troncs d’arbres ses bras robustes et rigides
que personne n’eût fait fléchir malgré lui[27]. Nul parmi les
plus adroits ne savait comme lui maîtriser un cheval indompté, porter un coup
de lance, atteindre de la flèche ou du javelot un but à peine saisissable au
regard. Il rapportait de la
Rome orientale, avec la connaissance des faiblesses et des
vices des Romains, celle des arts propres à les combattre : ses études n’allaient
pas plus loin. Théodoric resta toujours complètement illettré[28] ; et plus tard,
quand il fut parvenu à la plus haute fortune, il ne put jamais, quelque désir
qu’il en eût, apprendre à écrire son nom. Il se servit, pour signer, d’une
plaque d’or évidée, dont il remplissait les blancs au moyen d’une plume ou d’un
pinceau. Mais si quelque chose de rétif, inhérent à sa nature barbare,
empêcha le jeune Amale d’arriver au degré d’instruction le plus commun chez
les peuples civilisés, il possédait en revanche une rare intelligence, l’instinct
de ce qu’il ignorait, et ce génie politique qui lui fit apprécier dans les
sciences des Romains une puissance supérieure à la prééminence militaire qu’ils
avaient perdue. Cette intuition, ces jugements, encore obscurs dans l’âme de
Théodoric, s’y développèrent graduellement, avec les circonstances de sa vie
; ils le rendirent plus tard un chef sans égal entre tous, un souverain qui
sut combiner, dans le double intérêt de sa domination et de la grandeur de
son peuple, les forces de la civilisation avec celles de la barbarie.
Pour le moment, il ne retardait pas si loin. Rendu à la
vie barbare, il s’y retrempa avec bonheur ; et son ardeur juvénile se
communiquant aux bandes ostrogothes qui s’engourdissaient sous de vieux rois,
sembla les rajeunir à leur tour. Tout ce qu’il y avait d’adolescents
aventureux dans l’armée de Théodémir se, groupa autour du jeune homme et. lui
forma comme une clientèle qui ne compta pas moins de six mille lances[29]. A la tête de
cette milice à qui la prudence n’était guère plus connue que la peur, Théodoric
se jeta dans un série d’aventures, glorieuses pour le nom des Goths, mais
parfois compromettantes pour leur sûreté. Ses expéditions avaient lieu, la
plupart. du temps, à l’insu de Théodémir, qui ne les apprenait que par le
succès : une seule fera juger de toutes les autres.
Parti une nuit des bords du lac Pelsod avec son armée de
fidèles. Théodoric gagna le Danube qu’il passa à la nage, puis se dirigea à
pas de loup vers le camp du roi sarmate Babaï, dressé sur la rive droite, à
peu de distance du fleuve. La surprise réussit : Babaï, encore endormi. Ait
égorgé sous sa tente ; ses femmes, ses enfants, ses trésors furent enlevés.
et la bande victorieuse rentra au quartier des Goths, traînant triomphalement
à sa suite un immense butin. Nul n’eut le courage de blâmer un si beau et si
utile fait d’armes, accompli, disait-on, pour venger l’honneur romain ; car
Babaï, tout récemment, avait battu un général de l’empereur d’Orient, et mis la Dacie au pillage. C’était
bien jusque-là ; mais le vengeur du nom romain ne restitua point aux
provinciaux de la Dacie
le fruit des larcins de Babaï, et quelque temps après, ayant recouvré sur ces
mêmes Sarmates la forte place de Singidon, boulevard de l’empire du côté de la Save, il y mit une garnison
ostrogothe et refusa de la rendre à l’empereur. Tels furent les premiers
faits d’armes de ce barbare élevé à Constantinople : ils offrent comme un
avant-goût de toute sa vie. Le futur maître de l’Occident se développait
ainsi dans des coups de main hardis et fructueux ; la discipline barbare se
taisait devant les monceaux de butin, et les joies secrètes du père ne
laissaient plus de place aux sévérités du roi.
Au train dont marchaient les choses, il n’y eut bientôt
plus rien à piller dans le voisinage ; et la guerre ne nourrissant plus les
Goths, vint le mécontentement, puis le dénuement et la faim. Les vivres et le vêtement commencèrent à leur manquer,
dit l’historien de ce peuple[30], et ils se prirent à maudire la paix. Des
plaintes éclatèrent de toutes parts contre les rois, et un jour enfin une
multitude affamée se porta vers la demeure de Théodémir, à grand fracas d’armes
et de cris : nous voulons partir,
disaient les mutins ; conduis-nous où tu voudras
; mais partons ![31] La position
était grave. Théodémir appela près de lui son frère Vidémir ; et les deux
rois se mirent à délibérer sur la résolution la meilleure dans la
circonstance. Pour plus de sûreté, ils consultèrent les sorts, à la manière
de leur nation : les sorts prononcèrent qu’ils devaient partir. Toutefois,
comme un départ en ruasse de tout le peuple ostrogoth, par les mêmes routes
et vers les mêmes lieux, pouvait rendre l’émigration difficile et même
périlleuse, il fut convenu qu’ils se diviseraient et emmèneraient leurs
tribus chacun dans une direction différente. L’Italie et la Grèce se trouvent presque
à égale distance sous leur main. ils pouvaient choisir. Théodémir exhorta son
frère à prendre l’Italie, dont il aurait bon marché, ajoutait le vieux roi,
car les barbares ne connaissaient que trop bien l’impuissance où était tombée
cette reine du monde. Lui, comme le plus fort, jetait son dévolu sur l’empire
le plus fort : avec son peuple qui dépassait de beaucoup celui de Vidémir, il
affronterait les armées de l’Orient, et envahirait la Grèce. Tel fut l’arrangement
des rois amales. Restaient les préparatifs du départ ; on y pourvut, et en
quelques semaines, la nation se trouva tout entière sur pied.
Théodémir partit le premier. Du lac Pelsod, il se dirigea
vers la Save,
qu’il franchit sans opposition. Il avait pris soin de signifier d’avance aux
soldats des garnisons romaines et aux colons sarmates installés le long du
fleuve, qu’au moindre obstacle de leur part, ils seraient exterminés jusqu’au
dernier. Romains et Sarmates se le tinrent pour dit ; et convaincus d’ailleurs
que toute résistance serait insensée contre une pareille multitude, ils se
blottirent, ceux-ci dans leurs camps palissadés, ceux-là dans leurs châteaux,
et les Goths passèrent sans leur faire de mal. Des bords de la Save, Théodémir marcha
droit sur Naïsse, métropole de la
Dacie méditerranée, et la clef’ de l’Illyrie orientale ; il
l’enleva par surprise et s’y fortifia. La patrie du grand Constantin devint
la place d’armes d’un de ces rois germains qu’il exposait aux bêtes dans le
cirque de Trèves, pour l’amusement de la soldatesque romaine. Là, le roi goth
s’associa son fils, qui partageait avec lui les fatigues de la campagne ; il
lui assigna même un commandement particulier. Théodoric, placé à l’avant-garde
avec l’élite de la jeunesse, fut chargé d’éclairer la marche, tandis que
Théodémir et le gros de l’armée attendraient dans Naïsse ou le signal d’avancer,
ou le moment d’opérer la retraite.
Fier de cette confiance, Théodoric se jeta hardiment vers
le groupe de montagnes qui sépare l’Illyrie de la Grèce : le camp d’Hercule,
situé sur la première terrasse des monts dardaniens, tomba d’abord en son
pouvoir ; puis le château de Trajan avec un trésor qui renfermait, suivant
toute apparence, les caisses militaire et administrative de la province. L’avant-garde
des Goths touchait alors au pied de la double chaîne qui couvre à l’est la Thrace, à l’ouest la Macédoine ;
elle était maîtresse de la voie militaire de Dardanie en Thrace, par le
défilé de Sucques, mais comme cette voie passait sous la forte place de Sardique,
Théodoric craignit de trouver le passage interrompu. Il se détourna
brusquement, laissant à gauche le Rhodope, et à travers les monts dardaniens,
qu’il gravit par des sentiers à peine battus[32], il arriva en
Macédoine, lorsqu’on l’attendait en Thrace. Les villes effrayées se livrèrent
à lui sans résistance. De Macédoine il passa en Thessalie ; et, la main de
cet enfant adoptif de la
Grèce entassa, sur les chariots des Goths, les dépouilles
de Larisse et d’Héraclée.
Thessalonique restait à piller, mais cette ville n’était
point de celles qu’on enlève par un coup demain ; et Théodoric ne songea
point à l’attaquer avant sa jonction avec Théodémir. Celui-ci, en effet, s’était
mis en route à la nouvelle des succès de son fils. Ne conservant sur ses
derrières qu’une poignée d’hommes restés dans Naïsse, et suivant le chemin
frayé par son avant-garde, il se trouva bientôt transplanté en Grèce avec
tout son peuple. L’attaque de Thessalonique lui causa un tout autre souci que
celle de Naïsse ou d’Ulpiana. Défendue du côté de la mer par son golfe, du
côté de la terre par une haute muraille qu’entouraient de larges fossés,
cette capitale de la Grèce
péninsulaire contenait une population nombreuse enrichie par le commerce, et
décidée à vendre chèrement sa vie et ses biens. Une garnison choisie y était
arrivée de Constantinople, et le patrice Clarianus, qui la commandait,
passait pour un général non moins énergique que prudent. Les Goths, voyant à
quel les gens ils avaient affaire, se bornèrent à bloquer la ville ; mais leurs
courses ruinaient la campagne. Dans cette situation, qui n’était bonne pour
personne, Clarianus essaya de négocier[33], et des
pourparlers s’ouvrirent entre les Goths et les Romains. Pourquoi, disaient ceux-ci, vous qui êtes fédérés de l’empire, avez-vous quitté vos
cantonnements ? Quel tort vous a fait l’empereur ? Théodémir fit
valoir la détresse de son peuple en Pannonie. Son
cantonnement des bords du Danube se trouvant épuisé, il lui en fallait un
autre, sous peine de mourir de faim : la nécessité était une maîtresse
impérieuse contre laquelle aucun attachement ne prévalait, et il en coûterait
plus cher aux Romains de détruire les Goths que de les nourrir !
L’empire le crut ainsi. Clarianus ayant reçu de Léon le
pouvoir de traiter arec Théodémir d’un nouvel établissement, on lui assigna,
dans la partie septentrionale de la Macédoine, une centrée montueuse appuyée sur
les dernières élévations des monts de Dardanie, à leur point d’intersection
avec le Rhodope. Elle renfermait les cantons de Céropelles, Europe, Médiana.
Pétina, Berrhée et quelques autres, désignés sous l’appellation collective de
Sium[34]. Des officiers
romains, après l’avoir régulièrement délimitée, en firent la remise aux
Goths, qui s’y installèrent. Moins fertile que la Pannonie et bien moins
convenable pour un peuple agriculteur, ce cantonnement plaisait mieux à des
barbares dont le pillage était la seule industrie. Entre Byzance et Thessalonique,
placées à portée de leur épée, les rois amales s’empressèrent de renouveler
un seraient de fidélité qui vaudrait suivant les circonstances ; ils
offrirent même à Léon de lui prêter main-forte, à l’instant même, contre
Théodoric le Louche, alors brouillé avec lui. De pareilles avances étaient
toujours du goût des empereurs ; et, suivant les procédés de la politique
byzantine, les Ostrogoths de Macédoine devinrent une milice impériale opposée
aux Ostrogoths de Thrace qui, de leur côté, devaient tenir ceux-ci en respect[35]. Nous laisserons
dans cette situation Théodémir et son fils ; et, revenant sur nos pas en
Pannonie, nous suivrons l’émigration de Vidémir à travers les Alpes
italiques.
L’émigration de Vidémir avait succédé presque immédiatement
à celle de son frère ; et tandis que lai première colonne des tribus
gothiques pénétrait en Dardanie, l’autre s’acheminait, par la vallée de la Drave. ver- les passages
du Haut Norique[36].
Les Ostrogoths de Vidémir ne rencontrèrent pas devant eux, comme leurs
frères, de grasses campagnes bien approvisionnées, ou de riches villes mal
défendues ; ils parcoururent d’âpres territoires dévastés par la guerre, de
pauvres bourgades vaillamment gardées, et des routes infestées de barbares.
Le départ des Goths avait été reçu comme une délivrance dans toute la vallée
du Danube. Leurs voisins si longtemps opprimés, saisissant avec bonheur l’occasion
d’une revanche, se jetaient de côté et d’autre sur leur passage : Sarmates,
Ruges, Hérules, Turcilinges, naguère tremblants à leur nom, les insultaient,
les traquaient, les harcelaient dans leur marche. Les Ruges laissèrent alors
déborder tout ce qu’ils amassaient depuis vingt ans de colère et de haine
contre ces insolents dominateurs. A chaque pas, la colonne de Vidémir était
arrêtée par des embuscades ; il m’avançait que l’épée au poing, et la
nourriture de chaque jour lui coûtait un combat.
Les villes romaines, sûres d’être saccagées quoi qu’elles
fissent, préférèrent se défendre et fermèrent leurs portes. Il fallut que les
Goths assiégeassent Tiburnie[37], où ils
perdirent beaucoup de monde et de temps. Toutefois ils y trouvèrent un grand
approvisionnement de vêtements et de vivres qui les dédommagea, en partie du
moins, de leurs pertes. C’était cette collecte du Haut Norique, réclamée
plusieurs fois par Séverin et toujours retardée par la négligence des
Tiburniens : ils l’avaient conservée pour les barbares, suivant l’expression
du saint[38].
Après quelque séjour clans cette tille, la troupe de Vidémir atteignit les passages
des Alpes, d’où elle descendit en Italie. Il y eut là, pour des corps
exténués, une dangereuse transition, du dénuement absolu à l’abondance, et de
l’extrême fatigue au repos. Un si brusque changement, accompagné d’excès de
tous genres et aggravé par la mollesse du climat, produisit, au sein de cette
foule désordonnée, des maladies qui la décimèrent. Vidémir fut enlevé un des
premiers[39].
Il mourut laissant à son fils encore adolescent le gouvernement de ses
tribus, et la continuation de la guerre : ce fils s’appelait comme lui
Vidémir[40].
L’occasion eût semblé belle à un empereur romain digne de
ce nom, pour châtier des brigands qui venaient ainsi sans provocation fondre
sur l’Italie. Deux partis s’offraient à Glycerius, partis également sûrs,
quant au résultat, presque également acceptables pour un homme de cœur. Le
premier consistait à passer le Pô sans délai, en profitant de la stupeur de l’ennemi,
à forcer son camp et à rejeter, au delà des Alpes, avec un enfant sans
autorité, un ramas de tribus découragées et malades ; l’autre, plus simple
encore, était de les enfermer au nord du fleuve, pour les y laisser consumer
d’elles-mêmes. Mais Glycerius n’avait ni assez de décision pour le premier,
ni assez de prévoyance pour le second ; il en prit un troisième auquel
personne ne songeait : il entra en négociation avec un ennemi que la seule
vue des enseignes romaines faisait déjà trembler. Des ambassadeurs se
présentèrent en son nom dans le camp de Vidémir, lui demandant ce qu’il
voulait, comme si la chose n’eût pas été assez claire d’elle-même, et que le
roi goth n’eût pas eu à sa disposition l’argument traditionnel des envahisseurs
barbares depuis les Cimbres, à savoir : que chassés hors de leur patrie par
la faim, ils cherchaient des terres à leur convenance, et les prendraient, si
on ne les leur donnait ; que du reste ils désiraient l’amitié des Romains. Si
tel fut le langage de Vidémir, on n’invoqua pas pour lui répondre la fierté
de Marius ; au contraire, les ambassadeurs se montrèrent conciliants jusqu’à
l’humilité. Indiquant du doigt clans le lointain la ligne des Alpes gauloises
qui bornent l’Italie au couchant : Vois-tu là-bas
ces montagnes ? dirent-ils au jeune roi ; elles te séparent d’un peuple de ta race. Le pays situé
par delà est la Gaule,
dont les Visigoths, vos frères, possèdent une partiel : ils y sont puissants,
et disputent le reste à d’autres barbares leurs rivaux. Va les rejoindre ; près
d’eux t’attendent des campagnes d’une merveilleuse fécondité qui deviendront
le lot de ton peuple[41]. Il fut encore
question entre eux de l’Espagne, qui, voisine de la Gaule, offrait aux
Ostrogoths d’autres terres à conquérir et d’autres ennemis à combattre : les
Goths le savaient sans qu’on eût besoin de le leur apprendre.
Telle fut l’ambassade de Glycerius à Vidémir, accompagnée
de grands envois d’argent’, disent les historiens, comme si l’empereur eût pu
craindre de voir de pareilles offres refusées. Si le roi goth feignit quelque
hésitation, ce fut assurément pour obtenir davantage. Les préliminaires
échangés, on avisa aux clauses d’un traité de concession qui mettrait aux
mains des barbares, sans qu’if eussent recours à la violence, un certain
territoire dans le voisinage des Visigoths. Ce traité conférait à Vidémir le
caractère d’un agent romain, ou tout au moins d’un allié que l’empereur d’Occident,
en récompense de ses bons services et en témoignage de leur mutuelle affection,
dotait d’un cantonnement dans le midi
des Gaules. Mandement était fait au préfet du prétoire et autres officiers
représentant l’empereur à l’ouest des Alpes, d’assurer, suivant la nature de
leur pouvoir, l’entière exécution de sa volonté. C’était une pure fiction,
car les fonctionnaires romains, emprisonnés pour ainsi dire au cœur de la Narbonnaise, ne
pouvaient plus rien au delà, hormis dans quelques cités du centre ; et, la
concession d’un territoire transalpin dépendait plus maintenant des Visigoths,
des Burgondes ou des Francs, que de César et du sénat romain. Vidémir, devenu
si soudainement l’allié de Rome prit tout le temps nécessaire pour refaire
son armée aux dépens de l’Italie ; puis il prit le chemin de la Gaule, muni d’instructions
de la chancellerie impériale, délivrées en bonne et due forme.
On ne saurait peindre l’étonnement douloureux qui saisit
les populations gauloises, à l’apparition de ces hideux barbares, au teint
hâve, aux vêtements déchirés, débouchant des Alpes pour déposséder les provinciaux
de leurs terres, au nom de l’empereur. Les Visigoths les reçurent à bras
ouverts comme les envoyés d’une Providence ennemie de Rome ; et les soldats
de Vidémir allèrent, grossir aussitôt l’armée qu’Euric[42] préparait contre
les cités centrales des Gaules. Celles-ci et surtout l’Auvergne, forer de la
résistance gallo-romaine, ressentirent un désespoir qu’on ne saurait peindre.
La question pour elles n’était pas seulement la perte de la Romanité, mais encore
celle de la foi catholique ; car Euric faisait marcher de front dans les
provinces qu’il enlevait à l’empire, l’arianisme et la barbarie ; et c’était
un empereur romain qui se chargeait de recruter des renforts pour une
pareille œuvre ! Des populations catholiques étaient vouées à l’hérésie, en
vertu de rescrits impériaux ! La
Gaule n’eut pas assez de mépris pour un tel prince, de
malédictions pour un tel gouvernement. Elle sentit alors avec un redoublement
d’amertume le malheur d’être attachée au flanc d’un empire ruiné qui la
faisait servir de rançon tour à tour à ses lâchetés et à ses revers. Elle
devait les Visigoths à l’empereur Honorius, qui en la sacrifiant avait au
moins voulu délivrer l’Italie d’un vainqueur qui avait pris et saccagé Rome[43] ; niais Glycerius
lui jetait les Ostrogoths, sans avoir même essayé de les combattre ! Le
pillage des provinces transalpines était l’appât que présentaient les
Italiens à quiconque menaçait leur tranquillité. Ces accusations, souvent
répétées depuis un siècle, ne l’avaient jamais été avec plus de force et de
raison.
Sidoine Apollinaire, dans ces graves circonstances, donna
l’exemple du tirai patriotisme ; il ne se contenta pas de se plaindre, il
agit. Une élection inattendue l’avait arraché, en 471, aux studieux loisirs d’Avitacum,
pour le faire évêque de Clermont ; après de longues hésitations il avait
cédé, et soutenait bravement en face d’Euric, comme Romain et comme chrétien,
cette dignité pleine de périls[44]. Uni de sentiments
avec son beau-frère Ecdicius, alors maître des milices des Gaules, ils
étaient à eux deux l’âme de la cité d’Auvergne[45]. A leur appel,
le peuple de ces montagnes prit les armes ; les provinces voisines en firent
autant ; et une résistance nationale, à la vérité trop circonscrite, s’organisa
pour repousser du même coup les ennemis et les amis de l’empereur. Ceux-ci
cependant s’établissaient sur la lisière des possessions d’Euric, sans qu’il
fût besoin des ordres du prétoire, ni du cordeau des arpenteurs romains : ils
traçaient eux-mêmes leur cantonnement à la pointe de leur épée. Alors,
suivant toute apparence, furent occupés en totalité ou en partie les
territoires du Rouergue, du Périgord et du Limousin[46]. Amales et
Baltes, Goths de l’Est et Goths de l’Ouest, séparés, depuis l’époque où ils
habitaient ensemble les bords du Dniepr, se redonnèrent la main sur les
ruines des villes gauloises : ils ne firent plus qu’un même peuple et un même
corps, suivant l’expression de leur historien[47].
Le contrecoup de cet événement ébranla le reste de l’Occident,
presque aussi violemment que la Gaule. Rome et l’Italie se mirent à rougir du
rôle qu’on leur faisait jouer vis-à-vis du dernier lambeau de leur antique
puissance au delà des Alpes ; elles ne voulaient pas avoir été sauvées à ce
prix. L’armée de son côté se plaignit qu’on lui eût enlevé une occasion de
vaincre qu’elle n’avait pas cherchée peut-être avec grande ardeur. Il s’éleva
enfin contre cette lâche politique comme une réprobation universelle ; et en
face d’un prince sans cœur et d’un patrice imbécile, on put regretter la
tyrannie de Ricimer, qui du moins ne pactisait pas avec l’ennemi. Tandis que
la dignité romaine était ainsi immolée au dehors, la plus détestable
administration régnait au dedans. Tout se vendait au palais de Ravenne ;
aucune fonction n’était accessible au mérite pauvre : il fallait être riche
pour servir l’État, il fallait aussi être vieux, car Glycerius, assiégé de
soupçons, redoutait l’activité de la jeunesse[48]. Le patrice
Gondebaud, protecteur obligé du nouveau prince, ne lui apportait qu’un
embarras et des dangers de plus. L’espèce de folie de vengeance qui tenait
enchaînée au delà des Alpes l’âme de ce barbare lui faisait négliger ou
compromettre sans scrupule les intérêts de l’empereur et ceux de l’empire. A
force d’argent romain, il avait, relevé son parti en Burgondie ; la lutte recommençait
entre les Tétrarques[49] ; et ces
rivalités de barbares à barbares s’ajoutaient aux maux de l’invasion pour
consommer la perte des Gaules. Tout cela concourut à ébranler le gouvernement
de Glycerius qui, fondé depuis dix mois à peine, croulait déjà de tous côtés.
Léon cependant, du fond de son palais de Byzance,
observait avec un secret plaisir le progrès de cette ruine. Il y voyait une
revanche du meurtre d’Anthémius, et une leçon pour le peuple et le sénat de
Rome, qui semblaient vouloir rendre de jour en jour plus irrévocable la
rupture de l’Occident et de l’Orient. Dans le but de compléter et d’accélérer
la revanche, Léon cherchait un candidat qu’il pût lancer sur l’Italie après l’avoir,
pour ainsi dire, marqué au front du sceau de l’autocratie orientale. Ce
candidat, il ne le trouva pas aisément., non que les ambitieux manquassent à
Constantinople, mais parce que la circonstance particulière exigeait
certaines conditions plus rares que le désir d’être empereur, celles, par
exemple, de posséder un nom déjà connu en Occident, et, s’il se pouvait, un
parti tout formé. Après avoir mûrement réfléchi, et pesé plus d’une
candidature, Léon fixa son choix sur un homme à qui tout semblait promettre
un succès facile. Nos lecteurs sans doute n’ont point oublié ce noble et
infortuné Marcellinus, l’idole de l’Italie, mort misérablement en Sicile,
sous le poignard d’un assassin, et dont le meurtre avait été reproché à
Ricimer, comme le plus odieux de ses crimes. Marcellinus, en mourant, laissait
un neveu, fils de sa sœur et d’un certain Népotianus, général assez
distingué, au service de Rome. Les Dalmates le prirent pour chef suprême ou
prince, en remplacement de son oncle ; et depuis cinq ans environ, Julius
Népos (on l’appelait
ainsi) gouvernait paisiblement et sagement le petit État dont Salone
était la capitale, lorsque Léon, conçut le projet d’en faire un empereur d’Occident.
L’histoire ne dit pas à qui, de Léon ou de Népos,
appartint l’initiative de cette idée ; mais la première explication les finit
aisément d’accord. Léon ayant appelé Népos à Constantinople, le nomma
patrice, et lui fit épouser une nièce de sa femme, l’impératrice Vérine. Ce
mariage devait donner au nouveau prince d’Occident son caractère politique,
en même temps qu’il répondait de sa future conduite vis-à-vis de Léon.
Népos, outre ses relations personnelles en Italie et l’influence
attachée au nom de Marcellinus, présentait, pour la réussite de l’entreprise,
certains avantages qui n’étaient point à dédaigner. En sa qualité de prince
des Dalmates, il possédait une flotte, de bons marins, quelques vaillants
soldats, et un port sur l’Adriatique, d’où l’on pouvait, en quinze ou vingt
heures, faire un coup de main sur Ravenne. Quand les choses furent réglées
dans ce sens, le Dalmate regagna Salone, puis une escadre grecque mit à la
voile pour la mer Supérieure, avec une petite armée que commandait un officier
impérial, nomme Domitianus[50]. Domitianus
était porteur du manteau de César dont il devait donner l’investiture à
Népos, après leur débarquement. Les flottes opérèrent leur jonction sur la
côte de l’Adriatique ; et vers le milieu de janvier 474, comme Glycerius
achevait le dixième mois de son principat[51], Domitianus,
forçant l’entrée du port, débarqua Népos à Ravenne. Tous deux prirent possession
du palais impérial, que Glycerius venait d’abandonner. Le peu de soldats
restés à Ravenne ne fit aucune résistance ; et en présence de l’armée grecque,
de la faible garnison Ravennate et de la foule du peuple toujours curieuse de
nouveaux spectacles, Julius Népos fut proclamé César au nom de l’empereur d’Orient[52].
Glycerius (tant la fortune et les hommes le servaient mal) n’avait connu
l’expédition de Marcellinus, que lorsque déjà il était trop tard pour s’en
garantir[53].
Le patrice Gondebaud, qui n’avait rien su prévoir, ne sut rien ordonner au
moment du danger. Glycerius n’essaya même pas de combattre, et l’armée
préposée à la protection de Ravenne ne reçut de son empereur d’autre conseil
que celui de la retraite : elle partit avec lui par la route qui conduisait
aux Apennins. L’intention du fugitif était de se renfermer dans Rome, d’y
appeler autour de lui les troupes campées dans le reste de l’Italie, de faire
en un mot de la grande Métropole occidentale le centre de sa résistance
contre Népos, ainsi qu’avait fait Anthémius contre Ricimer. Mais Rome, peu
flattée de cette confiance et sans affection pour un tel maître, lui ferma
ses portes ; c’est du moins ce qu’on peut induire tant de la position
stratégique de Glycerius, que de la neutralité gardée par le sénat romain
pendant la courte durée de cette guerre. Réduit à courir la campagne,
Glycerius parvint néanmoins à rallier une partie des garnisons du centre et
du nord de l’Italie ; puis il attendit tranquillement l’arrivée de son rival.
Celui-ci ne perdait pas un moment. Se mettant en rapport
avec les divers corps de l’armée italienne et les grands municipes de la Ligurie et de la Vénétie, prodiguant les
faveurs aux uns, les promesses aux autres, il sollicitait une adhésion que la
plupart lui prêtèrent, mais avec réserve et défiance. Au fond, Népos ne
rencontrait point en Italie l’accueil dont il avait pu se flatter : son début
était malheureux. Débarqué furtivement sans avoir été ni appelé, ni consenti
d’avance, à l’insu des populations et presque au mépris du sénat, il
ressemblait assez à un lieutenant de Léon venant occuper Rome au nom de
Constantinople. La présence d’une armée grecque à ses côtés et l’attitude
hautaine de Domitianus ne légitimaient que trop d’ailleurs la susceptibilité
des Occidentaux. Aussi, quelque magie qui entourât encore le nom de
Marcellinus, la cause de Népos n’excita généralement aucune sympathie. On s’arma
cependant, les uns pour elle, les autres contre elle ; mais jamais on n’avait
mis dans une guerre civile autant de tiédeur et d’indifférence.
Népos franchit sans obstacle la barrière des Apennins, si
facile pourtant à défendre ; il n’en rencontra pas d’avantage à travers les
plaines de la Toscane,
et atteignit presque sans coup férir la campagne de Rome. L’armée ennemie se
dispersait à son approche, et ne livra pas un seul de ces combats que l’histoire
enregistre. Parvenu ainsi aux portes de la ville éternelle, Népos n’essaya
point de les forcer ; il voulut respecter l’espèce de neutralité que le sénat
gardait entre son rival et lui. Glycerius, abandonné de lui-même et des
autres, s’enfuit presque seul le long du Tibre, par la route qui conduisait à
ce qu’on appelait le port de Rome. Ce port, situé à dix-huit milles
au-dessous de la ville et aujourd’hui comblé par les atterrissements du petit
bras du fleuve, avait été creusé de main d’homme, sous le règne de Claude ;
Trajan l’avait agrandi par la construction d’un bassin intérieur qui portait
son nom. C’est là que depuis lors stationnèrent les principales flottes de l’empire
; mais au temps dont nous parlons, ces flottes avaient à peu près disparu.
Une voie latérale au Tibre, dont elle suivait les nombreuses sinuosités,
servait au halage des bâtiments qui remontaient de la mer à Rome, et un
troupeau de boeufs était entretenu aux frais de l’État, pour les besoins de
ce service[54].
Suivant toute apparence, l’empereur vaincu espérait trouver à l’ancre quelque
navire au moyen duquel il pourrait échapper à son ennemi et ranimer la guerre
sur un autre point de l’Italie.
Mais Népos, comprenant son dessein, arriva dans le port
presque aussitôt que lui[55]. On n’eut pas de
peine à découvrir le fugitif dans la retraite où il s’était caché ; saisi par
des soldats, il fut traîné devant le nouveau César, et tremblant, agenouillé,
il y attendait son arrêt de mort. Népos n’était pas cruel ; malgré la dureté
des mœurs romaines, encore exaspérée par le mélange des moeurs barbares, il
lui répugnait de répandre le sang. Au lieu d’envoyer quérir le bourreau, il
manda près de lui l’évêque du port, dont la demeure attenante à l’église
bordait le petit bras du Tibre[56] ; et lui
montrant Glycerius, toujours prosterné, il lui commanda de le sacrer évêque.
Le prêtre obéit ; quelques coups de ciseaux, suivis de l’onction
sacramentelle, rendirent à jamais impropre à porter ni casque, ni couronne,
la tête qui ceignait naguère le diadème des Augustes[57]. Craignant
néanmoins que, malgré sa métamorphose, Glycerius ne fût encore un instrument
de trouble en Italie, Népos le fit ordonner évêque de Salone, lui attribuant,
à vrai dire, par cette destination, plutôt une prison qu’un évêché[58]. Le vaisseau sur
lequel devait fuir l’empereur déchu le reçut à son bord évêque malgré lui, et
l’emmena sous bonne escorte jusqu’aux confins de l’Adriatique. Quant à
Gondebaud, il avait disparu : on apprit plus tard que gagnant les Alpes au
plus vite, il était parvenu en Burgondie, où des torrents de sang signalèrent
son retour. Il triompha enfin de ses frères après une longue et terrible
lutte, dont les tragiques aventures effrayaient encore l’imagination des
peuples, au siècle de Grégoire de Tours[59].
|
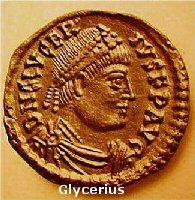 Glycerius était Italien, et, suivant toute vraisemblance,
de la province de Ligurie, où une famille de ce nom avait marqué dans les
charges publiques. Un Glycerius, cinquième successeur de saint Ambroise,
gouvernait en 438 l’Église de Milan avec une double réputation de beauté et,
de sainteté. Son portrait placé dans la galerie des évêques de cette
métropole, offrait le bizarre spectacle d’une figure de vierge candide et
rosée, coiffée d’une tiare et armée d’un sceptre en guise de bâton pastoral
Glycerius était Italien, et, suivant toute vraisemblance,
de la province de Ligurie, où une famille de ce nom avait marqué dans les
charges publiques. Un Glycerius, cinquième successeur de saint Ambroise,
gouvernait en 438 l’Église de Milan avec une double réputation de beauté et,
de sainteté. Son portrait placé dans la galerie des évêques de cette
métropole, offrait le bizarre spectacle d’une figure de vierge candide et
rosée, coiffée d’une tiare et armée d’un sceptre en guise de bâton pastoral