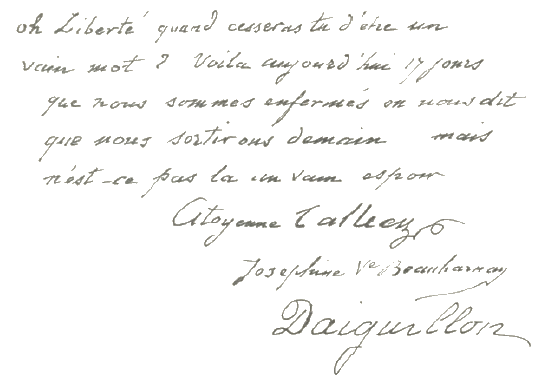JOSÉPHINE
IMPÉRATRICE DES FRANÇAIS - REINE D'ITALIE
À L'OMBRE DE L'ÉCHAFAUD.
|
De retour à Paris, au début de novembre 1790, Joséphine retrouve les siens. Elle s'installe au n° 856 de la rue Neuve des Mathurins, dans l'Hôtel de Beauharnais, qui appartenait à sa belle-sœur et cousine, Marie-Françoise. Alexandre qui continue à habiter à l'Hôtel de La Rochefoucauld, rue des Petits-Augustins, ne cherche même pas à la voir. Hortense est en pension à Saint-Germain chez Mme Campan, avec sa cousine germaine Stéphanie de Beauharnais[1]. Le 31 juillet 1791, Joséphine qui est alors à Fontainebleau, pour la saison d'été, apprend qu'Alexandre a été réélu Président de l'Assemblée Nationale, honneur sans précédent. Il est proclamé l'un des fondateurs de la Liberté. Il commande les ministres et les généraux, donne des ordres en souverain, si bien qu'en voyant passer le petit Eugène dans les rues de Fontainebleau on dit : Voilà le Dauphin ! Des amis communs, Lafayette, d'Aiguillon, Montesquiou, Hérault de Séchelles, Grillon, cherchent à amener un rapprochement entre les époux, mais en vain. Alexandre est intransigeant. La Princesse de Hohenzollern qui s'était prise d'une grande sympathie pour Joséphine ne réussit pas plus que les autres. La vie séparée continue. Le 20 avril 1792, c'est la déclaration de guerre à l'Autriche et à la Prusse. Cette déclaration marque le commencement des six coalitions de l'Europe contre la France (1792 à 1815). Les hostilités commencent immédiatement. Alexandre fait partie du 3e corps que commande M. le Maréchal de Rochambeau. Il quitte Paris sans dire adieu ni à sa femme ni à ses enfants et ils n'allaient se retrouver que dans la prison des Carmes, à l'ombre de l'échafaud. Le 23 mai 1792, Alexandre est nommé Adjudant général et envoyé à l'armée du Nord, sous les ordres de Luckner. Le 4 septembre il est promu maréchal de camp et va remplir les fonctions de chef de l'Etat-major à l'armée du Rhin. Le 21 septembre 1792, la République est proclamée. Le 19 janvier 1793, Louis XVI est condamné à mort et exécuté le 21. Le 13 juin 1793, il est ministre de la Guerre, commandant en chef de l'armée du Rhin et établit son quartier général à Wissembourg. Mayence est assiégée ; il cherche vainement à débloquer cette ville qui capitule le 23 juillet. Un soupçon de trahison plane sur tous les généraux. Custine et Dillon sont arrêtés. De Beauharnais offre sa démission qui est acceptée et il doit s'éloigner dans un séjour dont il donnera connaissance aux Représentants du peuple près l'armée du Rhin, ainsi qu'à la Convention nationale. Alexandre se retire à La Ferté-Aurain où il est chaleureusement accueilli par les patriotes qui l'élisent maire. Le 2 mars 1794 (12 ventôse an II), le Comité Révolutionnaire établi le 25 mars 1793, afin de pourvoir à la défense intérieure et extérieure de la république, sous prétexte d'une conspiration découverte dans les prisons du Luxembourg, donne l'ordre d'arrêter le général Alexandre de Beauharnais, ci-devant commandant en chef de l'armée du Rhin, de le conduire dans une maison d'arrêt de Paris et d'apposer les scellés sur ses papiers, distraction faite de ceux qui seront trouvés suspects. Il était condamné d'avance à la guillotine ! On lui reprochait d'avoir été malheureux à l'armée du Rhin, d'avoir contribué à la reddition de Mayence, et surtout la lettre que son frère avait adressée au président de la Convention Nationale, demandant à défendre le roi Louis XVI : AU PRÉSIDENT DE LA CONVENTION NATIONALE. Monsieur, J'apprends, avec l'Europe, étonné de ce forfait nouveau, qu'on veut attenter à la personne sacrée du Roi, en voulant prononcer son jugement. Je demande à être son défenseur, à plaider la cause de mon maître, de mon roi, de l'homme le plus vertueux de son royaume. Vous voudrez bien faire connaître à la Convention mon vœu. Vous voudrez bien me faire savoir sa réponse. Ce n'est point dans cette lettre que j'indiquerai mes moyens de défense. Ce n'est point ici que je démontrerai quel est le droit politique des peuples sur leur Souverain légitime, et, respectivement, quel est le devoir des Souverains envers leurs sujets. C'est moins devant une Assemblée factieuse et usurpatrice, qui s'est arrogé tous les pouvoirs, que devant le peuple français que j'énoncerai des faits, qui lui feront connaître, et les crimes de ces zélés sectateurs d'une liberté destructive de tout ordre social, et les vertus de Louis XVI, de ce monarque infortuné, fait pour être l'objet de la vénération de ses sujets, qui, triste jouet du sort, et coupable peut-être de trop de bonté, s'est trouvé tour à tour persécuté, trahi et enfin lâchement abandonné par ceux qu'il avait comblé de ses bienfaits. C'est à cette tribune publique que je dévoilerai les complots criminels de ces fourbes politiques, qui se sont emparés des rênes du gouvernement sous le voile du bien public, pour cacher plus adroitement leurs desseins ambitieux. Je désignerai les grands criminels, je ferai voir les replis tortueux de cette politique dangereuse pour tous les gouvernements. La Convention Nationale pourra juger si j'ambitionne la faveur insigne de défendre mon roi, puisque je ne crains pas d'abaisser mon front devant des rebelles ; puisque je ne rougis pas de supplier ce tribunal d'inquisition de m'accorder cette grâce spéciale. L'anarchie dans laquelle est plongée ma malheureuse patrie depuis la révolution, les crimes dont s'est souillée une partie de la nation française, ses attentats envers la famille royale, ses persécutions envers les ministres des autels, et, plus que tout, le désir si naturel à tout sujet fidèle de sauver son roi, et de l'arracher de ses bourreaux ; voilà les motifs qui m'ont fait quitter ma patrie. Ce dévouement volontaire, que je partage avec un grand nombre de mes concitoyens, est un titre dont je me glorifie hautement. Vous pouvez, Monsieur, en instruire l'assemblée. Après m'être opposé de tout mon pouvoir à la destruction de la monarchie, avec cette minorité de l'Assemblée Nationale de laquelle je fais gloire d'avoir été constamment, je suis venu me rallier aux drapeaux de l'honneur pour mourir en soldat, après avoir protesté solennellement contre cette même Constitution que vous aviez juré de maintenir et que vous anéantissez de votre propre autorité. J'attends de vous, Monsieur, une réponse simple et précise : couvrez vos attentats de la justice que je réclame, et que tout accusé doit attendre. Si vous oubliez que Louis XVI est roi, souvenez-vous qu'il est homme : montrez votre impartialité dans une cause qui intéresse tous les gouvernements, sur laquelle l'Europe attentive suspend son jugement, et dont la postérité recueillera précieusement toutes les circonstances. J'ai l'honneur d'être, FRANÇOIS, MARQUIS DE BEAUHARNAIS. Député par l'ordre de la noblesse de Paris aux Etats généraux de France, Aide-Major général de l'armée de Condé. De Beauharnais est arrêté et conduit à la prison des Carmes, l'ancien couvent des Carmes Déchaussés[2] transformé en maison d'arrêt, que l'on voit encore de nos jours, tel qu'il existait alors, 70 rue de Vaugirard. Les bâtiments, les jardins, les couloirs étroits, les murs noircis par le temps, les escaliers avec leurs rampes creusées dans le mur, sont demeurés ce qu'ils étaient lors des massacres de Septembre. On y retrouve le corridor où Maillard procédait à une parodie de jugement, l'escalier au pied duquel furent massacrés le plus grand nombre des prêtres. La crypte de la chapelle Saint-Joseph des Carmes, contient dans deux ossuaires les restes des 115 prêtres massacrés le 2 septembre 1792 et le petit musée qui s'y trouve renferme des souvenirs des victimes. Dans cette hideuse prison était entassé tout un monde vivant dans l'obscurité, l'insomnie, la puanteur et la peur de la mort. Dans la salle dite de garde, on a conservé une partie des enduits humides sur lesquels on peut distinguer les éclaboussures de sang. Deux des égorgeurs, lassés de meurtres, s'étaient reposés un instant et avaient appuyé leurs sabres contre les murs pour reprendre des forces. Le profil de ces deux sabres, depuis la poignée jusqu'à l'extrémité de la lame, est resté imprimé en silhouette de sang. L'image de la mort était sans cesse présente aux yeux des prisonniers, n'épargnait ni leurs regards ni leur imagination et jamais la jeunesse, la beauté, l'amour et la mort n'avaient été groupés dans un tel cadre de sang[3]. Frédéric Masson[4], lui aussi, nous a fait un tableau poignant de cette prison, l'une des plus insalubres de Paris : Des corridors de pierre, larges, obscurs pourtant, longs à l'infini ceux-là qu'emplissait la voix du recruteur des ombres, promenoirs, parloirs, réfectoires, parties neutres qui accèdent sur les préaux ; les escaliers, d'étage en étage plus sordides, menant en haut à des couloirs rétrécis, cahotés, coupés de marches, d'échelles de moulin aux rampes de bois rude qu'ont polis tant de mains ;sur ces couloirs, les cellules s ouvrent, qu'un lit emplit, qui, sous les toits, tantôt brûlantes ou glaciales, prennent jour par un hublot sur une courelle puante , une humidité effroyable, le supplice de la vermine, des fenêtres bouchées, des repas pris en commun, les hommes d'abord, les femmes après ; dans les corridors, jamais éclairés, des cuves pour les besoins, qu'on vide à peine et contre lesquelles on trébuche ; les hommes malpropres, les jambes nues, le col nu, un mouchoir autour de la tête, point peignés, la barbe longue ; les femmes en petite robe ou en pierrot de couleur, se négligeant pour la plupart. L'effroyable demain, l'inexorable tribunal et cet échafaud où il faut monter ! De Beauharnais y trouve tout un monde d'âge, d'origine, d'éducation et de milieu différents, condamnés à la plus complète promiscuité et à se frotter les uns contre les autres en attendant l'union ultime dans la mort. Tous y étaient pêlemêle, grandes dames, gentilshommes et noms obscurs. Il y avait de tout. D'une part des domestiques, des négociants, des soldats, des journaliers, des cultivateurs, des magistrats, des prêtres, des dentistes, des blanchisseurs, des matelots, des horlogers, des ingénieurs, des épiciers, des armuriers, des hommes de loi, des banquiers, des marchands de vin, des cochers, des poètes ; de l'autre, un ministre de la République, Deschamps, un ancien ministre, Destoumelles, un membre de la Convention, Dentzel, le prince Salm-Kyrbourg, le maréchal de Broglie, Lazare Hoche, le célèbre général en chef de l'armée de la Moselle, le comte Leneuf de Sourdeval, le marquis de Laguiche, compositeur émérite, M. de Rohan-Montbazon, le duc de Béthune-Charost, l'abbé de Boulogne, les frères Saint-Peru, M. de Gouy d'Arcy, M. de Mesgrigny, le comte de Soyecourt et Champcenetz, M. Charles-Louis-Ange de Beauvoir. Le livre d'écrou de la prison qui a été conservé aux archives en énumère 707 noms. Du côté des dames, on relève ceux de la citoyenne Ferrary, veuve d'un maréchal de camp, la ci-devant comtesse de Jarnac, la comtesse. Charles de Lamoth, la duchesse Jeanne- Victoire du Plessis-Richelieu, née Noailles, la duchesse d'Aiguillon[5], la comtesse de Sourdeval et ses deux filles, la dame Gaillard de Voursac, la marquise de Paris-Monbrun (âgée de soixante-neuf ans), née de Bragelonne, et sa sœur (âgée de soixante-sept ans), supérieure du couvent des Ursulines, la délicieuse marquise de Custine (Delphine), née Sabran, la jeune et belle Thérésia Cabarrus (Mme de Fontenay), aimée de Tallien et qui était accusée d'avoir amolli le républicanisme du représentant de Bordeaux et d'avoir soustrait des victimes à la proscription. Tous étaient traités comme des condamnés à mort. Le grand pontife du Comité de Sûreté générale, Vadier, écrivait à Fouquier-Tinville que ce serait une calamité publique s'il en échappait un seul au glaive de la loi. Heureusement, tous ne furent pas exécutés. C'est par un article de journal que Joséphine eut connaissance du soi-disant complot. Malgré la séparation, malgré les avanies de son mari, ayant bon cœur, elle se tenait au courant de tout ce qui intéressait Alexandre et elle écrivit aussitôt à sa chère tante Fanny qu'elle appelait sa seconde mère : Un article de journal du matin m'a glacée d'effroi ;
et comme il vous parviendra demain, je me hâte de le faire précéder de son
correctif. Vous y lirez qu'une grande conspiration a
été découverte dans la maison de réclusion du Luxembourg ; l'avoir découverte
et la signaler, ajoute le journaliste, c'est l'avoir déjouée et même
anéantie. L'un des chefs paraît être le ci-devant vicomte de Beauharnais,
membre de l'Assemblée dite Constituante, et l'un de ses présidents. Par ce
qu'on a démêlé, dans les lettres interceptées, les papiers saisis et les
interrogatoires subis, on peut comprendre qu'il ne s'agissait de rien moins
que d'opposer une résistance à l'action du gouvernement révolutionnaire.
Cette résistance, d'abord d'intention, n'attendait vraisemblablement qu'une
conjecture favorable pour devenir armée. Telle était la doctrine, telle eût
été la conduite des conjurés. Ils étaient servis, dans leurs coupables
manœuvres, par un jeune homme attaché à Beauharnais[6] et qui parait avoir été placé au Comité révolutionnaire de
la section, pour servir de plastron aux conspirateurs. Grâce au citoyen
Laflotte, ceux-ci voient déjà rompre leur trame liberticide : sous peu de
jours, l'œil du gouvernement l'aura totalement démêlée et sa main, armée pour
consolider la République, n'aura pas tardé à punir ceux qui semblent ne vivre
que pour la renverser. Ma chère tante réduira ces grandes phrases à leur expression simple et vraie. La conspiration est imaginaire ; la dénonciation attribuée en effet à un ex-ambassadeur en Toscane, a produit les mouvements que je vous ai racontés et qui probablement vont s'arrêter. Pourquoi continueraient-ils ? On n'a rien découvert, parce qu'il n'y a rien à découvrir ; on n'aura point à punir des conspirateurs parce qu'il n'y a pas de conspiration. Il eût été possible que, par défaut de renseignements, l'article du journal vous eût épouvantée ; c'est le premier effet qu'il a produit sur moi ; mais après un quart d'heure de réflexions, et depuis que j'écris cette lettre, je me rassure. A-t-on recours aux exagérations de l'imposture, lorsque l'exposé seul de la vérité suffit pour persuader ? P.-S. — Je rouvre ma lettre pour vous annoncer que le citoyen Névil est arrêté ; c'est ce qu'il me mande verbalement par une jeune personne avec laquelle il est lié, et qu'il doit épouser. Cet incident bannit ma sécurité et me rend toutes mes terreurs. Joséphine sait le danger que court son mari mais dans sa tendresse pour sa tante elle veut lui épargner une trop grande douleur. Plus tard, en apprenant l'arrestation d'Alexandre, elle écrit cette seconde lettre : Ah, ma tante ! plaignez-moi, consolez-moi, conseillez-moi : Alexandre est arrêté ; au moment où je vous écris, on le conduit au Luxembourg ! Dès avant-hier, un homme de mauvaise mine rôdait autour de la maison. Hier, vers trois heures, on vint demander au portier si le citoyen Beauharnais était revenu de Saint-Germain. Or, mon mari n'est point à Saint-Germain depuis le mois de mai. Vous étiez avec nous, ma tante ; et Cubières, si vous ne l'avez pas oublié, nous lut des vers sur le pavillon de Luciennes. Le même homme reparut dans la soirée, il était accompagné d'un grand vieillard sec et brusque qui fit quelques questions : — C'est bien Beauharnais le vicomte ? — Ci-devant, répondit le portier. — Qui a été président de l'Assemblée ? — Je crois que oui. — Et qui est officier général ? — Oui, monsieur. — Monsieur ! interrompit aigrement le questionneur ; tu vois, ajouta-t-il, en se tournant vers l'autre qui ne disait rien, tu vois que la caque sent toujours le hareng. Là-dessus ils disparurent. Aujourd'hui, à huit heures, on demanda à me parler : c'était un jeune homme d'une figure douce et honnête ; il portait un tablier de cuir, dans lequel étaient quelques paires de souliers. La citoyenne a demandé des chaussures de prunelle grise ? dit-il. Victorine était là, quand il me fit cette question, à laquelle je ne comprenais rien. Je regardais ma femme de chambre qui n'en savait pas plus que moi. Le jeune homme avait un air peiné ; il tournait un soulier dans ses mains, et fixait sur moi des regards douloureux. Enfin, il me dit à demi-voix et en s'approchant : J'ai à vous parler, Madame. Son ton, ses regards, un soupir qu'il réprima me causèrent de l'émotion. Expliquez-vous, lui dis-je vivement, Victorine n'est pas de trop. — Ah ! s'écria-t-il comme malgré lui, il y va de ma tête. Je me levai brusquement et renvoyai Victorine, après lui avoir ordonné d'avertir mon mari. — Madame, dit le jeune ouvrier, quand nous fûmes seuls, vous n'avez pas un moment à perdre pour sauver M. de Beauharnais. Le comité révolutionnaire a pris cette nuit la résolution de le faire arrêter et à l'heure qu'il est on rédige l'ordre. Je me sentais pâlir et défaillir. Et comment savez-vous ? demandai-je en tremblant. — Je suis du comité, répondit-il, en baissant les yeux, et comme je suis cordonnier j'ai pensé que ces souliers seraient un bon prétexte pour avertir Madame. J'aurais embrassé cet honnête jeune homme. Il s'aperçut que je pleurais, et je crois que les larmes lui vinrent aux yeux. En ce moment, Alexandre entra et je courus dans ses bras. Vous voyez que c'est mon mari, dis-je au cordonnier. — J'ai l'honneur de le connaître, répondit-il. Votre neveu apprit le service qu'on lui rendait ; il voulait le récompenser sur-le-champ, mais le jeune homme s'en défendit d'une manière à augmenter notre estime. Alexandre lui tendit la main, que le jeune homme prit avec respect, mais sans embarras, Ah ! ma tante, ne vous faites pas chausser par d'autres que lui. Malgré nos sollicitations, Alexandre ne voulut pas fuir. Que peut-on me reprocher ? disait-il, j'aime la liberté, j'ai servi la révolution et si cela avait dépendu de moi elle serait terminée au profit du peuple. — Mais vous êtes noble, répondit le jeune homme, et c'est un tort aux yeux des révolutionnaires. — C'est un malheur, irréparable, que l'on peut changer en crime, ajoutai-je. Et puis ils vous reprochent
d'avoir fait partie de la Constituante. — Mon
ami, répondit Alexandre, d'un air noble, d'un ton ferme, c'est mon plus beau titre de gloire, c'est même le seul
que je réclame. Qui ne serait fier d'avoir proclamé les droits de la nation,
la chute du despotisme et le règne des lois ? — Quelles lois, m'écriai-je, c'est
avec du sang qu'elles sont écrites ! — Madame,
dit le jeune homme, avec un accent que je ne lui avais pas encore vu, quand l'arbre de la liberté est planté dans un mauvais
terrain, c'est avec le sang de ses ennemis qu'il faut l'arroser. Nous nous regardâmes, M. de Beauharnais et moi ; et dans ce jeune homme, que la nature a fait sensible, nous reconnûmes le révolutionnaire que les nouveaux préjugés pourraient rendre cruel. Cependant l'heure s'écoulait, il prit congé de nous, en réitérant à mon mari que dans une heure il ne serait plus temps de se soustraire aux recherches. — J'ai voulu vous sauver, parce que je vous crois innocent, dit le cordonnier, c'était mon devoir envers l'humanité, mais, si j'étais commandé pour vous arrêter... pardonnez !... je ferais mon devoir, et vous reconnaîtriez un patriote. Je verrai toujours dans vous un honnête homme, un cœur sensible et généreux ; il est impossible que je n'y trouve pas un bon citoyen. Quand il fut sorti : Voilà, me dit Alexandre, les nouveaux préjugés dont ils abreuvent cette jeunesse. Le sang des nobles, même les plus dévoués aux nouvelles idées, doivent nourrir la liberté ! S'ils n'étaient que turbulents, cette soif sanguinaire, cette ardeur du despotisme s'éteindraient, mais ils sont systématiques et Robespierre a réduit l'action révolutionnaire en doctrine. Son mouvement ne s'arrêtera que quand ses ennemis réels ou présumés seront anéantis, ou lorsque son auteur ne sera plus. Mais c'est un opiniâtre qui croit que pour fortifier la liberté, il faut lui faire cuver du sang. — Vous me faites frémir, dis-je à Alexandre, pouvez-vous parler ainsi et ne pas fuir ? — Où fuir ? répondit-il, est-il une cave, une mansarde, un réduit où ne pénètre l'œil du tyran ? Songez qu'il voit par les yeux de quarante mille comités animés de son esprit et fort de sa volonté. Le torrent est débordé, le peuple en s'y jetant le grossit. Il faut céder ; si je suis condamné comment me soustraire ? Si je ne le suis pas, libre ou détenu, je n'ai rien à craindre. Mes larmes, mes sollicitations furent vaines. A midi moins un quart, trois membres du Comité révolutionnaire parurent, et la force armée s'empara de l'hôtel. Vous pensez que mon jeune cordonnier était au milieu d'eux ? Vous ne vous trompez pas ; et quoique les fonctions qu'il exerçait me fissent de la peine, je vous avoue que je ne les lui vis pas remplir sans une sorte de satisfaction. Il se chargea de signifier à Alexandre l'ordre qui le mettait en arrestation, ce qu'il fit avec autant d'égards que de fermeté. Au milieu d'une crise si douloureuse pour moi, je ne pus m'empêcher de remarquer l'air d'autorité et le ton décent que conservait ce jeune homme, que sa condition semblait devoir rendre étranger à tout emploi, mais qui s'en rapproche beaucoup par l'élévation de l'âme, jointe au tact des convenances. Ses deux confrères, qui en ignoraient jusqu'aux éléments, formaient avec lui le plus choquant contraste. L'un, qui est ce vieil inquisiteur qui, la veille, s'était inquiété de la présence et des occupations de mon mari, est un ancien planteur de la Martinique[7], lequel, en dépit de l'égalité, n'a jamais vu dans l'espèce humaine que deux classes : celle des maitres et celle des esclaves. Son opinion est qu'on ne terminera la révolution que lorsqu'on aura réduit ses ennemis à la condition des nègres exportés du Sénégal en Amérique ; et pour atteindre ce but, il demande que la traite des prêtres, des nobles, des riches, des savants et de toutes classes aristocratiques, aille remplacer à Saint-Domingue celle des noirs que la Révolution a supprimé. Par cette mesure, ajouta-t-il, vous obtenez deux grands résultats : l'un, c'est la tranquillité de la métropole et l'objet de la révolution, c'est-à-dire l'égalité ; l'autre, c'est le renouvellement de la population des colonies, et la restauration du commerce. De plus, vous rendez hommage à la nation innocente, en maintenant l'abolition de la traite sur les côtes d'Afrique, et punissez la nature orgueilleuse et corrompue, en transportant cette traite sur les côtes de France. C'est ainsi que les vrais républicains assurent, par des mesures d'une haute et profonde politique, le triomphe de la morale. Ces derniers mots me furent adressés par les regards méchants que me lança l'œil creux de ce vieillard féroce. Son troisième collègue, brutal et grossier, inventoriait bruyamment les principaux meubles et les papiers. De ces derniers, il choisit ce qu'il voulut, en fit une liasse qui fut scellée dans un carton et envoyée au Comité. Ce sont pour la plupart des rapports de discours prononcés par Alexandre à l'Assemblée Constituante. Cette assemblée est en horreur aux révolutionnaires ; elle n'est pas moins odieuse aux aristocrates de tout rang et de toutes nuances. Cela ne prouverait-il pas qu'elle a résolu tous les problèmes de la révolution, et qu'en matière de liberté, elle avait fondé tous les établissements ? Au régime de 89, elle a ôté tous moyens ; à celui de 93, elle enlève toute espérance. Alexandre m'a souvent répété qu'à l'une comme à l'autre, il ne restait pour naître, ou pour ressusciter, que la violence et les attentats. Pourquoi faut-il qu'il prédise si juste, et qu'au titre de prophète il veuille joindre encore celui de martyr ? Joséphine qui, malgré ses mauvais traitements, malgré la séparation qui existe entre eux, a de l'affection pour son mari, n'avait pas cessé de le voir, de causer avec lui de l'avenir de ses enfants et parfois même de la politique. Elle n'hésite pas à faire des démarches pour sauver sa tête. Elle ne parviendra qu'à compromettre la sienne. N'est-elle pas vicomtesse et ce titre n'est-il pas suffisant pour la rendre suspecte ? Après avoir obtenu un certificat de civisme, chose peu facile pour une ci-devant aristocrate, elle fait appel aux membres du - Comité de Sûreté générale : Vadier, Jagot, Dubarrau, David, qui restent sourds à ses démarches. Elle implore Lebas, Louis (du Haut-Rhin), Lavicomterie, Tallien ; tous sont inflexibles ou incapables d'intervenir. Tallien lui conseille, d'écrire à Vadier, le président du Comité. Elle s'exécute : Paris, 28 nivôse, l'an II de la République française une et indivisible. LIBERTÉ — ÉGALITÉ LAPAGERIE BEAUHARNAIS À VADIER REPRÉSENTANT DU PEUPLE. SALUT, ESTIME, CONFIANCE, FRATERNITÉ. Puisqu'il n'est pas possible de te voir, j'espère que tu voudras bien lire le mémoire que je joins ici. Ton collègue m'a fait part de ta sévérité, mais, en même temps, il m'a fait part de ton patriotisme pur et vertueux et que, malgré tes doutes sur le civisme des ci-devants, tu t'intéressais toujours aux malheureuses victimes de l'erreur. Je suis persuadée qu'à la lecture du mémoire, ton humanité. et ta justice te feront prendre en considération la situation d'une femme malheureuse à tous égards, mais seulement pour avoir appartenu à la famille d'un ennemi de la République, à Beauharnais l'aîné, que tu as connu, et qui, dans l'Assemblée Constituante était en opposition avec Alexandre, ton collègue et mon mari. J'aurais bien du regret, Citoyen représentant, si tu confondais dans ta pensée Alexandre avec Beauharnais l'aîné. Je me mets à ta place : tu dois douter du patriotisme des ci-devant, mais il est dans l'ordre des possibilités que, parmi eux, il se trouve des ardents amis de la Liberté et de l'Egalité. Alexandre n'a jamais dévié de ces principes ; il a constamment marché sur la ligne. S'il n'était pas républicain, il n'aurait ni mon estime, ni mon amitié. Je suis américaine et ne connais que lui de sa famille, et s'il m'eût été permis de te voir, tu serais revenu de tes doutes. Mon ménage est un ménage républicain. Avant la révolution, mes enfants n'étaient pas distingués des sans-culottes et j'espère qu'ils seront dignes de la République. Je t'écris avec franchise, en sans-culotte montagnarde. Je ne me plains de ta sévérité que parce qu'elle m'a privé de te voir et d'avoir une petite conférence avec toi. Je ne te demande ni faveur, ni grâce, mais je réclame ta sensibilité et ton humanité en faveur d'une citoyenne malheureuse. Si on m'avait trompé en me faisant le tableau de la situation et qu'elle fut et te parût suspecte, je te prie de n'avoir aucun égard à ce que je te dis, car, comme toi, je suis inexorable ; mais ne confonds pas ton ancien collègue. Crois qu'il est digne de ton estime. Malgré ton refus, j'applaudis à ta sévérité pour ce qui me regarde, mais je ne puis applaudir à tes doutes sur le compte de mon mari. Tu vois que ton collègue m a rendu tout ce que tu lui avais dit : il avait des doutes ainsi que toi, mais voyant que je ne vivais qu'avec des républicains, il a cessé de douter. Tu serais aussi juste, tu cesserais de douter si tu avais voulu me voir. Adieu, estimable citoyen, tu as ma confiance entière. LAPAGERIE- BEAUHARNAIS. N° 46, rue Saint-Dominique, faubourg Saint-Germain. Que de finesse, que de diplomatie dans cette lettre. En défendant Alexandre elle défend sa propre existence qu'elle sait menacée. Le 30 germinal (19 avril), le Comité de Sûreté générale ordonne l'arrestation de la nommée Beauharnais, femme du ci-devant général, rue Saint-Dominique ; la nommée Hosten, même maison, et le nommé Croiseul, leur allié, demeurant à Croissy, près Chaton. Examen sera fait de leurs papiers et extraction de ceux trouvés suspects, qui seront apportés au Comité, perquisitions seront faites, les scellés apposés, procès-verbal dressé et les sus-nommés et tous autres chez eux trouvés suspects, .conduits dans des maisons d'arrêt de Paris pour y rester détenus par mesure de sûreté générale. Cet ordre est transmis à la section des Tuileries qui décide : SECTION DES TUILERIES. Comité de surveillance révolutionnaire. Le Concierge de la maison d'arrêt des Carmes recevra la citoyenne Beauharnais, femme du général, suspecte, aux termes de la loi du 17 septembre dernier, pour y être détenue jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Fait au contrôle le 28 floréal 1793, l'an 2e de la République Française une et indivisible. Suivent les signatures. Le 20 avril dans la soirée, deux membres du Comité révolutionnaire de la section des Tuileries, Lacombe et Georges, auxquels est adjoint un membre de la section Fontaine-Grenelle, sont chargés de l'exécution de ces ordres. Ils se présentent rue Saint-Dominique où Joséphine logeait alors avec ses deux enfants, Eugène et Hortense dans le petit hôtel qu'occupait également la veuve Hosten[8] avec sa petite fille Jeanne-Rose-Sylvie-Désirée, née à la Martinique le 17 mai 1779 et qui avait épousé au mois d'août 1793, à dix-sept ans et trois mois, Jean-Henri de Croiseuil, âgé de trente-trois ans. Après avoir perquisitionné, comme ordonné dans toute la maison, ils apposent les scellés sur deux secrétaires et deux armoires qui sont dedans un grenier dans lequel ils ont déposé le papier correspondance du citoyen Beauharnais que sez effets (sic), dressent un procès-verbal dans lequel ils déclarent qu'après la recherche la plus scrupuleuse nous navons rien trouvez de contraire au interêt de republique, au contraire une multitude de lettre patriotique qui ne peuve faire que l'éloge de cette citoyenne (sic), et ils conduisent la malheureuse à la prison des Carmes où elle va rester cent huit jours. Avant de partir, elle a le temps de griffonner au crayon un mot pour sa bonne amie la princesse de Salon à qui elle recommande ses enfants. Durant le trajet elle s'évanouit deux fois. Comme dans cette prison les détenus allaient et venaient assez librement, elle s'empresse dans l'obscurité de rechercher son mari qui la reçoit dans ses bras avec une grande effusion de larmes et de tendresse. Face à, la mort, c'est la réconciliation. Ils ne s'aimaient plus mais les tristes événements avaient enfin réussi à faire naître dans le cœur d'Alexandre un sentiment sincère. S'ils s'étaient tous deux consolés d'une rupture devenue inévitable, vivant séparés depuis dix années, du moins, devant l'échafaud, ils pouvaient tout oublier pour ne penser qu'à leur triste sort et celui de leurs enfants qui bientôt seraient orphelins. Aussitôt après, Joséphine écrit à sa tante Fanny : Je commence cette lettre à l'aventure, et sans savoir si elle vous parviendra. Avant hier mardi, la mère de Névil entra chez moi, avec l'expression du chagrin, de la douleur même sur sa physionomie ; sur-le-champ, mon idée se porta sur son fils. Ce n'est pas pour lui que je pleure, me dit cette bonne femme en sanglotant ; quoiqu'il soit au secret, je ne tremble pas pour ses jours ; il est d'une classe à laquelle on pardonne, ou plutôt qu'on oublie. D'autres sont plus exposés que lui. — D'autres ?... ma pensée sauta tout à coup au Luxembourg. — Alexandre est-il au tribunal ? m'écriai-je. — Rassurez-vous, il n'est point question de Monsieur. Je ne voyais pas alors pour qui il fallait m'alarmer. Ma pauvre bonne femme, avec beaucoup de précautions, m'explique que c'était moi : je devins tranquille sur-le-champ. Après avoir tremblé pour ce qu'on aime, mon Dieu, qu'il est doux de n'avoir plus peur que pour soi ! Hier soir, je trouvai une lettre anonyme qui m'avertissait du danger. J'aurais pu fuir, mais où aller, sans compromettre mon mari ? Décidée à attendre, je m'entourai de mes enfants et dans leurs innocentes caresses j'aurais presqu'oublié mes adversités, si leur présence même ne m'avait plus vivement retracé l'absence de leur père. Le sommeil les arracha de mes bras, dont il semblait qu'un instinct plus tendre les' rapprochait davantage. Hélas ! l'amour qui unit une mère à ses enfants a aussi ses superstitions ; et je ne sais quel pressentiment invincible me plongeait dans une terreur stupide. Jugez si, restée seule, je pus écarter ce pénible sentiment. Le ciel m'est témoin cependant que les trois êtres chéris qui font mon bonheur, font aussi toute ma peine : comment songer à moi dès qu'ils sont menacés ? Je continuais à me plonger dans ces réflexions quand un grand bruit se fit entendre à la porte de l'hôtel. Je compris que mon heure était venue ; et trouvant dans l'inévitable coup qui allait me frapper le courage nécessaire pour le souffrir, je me résignai. Tandis que le tumulte croissait, je passai dans la chambre de mes enfants : ils dormaient ! et ce contraste de leur sécurité avec le trouble de leur mère, fit couler mes larmes. Hélas ! je déposai sur le front de ma fille peut-être mon dernier baiser, elle sentit les larmes maternelles et, toute endormie, passant 'autour de mon cou ses bras caressants : Couche-toi, me dit-elle, à demi-voix, et ne crains rien ; ils ne viendront pas cette nuit. Je l'ai demandé à Dieu ! Cependant on entrait en foule dans mon appartement, où, à la tête d'hommes farouches et armés, je trouvai ce même président que sa faiblesse rend inhumain, et auquel la paresse donne tant de préventions. Celles qu'il avait contre moi lui parurent justifier mon arrestation ; sans examen, comme sans probabilité, je vis qu'il croyait fermement à ce qu'on a l'audacieuse bêtise de nommer la conspiration du Luxembourg. Quand la sottise est réunie à la méchanceté, mon Dieu ! qu'elle fait mal ! Je vous épargne les détails inutiles, en voilà déjà trop de douloureux. Qu'il vous suffise de savoir que, les scellés apposés sur les meubles fermant à clef, j'ai été conduite dans la maison de détention des Carmes. Oh ! quel frisson j'ai ressenti en franchissant ce seuil encore teint du sang des victimes. Ah ! ma respectable tante ! que de crimes sont prêts à commettre des hommes qui n'ont pas puni ces crimes exécrables ! La cellule où avait été conduite Joséphine était relativement vaste. On y descendait par deux marches. Une lucarne grillée ouvrait sur le jardin. Le passage entre les murs froids, par les larges escaliers de pierre et sous les couloirs sombres, avait donné à Joséphine l'impression d'entrer dans une tombe. C'était en effet une tombe que cette prison d'où l'on ne sortait guère que pour monter à l'échafaud ! Un seul matelas, étendu sur le pavé, dans une niche au fond du cachot, servait de couche à trois captives, car Joséphine y retrouva deux autres femmes de sa connaissance : la très belle Duchesse d'Aiguillon[9] et la jeune et non moins belle Thérésia Cabarrus[10], toutes deux bien connues. Ces trois femmes formaient un groupe idéal de beauté et de grâce. Thérésia Cabarrus, grâce à l'influence qu'elle exerçait sur Tallien, son amant, allait aider à renverser Robespierre, en inspirant à son futur époux le courage d'attaquer les comités et, ultérieurement, lorsqu'elle devint Princesse de Chimay, Joséphine l'appelait Princesse de Chimère. Thérésia avait la réputation d'être une femme facile. Après son mariage avec de Fontenay, de la période où, âgée de seize à dix-neuf ans, elle fut si désirable que beaucoup s'attribuèrent vaniteusement une conquête en laquelle elle n'avait été cependant pour rien, on lui attribua pour amants le Maréchal de Broglie, Lameth, Félix Lepeletier, de Saint-Fargeau. Elle avait la voix caressante, les paupières aux longs cils battaient doucement sur ses prunelles au regard câlin. Sa main blanche et fraîche fondait entre les doigts avec une noblesse voluptueuse. Les épaules que découvraient ses robes hardies étaient si attrayantes que nul ne pouvait se dérober à leurs charmes[11]. Comme Joséphine, elle avait un cœur d'or, impulsif, et nous savons qu'elle usa de son crédit pour arrachera la mort une foule de personnes, ce qu'on lui reprochait amèrement. Après la libération, Joséphine lui conserva une grande affection. Elle avait été sa compagne d'infortune et avait puissamment aidé a sauvé sa vie en même temps que la sienne. Une fois mariée, Bonaparte ne voulut jamais lui permettre de la recevoir aux Tuileries, pas plus que Tallien d'ailleurs. Pour ne pas déplaire à son mari, elle la rencontrait ailleurs, témoin cette lettre de Joséphine : À MADAME TALLIEN. Il est question, ma chère amie, d'une magnifique soirée à Thelusson ; je ne vous demande pas si vous y paraîtrez. La fête serait bien languissante sans vous. Je vous écris pour vous prier de vous y montrer avec ce dessous fleur de pêcher que vous aimez tant ; que je ne hais pas non plus ; je me propose de porter le pareil[12]. Comme il me parait important que nos parures soient absolument les mêmes, je vous préviens que j'aurai sur les cheveux un mouchoir rouge, noué à la créole, avec trois crochets aux tempes. Ce qui est bien hardi pour moi est tout naturel pour vous, plus jeune, peut-être pas plus jolie ; mais incomparablement plus fraîche. Vous voyez que je rends justice à tout le monde. A demain je compte sur vous. JOSÉPHINE. ***Dans leur prison, les trois femmes se consumaient de souvenirs, d'impatience et de soif de vivre ; elles écrivaient avec la pointe de leurs ciseaux, avec les dents de leurs peignes, sur le plâtre de leurs cloisons, des chiffres, des initiales, des noms regrettés ou implorés, des aspirations amères à la liberté perdue. On y lit encore cette inscription :
Malgré ce cadre de sang, la jeunesse et l'amour n'abdiquent pas leurs droits. La séquestration donne tout au contraire à ce dernier plus d'ardeur et de feu. Menacés à tout instant de sortir de cette triste cellule pour marcher à la guillotine, il semble que l'on voulait s'étourdir par le bruit des éclats de rires et toute la folie de l'inconséquence prouvée à l'excès. C'est souvent au milieu d'une histoire plaisamment racontée, d'une scène de proverbe jouée avec esprit, que les geôliers venaient annoncer la sentence d'un des infortunés. Dans cette affolante société de Beauharnais, comme s'il eut été un jeune écolier de vingt ans, s'est épris de l'ensorceleuse et captivante Delphine de Custine, entrée à la prison dix jours après lui. Elle, non plus, n'a pas été heureuse en ménage, mais quand son mari fût, en décembre 1793, menacé de mort et conduit à la Conciergerie, elle s'était dévouée à lui héroïquement au point de risquer sa propre vie, dans une folle tentative d'évasion. Custine ne consentit pas à compromettre d'autre tête que la sienne et préféra l'échafaud. Il lui envoya une dernière lettre, navrante de résignation et de regrets contenus, avec ses cheveux que le bourreau venait de tailler. C'est à la suite de ces émotions que la pauvre Delphine, âgée de vingt-quatre ans, avait été amenée aux Carmes. Delphine ne s'était pas effarouchée de sa nouvelle conquête. Avec un insolent dédain de la mort, elle avait accueilli l'amour de Beauharnais, comme un rayon de soleil dans l'obscurité de sa prison. Elle s'y était abandonnée au point d'oublier l'horreur de la situation. Elle partagea les transports d'Alexandre avec une exaltation si passionnée que la passion des deux amants devint la fable de la prison et ne put être ignorée de Joséphine aussitôt après sa venue. Joséphine, qui n'avait nullement le désir de reprendre son mari, assista avec indifférence à ces ébats amoureux et n'éprouva qu'indulgence et pitié pour Delphine. On a cru devoir rapporter que, de son côté, Joséphine ne resta pas indifférente aux déclarations de Lazare Hoche, le célèbre général en chef de l'armée de la Moselle qui, reconnu suspect, fut incarcéré dans la même prison, le 22 germinal, et y demeura trente-cinq jours. La chose paraît impossible, car Hoche fut gardé dans une cellule isolée, complètement détachée de celle qu'occupait Joséphine, et s'il fut séduit par la grâce de la belle créole, il n'a pu qu'entretenir avec elle quelques conversations. On rapporte aussi que Désirée Hosten de Croiseuil inspira une passion violente à un compagnon de captivité : Charles-Louis-Ange de Beauvoir. L'enfantine beauté de Désirée le bouleversa et ce fut tout de suite la grande passion. En ce lascif printemps de l'an II, les sensibilités étaient attisées et la touchante idylle se prolongea soixante jours, au bout desquels Ange de Beauvoir fut appelé par l'échafaud. Un enfant naquit de cette union clandestine, s'il faut croire le journal du geôlier Coittant, puisqu'on y a trouvé plus tard cette annotation sur son registre : Une femme détenue, Croiseille (sic) âgée de quatorze à quinze ans est sur le point d'être mère. Vivant dans une atmosphère de sang, de larmes et d'angoisse perpétuelle, les prisonniers dans leur sombre isolement oubliaient tout préjugé, toute rancune, toute jalousie. Obsédés par le cauchemar de la guillotine, attendant à chaque minute la mort, ils cherchaient l'oubli dans des exaltations passionnées. Hoche qui était enfermé dans sa cellule tuait le temps en achevant les plans d'une prochaine campagne, comme s'il était assuré de reprendre son commandement. J'ai commandé, disait-il, sur les champs de bataille, un boulet pouvait m'emporter à chaque instant ; cela ne m'a jamais empêché de prévoir ce que je ferais une heure, un jour ou un mois plus tard. La mort est un accident, un accident bête avec lequel on ne doit pas compter. L'échafaud réclamait quotidiennement sa pâture. Chaque fois que l'on frappait à la porte du réduit, chacun s'attendait à voir entrer le spectre de la mort. Quand la charrette du tribunal, conduite par le cocher Budelot, entrait dans la cour, toute la maison était avertie ; les pourvoyeurs de Fouquier-Tinville faisaient l'appel au bas de l'escalier de pierre et, groupés à chaque étage, les prisonniers guettaient les noms. Celui qui entendait prononcer le sien serrait les mains tendues, tâchait de garder bonne contenance, descendait les marches, répondant d'un sourire forcé aux vœux de bonne chance et se livrait au bourreau. Joséphine, très superstitieuse, passait ses jours à tirer les cartes et ses nuits à tremper de larmes son grabat, et à gémir sur le sort de ses enfants qui, elle et leur père disparus, seraient dans la misère. Eugène, âgé de treize ans, était maintenant apprenti menuisier chez le père Cochard, agent national de la commune de Crossy et Hortense, de deux années plus jeune, apprenait la couture chez la citoyenne Lanoy. C'était donner preuve de civisme. Les cartes lui ont-elles alors confirmé la prophétie de la femme caraïbe ? Si oui, plus que jamais elle a dû penser : Quelle ironie ! Ses enfants venaient souvent la voir. Pour l'informer des choses du dehors, dont personne n'osait parler de vive-voix, ils cachaient des billets sous le collier d'un petit chien, appelé Fortuné, un carlin, bête laide et hargneuse que Joséphine avait adoptée et que maintenant elle accueillait à grand renfort de caresses. Ils apportaient aussi de beaux fruits envoyés par la bonne tante Fanny. Toujours compatissante, douce et affectueuse, Joséphine gémissait beaucoup plus sur la captivité des autres que sur la sienne et consolait tous ceux qui l'entouraient, leur donnant l'espoir. Elle multipliait les démarches pour sauver son mari et faisait oublier, par le charme de son esprit, le tragique de l'heure. Bienveillante avec les inférieurs, égale et aimable avec les égaux, polie avec les autres, elle jouissait dans la prison de l'affection générale et fut aimée, comme plus tard, sur le trône de France où l'amour du jeune Buonaparte devait l'élever. Le tact des convenances était inné chez elle. A sa tante Fanny, qui lui a envoyé de beaux fruits, elle écrit : Avec les beaux fruits que vous m'avez envoyés, ma bonne tante, j'ai reçu l'ingénieux billet renfermé dans l'un d eux. Mes enfants sont donc avec vous[13] ! Dieu soit loué, c'est pour mon cœur un grand point de repos. Pourquoi mon mari n'est-il pas avec eux ? Je n'ai point de ses nouvelles[14] ; je n'en ai point de Névil ; et la mère de ce dernier n'a pu obtenir encore la permission de me voir. Jugez de mes inquiétudes ! Tout s'empresse autour de moi pour me les faire oublier. Mais le cœur d'une épouse, d'une mère, quand il est meurtri, peut-il s'ouvrir si aisément à l'espérance et aux consolations ? Elle apprend que son mari a été interrogé. Elle écrit encore à sa tante Fanny : Alexandre a été interrogé hier, et j'aurai ma permission demain. Le président du Comité est un homme assez honnête, mais apathique et nul, auquel je ne sais combien de quintaux d'embonpoint ôtent le mouvement, les idées et presque la parole. Avec les meilleures intentions du monde, il a moins d'autorité que le dernier garçon de bureau. Il arrive tard, gagne son fauteuil en geignant, s'assied pesamment, et quand il est assis, reste un quart d'heure sans parler. Pendant ce temps, un secrétaire lit des rapports qu'il n'entend pas, quoiqu'il ait l'air de les écouter. Quelquefois il s'endort pendant la lecture, ce qui ne l'empêche pas de se réveiller justement pour signer ce qu'il n'a ni écouté ni compris. Quant aux interrogatoires qu'il commence et que chacun de ses confrères continue, il y a quelques-uns d'atroces, un plus grand nombre de ridicules : tous sont plus ou moins curieux. Qu'y a-t-il de plus singulier, en effet, que de voir l'élite de la société expliquer ses pensées à ceux qui, malgré leur élévation, en sont encore la boue ? Quand je parle, ainsi, ma tante, pensez bien qu'il n'est question ni de naissance, ni de fortune, ni de privilèges mais de principes, de conduite, de sentiments[15]. De Beauharnais ne se fait aucune illusion sur le sort qui lui est réservé. Entraîné, comme tant d'autres, par la séduisante philosophie du commencement de la révolution, il désirait des changements dans le système du Gouvernement et considérait l'amour du bien et de la patrie son plus cher devoir. Ce fut son crime, vis-à-vis de ses enquêteurs et il paya de sa vie la noblesse de ses sentiments. Joséphine, pour le distraire, lui envoie des livres, lui confie ses espoirs. Alexandre répond : Pauvre amie, quelle erreur est la vôtre ! L'espérance vous abuse ; mais au temps où nous vivons, l'espérance trompe et trahit. J'ai lu attentivement l'ouvrage de Camille[16] : c'est celui d'un homme de bien, mais d'une dupe. Il écrit, dites-vous, sous la dictée de Robespierre, c'est possible ; mais après l'avoir poussé, le tyran le sacrifiera. Je le connais, moi, cet opiniâtre, qui ne recule devant aucune difficulté. et qui, pour le triomphe de son détestable système, jouera s'il le faut le rôle d'un homme à sentiments. Robespierre, dans la conviction de ses sentiments, se croit appelé à régénérer la France, et comme ses vues sont courtes et son cœur froid, il ne voit de régénération réelle que dans un bain de sang : c'est la plus facile, car les victimes sont parquées, et le boucher n'a qu'à étendre la main pour les traîner à la boucherie. Cependant, quelques-unes avant d'expirer, ont jeté un cri lamentable, et c'est ce cri que le crédule Camille est chargé de reproduire, pour tâter l'opinion. Quel que soit son vœu, elle trouvera une opposition dont le tyran s'emparera pour immoler de nouvelles victimes. A quelques détails près, voilà sa tactique. Il m'est affreux, ma chère Joséphine, de détruire l'illusion de votre cœur ; mais puis-je en conserver, moi qui ai vu de si près les manœuvres de la tyrannie ? Quand on ne peut lui opposer une force qui la brise, il n'est plus qu'un moyen de lui résister : c'est de recevoir ses coups avec une vertu qui la déshonore. Nos successeurs, au moins, profiteront de l'exemple, et le testament des proscrits ne sera pas perdu pour l'humanité ! Non content d'avoir interrogé le père, le Comité fait subir un long et minutieux interrogatoire aux enfants. Joséphine, révoltée, écrit à sa tante : Le croiriez-vous, ma tante, mes enfants viennent de subir un long et minutieux interrogatoire ! Ce vieillard méchant, membre du Comité, et duquel je vous ai déjà parlé, s'est transporté chez moi, et, sous prétexte de s'inquiéter de mon mari et de m'en entretenir, il a fait causer mes enfants. J'avoue que d'abord j'ai été la dupe du stratagème : seulement je m'étonnais de l'affabilité du personnage ; mais bientôt elle s'est trahie par la malignité, par l'aigreur même qu'il témoignait lorsque les enfants, répondaient de manière à ne pas donner la moindre prise contre leurs infortunés parents. La ruse m'a été connue promptement. Lorsqu'il a vu que je l'avais pénétré, il a cessé de feindre, et m'avouant qu'il était chargé d'obtenir de mes enfants des renseignements d'autant plus certains qu'ils seraient ingénus, il a procédé à un interrogatoire en forme. Alors il s'est passé en moi une révolution inexplicable ; j'ai senti que je pâlissais d'effroi, que je rougissais de colère, que je tremblais d'indignation. J'allais exprimer au vieux révolutionnaire toute celle qu'il m'inspirait, lorsque j'ai songé que je ferais plus de mal encore à M. de Beauharnais, contre lequel cet homme exécrable paraît déchaîné ; j'ai donc modéré ma colère. Il m'a invitée à le laisser seul, avec mes enfants. J'ai voulu résister, mais j'ai remarqué tant de fureur dans ses yeux que j'ai été contrainte de lui obéir. Il a enfermé Hortense dans un cabinet et a commencé à questionner son frère. Le tour de ma fille est venu : oh ! pour celle-ci, dans laquelle il a reconnu une finesse prématurée et une pénétration fort au-dessus de son âge, il l'a tenue fort longtemps. Après les avoir sondés sur nos discours, nos opinions, les visites et les lettres que nous recevions, surtout sur les actions dont ils avaient pu être témoins, il aborda la question capitale, je veux dire le propos tenu par Alexandre. Mes enfants, chacun selon son caractère, ont très bien répondu et malgré la subtilité d'un méchant qui veut trouver des coupables, l'ingénuité de mon fils et la spirituelle adresse de sa sœur ont déconcerté la fourberie, s'ils ne l'ont pas confondue. Que fera-t-on de cet interrogatoire, tel que la vérité le dicta à des bouches sincères ? Il ne peut servir qu'au triomphe de l'innocence et à la honte de ses accusateurs : oseront-ils le produire s'il doit causer ce double échec ? Toujours le même silence sur ce malheureux Névil[17] : malgré ma répugnance, je me suis décidée à demander audience à un membre du Comité de la Sûreté générale, Louis (du Bas-Rhin), dont on dit moins de mal que de ses collègues. Votre neveu m'avait expressément défendu de voir ces hommes, qu'il regarde comme les bourreaux de notre patrie, mais il n'a pu me défendre de solliciter par reconnaissance et en faveur de l'amitié. S'il l'eut fait, j'aurais eu la force de le désobéir. J'ai l'horreur des ingrats, et n'en grossirai certainement jamais le nombre. Et quelques jours plus tard : La journée d'hier fut à la fois bien douce et bien pénible. Mon mari avait désiré de voir ses enfants, et par les soins de notre ange tutélaire, il l'avait obtenu ; mais pour épargner leur jeune sensibilité, je résolus de les lui envoyer d'abord, et Névil se chargea de les introduire. On leur avait dit, depuis quelques jours, que leur père était malade, il s'était mis entre les mains d'un médecin fameux, lequel, à cause de la salubrité de l'air et de l'abandon des bâtiments, s'était logé au Luxembourg. La première entrevue se passa très bien : seulement Hortense remarqua que les appartements de son papa étaient bien réduits et que les malades étaient bien nombreux. Quand j'arrivai à mon tour, ils n'étaient pas chez leur père ; un honnête porte-clef, gagné par Névil, ayant eu la précaution de les tenir écartés. Ils étaient en visite chez des voisins, touchés de leur jeunesse, de leur position et de leur ingénuité. Je craignais le spectacle de notre mutuel attendrissement ; il eut lieu, sans qu'ils en fussent témoins. Alexandre, qui supporte sa captivité avec courage, n'en eut pas d'abord contre mes larmes ; cependant, moi-même effrayée de le voir trop ému, je parvins à me calmer et je le consolai à mon tour. Nos enfants reparurent, et ce fut une nouvelle crise, d'autant plus pénible qu'il fallut en dissimuler la cause. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dans les visites que mes enfants avaient faites, et par les discours que ma fille entendait et recueillait, elle avait deviné que son père était prisonnier. Nous avouâmes ce qu'il n'était plus possible de cacher. — Et le motif ? demandait Hortense. Son frère, moins timide qu'à l'ordinaire, voulait aussi connaître la raison de cette rigueur. Il eut été bien difficile de les satisfaire. Etrange abus de la force ; coupable et méprisable excès de l'arbitraire, qu'un enfant peut dénoncer, que tout le monde devrait avoir le droit de punir, et dont on n 'ose même pas se plaindre ! Oh ! quand nous le pourrons, nous punirons tes dénonciateurs, s'écria Hortense. — Taisez-vous, ma fille, lui dit son père, si l'on vous entendait parler ainsi, je serais perdu, vous le seriez vous-même, aussi bien que votre mère ; et nous n'aurions pas la consolation de l'être tout à fait injustement. — Ne nous avez-vous pas dit souvent, remarqua Eugène, qu'il était permis de résister à l'oppression ? — Je vous le répète encore, répondit mon époux, mais la prudence doit accompagner la force ; et qui veut vaincre la tyrannie, doit bien se garder de l'avertir. Peu à peu la conversation prit un tour moins sérieux. On oublia le malheur présent, pour se livrer à de doux souvenirs et à des projets. Vous comprenez que dans ces derniers vous étiez pour beaucoup. Je veux infiniment de bonheur à ma tante, dit en riant Alexandre, cependant, comme on dit que les Muses ne sont jamais si intéressantes que quand elles sont affligées, je souhaiterais à celle de ma tante quelques jours de captivité : il nous en reviendrait une belle élégie, et la gloire du poète, en immortalisant sa prison, le consolerait aisément du chagrin de l'avoir habitée. Que diriez-vous de ce souhait, ma chère tante ? Peut-être le jugerez-vous dans vos véritables intérêts ; pour moi, qui aime encore plus votre personne que vos vers, je ne puis m'empêcher de faire un vœu contraire ; et dussiez-vous ne jamais joindre à celui d'Ovide et de Mme de La Suze, continuez d'écrire en prose et demeurez libre, pour être heureuse, en vous livrant au besoin de votre cœur, celui de faire du bien. Joséphine apprend que le citoyen Prosper Sijas, qu'elle avait rencontré et qui avait été si aimable pour elle, a été nommé adjoint ail Ministère de la Guerre, et qu'il a obtenu qu'Alexandre sera entendu en plein comité, elle lui écrit de suite, cherchant à innocenter son mari : J'apprends, citoyen, que vous êtes chargé de préparer le rapport que le représentant Louis (du Bas-Rhin) doit faire au comité de Sûreté générale, sur l'affaire du général Beauharnais : j'en remercie le ciel ; et si je connaissais celui qui vous a remis cette besogne, je l'en remercierais plus expressément. Si l'on m'eut donné le choix d'un juge, c'est sur vous, citoyen, qu'il serait tombé. J'avais ouï parler de vous ; et toujours votre nom a été accompagné de ces épithètes honorables, mais senties, que la flatterie ne trouverait pas, qui ne peuvent être inspirées que par la reconnaissance, et qui ne sauraient être trompeuses. Depuis, le hasard, ou plutôt le ciel moins sévère pour moi, m'a mis un instant en relation avec vous- : cet instant m'a sufi pour comprendre que le témoignage de vos obligés s'accordait avec la vérité. Et moi aussi, je suis devenue une de celles dont vous avez cherché à adoucir les maux. J'ai à joindre ma voix à celles des malheureux auxquels vous auriez voulu faire oublier leurs calamités. Toutefois, vous n'ignorez pas que les miennes augmentent et s'enveniment d'autant de jours que mon époux n'est point jugé. Car ce n'est plus sa liberté qu'il sollicite, c'est son jugement qu'il demande ; un brave militaire en a le droit, lorsqu'il est accusé d'un délit qui compromet son honneur. Alexandre de Beauharnais conspirateur ! Un des fondateurs de la liberté méditant sa ruine ! celui qui, parmi cent autres, fut distingué pour préparer la république, essayant de la renverser ! Vous ne l'avez jamais cru, citoyen, et ceux qui l'accusent ne le croient pas plus que vous. Mais l'important est que ses juges ne le croient pas davantage. Qu'ils vous entendent, et ils seront dissuadés. Ne leur dites même pas que son épouse, aussi innocente que lui, gémit loin de lui, sous des verrous autres que les siens : je ne parle de moi, que pour vous faire apprécier l'injustice des persécutions exercées contre Alexandre. Oubliez la mère persécutée et ses enfants dispersés, pour ne vous occuper que du père, de l'époux, ou plutôt du soldat, du citoyen digne de recouvrer l'honneur et la liberté. Aux Carmes, on lisait avec avidité tous les journaux que l'on pouvait se procurer. Une publication, le Cahier du Vieux Cordelier, laisse entendre que les prisonniers seront bientôt relâchés. Aussitôt Joséphine écrit à Alexandre[18] : Oh ! pour cette fois, mon ami, vous prendrez de mes almanachs ! Le troisième et le quatrième Cahier du Vieux Cordelier ont commencé à vous persuader ; mais que direz-vous de celui-ci ? Je m'empresse de vous l'envoyer : on se l'arrache, on le divise pour le lire par morceaux ; on pleure en le lisant, on s'embrasse après l'avoir lu ; la moitié de nos détenus ont commandé des fêtes, des parties de campagne, des ameublements nouveaux. Hier, Mme de S....[19] a fait venir un maquignon, avec lequel elle a conclu le renouvellement de son écurie. De son côté, le vieux du Merbion, avec lequel vous vous rappelez d'avoir chassé au Raincy, fait venir d'Ecosse six couples de furets comme on n'en vit jamais. Enfin, les fournisseurs de toutes espèces sont retenus pour le mois ; et quand nous sortirons, je ne sais si nous trouverons un morceau de pain. La mère de Névil partage nos espérances et notre joie ; et vous, mon cher Alexandre, vous ne les détruirez pas par une prévoyance cruelle, une défiance mal fondée, et tous les sinistres pressentiments qu'inspirent trop d'expérience, le souvenir d'une famille et l'aspect des verroux. Au revoir, mon ami, je ne vous embrasse pas aujourd'hui sur un froid papier, parce que je me réserve de vous prodiguer bientôt des baisers plus réels. Les événements, hélas, prirent une tournure toute différente de celle qu'anticipait Joséphine. Maitre absolu, Robespierre allait multiplier les exécutions[20]. De Beauharnais fut condamné à mort le 6 thermidor. Dans la nuit du 6 au 7, de la Conciergerie, il écrivit à sa femme cette dernière lettre : Encore quelques minutes à la tendresse, aux larmes et aux regrets puis, tout entier à la gloire de mon sort, aux grandes pensées de l'immortalité ! Quand tu recevras cette lettre, ma Joséphine, il y aura bien longtemps que ton époux ne sera plus, mais il y aura déjà quelques instants qu'il goûtera, dans le sein de Dieu, la véritable existence. Tu vois donc bien qu'il ne faut pas pleurer ; c'est sur les méchants, les insensés qui lui survivent, qu'il faut répandre des larmes ; car ils font le mal et ne pourront le réparer. Mais ne noircissons pas de leur coupable image ces suprêmes instants. Je veux les embellir, au contraire, en songeant que, chéri d'une femme charmante, j'aurais pu voir s'écouler sans le plus léger nuage les années que j'ai passées avec elle, si des torts que je reconnais trop tard n'eussent troublé notre union[21]. Cette pensée m'arrache des pleurs ; ton âme généreuse m'a pardonné dès que j'ai souffert ; je dois te récompenser de tes bienfaits, en en jouissant sans te les rappeler, puisque c'est te faire souvenir de mes erreurs, et de tes peines. Que de grâces je dois à la Providence qui te bénira ! Aujourd'hui, elle dispose de moi avant le temps, et c'est encore un de ses bienfaits. L'homme de bien peut-il vivre sans douleur, quand il voit l'univers en proie aux méchants ? Je me féliciterais donc de leur être enlevé, si je ne sentais que je leur abandonne des êtres précieux et chéris. Si pourtant les pensées des mourants sont des pressentiments, j'en éprouve un dans le fond de mon cœur, qui m'assure que ces horribles boucheries vont être suspendues ; qu'aux victimes vont succéder les bourreaux, que les arts et les sciences, prospérités des Etats, refleuriront en France[22], que des lois sages et modérées régiront après de si cruels sacrifices ; et que tu obtiendras le bonheur dont tu fus toujours digne et qui t'a fui jusqu'à présent, nos enfants s'en chargeront ; ils acquitteront la dette de leur père Je reprends ces lignes incorrectes et presque illisibles, que mes gardiens avaient interrompues. Je viens de subir une formalité cruelle, et que, dans toute autre circonstance on ne m'aurait fait supporter qu'en m'arrachant la vie ; mais pourquoi se révolter contre la nécessité V la raison veut qu'on en tire le meilleur parti. Mes cheveux coupés, j'ai songé à en racheter une portion, afin de laisser à ma femme, à mes enfants, des témoignages non équivoques, des gages de mes derniers souvenirs. Je sens qu'à cette pensée mon cœur se brise et que des pleurs mouillent ce papier... Adieu, tout ce que j'aime ! Aimez-vous, parlez de moi, et n'oubliez jamais que la gloire de mourir, victime des tyrans, martyr de la liberté, illustre l'échafaud. De Beauharnais fut exécuté le 7 thermidor, en même temps
que le délicat poète André Chénier. Bien étonné eut été le jeune général si,
tandis que la charrette le transportait à la guillotine, une voyante comme
Velléda, prêtresse des Bructères, ou un prophète comme Tiséras, dans la
légende grecque, lui était apparu et lui avait prédit : Ta jolie veuve, Joséphine, sera Impératrice des Français ;
ton jeune fils, Eugène, vice-roi d'Italie et gendre du premier roi de
Bavière, et le fils de ce fils épousera la fille aînée d'un Tsar ; ta jeune
fille, Hortense, sera reine des Pays-Bas et mère de l'Empereur Napoléon III,
qui sera fait prisonnier à Sedan par un Empereur allemand ; tes descendants
occuperont les trônes de Suède, de Norvège, de Danemark, du Brésil,
d'Anhalt-Dessau, de Köthen et de Bernburg ; ta petite nièce, Stéphanie sera
Grande Duchesse de Bade, deviendra l'aïeule française d'un roi de Belgique[23], et un de tes arrières-petits-fils le dernier chancelier
de l'Allemagne impériale : le prince Max de Bade ![24] Les lettres précitées prouvent irrévocablement qu'avant la mort d'Alexandre, les deux époux s'étaient rapprochés. Dans son cœur que ne pénétra jamais la haine, dès qu'elle connut les souffrances de son mari, Joséphine lui avait rendu toute sa tendresse. Touché par la noble conduite et le dévouement de sa femme, de Beauharnais avait, une fois de plus, confessé ses torts et Joséphine avait pardonné à l'infidèle. La dernière pensée du jeune général fut pour cette femme admirable. On juge l'effroi de Joséphine en recevant le lendemain (8 thermidor) la dernière lettre de son mari et en apprenant son exécution. Avec ses compagnes d'infortune, elle se livre au désespoir, les sanglots emplissent la cellule. Soudain l'administrateur de police y pénètre et, avec un atroce sourire, annonce à Joséphine qu'il viendra enlever le lendemain son lit de sangle pour le donner à un autre prisonnier, car, dit-il, vous n'en aurez plus besoin ; on doit venir vous chercher demain pour vous mener à la conciergerie et de là à la guillotine. Joséphine, à son tour, envisage la mort et doit s'y préparer. Elle écrit à ses enfants en leur envoyant une mèche de ses cheveux : La main qui vous remettra ceci est fidèle et sûre : c'est celle d'une amie qui a éprouvé et partagé mes douleurs. Je ne sais par quel hasard on l'épargna jusqu'ici ; j'appelle ce hasard une bonne fortune ; elle le nomme une calamité. — N'est-il pas honteux de vivre, me disait-elle hier, quand tous les gens de bien ont l'honneur de mourir ? Puisse le ciel, pour le prix de son courage, lui refuser ce petit honneur ! Quant à moi, je suis digne de le recevoir, et je m'y prépare. Pourquoi la maladie m'a-t-elle épargnée ? Mais, dois-je murmurer ? Epouse, ne dois-je pas suivre le sort de mon époux ? En est-il de plus glorieux aujourd'hui que l'échafaud ? C'est presque un brevet d'immortalité que l'on achète par une mort prompte et douce. Mes enfants, votre père y est mort et votre mère y va mourir. Mais puisqu'avant ce moment suprême les bourreaux me laissent quelques instants, je veux les employer à m'entretenir avec vous. Socrate, condamné, philosopha avec ses disciples : une mère, prête à l'être, peut causer avec ses enfants. Mon dernier soupir de tendresse, et je veux que mes dernières paroles soient une leçon. Il fut un temps où je vous en donnais de plus douces. Mais celle-ci, pour être donnée dans un moment sévère, n'en sera que plus utile. J'ai la faiblesse de l'arroser de mes larmes ; bientôt j'aurai le courage de la sceller de mon sang. Personne jusqu'ici ne fut plus heureuse ; si c'est à mon union avec votre père que j'ai dû ma félicité, j'ose croire et dire que c'est à mon caractère que j'ai dû cette union. Tant d'obstacles s'y opposaient ! sans efforts d'esprit, j'ai su les aplanir. Ainsi, je puisai dans mon cœur les moyens de gagner l'affection des parents de mon mari ; la patience, la douceur, finissent toujours par obtenir la bienveillance des autres. Vous possédez aussi, mes enfants, les avantages naturels qui coûtent si peu et qui valent tant ; mais il faut savoir les employer, et c'est ce que je me plais encore à vous enseigner par mon exemple. En vous rappelant où je suis née, vous jugerez combien, dès mes premières années, ils me furent utiles ; c'est sous-entendre combien ils le furent aux autres. La première époque de ma vie, passée à la Martinique, m'offrait le spectacle singulier de l'esclavage, qui ne devint si affreux que par celui du despotisme qui le domine. Représentez-vous sept à huit cents misérables, auxquels la nature donna un ton d'ébène, et de la laine pour cheveux, et que la cupidité, devenue féroce par les dangers qu'elle court à se satisfaire, arrache à leur patrie, pour les transplanter sur un sol étranger. Là, désunis, comme famille, mais assemblés en ateliers, ou groupés en travailleurs, ils offrent à un soleil brûlant leurs membres pressés dans des liens de fer, sous le rotin d'un commandeur ; ils fouillent une terre que leur sueur, que le sang même ne fertilise pas pour eux. C'est pour enrichir des maîtres barbares que ces infortunés furent retranchés de la loi commune du genre humain ; c'est pour assouvir l'avarice américaine qu'ils végètent nus, sans asile, sans propriétés, sans honneur, sans liberté. c'est pour éveiller les voluptés de l'Europe, qu'ils sont dès l'enfance, pour la vie, et sans espoir, condamnés à ces supplices. Cependant les tyrans, dont ils sont les esclaves, ou pour mieux dire les bêtes de somme, se gorgent de richesses, s'enivrent de jouissances, sont rassasiés de plaisirs. Fiers d'une couleur qui n'est qu'un hasard de la nature, orgueilleux de quelques connaissances qui pourtant les tiennent à plus de distance des Européens instruits, que les noirs n'en conservent relativement à eux, non seulement ils oublient qu'ils sont chrétiens, mais encore qu'ils sont hommes. Et pour comble de cruauté, ils érigent en droits leur conduite impie, et justifient par des sophismes d'inquisiteurs un régime de cannibales[25] ! Tel était, à l'époque de mon enfance, le tableau général de la colonie : celui que présentait notre habitation en différait beaucoup. C'était encore des maîtres et des esclaves, mais les uns se montraient sans dureté et les autres, pleins de zèle, vivaient sans douleurs. A la liberté près, les noirs partageaient tous les avantages de la société et quelques-uns les plaisirs de la vie. L'amour ne leur était pas interdit, et des mariages assortis récompensaient leur longue tendresse. Loin de leur patrie, ils voyaient croître leur famille et se développer leurs alliances. Et lorsqu'au son du tambour ils exécutaient, sous des berceaux de palmiers, leurs danses nationales, ils pleuraient de joie, et croyaient avoir retrouvé leur pays. Je n'étais point étrangère à leurs jeux, parce que je n'étais ni insensible à leurs peines, ni indifférente à leurs travaux. Je vivais sur l'habitation de votre tante Renaudin, cette excellente femme, cette bonne parente, cette âme parfaite, dont nous avons si souvent parlé, et qui mourrait aujourd'hui de douleur en voyant sa nièce immolée : comme elle a si longtemps gémi de regrets quand sa prévoyance nous sépara. Je dis sa prévoyance, et ce n'était peut-être alors que sa tendresse. Diverses circonstances avaient amené à la Martinique un jeune officier plein de grâces et de mérite : je puis le louer avec transport, c'était votre père qui, après avoir fait de moi une heureuse épouse, devait me rendre à la fois la mère la plus glorieuse et la plus infortunée[26]. Le mari de Mme de Renaudin avait réuni à la gestion de ses propriétés celle des domaines dont MM. de Beauharnais venaient d'hériter : rien ne lui paraissait mieux assorti que notre union, puisque celle projetée avec votre oncle, par nos deux familles, n'avait pas eu l'approbation de celui-ci, qui avait fait un autre choix. Je veux ici consigner la reconnaissance que je dois à mon excellent beau-père, qui m'a, dans plusieurs circonstances, donné des preuves d'une amitié sincère, quoiqu'il fût d'une opinion absolument différente de celle de votre père, qui embrassa les idées nouvelles avec toute l'exaltation d'une imagination très vive. Il croyait de bonne foi conquérir la liberté, en obtenant quelques concessions du Roi, qu'il vénérait et aimait. On perdit tout, et l'on n'obtint que l'anarchie. Qui arrêtera ce torrent ? Oh ! Dieu, si tu n'envoies une main puissante qui le réprime et qui l'enchaîne, c'est fait de nous[27]. Pour moi, mes enfants, qui vais mourir, comme votre père, victime des fureurs qu'il a toujours combattues, et qui l'ont immolé, je quitte la vie sans haine contre la France, et ses bourreaux que je méprise ; pénétrée de compassion pour les malheurs de mon pays. Honorez ma mémoire, en partageant mes sentiments. Je vous laisse pour héritage la gloire de votre père, le nom de votre mère, dont quelques infortunés se souviendront ; notre amour, nos regrets et notre bénédiction. L'heure du destin n'avait pas sonné ! La prédiction d'Eliama devait tout d'abord se réaliser et, après avoir échappé à l'échafaud, elle devait monter sur les trônes de France et d'Italie. Plus que reine ! Thérésia Cabarrus, prévoyant qu'elle allait, elle aussi, comparaître devant le terrible tribunal, loin de se résigner comme Joséphine, s'était révoltée. Elle avait une telle soif de la vie et des plaisirs ! Séduisant un des geôliers, elle parvint à faire passer à son amant, Tallien, le billet suivant : L'administrateur de police sort d'ici, il est venu m'annoncer que demain je monterai au tribunal, c'est-à-dire à l'échafaud. Cela ressemble bien peu au rêve que j'ai fait cette nuit : Robespierre n'existait plus et les prisons étaient ouvertes... mais grâce à votre insigne lâcheté il ne se trouvera bientôt plus personne en France capable de le réaliser. Tallien se contenta de répondre : Soyez aussi prudente que je suis courageux, et calmez votre tête. Thérésia, exaltée par la lecture des Cahiers du Vieux-Cordelier, avait rêvé la mort de Robespierre et la libération de tous les prisonniers. Son rêve s'accomplit. Le tyran, après avoir tant fait tomber de têtes, monta à son tour sur l'échafaud. Le 9 thermidor marqua la fin de la Terreur, clôtura la liste des exécutions qui désolaient la France. Fouché et Tallien, — la Montagne et la Plaine — s'étaient alliés pour abattre le tyran. Après une si longue tyrannie on allait pouvoir respirer. Avec le même accent de rigoureuse conviction, avec le même ton froid et impassible qui avaient condamné le 9 germinal Danton, Westermann, Camille Desmoulins, Lacroix, Fabre d'Églantine, Hérault de Séchelles, Chabot, Philippeaux et les autres, Fouquier-Tinville lut les décrets de hors la loi qui envoyaient à la guillotine Maximilien Robespierre, son jeune frère, Augustin, qui était l'ami de Bonaparte[28], Couthon, Saint-Just, Dumas, Hanriot et Le Bas, condamnant aujourd'hui les ennemis de ceux qu'ils avaient immolés quatre mois avant. Le lendemain, 10 thermidor, an II (28 juillet 1794) les condamnés furent attachés au bois de la charrette par les jambes, par le tronc et par les bras. Les cahots du pavé arrachaient des gémissements à Robespierre, blessé la veille, par une balle qui lui avait percé la lèvre inférieure et fracassé les dents. Il avait la tête entourée d'un linge taché de sang, qui soutenait son menton et se nouait sur ses cheveux. Sur tout le parcours, rue Saint-Honoré, les portes et les fenêtres, les balcons, les toits étaient encombrés de spectateurs et surtout de femmes en toilette de fête, les épaules et les bras nus, les seins exposés. — A la mort ! A la guillotine ! criaient autour de la charrette, les mères, les fils, les parents, les amis des victimes. Les gendarmes de l'escorte, montraient Robespierre au peuple, avec la pointe de leurs sabres. Il détournait la tête et levait les épaules, comme s'il eût eu pitié de l'erreur qui lui imputait à lui seul tant de forfaits rejaillissant sur son nom. Son intelligence toute entière respirait dans ses yeux. Son attitude indiquait la résignation, non la crainte. Le mystère qui avait couvert sa vie couvrait sa pensée. Il mourait sans dire son dernier mot. Arrivés au pied de la statue de la liberté, les exécuteurs portèrent les condamnés sur la plateforme de la guillotine. Aucun d'eux n'adressa ni parole, ni reproche au peuple. Ils lisaient leur jugement dans la contenance étonnée de la foule. Robespierre monta d'un pas ferme les degrés de l'échafaud. Avant de détacher le couteau, les exécuteurs lui arrachèrent le bandage qui enveloppait sa joue, pour que le linge n'ébréchât pas le tranchant de la hache. Il jeta un rugissement de douleur physique qui fut entendu jusqu'aux extrémités de la place de la Révolution. La place fit silence. Un coup sourd de la hache retentit. La tête de Robespierre tomba. Une longue respiration de la foule, suivie d'un applaudissement immense, succéda au coup de couteau. Avec Robespierre finit la grande période de la Révolution. Elle avait duré cinq années, cinq années qui furent cinq siècles pour la France et dont il ne restait qu'un vaste cimetière. Sur la tombe de chacune des victimes, tombées justement ou injustement pour la cause de la raison humaine, il est écrit : Mort pour l'avenir et ouvrier de l'humanité. Les idées végètent de sang humain. Les révélations descendent des bûchers et des échafauds. Toutes les religions se divinisent par les martyrs[29] ! La postérité a accordé le pardon aux Terroristes qui illustrèrent de si terrible façon la période la plus tragique de notre histoire révolutionnaire. Camille Desmoulins, Danton, Carnot, Saint-Just ont été immortalisés dans la pierre ou dans le bronze et leurs statues ornent nos jardins publics ou nos boulevards, seule, la mémoire de Robespierre — l'Incorruptible — en dépit du temps qui calme les plus grandes fureurs, reste marquée de la malédiction éternelle. Tout récemment, le 15 octobre 1933, sa ville natale, Arras, lui a élevé un buste, dont l'inauguration a donné lieu à de gros incidents et même des outrages sanglants de la part des citoyens arrageois. L'histoire a conservé une certaine sympathie pour Danton qui, en dépit de ses passions violentes, de ses fautes, a su, aux heures sombres où se jouait l'avenir de la France, espérer toujours et par son courage incarner la résistance pour chasser l'étranger du sol de la patrie, tandis qu'elle reproche à Robespierre, avec une haine instinctive, l'exécution. des Girondins, de Vergniaud, de Mme Roland, de Beauharnais et surtout ne lui pardonnera jamais la mort de ses propres amis, Camille Desmoulins, Fabre d'Eglantine et Danton, qu'il disait aimer d'une affection sincère et qu'il fit exécuter dans des conditions abominables, leur refusant le droit de se défendre. Avant de gravir l'échafaud, Danton lui donna rendez-vous au cimetière des suppliciés. Les muscadins firent alors circuler cette épigramme : Lorsqu'arrivés au bord du fleuve Thlégéton, Camille Desmoulins, d'Eglantine et Danton Payèrent pour passer cet endroit redoutable, Le nautonnier Caron, citoyen équitable, A nos trois passagers voulut remettre en mains L'excédent de la taxe imposée aux humains : — Garde, lui dit Danton, la somme entière, Je paye pour Couthon, Saint Just et Robespierre. ***Le lendemain de la mort de Robespierre, les prisonniers
des Carmes eurent une lueur d'espoir. Une nouvelle incroyable circula : Les monstres du Comité du Salut Public sont sous le
couteau ; les tyrans gravissent à leur tour les marches de la guillotine ;
Robespierre est mort ! Les esprits sont surexcités ; à l'heure habituelle, le soir, aucun geôlier ne parut avec sa liste de condamnés. Une certaine joie se manifesta parmi les détenus, l'espoir renaissait. Le jour suivant, cachés dans du pain, dans des fruits, des billets sont reçus confirmant la bonne nouvelle. Le 5 août (19 thermidor), Joséphine reçut ce mot : Bon courage. Demain vous serez libre. En effet, elle était libérée le 6 août ainsi que les autres prisonniers. Lorsque son gardien vint lui dire : Citoyenne Beauharnais, tu es libre, elle s'évanouit et c'est en larmes qu'elle quitta la prison. Curieuse coïncidence, le jour même où Joséphine était libérée, Bonaparte, reconnu Suspect et accusé de trahison, était arrêté, conduit au Fort Carré à Antibes, enfin relaxé quinze jours après, le 20 août 1794. Il profita de son isolement pour étudier les Codes de Justinien, étude qui semblait alors puérile pour un jeune officier dont la tête était en péril, mais qui, ultérieurement, fut des plus utiles au Premier Consul lorsqu'il présida la Commission du Code Civil. |