HISTOIRE DE L’ASIE
PHÉNICIENSAprès avoir vu toutes les scènes sanglantes que nous présentent les guerres cruelles et presque continuelles des rois de Judée, d’Égypte, d’Assyrie et de Médie, au milieu de ce bouleversement des empires qui se choquaient, s’envahissaient et se renversaient tour à tour, il est doux de reposer sa vue sur le tableau d’une nation pacifique, industrieuse, qui plaçait sa gloire dans l’étude des sciences et des arts utiles, et qui, par son immense commerce, adoucissant les mœurs, éclairant les esprits, servait de lien aux différentes contrées que parcouraient ses vaisseaux agiles et ses actifs négociants.
Les Phéniciens conduisaient les flottes de Salomon sur les côtes d’Afrique, à Ophir, à Tarsis, et, après un voyage de trois ans, leurs navires revenaient chargés d’or, d’argent, d’ivoire, de gomme et de pierres précieuses. Les cèdres du Liban descendaient de cette montagne pour
servir à la construction de leurs vaisseaux ; ils tiraient de l’Égypte leurs
voiles, et leurs cordages. L’observation des astres leur avait appris à parcourir,
sans s’égarer, les mers les plus éloignées. Chypre, Rhodes, Ils tirèrent de grandes richesses des contrées méridionales de l’Espagne, passèrent le détroit et pénétrèrent dans l’Océan. Cadix devint l’entrepôt dé ce grand commerce qui était si riche qu’on vit quelquefois leurs vaisseaux attacher, au lieu de plomb, à leurs ancres, l’argent dont ils étaient surchargés. Un Tyrien, nommé Hiram, construisit le fameux temple de Salomon. Les riches ornements, les métaux précieux qu’on y voyait briller venaient de Tyr et de Sidon. Six cent dix ans avant Jésus-Christ, pour satisfaire la
curiosité hardie de Néchao, roi d’Égypte, des Phéniciens partirent de la mer
Rouge, firent le tour de l’Afrique, rentrèrent dans Les manufactures des Phéniciens étaient célèbres ; les rois les princes et les grands de là terre recevaient d’eux cette pourpre précieuse qui fut un don du hasard pour les Tyriens. On raconté qu’un chien de berger, pressé par là faim, brisa entre ses dents un coquillage dont le sang teignit sa gueule d’une couleur éclatante qui frappa les yeux, et qu’on parvint ensuite à appliquer avec succès aux étoffes destinées à la parure des monarques. Ce peuple navigateur avait fait de grands progrès en astronomie, en géométrie, en mécanique, en géographie. On lui attribue l’invention des lettres, et il surpassa toujours en génie les Égyptiens, dont les superstitions arrêtèrent les lumières. On croit que leur premier roi s’appelait Sidon, fils de Chanaan. Après lui se trouve un long intervalle jusqu’au règne de Tetramnestus, qui fournit trois cents galères à Xerxès pour faire la guerre aux Grecs. Temnès, son successeur, se révolta contre les Perses. Darius Ochus assiégea Sidon. Les habitants de cette ville, ne pouvant obtenir de conditions favorables, et se voyant livrés à leurs ennemis que des traîtres introduisaient dans leurs murs, ne consultèrent plus que leur désespoir, s’enfermèrent dans leurs maisons avec leurs femmes et leurs enfants, y mirent le feu, et s’ensevelirent sous les ruines de leur patrie. Ainsi Darius ne conquit que des cendres d’où il tira cependant encore de grandes richesses en effets précieux et en métaux fondus. Le roi de Sidon seul avait échappé aux flammes : sa lâcheté lui fut inutile, car Darius le fit mourir. Quelques familles sidoniennes, réfugiées sur leurs vaisseaux, se retirèrent à Tyr qu’elles fortifièrent. Cette ville superbe avait perdu ses richesses ; mais elle conserva au moins quelque temps son indépendance. On rebâtit Sidon, et ses habitants nourrirent dans leur cœur contre les Perses une haine qui éclata lorsque le grand Alexandre parut. Les Sidoniens, malgré les ordres de leur prince, ouvrirent leurs portes avec empressement. Alexandre, voulant les rendre heureux, leur donna pour roi Abdolonyme, le plus vertueux de leurs citoyens. Les députés qui lui portèrent la couronne, le trouvèrent dans son jardin, occupé de travaux champêtres. Il résista longtemps, et craignait de quitter la paix de sa retraite pour monter sur le trône. Enfin il céda aux vœux de ses compatriotes ; sa main, qui avait fécondé la terre avec la bêche, porta dignement le sceptre, et sa sagesse fit le bonheur de ses sujets. Le premier roi des Tyriens fut Abibal, prédécesseur de cet Hiram, si connu par ses relations avec Salomon. On ne sait rien de positif sur les sept rois qui lui succédèrent. Pygmalion, leur héritier, ne fut que trop célèbre par son avarice et sa cruauté ; il tua son beau-frère Sichée dans l’intention de s’emparer de ses trésors. Mais Didon, veuve de ce prince infortuné, trompa l’avidité de son frère : elle emporta ses richesses sur des vaisseaux ; et, après avoir parcouru plusieurs mers, elle aborda sur la côte d’Afrique, près d’Utique, et y fonda la célèbre colonie de Carthage. Les Tyriens, dont les richesses étaient enviées par les rois voisins, furent souvent exposés à leurs attaques : ils soutinrent de longs sièges en différents temps ; l’un dura cinq ans, et l’autre treize. Enfin, sous le règne d’un de leurs princes, nommé Baal, Nabuchodonosor surmonta leur opiniâtre résistance. Ne pouvant plus défendre leurs murs, ils se sauvèrent sur leurs vaisseaux et abandonnèrent au vainqueur leurs maisons désertes : il les détruisit. L’ancienne Tyr était sur le rivage ; les Tyriens en rebâtirent une nouvelle dans une île peu éloignée, et la fortifièrent de manière à la rendre presque imprenable. Leur nouveau gouvernement fut républicain ; leurs chefs étaient des juges nommés suffètes. Ils retournèrent ensuite à la royauté. L’histoire de leurs princes n’a point laissé de traces. Pendant un interrègne, les esclaves, que le commerce avait rassemblés en grand nombre à Tyr, tuèrent leurs maîtres, s’emparèrent de leurs trésors et épousèrent leurs veuves et leurs filles. Comme ils voulaient se donner un roi, ils convinrent de nommer celui d’entre eux qui, le lendemain, verrait le premier le soleil et paraîtrait ainsi le plus favorisé par les dieux. Un esclave, qui avait secrètement sauvé la vie à son maître, Straton, lui apprit cette décision. Ce maître reconnaissant lui dit : Au moment où tous les autres regarderont demain l’orient pour épier l’apparition du soleil, prenez un moyen tout opposé ; tournez vos regards à l’occident sur l’endroit le plus élevé de la plus haute tour de la ville, et vous la verrez dorée par ses premiers rayons. Ce conseil fut suivi et réussit. Les esclaves, étonnés de la sagacité de leur compagnon, exigèrent qu’il déclarât la personne qui lui avait donné cet expédient. Il avoua tout, et les esclaves, attribuant aux dieux la délivrance miraculeuse de Straton, le proclamèrent roi. Son fils lui succéda, et le sceptre passa dans les mains de ses descendants, dont le dernier se nommait Azelmie. Sous son règne Alexandre parut devant Tyr. Il voulait, disait-il, punir les crimes commis par ces esclaves deux cents ans auparavant, et venger les citoyens libres qu’ils avaient égorgés. Le siège fut long et la résistance opiniâtre. Alexandre fit construire une digue pour joindre l’île à la terre ferme : ce travail fut souvent interrompu par les assiégés qui accablaient de pierres les assaillants et jetaient des traits enflammés et de l’huile bouillante sur leurs constructions. Au bout de sept mois les Macédoniens prirent d’assaut la ville de Tyr, et passèrent deux mille hommes au fil de l’épée. Alexandre fit mettre en croix autour des murailles deux mille Tyriens de la race des esclaves ; mais il épargna les descendants de Straton. La ville fut détruite et rasée ; sur ses débris Alexandre
bâtit une nouvelle cité qui resta, ainsi que ARMÉNIENSLes Arméniens, qui prétendent aussi être les plus anciens
peuples du monde, vivaient inconnus dans le temps où l’Égypte et Les deux Arménies sont hérissées de montagnes où l’on trouve les sources du Tigre et de l’Euphrate. Leurs habitants croient que l’arche de Noé e’est arrêtée sur le mont Ararat. La grande Arménie était séparée de la petite Arménie par le mont Caucase. Avant le règne d’Alexandre on ne sait que des fables sur
les princes qui gouvernaient ce pays. Depuis cette époque les rois d’Arménie
jouèrent un plus grand rôle. Antiochus avait possédé quelque temps ces
contrées ; mais les gouverneurs nommés par lui, Artasias et Zodriade, prirent
le diadème, se rendirent indépendants et s’appuyèrent de l’alliance des
Romains. Tigrane le Grand accrut beaucoup ses états : secondé par Mithridate,
roi de Pont, son beau-père, il domina en Syrie et conquit Artuazde, son fils, n’imita pas sa prudence. Il trompa Marc-Antoine, l’engagea dans une guerre contre les Mèdes et contre les Parthes, et, s’étant concerté secrètement avec ses ennemis, il conduisit l’armée romaine dans un défilé, où elle fut taillée en pièces. Antoine, qui échappa avec peine au vainqueur, dissimula son courroux et demanda sa fille à Artuazde, pour la donner au fils de Cléopâtre. Le roi d’Arménie, dupe de ce stratagème, se rendit près de lui : on le fit prisonnier, et on le conduisit, chargé de chaînes d’or, ainsi que sa femme et ses enfants, dans la ville d’Alexandrie, aux pieds de Cléopâtre qui lui fit couper la tête. Alexandre, fils de cette reine et d’Antoine, s’empara du trône d’Arménie, dont il fut bientôt chassé par Auguste. Il eut pour successeur d’abord un autre Artuazde qui déplaisait au peuple, et ensuite Ariobarzane que la nation désirait et qu’on obtint de Rome. L’Arménie, peu de temps après, fut subjuguée par les Parthes ; mais Tibère la délivra, et lui donna pour roi Mithridate Ibère, frère de Pharasmane, roi d’Ibérie. Ce prince éprouva successivement les faveurs et les revers de la fortune : couronné par Tibère, il se vit détrôné par Caligula qui le chargea de chaînes, et, délivré par Claude qui lui donna des troupes pour reconquérir sa couronne sur les Parthes. Pharasmane le seconda dans cette entreprise ; mais il le trahit après et excita une révolté dans ses états. Le cruel Rhadamiste, fils de Pharasmane, assiégea son oncle dans une forteresse, le trompa en lui jurant qu’il pouvait se rendre sans avoir à craindre ni le fer ni le poison ; lorsqu’il se livra à lui, il le condamna à mort et le fit étouffer. Vologèse, roi des Parthes, vengea cette mort et punit ce crime : il attaqua Rhadamiste et le chassa de ses états. Peu de temps après Rhadamiste y revint furieux contre ses sujets qui l’avaient faiblement défendu. Il les gouverna avec tant de cruauté, qu’ils se soulevèrent. Le roi eut à peine le temps de monter à cheval et de fuir. Zénobie, sa femme, le suivait. Sa grossesse l’empêchait de supporter la fatigue, mais, craignant de tomber dans les mains de ceux qui la poursuivaient, elle pria son mari de terminer ses jours. Le barbare lui enfonça son épée dans le sein et la jeta dans l’Araxe. Les vêtements de Zénobie la soutinrent sur l’onde ; des bergers l’aperçurent, la retirèrent et pansèrent sa plaie : elle revint à la vie. Tiridate, fils du roi des Parthes, la reçut dans sa cour avec de grands honneurs. L’histoire ne nous dit rien appris de plus sur la vie de Rhadamiste. La malheureuse Arménie fut longtemps le théâtre des guerres que se livraient les Parthes et les Romains. Néron donna aux Arméniens, pour roi, Alexandre, petit-fils d’Hérode, roi de Judée. Mais Tiridate soutenait ses droits ; il combattit avec succès les Romains, commandés par Corbulon, et gagna leur estime. Néron abandonna Alexandre et couronna lui-même Tiridate. L’Arménie se vit heureuse sous son règne. Ses successeurs se conduisirent plutôt en lieutenants des
empereurs qu’en rois. Enfin, Trajan réunit PHRYGIENS
La nation phrygienne est peut-être la seule qui ait conservé le souvenir d’un de ses prince régnant avant le déluge : il s’appelait Inachus. Instruit par un oracle de la destruction prochaine du monde, il passait ses jours, dit-on, à déplorer cette grande catastrophe, et l’on conserva en Phrygie l’habitude de dire, lorsqu’on se moquait des lamentations d’un homme : Il pleure comme Inachus. La plupart de leurs rois se nommaient Midas ou Gordien. Le premier Gordien était laboureur : un aigle, qui vint se percher sur le joug de ses bœufs, lui annonça son élévation. Après un interrègne les Phrygiens convinrent de donner le trône à l’homme qu’on verrait arriver le premier, sur un chariot, dans le temple de Jupiter. Un autre Gordien réalisa la prédiction ; et, lorsqu’il fut couronné, il consacra son chariot dans le temple. Le nœud qui servit à attacher le timon de ce char était si artistement fait, qu’il semblait impossible de le dénouer. Le roi promit l’empire de l’univers à celui qui le délierait : ce fut le fameux nœud gordien qu’Alexandre coupa pour obtenir par la force ce qui avait été promis à l’adresse. C’est plutôt dans la fable que dans l’histoire qu’on doit placer la plupart des actions qu’on attribue aux divers rois de Phrygie. On ne nous a conservé rien de certain que leurs noms. TROYENSLe génie d’Homère rend immortel le nom de ce peuple qui
habitait un pays charmant, situé sur la côte de l’Asie-Mineure, entre
Les deux peuples les plus fameux dans l’histoire, les Romains et les Français ont tous deux cherché leur berceau dans les fables troyennes. Tous les Romains croyaient descendre d’Énée et de ses compagnons ; et quelques auteurs ont prétendu que les Francs tiraient leur origine de Francus, prince troyen. MYSIENSLes Mysiens étaient voisins et alliés des Troyens.
L’histoire ne nous donne rien de certain sur l’ordre et la succession de
leurs rois. Ce peuple, connu par ses débauches, par le culte impur de Priape,
se fit quelque réputation par son habileté dans les arts. Cyzique, ville
magnifique, s’appelait LYCIENSLe nom de tous les peuples de l’Asie est plus connu que leur
histoire. Tour à tour envahis par les Égyptiens, les Assyriens, les Lydiens,
les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains, leurs limites ont sans cesse
varié, et leurs rois n’ont jamais joui que d’une existence et d’une puissance
éphémères. Les Lyciens avaient des mœurs plus rudes et un courage plus ferme
que les Phrygiens. Ils s’étaient rendus fameux sur mer par leurs pirateries. Après
avoir été gouvernés par des rois, ils furent assez longtemps en république
sous l’autarifé d’un sénat composé de députés de toutes les villes du pays,
c’est sur une de leurs montagnes que les anciens auteurs avaient fait naître
et exister CILICIENSLeurs côtes, parsemées de petits havres, protégées par des promontoires escarpés, leur donnaient une grande facilité pour cacher et défendre leurs bâtiments. Ils faisaient des descentes en Grèce et même en Italie, d’où ils emmenaient des esclaves qu’ils vendaient en Égypte, en Chypre et en Asie. Les Romains prirent souvent les armes contre eux ; mais ces pirates se réfugiaient dans leurs cavernes, et reparaissaient sur la mer dès que les flottes romaines s’étaient éloignées. Alexandre bâtit dans leur pays la ville d’Alexandrette qui fut longtemps un entrepôt fameux pour le commerce de l’Orient. Pompée, irrité des brigandages des Ciliciens, attaqua ces corsaires avec cinq cents vaisseaux, débarqua, à la tête d’une armée nombreuse, sur la côte, et parvint à détruire les repaires de ces brigands. SCYTHES
Les Scythes, un des peuples les plus fameux et les moins connus de l’antiquité, habitaient les plaines immenses qui se trouvent au nord de la mer Caspienne et du Pont-Euxin, dans les pays incultes qu’arrosaient le Volga, le Don ou le Tanaïs et le Dniepr ou le Borysthène. Cette nation nomade, pastorale et guerrière, ignorant les arts, détestant la servitude et la mollesse, dédaignait les mœurs des autres pays, et n’entretenait presque aucune communication avec eux. Leur fierté repoussait toute dépendance ; leur vaillance les mettait à l’abri de toute invasion ; leur climat glacé, leur vie sauvage n’attiraient aucun voyageur. La guerre seule les rapprochait quelquefois des autres peuples qu’ils effrayaient par la rapidité de leurs invasions et par les ravages affreux qu’ils avaient commis dans toute l’Asie et jusqu’aux frontières d’Égypte. Beaucoup de peuples modernes tirent leur origine des Scythes que plusieurs savants regardent comme une partie de l’ancienne nation des Celtes qui a peuplé toute l’Europe. Les Gomérites, les Galates, les Gaulois, les Titans, les Teutons, les Celtibériens, les Goths e les Visigoths, les Francs n’étaient que des ramifications différentes d’une même souche celtique, et chez lesquelles, on trouve une conformité de mœurs qui prouve la communauté de leur origine. Les Scythes déifiaient les héros et les rois. Les prêtres jouissaient au milieu d’eux d’une grande autorité sous le nom de curètes, de druides et de bardes : le souvenir de leurs lois militaires et de leurs exploits était conservé par des hymnes. Les rois commandaient leurs armées ; les prêtres dirigeaient leur conduite. Une partie de ces peuples était sédentaire, et l’autre errante. Les uns habitaient des bourgades ; les autres vivaient sous des tentes et sur des chariots qui transportaient leurs familles dans des lieux propres au pâturage. Les Tartares, qui les ont remplacés, conservent encore les mêmes mœurs et les mêmes usages. Laborieux, braves et tempérants, ils méprisaient les richesses ; mais ils étaient passionnés pour la gloire. Leurs filles même faisaient la guerre, et c’est peut-être à leur bravoure qu’on doit attribuer la naissance de toutes les fables que débitaient les anciens sur les Amazones. Ils étaient tellement attachés à leurs coutumes, que la loi punissait de mort quiconque proposerait le plus léger changement ; ils massacraient même souvent les étrangers qui abordaient sur leurs côtes, craignant que leur fréquentation ne corrompît les mœurs et n’inspirât le mépris des lois. Sous d’autres noms ils adoraient la plupart des dieux de Le dieu de la guerre était pour eux la première des
divinités : ils lui sacrifiaient des victimes humaines ; ils faisaient des
vases avec les crânes de leurs ennemis, et avec leurs peaux des baudriers,
des housses et des brides. Leur grande population les porta aux conquêtes.
Repoussés par les glaces du Nord, ils cherchaient au Comme on ne connaît aucun historien scythe, nous ne savons que par les Grecs les noms de quelques-uns de leurs rois et les actions qu’on leur attribue. On prétendait qu’ils devaient leur origine à Gomer, fils de Japhet et petit-fils de Noé. Scythès, fils d’Hercule, fut, dit-on, leur premier roi.
Sigillus, son successeur, envoya son fils au secours des Amazones attaquées
par Thésée. Sous le règne de Madiès les Scythes entrèrent en Asie, soumirent L’histoire ne parle de Thomiris que pour racon ter sa guerre contre Cyrus. On prétend que cette Thomiris, reine barbare, après avoir tué ce conquérant, fit plonger sa tête dans un tonneau de sang. Lorsque Darius attaqua les Scythes, leur roi Janeyrus lui envoya, un oiseau, une grenouille, une souris et cinq flèches. Darius ne comprit rien à ce présent mystérieux ; il voulait considérer ce tribut comme une preuve de soumission. Vous vous trompez ; seigneur, lui dit Gobrias, un de ses ministres ; les Scythes veulent vous faire entendre que, si les Perses entrent en Scythie, ils ne doivent pas espérer d’échapper à leurs coups, à moins qu’ils ne sachent voler en l’air comme des oiseaux, nager dans l’eau comme des grenouilles, ou entrer dans la terre comme des souris ; leurs flèches signifient que cinq rois scythes se joindront à Janeyrus pour vous repousser. Darius ne le crut pas et fut vaincu. Philippe, roi de Macédoine, plus heureux, pénétra dans les états d’Athéas, roi des Scythes, remporta sur lui une grande victoire, emmena vingt mille femmes et enfants prisonniers, s’empara d’un nombre prodigieux de bestiaux et de vingt mille cavales. Dans cet immense butin on ne trouva ni bijoux, ni or, ni argent. Depuis cette époque l’histoire ne parle plus des Scythes comme d’un peuple séparé. ROYAUME DE PONT(Au du monde 3490. — Avant Jésus-Christ 514.) Le royaume de Pont, situé sur les bords de la mer Noire,
entre le fleuve Halys et
MITHRIDATE-LE-GRAND(An du monde 3881.- Avant Jésus-Christ 123.) Mithridate, dès sa jeunesse, développa la force de ses
passions et la dureté de son caractère. Il fit mourir sa mère pour se
débarrasser de sa parricide tutelle. Les exercices de son adolescence le préparaient
aux travaux de sa vie : il domptait des chevaux sauvages, couchait sur la
dure, bravait les glaces et les frimas, et s’accoutumait aux poisons, dont la
férocité des princes d’Asie n’avait rendu l’usage que trop fréquent. Il avait
épousé Laodice sa sœur. Pendant un long voyage qu’il fit en Asie le bruit de
sa mort se répandit ; Laodice s’abandonna à un amour coupable. Surprise par
le retour de son mari, elle lui présenta un breuvage, empoisonné qui manqua
son effet, et le roi la fit périr avec tous ses complices. Mithridate ne tarda
pas à exécuter les projets de son ambition ; il envahit
Sylla et Fimbria s’avancèrent bientôt à la tête des armées romaines, et vengèrent ce massacre par d’horribles représailles. Jamais on ne vit de guerre plus cruelle, excitée par des passions plus terribles, et conduite par des hommes plus violents. Mithridate, d’abord battu, eut à son tour des succès, que
favorisait la division qui existait entre les généraux ennemis. Fimbria,
jaloux de Sylla, fut enfin obligé de céder au génie de son rival, et se donna
la mort. L’heureux Sylla reprit ses avantages ; le roi de Pont perdit sa flotte
et une armée de cent dix mille hommes, que commandait Taxile. Mithridate fut
obligé de demander la paix à Sylla, de sacrifier ses conquêtes, et de se voir
de nouveau entouré de ces Romains qu’il détestait. Une telle paix ne pouvait
être qu’une trêve. Mithridate reprit bientôt les armes, et s’empara de Après plusieurs succès balancés toute l’armée de Mithridate, saisie d’une terreur panique, se mit en déroute, et l’obligea de fuir. Lucullus le poursuivit vivement : pour arrêter sa marche le roi sema sur les chemins ses meubles et ses trésors. Un mulet chargé d’or et d’argent arrêta les Romains et donna le temps à Mithridate de se dérober à la poursuite de ses ennemis. Ses femmes, ses sœurs et ses concubines étaient enfermées dans la ville de Pharnacie ; il chargea un eunuque de les faire mourir. La célèbre Monime, qu’il avait forcée à l’épouser, voulut s’étrangler avec son bandeau royal, afin, disait-elle, qu’il fût au moins une fois utile à son bonheur. Mithridate, vaincu, s’était retiré en Arménie, chez Tigrane son beau-père ; il en sortit bientôt pour tenter encore la fortune des armes. Pompée commandait les Romains : il défit le roi de Pont dans deux batailles, le chassa de ses états, et s’empara de ses trésors et de ses papiers. Stratonice, une des femmes de Mithridate, voulant sauver la vie de son fils Xipharès, livra aux Romains la ville de Symphorie et les richesses qu’elle renfermait. On n’entendait plus parler de Mithridate ; on ignorait son
sort. Pendant l’espace de deux années on ne put savoir s’il avait succombé à
ses malheurs, ou s’il voyait encore le jour. Ce prince, caché dans Ce plan, quoique gigantesque, pouvait réussir, précisément parce qu’il était aussi imprévu que hardi ; mais la perfidie fit échouer cette grande entreprise. Au moment où Mithridate, qu’on croyait mort, reparut dans ses états à la tête d’une armée menaçante, des traîtres livrèrent aux Romains ses forteresses et plusieurs personnes de sa de famille. Pharnace, le plus aimé de ses fils, révolta par son armée contre lui, en effrayant les soldats sur les dangers et les fatigues d’une si longue expédition. Mithridate ignorait cette lâche trahison. Il apprend tout à coup dans son palais que son camp est soulevé ; il sort pour apaiser la sédition. On lance de toutes parts mille traits sur lui : son cheval est tué ; il se sauve avec peine dans la ville, dont il ordonne de fermer les portes. Monté sur le rempart, il appelle Pharnace et fait encore une tentative pour réveiller dans le cœur de ce perfide les sentiments de la nature et du devoir. Le traître est insensible à ses prières et à ses reproches. Alors Mithridate, après l’avoir accablé de malédictions, ordonne à ses sujets de se soumettre aux arrêts du sort. Pour moi, dit-il, incapable de vivre dans la honte, je saurai bien me soustraire à la trahison. Il entre aussitôt dans son palais, prend une coupe de poison, la vide, et, l’ayant remplie de nouveau, la donne à ses deux filles, dont l’une devait épouser le roi de Chypre et l’autre le roi d’Égypte. Elles tombèrent bientôt dans le sommeil de la mort, ainsi que ses femmes qui subirent le même sort. Mithridate, seul, trop aguerri contre le poison, n’en éprouva aucun effet. Il eut enfin recours à son épée, et termina ainsi une vie trop célèbre et un règne de soixante-six ans. Dès que Pompée eut appris par Pharnace la mort de ce redoutable ennemi, il rendit le plus grand hommage à sa mémoire par la joie immodérée à laquelle il s’abandonna, ainsi que toute l’armée romaine. Cicéron, alors consul, ordonna douze jours de fêtes pour célébrer cet événement. Les tribuns du peuple firent rendre un décret qui autorisait Pompée à porter aux jeux du cirque une couronne de laurier, une robe triomphale, et une robe de pourpre aux spectacles ordinaires. La république n’était pas loin de sa chute, puisque les Romains oubliaient assez leurs vertus pour s’enorgueillir du succès d’une trahison, comme leurs aïeux l’auraient fait d’une victoire. Le lâche Pharnace fit embaumer, habiller et armer le corps de son père, et le livra ensuite aux Romains, Pompée, saisi d’horreur à ce spectacle, détourna la vue ; et revenant à des sentiments dignes de lui : La haine des Romains contre Mithridate, dit-il, doit cesser avec la vie de ce grand roi. Il ordonna qu’on lui fit des obsèques magnifiques, et qu’on le plaçât dans le tombeau de ses ancêtres. Mithridate possédait d’immenses trésors : on vit briller au triomphe de Pompée deux mille coupes d’agathe, un grand nombre de selles et de brides enrichies de diamants, des vases et des tables d’or massif ; des statues de Minerve, d’Apollon et de Mars, faites du même métal ; une statue du roi, de huit coudées, entièrement d’or massif ; le trône, le sceptre des rois de Pont, et un lit magnifique, qui avait appartenu à Darius, fils d’Hystaspe. On y remarquait un trictrac fait de pierres précieuses, et beaucoup de vases magnifiques. Toutes ces richesses avaient passé tour à tour, par l’inconstance de la fortune, d’Égypte en Perse, en Grèce et en Syrie, et venaient s’entasser dans les murs de Rome pour devenir un jour la proie des barbares. Pharnace, aussi lâche que perfide, ne voulut prendre le titre de roi qu’après en avoir reçu la permission des Romains. Sa bassesse ne lui attira que du mépris, et il ne reçut de ses protecteurs, sous le nom de royaume du Bosphore, qu’une faible portion des états de son père. Lorsque la république romaine se vit déchirée par une
guerre civile ; Pharnace crut le moment favorable pour reprendre l’Arménie et
PARTHESL’empire des Parthes, faible dans son origine, devint un des plus grands et des plus célèbres de l’Orient ; mais le plus beau titre de gloire des Parthes est d’avoir été l’écueil des armes romaines.
Ce fut sous le règne d’Antiochus que les Parthes se rendirent indépendants. Plusieurs provinces de l’Orient s’étaient soulevées dans l’absence du roi de Syrie, qui faisait la guerre en Égypte. Agathoclès, gouverneur du pays des Parthes, avait commis quelques violences contre un jeune homme nommé Tiridate. Arsace, son frère, dont le courage fit oublier l’obscure naissance, réunit quelques-uns de ses amis, attaqua le gouverneur, et le tua[1]. Le succès d’un coup hardi donne toujours beaucoup de partisans. Des mécontents se rassemblèrent sous la conduite d’Arsace, qui profita de la négligence d’Antiochus, et parvint à chasser les Macédoniens de la province. Dans le même temps Théodote, encouragé par cet exemple, fit révolter la Bactriane[2]. Arsace jouit paisiblement du trône. Après sa mort Tiridate son frère qu’on nomme aussi Arsace II, combattit avec succès Séleucus, fils d’Antiochus, et le fit prisonnier. Antiochus le Grand[3]
se montra d’abord plus redoutable pour les Parthes. Il leur reprit Arsace en sortit bientôt avec une armée de cent mille hommes, et soutint la guerre avec tant de vigueur qu’Antiochus préféra son alliance à son inimitié, conclut un traité avec lui, et le reconnut roi de Parthie et d’Hyrcanie. Arsace eut pour successeur Priapatius son fils, dont le règne dura quinze ans, et fut paisible ainsi que celui de Phraate qui occupa le trône après lui. Celui-ci, touché des grandes qualités de Mithridate son frère, le préféra, en mourant, à ses enfants, et lui laissa la couronne[5]. Mithridate justifia son choix ; il étendit le nom, la
puissance et la gloire des Parthes. Ses armes conquirent Mithridate fut à la fois général habile et sage législateur : il se faisait craindre par ses ennemis et chérir par ses sujets : la douceur de son caractère égalait son courage. Attaqué par Démétrios Nicanor, il le fit prisonnier ; et, loin d’imiter les exemples des rois barbares de son temps, il traita son captif en roi, lui donna l’Hyrcanie pour résidence, et lui fit épouser sa fille Rodogune. Ce sage prince adoptait pour le gouvernement de son empire ce qu’il trouvait de mieux dans la législation des peuples que la fortune avait soumis à ses armes[6]. Phraate son fils lui succéda. Antiochus Sidètes, roi de Syrie, voulant délivrer son frère Démétrius, rassembla une forte armée, attaqua les Parthes, gagna sur eux trois batailles, et fut enfin vaincu et tué dans une quatrième. Phraate voulait profiter de sa victoire et entrer en Syrie ; mais une diversion des Scythes l’en empêcha. Obligé de porter ses armes contre eux, il perdit la vie dans une bataille. Il laissa le trône à son oncle Artabane, qui régna peu de temps[7]. Mithridate II, son héritier, mérita par ses actions le nom de Grand. Il vainquit le roi d’Arménie, et le força de lui donner son fils Tigrane en otage. Il rendit depuis le trône d’Arménie à ce jeune prince, et se joignit au fameux Mithridate, roi de Pont, pour faire la guerre aux Romains. Antiochus Eusèbe se réfugia chez lui[8],
et dut à sa protection la reprisé d’une partie de Mithridate conclut la paix avec les Romains, et devint leur allié : mais, loin de s’abaisser devant eux, il n’imita que trop leur orgueil ; car, ayant envoyé Orobaze pour traiter avec Sylla, il le fit mourir à son retour, parce qu’il avait cédé la place d’honneur au général romain[9]. La dernière expédition de Mithridate fut glorieuse : il secourut Philippe assiégé dans la ville de Bercé par son fière Démétrius Euchère. Démétrius fut vaincu et pris ; Mithridate l’emmena dans ses états, et le traita honorablement. Il mourut après avoir régné quarante ans[10]. Mithridate le Grand n’avait pas laissé d’enfants. La
vacance du trône excita des troubles dans l’empire des Parthes, Tigrane en
profita pour reprendre les provinces qu’il avait perdues ; il y ajouta même
une partie de Les Parthes élurent dans ce temps, pour roi Mnaskirès, et après Sinatroccès, dont on ne connaît que les noms. Phraate, fils de Sinatroccès, remarquable par son orgueil, prit le nom de dieu. Salluste nous a conservé une lettre qu’il écrivait à Tigrane, avec lequel il s’entendait secrètement, quoiqu’il eût envoyé des ambassadeurs à Lucullus pour traiter avec les Romains. Lorsque Pompée vint en Asie, il engagea Phraate dans son parti : mais le roi, qui voulait soutenir Tigrane le fils, se brouilla bientôt avec les Romains. Ses enfants, impatiens de régner, le tuèrent. Mithridate, l’aîné de ses enfants, lui succéda ; son frère Orode souleva ses sujets contre lui, et le chassa du royaume. Il fit de vains efforts pour se défendre, assiégé dans Babylone par Orode, il fut obligé de se rendre à son frère, qui le fit égorger, et devint, par ce crime, seul possesseur du trône. Son règne fut troublé par les Romains, qui l’attaquèrent à l’improviste. Le consul Crassus, chargé de maintenir la paix en Asie, commença, sans motifs cette guerre, dans laquelle il se flattait présomptueusement de surpasser la gloire de Lucullus et de Pompée. On ne lui avait point ordonné formellement de combattre les Parthes ; sa seule vanité le porta à cette entreprise, dont le succès trompa son attente. Les tribuns s’opposèrent en vain à son départ, il méprisa leurs prières, leurs menaces et leurs imprécations. Arrivé dans le port, il ne voulut point attendre un vent favorable pour mettre à la voile, et perdit, par cette imprudence, beaucoup de vaisseaux. Il trouva en Galatie le vieux roi Déjotarus, qui bâtissait une nouvelle ville. Crassus, oubliant qu’il avait lui-même soixante ans, dit au roi des Galates, en le raillant, qu’il attendait les dernières heures du jour pour commencer à bâtir. Et vous-même, seigneur, répondit le roi, vous ne commencerez pas trop matin à combattre. Crassus, aussi avare qu’ambitieux, voulut piller
Jérusalem. Il existait dans le trésor une poutre d’or du poids de trois cents
mines ; elle était cachée dans une poutre de bois. Le prêtre Éléazar fit
présent de cette poutre à Crassus, pour sauver le reste du trésor ; mais le
Romain, après l’avoir reçue, n’en emporta pas moins une partie des richesses
du temple, pour la valeur de trente millions. Chars de ces dépouilles, il
s’avança sur l’Euphrate, et entra dans le pays des Parthes, où il pénétra
sans obstacles. Sylla et Pompée avaient fait un traité d’alliance avec eux ;
et, comme ils en avaient observé strictement les conditions, ils ne pouvaient
s’attendre à une agression si injuste. Crassus parcourut ainsi une grande
partie de Orode lui envoya des ambassadeurs pour lui déclarer que, s’il avait entrepris cette guerre de son chef, il voulait bien lui pardonner, et se borner à chasser de ses états les garnisons romaines ; mais que si, au mépris des traités, il avait pris les armes par les ordres de la république, cette guerre serait une guerre à mort, et ne se terminerait que par la ruine des Romains ou par celle des Parthes. Le fier Romain répondit qu’il s’expliquerait dans la capitale des Parthes. Alors un des ambassadeurs, nommé Vahisès, lui dit en souriant. Crassus, tu verras plus tôt croître du poil dans le creux de ma main que tu ne verras Séleucie. Toute conférence fut rompue, et de part et d’autre on se prépara à la guerre. Orode rassembla deux armées ; il marcha avec une en Arménie ; Suréna conduisit l’autre en Mésopotamie, et reprit plusieurs villes dont Crassus s’était emparé. Les officiers échappés de ces villes, effrayèrent les Romains en leur parlant de la force de l’armée des Parthes, de leur adresse à lancer au loin les traits les plus pesants, et de l’agilité de leur nombreuse cavalerie, qui était telle qu’on ne pouvait échapper à sa poursuite, ni l’atteindre quand elle fuyait. Les chefs des légions, considérant la difficulté de
vaincre de pareils ennemis, représentèrent en vain à Crassus qu’on, ne devait
point les traiter aussi légèrement que les autres peuples efféminés de
l’Orient, et qu’il fallait mûrement délibérer avant de s’engager dans une
semblable entreprise. Crassus n’écouta que son ambition et marcha. Artabaze,
roi d’Arménie, qui lui avait amené des troupes, lui conseillait d’éviter les
plaines de Crassus dédaigna son avis : il était tombé dans cet aveuglement qui précède et annonce toujours les grands désastres. Lorsqu’il passa l’Euphrate, une horrible tempête éclata et parut à l’armée un sinistre présage. Cette armée, la plus forte que les Romains eussent jamais rassemblée, montait à plus de quarante mille hommes. Cassius (qui depuis tua César) conseillait au général de côtoyer l’Euphrate, afin d’éviter d’être entouré ; mais Crassus, trompé par un Arabe, nommé, Ariamme, émissaire adroit de Suréna crut que le meilleur parti à prendre était d’épouvanter les Parthes par une marche droite et rapide. Le perfide Arabe le conduisit d’abord par des chemins faciles, et parvint à l’engager dans une plaine immense, sablonneuse, aride, où l’on ne pouvait espérer ni repos ni rafraîchissements. Au moment où l’armée s’épuisait de fatigue au milieu de sables brûlants, il reçut des lettres d’Artabaze, attaqué en Arménie par Orode, et qui le priait de venir à son secours. Crassus, irrité de cette demande, la prit pour un artifice, et lui répondit qu’après avoir vaincu les Parthes, il irait le punir de sa trahison. L’adroit Arabe persuadait toujours à Crassus que les Parthes effrayés rie songeaient qu’à fuir ; mais, lorsqu’il l’eut mené aussi loin qu’il le souhaitait, il s’échappa et alla rendre compte à Suréna du succès de sa mission. Bientôt les Romains, accablés de lassitude et de besoin,
découvrirent l’armée innombrable des Parthes. qui s’avançait avec fierté pour
les attaquer. Crassus voulut d’abord étendre sa ligne pour ôter à l’ennemi
l’espoir de l’envelopper ; mais, s’apercevant que l’immense cavalerie des
Parthes le débordait, il resserra son infanterie en bataillons carrés que
flanqua sa cavalerie. Les officiers voulaient qu’on se reposât avant de
combattre ; mais Crassus, n’écoutant que son ardeur et celle de son fils,
ordonna la charge. Alors la plaine retentit des cris affreux des Parthes qui,
découvrant leurs armes cachées sous des peaux de tigre, éblouirent les
Romains par l’éclat de leurs casques et de leurs cuirasses. Bientôt l’armée
romaine fut enveloppée de tous côtés ; la cavalerie, harcelée de traits,
fatiguée de plusieurs charges inutiles que les Parthes évitaient par une
fuite rapide, se retira pour se mettre sous la protection de l’infanterie.
Les légions romaines, pressées de tous côtés, voyaient avec rage l’inutilité
de leur vaillance. Si les soldats restaient dans leurs rangs, ils tombaient
sous les traits pesants des Parthes ; s’ils voulaient joindre l’ennemi, ils
faisaient de vains efforts pour l’atteindre et le Parthe, en fuyant, leur lançait
des flèches acérées. On espéra quelque temps que ces traits s’épuiseraient,
et qu’enfin on combattrait avec la pique et le glaive ; mais un grand nombre
de chars et de chameaux apportaient sans cesse aux Parthes une nouvelle
provision de dards. Le jeune Crassus à la tête d’une troupe d’élite se
précipita de nouveau sur les ennemis, et, trompé par leur fuite, crut un
moment à la victoire : mais il fut entouré, privé de tout espoir de retraite,
accablé par le nombre et tué. Les vainqueurs portèrent sa tête sous les yeux
de son père : cet horrible spectacle jeta la consternation dans l’armée
romaine. Crassus, loin d’être abattu, ranima le courage des Romains, en leur
représentant que Lucullus et Scipion n’avaient point vaincu Tigrane et Antiochos
sans éprouver de grandes pertes, et qu’on n’achetait la victoire que par le
sang. On combattit encore toute la journée avec le courage du désespoir ; la
perte des Romains fut énorme. Le lendemain on voulut prendre les ordres de
Crassus ; mais il restait dans un morne, silence. Octavius et Cassius, le
voyant sourd à leurs consolations et à leurs, remontrances, ordonnèrent la
retraite ; l’embarras que causait le transport des blessés retarda leur
manche. Les Parthes ne voulurent pas les poursuivre de nuit ; ils, entrèrent
seulement dans le camp, et égorgèrent quatre mille hommes qui y étaient
restés. Leur cavalerie prit beaucoup de fuyards. Crassus était cependant
arrivé dans la ville de Carres. Suréna qui voulait le prendre, lui fit faire
des propositions de paix, promettant qu’il lui laisserait la liberté de se
retirer s’il lui cédait Cassius, découvrant la trahison, revint à Carres, franchit une montagne, et parvint à se réfugier en Syrie, suivi de cinq cents chevaux. Crassus, resté dans le marais avec quatre cohortes et ses licteurs gagna péniblement une petite hauteur peu distante de la montagne où s’était retiré Octavius. Les Parthes vinrent l’attaquer. Octavius et ses troupes, voyant le danger de leur général, se reprochèrent leur lâcheté et descendirent pour le défendre. Les Parthes fatigués du combat, commençaient à se ralentir. Suréna employa alors l’artifice ; il relâcha quelques prisonniers qui publièrent qu’on voulait la paix. Suréna, tendant la main à Crassus, l’invita à venir traiter avec lui ; mais le Romain, connaissant la fourberie du Parthe, n’y voulait pas consentir ; alors ses soldats éclatèrent en injures, lui reprochèrent de les exposer à mourir pour lui, dans la crainte de s’aboucher avec l’ennemi. Crassus opposa vainement les plus vives prières à ces reproches ; il fut contraint de céder, et partit en conjurant ses officiers de dire à Rome qu’il avait péri, trompé par l’ennemi, mais non trahi par ses concitoyens. Octavius et Pétronius l’accompagnèrent. Dès que Suréna le vit avancer il s’étonna de le voir à pied, et commanda qu’on lui amenât un cheval. Chacun, dit Crassus, suit les usages de son pays : ce n’est point un hommage que je vous rends ; les consuls romains marchent à pied à la tête de leur infanterie. — Eh bien ! répliqua Suréna, vous pouvez regarder le traité comme fait entre Orode et la république ; mais il faut en venir signer les articles sur les bords de d’Euphrate ; car, vous autres Romains, vous oubliez souvent vos promesses. Les écuyers du roi prirent Crassus, et le placèrent malgré lui à cheval. Dès qu’il y fut monté on frappa le coursier pour accélérer sa marche. Octavius, Pétronius et plusieurs officiers voulurent l’arrêter ; ce mouvement excita un tumulte et on en vint aux coups. Octavius, ayant percé un de ces barbares, fut renversé mort par eux ; un Parthe plongea son glaive dans le sein de Crassus. Les Parthes s’avancèrent contre les Romains, et leur proposèrent de se rendre : les uns y consentirent, les autres prirent la fuite ; ils furent presque tous atteints et passés au fil de l’épée par les Parthes et par les Arabes. Depuis la bataille de Cannes les Romains n’avaient pas éprouvé une semblable défaite. Vingt mille hommes y périrent, dix mille furent faits prisonniers ; le reste se sauva en Arménie, en Cilicie et en Syrie. Cassius en forma une armée qui défendit ces provinces contre le vainqueur[11]. La défaite des Romains avait été prévue par le roi d’Arménie ; il fit la paix avec Orode, et maria une de ses filles à Pacore, fils du roi des Parthes. Comme ils étaient au festin des noces, on leur apporta pour trophée la tête et la main de Crassus. On prétend qu’Orode fit verser de l’or fondu dans la bouche de l’infortuné Romain pour insulter à son avarice. Suréna ne jouit pas longtemps de sa gloire : il est dangereux de tenir une épée qui brille plus que le sceptre. Orode en devint jaloux et le fit mourir. L’ingratitude de ce monarque est inexcusable ; mais Suréna, trop fier de ses exploits, montrait une ambition, étalait un faste qui pouvaient donner de l’ombrage au trône : il voyageait avec mille chameaux pour porter son bagage ; deux cents chariots conduisaient ses femmes, et il se faisait accompagner de dix mille esclaves armés et de mille cavaliers qui composaient sa garde. Les Parthes, après leur victoire, comptaient trouver L’année suivante Pacore, fils d’Orode, rassembla une nombreuse armée, entra en Syrie, et fit le siége d’Antioche, où Cassius s’était enfermé. Cicéron, général des Romains en Cilicie, marcha à son secours et mit en fuite un corps de cavalerie parthe. Pacore, effrayé par ce succès, se retira. Cassius le poursuivit, le défit entièrement, et tua Arsace qui commandait l’armée sous les ordres du prince. Cicéron, profitant de ces succès, subjugua toute Peu de temps après la guerre civile déchira la république romaine et empêcha Cicéron de jouir des honneurs du triomphe. Les Parthes se déclarèrent alternativement pour César et pour Pompée : profitant des troubles qui divisaient les Romains, ils firent plusieurs irruptions en Syrie et en Palestine. César, vainqueur de son rival et nommé dictateur, voulait ajouter à sa gloire l’honneur de vaincre le seul peuple dont la vaillance avait triomphé de la puissance romaine et mis une borne insurmontable à ses conquêtes. Il allait partir pour combattre les Parthes, lorsqu’il fut tué au milieu du sénat par Cassius et par Brutus. Octave, Antoine et Lépide formèrent un triumvirat pour venger sa mort : ils défirent, tuèrent ses meurtriers et se partagèrent l’empire du monde. Antoine, chargé de commander en Orient, donna l’ordre à Ventidius, son lieutenant, d’attaquer les Parthes. Cet habile général remporta sur eux deux victoires et les chassa au-delà de l’Euphrate. Apprenant ensuite qu’ils rassemblaient toutes leurs forces contre lui, il employa pour les vaincre un stratagème adroit. Un prince arabe était venu près de lui comme allié, mais dans l’intention de le trahir en faveur des Parthes. Ventidius feignit d’avoir en lui toute confiance ; il paru craindre que les Parthes, au lieu de passer la rivière à Zeugma près des montagnes, ne s’avisassent d’effectuer leur passage beaucoup plus bas, dans un lieu où ils ne trouveraient que des plaines très avantageuses à la cavalerie. Les Parthes instruits de cet entretien par leur émissaire, ne manquèrent pas de prendre cette direction qui exigeait de grands détours, et qui leur fit perdre quarante jours, pendant lesquels Ventidius eut le temps de faire venir de Judée des légions qui renforcèrent son armée. Le général romain campait sur une hauteur, dans une forte position. Les Parthes vinrent l’y attaquer. Le combat fut long ; les Romains remportèrent la victoire. Pacore péri dans le combat sa mort mit l’armée en déroute. Les fuyards voulaient regagner le pont de l’Euphrate ; les Romains les prévinrent et les taillèrent tous en pièces. Cette célèbre bataille eut lieu précisément le même jour où, quatorze ans auparavant, Crassus avait été vaincu[12]. Le roi Orode fut tellement consterné de ce désastre et de la mort de son fils Pacore, qu’il en perdit presque la raison, et resta plusieurs jours sans prendre aucune nourriture ; le nom seul de Pacore sortait de sa bouche. Ce prince infortuné avait trente fils de différentes femmes, qui tous prétendaient au trône. Après avoir été longtemps obsédé par leurs intrigues et par celles de leurs mères, il choisit pour son successeur Phraate, l’aîné de ses enfants, qui malheureusement était le plus vicieux, et le plus cruel de tous. Lorsqu’il fut assuré du trône il commença par tuer ceux de ses frères nés d’une fille d’Antiochus, roi de Syrie, parce qu’il craignait que ce monarque n’appuyât leurs prétentions. Orode lui ayant montré son horreur de ce crime, ce fils dénaturé le poignarda ; il immola ensuite ses autres frères ; et n’épargna pas même son propre fils, dans la crainte que le peuple ne se soulevât pour le faire régner à sa place. Phraate était un monstre ; mais il avait des talents militaires qui aveuglèrent peut-être son père et décidèrent son choix. Antoine, jaloux de la gloire, de son lieutenant, et voulant au moins la partage, envoya Ventidius triompher à Rome ; et lui-même marcha contre les Parthes, dans l’espoir qu’épouvantés par leur dernière défaite ils lui opposeraient peu de résistance. Trompé par de perfides conseils, il s’engagea imprudemment dans le pays des Parthes. Phraate l’enveloppa, le battit et peu s’en fallut qu’il n’éprouvât le même sort que Crassus. Il se vit forcé à une retraite longue et difficile, qui prouva son courage, mais qui lui coûta la plus grande partie de son armée. Phraate aurait pu tirer de grands avantages de sa victoire ; une conspiration des principaux personnages de sa cour l’en empêcha. Ils le chassèrent du trône et élurent pour roi l’un d’entre eux nommé Tiridate. Phraate, ayant rassemblé quelques troupes, renversa son rival ; et, pour affermir sa puissance, il acheta la protection d’Auguste en lui restituant les aigles romaines conquises sur Crassus. Ce qui peut faire juger de la paissance des Parthes et de la crainte qu’ils inspiraient, c’est que cette restitution des aigles romaines fut célébrée à Rome comme aurait pu l’être la plus grande victoire. Tiridate trouva un asile à la cour d’Auguste. Phraate y envoya quatre de ses enfants par le conseil de sa femme Thermuse qui les éloignait pour assurer le trône à son fils. Dès qu’elle eut réussi dans ce projet, elle empoisonna son époux. Les Parthes découvrirent ce crime, la tuèrent et chassèrent son fils. Ils mirent à sa place Orode II, de la race des Arsacides ; mais bientôt las de sa tyrannie, ils le massacrèrent dans un festin, et demandèrent à Auguste un des enfants de Phraate. L’empereur leur envoya Vonone. Ce pince avait pris l’habillement, les mœurs et le langage des Romains ; il déplut à ses sujets qui déclarèrent qu’ils ne voulaient pas obéir à un esclave de Rome. Les mécontents offrirent le trône à Artabane, roi de Médie, de la race d’Arsace. Vonone avait un parti : on en vint aux mains ; Artabane fut vainqueur. Vonone implora vainement le secours des Romains ; il erra quelque temps en Arménie et en Syrie, et finit par être assassiné en Cilicie. Artabane ne jouit point paisiblement du trône ; on lui opposa un autre enfant de Phraate qui vint de Rome pour le combattre. Le nouveau prétendant mourut ; mais Pharasmane, roi d’Arménie, son protecteur, battit Artabane et le chassa de Parthie et de Médie. Les Romains replacèrent sur le trône Tiridate, ancien rival de Phraate. Cependant Artabane trouva le moyen de reprendre le sceptre ; il fut encore dépossédé, et se rétablit enfin solidement sur le trône. Ses longs malheurs avaient changé son caractère. Il se fit aimer par sa modération, par son équité. La fin de son règne fut tranquille, et sa mort excita de sincères regrets. Deux de ses enfants, Gotarse et Bardane, se disputaient le trône menacés tous deux par une conspiration, ils se réconcilièrent, et Gotarse céda la couronne à son frère. Le commencement du règne de Bardane fut glorieux. Il remporta plusieurs victoires ; mais son orgueil excita la haine des grands de sa cour, qui le tuèrent. Gotarse, son frère, lui succéda. Claude, empereur des Romains, lui opposa Méherdate, prince Arsacide, qui fut vaincu et pris. Gotarse, par mépris pour les Romains, lui fit couper les oreilles. Vologèse son successeur, aussi habile guerrier que
Bardane, battit les Romains et donna l’Arménie et L’union entre les deux empires dura jusqu’au règne de Cosroës, troisième successeur de Vologèse. L’Arménie devint encore le sujet de la guerre : Trajan nomina Parthanaspate à la place de Cosroës. L’empereur traversa le pays des Parthes comme un torrent dont rien ne peut arrêter le ravage. Cosroës temporisa, se retirant toujours devant les Romains qui firent de grandes pertes dans cette expédition sans en retirer d’avantages réels. Dès que Trajan fut sorti du pays des Parthes, Cosroës remonta sur le trône et renversa le fantôme de roi que Trajan y avait placé. Vologèse II, son fils, hérita de son sceptre. Les armes romaines l’obligèrent à faire le sacrifice de quelques provinces. Vologèse III, qui lui succéda, voulut réparer ses pertes ; l’empereur Sévère le battit et enleva ses trésors, ses femmes et ses enfants. Tous les successeurs de Trajan faisaient consister leur gloire à triompher des Parthes ; mais les armées romaines n’étaient pas assez fortes pour conserver des conquêtes si étendues, et les Parthes, trop belliqueux pour s’accoutumer au joug, le secouaient dès que les Romains se retiraient. Caracalla forma lé projet de triompher sans péril de cette indomptable nation. Artabane IV avait succédé à Vologèse son frère. Caracalla lui fit demander sa fille en mariage. Les ambassadeurs romains annoncèrent que l’empereur partait pour venir célébrer ses noces à la cour du roi des Parthes. Artabane vint au-devant de lui avec les grands de sa cour et une nombreuse suite sans armes. Caracalla, à la tête de sa garde, tomba sur eux à l’improviste, en tua un grand nombre et se retira, chargé d’un honteux butin. Il se fit décerner par le sénat, pour cette lâche action, le surnom de Parthique. Artabane, échappé à ce danger par une espèce de miracle, jura une haine irréconciliable à l’empereur ; la nation entière partagea son ressentiment : Les Romains et les Parthes rassemblèrent toutes leurs forces et se livrèrent une grande bataille : l’action avait duré deux jours, la fortune restait encore indécise. Quarante mille morts couvraient le champ de bataille ; la nuit seule avait suspendu les efforts des combattants qui se reposaient appuyés sur leurs armes. Un envoyé romain vint prier Artabane de faire cesser un si long carnage. Il répondit : Nous ne faisons que commencer ; je suis, déterminé à périr avec le dernier Parthe ou à tuer le dernier Romain. L’aurore du troisième jour paraissait ; le roi faisait sonner la charge, lorsqu’un général romain lui fit dire, que Caracalla venait d’être assassiné, et que le châtiment du traître devait mettre fin à toute dissension entre les deux peuples. Le roi des Parthes, satisfait, consentit à traiter et conclut une paix avantageuse. Jamais les Parthes n’avaient acquis plus de gloire ; mais cette bataille meurtrière fit à leur empire une blessure profonde et incurable ; les plus braves guerriers de la nation avaient péri. Les Perses, conquis par les Macédoniens, vivaient depuis cinq cents ans sous la domination des Parthes ; ils profitèrent de leur affaiblissement pour reprendre leur indépendance. Après plusieurs batailles sanglantes les Perses remportèrent une victoire décisive. Artabane fut tué ; son armée se dispersa, et les Parthes, sans chefs, s’incorporèrent au peuple victorieux. Ainsi finit l’existence de cette nation qui avait ébranlé le colosse romain. Les Parthes passaient avec raison pour les meilleurs cavaliers et les plus habiles archers de la terre. Dès leur plus tendre enfance ils s’exerçaient à manier les armes ; depuis l’âge de vingt ans jusqu’à cinquante on les assujettissait au service militaire. Les grands toujours à cheval et armés, même en temps de paix, ne connaissaient d’autre science que celle de la guerre. Les Parthes négligeaient l’agriculture et n’avaient ni navigation ni commerce. Une félicité éternelle attendait dans les cieux le guerrier qui périssait dans un combat. La polygamie était d’usage chez les Parthes ; on permettait le mariage entre frères et sœurs. Ils suivaient la religion des anciens Perses et adoraient le soleil sous le nom de Mithra. Leur parole était sacrée : ils regardaient comme un infatue celui qui la violait. Rien n’égalait l’orgueil des rois qui commandaient à ces peuplés belliqueux. Arsace s’adressant à un empereur romain, écrivait ainsi : Arsace, roi des rois, à Flavius Vespasien. L’empereur répondit modestement : Flavius Vespasien à Arsace, roi des rois. |
 La mer semblait devoir séparer éternellement les nations ;
les Phéniciens imaginèrent les premiers d’employer ce terrible élément pour
les rapprocher ; l’art de la navigation était pratiqué de temps immémorial
chez eux, et répandait le bonheur et l’aisance sur la côte stérile qu’ils
habitaient, et qui vit briller avec éclat les magnifiques villes de Tyr et de
Sidon.
La mer semblait devoir séparer éternellement les nations ;
les Phéniciens imaginèrent les premiers d’employer ce terrible élément pour
les rapprocher ; l’art de la navigation était pratiqué de temps immémorial
chez eux, et répandait le bonheur et l’aisance sur la côte stérile qu’ils
habitaient, et qui vit briller avec éclat les magnifiques villes de Tyr et de
Sidon.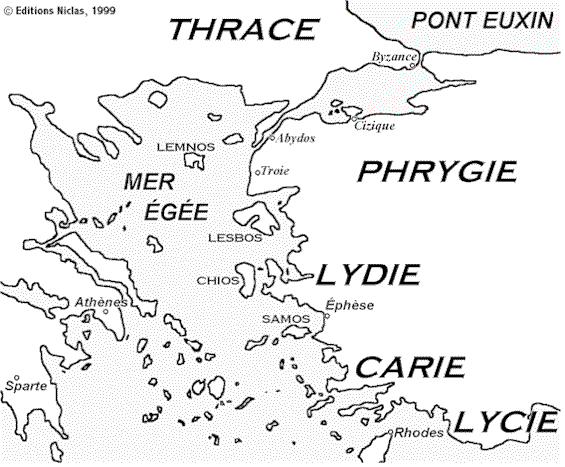
 L’histoire de
L’histoire de 

 Mithridate, prévoyant le ressentiment implacable de Rome,
ne mit plus de bornes à ses offenses et à ses fureurs ; il ordonna à toutes
les villes de sa dépendance en Asie de massacrer tous les Romains qui s’y
trouveraient. Cet ordre barbare fut exécuté ponctuellement, et dans ce jour
fatal cent cinquante mille Romains perdirent la vie. Quelques historiens
réduisent ce nombre à quatre-vingt mille.
Mithridate, prévoyant le ressentiment implacable de Rome,
ne mit plus de bornes à ses offenses et à ses fureurs ; il ordonna à toutes
les villes de sa dépendance en Asie de massacrer tous les Romains qui s’y
trouveraient. Cet ordre barbare fut exécuté ponctuellement, et dans ce jour
fatal cent cinquante mille Romains perdirent la vie. Quelques historiens
réduisent ce nombre à quatre-vingt mille. Ils occupèrent d’abord le pays situé entre l’Indus, le
Tigre, la mer Rouge et le mont- Caucase. Plusieurs auteurs les font venir de
Scythie, d’où ils avaient été chassés, et prétendent le prouver par leur nom
même de Parthes, qui veut dire
Ils occupèrent d’abord le pays situé entre l’Indus, le
Tigre, la mer Rouge et le mont- Caucase. Plusieurs auteurs les font venir de
Scythie, d’où ils avaient été chassés, et prétendent le prouver par leur nom
même de Parthes, qui veut dire 