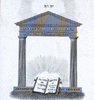LE TALMUD DE JÉRUSALEM
TOME PREMIER.
INTRODUCTION.
|
§ 2. — FORMATION DU TALMUD. Un écrivain a fort bien résumé ce point d'histoire en ces termes[1] : Lorsque, après deux cents ans d'une résistance énergique contre un empire qui devait tout dompter, le peuple hébreu vit s'évanouir sa nationalité politique, il sentit le besoin de resserrer, autant que possible, les liens de sa personnalité, afin de conserver moralement, par l'identité des croyances, l'unité que la dispersion allait matériellement briser. Le moyen qui se pressentait de lui-même, c'était de déterminer d'une manière invariable les principes des lois de Moïse, d'en développer le sens, d'en fixer l'interprétation. Mais alors, les lumières d'Israël s'étaient éclipsées ; des longtemps, la voix des prophètes ne laissait plus tomber sur les peuples la parole de Dieu, et l'inspiration divine semblait être remontée vers le ciel. D'ailleurs, l'organisation sociale n'existant plus, personne n'était en droit d'imposer son opinion aux autres hommes ; l'autorité s'était anéantie avec la puissance. Le seul parti rationnel dans cet état de choses était de réunir les Israélites, ou ceux qui seraient appelés à les représenter, et d'en former un synode souverain. C'est ce que tenta le rabbin Juda, Naci (prince) de la nation, qui vivait au IIe siècle de l'ère chrétienne[2]. Ce rabbin, plus particulièrement désigné sous le nom de notre saint maître, obtint, dit-on, de l'empereur Antonin[3], la permission de rassembler un concile compose des plus savants Israélites. L'œuvre de ce concile consista à
consigner par écrit ce qui, jusqu'alors, n'avait guère été livré qu'à la
mémoire, savoir la jurisprudence hébraïque, les opinions des principaux
docteurs sur l'interprétation de Par degrés presque imperceptibles, les explications et les recherches, qui avaient pour but d'édifier et d'instruire sur un point spécial, firent naître une science qui prit aussitôt les proportions les plus vastes. Son nom technique est déjà contenu dans les chroniques[6] : c'est celui de MIDRASCH (de darasch, étudier, expliquer). Le fait est qu'il y avait des méthodes innombrables pour étudier l'Écriture[7]. D'après la manière bizarrement ingénieuse de l'époque, on retrouvait les quatre principales méthodes dans le mot persan paradis, appelé à la façon sémitique, sans voyelles, P, R, D, S. Chacune de ces lettres mystérieuses était prise mémoniquement pour l'initiale de quelque mot technique qui indiquait une de ces quatre méthodes. Celle qu'on appelait P (PESCHAT) visait à la simple intelligence des mots et des choses, d'accord avec la loi élémentaire de l'exégèse du Talmud, qu'aucun verset de l'Écriture n'admettait pratiquement d'autre sens que le sens littoral, bien que, dans un sens familier ou différent, on pût l'expliquer d'une foule d'autres manières. La deuxième lettre R (REMEZ),
signifie insinuation, c'est-à-dire la découverte des indications contenues
dans certaines lettres et certains signes de l'écriture, superflus en
apparence. On supposait que ces signes avaient rapport à des lois qui n'étaient
pas expressément mentionnées, mais qui existaient dans la tradition, ou
avaient été récemment promulguées. Cette méthode, appliquée d'une manière
plus générale, donna naissance à une sorte de memoria
technica, à une sténographie semblable au notarikon des Romains. On ajouta des points et
des notes à la marge des manuscrits ; ainsi fut jetée la base de La quatrième lettre S (SÔD), ou secret, mystère, impliquait la science mystérieuse, à laquelle bien peu étaient initiés. C'était la théosophie, la métaphysique, l'angélologie, une foule de visions fantasques et brillantes de choses surnaturelles. De faibles échos de celte science se retrouvent dans le néo-platonisme, dans le gnosticisme, dans la cabale, dans Hermès Trismégiste. Mais bien peu de personnes étaient initiées aux choses de la création et du chariot, comme on appelait cette science, par allusion à la vision d'Ezéchiel. L'attrait du vague et du mystérieux a été si puissant qu'à la longue, le mot paradis ne désigna que cette dernière branche, la science secrète, ésotérique. Plus tard, dans le gnosticisme, il en vint à signifier le Christ spirituel. Cependant, les auteurs eux-mêmes posent en principe que
leurs décisions n'ont rien d'absolu, ni d'immuable, et peuvent toujours être
modifies par celle d'un pouvoir égal à celui dont ils étaient revêtus[8]. Ce qu'ils
voulurent faire, ce fut uniquement de fixer le sens et les règles de la loi écrite
; car, ainsi que le dit Moïse de Coucy : si l'on
n'eût ajouté à la loi écrite, l'interprétation de la loi orale, toute la loi
eût été obscure et sans clarté, parce que l'écriture Sainte est pleine de
passages qui semblent être en opposition et contradictoires[9]. Poursuivons le cours des évènements. Quelques années après la rédaction définitive de la Mischna[10], un rabbin nommé
Yohanan, et qui pendant quatre-vingts ans, à ce que dit la chronique, avait
été chef d'académie à Jérusalem, entreprit, aidé seulement des disciples de
Juda le Saint, d'augmenter Comme le dit Mr. R. T. Herford dans le Christian Reformer (febr. 1886, p. 99), pourquoi le premier
Talmud ou le plus ancien porte-t-il ce nom de Jérusalem
? On l'ignore ; c'est un point obscur, car on sait bien qu'il n'y avait plus
d'école rabbinique à Jérusalem après la destruction du Temple en l'an 70 de l'ère
vulgaire. Apres cet événement, le siège principal des Etudes a consisté un
moment dans la fameuse école de R. Yohanan b. Zaccaï, établie à Yabneh (Iamnia). Mais, pendant la plus grande partie
de la période d'élaboration de ce Talmud, le quartier-général du Rabbinisme (pour ainsi parler) a été fixé dans la ville
de Tibériade. D'autres écoles, certes moins importantes, étaient à Césarée (Caesarea Philippi),
ou d'autres à Séphoris (Cippori), sans compter des compagnies
d'études classées ensemble sous la dénomination d'écoles du Sud (Darom), dont une seule ville, celle de Loud (Lydda), était désignée nominalement. C'est
dans ces écoles que le Talmud palestinien (ou
de l'Occident, Bné-Maarab) prit naissance et se développa. R.
Yohanan bar Napha (le forgeron) passe
d'ordinaire pour avoir été le principal compilateur, et c'est en effet le
plus Eminent des rabbins de Tibériade. Mais, il n'est guère possible que
cette hypothèse soit fondée (comme l'a démontre
Z. Fraenkel dans son Mabo), car R. Yohanan a étudié sous la
direction de R, Juda le compilateur de Maints savants et des plus modernes[13], affirment que
depuis la clôture des livres bibliques jusqu'à la rédaction définitive de Le document le plus remarquable sous ce rapport, cité par
le Talmud lui-même, est On sait combien les peuples de l'antiquité avaient à cœur de transmettre à la postérité le souvenir de leurs hauts faits. Ils avaient coutume d'assurer la stabilité à leurs victoires et à leurs triomphes par des monuments impérissables, qui devaient défier le temps. On avait recours dans ce but, soit à l'érection d'arcs de triomphe, soit à la gravure descriptions sur le marbre ou sur le bronze ; soit enfin aux témoignages oraux ou écrits ; les chansons de gestes du moyen-âge offrent l'exemple le plus mémorable de cette troisième sorte de monuments. Cette dernière série d'attestations, — la seule contre
laquelle les effets du temps sont nuls ou peu importants, — a été spécialement
conserve par les petites peuplades qui ont longtemps combattu pour leurs
foyers, leurs principes, leurs opinions, en un mot pour leur indépendance. Ce
fut le sort d'Israël. Chaque fois qu'il a dû combattre ses ennemis, il
n'avait pas seulement en face de lui les adversaires de sa nationalité, mais
encore ceux de sa foi et de ses convictions religieuses. Lorsque Moise Peut
affranchi de l'esclavage d'Égypte, lorsque Josué et ses successeurs luttèrent
contre les Philistins, lorsque les tribus de Juda et de Benjamin se
séparèrent du reste d'Israël après le règne brillant du sage Salomon, lorsque
Nabuchodonozor se fut emparé une première fois de Jérusalem, lorsque les
successeurs d'Alexandre, Séleucides et Lagides, la conquirent de nouveau,
lorsqu'enfin les Romains eurent réduit pour la dernière fois la capitale de Quoi d'étonnant, dés lors, à ce que les moindres phases glorieuses de cette succession de luttes pénibles aient été soigneusement enregistrées comme autant de journées heureuses, dignes d'être conserves dans les Annales d'une nation, pour servir d'exemple illustre à ses descendants, aux héritiers de son nom et de son œuvre intellectuelle, morale, humanitaire. En tenant compte de ces considérations, on lira avec intérêt un document, succinct par la forme, mais embrassant un cadre étendu par le nombres des faits. C'est une série de jours de souvenirs heureux, écrite en l'honneur des circonstances les plus mémorables ou les plus joyeuses qui ont eu lieu depuis l'époque de Xerxès, ou au commencement du IVe siècle avant J.-C, jusqu'à l'empereur Antonin-le-Pieux en 138 de l'ère vulgaire. Ainsi, ce texte attribue à Dieu non seulement les triomphes et les victoires, mais toutes les conjonctures graves qui concernent le bien-être matériel de la nation, ou l'extension de son spiritualisme : il les considère comme des marques spéciales de sa puissance et de sa grâce. Aussi, cette chronique ne contient pas seulement des faits de guerre, mais bien d'autres détails intéressant l'histoire[14], depuis le retour d'Israël en Palestine sous Néhémie jusque bien après la destruction de sa nationalité politique. Enfin, au point de vue littéraire, nous sommes en présence
d'un texte qui, sans être aussi vieux que II fait prévoir, malgré sa concision, le développement futur des écoles talmudiques. Afin que ses leçons ne restassent pas ensevelies dans l'oubli, Asché[16] fit ce qu'à toute époque ont fait tous les professeurs[17] ; il se mit à compiler (plutôt qu'à rédiger) le cours qu'il professait ; et déjà trente-cinq traités étaient transcrits, lorsqu'il mourut, en l'année 427. Mar, son fils, et Marimor, son disciple, lui succédèrent dans le professorat, et ils résolurent de continuer ce que leur père et leur maître avaient si péniblement entrepris. II leur fallut une grande patience et d'immenses investigations pour terminer ce grand travail. Soixante-treize ans furent employés pour mettre la dernière main à l'œuvre. Telle fut l'origine de la formation du Talmud. Là encore,
il eût été contraire à la loi de Moïse d'établir, sur un autre principe que
l'adhésion libre des individus, des prescriptions législatives quelconques.
La base de la loi mosaïque, c'est la liberté d'adopter, ou de rejeter. J'ai mis devant vous le bien et le mal, la mort et la vie,
dit le prophète ; c'est a vous de choisir (Deutéronome, chap. XXX, 15 et 16). Ce
principe se retrouve partout dans l'histoire du peuple hébreu. Ainsi, deux
fois dans sa vie, Moise expose Longtemps après, lorsque, à la suite de la captivité de Babylone, la nation Israélite se reconstitua, le principe du libre arbitre était aussi vivace que du temps de Moïse, et le pacte social et religieux fut de nouveau sanctionné volontairement, par le serment et la signature de tout le peuple, grands et petits, hommes, femmes et enfants (Néhémie, IX et X). En présence d'une règle aussi constante, aussi
irréfragable, il est évident que nul parmi le peuple hébreu n'avait le droit
d'imposer aux autres son arbitraire volonté. Il est donc démontré, l'histoire à la main, que la liberté de penser a présidé la formation du Talmud. On retrouvera le même principe dans l'analyse de sa doctrine. Rappelons seulement en ce qui concerne la partie agadique, que le Talmud lui-même[21] ne lui attribue ni autorité ni caractère légal ; et cette appréciation est confirmée par tous les rabbins postérieurs, tels que Maimonide, Juda Halévi, Ibn-Ezra, Scherira Gaon, Isaac Israeli, etc. C'est là un point de départ capital, pour passer de la synthèse à l'analyse. |