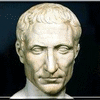JULES CÉSAR
CHAPITRE VIII. — ASSASSINAT DE CÉSAR. - RÉSUMÉ.
|
Quand César a été vraiment grand, nous ne lui avons certes pas marchandé les éloges ; mais l'homme perce sous le héros, et bien des petitesses se mêlent à cette incontestable 'grandeur. La flatterie qui l'obsède est devenue sans bornes comme son pouvoir ; ses ennemis mêmes l'invitent à en abuser, et le précipitent sur sa pente. A force de respirer l'encens dont on l'enivre, cette tête si ferme finit par se troubler. Le sénat le pousse à la tyrannie, et l'en absout d'avance à force de bassesse. Ne sachant plus quels honneurs inventer pour ce maitre blasé à qui l'on accorde tout, excepté le seul titre auquel il aspire, le sénat décerne l'hérédité de son pouvoir d'Imperator aux fils et aux petits-fils qu'il n'a pas. Il vote à César une statue dans le temple de Romulus, sous le nom de Jupiter Julius, et une autre dans le Capitole à côté de celle des rois, avec le droit d'être inhumé dans l'enceinte de Rome, exception unique et de mauvais augure ! Tous ces hommages, qui sont une insulte à notre pauvre humanité, César ne se contente pas de les accepter, il les provoque. Mais ce n'est là qu'un chemin pour arriver à son but suprême, la royauté, et, s'il daigne se laisser faire dieu, c'est pour aboutir à être roi ! Enfin est-ce lui, est-ce la lâcheté humaine qu'il faut accuser de cet étrange décret, proposé par Helvius, un de ses affidés, décret qui, flattant les goûts sensuels du maître, l'autorisait, comme un despote de l'Orient, à prendre à la fois autant de femmes qu'il voudrait ? Le despote passa dieu trop tôt, et le décret n'eut pas le temps d'être présenté. Le sénat l'eût voté à coup sûr ; mais, pour l'honneur de César, croyons qu'il ne l'eût pas accepté ! On l'invite à se méfier de tout le monde, à s'entourer de gardes ; mais il est entré dans la voie de la confiance, et n'en veut pas sortir, dût-il lui en coûter la vie. Il bâtit un temple à la Clémence, pendant que le sénat, amère dérision, en élève un à la Liberté ! Il relève les statues de Pompée, il épargne même celles de Sylla, et au dire de Cicéron, affermit ainsi les siennes. Fort de tant de vies qui se rattachent à sa vie, il renvoie sa garde espagnole, malgré les instances de ses amis ; il veut être gardé, non par la terreur comme Sylla, mais par sa force et par sa clémence. Il se flatte de désarmer ses ennemis à force de bienfaits, et prodigue au peuple les jeux, les festins et le blé, à ses soldats les terres et les largesses. Et pourtant, malgré tous ses efforts, il ne peut Pas
parvenir à se faire aimer. Même dans cette Rome avilie, les vieux instincts
de liberté se réveillent. Ne vous fiez jamais à leur sommeil, c'est le feu
sous la cendre ; il couve, mais il n'est pas éteint. Et puis, quand un
peuple, dans une heure de crise, se résigne à mettre sa liberté en gage aux
mains d'un grand homme, et que celui-ci confisque le dépôt, il faut au moins
qu'il donne l'ordre, la paix et le bien-être, en échange de cette liberté
perdue. César ne demanderait pas mieux, mais il a tout un monde à rendre
heureux ; lourde tâche, même pour un Trajan ou un Marc-Aurèle ! Rome, après
avoir régné si longtemps, ne veut pas abdiquer : les moins dociles de ses
sujets, ce sont ces Romains dont Tacite dira bientôt qu'ils
ne savent supporter ni la servitude, ni la liberté tout entières ! A toute force pourtant, Rome accepterait César pour
maitre, mais non pour roi, et, moins sage que son successeur, il ne se
contente pas de la chose sans le nom. Il fait répandre le bruit que les
Parthes ne peuvent être vaincus que par un roi, et, le terrain ainsi préparé,
un jour quelques affidés le saluent de ce nom désiré. Mais le peuple murmure,
au lieu de faire écho, et le dictateur, désavouant le zèle maladroit de ses
amis, prononce à regret ces paroles : Je ne
m'appelle pas roi, mais César ; et il se retire abattu, au milieu d'un silence improbateur auquel Rome ne
l'a pas habitué. Une autre fois, à la fête des Lupercales, César, vêtu de la robe triomphale, est assis sur un trône d'or, dans la tribune aux harangues. Antoine fait mine de le ceindre du diadème ; quelques applaudissements, achetés, se font entendre dans la foule. Le dictateur refuse mollement la couronne ; des applaudissements frénétiques accueillent son refus, et César, désappointé, envoie consacrer le diadème à Jupiter, seul roi des Romains ! Cependant, l'ivresse du pouvoir lui monte peu à peu à la tète. Lui, qui naguère pesait toutes ses paroles, en laisse échapper comme celles-ci : La République n'est plus qu'un nom, sans corps et sans réalité... Sylla n'a su ce qu'il faisait quand il a abdiqué. Il veut que l'on s'accoutume à lui parler avec plus de respect, et à tenir pour loi toute parole sortie de sa bouche. Un jour, les consuls et le sénat en corps viennent lui déférer des honneurs nouveaux. Il allait se lever, mais Balbus, son âme damnée, lui souffle à l'oreille : Oublies-tu que tu es César ? et il reste assis, en murmurant quelques mots sur un malaise qui l'empêche de se lever. Il demande que l'on diminue ses honneurs, au lieu de les augmenter. Le sénat se retire froissé, et César, humilié, mécontent de lui-même et des autres, découvre sa robe, et demande à haute voix qu'on le tue. Ici se présente une question : César pouvait-il rendre aux
Romains la liberté ? Mais d'abord, il n'y a plus de Romains, il n'y a qu'un
peuple factice et dégradé d'affranchis et de marchands de suffrages. Ce
peuple, César voulait sincèrement le refaire, et peut-être, avec le temps, y
eût-il réussi ; mais alors, en face du peuple romain ressuscité, il eût péri,
non plus sous les coups d'une oligarchie qui ne veut pas survivre à sa chute,
mais sous des besoins d'affranchissement plus sérieux, et qu'il ne pouvait
pas satisfaire ; car la même main qui a fondé le despotisme ne peut pas
fonder la liberté. Le rêve de César, dit Mommsen,
c'était d'accoupler avec le pouvoir absolu le
développement des libertés populaires ; mais on ne marie pas l'eau avec le
feu, et la république antique, basée sur l'esclavage, devait logiquement
aboutir à l'absolutisme. (T. III, p.
457.) Le peuple a besoin d'une idole, et César a cessé d'être
celle des Romains. Leur affection se tourne vers Marcus Brutus, descendant
présumé du premier Brutus qui a affranchi Rome des Tarquins. Il est le neveu
et le gendre de Caton qu'il est digne de continuer. Pompée autrefois a fait
mourir son père, et cependant il a embrassé le parti de Pompée, comme le plus
juste. Après Pharsale, il est passé avec les dieux dans le camp de César, qui
a pour lui une affection presque paternelle ; car il se souvient d'avoir aimé
Servilie, sœur de Caton et mère de Brutus. Chose étrange ! César, si peu
scrupuleux pour lui-même, a toujours respecté d'instinct cette austère et
mâle vertu qui l'étonne à cet âge. Je ne sais pas,
a-t-il dit, ce que veut ce jeune homme ; mais tout
ce qu'il veut, il le veut fortement. Si Brutus daignait se plier au rôle de courtisan, il
serait le favori du dictateur qui l'a brouillé avec Cassius, son beau-frère
et son ami, en le préférant à ce dernier pour la préture urbaine. Mais cette
âme trop haute se refuse à la faveur du prince ; il aime mieux vivre avec les
philosophes, ses maîtres, et cultiver l'éloquence au moment où elle va périr
avec la liberté. Parfois le maître du monde, en voyant repousser ses avances,
se sent saisi d'un sombre pressentiment : Ce ne sont
pas, lui a-t-on entendu dire, ces gens si
gras et si bien peignés que je crains (Antoine
et Dolabella), mais ces hommes maigres et
pâles (Brutus et Cassius). Bientôt
les renseignements deviennent plus précis : on l'avertit de se méfier de
Brutus, il ne peut pas s'y résoudre : Croyez-vous,
répond-il tristement, qu'il n'attendra pas la fin de
cette frêle carcasse ? — Brutus, dit-on partout,
hait la tyrannie et Cassius le tyran. En effet, l'inimitié de ce
dernier contre César est toute personnelle : le dictateur lui a volé ses lions,
jouets sanglants du peuple-roi, et ornements de ses fêtes. On excite Brutus à
délivrer son pays du joug ; les murs même parlent pour l'animer ; le tribunal où il rend la justice est tous les matins jonché de billets qui lui disent : Tu dors, Brutus ? — Ou,
plût à Dieu que tu fusses encore en vie ! Un seul homme, après Plutarque, a compris toute la
grandeur morale de ce caractère de Brutus ; c'est Shakespeare, qui en a fait
le vrai héros de sa pièce, la Mort de Jules César, et qui s'écrie avec
Cassius : Rome est donc devenue bien étroite qu'il
n'y a plus place dans ses murs que pour un seul homme ! Et dans cette
admirable scène où Cassius se réconcilie avec son beau-frère, et instille
goutte à goutte dans son cœur sa haine contre le tyran : Je l'ai vu, dit-il, atteint par la fièvre en
Espagne. Il a tremblé, oui, le Dieu a tremblé ! Ses
lèvres avilies ont perdu leur couleur, et cet œil qui frappe le monde de
respect a éteint son éclat. Je l'ai entendu gémir comme un simple mortel, et
de cette voix qui remplissait le forum, il a murmuré, comme une jeune fille
malade : Titinius, donne-moi à boire. Un matin, les statues du dictateur se trouvent ceintes du bandeau royal. Deux des tribuns, se fiant à leur inviolabilité, font ôter les diadèmes, et César casse les deux tribuns comme des licteurs à ses gages. On dirait que le crime de lèse-majesté, ce grand ressort de la politique de Tibère, est déjà inventé. Un sourd mécontentement couve dans Rome contre le dictateur ; on lui eût passé le fond, on ne lui passe pas les dehors de la tyrannie. Jusqu'au sein du sénat, si empressé à ramper devant lui, ses ennemis sont nombreux ; on les reconnaît à leur zèle pour le compromettre en ayant l'air de le servir. Une conspiration se trame : Cassius en est l'âme, Brutus en sera le chef. Les noms les plus honorés de Rome viennent s'y grouper autour de l'héritier de Caton. On y trouve les débris du parti aristocratique, les derniers défenseurs de la république expirante, Cimber, les deux frères Casca, Ligarius, le client de Cicéron, le racheté de l'éloquence, gracié par César. Tout ce qui a un nom dans Rome tient à honneur de conspirer. On y trouve même des familiers, des amis du dictateur, qui l'ont suivi partout, et ont partagé toutes ses fortunes, Trébonius, Labéon, Decimus Brutus et Galba. Tous ces hommes ont aimé César, mais ils aiment encore mieux la patrie, la liberté... et les intérêts de leur caste. Quant à Cicéron, on est sûr de sa haine contre l'usurpateur, mais on ne l'est pas assez de son courage, car il en doute lui-même, et on le laisse en dehors de la conspiration. On y compte soixante membres environ, et pas un, jusqu'au jour de l'exécution, n'a trahi le redoutable secret. Une femme même s'y enrôle : c'est Porcia, la digne femme de Brutus, la digne fille de Caton ! Jalouse de tout partager avec son mari, elle ne veut pas être tenue à l'écart de son dessein, qu'elle a soupçonné. Fille et femme de stoïciens, elle veut s'aguerrir à la douleur, et se blesse profondément à la cuisse, pour s'essayer elle-même, et montrer à son mari ce qu'elle peut supporter. Ce n'est pas dans Plutarque, c'est dans Shakespeare qu'il faut lire cette scène touchante, noble et saint idéal où' les tendresses de l'épouse se mêlent à l'énergie de la matrone romaine, compagne des desseins et des dangers de son mari ! Le ciel même s'émeut : des présages menaçants remplissent la ville de terreur. Les augures ont désigné les Ides de mars comme l'époque de la crise : Eh bien, dit César à l'un d'eux, les Ides sont venues ! — Oui, mais elles ne sont pas passées ! — Quelle est la mort la plus désirable ? lui demande-t-on. — La moins attendue ! Le jour fatal arrive enfin : le sénat est convoqué, et le dictateur a promis de s'y rendre. Toutefois, vaincu par les prières de Calpurnie qu'ont effrayée des rêves sinistres, il songe à remettre la séance. Mais Decimus Brutus, l'un des conjurés, lui annonce que le sénat, se rendant enfin à ses désirs, consent à le nommer roi de tout le monde romain, l'Italie exceptée, et qu'en cette circonstance, son absence serait un affront. César cède à regret, et marche au-devant de sa destinée. En route, on lui remet un billet qui lui dénonce toute la conspiration ; mais la foule se presse autour de lui, il n'a ni le temps ni la liberté de l'ouvrir, et il entre au sénat, tenant encore à la main ce billet qu'il ne lira pas. Les conjurés, se méfiant du dévouement et de la force corporelle d'Antoine, avaient songé à se défaire de lui en même temps que de César ; mais Brutus ne veut pas tacher son entreprise de plus de sang qu'il n'est besoin d'en répandre, et il sauve cette vie qui lui coûtera la sienne. Quelques affidés occupent Antoine et l'éloignent de l'assemblée. L'heure est venue. César entre enfin, et tous les sénateurs se lèvent pour lui faire honneur. Cimber lui demande avec instance le rappel de son frère banni, et tous les conjurés, comme pour appuyer sa requête, se groupent autour du dictateur, entouré sans s'en douter de ses plus mortels ennemis. Etonné, irrité de leur insistance, César leur reproche vivement de vouloir lui faire violence. Alors, Cimber s'attache à sa robe, comme pour le supplier, et lui découvre le haut de l'épaule. C'était le' signal qu'attendaient les meurtriers : aussitôt. Casca frappe le premier, au col, comme on frappe une victime devant l'autel ; mais le coup, mal dirigé, glisse et n'entre pas. La main de l'assassin a tremblé devant la grandeur de l'attentat. Ah ! scélérat de Casca ! s'écrie César, et il tire son épée ; mais les conjurés le pressent de tous côtés. Tous ceux des sénateurs qui ne sont pas dans le secret, saisis d'horreur ou d'effroi, n'osent pas défendre César. Dans leur précipitation, les meurtriers se blessent l'un l'autre en voulant le frapper. De quelque côté qu'il se tourne, il ne voit que des épées dirigées contre lui. Comme un lion aux abois, il rugit et se débat ; la meute des conjurés s'acharne sur sa proie, et dans cette curée, chacun veut goûter de son sang ; mais il fait face à tous, et se défend avec une rare présence d'esprit. Enfin Brutus, blessé lui-même à la main, le frappe à l'aine ; la blessure n'était pas mortelle, mais César se sent atteint au cœur : Et toi aussi, mon fils ! s'écrie-t-il, et cessant de lutter, il se couvre la tête avec sa robe, et s'abandonne aux coups. Il tombe enfin, percé de vingt-trois blessures, au pied de la statue de Pompée, tardive et solennelle satisfaction que le destin réservait au vaincu de Pharsale ! Le drame ici est impuissant, la peinture seule a pu exprimer la sombre horreur de cette scène. Qui n'a vu ce tableau d'un peintre moderne, cette page d'histoire, petite par les dimensions, grande par la pensée ? Le cadavre de celui qui fut César, étendu tout saignant au pied de la statue de Pompée, remplit seul le premier plan. Le sénat est vide, une muette horreur siège sur ces bancs déserts où reste seul assis un vieux sénateur, insoucieux de sa vie. Les autres ont déjà fui, reniant l'œuvre de sang dont ils ne veulent être ni vengeurs, ni complices. Les assassins s'échappent en désordre, pliant sous cette terrible responsabilité devant laquelle Brutus seul n'a pas fléchi ; car ce n'est pas à ses rancunes, mais à ses convictions qu'il a immolé César ! Bientôt, une sourde rumeur se répand dans la ville : les boutiques se ferment, chacun rentre chez soi, et s'isole clans sa peur et dans son égoïsme. Les amis de César, Antoine et Lepidus, se cachent ; Dolabella s'unit aux assassins, et brigue déjà près d'eux la place de consul que César lui destinait. Les sénateurs, froissés dès longtemps de la nullité de leur rôle, ne sont pas loin de prendre parti avec les meurtriers. Brutus et les conjurés, l'épée à la main, leurs toges teintes de leur sang et de celui du tyran, font porter devant eux au bout d'une pique le chapeau, symbole de la liberté, et appellent le peuple aux armes. te peuple, en suspens, ne blâme ni n'approuve : il est d'avance au plus résolu, à celui qui saura lui dire ce qu'il doit penser, sentir et faire. Le lendemain, Brutus, qui s'est emparé du Capitole, harangue le peuple qui ne lui répond que par un morne silence. Il plaint César qu'il aimait, mais il respecte Brutus qu'il sait incorruptible, et il hésite, partagé entre la stupeur, le deuil et l'effroi. Le sénat, toujours porté à louvoyer entre les deux partis, se décide enfin, sur la motion d'Antoine, à ratifier les actes du gouvernement de César, et à lui décerner les honneurs divins. Nouveau Romulus, en passant dieu, n'a-t-il pas disparu au milieu de la tempête ? Mais en revanche, le sénat partage entre les meurtriers les plus hautes dignités de la république. Brutus, généreux jusqu'à l'imprudence, a commis une première faute, c'est d'épargner Antoine, le plus résolu, le plus dangereux des amis du dictateur ; il espère le ramener à son parti, et avoir par lui Lepidus et l'armée. Malgré les avis de Cicéron, qui l'engage à se méfier d'Antoine, Brutus commet une seconde faute, non moins grave : c'est de laisser le lieutenant de César célébrer ses obsèques sur la place publique, au lieu de jeter ses restes dans le Tibre, comme le voulaient d'abord les conjurés. Le corps sanglant du dictateur est porté sur le forum. Antoine se charge de son oraison funèbre, et lit tout haut son testament : César lègue à chaque citoyen 70 francs, et abandonne au peuple ses somptueux jardins au delà du Tibre, avec d'autres legs non moins importants. Le peuple est ému, et déjà la pitié, à la suite de l'intérêt, se glisse dans tous les cœurs. Dans Plutarque, la scène est à peine indiquée ; mais comme Shakespeare a saisi sur le vif ce peuple romain que le mob anglais lui a révélé ! Comme son génie divinateur a retrouvé et rendu, dans sa saisissante vérité, cette page familière d'une grande histoire ! Antoine se garde bien d'accuser Brutus, plus vénéré dans Rome que vraiment populaire ; mais à la lecture du testament de César, habilement commenté, une irrésistible explosion de douleur et de regrets soulève tout le forum. Antoine ose alors davantage : il montre au peuple la toge sanglante de César, son corps tout labouré de blessures, d'où le sang coule encore. Le peuple, hors de lui, entasse les bancs et les tables pour célébrer lui-même les funérailles de son libérateur. Aux regrets a succédé la fureur : il veut mettre le feu aux maisons des conjurés. Bien leur en a pris de s'y retrancher comme dans un fort, et d'armer leurs esclaves, car nul n'est plus en sûreté chez soi : la société, au milieu de toutes ces passions déchaînées et de ce mépris des lois, dont César a donné le premier l'exemple, s'est constituée sur le pied de guerre. Le pouvoir appartient désormais à qui l'osera prendre ! Troisième faute : Brutus quitte la ville, où le respect pour lui a survécu à l'affection, laissant ainsi la place à Antoine, dont la feinte modération n'a trompé personne, et en qui l'on pressent déjà un héritier de César. Absent, Brutus donne au peuple des jeux magnifiques, dans le vain espoir de le rallier à sa cause. Mais cet élève de la sagesse grecque ne devrait pas ignorer qu'il ne suffit pas d'amuser le peuple, ni même de le nourrir ; il faut l'occuper, le saisir par l'âme plus encore que par les yeux, et César seul a su le posséder par tous ces côtés à la fois. Aussi l'avenir n'est-il ni à ce rêveur de vertu qu'on appelle Brutus, ni à ce grossier soldat qui a nom Antoine, mais à ce rusé Octave, à ce poltron heureux, qui vient, en traînant la jambe, recueillir l'héritage de son oncle, et s'emparer par surprise de l'Empire, comme le renard après le lion. Brutus a fait son œuvre, si c'est une œuvre que de détruire ! Il a tué César, et ne peut rien de plus : il ne peut pas faire sortir la liberté de ce cercueil, où il vient de coucher ce redoutable ennemi des lois et de son pays, dont il fut à la fois la gloire et le fléau. La liberté était morte avant César, et elle ne peut pas plus ressusciter que lui ! Que reste-t-il donc à faire pour Brutus ? A combattre, sans espoir et sans but, car il se sent vaincu d'avance, puis à mourir, comme Caton, pour une cause morte ! Noble et sainte figure, qu'on ne peut pas contempler sans douleur, car, à l'inverse de Caton, qu'on admire sans l'aimer, on aime encore Brutus, même en le blâmant ! Il a compris maintenant sa dernière et sa plus grande faute, celle d'avoir immolé César, sans que Rome y ait gagné ce que le monde y perdait. De là cette immense tristesse, empreinte sur le beau buste qui nous est resté de lui ; de là son dernier blasphème contre la vie et contre lui-même : Vertu, tu n'es qu'un nom ! Blasphème, s'il en fut jamais, car s'il n'y a plus place pour la vertu dans ce triste monde, le dernier sanctuaire d'où Brutus au moins ne devrait pas la chasser, c'est l'âme d'un sage et d'un grand citoyen ! Ecoutons encore, avant de quitter Brutus, Sénèque condamner, au nom du bon sens et de l'intérêt public ; ce meurtre qui a surtout à ses yeux le tort d'être inutile. Brutus s'est trompé, dit-il, en croyant que la liberté pouvait encore exister là où tout le monde avait intérêt à commander ou à servir ; que l'Etat pouvait être ramené à ses anciennes formes, quand il avait perdu ses anciennes mœurs ; enfin que l'égalité pouvait régner encore, et les lois reprendre leur empire, là où l'on avait vu tant de milliers d'hommes combattre pour savoir, non si l'on devait servir, mais qui l'on servirait. Il fallait certes être bien ignorant et de la nature humaine et de l'histoire de son pays pour croire que, le tyran abattu, il ne s'en trouverait pas un autre pour le recommencer ! (SENECA, de Beneficiis, II, 20.) Dans le meurtre de César, Sénèque ne voit qu'une faute. Je n'hésite pas, pour ma petit, à y voir un crime. L'assassinat politique, dont l'antiquité a fait un dogme et presque une vertu, n'a pas plus d'excuse à mes yeux que l'assassinat privé. Pourquoi la vie d'un tyran nous appartiendrait-elle plus que celle de tout autre individu ? Comment comprendre un bourreau là où il n'y a ni tribunal, ni jugés, ni accusé même, et où nous ne voyons qu'une victime ? Que ce soit la religion ou la politique qui arme la main du meurtrier, le couteau qui tranche une vie d'homme, fût-ce la plus indigne, ne m'inspire que de l'horreur. En enseignant ainsi le crime à un peuple, on n'a jamais sauvé ni son pays, ni les lois, ni la liberté, et le châtiment de tous les assassinats de ce genre, depuis J. César jusqu'à Lincoln, c'est qu'ils ont toujours été inutiles. C'est ainsi que meurt César, à 56 ans, dans la plénitude de sa force et de son génie, et Pompée ne l'a précédé que de quatre ans dans le tombeau ! Il n'a pas cru aux dieux, et cependant la vengeance céleste semble poursuivre ses meurtriers qui meurent tous dit male mort comme lui. Toute sa vie a tendu vers un seul but ; il l'a atteint, et à peine en possession de son vœu (voti compos), il meurt, comme Alexandre, et le sang coule à flots pour célébrer ses funérailles. Il est mort trop tôt, dira-t-on, pour le bonheur de Rome ! Qui sait ? Rêver le bien est chose plus facile que de le faire. Que César valût mieux que tout ce qui est venu après lui ; que Brutus, à ce titre, ait mal fait de le tuer, nous le concédons volontiers ; mais, une fois maître incontesté de ce pouvoir qui n'a jamais eu d'égal, et n'en aura jamais ici-bas, l'ivresse de la toute-puissance lui serait montée au cerveau. Ce qu'il a fait pour arriver au trône nous est un gage de ce qu'il eût pu faire pour y rester. Sa mort, du moins, a averti Auguste et Tibère, et les a rendus sobres ; c'est le service le plus réel, le seul peut-être qu'elle ait rendu à Rome ! La jeunesse de César appartient au vice, son âge mûr à l'ambition, qui sait ce qu'eût été sa vieillesse ? Voyez Alexandre à Babylone ! Le repos est fatal à ces ardentes natures qui vivent d'étourdissement, et tombent aussitôt qu'elles s'arrêtent. Quand on aspire à régner sur un monde, que faire après qu'on l'a conquis ? Quel remède à cet immense ennui d'une ambition repue qui, retombant sur elle-même, se dévore faute d'aliment ? César est mort à temps pour sa gloire. Le grand homme chez lui a péri tout entier, à l'apogée de sa puissance, et l'ambitieux désabusé n'a pas eu le temps de lui survivre. Maintenant, allons au fond : laissons les vices, les vertus même, qui 'ne sont chez lui que surface ; creusons dans cette nature enveloppée et profonde : le dernier mot de César, c'est l'égoïsme, sans bornes chez lui comme lé génie. Aristote l'a dit avant nous, l'homme de génie se sent né pour régner, et il faut qu'il règne à tout prix ! L'artiste, le lettré ne veulent que l'admiration, lui réclame l'obéissance, et, chose étrange ! il l'obtient, au nom de la plus immorale et de la mieux acceptée de toutes les tyrannies, la force au service de l'intelligence. Que sont les conquérants, les fondateurs d'empires ? Des personnalités agressives qu'il faut ou combattre ou servir ; à côté d'eux, il n'y a plus place pour rien, ni pour personne. Qu'eût fait Alexandre à côté de César ? La terre même aurait été trop étroite polir eux ! César est venu à sa date, à son heure : il a fait son œuvre, en foulant aux pieds toutes les lois, divines et humaines. Contempteur superbe de tout droit, souriant dédaigneusement aux noms sacrés de justice et de patrie ; facile à pardonner, parce que la vengeance chez lui peut être un calcul, mais jamais un besoin ; ne prenant dans la vie que deux choses au sérieux, l'ambition et le plaisir, n'ayant de l'humanité que ses faiblesses qu'il domine, mais non ses affections qu'il méprise ; toujours maître de lui, jamais irrité, mais jamais ému, il ne pourrait pas s'appliquer ce beau vers de Térence : Homo sum, nil humani a me alienum puto. (Je suis homme, et rien de
ce qui est humain ne m'est étranger.) Etudiez César superficiellement, et vous êtes sous le charme ; creusez plus avant, et la peur vous saisit, comme si vous aviez à faire à un être d'un autre nature que la vôtre. En élevant cet édifice dont la grandeur vous étonne, vous croyez qu'il a voulu travailler au bonheur de l'humanité ; erreur, il n'a travaillé que pour lui ! Il n'a pas compris, dans son splendide égoïsme, qu'il n'était qu'un instrument aux mains de Dieu. Il a rassemblé l'univers, et l'a tenu un instant dans sa main. Etait-ce pour lui ? Non, car il laisse son œuvre à peine ébauchée. Qui donc héritera de lui ? Est-ce Auguste ou Tibère ? Non, c'est le christianisme ! Une force nouvelle, un nouveau principe de vie est entré dans ce monde pour le régénérer. L'humanité a reçu le baptême qui lui manquait : l'humilité, la charité, c'est-à-dire le mépris et l'oubli de soi-même, voilà ces humbles vertus destinées à changer la face du monde, et que César eût prises en pitié, si le nom même n'en eût pas été ignoré de son siècle et de lui ! Ce qui a perdu César, c'est qu'il a méprisé l'espèce humaine, et c'est encore ce qui perd tous ceux qui, pour passer grands hommes, se croient obligés de la mépriser comme lui. Or, s'il est une règle sans exception, c'est celle-ci : quiconque méprise les hommes mérite d'être méprisé par eux. C'est votre conscience qui parle à votre insu, et quand vous condamnez tout le monde, c'est vous-mêmes que vous condamnez. Je sais qu'il est parfois difficile d'estimer beaucoup notre pauvre nature humaine, mais il est toujours facile de la plaindre. C'est ainsi qu'on la relève de ses déchéances, et tous ceux qui ont fait du bien aux hommes ont commencé par les aimer, sans se demander s'ils en étaient dignes. César n'était pas né méchant, il n'a jamais haï personne, mais il n'a jamais aimé non plus, et, pourparler avec Juvénal : Rien ne battait sous sa mamelle gauche. Résumons-nous : que reste-t-il du vainqueur de Pharsale ? un modèle désespérant pour les ambitieux de tous les temps qui l'étudient sans pouvoir l'égaler ! Un défi jeté à toutes les lois qui régissent le monde moral, lois immuables, car elles vivent encore, et César a passé ! Un souvenir immortel enfin, une des grandes pages de l'histoire, qu'après tant d'autres, et dans notre faiblesse, nous avons essayé de récrire, pour remettre en lumière quelques vérités méconnues ou faussées. César a cru fonder l'empire ; mais il meurt à la peine, et tout est à refaire après lui. L'œuvre d'Auguste est indépendante de la sienne, et César n'a fait que la préparer. Est-il, comme on l'a dit, le plus grand homme des temps anciens ? Non ! répondrai-je sans hésiter, car ma pierre de touche pour juger la grandeur morale, c'est l'oubli de soi-même ! C'est le moi perdu, absorbé, noyé dans une de ces grandes pensées qui illuminent tout un siècle, et entourent de leur auréole le front qui les a conçues. Les vrais grands hommes, ce sont les grands citoyens, comme Phocion, Lycurgue et Caton dans les temps anciens, comme Guillaume le Taciturne, Washington, Lincoln dans les temps modernes, tous ceux, en un mot, qui n'ont pas vécu pour eux-mêmes, mais ont vécu ou sont morts pour une conviction, une idée, une foi, une patrie ! Aux yeux de César et de ses admirateurs, ce sont des dupes que des hommes pareils ; et ils ont bien mal compris leur rôle de Messie en s'immolant eux-mêmes à leur pays, au lieu d'immoler leur pays à leur intérêt. Sans doute César est grand lorsqu'il pardonne, et même lorsqu'il tombe sous le fer de ses meurtriers ; mais son καί σύ τέκνον ! ne vaut pas le dernier cri de Guillaume d'Orange assassiné : Mon Dieu, aie pitié de ce pauvre peuple et de moi ! Mais on n'en impose à la longue ni à l'histoire, ni à la postérité. Le verdict des siècles a été prononcé, le jugement sur César est rendu, il n'y a plus à en appeler. Tous les sophismes du monde finissent par se briser contre le roc de la vérité. Cette morale éternelle, à qui chaque siècle livre son assaut, cette morale, sans laquelle crouleraient bientôt toutes les sociétés humaines, n'a pas besoin qu'on la venge de ceux qui voudraient la fausser ; elle n'a pas même à leur répondre, elle n'a qu'à attendre et à durer. FIN DE L'OUVRAGE |