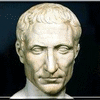JULES CÉSAR
CHAPITRE VII. — PLANS ET RÉFORMES DE CÉSAR.
|
Après huit mois donnés à soumettre l'Espagne et à la pacifier, César revient à Rome, aigri, mécontent, avec les soucis sans les joies du succès. Plus de ménagements pour l'opinion qui ne l'a pas assez soutenu : il ne craint pas de triompher des fils de Pompée ; ne sont-ce pas des ennemis publics, puisque ce sont les siens ? D'ailleurs, c'est sa dernière guerre, cette fois, il va laisser la terre se reposer : plus d'ennemis, plus do luttes pour l'empire ou pour la liberté, ensevelie à Pharsale sous sa victoire ! Rome n'en est plus à se révolter contre lui, mais elle a senti ce dernier affront, et en veut à César de triompher ainsi des malheurs de la patrie. Peut-être, livré à lui-même, le vainqueur de Munda dit-il eu la prudence de s'abstenir d'un triomphe sacrilège ; mais le sénat, en se ruant, comme dit Tacite, vers la servitude, pousse encore son maitre sur la pente où il eût fallu le retenir. En votant pour cette victoire fratricide cinquante jours de fêtes, il a enseigné à César à n'en pas rougir ! La position du dictateur est aussi difficile qu'elle est grande : pour lui, comme l'a fort bien remarqué Mommsen, les vraies difficultés commencent avec la victoire, de même que pour notre Henri IV et pour Guillaume III d'Angleterre. Et d'abord, à cette position nouvelle, sans précédents dans le passé, il faut un nom nouveau comme elle, un nom qui ne froisse ni les préjugés, ni les souvenirs populaires. Celui de roi, le seul dont César ait envie, est hors de question. Celui de dictateur, même perpétuel, que le sénat lui a décerné, suppose un pouvoir exceptionnel qui ne peut ni se transmettre, ni rien fonder. Ceux de consul ou de tribun n'expriment qu'une autorité temporaire et partagée ; il aime mieux en faire des noms vides de sens, et les abandonner à des subalternes. Au tribunat, seulement, il emprunte l'incarnation en sa personne de la puissance populaire, et l'inviolabilité, faible rempart contre le poignard des assassins. Mais le sénat a beau entasser sur lui des titres creux et sonores comme ceux de libérateur du monde et de père de la patrie, il y manque l'expression d'un pouvoir réel, permanent, héréditaire surtout, rêve de tous les ambitieux parvenus qui, dès qu'ils règnent, aspirent à durer. Enfin, il s'arrête de préférence au nom d'Imperator, qui, sans faire encore de lui un empereur, en fait plus qu'un général, car il lui confère le commandement de toutes les armées. Dès lors, tous les pouvoirs, civils et militaires, se trouvent concentrés dans ses mains : le peuple, dont ils émanent, le sénat qui les a votés, sont désormais impuissants à les reprendre. Dans cette autorité, aussi vague qu'étendue, dont nul ne peut définir ni la source, ni les limites, on retrouve quelques traces de la vieille royauté romaine, s'appuyant au besoin sur le peuple pour combattre l'aristocratie, et se continuant par une sorte d'hérédité bâtarde dont l'adoption est la base. A cette royauté nouvelle, il faut une cour, et les
courtisans sont trouvés : ce sont tous ceux qui ont servi César, et qui, déjà
payés par lui, réclament encore leur salaire. Il est loin pourtant d'être
ingrat, car il n'oublie jamais un service rendu. Il a le culte de la
reconnaissance, et dit tout haut que si des voleurs
ou des assassins l'avaient aidé à élever sa fortune, il se croirait obligé de
leur en tenir compte ; or, on va loin avec de pareils principes !
Déjà, comme en Orient, le despote devient difficile à approcher, et n'est
plus visible qu'à ses heures, et pour ses familiers seulement. Cicéron
lui-même se plaint des indignités
qu'il faut subir pour arriver jusqu'à lui. Une noblesse nouvelle, champignon toujours prêt à pousser sur le terrain des cours, vient remplacer l'ancienne, réduite à mie vingtaine de familles, décimées par les proscriptions et les guerres civiles. Parmi les nouveaux patriciens, nous n'en connaissons que deux, Octave et Cicéron. Le premier l'était de droit, comme issu du même sang que le maître. Quant à Cicéron, nous ne voyons pas ce qu'il a gagné à se laisser anoblir, tandis qu'en refusant, il demeurait lui-même, et se vengeait des longs mépris du patriciat pour lui. Le sénat, descendu au rôle d'assemblée consultative, qui donne son avis.... quand on le lui demande, est peuplé des créatures du prince, et donne à tous l'exemple et la leçon de l'obéissance. Comme le sénat, l'assemblée du peuple subsiste, au moins de nom ; elle demeure, avec le pouvoir impérial ; l'expression collective de la souveraineté nationale. Mais en réalité, il n'y a plus qu'un pouvoir, celui de César ; qu'une loi, sa volonté. Les instruments qu'il daigne employer peuvent changer de nom, de place, de fonction ; mais du sénat aux comices, en descendant tous les échelons de cette hiérarchie qui n'est plus qu'une ombre vaine du passé, ce que vous retrouvez au fond de tout, c'est l'œil, la main, la direction du maitre. On le voit, l'idée de déguiser le despotisme sous le masque de la démocratie n'est' pas aussi neuve qu'on le croit d'ordinaire, et César lui-même ne l'a pas inventée. Du reste, dans les mensonges de ce genre, il n'y a de trompés que ceux qui veulent l'être. Les peuples, s'ils sont dupes un moment, sont bien vite désabusés, et laissent l'illusion à ceux qui ont intérêt à la faire vivre. Quant aux autres magistratures, consulat, questure, édilité, préture, tribunat, César les laisse subsister toutes, se réservant de les remplir ou de les laisser vacantes au gré de son caprice. Et pourquoi les supprimerait-il ? Aucune ne confère une autorité assez réelle pour faire ombrage à ce pouvoir de qui émanent tous les autres. Mais j'oubliais un titre que le sénat, dans sa servilité maladroite, ose donner à César, c'est celui de Réformateur des mœurs. Etrange ironie, insulte à la pudeur publique, dirais-je, s'il y avait encore à Rome une pudeur publique ! Le galant chauve, comme l'appelaient ses soldats, est autorisé à porter constamment une couronne de lauriers ; et sous cet emblème de gloire, le vainqueur de Pharsale, le croirait-on, se réjouit de cacher sa calvitie ! Enfin, le nouveau censeur des mœurs loge sous le même toit Calpurnie, son épouse, Cléopâtre, sa concubine, et son fils Césarion, dont il veut faire un roi d'Egypte, n'en pouvant faire un empereur ; et Rome, qui eût pardonné au scandale, s'il ne fût pas sorti de ses murs, s'alarme de voir son maitre aux genoux d'une étrangère, et craint de se voir sacrifiée. Il faut le reconnaître pourtant, à cette époque culminante
de la carrière de César, ce n'est plus le mal qui domine, c'est le bien. La
plus belle page de cette grande vie, c'est toujours sa clémence, qui ne se
lasse ni ne s'épuise, et vient même au-devant de ceux qui ne la réclament
pas. Ainsi Marcellus, consul à l'époque de la bataille de Pharsale, était un
de ces nobles cœurs comme il en restait peu dans Rome, depuis la mort de
Caton. Ne pouvant plus croire à la République, ne voulant pas se résigner à
l'Empire, il s'était condamné à un exil volontaire. Retiré à Mitylène, il s'y
consolait du malheur des temps par l'étude et la philosophie, et s'attirait
ce bel éloge de Cicéron : J'ai vu, fait-il
dire à Brutus, Marcellus dans sa retraite, jouissant
de tout le bonheur que comporte la nature humaine.... et quand il m'a fallu repartir sans lui, il m'a semblé que
c'était bien plutôt moi qui allais en exil que lui qui y restait. Et
Sénèque d'ajouter : Quelle gloire pour Marcellus que
dans son exil, il ait fait envie à Brutus, et honte à César ! Avec une âme ainsi faite, il fallait que le pardon vint chercher Marcellus, car il n'était pas homme à courir après lui. Tout ce que purent lui arracher les instances de ses amis, c'est qu'il ne s'opposât pas à ce qu'on demandât pour lui la permission de revenir à Rome. Alors, en plein sénat, le frère de l'exilé vint se jeter aux pieds du dictateur, et tous les sénateurs intercédèrent avec lui. César se fit un peu prier, se plaignant des hauteurs de Marcellus et de ses âpres censures ; puis il finit par se laisser fléchir, sa magnanimité native étant ici d'accord avec sa politique. Cicéron, jusqu'à ce moment, avait gardé dans le sénat un silence assez cligne, qui lui pesait peut-être. Il jugea l'heure favorable pour le rompre, à la grande joie de César, qui s'attristait de ce silence improbateur, et regrettait cette grande voix dont l'éclat manquait à son règne. C'est alors que Cicéron improvisa cette immortelle harangue, le pro Marcello, où, avec un enthousiasme sincère, mais qui va jusqu'au dithyrambe, il élève aux nues cet acte mémorable de clémence. L'illustre orateur, heureux de pouvoir louer César sans bassesse, sait dans la flatterie même mettre de la dignité. Il rappelle au vainqueur, pour mieux faire ressortir sa clémence, que lui-même a combattu dans les rangs opposés, et qu'il plaide en ce moment devant lui pour un de ses complices. Dans ce sénat muet, où tout ce qui ne flatte pas se tait, il ose faire entendre des paroles comme celles-ci : Je souffre de voir le destin de la République, qui doit être immortelle, dépendre de la vie d'un homme mortel... Vous avez beaucoup fait pour enlever l'admiration des hommes, pas assez pour leurs éloges. Noble langage que César était assez grand pour comprendre, et qui honore celui qui ré-conte autant que celui qui le tient ! Mais bientôt Cicéron, effrayé de son courage, et ne
voulant pas désavouer son passé, sent le besoin de se le faire pardonner.
César avait laissé échapper ces mots où perçait un pressentiment sinistre : J'ai assez vécu pour la nature, et assez pour ma gloire !
Cicéron s'empresse d'y répondre, en faisant parade, pour son ancien
adversaire, d'un dévouement qui nous étonne : Tu
n'es pas né pour toi seul, lui dit-il, et tu
te dois à tous. Le salut public repose sur toi ; tu as ton œuvre à faire, et
tu en as à peine jeté les fondements... Si tu
crois que quelque danger menace ta vie, nous serons là pour veiller sur toi
nuit et jour, et te faire au besoin un rempart de nos corps ! Langage
au moins étrange, et qui contraste avec la joie
peu décente dont l'avocat de Marcellus devait saluer l'assassinat de César ! Quintus Ligarius, l'un des vaincus de Thapsus, avait été condamné à l'exil. Ses frères, partisans dévoués de César, et Cicéron, son ami, intercédèrent pour lui auprès du dictateur ; mais un des anciens complices de Ligarius s'étant porté son accusateur, la cause fut renvoyée devant les tribunaux, et Cicéron se chargea de la plaider. César, curieux d'entendre l'illustre orateur, voulut présider l'audience. Au fond du cœur, il ne se souciait guère de pardonner à un de ses plus irréconciliables ennemis, et Ligarius était d'avance condamné. César s'était armé contre sa propre clémence, mais non contre l'éloquence de Cicéron. A mesure que celui-ci parlait, on voyait le juge se troubler et changer de couleur. Chacun des sentiments qu'exprimait l'orateur se peignait sur ce front, impassible d'ordinaire et fermé comme un livre. Mais quand Cicéron parla de cette clémence immortelle de César dans un langage qui l'égalait en grandeur ; quand il rappela ses propres torts pour atténuer ceux de son client, et les faire envelopper dans le même pardon ; quand il évoqua Pharsale et ses dangers, et César deux fois vainqueur, par les armes et par la clémence, on vit trembler et s'agiter sur son siège le maître du monde ; les pièces du procès s'échappèrent de ses mains, et César vaincu, en pardonnant malgré lui à Ligarius, décerna à. l'éloquence la palme la plus glorieuse qu'elle ait jamais obtenue. Il nous en coûte de quitter Cicéron, même pour revenir à César. On' se sent attiré malgré soi vers cette aimable et facile nature, portée d'instinct vers l'honnête, et à qui il n'a manqué que la force, de n'en jamais dévier. Dépaysé dans Rome comme un vrai citoyen d'Athènes, cet esprit mobile et charmant. se sent mal à l'aise dans des temps trop rudes et trop agités pour lui. Les lettres, il est vrai, sont sa consolation et son refuge, mais il est toujours prêt à les quitter pour la politique, et cette ambition, pour laquelle il n'était pas né, a fini par lui coûter la vie. Aussi, même au sein du port, regrette-t-il la tempête. Sa position d'ailleurs est diminuée, comme toutes les positions politiques, effacées désormais au profit d'une seule. Il a cessé d'être l'arbitre du sénat, que son nom sert encore à décorer, mais où son astre a pâli, où sa voix a cessé de se faire entendre. Certes, pour un ennemi rallié, il n'a point à se plaindre de César, mais il ne comptera jamais parmi les familiers du maître ; la place est prise depuis longtemps, et, dans les affaires graves, César ne prend conseil que de lui-même. Mais les chagrins de Cicéron sont trop vifs pour durer. Après
avoir pleuré la patrie plus amèrement et plus longtemps,
nous dit-il, que jamais mère n'a pleuré son fils,
fait comme tant d'autres, il se résigne, et sa gaieté revient peu à peu.
L'épigramme, d'ailleurs, ne l'a-t-elle pas toujours consolé de tous ses maux
? Il raille agréablement le nouveau régime, but en faisant les honneurs de
lui-même avec une grâce infinie : J'occupais la
poupe autrefois, écrit-il, et je tenais le
gouvernail ; maintenant, à peine y a-t-il pour moi place à la sentine. Que je
sois à Naples ou à Rome, si mon nom se présente à la mémoire de César, on
l'inscrit au bas d'un sénatus-consulte qui, dressé dit-on à ma requête,
arrive en Syrie ou en Arménie avant que je sache un mot de l'affaire ; et des
rois m'écrivent pour me remercier de leur avoir conservé leur trône, quand
j'ignorais même qu'ils fussent nés ! Du reste, il s'est créé une occupation qui lui vaut de
hautes amitiés, et lui donne accès à l'oreille du maître : il enseigne la
philosophie et les lettres aux familiers de César. Comme
Denys le tyran, dit-il plaisamment, j'ai
ouvert à Corinthe une école de rhétorique. Ses élèves, disciples
d'Epicure, Hirtius, Dolabella, Balbus, le payent en dîners fins et en menus
services qui ont leur prix, dans cette cour moins lettrée que son maitre, et
où les armes ont détrôné la toge. Et puis, sous un despote littérateur, un
courtisan comme Cicéron ne peut pas longtemps rester en disgrâce. Quand on le
néglige, il écrit sa Vie de Caton, et a le courage de la publier du
vivant du dictateur. Celui-ci, au lieu de la proscrire, a le bon goût de la
louer et d'y répondre par son Anti-Caton, opposant ainsi plaidoyer à
plaidoyer, et prenant, comme un simple mortel, le public pour juge. Laissons maintenant Cicéron pour revenir à César, et ne le plus quitter jusqu'à sa fin. L'an 44 av. J.-C., le dernier de sa vie et de la République, va s'ouvrir : il faut pourvoir au consulat, au moins de nom. Le dictateur perpétuel, qui l'a refusé pour dix ans, daigne l'accepter cette fois, mais pour trois mois seulement. Il se donne pour collègue Antoine, rentré en grâce avec lui, car César ne se brouille jamais pour longtemps avec ceux qui l'ont servi, et peuvent le servir encore. Il nomme de nouveau Lepidus son maitre de cavalerie, la seule dignité réelle dans l'Etat, car toutes les autres ne sont plus que des noms. Le dictateur prépare Rome à une nouvelle absence, et se croit, à tort, assez sûr d'elle pour oser la quitter. A peine arrivé au terme de ses vœux, César était déjà las de l'inaction. Comme son esprit, son corps avait besoin de mouvement ; sa santé, languissante dans le repos, puisait dans l'action une vigueur nouvelle. Plutarque, pour faire de César un pendant d'Alexandre, lui prête le projet d'arrondir, aux dépens des barbares de l'Est et du Nord, l'empire qu'il voulait fonder. Son plan, nous dit-il, c'était de prendre à rebours le monde de la barbarie, en commençant par les Parthes, danger et honte de Rome depuis la mort de Crassus ; d'entrer ensuite par l'Hyrcanie et l'est de la mer Caspienne dans ces vagues régions où errent les Scythes et les Sarmates ; de soumettre tous ces peuples, après eux les Germains, et de rentrer dans l'empire par le Rhin, après en être sorti par l'Euphrate. Osons le dire, excepté les Parthes que Rome avait intérêt, non à conquérir, mais à refouler dans leurs déserts, tout ce plan n'était qu'une splendide folie, qu'Alexandre s'était contenté de rêver, et que dut repousser bleu loin l'esprit pratique de César. Le plus pressé pour Rome et pour lui, après avoir châtié les Parthes, c'était de civiliser la Gaule et l'Espagne, et d'achever ainsi leur conquête. Avec l'Euphrate, le Danube, le Rhin et la mer pour frontières, l'empire avait atteint ses limites normales, et plus tard, sous Trajan, il ne se trouvera pas bien de les avoir dépassées. Mais j'ai hâte d'arriver à des titres plus sérieux, aux réformes accomplies par César, et à ses plans de régénération de Rome et du monde, plans dignes de ce génie large et vraiment humain, mais que la mort ne lui a pas laissé le temps de réaliser. Le premier, c'était de refaire à Rome une population libre avec les provinciaux ; d'en appeler l'élite dans le sénat, et de renvoyer en échange aux provinces, par un système régulier de colonisation, le trop 'plein de la grande cité. Une nuit il voit en songe une grande armée qui pleure en lui demandant de relever Carthage de ses ruines. Il se réveille en sursaut, et écrit sur ses tablettes : Coloniser Carthage ! Et ce qu'il a dit, il le fait ; il envoie quatre-vingt mille citoyens romains repeupler Carthage et Corinthe, et le monde charmé d'applaudir à cette grande réparation ! Ainsi, dans le programme de César, le sénat fût devenu la vivante représentation de l'univers soumis, et Rome son centre politique et sa plus haute expression. Certes, si jamais homme fut excusable de rêver l'unité matérielle du genre humain, avec la force pour ciment, ce fut celui qui fonda l'Empire, et rassembla un instant l'univers sous sa main. Mais après Rome et après César, les rêves de monarchie universelle sont finis pour jamais. Ils ont fait place à une ambition plus haute et moins personnelle, où les peuples ont succédé aux rois : c'est de répandre sur le globe entier, déjà tributaire de notre industrie, la civilisation, les langues, et la foi de notre vieux continent. Ces projets de César répondaient aux idées alors régnantes, et au besoin de conciliation et de paix qui s'était emparé de tous les esprits ; car le plus beau privilège du génie, c'est de marcher le premier dans la voie que tout le monde suit. Mentionnons encore quelques autres projets, moins grands, mais non pas moins utiles. Il voulait, nous dit-on, couper l'isthme de Corinthe, et unir la mer Ionienne à la mer Egée, noble entreprise qui égale presque en audace celle de l'Hercule phénicien, séparant l'Europe de l'Afrique, et ouvrant l'Océan aux navires de Sidon. Il voulait aussi creuser un nouveau lit au Tibre, ouvrir un canal de Rome à Terracine, dessécher les marais Pontins, relever cette rive noyée où les fleuves ne coulent pas, endiguer la mer comme elle l'est en Hollande, et amener à Rome le commerce de l'univers, en faisant d'Ostie un port digne de la ville éternelle. On sent ici le génie pratique de César, si supérieur à celui d'Alexandre : il aime l'utile, c'est-à-dire ce qui dure, la seule de toutes les gloires des conquérants dont les peuples leur sachent gré ! Mais le monde matériel ne suffit pas à son ambition : la refonte des lois et leur codification entrent aussi dans ses vastes projets. Les conquêtes passent et les codes demeurent ; et puis, c'est bien le moins qu'on régularise le droit civil, quand on supprime les droits politiques, et qu'on protège les intérêts, quand on asservit les consciences. Cet esprit organisateur a besoin de porter l'ordre et la lumière dans le chaos de la législation romaine qui, s'améliorant sans cesse pendant tout l'Empire, n'atteindra sa forme définitive que sous Justinien, cinq siècles après César. Ainsi, à mesure que la société se dissout, on la voit prendre une forme plus régulière et plus savante ; comme César expirant, elle se drape dans sa toge avant que de mourir. D'autres réformes s'ajoutent à ces créations nouvelles ; une carte de l'Empire, levée par des géomètres grecs, rassemble le monde romain sous les yeux de son maître. Les tribunaux sont purgés des magistrats corrompus et prévaricateurs. Le sénat, composé d'éléments pris au hasard et sans choix, est épuré, et César y appelle les notables de la Gaule et de l'Espagne, en attendant ceux des autres provinces. Deux pamphlets, attribués à Salluste l'historien, se rattachent à cette heure solennelle de la vie de César. On n'en connaît que quelques fragments : Saisis (capesse), dit-il au vainqueur de Pharsale, l'Empire qui s'affaisse de vieillesse ; ne livre pas le monde aux ravages des guerres civiles. Saisis-le, au nom des dieux, pacifie la terre et les mers. Ecrase la noblesse, augmente le sénat en nombre pour le diminuer en crédit. On dira que tu fondes une royauté, ne t'en inquiète pas ! Ces conseils-là, on les entend d'ici, ils sont de tous les temps et de tous les régimes ; les Césars de toute date ont au fond de leur cœur une voix qui les leur crie, et n'ont pas besoin de Sallustes pour les leur répéter ! |