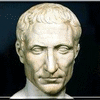JULES CÉSAR
CHAPITRE VI. — GUERRE CIVILE. - AFRIQUE. - ESPAGNE.
|
Passons en Afrique avec César, et nous y verrons les conséquences de sa faute. Les pompéiens, ou plutôt les républicains, ont dû à cette faute le temps de s'organiser. Mais, au lieu de réunir leurs forces contre l'ennemi commun, ils se divisent avant d'avoir vaincu. Trois hommes aspirent au titre de général en chef, Varus, l'incapable et vain Metellus Scipion, beau-père de Pompée, et Juba, roi de Numidie. Caton est obligé de venir de Cyrène mettre la paix entre les alliés. Il humilie l'orgueil du roi barbare, et, au lieu de prendre pour lui l'autorité suprême, dont lui seul est digne, il commet la faute de la faire donner à Scipion, dont le rang est au-dessus du sien. Il sauve Utique que Juba voulait détruire, la fortifie, et en forme un dépôt pour les besoins de l'armée. Les ressources du parti sont encore considérables ; Juba a quatre légions et une cavalerie innombrable ; Scipion en a dix, une masse de troupes légères et cent vingt éléphants. Leurs flottes tiennent toute la côte, et la ferment à César ; mais le pays est épuisé, on a pris tous les hommes pour faire la guerre, et les bras manquent à la culture. Maîtres de la mer, les pompéiens infestent la Sardaigne et la Sicile, et menacent l'Italie. En Espagne, ils donnent la main au fils de Pompée, que Caton a envoyé relever le drapeau de son père. César, on le voit, n'a pas un moment à perdre s'il veut réparer sa faute. Tout autre que lui ne s'en relèverait pas ; mais son activité suffit à tout. Avec cette volonté opiniâtre, qui se roidit contre l'obstacle jusqu'à ce qu'elle le brise, il rassemble à Lilybée, en Sicile, vers la fin de septembre, six légions et deux mille chevaux. Pendant les tempêtes de l'équinoxe, il fait embarquer tout son monde, et campe au bord de la mer, sous une tente battue par les flots, afin de se tenir tout prêt à partir. Au premier bon vent, il lève l'ancre ; sans donner même à sa flotte un rendez-vous sur une côte occupée tout entière par l'ennemi. Chacun débarquera où il pourra, et avisera à rejoindre son chef, en prenant pour guide l'étoile de César. Quant aux vaisseaux des pompéiens, qui pourraient l'arrêter en chemin, sa fortune les écarte. Les vents lui sont fidèles, et le quatrième jour, il débarque à Asdrumète, avec trois mille hommes seulement et cent cinquante chevaux. C'en est assez pour commencer la guerre, et avec son nom il trouvera partout des soldats. En mettant le pied sur la terre d'Afrique, il fait un faux pas et tombe, mauvais présage pour un conquérant ! mais il se relève aussitôt, une poignée de sable à la main : Afrique, je te tiens ! s'écrie-t-il, et ce mot heureux est accepté comme un présage de victoire. Depuis la chute de Carthage, l'idée s'est répandue que les Romains ne peuvent plus vaincre en Afrique sans un Scipion pour les commander. Les pompéiens en ont un à leur tête, et César veut avoir aussi le sien ; car il caresse, en les méprisant, ces préjugés vulgaires. Il a trouvé, sur le pavé de Rome, un descendant ruiné de cette grande famille, qui ne porte ce beau nom que pour le déshonorer : Il emmène avec lui, comme un gage de victoire, cet héritier avili des Scipions, et lui donne un grade dans son armée. Déjà César est maître de Leptis et de quelques ports. Ses troupes le rejoignent peu à peu ; mais il manque de vivres et de fourrages, et se bat pour en conquérir. Les cavaliers numides étonnent d'abord ses soldats en s'abattant sur eux, comme une avalanche d'hommes et de chevaux. César voit le porte-aigle prêt à prendre la fuite, il le saisit par le bras, lui tourne la tête du côté des Numides : Tu te trompes, lui dit-il, c'est là qu'est l'ennemi ! et il le ramène au combat. Mais l'heure de frapper les grands coups n'est pas venue, et César sait attendre. Il refuse le combat au présomptueux Scipion qui le lui offre, malgré les conseils de Caton, et il se fortifie dans son camp comme dans une ville fermée. Redoutant l'arrivée de Juba, il suscite contre le roi numide un roitelet mauritain et un ancien complice de Catilina, Sittius, espèce de condottiere qui, à la tête d'une troupe de bandits, est venu chercher fortune en Afrique. Sittius enlève à Juba sa capitale, et le force à venir défendre ses Etats. Du reste, le prestige du nom de César est tel, que pompéiens, Gétules et Numides désertent en foule pour s'enrôler dans son armée. Les souvenirs mêmes que Marius a laissés en Afrique y servent la cause de son neveu. Vivres et renforts, tout lui arrive à souhait. La Sicile, la Sardaigne ont reçu l'ordre de lui envoyer des soldats et du blé, et les ordres de César ne sont pas de ceux auxquels on désobéit. Enfin toutes ses troupes sont réunies, et il est libre d'agir. Juba, laissant à d'autres le soin de combattre Sittius, accourt pour rejoindre Scipion. Mais les soldats de César se sont habitués à tenir tête aux Numides et à leurs éléphants ; ils souhaitent maintenant la bataille autant qu'ils l'ont d'abord redoutée. C'est le tour des pompéiens de refuser le combat ; mais César saura bien les y forcer. Il commence, sous leurs yeux, le siège de Thapsus. Scipion et Juba accourent pour la défendre, et les deux armées viennent s'établir près de la ville, chacune dans un camp séparé. Voir ses ennemis se diviser au moment de les combattre, c'était plus que n'en eût osé espérer César. Il s'attaque d'abord à Scipion, le plus facile à vaincre. Mais, au moment de donner le signal, César, s'il faut en croire Plutarque et Suétone, est atteint d'un de ses accès d'épilepsie. On le voit hésiter, chanceler, et ses légions, dont on ne peut plus contenir l'ardeur, finissent par sonner la charge, et engager le combat sans son ordre. Mais l'esprit du général anime jusqu'au dernier de ses soldats, et, même malade, c'est encore lui qui gagne la bataille ! Les éléphants de l'ennemi, harcelés par une grêle de traits, se renversent sur leurs lignes, et y sèment le désordre. Les généraux eux-mêmes, suivant l'exemple de Pompée à Pharsale, sont les premiers à s'enfuir. Les pompéiens, chassés de leur camp, courent chercher un asile dans celui de Juba, et le trouvent déjà envahi par l'ennemi. Les césariens, fatigués de cette campagne de six mois, ne font de quartier à personne. Le sang coule à flots, et dix mille cadavres restent étendus sur le champ de bataille, cruauté gratuite que César n'eût jamais commise, et qui est une raison de plus de croire à s'on absence. En quelques heures, l'Afrique est conquise, et le parti pompéien tranché dans son nerf. Scipion et Juba s'en vont mourir plus loin, le premier de sa main, le second de celle d'un esclave ; l'empire serait à César si Caton ne vivait encore, et si l'Espagne n'était pas au fils de Pompée. Mais à force de voir recommencer cette lutte sans fin, le vainqueur de Pharsale s'est lassé de pardonner : de sang-froid, après la bataille, il fait mettre à mort quelques prisonniers de marque, comme Fans-tus Sylla et Afranius. Il reviendra plus tard à la clémence ; mais elle ne désarmera pas ses ennemis. Il manque un trophée à sa victoire, c'est Caton, qui n'a pas assisté à la bataille, et qu'il brûle de tenir en son pouvoir, pour lui pardonner, on n'en peut pas douter. Mais Caton ne lui laissera pas remporter ce facile triomphe : puisque les dieux ne sont pas de son parti, il lui reste dans la mort une porte toujours ouverte pour échapper à la clémence de son vainqueur. Et, en effet, la seule conclusion logique du stoïcisme, c'est le suicide ! Cette noble et triste doctrine, où l'homme se tient lieu de Dieu à lui-même, n'a pas de solution dans l'autre vie, et n'aboutit qu'au néant ; son dernier mot, quand tout nous a trompés, c'est de sortir de celle-ci ; la dernière révolte de l'orgueil, qui en est la base, c'est de rendre aux dieux, lorsque la lassitude de vivre nous prend, ce don stérile de l'existence, et de déserter le poste où ils nous ont placés. Quand je lis dans Plutarque la mort de Caton, la tristesse me prend, et je ne sais plus de quel côté me ranger, ne voulant ni vivre sous César, ni mourir avec Caton ! Lorsque je vois ce grand homme, si ferme et si doux à la fois, si occupé des autres jusqu'à ses derniers moments, s'emporter contre l'esclave qui, par ordre de son fils, lui refuse son épée, et se blesser en le frappant, je me dis : Est-ce donc là cette sagesse antique si vantée, et y chercherons-nous notre modèle ? Non ! ce n'est pas encore là la vraie grandeur, et je sais des morts moins célèbres qui me touchent plus que celle-là. Ô Caton, s'écrie César, en apprenant sa fin, je t'envie la gloire de ton trépas, puisque tu m'as envié celle de te donner la vie ! Ce qui ne l'empêchera pas un peu plus tard de poursuivre encore de sa plume celui qu'il ne peut plus combattre avec l'épée ; car le souvenir même de cet austère défenseur des lois l'importune, et Caton mort lui fait presque autant de peur que Caton vivant ! La guerre d'Afrique a duré cinq mois. Après avoir pardonné au fils de Caton, comme pour montrer au monde comment il aurait traité le père ; après avoir réduit la Numidie en province romaine, César revient à Rome, mais non plus tel qu'il en était parti. L'ivresse du succès, de ce succès continu qui ne peut pas être l'œuvre du hasard, et que les conquérants appellent leur étoile, perce dans son attitude, dans son langage. Lui si sobre d'ordinaire et si maitre de lui, il se vante d'avoir donné la paix au monde, et fermé les plaies de la guerre civile. Le sénat, il est vrai, par les basses flatteries sous lesquelles il déguise sa peur, ajoute encore à cette ivresse. Ses décrets adulateurs dépassent même le niveau de l'obéissance publique et les prétentions de César. Ainsi l'on célébrera par quarante jours de fêtes ses victoires en Afrique. Le char du vainqueur sera attelé de quatre chevaux blancs. Sa statue, sur un char de triomphe, se dressera dans le Capitole, en face de celle de Jupiter, avec cette inscription : A César, demi-dieu. Ici-bas enfin, en attendant l'Olympe, la dictature lui sera continuée pour dix ans. Mais au fond, malgré tous ces témoignages d'une joie
officielle, l'inquiétude se cache sous l'admiration ; derrière César on a
peur de rencontrer Sylla. Le dictateur s'en aperçoit, et, dans une harangue
solennelle, il daigne rassurer le sénat, Rome et le monde sur l'usage qu'il
compté faire de ce pouvoir sans bornes et sans contrôle. Ne vous imaginez pas, dit-il, que je pense à prendre Sylla pour modèle. Je veux être votre
chef, et non votre maître ; vous gouverner, et non vous tyranniser.
S'agira-t-il de vous servir, je serai consul et dictateur ; mais pour faire
du mal à quelqu'un, je ne serai plus qu'un simple citoyen. On peut l'affirmer sans crainte, César était de bonne foi quand il parlait ainsi. Porté par Un concours inouï de circonstances sur le faite le plus élevé où jamais homme fût monté depuis Alexandre, il n'avait plus qu'une ambition, c'était celle de se faire aimer. Mais, juste châtiment de son usurpation, et des voies criminelles qui l'y ont conduit ! sous peine de se livrer désarmé aux poignards des assassins, il ne lui est pas permis de cesser de se faire craindre. Il l'a essayé, on sait avec quel succès ! Quand on a employé les deux tiers de sa vie à conspirer contre les lois avec tous les mauvais citoyens, il est trop tard pour rallier à soi les bons, et réédifier tout ce qu'on a détruit. On ne change pas de voie après une carrière comme celle de César ; qu'elle mène au trône ou à l'abîme, il faut la suivre jusqu'au bout. Après avoir rassuré Rome, César a besoin de l'occuper : Dans quatre triomphes successifs, il étale sous les yeux du peuple les trophées de sa quadruple victoire sur les Gaules, l'Egypte, le Pont et l'Afrique, représentée par le fils de Juba. Par un reste de pudeur, il épargne à sa patrie l'affront d'un triomphe sur Afranius et Scipion : il ne veut pas glorifier le souvenir de ces luttes fratricides, où le sang romain a coulé des deux côtés. Un faste inouï préside à ces solennités, où la République expirante semble célébrer ses propres funérailles. De tous ces triomphes, le plus splendide, le plus vraiment glorieux, c'est celui des Gaules. Une seule tache le flétrit, c'est de voir traîner sur le char du vainqueur, parmi les captifs qui le décorent, ce noble Vercingétorix, qui sut donner un instant à la Gaule l'unité sans laquelle elle ne pouvait résister à César. Depuis six ans, il attendait dans les fers cette suprême honte d'orner le triomphe de son vainqueur. Le soir même, il fut étranglé dans son cachot. Son crime, on le sait, c'était d'avoir défendu contre l'étranger l'indépendance de son pays ! La nuit venue, César, par une pompe puérile, monta au Capitole à la lueur des lustres portés par quarante éléphants ; il gravit à genoux les degrés du Capitole, symbole expressif de l'ambition qui s'abaisse pour monter, et, pour cette fois du moins, le demi-dieu s'inclina devant le Dieu protecteur de Rome, et reconnut sa suprématie. Les largesses de César à ses soldats et au peuple dépassent les bornes d'une fortune privée ; elles épuiseraient la fortune de Rome, si ce n'était pas en même temps celle du monde. A chacun de ses vétérans 2.500 francs, sans parler des terres qu'il leur distribue. A chaque homme du peuple, dix boisseaux de blé, dix livres d'huile et 50 francs par tête ; Appien évalue à 65 mille talents (325 millions de francs) l'or étalé par lui dans son triomphe, comme fruit de ses victoires. Un festin de 22 mille tables à trois lits réunit la ville entière, conviée à cette solennelle inauguration de l'Empire. Mais le nombre des citoyens a diminué de plus de moitié depuis les dernières guerres. De tout temps, on le voit, la gloire a coûté cher, et les peuples la sèment, mais ne la récoltent pas ! Le cirque, recouvert d'un velarium de soie, reçoit dans son enceinte la moitié de la cité. Des jeux gigantesques, qui durent plusieurs jours, des centaines de couples de gladiateurs, des chevaliers mêmes qui combattent dans l'arène, apportent Pharsale sous les yeux des spectateurs. La fête est digne de Rome, le sang y a coulé à flots ! Mais au milieu de ces fêtes de la servitude, la vieille liberté romaine se fait jour par plus d'un côté. César a forcé un chevalier, Laberius, célèbre par son talent pour les mimes, imités de la Grèce, à déshonorer son ordre et lui-même en jouant un rôle dans une de ses pièces. Laberius obéit en frémissant, et se venge par mainte allusion mordante : Romains, s'écrie un de ses personnages, nous perdons notre liberté ! — Celui que tout le monde craint doit craindre tout le monde ! Et tous les regards se dirigent du côté de César, tandis que Laberius, comme il le dit amèrement de lui-même, sorti chevalier de sa maison, y rentre comédien. Une autre liberté proteste, plus cynique et plus mordante encore que celle du théâtre : ce sont les chants familiers dont les soldats romains saluent le triomphe de leur général, chants où la satire sert d'ombre à l'éloge. Les mœurs infâmes de César, les souillures de sa jeunesse à la cour de Nicomède sont rappelées sans pitié par la verve grossière de ses compagnons d'armes ; et ces railleries vengeresses, il est obligé de les subir, car il a encore besoin de ses vétérans, et ne peut pas les licencier. Il a eu beau les combler de ses dons, ils se trouvent encore trop peu payés, en se rappelant tout ce qu'ils ont fait pour lui, et en comparant leur part à la sienne. Ce triomphe, toutefois, n'est pas une vaine solennité ; c'est le point de départ d'une ère nouvelle, la première étape de l'Empire. César triomphe, non sur l'Afrique, mais sur les lois, captives derrière son char avec le fils de Juba ; sur Rome elle-même, prise d'assaut par les barbares qui, non contents de peupler ses armées, viennent encore siéger dans son sénat. Des centurions, des Gaulois à demi barbares y sont admis, comme à une école où ils vont apprendre le latin. Rome se venge, en les bafouant, de ses rudes conquérants : des affiches invitent les citoyens à ne pas montrer aux nouveaux sénateurs le chemin du sénat. L'esprit, on le voit, est de tous les temps et de tous les pays ; il a toujours consolé les vaincus, et prononcé l'oraison funèbre des libertés mortes. César triomphant, dit-on encore, trame au sénat les Gaulois conquis ! Mais ce n'est pas seulement la Gaule, c'est l'univers que César affranchit, pour se faire pardonner Rome asservie. Singulier contraste ! Les vrais, les seuls vaincus de cette grande journée, ce sont les Romains. Ils ont cru vaincre à Pharsale et à Thapsus, et ils ont vaincu en effet, mais hélas, ce n'était pas pour eux ! Avant d'étudier les réformes accomplies par César et ses plans d'organisation, un mot encore sur le dernier acte de ce sanglant drame. César ne se sent pas assez solidement assis pour donner la forme définitive à l'Empire qu'il veut fonder ; il a besoin d'une victoire de plus pour le consolider. Décidé à en finir avec les fils de Pompée, il sent la nécessité de payer encore une fois de sa personne, et part pour l'Espagne. Ses vétérans, fatigués et repus, s'arrachent à regret à leur repos. César lui-même est las de voir toujours tout remettre en question. Aussi, dès le début de la campagne, annonce-t-il qu'il ne fera pas de quartier, et il tient parole. Des deux côtés, dans ces longues et atroces guerres, les âmes se sont endurcies, et comme elle est sans fin, la lutte est sans pitié. A Munda, dernière et décisive journée qui tranche le destin
de l'Empile, Cnéius Pompée a l'avantage du terrain et du nombre. Les
césariens, découragés, refusent de se battre. César est malade comme à
Thapsus ; sa fortune chancelle un instant, et déjà, ne voulant pas survivre à
sa fortune, il songe à se donner la mort. Mais il aime mieux mourir de la
main de ses ennemis : désespéré, il saute à bas de son cheval, arrache une
aigle des mains de celui qui la porte, et marche en avant. Ses vétérans,
honteux de leur faiblesse, le suivent, sans hésiter cette fois. La victoire
lui reste enfin, conquise par ce dernier effort : trente mille pompéiens
demeurent sur le carreau, et César n'a perdu qu'un millier de soldats.
Labienus, Varus, Cn. Pompée sont parmi les morts. J'ai
souvent combattu pour la victoire, dit amèrement le vainqueur, mais aujourd'hui, j'ai combattu pour la vie ! Après Munda, toute résistance a cessé. Le second ' fils de Pompée est en fuite, le parti pompéien est dissous : ses chefs iront, ou flatter leur nouveau maitre, ou conspirer contre lui. César ne veut pas sévir contre l'Espagne, mais il lui fait acheter son pardon, et la rançonne sans pitié, en dépouillant même ses temples. Il fait argent de tout, et vend jusqu'au droit de bourgeoisie romaine. Son neveu et son favori, le jeune Octave, retenu par la maladie, n'a pas pu faire la campagne avec lui ; César qui l'a adopté, et se prépare en lui un héritier, le fait revêtir, à dix-huit ans, du sacerdoce suprême, et l'associera à son triomphe. |