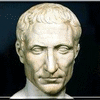JULES CÉSAR
CHAPITRE V. — GUERRE CIVILE. - PHARSALE.
|
En onze jours, tout est terminé, et César abdique la dictature, après s'être fait nommer consul, avec je ne sais quel obscur collègue ; il faut des ombres à côté de ces génies lumineux ! Il part pour Brindes, où l'attendaient douze légions et sa cavalerie. Mais ses flottes ne sont pas prêtes, et César ne veut pas attendre ; il lui semble qu'il n'a rien fait tant qu'il lui reste quelque chose à faire. Il n'a que douze vaisseaux de guerre avec-des transports ; n'importe ! il part pour l'Epire, avec vingt mille fantassins et six cents chevaux. C'est avec cette poignée d'hommes, affaiblis par les fièvres de la Pouille, qu'il se prépare à aller affronter Pompée, appuyé sur la majesté de la république. sur la moitié de l'Occident et sur l'Orient tout entier. Il part le 14 octobre de cette année mémorable (48 avant Jésus-Christ). Avec son bonheur ordinaire, il franchit le canal sans rencontrer un ennemi, et, à peine débarqué, il renvoie sur-le-champ ses navires chercher le reste de son armée. Pendant ce temps, que fait Pompée ? 'Durant l'expédition d'Espagne, il faut lui rendre cette justice, il n'a pas perdu son temps : outre ses cinq légions italiennes, il en a tiré une de la Sicile, et trois de Crète et de Macédoine, en appelant à lui tous les vétérans des guerres civiles. L'Asie, théâtre de son ancienne gloire, hélas ! éclipsée, s'est chargée de lui fournir des auxiliaires. Tous les rois, tous les peuples de l'Orient lui ont payé leur tribut. L'Egypte, la Phénicie, l'Asie Mineure, la Grèce, ont envoyé leurs vaisseaux. Comme Thémistocle, il aurait voulu mettre la lutte sur mer ; mais il a à faire à un adversaire qui choisit son terrain, et ne se le laisse pas imposer. Chacun s'attendait à voir Pompée confier à Caton le commandement de cette immense flotte, qui dépassait cinq cents navires ; lui-même y avait songé un instant. Mais la vertu de Caton et son culte pour la légalité importunent Pompée presque autant que César. Caton est homme, après la victoire, à exiger que le grand Pompée licencie son armée, et à lui dicter la loi à la tête de cinq, cents vaisseaux, et Bibulus est nommé amiral à la place de Caton. La flotte de Pompée était dispersée dans l'Adriatique, ses troupes dans les ports de l'Epire. Maître incontesté de la mer, de la Grèce et de l'Orient tout entier, il se flattait d'avoir rendu le passage impossible à son rival. Revêtu du commandement suprême par les deux cents sénateurs qui siégeaient à Thessalonique, il avait sous ses ordres les deux consuls, les préteurs, les questeurs et tous les magistrats de la république. On peut juger de sa honte et de sa colère quand il apprit que son rival avait franchi le détroit, qu'il était en Epire, et qu'il fallait lui disputer ce pays dont Pompée se croyait maitre. Déjà César s'était emparé d'Oricum et d'Apollonie, et, avec cette foudroyante activité qu'on lui connaît, il marchait sur Dyrrachium, la place la plus forte de l'Epire. Pompée toutefois parvint à le gagner de vitesse ; il se jeta dans la ville avant qu'elle ne fût investie, et César vint camper sous ses murs, aux bords d'une rivière qui seule séparait les deux armées. La faute de Pompée pouvait se réparer, s'il parvenait à fermer la mer aux vaisseaux de son ennemi. Bibulus, furieux de l'avoir laissé échapper, explorait sans relâche les côtes de la Grèce et de l'Italie, et faisait brûler avec leurs équipages tons les navires dont il s'emparait. Les deux concurrents étaient toujours en présence ; mais combien leur position était différente ! Pompée, maître de la mer, et appuyé sur une ville forte, pouvait à son gré accepter ou refuser le combat ; César, jeté sur une terre ennemie, sans vivres et presque sans armée, attendait ses troupes qui ne venaient pas, et pouvait à chaque instant expier sa faute par une défaite impossible à réparer. Pour gagner du temps, et mettre de son côté les dehors de la modération, il fait proposer à son rival de licencier tous les deux leurs troupes, et de s'en remettre au sénat du soin d'arbitrer leurs querelles. Mais la proposition, acceptable tout au plus pour César,
dont tous les vétérans lui seraient revenus au premier appel, ne l'était pas
pour Pompée, avec son armée de recrues : Je ne veux,
s'écrie-t-il, ni de la vie ni du retour dans ma
patrie, s'il faut les tenir de César ! Après avoir échoué auprès du
général, celui-ci se rejette sur les soldats ; mais pendant qu'on essaye aux
avant-postes quelques pourparlers, les pompéiens font pleuvoir sur leurs
ennemis une grêle de traits, et Labienus crie à haute voix à ses anciens compagnons
d'armes : Vous n'aurez la paix qu'en nous apportant
la tête de César ! Les semaines, les mois s'écoulaient, et l'hiver touchait à sa fin. Enfin César prend un parti, désespéré comme sa situation : ses troupes ne viennent pas, il ira les chercher ! Il s'embarque seul, déguisé en esclave, sur une barque non pontée, pour traverser le détroit. La barque, à l'embouchure du fleuve, est arrêtée par le vent contraire, et ne peut franchir la barre. Le pilote s'intimide et veut rebrousser chemin : Ne crains rien, lui dit en se découvrant le vainqueur des Gaules, tu portes César et sa fortune ! Les rameurs redoublent d'efforts, mais il faut céder aux flots et aux vents conjurés, et César, forcé de reconnaître qu'il y a ici-bas des obstacles que la volonté ne peut pas vaincre, finit par retourner dans son camp. Ajoutons que, dans ses Commentaires, il n'est pas dit un mot de ce coup de tête, plias digne d'un aventurier que d'un grand général, mais qui nous est, à défaut de lui, attesté par tous les historiens. Les ordres réitérés du dictateur finissent par décider Antoine à s'embarquer, au premier vent favorable, avec quatre légions et huit cents chevaux. Tout va bien jusqu'à la hauteur de Dyrrachium ; mais là seize galères de combat sortent du port pour les poursuivre. C'en était fait des quatre légions et de la fortune de César si, par suite de cet insolent bonheur qui ne le quitte pas, le vent n'ait pas tourné brusquement. Une tempête furieuse, en poussant les césariens au port, disperse la flotte de Pompée, et engloutit toutes ses galères, tandis qu'Antoine n'a perdu que deux navires. César est maintenant à la tête de quarante mille hommes, invincibles tant qu'il les commande, car la plupart sont de vieux soldats, habitués avec lui à tout souffrir et à. tout oser. Les deux armées étaient toujours en face l'une de l'autre. Les pompéiens, maîtres de la terre et de la mer, vivaient dans l'abondance, tandis que les troupes de César en étaient réduites à manger du pain d'herbes et de racines. Mais l'indomptable volonté du chef est passée dans l'âme des soldats : Nous mangerons l'écorce des arbres, s'écrient-ils, plutôt que de laisser échapper Pompée ! Celui-ci, malgré toutes les provocations, s'obstine à refuser la bataille. Sa position est sûre, ses ressources inépuisables. La Grèce, l'Asie, l'Afrique, tout le sud et l'est du monde romain sont à lui ; César n'a que la Gaule et l'Italie qui, les yeux tournés vers l'Epire, attend qu'elle lui envoie un maitre. Mais il a lui-même, et c'est assez ! La position n'est pas tenable, et vaincre est la seule porte pour en sortir. C'est alors que, par un effort désespéré, digne de la grandeur du danger et de celle de son génie, César, avec une armée affamée, inférieure en forces à l'ennemi, entreprend d'enfermer les pompéiens dans un immense retranchement, appuyé sur une série de forts. Il y gagnera d'occuper ses soldats, de proclamer aux yeux du monde sa supériorité sur un rival qu'il traite en vaincu, même avant la bataille, et de l'acculer à une fuite honteuse ou au combat, objet de tous ses vœux. Pompée le laisse faire, et se contente de se fortifier à son tour. Les deux camps se changent en deux forteresses dont l'une enferme l'autre, et la moindre a encore quinze Mille pas de circonférence. Tels sont les gigantesques travaux par où les deux armées rivales préludent au combat. Enfin les pompéiens, las de se voir provoqués, forcent les lignes de l'ennemi, lui tuent un millier d'hommes, et rétablissent leurs communications avec la mer. Un effort de plus, et le camp de César était à eux ; mais un ordre de leur chef les rappelle : Pompée sait vaincre, dit César, il ne sait pas profiter de sa victoire, et la fortune, implacable pour ceux qui la laissent échapper, le quitte pour ne plus lui revenir. César a besoin de relever le moral de ses soldats, trop habitués à vaincre, et abattus par ce léger échec. Il n'a plus qu'un moyen d'attirer Pompée hors de ses lignes, c'est d'avoir l'air de fuir devant lui. Il se met en route pour la Thessalie, épargnée jusque-là par la guerre. Pompée le poursuit pendant trois jours, mais désespère bientôt de l'atteindre. On tient conseil : Afranius ouvre un avis, menaçant pour César : c'est de lui laisser l'Epire et la Thessalie, et de regagner l'Italie, dont la possession entraînera bientôt celle de l'Espagne et des Gaules ; mais Pompée ne veut pas avoir l'air de reculer devant César fugitif, quand les dieux mêmes semblent le lui livrer. La confiance du chef a gagné les soldats, pleins de dédain pour un ennemi qu'ils croient prêt à demander grâce. Dans cette armée où tout le monde commande, hors le général, ce sont les soldats qui décident la bataille, et l'on se remet à marcher sur les traces de César. Le vainqueur des Gaules, battant en retraite pour la première fois de sa vie, a perdu tout son prestige. Les villes se ferment à son approche, et lui refusent des vivres. Il en prend une, la livre au pillage, et toutes les autres lui ouvrent leurs portes. Ses légions, avec l'abondance, ont bientôt retrouvé la santé. A l'approche des pompéiens, César s'arrête tout court, et demande à ses soldats s'ils veulent attendre le reste de ses troupes, ou vaincre seuls, et garder pour eux toute la gloire. L'armée n'a qu'une voix pour demander le combat. César, s'il faut en croire ses Commentaires, n'a que vingt-deux mille fantassins et mille chevaux, et Pompée quarante-cinq mille, plus sept mille cavaliers, la fleur de la jeunesse, romaine. Mais ni César ni ses soldats n'ont hésité : la foi qu'il a en lui est si forte qu'elle a gagné son armée. Dans le camp des pompéiens, on se partage d'avance ses dépouilles : la candidature est ouverte pour le grand pontificat, déclaré vacant avec l'héritage de César. On se dispute déjà le consulat, la préture et les plus belles maisons du forum, pour l'heure triomphante du retour. Pompée, ivre de sa victoire, avant de l'avoir gagnée, tranche du dictateur, et soulève contre lui, dans son propre camp, presque autant de haines que César. Déjà, dans son entourage, on ne l'appelle plus qu'Agamemnon, le Roi des rois. Caton et Cicéron n'aspirent à en finir avec César que pour se débarrasser ensuite de Pompée. Du reste, en homme prudent, celui-ci a eu soin de laisser à Dyrrachium ces deux censeurs incommodes. Comme il compte sur la victoire, il n'a pas besoin de Caton, qui n'est fidèle qu'aux amis dans la disgrâce, et n'aime que son pays et les lois. Aussi lui a-t-il confié le soin de garder les bagages, sachant que, en cas de défaite, il le retrouvera plus dévoué que jamais. Quant à Cicéron, trop perspicace pour ne pas voir les fautes de ses amis, et trop malin pour les épargner ; il aime mieux juger qu'agir, blâmer que conseiller, et décline obstinément toute responsabilité. Si Caton et Cicéron avaient siégé dans ce conseil où la
jeunesse dictait la loi à l'âge mûr, peut-être le sort de Rome et du monde ne
se fût pas joué dans les plaines de Pharsale. Mais le résultat eût été le
même ; car, à la longue, celui qui l'emporte, c'est toujours le plus brave et
le plus habile. Du reste, rien qu'à voir les deux armées, on savait celle qui
devait vaincre : ici de vieux soldats, bronzés par le soleil et par le froid,
regardant à leur général, et ne comptant jamais leurs ennemis ; là une
jeunesse élégante, plus rompue à la débauche qu'à la guerre, étalant au camp
le luxe de la cité, et luttant de faste en armures, en chevaux, en tentes où
brillaient l'or et la soie. Pompée, avec sa vieille expérience, aurait dû
comprendre l'inégalité morale de ces deux armées, où le nombre était d'un
côté, et la valeur de l'autre ; mais, aveuglé par l'amour-propre, il se
laissa faire violence par les folles passions qui l'entouraient, faute inexcusable, s'écrie Plutarque, chez le chef et l'autocrate de tant de peuples et de rois
! Car si on loue un médecin qui résiste aux appétits déréglés de ses malades,
que dire d'un général qui, pour sauver son armée, ne sait pas la contrarier ? Les vœux de César sont comblés : on va combattre, et sur le terrain que lui-même a choisi. Pompée occupait les hauteurs, et, malgré l'immense supériorité de sa cavalerie, il hésitait à descendre dans la plaine où son ennemi voulait l'attirer. Enfin César trouve un moyen de triompher des éternelles irrésolutions de Pompée : il donne à ses troupes l'ordre de décamper. Déjà les tentes étaient pliées ; mais les pompéiens, plus résolus que leur chef, ne veulent pas laisser l'ennemi leur échapper : ils s'ébranlent à leur tour, et viennent prendre position dans la plaine. Pompée, enfin résigné à combattre, prit ses dispositions en général habile : au centre et aux deux ailes, il plaça l'élite de son armée, et les recrues dans les intervalles. Lui-même se posta à l'aile gauche, où il avait réuni presque toute sa cavalerie. Son plan était d'envelopper l'aile droite de l'ennemi, de la tailler en pièces, et de prendre ensuite à revers l'armée de César qu'il se vantait de mettre en fuite avant qu'on n'en vînt à la portée du trait. Quant à son aile droite, elle était couverte par le fleuve Eunipée. Ce plan n'était pas mal conçu ; mais Pompée avait un tort grave, c'était de trop compter sur le succès, et de, mépriser son ennemi, surtout quand cet ennemi s'appelait César. Celui-ci, divisant aussi son armée en, trois corps, se place à l'aile droite pour faire face à Pompée, à la tête de la 10e légion, sa favorite. Pour suppléer à l'infériorité de sa cavalerie, il met en embuscade, derrière son aile droite, six cohortes d'élite, avec ces trois mots pour consigne : Frappez au visage. Pompée avait donné à son infanterie l'ordre de rester immobile, et d'attendre l'ennemi. C'était une faute, et César a raison de la lui reprocher, car l'élan du soldat ajoute à son courage, et attaquer, c'est la moitié de la victoire ! Les césariens chargent donc l'ennemi avec leur entrain ordinaire, et le combat s'engage au centre. Mais le sérieux de la bataille n'était pas là : à un signal, toute la cavalerie de Pompée s'élance sur l'aile droite de César, qui plie bientôt, trop inférieure en nombre. Déjà les pompéiens étendaient leurs longues lignes pour la prendre à revers ; mais les six cohortes, se démasquant tout d'un coup, courent droit à l'ennemi avec une furie qui l'étonne et l'arrête tout court. Les vétérans, leurs javelots à la main, les présentent sous les yeux de cette jeunesse dorée qui craint plus que la mort les blessures qui la défigurent. La plupart se cachent le visage, et tournent bride après un semblant de combat. Cette troupe, plus brillante que solide, est bientôt dispersée. Les six colonnes tournent à leur tour l'aile gauche de l'ennemi, 'et l'attaquent par derrière, tandis que César la fait charger de front par sa seconde ligne qui n'a pas encore donné. Dès lors la bataille est gagnée, et les pompéiens ne demandent plus leur salut qu'à la fuite. Le contraste entre César et Pompée n'est nulle part aussi frappant qu'à la journée de Pharsale. Comme Caton, qui pleurait à Dyrrachium, en voyant étendues sur le champ de bataille les premières victimes de la guerre civile, César, dès qu'il voit que la victoire est à lui, n'a plus qu'une pensée : Sauvez les citoyens romains ! s'écrie-t-il ; hélas ! ils l'ont voulu ! ajoute-t-il, comme pour se justifier à ses propres yeux. Pompée, au contraire, semble avoir pris à tâche d'absoudre la fortune qui le trahit. En se voyant abandonné par l'élite de son armée, il oublie, nous dit Plutarque, qu'il est le grand Pompée, et, semblable à un homme dont un dieu aurait aliéné l'esprit, il se retire dans sa tente, pour y attendre l'issue de la journée, sans rien tenter pour ressaisir la victoire qui lui échappe. Mais bientôt le camp même est envahi, malgré l'énergique résistance des auxiliaires barbares qui le défendent. Eh quoi ! s'écrie-t-il, jusque dans mon camp ! Et se dépouillant des insignes de sa dignité, il se met à fuir du côté de Larisse. Nous connaissons maintenant Pompée tout entier, nous l'avons vu à l'œuvre, et les mépris de César sont justifiés ! Nous avons hâte d'en finir avec ce faux grand homme dont l'histoire n'a pas assez fait justice. Laissons-le donc se faire égorger en Egypte, sous les yeux de sa femme, et recevoir les honneurs funèbres de la pitié d'un affranchi. Pompée a mieux mérité de l'histoire dans la première moitié de sa carrière ; oublions la seconde, et pardonnons à Corneille d'avoir prêté à sa mort la grandeur qui manquait à sa vie. Les durs soldats de César, habitués aux privations, furent étonnés, en entrant dans le camp des pompéiens, des richesses qu'ils y trouvèrent ; ce n'étaient partout que lits de pourpre, que vaisselle d'or et d'argent, que débris de festins et tentes tapissées de myrtes et de roses. On eût cru voir les apprêts d'une fête plutôt que ceux d'un combat. Tout compte fait, César n'avait perdu que deux cents hommes (d'autres disent douze cents), et Pompée quinze mille, dont six mille Romains seulement, et c'est peu pour une journée qui devait changer le sort du monde ! Plus de vingt mille fugitifs avaient cherché un refuge dans les montagnes ; César, sans perdre un instant, les poursuit, les force à mettre bas les armes, et se hâte de leur pardonner. La plupart s'enrôlèrent dans son armée. Dix sénateurs et quarante chevaliers, du parti de Pompée, étaient restés sur le champ de bataille. Quant à ceux qui tombèrent dans les mains du vainqueur, il les laissa libres de suivre leur général, et pas une goutte de sang, versée après le combat, ne vint souiller sa victoire. On avait trouvé dans la tente de Pompée des lettres de ses partisans à Rome ; César refusa de les lire, aimant mieux ignorer même ce qu'il avait intérêt à savoir, pour avoir moins à punir ! Rendons justice à César : il fit un noble usage de sa victoire, quoiqu'elle fût remportée sur Rome et sur les lois. Il rendit la liberté à la Thessalie qui lui avait donné l'empire. Les princes et les peuples, auxiliaires de Pompée, trouvèrent grâce auprès de lui. Les plus compromis en furent quittes pour quelques amendes. Avec Athènes, il se vengea par un mot seulement : Jusques à quand, dignes de périr par vous-mêmes, ne devrez-vous votre salut qu'à la gloire de vos aïeux ? Après Pharsale, on n'avait trouvé Brutus ni parmi les morts ni parmi les vivants, et César, qui l'aimait comme un fils, et qui lui donnait ce nom, s'affligea hautement de son absence. Brutus avait suivi Pompée à Larisse, mais, en voyant son chef s'abandonner lui-même, il se tint pour dégagé de son serment, et vint se rendre à César qui l'accueillit avec transport, comme là plus belle de ses conquêtes. En somme, le conquérant des Gaules se montre à nous ici sous son plus beau jour, et Pharsale est le point culminant de sa Carrière : Il s'est assez fait craindre, il ne cherche plus qu'à se faire aimer. Toute grande ambition, parvenue au but, veut se faire pardonner les moyens qui l'y ont amenée. Ainsi Octave, après Actium, sentira peser sur lui les proscriptions de son triumvirat, et la seconde moitié de sa vie sera consacrée à demander grâce pour la première. Pompée était mort, mais son parti n'était pas mort avec lui. Après Pharsale, l'armée était dissoute, mais la flotte restait ; Caton était à Dyrrachium avec Cicéron et Varron, à la tête d'un petit corps de troupes. Labienus, qui n'avait pas de pardon à attendre de César, vint les rejoindre avec le fils aîné de Pompée. Le rendez-vous général était à Corcyre, et bientôt tous ces débris de Pharsale s'y trouvèrent réunis. Caton, toujours soucieux de légalité, quand personne ne s'en occupait plus, proposa de donner le commandement à Cicéron, personnage consulaire ; mais celui-ci, qui n'aspirait qu'à l'étude et au repos, refusa nettement : Ce n'est pas assez, ajouta-t-il, de mettre bas les armes, il faut les jeter ! Sur quoi le jeune Pompée le traita de déserteur et de traître, et, tirant son épée, il voulait l'en percer, si Caton ne s'y fût opposé. Cicéron, dégoûté pour jamais des aventures, se retira à Brindes, bien décidé à se laisser amnistier par César. Les six mois qu'il y passa, dans une agitation fébrile et un abattement dont ses lettres portent la trace, sont une des époques les plus pénibles de sa vie. Quant à Caton, toujours calme, comme un homme qui est en paix avec sa conscience, il alla avec la flotte chercher sur les mers son général dont il ignorait le destin. Bientôt il apprit sa fin, et, prévoyant que l'Afrique deviendrait le point de ralliement de son parti, il s'établit dans Cyrène avec les deux fils de Pompée. César n'a pas pour habitude de laisser reposer un ennemi vaincu ; il se met donc sur la piste de Pompée ; mais privé de vaisseaux, il est condamné à faire un long circuit par la Thrace jusqu'à l'Hellespont. En traversant le détroit, il rencontre dix vaisseaux de guerre pompéiens. Il n'a qu'une barque, et ses troupes sont sur le rivage. Il cingle droit à l'ennemi, et les dix vaisseaux sont bientôt à lui. Avec trois mille légionnaires et huit cents chevaux, il parcourt en vainqueur les côtes de l'Asie, ouvrant ses bras à qui vient à lui, pardonnant à tout le monde, et protégeant les populations éplorées contre les publicains, les partisans de Pompée et les siens. A Rhodes, il recrute encore quelques galères, et se dirige vers Alexandrie. C'est là qu'en débarquant ; il apprend la mort de son rival,
et verse sur sa tête-pâlie, que lui présente un des meurtriers, quelques-unes
de ces larmes pieuses qu'on ne refuse pas à un ennemi vaincu. Il rend à ces
tristes restes les derniers honneurs, et place les cendres dans un temple
qu'il consacre à la déesse Némésis. Les larmes de César et quelques lignes
décentes, mais froides, de Cicéron, voilà toute l'oraison funèbre du grand
Pompée : Je ne suis point étonné de cette fin
tragique, écrit Cicéron à Atticus ; son état
semblait si désespéré que, en quelque lieu que sa fuite l'eût porté, je
m'attendais à une pareille fin. Je ne puis me refuser à le plaindre, car je
l'ai toujours estimé pour l'intégrité, la pureté de ses mœurs et la dignité
de son caractère. Ainsi, sur trois de ces maîtres du monde que l'on
appela triumvirs, deux ont déjà péri de mort violente, et le troisième n'a
pas longtemps à leur survivre. Voilà donc César à Alexandrie, et pour longtemps. Retenu d'abord par les vents qui s'opposent à son départ, et plus tard par son amour pour Cléopâtre, son séjour de neuf mois en Egypte est sans excuse ; c'est la première fois de sa vie qu'il ait manqué à ce qui passe pour lui avant le devoir, à son intérêt. Perdu, avec sa petite armée, dans cette immense cité, au milieu de cette population où gronde une éternelle émeute, il y reste, trop longtemps pour sa gloire, à la merci des intrigues de l'eunuque Pothin et d'Achillas, général de Ptolémée. Il a compté sur son ascendant, faute héroïque qu'il recommence souvent, et qui, cette fois, est sur le point de le perdre. Citée par lui à ce tribunal souverain où il juge les peuples et les rois, la trop fameuse Cléopâtre vient disputer le trône à son frère, à son mari Ptolémée, enfant vicieux, régenté par des sophistes grecs. Elle se glisse dans le palais, cachée sous un paquet de hardes, frêle, gracieuse, impudique, pouvant tout à force de tout oser. Elle amuse de son esprit et de son audace le vainqueur de Pharsale qui, malgré ses cinquante ans, n'est pas à l'abri d'une faiblesse, et a tout vaincu, sauf lui-même. Ptolémée, qui se soucie peu de partager son trône avec sa sœur, entoure César de complots. Bloqué dans le palais par une populace en furie, celui-ci va perdre sa flotte ; il la brûle, et le feu gagne la bibliothèque d'Alexandrie, centre des trésors littéraires de l'ancien monde. César pleure cette perte irréparable, et ses larmes sont sincères, car c'est un conquérant lettré, ce n'est pas un Omar ! Sur terre, sur mer, il lui faut combattre : enveloppé par l'ennemi, il se jette à la mer, et nage en tenant d'une main ses papiers hors de l'eau, sous une grêle de traits. Mais la fortune, après avoir hésité un instant, pour le punir d'avoir trop compté sur elle, revient à son favori : des renforts lui arrivent de l'Asie ; Ptolémée, noyé dans un combat, disparaît de la scène, et César, maître de l'Egypte, la donne à Cléopâtre, au lieu de la réduire en province romaine. Jusqu'ici, César n'a pas perdu son temps ; mais l'Egypte une fois soumise, qu'a-t-il à faire d'y rester ? Quand le monde romain tressaille encore de la secousse de Pharsale, et que les tronçons sanglants du parti pompéien s'agitent pour se rejoindre, en Asie, en Afrique, en Illyrie, en Espagne, partout où César n'est pas ; quand Pharnace, le fils, l'assassin et l'héritier de Mithridate, remue l'Asie tout entière, s'empare du Pont, de la Cappadoce et de l'Arménie, bat un lieutenant de César qui veut l'arrêter, et semble près de recommencer l'audace et les succès de son père ; quand Rome elle-même oscille entre la peur, la révolte et l'anarchie, est-ce le moment, pour le vainqueur de Pompée, de ramper aux pieds de cette cruelle et perfide sirène, et d'étaler aux yeux de l'Egypte le triomphe de sa reine lascive ? J'ai trouvé César bien grand après Pharsale, mais je le trouve bien petit quand il se traîne sur le Nil, à la suite de sa maîtresse, avec la pompe efféminée des despotes de l'Asie. Sans les murmures de ses soldats, peut- être même eût-il poussé plus loin, et remonté jusqu'à l'Ethiopie ! Il fait bâtir un temple somptueux à Vénus genitrix, la souche de sa race, et place à côté de la statue de la déesse celle de sa concubine. Antoine n'est-il pas justifié quand César en est descendu là ? Les progrès de Pharnace en Aste viennent enfin l'arracher à son ivresse. Il quitte l'Egypte, après avoir assuré la couronne sur la tête de Cléopâtre en lui faisant épouser, selon l'immonde usage de cette race, son second frère, Ptolémée l'Enfant, qui partagera le trône avec elle. Il reconnaît pour sien le fils qu'elle met au monde un peu après son départ, et lui donne jusqu'à son nom, en le laissant appeler Césarion. La faute de César porte ses fruits : les pompéiens relèvent déjà la tête, et Rome se demande avec inquiétude quand l'Egypte lui renverra son maitre. Mais avant d'y revenir, le vainqueur de Pharsale a deux choses à faire : pacifier l'Asie et en tirer de l'argent. Il soumet en passant Pharnace, et résume sa facile victoire dans ces trois mots célèbres : Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ! Et il annule ainsi la gloire de son rival en montrant le peu qu'elle lui a coûté. A tous les peuples ou rois alliés de Pompée, il impose de lourdes taxes, et pressure sans pitié cette opulente Asie qui n'a jamais su ni s'appartenir, ni se défendre. Depuis Pharsale, au reste, il a cessé de farder son
langage ; avec l'audace de la force, il en a le cynisme : Pour fonder une puissance solide, répète-t-il souvent,
il faut deux choses ; des soldats et de l'argent ;
avec l'argent, on a les soldats, et avec les soldats l'argent. Si l'un des
deux manque, on n'a plus rien ! Après la pratique de la tyrannie, nous
en avons ici la théorie. Avec son redoutable bon sens, César a vu plus juste
que ses adversaires : Cicéron, Brutus et Caton croient encore à la république
et aux lois ; César ne croit qu'à l'armée, c'est-à-dire à la force, et
l'événement lui a donné raison. Rome, après Pharsale, n'appartient qu'à César ; mais soit
embarras, soit pudeur, il n'a pas osé notifier au sénat sa victoire, et Rome
ignore longtemps les intentions de son maitre. Elle les apprend enfin, quand
le consul Servilius, à l'expiration de sa charge, nomme César dictateur, et
Antoine maître de la cavalerie. En
l'absence du dictateur, toutes les autres magistratures sont suspendues,
puisque lui seul a le droit d'y pourvoir. Tandis que César reste enchaîné
dans Alexandrie par son fol amour pour Cléopâtre, Antoine se trouve pendant
des mois l'arbitre suprême des destinées dg la ville éternelle. Elle ne
pouvait tomber en de pires mains : sans parler des débauches effrénées de ce
brutal soudard, de son ivrognerie qu'il étale en plein forum, dans l'exercice
même de ses fonctions, nulle fortune n'est à l'abri de ses exactions. La
justice, à son tribunal, se vend au plus offrant, et la faveur du maître y
tient lieu de loi. Ce n'est plus, comme avec César, la force intelligente et
maîtresse d'elle-même, c'est la force brutale, sous sa forme la plus hideuse,
celle d'une soldatesque sans frein, digne émule de son chef dans son mépris
pour tout droit. Un autre suppôt de César, le tribun Dolabella, vient encore ajouter à l'anarchie par un projet d'abolition des dettes et des loyers. La guerre civile est partout : en Illyrie, en Afrique, en Espagne où les pompéiens, sûrs de voir bientôt arriver le vainqueur de Pharsale, s'apprêtent à lui tenir tête ; dans les rues de la ville enfin, entre Antoine et ses soldats d'un côté, de l'autre Dolabella avec l'armée des débiteurs insolvables. Tel est le moment que César a choisi pour jouer dans Alexandrie le rôle d'Hercule aux pieds d'Omphale. Mais la seule menace de son retour fait tout rentrer dans l'ordre. Un vainqueur, qui pardonne à tous ses ennemis, s'est ôté le droit de sévir contre ses amis : soit insouciance pour les droits lésés, soit faiblesse pour des complices, il aime mieux tout ignorer, et envelopper dans un même pardon les torts des deux adversaires. Rome soupirait après son retour ; mais ses espérances furent déçues comme ses craintes, César ne fit que la traverser. Pour redevenir lui-même, et se livrer à ses meilleurs instincts, il lui fallait d'abord en finir avec tous ses ennemis ; Auguste ne pouvait venir qu'après Octave ! Et puis, il avait besoin d'argent, motif odieux et bas qui explique tout, quand, faute d'un peu d'or, il faut voir crouler le laborieux édifice qu'on a mis trente ans à élever. Cet or, il fallait le demander ou à ses ennemis, ou au public, ou à ses amis. César commença par les premiers : tous les biens des pompéiens morts pendant la guerre civile furent mis à l'encan, y compris ceux de Pompée lui-même. Cicéron, à qui César, en passant à Brindes, avait
gracieusement apporté son pardon, se tut à grand'peine en face de cette
injure que César aurait dû épargner à sa gloire et à celle de Pompée ; mais
son indignation, alors contenue, éclata plus tard dans cet admirable passage
des Philippiques qui lui coûta la vie peut-être, mais qui vaut pour un
noble cœur cette vie qu'il a coûtée. César revient à
Rome, heureux, il l'imagine du moins ! Mais peut-on être heureux quand on
fait le malheur de son pays ? Devant le temple de Jupiter, les biens de
Pompée le Grand sont mis à l'encan par la voix d'un misérable crieur !
Un seul instant, Rome oublie sa propre servitude pour gémir sur un autre
malheur que le sien ; si les âmes sont enchaînées, les soupirs du peuple
romain sont du moins restés libres ! Mais
tous sont dans l'attente : qui sera assez impie, assez insensé, assez ennemi
des hommes et de Dieu pour oser se faire adjuger les biens de Pompée ? Parmi
ces scélérats, capables de tout oser, qui entourent l'encan, qui
trouverait-on si ce n'est Antoine ?... Poussons jusqu'au bout cette curieuse histoire : Antoine
s'était fait adjuger les biens, mais César parti, il oublia de les payer. En
peu de semaines, meubles précieux, statues, vaisselle d'or et l'argent, tout
fut gâté, dissipé, vendu. César revient de l'Afrique, où Antoine ne l'a pas
suivi ; il en revient, toujours à court d'argent, et fait réclamer à Antoine
sa créance. Mais ici laissons parler encore Cicéron, dans cette scène de
haute comédie dont il a orné ses Philippiques : Comment, s'écrie Antoine, jouant la surprise et
l'indignation, à moi, César me demander de l'argent
! Eh quoi, n'est-ce pas à moi plutôt à lui en demander ? aurait-il pu vaincre
sans moi ? N'est-ce pas moi qui lui ai apporté un prétexte pour sa guerre
civile ; moi qui ai proposé des lois pernicieuses ;
moi qui ai porté les armes contre les consuls, le sénat, le peuple romain,
les dieux nationaux, les autels et les foyers, et contre la patrie même ?
N'a-t-il donc vaincu que pour lui seul ? Si le crime est commun, pourquoi la
proie ne l'est-elle pas ? César, poussé à bout, met garnison chez l'acheteur, et le force à remettre en vente les misérables débris du mobilier de Pompée. D'anciens créanciers viennent faire opposition à la vente, et César repart pour l'Espagne avant d'avoir été payé ; on ignore le reste, mais on peut parier hardiment qu'il ne le fut pas. Ainsi les biens de Pompée n'ont profité à personne, ni à celui qui les a vendus, ni à celui qui les a achetés. N'est-ce pas toujours la morale de la fable quand il s'agit de biens mal acquis ? Aux yeux de Cicéron, on le voit, les torts des vaincus n'excusent pas ceux du vainqueur, et le succès n'a pas toujours raison. Aussi, dans ses lettres intimes, s'en donne-t-il à cœur joie sur cette royauté que, je ne dis pas un Romain, mais un Perse même ne pourrait supporter.... Cet homme là (iste) n'en a pas pour six mois ; il tombera, ou sous le poids de ses fautes, ou sous les coups de ses adversaires ! Il est vrai, ajouta-t-il pour se consoler, que les choses n'iraient pas mieux sous Pompée, s'il était à la place de César ! Et cette perspicacité maladive, qui voit le mal sans pouvoir l'empêcher, fait de lui un prophète de malheur, qu'on rend responsable de tout ce qu'il a prédit. César a deux soucis : faire de l'argent, et gagner le peuple. Ce qu'il prend d'une main, il le donne de l'autre, toujours prodigue de son bien comme du bien d'autrui. Il refuse, avec une fermeté qui l'honore, l'abolition des dettes, réclamée par ses amis ; toutefois, comme on ne peut pas tout refuser, il remet aux débiteurs les arrérages échus depuis la guerre civile, et exempte de loyers pour un an tous les citoyens pauvres. Mais il a aussi ses créanciers, ce sont ses complices, et l'heure est venue pour lui de s'acquitter. L'année va finir : il crée consuls, pour la terminer, deux de ses lieutenants, Calenus, qui lui a soumis la Grèce, et Vatinius l'Illyrie ; et Cicéron fait ses gorges chaudes aux dépens de Vatinius, le plus indigne des deux, et de son consulat de huit jours, qui n'a eu ni hiver, ni printemps, ni été, ni automne. Et plus tard, à un consul de dix-sept heures, Caninius, le même Cicéron écrit : J'ai voulu vous rendre visite pendant votre consulat, mais la nuit m'a pris en chemin, et au réveil, tout était fini. A tous ces mendiants effrontés qui entourent César il faut jeter leur obole : il crée dix places de préteurs ; Salluste l'historien, est un des dix, et non le moins décrié. Par exception pourtant, César place aussi quelques hommes de mérite ; il confie l'Achaïe à Sulpicius, la Gaule Cisalpine à Brutus qui, depuis Pharsale, s'est franchement donné à lui, et Brutus se fait adorer de sa province, qui lui élève une statue. César, avant de passer en Afrique, se fait continuer dictateur, et désigner consul pour l'année suivante, avec Lepidus pour collègue. Il nomme en outre ce dernier maitre de la cavalerie, et lui donne Rome à gouverner pendant son absence. Rien ne le retenait plus, et il allait partir, quand une terrible Sédition éclate en Campanie parmi ses vieilles bandes, gorgées de gloire et de butin. Toutes, et au premier rang sa dixième légion, refusent de le suivre en Afrique tant qu'il ne leur aura pas soldé les récompenses promises. César pour le moment n'a rien à donner que des promesses ; les légions mutinées marchent droit sur Rome, en dévastant tout sur leur passage. César n'hésite pas : il fait fermer les portes de la ville, et s'avance à leur rencontre dans le Champ-de-Mars. Il monte sur son tribunal, seul, sans licteur, sourd aux prières de ses amis, et d'une voix calme et hautaine : Que demandez-vous, dit-il aux rebelles ? — Notre congé ! — Je vous le donne ! Quand j'aurai vaincu avec d'autres soldats, je n'en tiendrai pas moins les promesses que je vous ai faites. Et pour dernier adieu, il leur laisse ce mot, qui est pour eux la plus sanglante injure, Quirites (bourgeois ou citadins). Les rebelles, domptés, le supplient de les décimer, s'il le veut, mais de ne pas les congédier ; César se fait prier longtemps, refusant ce qu'il brûle d'accorder. A la fin il se laisse fléchir, et consent à les emmener avec lui ; mais pour la dixième légion il demeure inflexible, et lui reprochant son ingratitude, après toutes les faveurs dont il l'a comblée, il la condamne à être licenciée. La légion, désespérée, s'obstine à le suivre en Afrique, sans sa permission ; mais il lui tient rigueur : pendant toute la campagne, il la place toujours au poste lé plus dangereux, et la décime de fait ; puis, la guerre finie, il prive les survivants du tiers du butin et du tiers des terres qu'il leur distribue. On le voit, César, Si clément pour ses ennemis, n'est inflexible que pour les rebelles. Il traite ses soldats comme ses enfants, il a soin de leur parure, l'or et l'argent éclatent sur leurs armes, il ferme les yeux avec eux sur bien des choses ; il n'y en a qu'une qu'il ne leur pardonne pas, c'est de lui désobéir ! |