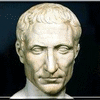JULES CÉSAR
CHAPITRE III. — EXPÉDITION EN GAULE.
|
Je n'ai pas l'intention de raconter ici les campagnes de César en Gaule. Lui-même l'a fait, de manière à ôter à tout autre l'envie d'y toucher après lui. Je laisse apprécier à de plus compétents ce rare génie militaire qui, Une fois en possession du théâtre dont il avait besoin, éclate au dehors par des prodiges que les siècles postérieurs n'ont pas encore égalés. Deux mots seulement sur la Gaule : elle a longtemps manqué d'unité, ce fut son vice et sa faiblesse. La Providence l'a faite une, comme l'Espagne, et les hommes seuls ont pu la morceler. Comme l'Espagne encore, elle n'a connu ses forces qu'après avoir été vaincue, et quand il était trop tard pour s'en servir. Par cette conquête si longue, si disputée, César s'est acquis une gloire militaire sans rivale, et pourtant il n'en a rien coûté à l'honneur des vaincus, Vercingétorix est là pour l'attester ! Dans cette grande fédération du monde asservi qui allait s'appeler l'Empire romain, la Gaule et l'Espagne sont les deux seules nations qui y soient reçues tout armées, avec les honneurs de la guerre. Rome mesure leur valeur à ce qu'elles lui ont coûté ; aussi entrent-elles, comme de plain-pied, dans la cité romaine. Les Gaulois et les Espagnols, nous dit Cicéron, sont les seuls étrangers qui se promènent le front levé dans le forum, et y triomphent comme dans une ville prise. Mais veut-on savoir de quel prix la Gaule a payé son droit de cité ? Ecoutez César : il vous dira froidement qu'il y a pris d'assaut 800 villes, soumis 300 nations, et combattu trois millions d'ennemis, dont il a tué un million, vendu un autre million, et mis le reste en fuite. Mais le vainqueur, en luttant neuf ans contre la Gaule, a appris à ses dépens ce que vaut une pareille race. Aussi, même avant qu'elle soit soumise, n'épargne-t-il rien pour l'incorporer dans ses armées. Il lève une légion chez ces vives populations qui devinent d'instinct le génie, même chez un ennemi, et se sentent fières de le servir. Sa cavalerie se recrute presque exclusivement chez les Gaulois. Avec de pareils soldats, il ne craint pas de rendre à Pompée, qui les lui redemande, deux légions que celui-ci lui a prêtées. Ne fût-il suivi que de ses braves Gaulois, il peut marcher, sur les traces de Brennus, à la conquête de Rome. Si des étrangers se passionnent ainsi pour lui, que sera-ce de ses concitoyens ? Comment ne donneraient-ils pas cent vies, s'ils les avaient à perdre, pour ce chef à la peau blanche et molle, frêle de santé, épileptique même, mais domptant, à force de volonté, ce corps qui n'est pour lui qu'un esclave ; toujours le premier partout, au combat, à l'assaut, aux marches, à travers les forêts de la Gaule chevelue, les marais de la Hollande, les neiges des Vosges et des Arvernes ; invisible et présent partout, se multipliant à force d'audace et d'activité, toujours prêt à apparaître au lieu et au moment où l'on a besoin de lui ; imposant à ses soldats ces prodigieux travaux qui, sous tout autre général, les eussent poussés à la révolte, et qui leur font faire ensuite si bon marché de leur vie. Leur nourriture est la sienne, et il s'en passe quand ils n'en ont pas, au lieu de boire du falerne quand son armée meurt de faim et de froid. Son lit, c'est un chariot de voyage où il chemine encore, même en dormant. C'est ainsi qu'en huit jours il est allé de Rome aux bords du Rhône. Le jour, le voyez-vous chevaucher entre quatre secrétaires, portés dans des litières, allant de l'un à l'autre, et leur dictant autant de lettres à la fois ? Mais ce qui achève de lui gagner ceux qui le servent, c'est qu'il sait au besoin s'oublier pour eux : je n'en veux pour preuve que cette chaumière où, surpris par la pluie, il cède à un de ses lieutenants malade l'étroit réduit et le grabat qui s'y trouve, et couche dehors, à l'injure de l'air, sous le toit en saillie. Dieu merci, nous n'avons point à rougir de nos aïeux : jamais peuple n'a résisté plus énergiquement à l'agression, pour se donner ensuite plus franchement à son vainqueur. En somme, la conquête romaine, malgré tout ce qu'elle a coûté à la Gaulé, a fini par lui profiter, comme à l'Espagne, son pendant en histoire. Et qu'on m'entende bien : quand je parle ainsi, je suis loin de fermer les yeux sur les maux de l'invasion, les campagnes dévastées, les villes incendiées, et cette longue traînée de sang et de larmes que laissent après eux ces fléaux de Dieu qu'on appelle des conquérants. Non ! toute guerre où il ne s'agit pas de défendre son pays ou ses alliés contre une injuste attaque, toute guerre suscitée par le caprice ou l'ambition d'un seul est maudite, et l'égoïsme qui la déchaîne en doit compte au tribunal de l'histoire comme à celui de Dieu ! Mais les générations passent, et le souvenir des maux infligés disparaît avec ceux qui les ont soufferts ; le sillon se referme, plus fécond que jamais, sur ceux qu'il a recouverts. Les arts, la civilisation du vainqueur viennent fermer les plaies de la guerre, et réconcilier les vaincus avec leur défaite. Ainsi a toujours agi Rome, dure à qui résiste, clémente à qui s'est soumis. Grâce à ce sanglant baptême, la Gaule est entrée, pour n'en plus sortir, dans le faisceau des races latines ; elle a hérité de l'esprit de la vieille Rome, et de son double besoin de conquêtes et d'unité. Loin de protester contre le joug d'une centralisation oppressive, elle en a fait son idole, et s'est passionnée pour elle, comme d'autres pour la liberté. De Charlemagne jusqu'à nos jours, un lien de plus en plus étroit a uni ses destinées à celles de l'Italie. Conquise une fois, la Gaule a conquis à son tour. Sœur cadette, après avoir tout reçu de son ainée, elle lui a tout rendu avec usure, le mal d'abord, le bien ensuite ! Elle est quitte avec l'Italie maintenant, depuis le jour où, en lui achetant l'indépendance au prix de son sang, elle l'a laissé reconquérir elle-même l'unité dans la liberté. Nous voici bien loin de César, et cependant toue date de
lui dans ces deux destinées de peuples, solidaires l'une de l'autre à travers
les siècles, tandis que l'Espagne, un instant rattachée à l'Italie, s'en
sépare bientôt pour se tenir à part dans l'histoire, comme sa péninsule est à
part du continent. Au point de vue de l'intérêt de Rome, la conquête de la
Gaule était indispensable, écoutons plutôt Cicéron : C'est
la première fois, écrit-il, qu'on ose attaquer
les Gaulois ; jusqu'ici on s'était contenté de les empêcher d'entrer chez
nous, César est allé les chercher chez eux. Nous ne possédions qu'un sentier
dans la Gaule, ses limites sont aujourd'hui celles de notre Empire. Un
bienfait de la Providence avait donné les Alpes pour rempart à l'Italie ;
sans elles, Rome n'eût jamais été la maîtresse du monde. Qu'elles s'abaissent
désormais, ces barrières infranchissables : des Alpes à l'Océan, l'Italie n'a
plus rien à craindre ! Etrange contraste ! Pompée, proconsul
d'Espagne, n'a pas mis une fois le pied dans sa province, qu'il gouverne par
ses lieutenants. Absent de Rome, il paraissait plus grand, et c'est sa
présence qui le diminue. César, au contraire, grandit par la distance, et n'a
jamais été plus présent à Rome que depuis
qu'il n'y est pas. De temps en temps, il vient passer quelques mois d'hiver
dans la Gaule Cisalpine, pour être plus à portée de la capitale, et
rassembler dans sa main les fils qui y font tout mouvoir. Comme il ne lui est
pas permis de franchir les limites de sa province, Crassus vient le trouver à
Ravenne, et Pompée à Lucques. Tel est l'empressement des Romains à saluer
leur maître futur qu'on compte une fois à sa porte plus de 120 licteurs,
escorte des hauts personnages qui viennent faire leur cour au conquérant de
la Gaule. Dans cette double entrevue où se trament à la fois la servitude de
nome et la ruine de Pompée, les triumvirs essayent de raffermir leur alliance
déjà chancelante : on arrête que Crassus et Pompée seront nommés consuls, et
César continué pour cinq ans dans son gouvernement. Pendant ce temps, que fait-on à Rome ? Voyez les lettres de Cicéron, ce fidèle miroir de toutes les opinions, de toutes les rancunes, de toutes les passions de l'époque : tous les yeux sont fixés sur César ! Au prestige qui entoure ce conquérant lointain se joint je ne sais quel vague pressentiment de l'avenir, quelle secrète terreur de ces barbares qui s'amassent lentement autour de l'Empire, pomme l'eau au pied d'une digue, en attendant l'heure de la dépasser. On sait gré au vainqueur des Gaules d'avoir rendu a Rome sa foi en elle-même, et de la consoler, avec les gloires du dehors, des hontes et des misères du dedans. Pendant ce temps, ses adversaires disparaissent ou s'annulent. Crassus va se faire tailler en pièces par les Parthes, avec l'élite des légions romaines. Sa mort, deux fois fatale à la république, laisse aux prises les deux ambitions qu'il empêchait de se heurter. Le inonde romain a cessé d'être assez large pour les contenir toutes deux. Enfin la mort de dulie, fille de César et femme de Pompée, morte en couches avec son enfant, vient briser le fragile et dernier lien qui unissait les deux rivaux. Cette alliance contre nature, œuvre de la politique de César et de Pompée, se relâche peu à peu, et Rome se débat en vain contre la guerre civile où elle se sent fatalement entraînée. Quant à Pompée, il hésite, il flotte d'un parti à l'autre, au gré, non de ses passions, il n'a pas l'âme assez grande pour en avoir, mais de sa vanité et de ses caprices. Assez puissant dans Rome pour y suspendre le règne des lois, il y fomente à dessein l'anarchie, dans l'espoir que tout le monde finira, de guerre lasse, par se jeter dans ses bras, En attendant Pharsale, que chacun sent venir, la guerre civile est dans les rues de la ville que se disputent les gladiateurs de Clodius et de Milon. Le sang y coule à. flots pendant des mois, et la mort même de Clodius, ce grand artisan de troubles, ne parvient pas à y ramener la paix. Maîtresse du monde et à la merci du premier factieux, Rome est dans un état si désespéré que tout y est possible, excepté cette liberté sous la loi que Caton s'obstine seul à défendre. Enfin Bibulus, ancien ennemi de Pompée, suggère un expédient, extrême comme la situation : c'est de nommer Pompée consul unique, et de lui confier le soin de sauver la patrie en danger ; et, au grand étonnement de tous, Caton se range de cet avis. Soyons juste, même avec Pompée ; il ne se montra pas indigne cette fois de la confiance de Caton. Au bout de six mois, renonçant de lui-même à cette espèce de dictature, il se donne pour collègue son beau-père, Metellus Scipion. Mais il est trop tard pour faire plier Rome sous le joug de la légalité : tant de semences de discordes, de rivalités et de haines devaient porter leurs fruits. L'union, sincère cette fois, de Pompée avec le sénat, irrite le parti populaire. Enfin une dernière faute de Pompée vient tout perdre : il permet à César de prétendre au consulat sans venir le briguer en personne. On l'autorise, par une exception unique, à aspirer, du fond de sa province, à cette dignité suprême, et à mener de front la conquête des Gaules et celle du consulat. Pompée se charge lui-même de grandir son rival, sous prétexte de l'éloigner. Mais le vrai, le seul maître de la situation, c'est César qui règne à Rome, invisible et présent. Si l'on se demande pourquoi il n'y revient pas, c'est qu'il veut, en achevant là conquête des Gaules, asseoir sur une base plus ferme sa popularité. Il vent surtout conserver son armée, instrument de conquête, avec lequel il peut tout oser. Car si le peuple est pour lui, le sénat et le parti aristocratique sont toujours contre lui. Il a peur, s'il rentre dans la ville en simple citoyen, d'être traduit en justice ; Caton l'en a menacé plus d'une fois, et a demandé même, en plein sénat, qu'on le livrât aux Germains. Et voilà pourquoi il reste en Gaule ! mais en même temps, il est à Rome, il y habite, dans le cœur ou dans la pensée de tous, tant il sait tenir en haleine l'admiration et la faveur publique. Tout lui sert dans ce but : sa fille vient-elle à mourir, il donne en son honneur au peuple des jeux et un repas. Il fait construire dans la ville une place immense dont le terrain seul lui a coûté douze millions de francs. Il sème l'or et les bienfaits à pleines mains ; il double la paye de ses légions, il leur prodigue le butin, les récompenses de toute sorte, et Plutarque pourra dire de lui qu'il a subjugué les Gaules avec le fer des Romains, et les Romains avec l'or des Gaules. Mais vous n'avez pas encore là César tout entier, et son cercle d'action ne se confine pas à Rome et à la Gaule. Il fait conférer le droit du Latium à la Gaule Cisalpine, avant-garde de la barbarie sur le sol de l'Italie. Patron avoué des provinciaux, il les couvre de sa protection devant les tribunaux romains, et l'univers rassuré s'abrite sous cette puissante tutelle. Dans ce monde fermé de la Vieille Rome, lui seul n'en a ni les étroits préjugés, ni la politique sans entrailles. Caton est l'homme du passé, César l'homme dé l'avenir. Lui seul a compris que l'enceinte de la cité romaine doit s'ouvrir enfin pour laisser entrer tous les peuples. La domination de la race conquérante, seul droit des gens qu'ait connu l'antiquité, depuis Sparte jusqu'à Rome, va faire place peu à peu à un droit social plus large et plus humain. La ville-reine associera enfin ses sujets à son empire. Les lois, les lettres, les arts achèveront l'œuvre commencée par l'épée, et la paix romaine fermera les plaies des provinces. La famille humaine va se constituer, avec l'unité clans la politique, en attendant l'unité dans l'amour, c'est-à-dire le christianisme ! Une pareille révolution, ébauche puissante du génie d'un seul homme, qui devait léguer à ses successeurs le soin de la réaliser, ne pouvait pas s'opérer sans obstacle ; il fallait s'attendre tôt ou tard à une révolte du patriciat et du vieil esprit romain. Marcellus, un des deux consuls qui ont succédé à Pompée, fait battre de verges un magistrat transpadan, devenu citoyen latin : Les coups, lui dit-il, sont la livrée de l'étranger ; va montrer à César la trace de ceux que tu as reçus. César a pris pour lui l'injure, et il la vengera. Plus populaire que jamais à Rome, il s'y appuie sur sa gloire, sur ses intrigues, ses largesses, et sur les provinces dont il est le Dieu tutélaire. Anticipant sur le rôle à venir des Empereurs, il sème sur son passage de somptueux édifices. Il conquiert et il pacifie, comme Rome dont il personnifie le génie, en le faisant moins dur et plus humain. Tous les moyens lui sont bons pour réussir, mais il préfère les plus doux, et il faut lui en savoir gré. Il se fait tout à tous, et se prête à qui le réclame, sans se donner jamais. L'univers, façonné au joug, est mûr pour la cité romaine ; mais Rome ne l'est pas pour l'obéissance : il faut la laisser se débattre encore quelque temps entre deux ou trois médiocrités politiques, comme Pompée et Cicéron, et invoquer son libérateur, trop habile pour se presser de venir. Pompée, de plus en plus effrayé du sourd progrès de la puissance de César, fait rendre par le sénat un décret qui ordonne à celui-ci de licencier son armée dans un délai fixé, sous peine, s'il n'obéit pas, d'être déclaré coupable d'attentat contre la république. Deux tribuns, dévoués à César, Antoine et Cassius, protestent contre ce décret ; leur vie est menacée, et forcés de quitter Rome la nuit, déguisés en esclaves, ils vont porter dans le camp du futur dictateur l'ombre de légalité dont il a besoin pour en parer là cause. Déjà depuis longtemps, min camp est le refuge de toutes les ambitions subalternes qui viennent s'y enrôler sous la sienne. Cicéron qui, sans se brouiller avec Pompée ; s'est prudemment rapproché de César, lui à envoyé son frère Quintus, dont il a fait un de ses lieutenants. Quiconque accourt sous ses drapeaux, pauvre et perdu de dettes, est sûr d'y trouver la fortune ; car César ne marchande pas avec les dévouements, et prodigue à ses fidèles les trésors de la Gaule. Aussi les recrues ne lui manquent pas, et bientôt il pourra dire avec Sertorius : Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis ! |