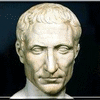JULES CÉSAR
CHAPITRE PREMIER. — JEUNESSE DE CÉSAR.
|
Après qu'Aristote, dans sa Politique, a tracé les règles qui doivent régir un Etat, il a la franchise d'avouer que les règles ne sont pas faites pour ces hommes supérieurs qui brillent comme des dieux parmi le reste des humains, et qu'on ne peut sans injure soumettre à la loi, car ils sont eux-mêmes la loi. Ces lignes prophétiques semblent avoir été écrites pour César, qui dut sourire en les lisant, et se reconnaître à cette image. Quel homme exceptionnel, en effet, que celui qui, depuis dix-neuf cents ans, fixe sur lui tous les regards, et est le point de mire de toutes les grandes ambitions ! Sylla n'est qu'un tyran vulgaire, froidement cruels qui repousse au lieu d'attirer ; mais César est aimable, il charme en subjuguant ! Et puis, vainqueur, il a su pardonner ; c'est là son plus beau titre. Du reste, aussi immoral que Sylla, avec la grâce de plus, pour se faire pardonner son empire ; toujours maitre de lui, jusque dans la colère, l'homme le plus habile et le moins ému de son temps, suivant le mot de Saint-Evremond. Roué subtil et profond, qui calcule tout, jusqu'à ses vertus, il fascine encore ceux qu'il ne petit vaincre, et Caton, qui le dénonce sans cesse, ne petit pas parvenir à le haïr. Ses vices, comme ceux de Catilina, lui servent à recruter des alliés : par eux il a les femmes, jalouses de donner l'empire à ceux qu'elles aiment, il a même les hommes, car la débauche est un lien étroit dans le monde taché de boue et de sang dont César est le représentant le plus complet, et qui, prêt à revêtir avec l'empire sa forme définitive, porte déjà en lui le germe de sa dissolution. A tous les titres, César semble destiné à régner : Libéral jusqu'à la profusion, d'un a courage qui dépasse la nature humaine, et même l'imagination, il est aussi, nous dit Velléius, le plus beau des Romains. Issu d'une des plus anciennes familles de Rome, il unit dans sa généalogie les rois et les dieux ; que lui manque-t-il pour entraîner la plèbe après lui ? Les fils de Cornélie, quoique alliés à la race orgueilleuse des Scipions, avaient dans les veines trop de sang plébéien ; aussi ont-ils échoué dans toutes leurs réformes ; César, au contraire, a pour tante la femme de Marius, et loin de répudier cette parenté plébéienne, il s'en fait gloire, et hérite ainsi de toute la clientèle de Marius, les publicains, la plèbe et les Italiens, opprimés par Sylla. Descendant de Vénus et d'Ancus Martius, allié du paysan d'Arpinum, il touche à tout, même à l'Olympe, et a sa racine dans tous les partis. Pour d'autres l'argent est un but, pour lui ce n'est qu'un moyen : deux ou trois fortunes, dévorées l'une après l'autre, ne suffisent pas à ses prodigalités sans mesure. Mais ses dettes mêmes lui servent de point d'appui, ses créanciers sont des clients qu'il se fait. Sylla seul a pressenti César, et lui fait un moment l'honneur de le craindre. Il veut la tête de ce jeune voluptueux, à la ceinture relâchée, qui ose seul le braver, et qui, à dix-huit ans, refuse de répudier sa femme sur l'ordre du dictateur. Rome tout entière s'émeut pour demander la vie de son favori ; les vestales même intercèdent pour lui, et Sylla, vaincu, l'épargne à regret en disant : Vous êtes bien mal avisés de ne pas voir dans cet enfant plusieurs Marius ! Mais César, qui ne se fie pas au pardon de Sylla, va jusqu'au fond de l'Orient chercher un refuge contre sa haine. Jusqu'à la mort du dictateur, il reste à la cour du roi de Bithynie, Nicomède, et étonne de ses débauches l'Orient lui-même, de qui Rome n'a plus rien à apprendre. Puis enfin, quand Sylla a disparu de la scène, heureux jusqu'à la fin de sa vie, si le succès c'était le bonheur, César revient à Rome, où Lepidus essaye une réaction impuissante contre le système du dictateur, qui lui a survécu. César n'a que vingt et un ans, et la politique l'attire déjà puissamment. Il sait qu'à lui seul est réservé l'honneur de recommencer Sylla, tout en combattant son parti ; mais, avec son tact précoce, il s'aperçoit que son heure n'est pas encore venue ; il se contente d'essayer son talent d'orateur en accusant de concussion Dolabella, l'un des partisans de Sylla. L'accusé, défendu par Hortensius, et trop puissant pour être condamné, est absous par ses juges ; mais, après ce début, qui a révélé un maitre, César n'en va pas moins étudier l'éloquence à Rhodes. Chemin faisant, il est pris par des pirates qui lui demandent vingt talents (116 mille francs) pour sa rançon. Il se trouve estimé trop bas, en offre cinquante, reste en otage jusqu'à ce qu'ils soient trouvés, les paye, quitte les pirates en leur promettant de les faire mettre en croix, et tient parole. Le temps qu'il a passé à Rhodes n'est pas perdu pour lui, car dans le monde ancien, l'art de bien dire a toujours été une des parties de l'art de régner. La Grèce était alors le séminaire de tous les jeunes Romains de distinction. Si César se fût donné tout entier aux lettres, il y eût brillé au premier rang, par le propre du génie est de se plier à tout, et d'exceller en tout. De l'aveu même de Plutarque, il fut le second des orateurs du forum, des rois de la parole, et si Cicéron n'eût existé, il eût été le premier. Admirable préparation pour des hommes d'État, sobres et durs comme les Romains, que cette culture grecque par où il leur fallait passer pour s'assouplir ! Seule, elle n'eût pas suffi, et n'aurait fait que des sophistes ; mais Rome les attendait au retour pour les tremper aux affaires. Ainsi la Grèce déchue règne encore sur ses rudes vainqueurs, et les façonne à son image : Græcia capta ferum victorem cepit... (HORACE.) Un ambitieux doit se tenir prêt à tout, à la guerre comme à la politique. Tout l'ouest de l'Asie est alors ébranlé par les armes de Mithridate : César quitte ses paisibles études pour aller faire une excursion dans la guerre, comme il en a fait une dans l'éloquence, en attendant la politique qui est pour lui le but, quand tout le reste n'est que le chemin. Avec des troupes que lui-même a levées, il marche au secours de la Bithynie, harcelée par les lieutenants de Mithridate, et force l'ennemi à évacuer la province. Rentré enfin à Rome, César, suivant l'usage des jeunes patriciens, prélude à la politique par le barreau. Il défend gratuitement, c'était alors l'usage des avocats, les provinciaux, les Grecs surtout, qui osent traduire leurs préteurs devant les tribunaux romains, mais qui n'y trouvent pas toujours pour les défendre un Cicéron ou un César. L'héritier des Jules se fait ainsi le patron du monde opprimé, et sème autour de lui des bienfaits placés à usure. Qui pourrait résister à son ascendant ? Des ennemis, il n'en a pas encore ; il ne demande rien, et il donne sans compter. Affable, bienveillant pour tous, nul ne peut échapper au charme. Sans doute, il emprunte d'une main pour donner de l'autre. Mais qu'importe à ceux qui reçoivent ? Chacun d'ailleurs se dispute l'honneur de lui prêter, et de placer ainsi à fonds perdus sur son avenir. L'argent ici-bas, c'est le pouvoir, et ce qu'on peut, c'est ce que l'on ose ; aussi César, dès sa jeunesse, a-t-il tout osé, car sa fortune n'a pas de bornes, puisqu'il puise à son gré dans toutes les bourses. Toutefois, quelques esprits plus perspicaces, Cicéron par exemple, que la peur rend clairvoyant quand l'amour-propre ne l'aveugle pas, s'effraye de la douceur menaçante du démagogue patricien : C'est la bonace de la mer, dit-il, la tempête est dessous. Mais quand je vois ses cheveux si bien arrangés, et ce jeune élégant se grattant la tête du bout de son petit doigt, de peur de déranger sa coiffure, je ne puis croire à un dessein arrêté de renverser la république. Mais le moment est venu de se désigner, par quelque coup d'audace, aux suffrages du peuple romain. César, déjà tribun militaire, prononce l'oraison funèbre de sa tante Julia, veuve de Marius, et ose promener en plein forum les images du rival de Sylla. Marius, même vaincu, vit encore dans les souvenirs du peuple, chez qui le culte survit souvent à l'idole, et du premier coup, voilà César populaire ! Après l'apothéose de Marius, il imagine de faire l'éloge de sa femme morte, et le peuple d'applaudir, sans comprendre qu'en faisant ainsi un deuil public de sa douleur privée, César tranche déjà du monarque. En toutes choses, du reste, il aime à se singulariser, et comme Alcibiade, pourvu que l'on parle de lui, peu lui importe ce que l'on en dit ! On sent percer dans les historiens du temps, mais surtout dans les lettres de Cicéron, vivant écho des rumeurs du moment, la peur que cette ténébreuse ambition commence à inspirer au sénat, grand nom qui survit à une réalité disparue, ombre de gouvernement qui remplit, avec Pompée, l'intermède entre Sylla et César. Aussi, en ambitieux qui sait attendre, juge-t-il à propos de s'éloigner encore une fois. Nommé questeur, il part pour l'Espagne sous le préteur Vetus. Mais pour révéler, à lui-même et aux autres, ses talents militaires, César a besoin de commander en chef ; peu lui importe le rang qu'il occupe, dès qu'il ne peut pas être le premier. En revenant d'Espagne, il s'arrête dans sa future province, la Gaule transpadane, et y entretient une agitation savante en la poussant à aspirer an droit de cité latine. De retour de sa questure, il épouse en troisième noces, à trente-deux ans, Pompéia, petite-fille de Sylla, son ancien ennemi. Qu'on ne s'en étonne pas ; les hommes de cette trempe n'ont que des intérêts, et jamais de rancunes ! De sa seconde femme, Cornélie, il a une fille qu'il mariera à Pompée. C'est ainsi qu'il se rattache à tons les partis, en nouant, comme l'araignée, sa tramp à tout ce qui résiste. En attendant, ses dépenses grandissent chaque jour avec le
but qu'il poursuit : il doit déjà 1.300 talents (six
millions et demi de francs), et se vante en riant d'avoir cette somme de moins que rien ! Ce qui ne l'empêche pas
d'ouvrir une candidature ruineuse au grand pontificat, et de parvenir, non
sans peine, à se faire élire. La chose étonne quand il s'agit d'un homme qui
dira plus tard en plein sénat : Il est des gens qui
croient qu'il y a des dieux ! Mais pour là comprendre, il fuit se
rappeler ce qu'était à cette époque la religion dans le monde romain : un instrument de règne, et rien de plus. Amère
ironie qui met un athée voluptueux à la tête des croyances du genre humain,
en attendant que le poignard de quelques assassins vienne en faire un dieu ! Nommé édile, il étonne Rome, même après Crassus, de son faste et de ses dépenses. Il se rend plus populaire que jamais en faisant couler à flots dans l'arène le sang des bêtes fauves et des hommes : 320 équipes de gladiateurs y combattent à la fois. Enfin, enhardi par sa popularité toujours croissante, il ose faire relever pendant la nuit les statues et les trophées de Marius, abattus par Sylla. Rome, à ce coup hardi, tressaille d'espérance ou d'effroi, et pressent un maître dans cet étrange démocrate, qui ne réhabilite Marius que pour continuer Sylla. Un historien moderne a fait de César l'homme de l'humanité, en l'opposant à Caton, l'homme de la loi. J'y consens, pourvu qu'on s'entende sur ce mot d'humanité. Oui. César fait enlever de l'arène les gladiateurs blessés, quand le peuple a baissé le pouce pour les condamner ; mais ces hommes qu'il a dotés de la vie seront un jour ses plus dévoués soldats, et jamais pitié n'a été placée à plus gros intérêt. Et puis, en agissant ainsi, il apprend au peuple, habitué à régner dans le cirque, à obéir au lieu de commander. Qu'on nous parle donc ici d'un calcul habile, mais non pas d'émotion ni de sympathie ; il n'y a pas place pour de pareilles faiblesses chez ces hommes de bronze que la louve a nourris du lait de ses mamelles. Quel contraste entre César et Caton ! L'un, c'est le vice aimable, l'autre, c'est la vertu indignée qui proteste en vain contre les turpitudes et les crimes de son temps. Mais la première condition pour agir sur son siècle, c'est d'en être, et Caton est en dehors du sien. Plutarque le compare à Phocion, qu'il lui préfère, non sans raison ; il vaut mieux, en effet, périr victime de l'injustice de son pays et du malheur des temps que de leur échapper par le suicide... Mais je m'arrête, et ne veux pas médire de Caton, que j'admire plus que je ne l'aime. Quand tout le monde se courbe devant l'iniquité triomphante, lui seul est resté debout. Il a protesté de toute la hauteur de son mépris contre cette apothéose du succès, seul Dieu qu'adore l'humanité à ses heures de déchéance. Seul, il a professé, dans un siècle d'égoïsme, le culte de la vertu désintéressée, et comme tel, je l'honore, en souhaitant aux siècles qui ressemblent au sien des Catons, pour trancher sur ce fond monotone de lâcheté et de bassesse. Du reste, César, en écrivant deux Anti-Catons, a donné la mesure de la haine que lui inspirait le seul adversaire sérieux qu'il ait rencontré dans son chemin, et cette haine, au fond, ce n'est que de la crainte ; si Caton n'eût songé qu'à soi, César eût été plus indulgent pour lui ! Mais au milieu de ce monde corrompu, cette inflexible vertu était d'un mauvais exemple, et César ne la lui a pas pardonnée. Aussi n'a-t-il rien épargné pour rendre Caton ridicule et odieux, mais sans y parvenir. Cicéron, au contraire, noble et faible cœur, toujours porté à admirer chez les autres les vertus même qu'il n'a pas, a rendu pleine justice à Caton en écrivant sa vie qui, par malheur, ne nous est pas parvenue. Vivant, il l'avait combattu plus d'une fois ; Mort, il le porte aux nues, et toute l'école stoïcienne, depuis Sénèque jusqu'à Thraséas, a montré dans Caton l'idéal du sage et du citoyen, mourant pour la liberté quand il ne peut plus vivre pour elle. Nous arrivons à Catilina, le second précurseur de César. Comme Sylla, il aplanit au fondateur de l'empire le chemin du trône, en montrant à Rome épouvantée la tyrannie pour refuge. César s'acquitte avec lui en défendant devant le sénat l'ennemi des lois et de son pays. Je ne veux pas faire à César l'injure de le comparer à Catilina ; mais il ne lui déplait pas qu'avant lui on essaye d'asservir Rome, pourvu qu'on n'y réussisse pas, et qu'on lui laisse la place libre, quand son heure sera venue. Et puis, avec de pareils repoussoirs, ses vices restent dans l'ombre, ses vertus seules sont en lumière. Quant à Catilina, le personnage est si hideux, si souillé de fange et de sang que c'est à regret que je m'y arrête un instant. L'homme du reste reflète l'époque, et ne peut s'expliquer que par elle ; essayons de la définir. Ce qui frappe avant tout le regard, à cette heure solennelle de l'histoire, où Jésus-Christ et l'empire romain vont apparaître presque en même temps, c'est une immense confusion. Tout vacille, tout est bouleversé, dans le monde matériel comme dans le monde moral. La propriété n'existe plus que de nom, la terre passe de main en main, le plus souvent par la violence ; on hérite en assassinant, on acquiert en expropriant. Un flot de laboureurs, de colons, chassés de leurs domaines par les vétérans de Sylla, en attendant ceux de Pompée et de César, s'abat sur l'Italie, et cherche à ressaisir par le pillage son droit de propriété perdu. De travail, de culture, il n'en est plus question ; l'Italie n'est plus qu'une lande où errent des troupeaux nomades, conduits par des pâtres esclaves, toujours prêts à se changer en bandits. Les hommes libres deviennent rares, à Rome surtout ; ils sont remplacés par des affranchis, dont le seul commerce est celui des suffrages, et par des bandes de gladiateurs, mis à l'enchère par les concurrents. L'argent règne, et même la forée brutale ne peut pas se passer de lui. Avec lui on peut tout acheter, jusqu'à l'empire. Les grandes propriétés sont devenues le fléau de l'Italie ; l'avide Crassus, un des types les plus bas de cette ignoble époque, n'a pas moins de 40 millions. Dans toute la cité, dit Cicéron, il n'y a pas deux mille propriétaires. Au sein de cette société dévorante, qui consomme et ne produit pas, le seul emploi actif de l'argent, c'est l'usure qui, dans les mains savantes des chevaliers, ronge l'Italie comme une lèpre. Et ce luxe effréné, dévorant, qui vient toujours dans les époques de corruption insulter à la misère publique, ce luxe, précurseur infaillible de la chute des empires, qu'il traîne à sa suite, en la précédant seulement de quelques pas ! Et ces soupers où un Lucullus dévore en une nuit la sueur d'une province ; où un Apicius bientôt fera battre sans relâché la terre et les mers pour découvrir un mets nouveau qui réveille ses appétits blasés ! Et la débauche, rapprochant, confondant les âges, les sexes, les rangs, et s'étalant à Rome dans des proportions que l'Orient même n'a pas connues ; les matrones romaines sortant de ce chaste sanctuaire où fila Lucrèce pour venir, au grand jour du forum, mêler la brigue à la luxure, et assaisonner de sang la volupté, en embauchant des gladiateurs pour faire élire leurs amants ! Dans une société ainsi faite, il s'agit bien, en vérité, de parler de lois comme Caton, ou de liberté comme Brutus ! Il s'agit de cueillir l'heure rapide (carpe diem), de vivre, d'oublier et de jouir, entre deux proscriptions. Et puis, de folles, de sanglantes ambitions s'agitent dans
ce chaos : Je vois dans l'Etat, disait
Catilina, deux corps, l'un sans vigueur (le sénat), avec une
tête plus faible que lui (Cicéron,
consul), l'autre (le peuple),
vigoureux, mais sans tête ; or cette tête, ce sera moi ! Chacun des
prétendants suit sa voie pour marcher à l'empire : Catilina veut violer la
république, Crassus l'acheter, Pompée la voir à.ses pieds, et César la
séduire. Inférieur sur tous les points à ce dernier, Catilina lui ressemble par ses pires côtés. Il ne représente que l'élément du mal dans la société romaine. Or le mal est une force, on ne peut pas le nier, mais une force qui ne dure pas ; car le monde, en définitive, n'est pas fait pour lui appartenir. Bonne tout au plus pour détruire, la force ne vaut rien pour fonder, quand elle n'a pas le droit pour complice. Un peuple peut trouver, dans une heure de crise, un Catilina pour étonner les failles de son audace, un Sylla pour systématiser la terreur, et mettre le massacre en coupe réglée ; mais ce n'est pas tout de vaincre et de proscrire, il faut gouverner, et c'est là qu'on les attend. César l'eût fait, s'il eût vécu, et Auguste, avec de moins beaux dons, l'a su faire après lui ; mais Catilina ne pouvait pas même vaincre ! Pour frapper d'impuissance ce bandit éhonté, dont la lâcheté universelle avait fait le courage, il suffit d'un avocat dont le danger public et l'amour de son pays firent un jour un grand citoyen. Le sénat, un instant ébranlé par César, qui ose invoquer la légalité en faveur de Catilina, est ramené par Cicéron, par Caton surtout, qui, avec son indomptable énergie, sait prêter du cœur à ceux qui en manquent, et déjouer le timide appui prêté aux factieux par César. Le sénat, entraîné, finit par s'armer d'une de ces peurs héroïques qui donnent du courage ! Le peuple lui-même, retourné par l'éloquence de Cicéron, se prononce contre Catilina qu'il favorise en secret. Les chevaliers, rassemblés en armes, insultent César à sa sortie du sénat. Il eût été massacré sans Cicéron, qui pouvait le laisser périr, et eut l'honneur de sauver cette vie redoutable qu'il tint un instant dans sa main. Faut-il l'approuver ou le blâmer ? Qui oserait prononcer, quand il s'agit d'un de ces hommes prédestinés dont la vie ou la mort ont été également funestes à leur pays ? Catilina, sentant Rome qui lui échappe, la quitte pour aller soulever l'Italie ; mais ses complices payent pour lui, et sont étranglés dans leur prison. Ils ont vécu ! s'écrie Cicéron, ivre de son triomphe ; mais les lois aussi ont vécu, et c'est la force qui a triomphé plus que le droit. Seulement, elle est du bon côté, cette fois, sauf à en changer plus tard. La ville est illuminée, le consul parcourt les rues aux flambeaux. Les femmes, du haut de leurs terrasses, acclament le libérateur de Rome. Courte illusion, éphémère victoire ! Tous, Caton excepté, ont travaillé pour César, et ne s'en doutent pas. En somme, il est permis de croire que le danger n'était pas aussi sérieux qu'il eut l'air de l'être, et que Cicéron l'a exagéré au profit de sa gloire. Catilina n'a pour armée que des pâtres, des paysans et trois mille soldats. Rome, aux jours d'Annibal, ne s'effrayait pas pour si peu. Par un reste d'orgueil patricien, il refuse d'enrôler les esclaves, dont la république naguère ne dédaignait pas l'appui à l'heure du danger. Ses soldats n'ont pour combattre que des bâtons durcis au feu ; leur courage, l'audace de leur chef ne peuvent suppléer à tout ce qui leur manque. Pris à Fesulæ (Fiesole) entre deux armées, Catilina se fait tuer avec la plupart des siens, en vendant chèrement sa vie. Ainsi, jusqu'à Catilina, chacun se fait complice de César, tout achemine Rome vers l'Empire et vers lui. Les obstacles même deviennent des points d'appui. Mais aussi, comme il sait attendre, art suprême, ignoré des ambitieux vulgaires, qui manquent l'heure en voulant la devancer ! Déjà tous se tournent vers lui comme vers un sauveur : on s'habitue à tout espérer d'un homme, hors la seule chose qu'il ne peut pas donner, le règne des lois et de la liberté. Cicéron lui-même oublie les affaires pour la philosophie ; on se dégoûte de la vie publique, dont la responsabilité effraye, et les âmes, entraînées par un courant plus fort qu'elles, s'en vont toutes à César. L'empire se fait tout doucement, ou plutôt l'empire est fait, l'homme nécessaire est trouvé ; car il y a toujours, on le sait, un homme en réserve pour toutes les grandes nécessités politiques. Le secret du génie, c'est de venir à propos, et ce secret, qui l'eut jamais plus que César ? Mais je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé de lui, et que je ne l'ai pas fait voir à ceux qui aiment à chercher l'homme du dedans sous celui du dehors. Les bustes de César sont rares, et je n'en vois guère que trois, dans l'Iconographie de Visconti, qui méritent qu'on s'y arrête. Tous trois appartiennent aux dernières années de cet homme célèbre, et pour le connaître à vingt ans, il faut le chercher dans Suétone : De haute taille, le teint blanc, les membres replets, le visage un peu plein, les yeux noirs et vivants, la santé florissante. Voilà César jeune et vous l'avez vu ! Si vous cherchez maintenant dans les bustes les traits qui demeurent et que l'âge n'a pas pu changer, vous êtes frappé du contraste entre ces lèvres ouvertes, bienveillantes, et l'inflexible volonté qui siège sur ce front, calme et fort comme la Destinée. On dirait qu'il y a chez cet homme étrange deux natures qui se complètent en se combattant. Il associe, dans une synthèse puissante, la guerre, l'ambition, la science, l'éloquence, le plaisir ; mais au fond, c'est toujours l'ambition qui domine. Il trempe de fer, par la gymnastique et la guerre, cette nature élégante et presque féminine que les lettres ont polie, et que la débauche même n'a pu énerver. Les repas, le sommeil sont pour lui une nécessité, jamais un plaisir. Regardez-le à 50 ans : l'homme extérieur a changé chez lui, la lame a usé le fourreau. Cette pensée fixe qui ne le quitte pas, régner, le dévore et l'excite à la fois. Son œil a vu le but, et ne s'en détournera plus. Pour l'atteindre, tous les chemins sont bons : lui, l'orgueilleux patricien, il flatte bassement ce peuple d'affranchis, oisifs et affamés. Peu lui importe de s'abaisser, dit Dion, pourvu qu'il se relève plus puissant. Dès sa jeunesse, nous dit Suétone, il a rêvé l'empire. Sans cesse il a à la bouche ces deux vers d'Euripide que lui-même a traduits en latin : S'il faut violer le bon droit,
que ce soit pour régner ; dans tout le reste, observons la justice. Allié par de savants mariages à toutes les grandes familles, il s'y glisse encore par l'adultère comme par une porte dérobée. Il séduit tour à tour, peut-être en même temps, la femme de Crassus, celle de Pompée et jusqu'à la sœur du sévère Caton. C'est par ces fils déliés qu'il enlace tout le monde, même ses rivaux et ses ennemis. La séduction de ses manières, le besoin qu'on a de lui, la peur même qu'il inspire, tout fait sa force et son empire. Ecoutez plutôt Cicéron, qui le connaît si bien : Voyez cet homme-prodige (τέρας) ; il vous épouvante par sa vigilance, sa célérité, son ardeur ! Clodius est un jeune patricien, beau, éloquent, impudique,
hardi, habitué à mener de front, comme César son modèle, la brigue et le
plaisir. Il courtisait la femme de ce dernier, Pompéia, gardée à vue par sa
belle-mère, l'austère Aurélia. A un jour fixé, les darnes romaines se
réunissaient à huis-clos chez Pompéia pour célébrer la fête de la Bonne Déesse ; les hommes, sous peine de sacrilège,
ne pouvaient y être admis. Clodius, imberbe encore, se déguise en femme, et
pénètre dans le gynécée. Il est reconnu, ignominieusement chassé, et un
procès criminel vient menacer sa vie. Mais le peuple, toujours prêt à prendre
le parti de ceux qui se jouent des lois, ne veut pas qu'on touche à la vie de
Clodius. César, esclave, comme tout ambitieux, de ceux dont il veut devenir
le maître, refuse de témoigner en justice contre l'accusé, et le fait
absoudre. Mais il faut à l'opinion publique une satisfaction : il répudie sa
femme, peut-être innocente, et comme on lui en demande le motif : La femme de César, répond-il, ne doit pas même être soupçonnée ! Evidemment, des quatre à cinq hommes différents qui se rencontrent en César, celui qui fait le fond de son être, c'est l'homme politique. Plus tard la guerre nous révèlera son génie militaire, égal au moins, sinon supérieur à l'autre : mais à l'inverse de tous les conquérants célèbres, l'homme d'Etat chez lui a précédé de vingt ans le général. La guerre, quel que soit le talent qu'il y déploie, n'est qu'un épisode dans sa vie, toute remplie par l'ambition. Du moment qu'il se décide à la faire, il y est le premier, comme en toutes choses ; mais à bien dire, sa carrière militaire ne commence qu'avec sa guerre des Gaules, à 41 ans. C'est par un calcul politique, pour revenir à Rome par la Gaule, qu'il se résigne à cette campagne de neuf ans où il devine, sans les avoir appris, les secrets du grand art de détruire. Mais sa pente n'est pas de ce côté ; s'il pouvait arriver à l'empire par les luttes du forum, et vaincre sur ce terrain où il a livré ses premières batailles, il renoncerait volontiers à une gloire qui lui semble inférieure, et qu'il n'a pas cherchée. Ce qui me frappe aussi dans César, c'est son amour pour les lettres, amour sincère, mais légèrement dédaigneux, comme d'un homme qui aurait mieux à faire. A le voir rédiger ses Commentaires avec une rapidité qui confond ses amis, on dirait qu'il se reproche le temps qu'il y perd. S'il écrit, ce n'est pas pour écrire, mais pour fixer ses souvenirs, en homme trop occupé du fond pour penser à la forme. Il parle de lui à la troisième personne, comme il parlerait d'un autre, laissant aux faits qu'il raconte le soin de le louer, et retraçant, pour la postérité, le récit de cette prodigieuse campagne, dans ce style lapidaire dont Rome a seule le secret. Comme toute chose ici-bas, les lettres ont été pour lui un moyen, jamais un but ; il les traite comme il a traité les femmes ; elles sont pour lui un passe-temps, un jeu qui l'amuse ou le sert, mais rarement une faiblesse, car il domine tous ses goûts, même en leur cédant. Et ce que j'ai dit des lettres et du plaisir, je le dirai de l'amitié, à laquelle il a toujours été fidèle, par nature autant que par intérêt. Aussi a-t-il été aimé, chose rare et qui doit sembler douce à ces maîtres du monde, plus habitués dans ce commerce à recevoir qu'à donner. Reste un dernier trait de cette physionomie, si forte et si fine à la fois, qu'il faut juger d'ensemble et non par les détails : César est Romain avant tout, par tous les grands côtés de son être ; mais le Grec aussi se retrouve chez lui, fondu avec le Romain dans une merveilleuse harmonie. J'indique ce trait en passant, car on le fausserait en voulant appuyer ; et certes, ce n'est pas une médiocre gloire pour ce génie cosmopolite que d'incarner ainsi en lui les deux grands peuples du monde ancien, les deux civilisations mères qui ont enfanté la civilisation moderne. Nous connaissons César maintenant, et nous allons le voir à l'œuvre, car jusqu'ici, il a préparé son action plutôt qu'il n'a agi. Il a étonné Rome de son audace, de ses débauches, de ses prodigalités ; mais il plie sous le poids de ses dettes ; il lui faut, pour les payer, quelques-unes de ces grasses provinces, comme l'Espagne ou l'Asie, où les ambitieux ruinés vont refaire leur fortune, avant de revenir à Rome se disputer les grandes charges sur le marché aux suffrages. Après sa préture, il se fait donner pour province l'Espagne ultérieure. Ses créanciers, craignant de perdre leur gage, ne veulent pas le laisser partir ; mais l'avare Crassus, pour se faire de lui un appui contre Pompée, le cautionne pour 830 talents (4 millions de francs). Deux traits me frappent dans ce court passage de César en Espagne, où il ne reste pas même une année : il pleure à la vue d'un buste d'Alexandre qui, à son âge, dit-il, avait conquis le monde ; et en passant devant une bourgade des Alpes, il jette à ses amis, qui s'étonnent qu'on puisse y vivre, ce mot révélateur : J'aimerais mieux être le premier dans cette bicoque que le second à Rome ! En Espagne, César commande en chef pour la première fois, et soudain se révèlent, comme innées en lui, ces hautes qualités qui font le grand homme de guerre, audace, rapidité, résolution indomptée, mépris pour la souffrance et le danger, et aussi pour la vie des hommes qu'il ne ménage pas plus que la sienne. Il bat sur terre et sur mer les Ibères révoltés, puis sa sage administration les réconcilie avec le joug romain. Il a trouvé le secret de pressurer l'Espagne et de s'en faire aimer, et y refait sa fortune, sans négliger celle de Rome. A son retour, forcé de choisir entre le triomphe et le consulat, il aimerait mieux rentrer à Rome par ces deux portes à la fois. Mais comme il faut, pour obtenir le triomphe, rester en dehors de la ville, et y résider pour briguer le consulat, César laisse l'ombre, et choisit la proie, c'est-à-dire le consulat. Tout ce que peut faire le parti opposé, c'est de lui associer un ami de Caton, Bibulus, et de lui donner un adversaire dans son collègue. |