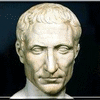JULES CÉSAR
CHAPITRE II. — PREMIER TRIUMVIRAT. CONSULAT DE CÉSAR.
|
Nous touchons à l'époque du premier Triumvirat, ce monstre à trois têtes, comme l'appelle Varron ; fatale union, plus nuisible à la république que toutes les discordes de ses grands (graves principum amicitias) ! Nulle part n'éclate mieux la savante profondeur des desseins de César : Pompée et Crassus, rivaux de puissance, sinon de gloire, troublaient depuis longtemps Rome de leurs divisions ; mais ces deux forces presque égales, en s'annulant l'une l'autre, étaient pour l'état une garantie encore plus qu'un danger. César persuade aux deux rivaux, au lieu de s'affaiblir eu se divisant, de s'associer avec lui pour régner. Ce pacte, menaçant pour la république, ne l'est guère moins pour ceux qui vont l'accepter ; car, sur les trois associés, deux à coup sûr travaillent à se donner un maître. Quant à Rome, elle y apprend à s'assouplir au joug, et à obéir à trois maîtres, en attendant un seul. Les trois alliés cachent quelque temps leur accord sous une feinte opposition. César, déjà l'obligé de Crassus, achète l'amitié de Pompée en lui donnant pour femme sa fille unique Julia, et le beau-père est plus jeune que le gendre. Lui-même épouse Calpurnie, fille de Pison. On prostitue la république par des mariages, s'écrie Caton indigné, et personne ne l'écoute : le règne de la pudeur est passé avec celui des lois. L'alliance de Pompée avec César nous étonne à bon droit, puisque l'un, comme dit Dion Cassius, ne veut pas de la seconde place, et que l'autre ne veut que la première. Pourquoi s'unir alors, quand, par des voies diverses, on tend au même but, et qu'un seul peut l'atteindre ? On comprend le jeu de César, mais l'aveuglement de Pompée, comment l'expliquer, si ce n'est par sa vanité ? Il faut voir avec girelle habileté perfide César attire ce parvenu, ennobli par la gloire, sur le terrain mouvant de la démocratie, où lui seul a su prendre pied ; comme il exploite à son profit les fautes, les maladresses de ce grand homme de parade, moins occupé d'être que de paraître ! Gonflé de sa réputation, qu'il perdra bientôt, de premier général de l'époque, Pompée croit avoir César pour lieutenant, et l'a en réalité pour maître. Celui-ci s'empare de sa confiance, le compromet avec le sénat, le pousse en ayant l'air de le suivre, et devient son mauvais génie. En réagissant contre le système de Sylla, Pompée rompt décidément avec son ancien parti ; la place qu'il quitte, il ne la recouvrera plus ; et celle qu'il veut prendre est déjà occupée par son insidieux rival. César le traite comme il traitera sa vieille alliée, la démocratie : il l'élève sur un piédestal, pour l'en jeter à bas, et creuse sous ses pas l'abîme où la république finira par tomber avec lui. Nommé consul, César agit en tribun : pour s'assurer la faveur
du peuple, il emprunte aux Gracques leur vieille machine de guerre, et met en
avant une nouvelle loi agraire. Il propose
de distribuer des terres à tous les citoyens pauvres qui auront trois enfants
ou plus, sûr d'avance que le peuple lui saura gré de sa loi, admise ou
rejetée. Caton, seul dans le sénat, a le courage de s'y opposer ; mais Caton,
au dire de Dion, n'a jamais eu l'art de persuader.
César, importuné de cette voix austère qui trouble seule l'universel silence,
fait arracher Caton de la tribune, et Caton, pendant qu'on l'entraîne en
prison, parle encore contre la loi. Bon nombre de sénateurs, épousant son
injure, le suivent d'un air consterné. Pourquoi
sors-tu avant la fin de la séance, dit César à l'un d'eux ? — Parce que j'aime mieux être avec Caton dans la geôle
qu'avec toi au sénat ! Ainsi tonte voix n'est pas muette encore, toute
liberté n'est pas éteinte dans les âmes ! César, embarrassé de son
prisonnier, finit par le relâcher, et Caton se remet à déclamer contre la
loi. Désespérant de triompher de l'opposition du sénat, César,
au mépris de toute légalité, traduit l'affaire devant le peuple, Crassus et
Pompée, démasquant enfin leur alliance avec lui, viennent hautement
l'appuyer. La loi passe, à grand renfort des soldats de Pompée. Bibulus,
collègue de César au consulat, est livré par lui aux outrages de la populace
: souillé d'ordures, tramé tout sanglant sur les degrés du temple de Castor,
il oppose à toutes ces infamies une inébranlable constance : Si je ne puis apprendre à César, s'écrie-t-il, à devenir homme de bien, au moins ma mort appellera sur
lui la vengeance de Dieu et la haine des humains ! Deux fois Caton
veut élever la voix pour en appeler au peuple, et deux fois les satellites de
César le prennent par le corps, et l'emportent hors de la place. Bibulus,
sauvé à grand'peine par ses amis, passe enfermé chez lui les huit mois qui
restent de son consulat, et de fait, César est seul consul. Telles sont les
voies sanglantes par où il mène Rome à la servitude, en créant lui-même l'anarchie
dont il prétend la sauver ! César triomphe enfin, les lois se taisent, et Rome est à ses genoux. On ne prononce plus le nom de son collègue, on date l'année du double consulat de Caïus et de Julius César. Il a dompté le sénat par la peur, acheté le peuple par sa loi agraire, les chevaliers par la remise d'un tiers du fermage de l'Asie ; Crassus et Pompée, ses rivaux, se sont mis à son service. Et cependant, tel est le soulèvement causé par ses violences que, lorsqu'il entre au théâtre, le peuple et les chevaliers lui refusent les applaudissements sur lesquels il a compté. Les sénateurs désertent la curie, où il faut flatter ou se taire, et où ne siègent plus que les partisans du futur dictateur. César s'en plaint un jour à Caussidius, un vieux sénateur : On s'absente, répond celui-ci, parce qu'on a peur de tes soldats. — Mais alors, pourquoi es-tu venu ? — Mon âge m'empêche de craindre ; le peu de vie qui me reste ne vaut pas qu'on en prenne tant de soin ! Maître de la situation, César fait d'abord ratifier les actes du généralat de Pompée. Il partage entre ses amis les plus riches gouvernements, et prend pour lui l'Illyrie et les deux Gaules, Cisalpine et Transalpine, avec trois légions pour cinq ans. Ainsi, sans sortir de la légalité, il se ménage aux portes de Rome une armée, une place d'armes, et un point d'appui pour marcher à l'Empire, quand il en sera temps. Mais pour réaliser ses projets, il lui faut de l'argent : il vend sa protection au roi d'Egypte au prix de six mille talents (trente millions). Il puise en outre à pleines mains dans le trésor public. S'il est avide, ce n'est pas comme Crassus, pour thésauriser ; non, c'est pour enrichir tous ceux qui l'approchent, et, à défaut d'affection, les enchaîner par l'intérêt. Il fait désigner comme consuls pour l'année suivante Pison, son beau-père, accusé de concussion, et qui n'échappe que par son crédit à une accusation infamante, e t Gabinius, créature de Pompée. Quant à Cicéron, son rôle politique a cessé après l'affaire de Catilina ; aux yeux du parti démocratique, exaspéré par sa défaite, il n'est plus qu'un accusé attendant son arrêt ; aux yeux des patriciens, Cicéron ne sera jamais qu'un parvenu, un homme nouveau, auquel ils n'ont pas pardonné encore de les avoir sauvés. Dans le débat sur la loi agraire, tout ce qu'il à accordé aux instances de César, c'est le silence et une abstention qui n'était pas sans courage. Retiré dans une de ses nombreuses villas, peut-être à celle d'Antium, où il allait, nous dit-il, dans ses longues rêveries, compter les vagues, sur le bord de la mer, il s'y console en répandant dans ses lettres à Atticus toutes les douleurs de son âme de citoyen. C'est alors qu'il écrivit, avec le parti pris de ne rien taire et de ne rien ménager, une Histoire secrète du Triumvirat qui, destinée à la postérité, s'est perdue avant d'arriver à son adresse. Les lettres même de Cicéron, ces inimitables lettres, où l'homme revit tout entier avec son époque, ne suffisent pas à nous consoler de cette perte irréparable. Ce qui n'empêche pas leur auteur, par une de ces désolantes contradictions que renferme le cœur humain, de désirer une place d'augure, alors vacante, et de confesser tout bas à Atticus, — Voyez ma faiblesse ! dit-il en rougissant, — que c'est là le seul côté vulnérable par où ces triumvirs si détestés pourraient le gagner. Et cependant, par un étrange retour des choses d'ici-bas,
ces mêmes triumvirs, tout puissants qu'ils soient, ne peuvent pas se faire
accepter par l'opinion publique. Les bras sont
enchaînés, dit Cicéron, mais les langues restent
libres. Bibulus couvre les murs de mordants placards, et la foule qui
les lit est si compacte que la rue en est obstruée. Des sifflets, des huées
vengeresses accueillent à leur passage les triumvirs, sans en excepter César
lui-même. Au théâtre, toute allusion hostile est saisie avec un empressement
qui touche à l'insulte. Mais, c'est encore
Cicéron qui parle, tout le monde murmure, et tout le
monde obéit. On gémit, on déclame tout haut contre le mal, mais personne n'y
remédie. Sans doute, résister amènerait un affreux massacre ; mais à quoi
peut nous mener notre facilité à tout céder, si non à tout perdre ? L'année du consulat de César touchait à sa fin. Pompée, s'éveillant un peu tard au sentiment de son danger, commence à avoir peur de son jeune beau-père, et de cette ambition patiente, infatigable, qui marche à son but, le front levé, par toutes les voies et tous les moyens. Il lui tarde de voir son rival hors de Rome, où il se flatte de régner en son absence, et César s'y résigne avec une docilité qui nous étonne. Ce profond calculateur, sentant, à la sourde résistance qu'il rencontre, que Rome n'est pas mûre encore pour la tyrannie, trouve son compte à s'éloigner pour se rendre nécessaire, pour agir de loin sur l'imagination des hommes, et laisser ses rivaux s'user en soli absence ; puis à revenir, avec le double prestige de l'éloignement et de la victoire. Il ne lui en coûte pas de céder la première place à Pompée, qui est homme à la garder vacante sans la prendre pour lui. Mais avant de quitter Rome, César veut être sûr d'y régner, absent comme présent. Pour cela, il est deux hommes qu'il faut en faire sortir à tout prix, Cicéron et Caton ; le premier, moins haï, mais plus importun peut-être, parce qu'il se refuse à toutes les avances, et que, ramené à Rome, du fond de sa retraite, par cette fièvre de l'inaction qui est la maladie des hommes d'Etat retirés, il harcèle le triumvirat d'une guerre d'épigrammes qui ne laisse pas que de le fatiguer. Mais César, lié comme Catilina avec tous les scélérats de Rome, avec les fils de famille endettés, ruinés, décriés, avait à lâcher sur Cicéron et sur Caton un admirable limier : c'était ce même Clodius, qui l'avait déshonoré, et dont il allait faire son bras droit, son lieutenant civil, comme d'Antoine son lieutenant militaire. La campagne de Clodius mériterait d'être étudiée en détail ; mais l'espace nous manque, et nous le regrettons. Qu'il suffise de savoir que Cicéron, après s'être traîné en vain aux genoux de Pompée qui ne daigna pas le relever, après avoir pris le deuil comme un suppliant, deuil que le sénat tout entier voulut partager avec lui, fut exilé à 600 milles de Rome, sous peine de mort s'il rompait son ban, pour avoir fait mourir des citoyens romains sans forme de procès. Ses biens furent confisqués comme ceux d'un ennemi public, et Clodius se chargea d'exécuter la sentence en faisant jeter bas sa maison de Rome et sa villa de Tusculum pour s'en approprier les dépouilles. La lie du peuple romain sanctionna ce décret infâme qui mentait aux souvenirs de Rome, sauvée naguères par celui qu'elle chassait de son sein. Cicéron alla traîner en Grèce son exil, qu'il supporta avec un abattement et une impatience peu dignes d'un citoyen qui s'immole à son pays. Quant à Caton, que l'on pouvait éloigner, mais non pas condamner, on le déporta, par un exil honorable, dans l'île de Chypre, avec mission de la réduire en province romaine ; et Clodius se vanta de lui avoir arraché cette langue importune, toujours prête à s'élever contre toute violation des lois. Une fois la ville purgée de Cicéron et de Caton, César, qui, depuis plusieurs mois, campait à ses portes avec une armée, pouvait s'en éloigner sans crainte ; il la laissait à Clodius. Il part donc, mais non sans avoir vu commencer dans Rome la réaction vengeresse qui doit y ramener Cicéron, et faire périr Clodius sous ce réveil de la conscience publique, que César, avec toutes ses violences, ne peut pas étouffer. |