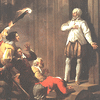LES ORIGINES POLITIQUES DES GUERRES DE RELIGION
LIVRE IV. — LA RÉCONCILIATION DES DYNASTIES CATHOLIQUES
CHAPITRE PREMIER. — LA DISGRÂCE DES GUISES. - L'ABANDON DES CONQUÊTES ITALIENNES. - LE TRAITÉ DU CATEAU-CAMBRÉSIS.
|
L'histoire diplomatique de la France n'offre guère de spectacle plus attristant que celui de la cour de Henri II pendant les six mois que durèrent les négociations de Cercamp et du Cateau-Cambrésis. Jusqu'aujourd'hui, les auteurs ont dressé seulement le diaire officiel de cette période, décrivant les gestes publics des protagonistes sans pénétrer au delà du décor politique. On voudrait suivre ici le mouvement moins connu des factions, pour montrer, parmi ces querelles étranges, le signe déjà menaçant des guerres civiles. Les Guises sentaient leur échapper de plus en plus chaque jour l'esprit du Roi. Avec une inquiétude fiévreuse, ils surveillaient les démarches de Montmorency, censuraient ses messages, arrêtaient ses courriers. Aussi bien, jamais, au temps de sa liberté, le vieux ministre n'avait montré plus d'initiative politique, plus d'audace entreprenante que dans sa prison : pendant tout le règne il avait été le frein du gouvernement, maintenant il prenait figure d'impatient, tandis que les Lorrains empêchaient le Roi de, glisser vers de nouvelles destinées. Le secrétaire Claude de L'Aubespine, envoyé par Henri II sur la demande de Montmorency et de Saint-André[1], était arrivé à Lille le 23 septembre : il s'entretint une semaine avec les deux prisonniers et Ruy Gomez de Silva, puis il repartit emportant l'adhésion de Philippe II au projet de nommer des plénipotentiaires officiels. Charles et François de Lorraine, au camp d'Amiens, attendaient son retour, craignant l'effet sur leur maître des dépêches du Connétable. Quand ils surent la venue de L'Aubespine, ils envoyèrent le Roi jouer à la paume, reçurent le secrétaire, prirent connaissance de ce qu'il apportait et le transmirent à leur façon[2]. Peut-être le cardinal de Lorraine dut-il à ce petit
procédé sa charge de plénipotentiaire. Le 1er octobre, Henri II dépêchait à
Doullens l'abbé de Bassefontaine, Sébastien de L'Aubespine, frère de Claude,
pour communiquer aux Espagnols les noms des délégués qu'il se proposait de
choisir et fixer le lieu des conférences, ainsi que les pouvoirs à donner aux
plénipotentiaires. Bassefontaine déclara que son maitre, dans le cas où
Philippe II désignerait Emmanuel-Philibert comme l'un de ses représentants,
adjoindrait aux deux prisonniers qui avaient mené jusqu'alors les
négociations, non seulement le cardinal de Lorraine, mais encore le duc de
Guise. Cette menace, que le Roi fit sans doute innocemment, parut une mesure
de défiance à l'égard de Montmorency, prisonnier du duc de Savoie et enclin à
favoriser ce dernier. Les Espagnols, peu désireux de se rencontrer avec le
duc de Guise, écartèrent aussitôt le nom d'Emmanuel-Philibert de la liste des
plénipotentiaires[3].
Leur homme, c'était le Connétable : Il est facile,
écrivaient-ils, de congnoistre son humeur en ses
négociations, car ses motz, sa contenance, sa couleur le descouvrent
incontinant. Quant aux aultres, de la maison
de Guise, ils reçoivent si granz prouffitz des conquestes et si grandes
entremises par la guerre qu'ilz ne seront faciles à convertir à la paix et
restitution[4]. Les deux Rois désignèrent, le 6 octobre 1558, leurs plénipotentiaires. Les noms sont bien connus : pour la France, le connétable de Montmorency, le cardinal de Lorraine, le maréchal de Saint-André, Jean de Morvillier et Claude de L'Aubespine ; pour l'Espagne, le célèbre évêque d'Arras Granvelle, le duc d'Albe, le prince d'Orange, Ruy Gomez de Silva et le président Viglius van Zwichem. Du côté français, Morvillier et L'Aubespine n'eurent d'autre influence que celle de secrétaires ou conseillers techniques ; les orateurs actifs furent Montmorency, Lorraine et Saint-André. Les deux premiers, qui se détestaient personnellement, représentaient, en outre, des politiques tout opposées. Le troisième, soucieux seulement de ménager ses propres intérêts et sa fortune à venir, persista dans l'attitude qui lui était familière : serviteur du Connétable d'apparence, en réalité valet des Guises. On sait que le siège des conférences fut fixé, le 8 octobre, à l'abbaye de Cercamp, en terre française[5]. En attendant l'ouverture des négociations officielles, les factions accentuèrent leur rivalité à la cour de France. Les efforts et les ruses des Lorrains ne pouvaient arrêter l'affection de Henri II qui se tournait de plus en plus vers le Connétable absent. Depuis longtemps, celui-ci savait qu'il lui suffirait de revoir son maître pour être définitivement vainqueur. Il sollicitait des Espagnols un congé qui lui permît d'aller trouver le Roi au camp d'Amiens. Si je pouvais parler au roi de France, déclarait-il le 24 septembre à Ruy Gomez, je mettrais cette affaire de la paix en bon chemin. Le Très-Chrétien lui-même, par Bassefontaine, appuya la demande auprès de Philippe II. Les ennemis n'avaient aucune raison de s'opposer à une entrevue favorable à leurs desseins. On signa, le 7 octobre, une trêve de quelques jours entre les deux armées, valable pour le territoire compris entre Doullens, Cercamp, Auxy et Amiens, une lieue de côté et d'autre du chemin royal. Et Montmorency reçut aussitôt l'autorisation d'aller visiter son maître. Les Espagnols souffraient alors gravement du manque d'argent. Il ne restait pas même, dans les coffres de Philippe II, de quoi payer aux troupes un mois de solde : J'ignore comment nous ferons pour l'avenir, notait le duc de Savoie. Ils entourèrent donc le Connétable, à son départ, de prévenances flatteuses, sachant bien qu'auprès de Henri II, il serait le grand, le seul avocat de la paix. Selon l'usage, le prisonnier voulait remettre des otages : Vous êtes trop homme de bien, répondit Emmanuel-Philibert, pour que nous acceptions des otages de vous. Montmorency s'en alla sur parole, joyeux et promettant de faire des merveilles. Arrivé à Béthune le 7, il passa par Hesdin le lendemain, dîna le 9 à Auxy-le-Château avec le comte d'Egmont ; le 10, à Doullens, il rencontrait les cardinaux de Lorraine et de Châtillon[6]. Henri II était au camp d'Amiens. Le 10 au matin, il reçut un mot de Montmorency lui annonçant sa visite. Si grande que fût sa joie, le Roi n'en dit rien à personne jusqu'au soir : par pudeur sans doute de montrer ses sentiments au duc de Guise. Très tard dans l'après-midi, il déclara qu'il voulait monter à cheval pour courir les lièvres, et négligemment il ajouta, sans préciser, que peut-être il rencontrerait le Connétable. Guise, de mauvaise humeur, observa qu'il était bien tard pour sortir. Henri ne répondit pas et partit, précédé à quelque distance du duc de Nevers, d'Alphonse d'Este et d'Antoine de Bourbon. Le rendez-vous était exact. A une grande lieue des tranchées, on vit arriver un cavalier : c'était Montmorency. La captivité avait démoli ce robuste baron de l'isle de France. Il montrait maintenant l'air d'un petit vieux, le visage enflé, la mâchoire tombante, le crâne couvert d'un bonnet sous la toque, l'œil terne, l'allure hésitante[7]. Il salua Nevers, Alphonse d'Este, le roi de Navarre, puis il s'avança vers son maître. Henri II se découvrit : le chapeau à la main, il embrassa le vieillard, et tous deux, plusieurs minutes, restèrent enlacés dans un geste de suprême affection. Dégagé, le Roi passa son bras sur l'épaule du Connétable, et ils s'en allèrent ainsi visiter les tranchées. Une fois la nuit tombée, Montmorency, fatigué de son voyage et affaibli par le long repos de la prison, voulait se retirer : Henri l'emmena coucher dans sa chambre[8]. Tout le monde comprit l'éloquence de cet accueil : le Connétable, en touchant son maître, son disciple, avait recouvré, comme on disait alors, le sommet de la faveur. Les courtisans, prenant le vent, sentirent approcher la chute des Guises et la paix. L'illustre prisonnier resta deux jours et deux nuits au
camp d'Amiens : Henri II ne le laissa ni le jour ni la nuit. Que se
communiquèrent ces hommes dans une si longue intimité ? Nous connaissons le
principal de leur dialogue : ce fut un réquisitoire contre les Guises. Après
s'être justifié par des explications plus ou moins spécieuses, qui
contentèrent facilement le Roi, touchant le désastre de Saint-Quentin,
Montmorency lit pour son maître un parallèle saisissant de la politique des
Lorrains et de la sienne propre. Votre Majesté,
dit-il, peut bien voir aujourd'hui qui de nous avait
raison, les Guises qui prônaient la guerre ou moi qui vous conseillais de
persévérer dans la trêve de Vaucelles et de vivre en paix : Votre Majesté a
dépensé et ruiné un monde, pour ne rien obtenir. Mais le parallèle ne
resta pas toujours aussi général. Le Connétable prétendit opposer son propre
désintéressement à la cupidité de ses rivaux : Je ne
demande rien à Votre Majesté, comme elle a pu le constater, et n'ai jamais
rien demandé ni pour moi ni pour les miens, tandis que ces autres l'entendent
différemment : ils n'ont jamais cessé de solliciter des biens, des bénéfices,
des dignités cardinalices, tous les honneurs de terre et de mer, ils aspirent
à des destinées encore plus hautes, à des royaumes et choses semblables et,
pour cela, ils ont conseillé à Votre Majesté la guerre. Le Roi écouta,
approuva les griefs de son compère et y
ajouta contre les Lorrains ses propres doléances. Trait étrange et qu'on
hésiterait à noter s'il n'était fourni par des témoins sûrs ; en tout cas,
admirable illustration d'un caractère : ce prince timide, courbé pendant un
an, à contrecœur, sous l'autorité de ministres déplaisants, avait attendu,
pour s'en plaindre, l'occasion d'un entretien secret avec son vieux maître retrouvé[9]. Secret, à vrai dire, cet entretien ne le fut guère. Des
écouteurs diligents rapportèrent au duc de Guise ce que Henri II et
Montmorency avaient dit contre sa famille. François sentait, depuis
longtemps, s'éloigner de lui et des siens l'âme du Roi, mais il n'avait pas
prévu un tel détachement : soldat au cœur primesautier et un peu candide, il
en fut accablé. Alvarotti, confident intime et ancien des Lorrains, notait : Le duc a pensé mourir de chagrin ; son visage a montré une
douleur si expressive que chacun l'a remarqué. Guise déclara à ses
commensaux qu'il s'en irait chez lui pour chasser[10]. Dans toute
l'Europe, la nouvelle de cette révolution intime circula avec une rapidité
étonnante. Dès les premiers jours de novembre, on se moquait, à Rome, de la pauvre gent de Guise, pleine d'ambition, qui avait été
en grand péril de sa vie pour la rencontre du Connétable avec Sa Majesté
Très-Chrétienne[11]. La conférence des plénipotentiaires devait se réunir à Cercamp le 13 octobre. Le 12 après dîner, Montmorency partit du camp d'Amiens ; Henri II l'accompagna jusqu'à la limite des tranchées avec une escorte de deux mille cavaliers[12]. Le vieillard emportait vraiment plein pouvoir, toute la confiance de son maître. Les Espagnols, informés de ce qui s'était passé, le félicitèrent avec effusion. Quant au roi de France, cette nouvelle séparation après une rencontre si longtemps désirée le laissa tout attristé. Il fit porter au Connétable ce billet autographe, qu'on dirait d'une amoureuse : Mon amy, sete lestre fera l'ofyse que je n'è peu fayre quant je vous è dyst adyeu, pour avoyr le ceur sy seré qu'y m'estoyt imposyble de vous ryens dire. Je vous prye de croyre que vous estes la persoune de se monde que j'ème le plus, et pour sela, je ne vous saroys ryens oferyr, car, puysque mon ceur est à vous, je croy que vous pansés byen que je n'épergnerè mes byens ny se quy sera an ma puysanse pour avoyr set heur que de vous ravoyr, que je suplye à Dyeu et à Nostre Dame que se puyse estre sy tost que je puyse estre hors de la poyne an quoy je suys vous ayant perdu de veue[13]. La première session des conférences de Cercamp s'acheva le 30 octobre. Le principal sujet des disputes, pendant deux semaines, avait été la question de Savoie : boulet que les diplomaties rivales traînaient depuis 1536. De juridique, ce problème était devenu psychologique : changement qui devait avoir des conséquences décisives. Pour suivre le rôle de Montmorency et le cours presque fatal des négociations sur ce sujet, il faut connaître l'attitude d'Emmanuel-Philibert vis-à-vis des Espagnols. L'illustre vainqueur de Saint-Quentin n'était guère aimé à la cour de Bruxelles. Les ruses défiantes de Philippe II et les jalousies de ses ministres ne plaisaient pas au fils du malheureux Charles de Savoie : habitué à la fermeté séduisante et courtoise de l'Empereur disparu, Emmanuel-Philibert subissait avec impatience les nouvelles manières du Catholique. Mais, au fond de ce dissentiment, il y avait un désaccord plus général et plus grave, dont les suites pouvaient ruiner, un jour ou l'autre, les intérêts du duc. Aussi bien que de modes, la cour d'Espagne avait changé de conscience, et, pour le nouveau maître, la question de Savoie devenait une charge ennuyeuse. Après l'invasion par François Ier du duché, Charles-Quint, homme de longue vue, suivant les principes inflexibles de sa politique, avait assumé vis-à-vis de soi-même l'obligation de ne pas désarmer avant que cet attentat ne fût effacé. Jusqu'à l'heure de son abdication, l'Empereur, résistant à son intérêt immédiat, s'était obstiné dans la volonté d'obtenir justice pour l'allié malheureux : avec une énergie vraiment grandiose, il avait maintenu l'honneur de sa protection. En 1558, Philippe II trouvait trop lourd cet héritage moral, il éprouvait durement les inconvénients de la guerre et, pour obtenir la paix, il eût sacrifié la cause de Savoie : ses ministres avouaient dans l'intimité qu'ils étaient las, excédés d'une trop longue et vaine revendication. Aussi, venus à Cercamp, traitèrent-ils le problème avec le seul souci des intérêts espagnols : peu leur importait que le duc de Savoie rentrât ou non dans tous ses biens, pourvu que les Français, abandonnant les clefs stratégiques de la région des Alpes et les portes de l'Italie, ne pussent à l'avenir menacer la Lombardie. Une fois retirés ses adversaires de la plaine du Pô, la maison d'Autriche dominerait en reine absolue la Péninsule par Naples et par Milan[14]. Le 18 octobre, les plénipotentiaires français écrivaient à Henri II : le roi d'Espagne a merveilleusement à cueur de veoir que vous n'eussiez plus riens delà les montz[15]. Emmanuel-Philibert, sachant toutes ces choses, était mécontent de ses patrons : on récompensait bien mal la victoire décisive qu'il avait donnée aux armées espagnoles, si faibles jusqu'à Saint-Quentin devant les généraux français. Il envoya aux conférences de Cercamp son conseiller, Gian Tomaso Langosco, comte de Stroppiana, Piémontais très fort, très tenace et très souple. Stroppiana emporta un mémoire où étaient exposées les revendications du duc sur tous les anciens Etats de la maison de Savoie, y compris Genève et le Montferrat. En lisant ce papier, Granvelle fit la moue : quant à Genève, il déclara qu'il n'y fallait pas songer ; on risquerait de se mettre en guerre avec les Suisses, lesquels sont frais et capables de la soutenir longtemps. La leçon infligée jadis à Charles le Téméraire faisait trembler encore les descendants de la maison de Bourgogne ! D'une manière générale, Granvelle avertit l'agent piémontais que si les deux rois désiraient la paix, c'était par lassitude, et qu'il convenait de ne pas les ennuyer avec des prétentions dangereuses[16]. De la situation fâcheuse, dans laquelle se trouvait Emmanuel-Philibert, les diplomates français pouvaient tirer grand avantage. Ce fut au contraire un piège où Montmorency tomba par sa naïveté et par ses rancunes contre les Guises. Peu à peu, en effet, le duc de Savoie et son représentant exercèrent sur le Connétable une véritable séduction : un jour, le vieux ministre pensera faire un coup de génie en attirant Emmanuel-Philibert dans son parti à la cour de France et, pour y réussir, il lui restituera les conquêtes alpines. Mais, quand s'ouvrirent les négociations officielles, cette tendance de Montmorency ne s'était pas encore décidée. Les plénipotentiaires français s'opposèrent unanimement à l'abandon du Piémont : pour les Guises, la possession de ce pays était indispensable à la poursuite de nouveaux desseins en Italie ; aux yeux du Connétable, les forteresses subalpines formaient le rempart de la France et la garantie de sa sécurité. Déjà cependant, les arguments de Montmorency apparaissaient fragiles : fondés sur des considérations de stratégie défensive, ils devaient s'écrouler le jour où Emmanuel-Philibert se montrerait disposé à devenir l'allié du Roi. Les plénipotentiaires français refirent donc, au début, la proposition que, depuis plus de dix ans, Henri II mettait en avant : mariage d'Emmanuel-Philibert avec la sœur du Roi, Marguerite de Berry, et compensation au duc pour les Etats de Piémont et de Savoie définitivement acquis à la couronne, compensation à prendre soit en France, soit en Italie. Dès le 9 octobre, Jacques de Savoie-Nemours, venu en visite chez son cousin, l'avait vivement engagé à accepter la sœur et le dédommagement. Emmanuel-Philibert agréait volontiers l'idée d'un mariage français, mais il désirait la fille aînée de Henri II, et point du tout Marguerite, plus âgée que lui de quatre ans et incapable, pensait-il, de lui donner un héritier. Justement l'espoir que la dynastie de Savoie s'éteignît faute de rejeton incitait la diplomatie royale et surtout les Guises à offrir la sœur : devenus vacants, les biens de la maison de Savoie tomberaient naturellement et légitimement au pouvoir des Valois[17]. Sur la fécondité douteuse de Marguerite, question qui avait préoccupé jadis Charles-Quint lui-même, les plénipotentiaires engagèrent avec gravité une querelle plaisante. Nous ne voulons point, dirent les Espagnols, entrer en dispute sur l'âge de la dite dame, que vous nous avez dit être de trente-cinq ans, pour être chose qui se prend mal de disputer de l'âge des dames ; et, combien qu'elle soit en âge auquel on pourrait encore espérer d'en avoir succession, pourtant serait l'espoir de ce encore beaucoup plus grand si elle n'avait que de seize jusques à vingt ans. A quoi les Français répondirent par cet argument savoureux : elle n'est nullement hors d'âge, n'excédant les trente-cinq ans et en montrant beaucoup moins, et étant descendue de race où les femmes ont porté jusque bien tard[18]. La question des territoires donna matière à une controverse plus élevée. Tandis que les Français affirmaient que la possession du Piémont était une garantie nécessaire à la sécurité du royaume, les Espagnols invoquaient déjà le principe des frontières naturelles. Les montagnes, déclaraient-ils, sont les vraies et assurées limites des pays. Doctrine singulière dans la bouche de gens qui représentaient la monarchie la plus bigarrée du monde. Montmorency, que n'impressionnait pas l'idéologie, répondit brutalement : Montagnes et rivières se passent[19]. De ce point de vue les deux thèses étaient irréductibles. Mais Granvelle, laissant vite le terrain géographique, transporta la discussion dans l'ordre des sentiments. Et sa finesse offrit à l'adversaire le piège où il devait fatalement tomber : Puisque, dit-il en substance, vous accordez assez d'amitié au duc de Savoie pour lui donner en mariage la sœur ou la fille du roi de France, vous devez également lui faire assez de crédit pour ne pas craindre qu'une fois remis en possession de ses biens, il ne livre à votre ennemi la frontière des Alpes. Merveilleuse suggestion, qui devait gagner peu à peu l'esprit du Connétable, le cœur du Roi et celui de Marguerite. La confiance à donner au duc de Savoie étant une affaire d'appréciation personnelle, il devait en résulter un dissentiment certain entre les plénipotentiaires de Henri II : Emmanuel-Philibert s'efforça dès lors, sûr par ce moyen de vaincre, d'augmenter la confiance des Français à son égard, et particulièrement celle de Montmorency, qui lui appartenait comme prisonnier. Mais tout cela n'était qu'en germe. Avec un peu de constance et de fermeté, les représentants de Henri II eussent pu tirer bon parti des circonstances favorables. Granvelle conseillait secrètement au roi d'Espagne, si ses intérêts étaient sauvegardés et si le duc de Savoie obtenait un minimum de réparation, de se montrer conciliant[20]. Plus favorable encore était la position de la diplomatie de Henri II sur le terrain des établissements français en Toscane. Philippe II et ses ministres, depuis quelque temps, détestaient Cosme de Médicis, bien que ce dernier fût un des anciens alliés de la maison d'Autriche : les agents les mieux informés assuraient alors que, pour déplaire au duc de Florence, les Espagnols n'eussent pas fait d'opposition sérieuse aux demandes françaises touchant cette région. Il est vrai que Philippe II avait cédé à Cosme, le 19 juillet 1557, ses droits de souveraineté sur l'État de Sienne et que t'eût été une grave offense que de les reprendre. Mais le Catholique, sans annuler sa donation, pouvait jouer un mauvais tour au duc en rétablissant la République toscane dans son ancienne liberté[21]. Les Français se souciaient bien peu de ces choses ; mal informés, ils étaient en outre mal intentionnés : l'on se pourra servir et aider de ce que nous tenons au Siennois, disait leur programme[22]. En réalité, désireux, s'il était possible, d'échanger les territoires de Montalcino contre un avantage quelconque, ils inclinaient à une résignation prématurée. Les Guises, éloignés par de vieilles rancunes de la cause des fuorusciti florentins et d'ailleurs interprètes des combinaisons du duc de Ferrare, n'éprouvaient que de l'aversion pour la Toscane. Quant à Montmorency, il voyait dans l'abandon de ces territoires lointains un bon moyen de réaliser des économies. Les plénipotentiaires n'étaient pas disposés à mieux défendre la Corse. Sur ce sujet, voici leur intention : Sera bon d'aviser quel service et quelle commodité on peut tirer de la Corse, et si l'importance en est plus grande que des deniers que l'on pourrait obtenir des Génois, considérant la grande dépense qu'il faut y faire chaque année[23]. Mais de ces dispositions secrètes et de ces faiblesses rien ne parut officiellement dans les conférences d'octobre. Les Français affirmèrent le maintien de leurs exigences anciennes touchant Calais, le Piémont, le Montferrat, Sienne Montalcino et la Corse. Ils écrivaient, le 21 octobre, à Henri II : Tant plus nous voyons cler en ceste négociation, tant plus jugeons-nous qu'il ne fault riens espérer de vostre ennemy que le pis qu'il pourra faire[24]. Fermeté de façade que minaient des dissentiments plus ou moins cachés et des tendances nettement opposées. En réalité, les plénipotentiaires du Très-Chrétien n'étaient résolus que sur deux questions : celle de Calais et celle du Piémont ; sur ces points la diplomatie française restait attachée aux prétentions qu'avait exprimées le cardinal de Lorraine dès les conférences de Péronne, en mai 1558. C'était le programme des Guises, que Henri II n'osait pas encore désavouer[25]. A cette belle contenance, les Espagnols répondirent par une attitude aussi fière ; mais, de fait, ils cherchèrent à éviter une rupture. La négociation de la paix, notait Emmanuel-Philibert, va fort froidement. Dieu mette fin à tant de maux ![26] La trêve, renouvelée le 17 octobre, fut prolongée sine die le 28. Le 30, on suspendit les conférences pour une semaine[27]. Au mois de novembre 1558, s'écroula subitement, devant l'Europe étonnée, tout l'édifice qu'avaient construit les Valois depuis soixante ans. Alors apparurent, dans une crise à la fois mesquine et grandiose, les inquiétudes qui ravageaient l'esprit de Henri II. Tout le monde savait combien Montmorency désirait la paix
pour recouvrer sa puissance à la cour[28]. Le Roi lui-même
ne pouvait plus supporter l'absence de son premier conseiller. Il faut relire
les billets qu'il lui adressait, pour comprendre les incidents publics : Mon ami, je vous assure que Monsieur de Guise ne désire la
paix, me remontrant tous les jours que j'ai plus de moyens de faire la guerre
que je n'eus jamais et que je n'en saurais tant perdre, en faisant la guerre,
que je n'en rends si vous venez d'accord. Faites ce que vous pourrez afin que
nous ayons la paix. Et ne montrez cette lettre que au maréchal de Saint-André
et la brûlez après. Le dit personnage [Guise] a dit ici à quelqu'un que, tant que la guerre durera, pas
un de vous deux ne sortirez jamais de prison, et pour ce pensez-y, comme
chose qui vous touche[29]. Après la suspension des conférences, les plénipotentiaires étaient partis de Cercamp. Le Connétable, le cardinal de Lorraine et le maréchal de Saint-André arrivèrent à la Cour le 2 novembre dans l'après-midi. Ils trouvèrent le Roi chez Diane de Poitiers. Henri II prit aussitôt Montmorency par la main, le mena saluer la Reine, puis se retira, pendant deux heures, seul avec lui. Ensuite, un long entretien eut lieu jusqu'au souper avec la favorite et Catherine de Médicis. Le Connétable mangea à la table et à côté de son maître. Celui-ci lui fit préparer un lit pour la nuit dans la garde-robe de sa propre chambre[30]. Nous allons voir à quoi aboutit cette intimité. Les négociations de Cercamp recommencèrent le 7 novembre. En partant, Montmorency avait promis la paix au Roi. Celui-ci, considérant l'affaire comme finie, montrait une joie puérile il parlait à tout venant des tournois, des jeux et des fûtes par lesquels il voulait réjouir les noces de sa sœur avec le duc de Savoie. Et les tailleurs en préparaient déjà les costumes[31]. Cette exubérance était très prématurée. Après une semaine de conférences, les plénipotentiaires se trouvèrent en opposition complète, sans pouvoir avancer. Informés par le menu des gestes et des paroles imprudentes du roi de France, les Espagnols reprirent toute leur insolence. Ils déclarèrent brutalement que Philippe II ne ferait rien, si les Français ne restituaient le Luxembourg à l'Espagne, Calais aux Anglais, toute la Savoie et tout le Piémont à Emmanuel-Philibert, tout le Montferrat au duc de Mantoue, la Corse aux Génois, et s'ils ne quittaient sans réserve la Toscane. Ils ajoutèrent qu'ils ne voulaient négocier que sur cette base et, comme les autres protestaient, ils menacèrent de rompre aussitôt[32]. Le 13 novembre au soir, la guerre était décidée. Le 14 au matin, L'Aubespine, évêque de Limoges, partit de Cercamp en toute hâte pour aller informer Henri II de cette catastrophe et lui demander des instructions. Le Roi fut accablé. Pourtant, son orgueil se révolta contre l'arrogance des Espagnols. Le 14 au soir, il renvoyait l'évêque de Limoges avec l'ordre de rupture[33]. Dans la nuit, arrivèrent deux lettres autographes de Montmorency, l'une adressée au souverain, l'autre à Diane de Poitiers. La favorite qui, pendant tant d'années, avait soutenu la fortune des Guises, s'était détachée d'eux pour des motifs d'intérêt, et le Connétable, profitant de cette brouille avec un art de l'intrigue où il excellait, avait conquis d'un coup son ancienne rivale en accordant le mariage de son fils, Henri de Montmorency-Damville, avec la petite-fille et héritière de Diane, Mademoiselle de Bouillon[34]. Dans cette lettre, il la suppliait de conseiller à son maître de prendre la paix comme elle s'offrait. Le tai novembre au matin, Henri II à peine levé partit pour la chasse. La cour, croyant la guerre inévitable, était en rumeur ; la faction des Guises triomphait. Rentré, le Roi s'enferma longtemps avec Diane de Poitiers. Quand il sortit, il donna l'ordre de réunir immédiatement le conseil des affaires. Il portait un air d'assurance et de domination qu'on ne lui avait jamais vu. Devant ses conseillers rassemblés, il prit aussitôt la parole : Après avoir mieux considéré ma situation, dit-il, j'ai résolu de faire la paix avec le roi Philippe par n'importe quel moyen : pour cela, je consens à restituer toutes mes conquêtes en Luxembourg, en Montferrat, en Corse, en Piémont — sauf trois, quatre ou cinq places —, et en Toscane. Je veux garder Calais. Il termina d'un ton impérieux : Je vous ai convoqués pour vous faire savoir ma volonté et non pour autre chose. Seul dans l'assemblée, Charles de Marillac commença de protester ; le Roi lui ordonna brutalement de se taire. Et tous restèrent silencieux, stupéfaits et résignés devant l'attitude du maître. Henri II dépêchait aussitôt un nouveau courrier, M. de Saint-Sulpice, à Cercamp pour démentir les instructions données à l'évêque de Limoges et informer les plénipotentiaires des dernières décisions[35]. C'est alors, semble-t-il, que fut porté au Connétable le fameux billet, écrit moitié par le Roi, moitié par Diane, qui offre une illustration audacieuse des rivalités secrètes de la cour[36]. L'extraordinaire séance du Conseil, après la première
stupeur, souleva des mouvements presque tragiques. Les Lorrains et Catherine
de Médicis, qui leur appartenait depuis le mariage du Dauphin, voulurent
reconquérir Henri II. La veille même, 14 novembre, Catherine et le duc de
Guise avaient fait jurer au souverain de ne jamais
rendre le Piémont. Montmorency et son abjecte alliée, la favorite,
obtenaient donc un parjure ! La Reine montra, comme jadis aux heures
sanglantes de la guerre de Sienne, l'énergie et la violence que cachait sa soumission
quotidienne. Elle se mit à genoux aux pieds du Roi pour l'ébranler encore : Le Connétable n'a jamais fait que du mal !
s'écria-t-elle. Il a toujours fait du bien,
répondit Henri II, et quant au mal, ceux-là l'ont
fait qui me conseillèrent de rompre la trêve de Vaucelles, et il la
laissa sans plus. Quelques heures après, Catherine, retirée dans sa chambre,
lisait les histoires de France. Diane vint
lui demander ce qu'elle lisait de beau. La
réponse fut roide : Je lis, dit textuellement
Catherine, les histoires de ce royaume, et j'y
trouve que de temps en temps, à toute époque, les putains ont dirigé les
affaires des rois. Et elle partit[37]. L'attitude de
la Reine commandait celle des Lorrains. Dans la journée, Henri II,
s'adressant au duc de Guise, lui demanda ce qu'il pensait de sa décision. François
répartit insolemment : Je me laisserais trancher la
tête plutôt que de dire qu'elle est honorable et avantageuse pour Votre
Majesté[38]. La nouvelle de ces scènes étranges ne s'ébruita que le 16 novembre à travers le royaume : elle produisit partout l'émotion d'un grand événement. Très tard dans la nuit, un ami, confident des affaires d'État, vint réveiller l'ambassadeur de Mantoue, qui était alors à Paris : Je suis accouru pour t'annoncer une bonne nouvelle : la paix est accordée et le Roi restitue à ton patron tous ses États[39]. De cette crise le parti des Guises sortit définitivement vaincu, dans une disgrâce morale. Tout autre roi eût renvoyé de la cour des conseillers qu'il ne pouvait plus supporter. Mais Henri II était incapable d'énergie dans les choses du cœur. Il n'osait ou ne voulait se séparer des amis de sa jeunesse. Vers le 20 novembre, à Saint-Germain, entre le Roi et François de Lorraine un dialogue émouvant précisa cette situation étrange. On disait parmi les courtisans que le souverain, au cours de sa dernière entrevue avec Montmorency, lui avait promis pour son fils en survivance la charge de Grand-Maître. Le duc de Guise se plaignit : Sire, dit-il, Votre Majesté peut avoir souvenir qu'au temps de son avènement, Elle me promit la charge de Grand-Maître de France. Henri II, gêné, murmura des paroles évasives. Alors, François déclara : Sire, puisque Votre Majesté me tient en si petite estime et considération et fait si peu compte de ma personne et des très grands services que je lui ai rendus, je quitte son service en tout et pour tout : avec sa permission, je me retirerai chez moi, lui promettant et jurant de ne plus vêtir l'armure, de vivre seulement et de prier Dieu ! Abasourdi, le Roi répondit : Vous avez tort, je vous aime[40]. A Cercamp, tout était changé. Jusqu'au 13 novembre, on n'avait pu trouver un moyen de discussion touchant les conquêtes italiennes[41]. Mais après l'arrivée de Saint-Sulpice, qui apportait les nouvelles résolutions de Henri II, les Français devinrent si conciliants que leurs adversaires crurent à une manœuvre. A partir du 17, les Espagnols eurent cause gagnée sur le principe des restitutions, sur la Toscane, la Corse, le Luxembourg et les Etats de Savoie. Il ne restait plus à régler que les détails et la procédure de ces restitutions et à fixer le nombre des places que le Très-Chrétien voulait garder en Piémont. Une seule question demeurait entière, celle de Calais, — conquête personnelle du Roi. Saint-Sulpice répéta aux plénipotentiaires ce que son maître avait dit déjà maintes fois : Je perdrai ma couronne plutôt que de rendre Calais[42]. Au cardinal de Lorraine, démonté par la révolution du 15 novembre, la résistance de Henri II sur Calais permit de reprendre pied : le 23, il faillit obtenir ce qu'il cherchait, la rupture des conférences[43]. A vrai dire, bien que le Très-Chrétien eût abandonné la thèse soutenue pendant quinze ans par la diplomatie royale et accepté le principe des Espagnols, la question de Savoie offrait encore riche matière à disputes. Quels seraient le nombre et la situation des places laissées aux Français en Piémont ? Pourvu que la Lombardie fût à l'abri de toute menace, Philippe II et ses conseillers inclinaient à céder sur ce terrain. Dès lors les Espagnols ramenèrent leurs efforts vers la question de Calais, qui, seule, retarda de plusieurs mois la conclusion de la paix. Il appartenait donc à Emmanuel-Philibert de défendre lui-même ses intérêts et d'arracher aux Français une restitution à peu près complète des États de Savoie. Entre le duc et Montmorency, — le vainqueur et le vaincu de Saint-Quentin, — unis d'ailleurs par des liens de famille, l'intimité devenait chaque jour plus étroite. Au camp espagnol, le 25 octobre, on avait vu arriver les fils du Connétable avec M. de Villars et plusieurs Français de distinction. Emmanuel-Philibert les fit dîner et les entretint longuement[44]. Une fois obtenu le principe de la restitution, le duc
s'efforça d'échapper au mariage qu'on lui offrait et de gagner quelques
places sur celles que le Roi voulait retenir. A vrai dire, il n'était pas
facile d'écarter Marguerite : la princesse, informée que son futur époux ne
montrait point un grand goût pour elle, s'en offensait, et l'on fit comprendre
au récalcitrant qu'il devait se résigner à payer de sa personne la générosité
du Très-Chrétien[45]. En vain
essaya-t-il de mettre sur le tapis un projet de mariage avec Élisabeth
d'Angleterre[46].
La question des places n'était pas moins ennuyeuse. Henri II résistait très
fortement aux demandes d'Emmanuel-Philibert. Sur la cause de cette
résistance, les historiens se sont trompés : on a cru que le Roi voulait
garder ainsi le moyen de rouvrir les guerres d'Italie. Un tel espoir guidait,
en effet, la conduite du cardinal de Lorraine. Mais le souverain lui-même
obéissait à des motifs tout autres, à des motifs d'honneur. Le Piémont
offrait depuis le règne de François Ier les caractères d'un patrimoine et
d'une province française, il avait été annexé et naturalisé
légalement, il avait perdu ainsi la forme toujours provisoire d'une conquête
non juridique : sa restitution impliquait donc, sans nul doute possible, un
démembrement du royaume. C'était pour éviter de quelque manière une telle
honte et ne pas encourir le mépris de son peuple, comme aussi bien les
remontrances des corps conservateurs de l'État, que Henri II voulait
absolument retenir des places fortes en Piémont. Montmorency, après la
reculade du 16 novembre, fit aux représentants d'Emmanuel-Philibert une
déclaration très nette à ce sujet : Le roy de France
entend de ne rien retenir à Vostre Alteze, mais Sa Majesté veldt que le monde
cognoysse que le roy d'Espagne ne l'a peu contraindre à se despouiller
entièrement des conquestes du feu roy François son père, et, par conclusion,
le roy de France ne veult pas infamer son histoire[47]. Sur ce terrain, la division des plénipotentiaires français était certaine. Puisqu'on ne retenait des forteresses que pour sauver l'honneur, peu importait leur situation et leur nombre : ainsi pensait le Connétable. Au contraire, le cardinal de Lorraine soutint jusqu'à la fin qu'il fallait garder les forteresses les plus efficaces. Montmorency lui-même était un peu gêné par la crainte de l'opinion publique : Si j'étais complètement libre, faisait-il entendre au duc de Savoie, je plaiderais bien mieux la cause de Votre Altesse, car, en France, il y a beaucoup de bons capitaines, mais peu d'hommes pacifiques comme moi. Et il avouait, avec cette grosse ingénuité qui se mêlait souvent à sa sournoiserie : J'ai toujours procuré et maintenu la paix autant qu'il m'a été possible, j'ai toujours détesté la guerre par égard au bien public et par souci de mon intérêt particulier, car, de la guerre, je ne peux attendre rien, et j'y ai beaucoup de pairs, tandis que, en temps de paix, je suis le seul vice-roi. Prisonnier d'Emmanuel-Philibert, il redoutait les calomnies que ses ennemis ne manqueraient pas de répandre à ce sujet : Par jalousie, disait-il encore, on remontre au peuple et au loi que je travaille non pour le service de mon maître et du royaume, mais en vue de mon intérêt personnel, pour obtenir ma libération de captivité[48]. Bien sûr, Montmorency n'eût pas soumis de plein gré les affaires du royaume à sa commodité privée. N'empêche qu'ayant pris le rôle d'ami secret d'Emmanuel-Philibert, il devait fatalement tomber en des fautes plus graves. D'abord, en déclarant que, s'il était libre, il défendrait mieux les intérêts du duc, il offrait à celui-ci, consciemment ou non, un véritable marché. Le prince n'était ni assez riche ni assez naïf pour libérer son prisonnier gratuitement, mais il comprit aussitôt quel parti il pouvait tirer des négociations touchant la rançon du Connétable, et nous allons voir qu'il ne tarda pas à lui proposer sans vergogne un contrat déshonorant. D'ailleurs, il devait en résulter une conséquence plus générale, à laquelle déjà nous avons fait allusion : à force de traiter secrètement' avec Emmanuel-Philibert, à l'insu des Guises et contre eux, Montmorency crut que le duc prenait place dans sa faction et qu'il deviendrait, une fois la paix signée, son plus fort allié à la cour de France. Marie Tudor était morte le 17 novembre, laissant le trône d'Angleterre à sa jeune sœur Elisabeth : la nouvelle parvint à Cercamp le 30, et les Français proposèrent, à cette occasion, de suspendre les conférences pour deux mois. Les Espagnols, qui avaient plus gagné, pendant ce mois de novembre, que durant trente ans de guerre, y consentirent de bonne grâce et se révélèrent enfin comme des gens aimables. Le cardinal de Lorraine, parti de Cercamp en compagnie des secrétaires L'Aubespine et Morvillier, arriva le fi décembre à Paris[49]. Montmorency ne put s'en aller si tôt, mais dut rester encore deux semaines en Flandre pour négocier le prix de sa rançon. Ce retard fit gémir Henri II : Je ne veus plus vyvre, sy à se coup vous fallés à venir[50]. Bien que revêtu de sa qualité de plénipotentiaire, le Connétable, comme le maréchal de Saint-André, était toujours prisonnier de guerre. Avant de suspendre les conférences, on avait discuté pour savoir si les deux hommes pourraient passer ces vacances en France. Montmorency, qui s'était constamment montré amateur de la paix et repos public, obtint facilement congé, sur parole, pour aller voir son maître[51]. Philippe II prévoyait bien, et il l'avouait cyniquement, que le retour du vieillard provoquerait, à la cour de son rival, des divisions favorables aux intérêts espagnols[52]. Mais le Connétable ne put jouir tout de suite de cette permission : les Espagnols, en effet, avaient décidé que leurs prisonniers, avant de partir, fixeraient soit avec le roi catholique, soit avec le duc de Savoie, le prix exact de leur rançon, pour recueillir, une fois arrivés en France, les sommes nécessaires. Montmorency retourna donc à Lille, après la suspension, et entreprit des négociations fort délicates. Depuis le début des conférences, le désaccord entre Emmanuel-Philibert et la cour de Bruxelles s'était aggravé. Le duc accusait de mauvaise foi les ministres de Philippe II et n'échangeait avec eux que des politesses froides. Enervé et inquiet, il doutait même qu'on pût arriver à la paix. En conséquence, il avait résolu de mettre ses affaires hors des mains des Espagnols et de traiter directement avec le roi de France. Que la paix se fit ou ne se fit pas, il voulait recouvrer ses États. Pour cela, il allait tenter une manœuvre audacieuse. Dès le 30 novembre, il avait envoyé son secrétaire Fabri au Connétable pour lui communiquer le désir que j'ay de vous contenter en toutes choses à moy possibles[53]. Puis, le 9 décembre, il remit à Stroppiana des instructions décisives. L'agent piémontais proposa donc à l'illustre prisonnier le marché suivant : Si le Connétable fait en sorte que le duc de Savoie recouvre son État entier et libre de toute servitude, ledit duc s'engage à lui quitter toute sa rançon ; de plus, il promet au Roi Très-Chrétien d'être comme le bouclier de son royaume et de se déclarer l'ennemi de quiconque essaierait de l'attaquer du côté des Alpes. Ainsi Sa Majesté obtiendrait les mêmes avantages que si elle occupait le Piémont, sans devoir supporter les frais et les inconvénients de cette occupation. Offre audacieuse, mais singulièrement habile : outre le piège proposé à la conscience de Montmorency, il y avait là de quoi ruiner toutes les objections d'ordre militaire qui s'opposaient à l'abandon des forteresses. Bien plus, Stroppiana informa le prisonnier que si le roi de France retenait trois places fortes, la rançon serait de trois cent mille écus, s'il n'en gardait que deux, la rançon s'abaisserait à deux cent mille écus, enfin qu'une seule place coûterait cent mille écus : afin que Sa Majesté connaisse que ce qu'elle fera en faveur du duc tournera au profit du Connétable[54]. Montmorency, certes, n'accepta point un tel contrat. Sans parler de scrupules, il était assez avisé pour prévoir ce qu'en pourraient tirer contre lui ses ennemis et pour craindre la révolte de l'opinion publique. Mais il ne s'indigna nullement. Le 10 décembre, il écrivait à Emmanuel-Philibert : Je vous mercye très humblement de l'honneste lettre qu'il vous a pieu m'escripre, vous suppliant croyre que, en tous lieux et endroictz où je vous pourray faire service, je m'y emploiray comme celluy qui désire demourer toute sa vye vostre serviteur. Il exposa seulement à Stroppiana les raisons politiques et personnelles qui le détournaient de s'engager sur une voie aussi périlleuse[55]. L'agent piémontais prétendit alors fixer la rançon à trois cent mille écus. Finalement, après trois jours de discussion, on s'arrêtait à deux cent mille écus : mais Montmorency prit l'engagement moral de favoriser autant que possible les revendications d'Emmanuel-Philibert. Le 14 décembre, l'affaire était réglée, et, deux jours après, le 16, le prisonnier libéré partit pour la France[56]. En arrivant à la cour, le cardinal de Lorraine avait
trouvé le Roi fort mal disposé à l'écouter. Irrité par les scènes qui
s'étaient produites pendant les dernières semaines de novembre, Henri [I
fuyait la Reine et le duc de Guise. Il voulait obstinément la paix et
supportait avec peine la résistance insolente du parti belliqueux. Son refuge
était chez Diane de Poitiers. A l'influence de la favorite il faut en ajouter
une autre, très efficace, celle de Marguerite de Berry, dont on avait négocié
le mariage à Cercamp. Marguerite, déjà mûre et protectrice vénérée des
poètes, était lasse de n'aimer que les lettres. Elle désirait vivement se
marier : les diplomates lui parlaient depuis si longtemps
d'Emmanuel-Philibert qu'elle s'était éprise à la fin de ce grand capitaine
qui passait pour ardent cavalier. Et maintenant elle trouvait les diplomates
trop lents. La princesse manqua un peu de discrétion dans ses sentiments. Dès
les premiers jours d'octobre, tout au début des conférences, elle avait
envoyé son portrait, par l'entremise de Nemours, au duc de Savoie. Celui-ci
s'efforçait alors d'éviter un 'mariage qu'on lui offrait comme une embûche,
et il demandait qu'au lieu de la sœur, on lui donnât la fille de Henri II.
Très gêné, il remercia du portrait par une lettre courageuse : Monsieur mon cousin, j'ay
reçeu la pinture de Madame la sœur du Roy, qui m'a esté si agréable qu'elle a
augmenté le désir que dès longtemps j'ay conçeu en ma pensée, dont sur ce ne
vous diray aultre fors que s'il plaît à Dieu me donner ce bonheur et au Roy
me faire tant d'honneur que je espouse Madame, m'en acquitteray de sorte que
tous trois en recevront service[57]. Il est plaisant
de lire dans le journal d'Emmanuel-Philibert, à la même date : M. de Nemours a tendu à me persuader d'accepter la sœur :
j'ay été inflexible là-dessus[58]. A vrai dire, le
duc de Savoie comprit bien vite ce qu'il pouvait obtenir de l'amour de
Marguerite. Dans la même lettre à Nemours, il écrivait astucieusement : Je veulx bien vous prier, sy en mes afères y s'y offre
quelque difficulté, vouloir supplier Madame m'y prester son ayde et faveur,
dont je me tiens desjà tout assuré, tant pour les bontéz et vertuz qui sont
en elle comme pour l'assurance qu'elle peult prendre que, sy Dieu me rend si
heureux de l'espouser, elle aura sur ma fortune et mon bien toute l'autorité
que luy plaira prendre[59]. Nous verrons
que la princesse exauça largement la prière de son futur époux. C'est ainsi
qu'aux intérêts et aux passions si nombreuses, qui troublaient les
négociations, Marguerite ajouta une influence sentimentale, que le Roi son frère
inclinait naturellement à suivre. Le cardinal de Lorraine, informé par François des incidents récents, comprit, après avoir vu Henri II, qu'il était inutile de résister plus longtemps à la volonté du maître. Il passa les quelques jours qui lui restaient, en attendant l'arrivée de Montmorency, à régler les affaires d'État dont il avait encore la charge et à se munir en prévision du contrôle sévère que ne manquerait pas d'exercer son rival[60]. Avant de céder la place, il voulut, ce semble, regagner un peu de popularité : jamais on ne l'avait vu si bienveillant, si facile, il accordait toutes les demandes et prodiguait sa courtoisie[61]. Cependant, le Connétable cheminait sur les routes de Picardie. Les bourgs et les villages l'accueillaient comme la personne du Roi, et le petit peuple lui faisait fête : les uns le flattaient sachant qu'il allait reprendre le pouvoir, les autres le remerciaient pour son œuvre de paix[62]. Beaucoup de gentilshommes s'étaient empressés de courir à sa rencontre. Le 21 décembre, vers 2 heures de l'après-midi, il descendit de cheval à Saint-Germain-en-Laye : il parut avoir recouvré, un peu de son ancienne vigueur, bien que l'arquebusade reçue à Saint-Quentin le fît toujours souffrir et le forçât à demander la main pour descendre de monture[63]. Henri II jouait à la paume dans le parc du château, et la Reine le regardait s'amuser. De loin, Montmorency fit la révérence à son maître, qui se précipita pour l'embrasser trois fois de suite, avec une extraordinaire tendresse. Ils se retirèrent aussitôt, seuls, et restèrent enfermés un temps très long. Ensuite, le Connétable alla changer de costume. Il était à peine entré dans son appartement que se présenta un gentilhomme de la maison de Guise, qui lui remit le cachet royal : le cardinal de Lorraine, sans attendre l'ordre du souverain, rendait à son ri val l'instrument et le signe de la toute-puissance ministérielle[64]. A partir de ce jour, le Connétable expédia, seul, les affaires d'État. Les Guises refusèrent d'y prendre la moindre part et se retirèrent même du Conseil. Au Roi, qui lui demandait des explications sur cette attitude, le cardinal répondit qu'il ne voulait pas passer pour le valet de Montmorency[65]. Par un mouvement naturel, la foule des courtisans, abandonnant ceux qu'elle avait adulés si longtemps, se pressa autour du vieillard. On avait compté plus de mille gentilshommes dans la troupe qui était allée à sa rencontre, jusqu'à six lieues de Saint-Germain[66]. Tous les officiers ou fonctionnaires s'efforçaient d'oublier l'amour qu'ils avaient montré à la maison de Lorraine. Il y eut des gestes comiques. Le banquier Albisse del Bene, administrateur à la fois et fournisseur des finances royales en Italie, désireux de gagner l'appui du duc de Guise pour ses opérations de trésorerie, au cours de l'année 1558, avait chargé un artiste de ciseler un grand bassin d'argent avec l'histoire de la prise de Calais, qu'il comptait offrir à l'illustre général. Après le retour de Montmorency, Albisse décommanda l'œuvre. L'intérêt est plus fort que l'amour, écrivait un confident des Lorrains[67]. Mais, plus que de comédie, c'était de tragédie qu'il s'agissait. Sous une résignation apparente, les Guises mâchaient leur haine, concentrée et meurtrière. Dans les corridors du château de Saint-Germain, on entendait des injures féroces et le bruit de rixes mystérieuses. Alvarotti notait : Seule la crainte du Roi empêche que les poignards et les épées ne se teignent de sang[68]. Aussi bien le Connétable faisait tout pour exaspérer la rage de ses adversaires : c'était la rançon de l'affaire d'Andelot. Lui et Diane de Poitiers affichaient une amitié insolente : le lendemain de son arrivée, Montmorency avait scellé le contrat de mariage de son fils Damville avec Mademoiselle de Bouillon[69] ; revenu de Piémont le 18 janvier, le jeune homme épousa, le 29, l'héritière de la favorite[70]. L'intimité du maître et de la gouvernante devint un scandale : Ils sont comme chair et ongles, pour ne pas dire cul et brayette[71]. Chaque soir ils dînaient ensemble, avec des caresses infinies. Tous deux alliés menaient le Roi à la baguette[72]. Dans l'administration, Montmorency bouleversait ce qu'avait établi le cardinal de Lorraine. Connaissant mieux que personne le mécanisme de l'Etat, il put d'abord tromper l'opinion publique par des tours de force en matière de finances : il trouva le moyen de distribuer une solde aux troupes qui n'en avaient pas reçu depuis quatre ou cinq quartiers et de payer des intérêts aux marchands, lesquels n'osaient plus rien espérer. Il prit ainsi figure de sauveur[73]. Mais, à vrai dire, le Connétable s'occupa surtout de lui-même et de sa famille. Il obtint du Roi cent mille écus pour payer sa rançon, à tirer des ventes d'offices et des parties casuelles du domaine, puis cent mille francs, qui furent donnés à François de Montmorency avec la survivance de la charge de Grand-Maître. Quant à Damville, il reçut la survivance du gouvernement de Languedoc et la promesse du bâton de maréchal. Tout cela dans l'espace de quelques jours[74]. Par un acte de véritable provocation à l'égard des Lorrains, le premier conseiller fit nommer son neveu d'Andelot lieutenant au gouvernement de Picardie, en l'absence de Coligny, et lui ordonna de réformer toutes les mesures qu'avait prises le duc de Guise, pendant la campagne de l'année précédente, pour l'organisation de l'armée du Nord[75]. La plupart des faveurs, pensions et dons, accordés par le cardinal, furent révoqués. Montmorency, le plus brutal des hommes, renouvelait contre ses rivaux les procédés par quoi jadis il avait écrasé les anciens ministres de François Ier. Mais, cette fois, les victimes étaient capables de répondre. Tandis que le cardinal de Lorraine s'indignait avec éclat, le duc de Guise, meurtri dans son orgueil de soldat, rongeait le frein : Il est à moitié enragé, écrit Alvarotti. Les spectateurs redoutaient une scène sanglante. Au Roi, les Guises faisaient savoir qu'ils ne mendieraient point la gratitude d'un maître qui leur devait des services si nombreux et si grands[76]. Par bonheur, les ennemis du Connétable trouvaient des compensations pour l'avenir. La grossièreté du vieux ministre ne tarda pas à produire ses effets ordinaires : les Guises, dont le gouvernement avait paru jadis arbitraire, devinrent de nouveau sympathiques. Leur parti, fort réduit à la fin de décembre, grossit bien vite au mois de janvier. Ils avaient des alliés sérieux et francs : Catherine de Médicis, le dauphin François, Marie Stuart, le prince Alphonse de Ferrare, le duc Charles de Lorraine, le duc de Nemours. Moins déclarés, mais foncièrement hostiles à Montmorency, étaient Longueville, La Rochefoucauld, Montpesat, Vieilleville. D'autres, comme Saint-André, venaient dire aux Lorrains : Je suis avec vous, mais ne gâtez pas mes affaires ! Le Connétable tirait toute sa force de l'amitié de Henri II et de celle de Diane. Quant aux Bourbons, — le roi de Navarre et ses frères, — ils détestaient assurément le cardinal de Lorraine, mais ce n'était pas une famille de héros ni de Machiavels. Le duc de Nevers suivait sans trop se vanter la fortune du premier conseiller. A vrai dire, le grand parti de Montmorency était dans le peuple et dans la bourgeoisie, classes qui désiraient la paix. Naturellement aussi, tous les robins et fonctionnaires flattaient, comme de coutume, l'ordonnateur des finances publiques[77]. A ce moment même, un événement important, le mariage du jeune duc Charles III de Lorraine avec la seconde fille de Henri II, donna aux Guises un regain de prestige. Disgraciés à moitié, ils purent cependant mépriser leur rival, leur ennemi, petit baron de l'Ile de France, qui se glorifiait d'avoir obtenu pour ses fils la bâtarde du Roi et une héritière de la favorite. La branche aînée de la maison de Lorraine était alors un peu grêle, avec le duc mineur qu'on élevait à la cour de France, depuis 1552, et sa mère, la douairière régente Christine de Danemark. A l'adolescent, Henri II avait promis, dès longtemps, sa fille Claude. Montmorency voyait venir, sans plaisir, ce mariage qui allierait une troisième fois, dans la même génération, les Guises à la famille royale[78]. Mais il n'y avait pas moyen pour lui de s'y opposer, à moins de trahir criminellement les intérêts de la France. En effet, la politique de ce règne, justement sous l'influence du Connétable, avait poussé des ambitions très résolues et très fructueuses du côté de l'Est. L'occupation des Trois Evêchés, en 1552, avait été le pas décisif de cette marche vers la frontière du Rhin où aspiraient unanimement les forces dirigeantes du royaume. Pour assurer la durée et le succès d'une telle politique, il était nécessaire que la maison ducale de Lorraine passât par des liens nouveaux et intimes sous la protection du roi de France. Or, Christine de Danemark, nièce de Charles-Quint, intelligente et adroite, inclinait très nettement vers l'Espagne et s'efforçait d'écarter le danger qu'elle sentait du côté de l'Ouest. Son fils, Charles, emmené par Henri II après la campagne de 1552, recueillait à la cour d'affectueuses caresses, mais ceci n'empêchait point qu'au vrai, il ne fût un otage. Le Roi et Montmorency savaient fort bien que s'ils lâchaient l'enfant, sa mère lui ferait contracter mariage à la cour de Philippe II et qu'ainsi la maison d'Autriche établirait pour longtemps sa tutelle sur la Lorraine indépendante. Même, les craintes d'enlèvement étaient telles qu'on ne permit pas à Charles III, jusqu'à la fin de l'année 1558, de voir sa mère ailleurs qu'en terre française[79]. Il pressait donc d'enchaîner le prince définitivement par un mariage. Une autre raison empêchait Montmorency d'y faire opposition : c'est que Christine de Danemark était son amie personnelle et, en outre, la grande ouvrière du rapprochement entre la France et l'Espagne ; grâce à elle, les adversaires avaient pu s'entretenir avec une relative courtoisie ; son tact intelligent, sa finesse et sa douceur rusée faisaient d'elle la reine des négociations. Enfin, toute la cour désirait ce mariage, autant par affection que par politique : Henri II aimait tendrement, comme un fils, le duc de Lorraine, et Catherine de Médicis adorait sa fille Claude[80]. Les fiançailles furent accordées le 19 janvier 1559, à Paris. Un carrousel et un tournoi occupèrent les journées du 20 et du 21. Le 22, on célébra le mariage à Notre-Dame, avec la pompe habituelle. Montmorency, au cours des cérémonies, remplit diligemment ses fonctions de Grand-Maître[81]. Henri II et la Reine partirent le 25 janvier, pour visiter, pendant quelques jours, les domaines du Connétable, Ecouen et Chantilly. Le dimanche suivant, à Chantilly, le souverain assistait aux noces de Montmorency-Damville avec la petite-fille de Diane, Mademoiselle de Bouillon. Puis, le Connétable et, le maréchal de Saint-André firent leurs préparatifs pour se rendre au Cateau-Cambrésis, où avait été transféré le siège des conférences. Le cardinal de Lorraine partit, seul, en poste. Le Roi revint passer les fêtes du Carnaval à Paris[82]. Henri II n'avait pas même essayé de réconcilier Montmorency et les Guises, avant les négociations définitives. Les rivaux, à la fin de janvier 1559, continuaient de s'injurier plus ou moins ouvertement. Toujours soutenu par son maître et par Diane, le Connétable administrait les affaires selon son plaisir, mais il avait perdu un peu de sa brutale assurance. L'intimité du Dauphin, de Marie Stuart et de Catherine avec ses adversaires, sans compter le mariage de Claude de France, lui inspirait quelque prudence. Aussi bien, très audacieux dans le Conseil ou dans les bureaux, cassant, réformant et ordonnant, le terrible vieillard n'était pas également brave en plein air et dans les salles du château ; il fuyait les Guises par une sorte de crainte physique : Il a peur que nous lui parlions de Saint-Quentin ! disaient avec mépris ses victimes[83]. François de Lorraine, beaucoup plus sensible que son frère le cardinal, souffrait profondément de cette disgrâce. La douleur ruina son énergie, et, à la fin de février, il tombait malade, ressaisi par les fièvres qu'il avait prises en Italie. Il s'alita, déprimé, mélancolique à tel point qu'il ne voulait pas se laisser soigner par les médecins. Presque toutes les personnes de la cour le visitèrent, mais Diane et Montmorency lui refusèrent cette politesse. Henri II lui-même ne se rendit à son chevet qu'en se cachant du Connétable[84]. Le 6 février, les plénipotentiaires de la paix s'étaient réunis au Cateau-Cambrésis, dans une maison sise hors de l'enceinte et appelée la maison des plaisirs[85]. Montmorency était parti, le 2, de Chantilly[86]. Cette fois, tout le monde attendait la conclusion comme certaine. Le roi de France avait ordonné de solennelles processions pour hâter l'achèvement d'une œuvre où il avait mis toute sa générosité[87]. Une personne se réjouissait infiniment du bonheur à venir,
c'était la sœur du Roi, Marguerite, qui défendait maintenant les intérêts du
duc de Savoie, son futur époux. Par l'entremise du Rhingrave, prisonnier en
congé, elle fit exprimer à Emmanuel-Philibert, dès le début de février, ses très humbles recommandations, l'assurant que en tout lieu où elle pourroit faire office de bonne
parente et amie, elle n'y mancqueroit de meilleur cœur. Et
l'intermédiaire ajoutait cette déclaration beaucoup plus grave : Comme très humble et très affectionné et obligé serviteur
de Vostre Altesse, je ne veulx lesser à vous dire qu'elle a supplié le Roy,
s'i trouve bon la partie de Vostre Altesse et d'elle, qu'il veuille à sa
faveur accorder les choses sans retenir ny réserver aulcun scrupule[88]. Le même
Rhingrave alléchait le sieur du Bouchet, conseiller intime
d'Emmanuel-Philibert, par des renseignements indiscrets : Je pense, si vostre seigneur permectoit que les choses
commencées sortissent en érect, que Monseigneur le duc seroit le plus aimé,
estimé et heureux prince de ce monde. Sy je n'estois pressé, je vous en
diroys davantaige... Cela se faisait secrètement, et non sans quelque
honte : Je supplie, ajoutait le Rhingrave, que de ce propos Vostre Altesse ne me veuille alléguer :
il me nuyroit. Et encore : Sur tout le bien
que vous me voullés, que cela ne passe plus oultre : on lui sçauroit maul
vais gré et à moy[89]. Des suivantes
de Marguerite prenaient part à ces intrigues. La cour d'Espagne et, bientôt
après, toutes les petites cours d'Europe furent informées des conversations
de Marguerite ; on sut même qu'elle écrivait directement au duc de Savoie
pour faciliter ses pourparlers avec Montmorency[90]. Cependant, au Cateau-Cambrésis, les plénipotentiaires abordaient la discussion décisive. Il s'agissait de fixer précisément les limites et les moyens des restitutions, dont le principe avait été accordé dès le mois de novembre précédent ; il fallait surtout régler la question de Calais. Au sujet de la Corse, on s'entendit facilement : les Français abandonneraient l'île aux Gênois sans condition, bien qu'ils eussent d'abord demandé une indemnité[91]. Pour Montalcino et la Toscane française, au contraire, le problème s'était fort compliqué depuis le mois de novembre. Non que Henri II voulût revenir sur ses concessions : mais quel serait le sort des républiques de Sienne et de Montalcino après le départ des Français ? Les intéressés demandaient qu'on les remît en liberté pure et simple. Philippe II, d'autre part, revendiquait ces territoires pour en disposer à son gré. Au mois de novembre 1558, les plénipotentiaires n'avaient examiné que ces deux solutions. En février 1559, il s'en présentait bien d'autres. D'abord, les Carafa et Paul IV lui-même avaient instamment prié l'ambassadeur de France à Rome, Babou de la Bourdaisière, pour que le Roi cédât au Saint-Siège la Toscane française. Cette demande, soutenue par le cardinal de Tournon[92] ne fut pas écoutée. De sa part, Montmorency ne portait aucun intérêt à cette question et s'efforçait seulement d'éviter toute difficulté qui pût retarder l'accord. Quant au cardinal de Lorraine, il dut défendre la demande que présentait alors le duc de Ferrare. Celui-ci, — déjà nous y avons fait allusion, — suppliait Henri II, par l'entremise de son fils Alphonse, qui résidait à la cour, et d'autres agents, de lui céder les terres de Toscane en remboursement des sommes que le Trésor devait depuis longtemps à la maison d'Este[93]. Les Guises appuyaient naturellement cette combinaison. On ne pouvait, sans doute, vendre ouvertement un peuple qui s'était mis de confiance sous la protection du roi de France, mais la diplomatie se fût chargée de trouver des moyens élégants et moraux : donner, par exemple, au duc de Ferrare, la tutelle des Siennois et obtenir secrètement de lui renonciation à ses créances[94]. On crut, un moment, que ce marché serait accepté des Espagnols, et il est vrai qu'à l'automne 1558, il n'y eussent pas fait grande opposition. Mais, quand les conférences s'ouvrirent, en février 1559, au Cateau-Cambrésis, les sentiments de Philippe II étaient bien changés. Cosme de Médicis, informé du risque qu'il courait par la malveillance du Conseil espagnol, de perdre toute chance d'annexer jamais à ses Etats le territoire entier de la Toscane méridionale, qu'il convoitait si fort, avait dépêché à Bruxelles un homme de grande valeur, assez connu dans l'histoire du XVIe siècle, le Florentin Chiapino Vitelli. Celui-ci rejoignit Philippe II au mois de janvier 1559 : sous prétexte d'apporter au Catholique des condoléances pour la mort de Charles-Quint, il venait obtenir à tout prix, même à prix d'argent, la donation définitive au duc de Florence des républiques de Sienne et de Montalcino. Et, une fois de plus, le Médicis obtint de Philippe II ce qu'il voulait[95]. Aux conférences, la résistance du cardinal de Lorraine fut assez vive. Les Siennois de Montalcino, très inquiets, avaient envoyé des ambassadeurs à la cour de France, et l'un d'entre eux se rendit même au Cateau-Cambrésis pour surveiller les négociations. Mais finalement, mal soutenu par le Roi et par Montmorency, Lorraine céda. Les plénipotentiaires rédigèrent alors un article dont le sens était d'une obscurité voulue, afin de ne pas déchaîner les crieries des Siennois : A été conclu que le Roi Très-Chrétien retirera tous les gens de guerre qu'il a dans la ville de Montalcino et autres places du Siennois et de la Toscane, et se désistera de tous droits qu'il peut prétendre ès dites villes et pays. Est aussi convenu que tous gentilshommes siennois et autres sujets dudit Etat, qui se détermineront à se soumettre au Magistrat établi au gouvernement de la République de Sienne, y seront reçus, et leur sera pardonné tout ce que l'on pourrait prétendre à l'encontre d'eux pour s'être retirés au dit Montalcino et ailleurs[96]. Cet article cachait une vraie tromperie de la part des ministres français. Pris à la lettre, le texte laissait entendre que la république de Sienne, après le départ des troupes royales, resterait indépendante et libre sous son propre gouvernement, à condition de recevoir tous les fuorusciti qui, chassés par les événements de 1555, s'étaient retirés soit à Montalcino, soit même hors de la Toscane. Ainsi le comprirent les ambassadeurs de Montalcino : ils annoncèrent partout que Sienne serait libérée par le traité aussi bien de la domination florentine que du joug étranger[97]. Jusqu'à la conclusion officielle de l'accord et plus tard même, Henri II et ses ministres, craignant les doléances très légitimes des Siennois, laissèrent vivre, sans la démentir, cette interprétation. Or, elle était absolument erronée. Les plénipotentiaires avaient établi, sans le spécifier en forme, que les Français remettraient les territoires qu'ils occupaient en Toscane à Philippe II, lequel en disposerait à son gré ; et, à la cour d'Espagne, les gens avertis savaient que le Catholique, séduit par les discours de Chiapino Vitelli, donnerait à Cosme de Médicis la république de Montalcino pour l'unir, comme la république de Sienne, au duché de Florence[98]. Ce procédé fâcheux ne doit guère étonner : on sait que Montmorency ne portait aucun intérêt aux affaires lointaines de Toscane ; quant au cardinal de Lorraine, une fois écartées les propositions du duc de Ferrare qu'il avait soutenues en vain, peu lui importait le sort des malheureux Siennois. Nous verrons cependant qu'au dernier moment, le cardinal rouvrit la discussion sur ce sujet avec une vivacité soudaine, mais on peut croire qu'il y chercha seulement une occasion de faire échouer la paix. Les autres fuorusciti d'Italie furent plus mal traités encore que les Siennois. Philippe II exigea que les bannis du royaume de Naples et du duché de Milan, et implicitement les bannis florentins, qui avaient épousé le parti de la France, fussent privés du bénéfice de la paix. Les plénipotentiaires du Très-Chrétien n'y firent pas d'opposition sérieuse, sauf une dernière révolte du cardinal de Lorraine à la fin des négociations. C'était livrer les exilés aux pires représailles de leurs ennemis. Hélas ! Piero Strozzi, tué l'année précédente au siège de Thionville, ne protégeait plus son parti. Pourtant, les fuorusciti florentins voulurent, par une manœuvre audacieuse, parer ce coup terrible. Vers le 15 mars 1559, arrivait à Bruxelles un ancien confident de Strozzi, Masino del Bene. Au nom des fuorusciti de Lyon, représentant en cette occasion toute la Florence exilée et toutes les colonies de l'Europe, il proposa à Philippe II un marché incroyable. Après lui avoir rappelé que Charles-Quint, son père, s'était jadis engagé à restaurer la liberté florentine contre les Médicis, il prétendit lui prouver que Cosme, enclin à trahir l'Espagne, avait tenté plusieurs fois de se rapprocher de la France : en conséquence, del Bene offrit au Catholique, s'il voulait rétablir la République à Florence, une somme de deux millions d'écus d'or avec la cession des villes de Livourne et de Pise ; pour indemniser Cosme, les marchands fuorusciti lui achèteraient, dans le royaume de Naples, des châteaux et des terres avec un revenu de cinquante à cent mille écus. Del Bene obtint deux audiences de Philippe II, qui ne trouva point la proposition désagréable. L'orateur florentin vit également Ruy Gomez de Silva et le duc d'Albe : il essaya même de les corrompre par l'offre de riches pensions[99]. Cette démarche hardie, six mois plus tôt, eût peut-être réussi. Mais, au printemps de 1559, le duc de Florence avait reconquis les ministres espagnols. Les fuorusciti se retirèrent, abandonnés de tous. Le traité du Cateau-Cambrésis scella l'échec définitif des bannis qui, depuis plus d'un siècle, luttaient pour la liberté contre les Médicis : la république de Florence était morte. Le roi de France y va de si bon courage qu'il stupéfie tout le monde, écrivait Hercule d'Este à Cosme de Médicis[100]. La restitution des Etats de Savoie fut vite réglée entre Emmanuel-Philibert et les Français. Il n'y eut de difficultés que celles que souleva Philippe II lui-même, peu disposé à rendre les places du Piémont que ses troupes occupaient. Enfin il fut accordé que Henri II restituerait au vainqueur de Saint-Quentin : le duché de Savoie, les pays de Bresse, Bugey, Valromey, Maurienne et Tarentaise, la vicairie de Barcelonnette, les seigneuries de Galtières, le comté de Nice et tout ce que le duc Charles II avait possédé au delà du Var ; outremonts, la principauté de Piémont, le comté d'Asti, le marquisat de Ceva et le comté de Cocconato. Tandis qu'il abandonnait toutes les terres qui, suivant le principe même soutenu par les Espagnols, rentraient dans les frontières naturelles de la France, le Roi gardait, en Piémont, les villes et places de Turin, Chieri, Pignerol, Chivasso et Villeneuve d'Asti, avec les finages, territoires, mandemens et juridictions, jusques à ce que les différends sur les droits par Sa Majesté prétendus contre ledit sieur de Savoie soient vidés et terminés, ce que lesdits sieurs s'obligent de faire dedans trois ans pour le plus tard[101]. A vrai dire, c'était là du formalisme diplomatique : les cinq villes, isolées très loin du royaume, ne pouvaient jouir que d'une vie anormale et ralentie, jusqu'au jour où fatalement, par des nécessités économiques et militaires, elles reprendraient leur place naturelle dans l'unité du Piémont ; aussi bien, Emmanuel-Philibert était assuré de faire reconnaître ses droits juridiques, comme le prévoyait le traité, avant trois ans ; pour finir, le duc savait que Montmorency et Marguerite de France soutiendraient vivement ses revendications. Cette clause, on l'a vu, s'explique par le désir de sauver l'honneur du Roi et par la crainte d'infamer son histoire. En fait, le cardinal de Lorraine, par des efforts acharnés, avait obtenu le choix de ces cinq villes, fenêtres sur le Milanais. Emmanuel-Philibert laissa paraître sa joie. Après tant d'années d'exil et de misère, il allait rentrer dans sa maison[102]. Bientôt arrivèrent à la cour de Henri II des Piémontais, Albertino de Moretta, le sieur de Montafia, le sieur de Racconigi et d'autres gentilshommes, qui supplièrent le Roi de ne pas restituer leur pays : il était trop tard, et la démarche, en tout cas, n'eût pas abouti[103]. Le 18 mars, entraient au Cateau-Cambrésis Michel de L'Hospital, chancelier de Marguerite de Berry, et Robert Hurault, sr de Belesbet, conseiller au Grand-Conseil et maître des requêtes. Ces deux juristes venaient établir le contrat de mariage[104]. Le sieur de Savoie aura à femme Madame Marguerite, à laquelle Sa Majesté Très Chrétienne laissera la jouissance, sa vie durant, du duché de Berry et autres terres et revenus dont elle jouit à présent. Et davantage lui baillera en dot, pour tous ses droits paternels, maternels et autres qui lui peuvent appartenir, auxquels, moyennant ce, elle renoncera, la somme de trois cents mille écus. Tel est l'article qui donna la sœur de Henri II au vainqueur de Saint-Quentin[105]. Enfin, comme il avait été convenu dès le mois de novembre, les plénipotentiaires décidèrent que le marquisat de Montferrat et la ville de Casal seraient restitués entièrement au duc de Mantoue. Restait à résoudre la question de Calais. On connaît l'article qui fut adopté, après deux mois de disputes : le roi de France resterait possesseur de cette conquête pendant huit ans, au terme desquels il devrait ou la rendre à l'Angleterre ou payer une somme de cinq cent mille écus au gouvernement d'Elisabeth. Victoire de fait, dont une lourde servitude ruinait la valeur juridique : au fond, la controverse n'était que suspendue par une sorte de trêve. Les représentants de Henri II eussent pu gagner une partie plus nette, en profilant des circonstances. Par la mort de Marie Tudor, Philippe II avait perdu ensemble son épouse et le titre de roi d'Angleterre ; les intérêts anglais et les intérêts espagnols se trouvaient maintenant déliés. Le Catholique s'affligeait fort de cet événement, non point qu'il regrettât la reine, pour laquelle il n'avait guère dépensé de sentiments conjugaux, mais parce que l'Angleterre échappait à son influence et même risquait d'échoir un jour ou l'autre, par Marie Stuart, à la dynastie des Valois. C'est pourquoi, veuf bientôt consolé, dès le début de décembre 1558, il avait entouré la jeune Elisabeth d'assiduités singulières, où l'ardeur se mêlait à la défiance. Par malheur, la nouvelle souveraine n'avait pas de goût ni ne se mettait en frais pour ce prétendant : elle inclinait d'autre côté ses sentiments et, fait beaucoup plus grave, menaçait de détruire le catholicisme en Angleterre. Désolé et inquiet, Philippe II s'efforça vainement de lui faire prendre un chemin plus sûr ; et même il la défendit auprès du Saint-Siège, pour empêcher qu'on ne l'excommuniât tout de suite. Mais enfin, quand fut perdu l'espoir d'un amendement, le roi d'Espagne, au mois de mars 1559, consentit à prendre pour épouse celle qu'on lui offrait, Elisabeth de Valois, fille aînée de Henri II, précédemment destinée à l'infant Don Carlos[106]. Un article du traité pourvut la princesse de quatre cent mille écus de dot[107]. L'attitude des plénipotentiaires espagnols touchant la question de Calais suivit étroitement celle de Philippe II à l'égard d'Elisabeth. Dès le début des conférences, Marie Tudor avait délégué quelques personnages à Cercamp pout soutenir ses revendications ; de même, au Cateau-Cambrésis, divers milords vinrent faire figure de représentants d'Elisabeth. Au vrai, si longtemps que Philippe espéra d'épouser la reine d'Angleterre, les intérêts de celle-ci furent défendus par les Espagnols. Mais, au mois de mars 1559, il y eut entre les alliés un refroidissement très marqué, dont auraient pu profiter les Français. Les ministres de Henri II ne connurent pas l'évolution des désirs et des sentiments du roi d'Espagne. Ils n'avaient d'yeux que pour se surveiller mutuellement. La discussion au sujet de Calais, en février, fut très violente. Dans ce combat, Montmorency et le cardinal de Lorraine ne s'accordaient point : sans doute ils savaient l'un et l'autre que le Roi ne consentirait jamais à restituer sa conquête personnelle, mais ils ne s'entendaient pas sur les compromis possibles. Au seul mot de rupture, le Connétable, qui n'avait pas encore payé toute sa rançon, tremblait de perdre de nouveau sa liberté et sa puissance. Le 23 février, il accourut à Villers-Cotterêts pour faire entendre au Roi beaucoup de choses et surtout pour lui proposer des combinaisons de formules[108]. Cependant, le cardinal déployait une éloquence que louèrent les Espagnols mêmes[109]. Au début de mars, il semblait qu'on dût désespérer. Les Français ne cachaient plus leur trouble, leur désaccord[110]. A l'approche du printemps, comme par habitude, les instincts belliqueux se réveillaient. Anglais et Espagnols examinaient s'ils pourraient porter une nouvelle guerre. Henri II lui-même, inquiet, cherchait de l'argent[111]. Enfin, vers le milieu du mois, les ministres de Philippe II lâchèrent brusquement les Anglais, et ceux-ci durent accepter l'article sur Calais que Montmorency, trop pressé, leur avait soumis quelques semaines auparavant[112]. La cour de France s'agitait, impatiente de ces longueurs et désireuse de nouer des relations avec la cour de Bruxelles. Des personnages officieux apportaient au Catholique des confidences dangereuses ou superflues. Après le mariage de sa fille Claude avec le duc de Lorraine, Henri II permit à celui-ci d'aller saluer le roi d'Espagne : le jeune prince rencontra Philippe II à Mons, vers le 25 février[113]. On convint alors qu'il se rendrait au Cateau, où se trouvait déjà sa mère, Christine de Danemark, et qu'il assisterait, comme prince neutre, à toutes les conférences. Naturellement l'adolescent subit l'influence de sa mère et, avec elle, adoucit la résistance du cardinal de Lorraine, leur parent[114]. Bientôt arrivait au Cateau une troupe de dames françaises. C'était la nouvelle duchesse de Lorraine, Claude de France, venue pour saluer sa belle-mère, et, en sa compagnie, la duchesse de Guise, Anne d'Este, avec un grand nombre de demoiselles. Ces personnes apportèrent chez les négociateurs une indiscrète frivolité : elles considéraient la paix comme faite et ne s'embarrassaient d'aucune réserve[115]. Philippe II, en cette occasion, ne manqua pas d'esprit : il lit remettre aux dames par un gentilhomme des joyaux et d'autres présents ; la duchesse de Guise fut tout particulièrement distinguée et reçut de ces cadeaux pour quinze mille écus. A la même duchesse Ruy Gomez de Sylva, l'un des plénipotentiaires, offrit des gants parfumés et un cheval d'Espagne. Quant aux demoiselles, chacune s'en alla munie d'un présent d'au moins cent écus. Cette troupe légère, revenue à la cour de France, y soutint copieusement la louange des Espagnols[116]. Il était difficile de parler de rupture. Henri II plus que jamais voulait la paix et suivait en aveugle docile la guide de Montmorency. Le cardinal de Châtillon, en l'absence de son oncle, gardait le souverain contre un retour offensif des Guises et essayait même de gagner Catherine de Médicis, principal soutien des Lorrains. C'est alors que le Roi, força son fils, le dauphin François, qui n'aimait pas le Connétable, à nommer celui-ci : Mon compère[117]. Vers le 15 mars, surgit entre les plénipotentiaires une conversation nouvelle, touchant le salut de la religion catholique et la répression de l'hérésie. Elle fut de l'initiative espagnole. Que le zèle de Philippe II pour la défense de l'Eglise se manifestât dans cette négociation, c'était autant par finesse que par vertu. Un an auparavant déjà aux conférences de Péronne, Granvelle avait troublé le cardinal de Lorraine en évoquant le spectre de l'hérésie pullulante. Contre le même adversaire, dont on connaissait bien les sentiments catholiques, la même manœuvre parut bonne, dans la bataille suprême. Les Espagnols prétendaient savoir qu'à Paris plus de deux mille personnes se réunissaient presque chaque jour en des cavernes pour entendre des prêches et célébrer le culte réformé ; ils ajoutaient que, dans tout le royaume, la religion était au pis ; ils prônaient l'union des princes catholiques contre la secte ; et naturellement ils concluaient que les Français devaient, autant que quiconque, désirer la paix, puisque chez eux le nombre des hérétiques était très grand[118]. L'inquiétude de Henri II s'accordait parfaitement avec ces révélations. La volonté d'arrêter le développement de l'hérésie restait, au-dessus des rivalités de factions, le grand motif du Roi dans l'œuvre de paix. Sur ce sujet, tous ses conseillers étaient du même avis. Montmorency, bien que ses neveux fussent parmi les chefs de la Réforme française, se montrait nettement hostile à la nouvelle religion, ennemie, disait-on[119], de toute monarchie et source de toute confusion. De Diane de Poitiers et de Saint-André on sait la haine contre les protestants. C'était, enfin, le seul argument qui pût vaincre, chez les Guises, l'amour inné et nécessaire de la guerre. La proposition espagnole, agréée par les Français, se réduisit, dans la forme officielle du traité, à un article religieux qu'on inscrivit en tête de l'acte : Les deux princes, mûs de même zèle et sincère volonté, ont accordé qu'ils procureront et s'emploieront de tout leur pouvoir à la convocation et célébration d'un saint concile universel, tant nécessaire à la réformation et réduction de toute l'Eglise chrétienne en une vraie union et concorde[120]. Cette clause paraît d'abord assez indirecte. Mais, dans un traité de paix, instrument juridique, il était difficile d'introduire, sous une forme de droit international, l'action commune des deux princes contre l'hérésie, parce que cette action appartenait surtout à la politique intérieure de chaque gouvernement. Le concile offrait la seule matière diplomatique où pût s'exercer officiellement la collaboration religieuse des deux souverains, Nous verrons qu'après la signature du traité, on examina plus précisément et, pour ainsi dire, plus brutalement, en des négociations particulières, les moyens à employer contre l'hérésie. D'ailleurs, cet accord sur la question du concile importait beaucoup à la cause de l'Eglise catholique. Depuis très longtemps, la polémique entre les protestants et le Saint-Siège portait sur l'autorité du concile de Trente, niée par les premiers, qui réclamaient la réunion d'une assemblée plus indépendante. Or, jusqu'à l'année 1559, le gouvernement français, favorisant plus ou moins consciemment sur ce point, comme sur tant d'autres, la thèse et les revendications des dissidents, s'était montré, par tradition gallicane, à peu près rebelle au concile. Par le traité du Cateau-Cambrésis, Henri II abandonna cette attitude et changea l'orientation de sa politique. Une étude, qui reste à faire, sur les dernières sessions du concile en 1563 et sur le rôle qu'y joua le cardinal de Lorraine, comme aussi bien sur les pourparlers relatifs à l'acceptation des décrets dans le royaume, montrerait quel parti le Saint-Siège et Philippe II tirèrent du traité de 1559. Après cette grave et dernière convention, il semblait que les pourparlers fussent terminés. Coligny, prisonnier, venait d'être libéré[121]. Brusquement, le 25 mars, veille de Pâques, tout se rompit. C'était un coup du cardinal de Lorraine, qui avait élevé des prétentions nouvelles, exigeant que Scipione Fieschi fût reçu et remis dans ses biens par la république de Gênes, que tous les fuorusciti pussent rentrer à Florence et recouvrer leur patrimoine confisqué, que Sienne fût laissée libre et non soumise à Philippe II, enfin que les Espagnols quittassent aussitôt les forteresses du Piémont qu'ils occupaient[122]. Il n'y avait pas là de quoi faire échouer la paix, mais les ennemis virent dans ce réveil une sorte de provocation, et, en tout cas, un manque de parole, puisqu'on retournait sur des choses précédemment accordées. L'alerte fut très grave. Déjà les plénipotentiaires faisaient leurs bagages pour s'en aller. Le tact et l'autorité de la duchesse de Lorraine, Christine de Danemark, obtinrent un sursis. Le cardinal, pourtant, voulait partir ; Montmorency, sentant que si son rival parlait au Roi, tout serait perdu, l'en empêcha. On dépêcha un courrier à Villers-Cotterêts pour demander des instructions. Les trois questions, ranimées par Lorraine, étaient celles qui troublaient le plus la conscience de Henri II : il s'agissait de son honneur. Ce fut l'occasion d'un suprême sacrifice. Le Roi, lui-même l'annonçait en ces termes au duc de Nevers : Mon intention, toutes choses bien pesées et considérées, à la fin a esté telle que je me laschasse en leur demande, [plutôt] que d'empescher que la Chrestienté ne reçoive le repos qui luy est si nécessaire pour infinies raisons[123]. Le 27 mars, lundi de Pâques, vers sept heures de l'après-midi, le traité fut enfin conclu par les plénipotentiaires. Il ne restait plus qu'à coucher les articles sur parchemin et à les signer[124]. Henri II se trouvait à Villers-Cotterêts. Il dormait avec la reine, dans la nuit du 28 au 29 mars ; une chambrière vint le réveiller pour lui annoncer qu'un courrier, arrivé à minuit et passé malgré les gardes, apportait, de la part du Connétable, la nouvelle de la paix[125]. Le traité fut signé le 3 avril. La veille, les plénipotentiaires avaient validé un acte spécial réglant l'accord entre la France et l'Angleterre. Quand tout fut fini, ils assistèrent à un Te Deum, puis à un banquet qu'offrit la grande ouvrière de cette réconciliation, Christine de Danemark. A midi, dans le petit village du Cateau, la trompe et les cloches publièrent l'heureuse nouvelle : l'allégresse fut générale et infinie[126]. Trois jours après, à Coucy, où s'était rendu le Roi, le secrétaire L'Aubespine rédigea le cri de la paix pour tout le royaume, et l'on dépêcha aux princes étrangers, amis ou alliés, des courriers portant les clauses[127]. Les historiens modernes, en France, ne s'accordent point pour juger la paix du Cateau-Cambrésis. Au contraire, les contemporains, les historiens anciens et les auteurs étrangers ont, presque tous, reconnu que c'était une véritable abdication du Très Chrétien devant la monarchie espagnole, dans le domaine extérieur. A ne considérer que les événements politiques, cette dernière opinion nous semble d'une justesse évidente. Les arguments qu'on lui oppose d'ordinaire ne résistent pas à un examen précis. Quelqu'un vante le bon sens de ce roi qui abandonna l'Italie : il livra l'Italie assurément, non aux Italiens, mais à la maison d'Autriche qui y domina jusqu'au XIXe siècle. D'autres, très nombreux, estiment la possession de Calais plus que toutes les conquêtes abandonnées : sans doute, mais cette possession de fait était antérieure, et le traité, au lieu de la consacrer juridiquement, la rendait provisoire en droit ; c'est Catherine de Médicis, qui plus tard, régente, devait obtenir l'annexion de Calais. Enfin ce traité ne donnait pas les Trois-Evêchés à la France puisqu'il n'en était point question dans l'acte et que la conquête restait, après comme avant, une simple occupation militaire. Les historiens oublient trop facilement qu'un traité est un instrument juridique, ayant pour but de consacrer et de légitimer une situation de fait : or, par la paix du Cateau-Cambrésis, Fleuri Il renonçait, devant le roi d'Espagne, à la plupart de ses droits ou prétentions et n'en acquérait aucun. En réalité, cet acte ne peut être défendu que par les raisons qui l'expliquent, par des considérations religieuses et de politique intérieure. Toute la responsabilité, ou tout le mérite, du sacrifice appartient au Roi lui-même et à Montmorency. Dans son principe, sinon dans ses détails, l'accord célèbre de 1559 fut l'un des actes les plus personnels de Henri II. On peut classer ainsi les motifs qui le déterminèrent : résolution d'extirper à tout prix l'hérésie du royaume, remords d'avoir rompu la trêve de Vaucelles, dégoût des alliances italiennes, désir de rappeler Montmorency à la tête du Conseil, enfin souci de marier la très docte fille de François Ier Marguerite de Berry. Le Connétable, quelle que fût, d'ailleurs, la clairvoyance
de sa politique générale, joua, dans cette négociation, le rôle mesquin d'un
homme de faction. Il y perdit, même auprès des personnes désintéressées,
quelque chose de son prestige. Un prince, qui était de ses amis et de ses
protégés, bien informé et très averti des sentiments des deux cours, Louis de
Gonzague, — le futur Gonzague-Nevers, — écrivait au duc de Mantoue, son frère
: Montmorency et le duc de Savoie ne sont qu'une âme
et un corps. La paix est l'œuvre particulière du Connétable : s'il a fait
restituer le Piémont au duc de Savoie, c'est pour que celui-ci soit grand à
la cour de France et l'aide à vaincre les Guises. Gardez le secret de ce que
je vous écris[128]. Il faut
ajouter que le vieillard n'eût pas réussi sans le secours de Diane de
Poitiers. Quant aux. Guises, leur attitude fut très fière, parfois émouvante. Le cardinal de Lorraine y montre une figure qu'il n'a pas souvent, dans l'histoire. Seule, avec la reine Catherine, cette famille de chevaliers lorrains, en quête de gloire et de fortune, semble avoir vibré de quelque passion d'honneur. En défendant la guerre, les Guises défendaient aussi leurs moyens d'existence et de progrès. Ardents dans la dispute, ils se soumirent vite au fait accompli, parce que s'offrait à eux une œuvre nouvelle. Mais ils emportèrent de ce terrible conflit une haine meurtrière contre toute la race de Montmorency. Épuisé, desséché par le fisc et par les misères de la magnificence extérieure, le royaume attendait la paix. Celle qu'on lui offrit, fruit des haines religieuses et des rivalités de factions, contenait en germe les horreurs de la guerre civile. Au lendemain du traité on fit frapper une médaille : elle représentait la France, assise sur un monceau d'armes, avec une Victoire à sa main droite lui offrant une palme et une couronne ; la devise était Optima principi, dans l'exergue Gallia[129]. |