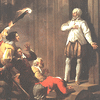LES ORIGINES POLITIQUES DES GUERRES DE RELIGION
LIVRE III. — L'ORIENTATION NOUVELLE
CHAPITRE II. — L'AVÈNEMENT POLITIQUE DE LA RÉFORME FRANÇAISE.
|
Les événements de l'année 1557 ramenèrent l'attention du Roi sur ses propres Etats. Il vit alors la gravité de certaines manifestations qui, dans l'accablement de la défaite, lui parurent plus sonores et plus étendues qu'auparavant. Quelques mois après le désastre de Saint-Quentin, Henri II éprouva pour la première fois une sensation d'insécurité religieuse et politique, la peur de l'hérésie, qui l'envahit chaque jour davantage. Il n'est pas de mouvement historique plus divers, plus complexe par ses origines, ses forces intimes et ses éclats, aussi bien il n'en est pas de plus national ou local que celui de la Réforme française, tel qu'on peut le surprendre avant la constitution ferme des églises et l'explosion des guerres civiles, qui firent tomber tant de rameaux. Il a emporté des éléments venus de toutes les sources et de toutes les époques de la tradition médiévale. Quel esprit n'a pas soufflé dans l'orage religieux du seizième siècle ? On y trouve un mysticisme à la fois ardent et logique, propre au caractère national, la vieille haine du bourgeois et du légiste contre le clerc ultramontain, la révolte du paysan tondu par l'abbaye dégénérée, le brigandage et la jacquerie que soulèvent toutes les guerres prolongées, des formes agressives du gallicanisme, enfin, chez quelques-uns et surtout chez les femmes, un désir profond d'amélioration morale, une renaissance de la sensibilité et de la délicatesse chrétiennes, un goût de l'élégance intime qui s'oppose aux rodomontades chevaleresques. Dans son principe religieux et politique, la Réforme française n'avait rien qui l'opposât à l'autorité royale. Amendé et adapté au cadre historique, son esprit anti-romain n'eût pas effarouché les légistes du Très-Chrétien. Quant aux sentiments du peuple et de la Cour, avant les guerres civiles, on n'y trouve aucune trace d'une grande affection envers le Saint-Siège. Plus respectueux de la réalité, plus souple et moins dominé par l'implacable logique calvinienne, le programme des Réformés français se fût imposé à la longue, sans difficultés violentes, au gouvernement des Valois[1]. Mais cette transformation n'était possible que par une conquête prudente, discrète et tenace. Œuvre, d'ailleurs, forcément périlleuse à cause des éclats individuels, des manifestations prématurées, de l'impatience des recrues, et de la répression fatale qu'attire toute nouveauté. Le développement du Protestantisme s'était affirmé, malgré ces dangers, sous les règnes de François Ier et de Henri II : en 1557, rien d'irréparable ne laissait prévoir encore la séparation définitive du pouvoir royal et de la Réforme. Mais on sentait proche l'heure critique. A mesure qu'ils devenaient plus nombreux, plus forts et par leur masse même plus dangereux au regard de ceux qui ne les connaissaient ou ne les aimaient pas, les protestants français devaient s'imposer plus de prudence, de tact et de discipline. Les conditions critiques dans lesquelles se trouva le royaume devant l'ennemi, rendaient, en effet, irritable la susceptibilité du souverain vis-à-vis de ses sujets et donnaient aux moindres manifestations, aux moindres remontrances collectives la couleur et la gravité d'un attentat contre la patrie. A vrai dire, pour régler les mouvements de cette foule qui remplissait maintenant les prêches et pour en brider les gestes publics, il était besoin d'un chef de génie. Ce chef manqua, et les hommes dont les protestants français écoutèrent alors la voix, n'avaient ni conviction, ni programme, ni habileté. Les ministres et Calvin lui-même s'en aperçurent souvent, mais emportés par leur zèle de réformateurs, excités par l'ardeur et le goût de la conquête religieuse, aveuglés, enorgueillis et débordés par le succès de leur apostolat, ils crurent à un avènement subit et miraculeux de leur foi et perdirent toute chance d'accommodement avec la royauté. La prudence était commandée aux protestants français surtout dans leurs rapports avec l'étranger. Les chefs montrèrent à cet égard un aveuglement extraordinaire. Pour bien observer, en effet, l'attitude de Henri II et de quelques-uns de ses courtisans, hommes sûrement loyaux et justes, pour comprendre la résistance entière et la roide cruauté qu'ils opposèrent, un jour, aux Réformés quels qu'ils fussent, il faut se rappeler la carrière déjà longue des Luthériens de l'étranger. A l'heure de la maturité, le protestantisme français se trouva compromis d'avance par la Réforme allemande et le schisme anglais. Ce fut là nous semble-t-il, l'origine de son infortune politique. II fut moralement et historiquement rattaché à des révolutions dont il ne se garda pas assez. De leurs rapports avec les Allemands, en particulier, les protestants français tirèrent plus de force matérielle, plus de facilité pour leur recrutement et l'expansion de leur doctrine, mais attirés dans un mouvement international, ils perdirent, avec l'indépendance et l'originalité de leur attitude native, la seule chance qu'ils avaient de réussir et assumèrent la responsabilité d'actes qui ne leur appartenaient point. Avantageuse en quelque endroit, une scission violente à forme révolutionnaire ne pouvait obtenir de succès en France, parce que la Réforme y avait grandi tardivement sous un prince qu'avertissaient depuis longtemps les exemples du dehors. Les bruits venus de l'étranger avaient produit dans l'esprit du Roi et de ses conseillers, même des plus gallicans, comme Montmorency, un préjugé qu'il fallait se garder d'irriter. La crainte des expériences déjà vérifiées tenait en éveil le gouvernement. Henri II et beaucoup de catholiques honnêtes, jugeant les protestants français sur le dossier d'autrui, n'entendaient dans le mot Réforme que le sens de rébellion et de jacquerie. Il était facile aux innombrables gens que gênait toute nouveauté ou toute amélioration, d'exploiter et d'encourager ce préjugé très naturel. Sur la voie périlleuse qui s'ouvrait à eux, les protestants français ne pouvaient avancer qu'avec difficulté : ils avaient besoin de prudence, de discipline et d'une direction experte ; ils devaient épurer leur recrutement, se défendre des compromissions hâtives et ne point mêler leur cause religieuse à des querelles politiques. Mais, à vrai dire, ils se présentèrent au gouvernement comme une puissance avec laquelle il fallait traiter, et cette puissance n'était qu'une multitude bigarrée, où se pressaient toutes sortes de gens, parmi lesquels des espions, et qui n'avait d'autre force que le nombre. Le flot clair de la première Réforme, grossi subitement d'eaux troubles, s'était étendu en largeur, mais avait perdu beaucoup de sa vertu pénétrante. Il est bien sûr que l'effroyable misère, produite dans le royaume par les guerres de magnificence, en privant les sujets de la richesse, leur ôtait le goût de la stabilité, les poussait à la révolte et les offrait comme des recrues faciles aux prêcheurs de nouveautés sociales ou religieuses. Au lendemain de la trêve de Vaucelles, la ruine était déjà complète. Le Roi avait employé les dernières ressources des contribuables à fortifier les places frontières de Picardie, Champagne, Luxembourg, Lorraine et Barrois, en prévision d'une attaque que faisait craindre l'échec des conférences de Marcq[2]. La France ne put se relever pendant l'année de paix 4556 : le mal était trop grand, l'épuisement trop profond. Les instruments mêmes du fisc, usés, faussés et engorgés par le surmenage, ne jouaient plus qu'à peine. Le roy de France, écrit Simon Renard en mai 1555, a condescendu à la tresve et cessation d'armes par nécessité, ne treuvant plus moien de tirer de son peuple argent ou finance pour plus longtemps souldoier la guerre : estant le peuple sy appauvri des exactions et contributions, tant ordinaires qu'extraordinaires, estans les changeurs et bancquiers si en arrière par le grand crédit qu'ilz ont fait, estant le païs si déforni d'argent, pour avoir esté tiré hors d'icelluy ès lieux où la guerre et gens de guerre se sont levéz et entretenuz, estans les églises et ecclésiastiques si rechastrés par les décimes et accreues de décimes et aultres impositions, comme des cloches et calices, estant la noblesse si pauvre et désacréditée par les contributions, pour avoir servi aux bans et rières-bans, pour avoir au service du roy et longs véaiges soubstenu grandz frais, pour estre les domaines du roy du tout venduz et toutes les inventions de finances mises en exécution, ne lui restans que les tailles ordinaires, jà pour la plupart engaigées aux bancquiers et ausquelles le même peuple n'a moien fournir[3]. Dans ces conditions, la rupture de la trêve de Vaucelles et l'expédition de Guise en Italie furent un coup de folie, qu'explique seulement l'ignorance de Henri II des choses du gouvernement. A l'automne de 1556, lorsque de nouveau il se précipita dans l'aventure, si le Roi avait écouté les voix de son peuple, il eût entendu déjà des murmures de révolte[4]. Les ministres de Philippe II étaient attentifs aux bruits de France ; en préparant la campagne de Picardie et en négligeant pour un temps l'Italie, ils ne firent que suivre le conseil que donnait à son maître l'ambassadeur espagnol : Si vostre Majesté a moien d'entrer en France, elle esbranlera fort le rey et ses subjectz[5]. Et, pourtant, le Trésor royal entretint, pendant le printemps et l'été 155'7, quatre armées d'Italie : armée de Guise, armée de Brissac, armées de Rome et de Montalcino[6], sans parler des sommes employées à réunir la foule de gentilshommes et de soldats que Montmorency conduisit au massacre de Saint-Quentin, à quoi s'ajoutèrent les énormes dépenses de la guerre diplomatique, les avances consenties au duc de Ferrare et au pape. Après le désastre du 10 août, Henri II, privé de l'aide du connétable, alors que toutes les forces militaires étaient dispersées ou détruites, put rassembler encore, dans un délai assez court, l'armée qui prit Calais. De tels prodiges ne s'expliquent que par la souplesse économique du royaume de France et par la résistance des rouages du gouvernement central, que dirigeaient dans le silence d'un labeur acharné ceux que le Roi va bientôt créer secrétaires d'Etat[7]. Sans doute cet effort fut grandiose. Mais il ne faut pas s'étonner si, dès le mois d'avril 1557, on voyait des malheureux mourir de faim au long des routes[8]. La tête de l'Etat s'alimentait encore grâce à des emprunts usuraires et à des contrats insensés, niais le corps périssait. Après la journée de Saint Laurent, Henri II, qui n'avait guère connu de son peuple jusqu'alors que les courtisans, se trouva en face de la nation, et ce lui fut une rencontre salutaire. Pour sauver le royaume, il fallut réunir les Etats Généraux. Par timidité ou par pudeur, le Roi en retarda l'assemblée jusqu'au mois de janvier 1558, espérant qu'une victoire, celle de Calais, lui permettrait de paraître moins honteux devant ces juges muets. Aussi bien, toute son attitude montra la gêne qu'il éprouvait. Le gouvernement convoqua les Etats sous prétexte de leur faire approuver le mariage du Dauphin avec Marie Stuart, et les députés n'apprirent qu'au dernier moment qu'il s'agissait d'écus à fournir[9]. A Paris, le 5 janvier 1558 au matin, dans la salle de Saint-Louis
au Palais, eut lieu la séance solennelle d'ouverture. Henri II y vint,
accompagné du Dauphin et de toute la cour ; la Reine et les dames y
assistèrent des tribunes. Le discours du Roi fut une longue apologie de sa
politique, en particulier de sa politique italienne. Il insista beaucoup sur
la rupture de la trêve de Vaucelles, s'efforçant de montrer qu'il y avait été
contraint par l'obligation de secourir le Saint-Siège contre les Espagnols.
Puis, il avoua se trouver sans ressources, ayant dépensé, outre les subsides
ordinaires, tous ses biens personnels, vendu ou engagé tout son domaine.
Enfin, il pria les Etats de lui donner aide, en vertu du principe que les royaumes et les rois ayant été établis par Dieu, il
est juste de les défendre. On remarqua le ton déférent de ce discours.
Le Roi a fait beaucoup, beaucoup de démonstrations,
écrit un témoin[10]. Par innovation, les députés étaient groupés en quatre ordres : le clergé, constitué par les archevêques et les évêques, la noblesse, comprenant les sénéchaux et les baillis, la bourgeoisie, représentée par les maires et échevins, enfin l'ordre de la magistrature, formé des premiers présidents de tous les parlements du royaume. Le cardinal de Lorraine, au nom du clergé, le duc de Nevers, au nom de la noblesse, le président de Saint-André, du Parlement de Paris, au nom de la magistrature, et M. du Mortier, prévôt des marchands, au nom de la bourgeoisie, promirent à Henri II dévouement de corps et de biens[11]. C'était la cérémonie, restait la pratique. On y travailla
pendant une semaine. Le 14 janvier, avant de partir pour Calais, Henri II
licencia les Etats Généraux. La principale conclusion,
écrit un témoin, a esté d'or et d'argent, à tant que
le Roy tirera pour ceste année d'extraordinaire plus de sept millions d'or,
dont les troys millions seront payés par tout février, le demeurant par
quartiers. Quant aux doléances ou autres
matières proposées, ont esté différées jusques à autre diète, et cependant
les poincz ont esté baillés aux ambassadeurs et commis des provinces pour les
communiquer aux Estas provinciaux[12]. Les députés des ordres étaient à peine partis qu'arrivèrent dans la capitale les représentants de la banque lyonnaise, créancière de la couronne. On ne sait s'ils avaient été convoqués par le Roi ou s'ils étaient venus de leur propre mouvement. En tout cas, ils se montrèrent fort inquiets. Depuis plusieurs mois, les banquiers ne recevaient plus du Trésor l'intérêt des sommes énormes qu'ils avaient prêtées : leurs délégués demandèrent des explications au gouvernement[13]. Pendant tout le mois de février, Jean d'Avanson, garde des sceaux, s'efforça de négocier avec eux une entente. Le Roi lui-même, très désireux de flatter ces personnages, leur fit grand accueil et justification de son intention, jusques à leur communiquer l'universel estat des finances ordinaires et extraordinaires de ceste année, qui surmonte de beaucoup tous les autres estas précédens[14]. Enfin, ils voulurent bien se contenter d'une satisfaction provisoire : le Trésor leur devait seize cent mille livres d'intérêts ; ils emportèrent la promesse d'être payés du quart de cette somme, — quatre cent mille livres, — sur le dernier quartier de l'année 1558. Par ce moyen, le Roi gagnait une avance de douze cent mille livres[15]. En même temps, le gouvernement mettait en jeu toutes les mesures traditionnelles de la fiscalité extraordinaire et en inventait de nouvelles. Le Roy, écrit Macar à Calvin le 22 février[16], retire tout le revenu d'une année de son domaine aliéné par tout le royaume et toutes les rentes constituées assignées sur les hostelz de ville, excepté Paris, ensemble tous les gages des officiers de son royaume. Le 13 mars, Dalmatio annonçait au cardinal Farnèse : Les provisions de la guerre se font icy plus grandes et gaillardes que ne furent de mémoyre d'homme, et surtout d'argent extraordinaire. Entre autres provisions extraordinaires, l'on a faict ung impoz des pouldres et salpêtres par tout le royaume, qui n'avoyt esté faict puys l'année que l'Empereur vint à Soyssons ; et pareillement l'on couche au ban et arrière-ban les biens d'Eglise amortiz et autres qui n'y avoyent jamays esté comprins[17]. L'application de cet énorme appareil fiscal provoqua des résistances significatives[18]. Les forces suprêmes du royaume étaient tendues comme pour une épreuve désespérée. Mais ce corps épuisé et fiévreux consumait sa substance avec une rapidité effrayante. Pendant le printemps et l'été de 1558, Henri II fut comme un mendiant affolé. Alvarotti, confident des Guises, écrivait, au lendemain de la prise de Thionville : Le Roi n'a plus de deniers, il en cherche par tout le monde et, s'il pouvait en trouver en engageant son royaume, il le ferait[19]. Quel effet produisit dans l'organisme profond de la nation, après cinquante ans de guerres inutiles, cette terrible secousse, on l'imagine sans peine : ce fut une dislocation économique, que suivit le déclassement des énergies. Dès lors apparurent dans la société les signes ordinaires de l'anarchie prochaine : d'une part l'inquiétude maladive qu'un choc change en fureur, d'autre part les mille formes de la révolte individuelle vis-à-vis des tuteurs qui n'ont pas rempli leur fonction. L'inquiétude et l'énervement du peuple se révèlent dans ce fait vraiment étrange : en août 1558, après huit mois d'une campagne presque toujours victorieuse, les habitants de Paris menaçaient encore de s'enfuir si le Roi quittait la capitale[20]. Quant au mécontentement, on le trouvait diffus dans toutes les couches de la société, chez les hommes de métier, les bourgeois, les nobles et les clercs. En multipliant le nombre des charges, le gouvernement avait irrité même les parlementaires, les officiers de finances et de justice, gens qui soutiennent volontiers l'ordre social parce qu'ils l'exploitent[21]. Au concert des plaintes il ne manquait plus que la voix des soldats : on pouvait prévoir aisément que, privés de leurs occupations traditionnelles et de leur solde par une paix générale, les capitaines et hommes d'armes feraient naître les plus graves désordres. Ainsi l'état du royaume était tel qu'on avait raison de craindre également et la conclusion de la paix et la prolongation de la guerre : à force d'être tendu, l'organisme menaçait de se rompre, et, d'autre part, il ne pouvait supporter sans trouble grave la réaction d'une détente. La royauté, l'eût-elle voulu, ne pouvait plus empêcher le mal d'accomplir son évolution entière et fatale. La suite de ce récit montrera que l'exaspération des haines de partis pendant les derniers mois du règne eût en toute rencontre provoqué des désordres civils. D'autre part, l'état économique et social créé par la prolongation des guerres de magnificence extérieure, tel qu'on vient de le voir, devait se résoudre dans une explosion d'anarchie inévitable. Ainsi s'expliquent la gravité soudaine et la résonance infinie du conflit religieux, lorsque des hommes maladroits ou intéressés le firent éclater au grand jour. Henri II lui-même semble avoir saisi par instants la complexité du mouvement qu'il entreprit d'arrêter, et nous verrons qu'à la volonté de détruire l'hérésie il joignit la résolution ferme de guérir les maux profonds dont souffrait son royaume. Depuis longtemps, dans toute l'Europe, une inquiétude très
vive tourmentait les esprits catholiques. Après la mort de Jules III, dont le
pontificat avait montré tant de scandales, les hommes sincèrement religieux
attendirent avec angoisse le choix du conclave. L'élu, Marcel II, n'eut que
le temps d'éveiller de grands espoirs, avant de mourir. Ces espoirs, son
successeur les recueillit à son avènement. Paul IV, l'ancien cardinal
Théatin, l'un des membres les plus pieux et les plus ardents du
Sacré-Collège, fut salué joyeusement. De tous les points du monde chrétien il
reçut des exhortations émues. L'Eglise, noble vierge
d'Israël, écrivait au nouveau pape l'évêque de Vérone Lipomano, gise étendue dans la poussière : la nuit elle pleure, le
jour elle se consume de tristesse, et personne ne la console. La loi divine,
l'honneur, la religion, la justice ont fui loin du clergé. Ceux qui ont cure
d'âmes ne se soucient aucunement de cette charge ; plût à Dieu qu'ils eussent
autant d'indifférence pour la chair, le luxe et l'avarice ! On voit des
enfants occuper les stalles des églises cathédrales et leurs prélats
ressemblent à des maîtres d'école plutôt qu'à des évêques. Les clercs riches
abusent de la pluralité des bénéfices, tandis que les clercs pauvres meurent
de faim. Pour toute charge sacerdotale on trouve autant de collateurs que de
candidats. La liberté de l'Eglise est avilie, écrasée. Les évêques ne sont ni
respectés ni obéis. On se moque des censures ecclésiastiques. Les religieux,
pour vivre à leur guise, se cachent dans le gouffre de leurs privilèges.
Enfin, chacun se fait une foi personnelle, selon son talent, il y conforme sa
vie, il la propage impunément. Le saint évêque terminait par cette
constatation triste : Il y a longtemps que les
prédécesseurs de Votre Sainteté nous ont promis des réformes, en paroles plus
solennelles peut-être qu'il n'était nécessaire. Ces réformes, tous les gens
de bien les désiraient et les invoquaient ; mais des promesses de vos
prédécesseurs il n'est resté que vanité[22]. Cette plainte n'est qu'un exemple dans une littérature tout aussi désolée. Des hommes fort différents adressent alors au pontife leurs supplications ardentes. Ce sont les ambassadeurs de Venise, les marchands les plus réalistes de la chrétienté[23]. C'est Girolamo Siripando écrivant à l'évêque de Fiesole : J'ai prié Dieu de nous donner un pape qui fasse disparaître l'opprobre et la dérision où s'abîment, depuis tant d'années, les saints noms d'Eglise, de Concile, de Réforme[24]. C'est un chanoine de Bayeux qui exhorte : Nous tous supplions Paul IV, souverain pontife, avec révérence et humilité, qu'il daigne purifier l'Eglise de ses abus[25]. C'est Claude d'Urfé, gouverneur des enfants de France et ancien ambassadeur à Rome, qui, d'Ecouen, le 18 juin 1555, félicite Giovanni Pietro Carafa d'être choisi de Dieu pour réformer sa saincte et affligée Eglise[26]. On imagine quelle stupeur douloureuse fut celle des âmes catholiques devant les emportements belliqueux du nouveau pape. Ceux mêmes qui profitaient de la politique de Paul IV s'étonnèrent d'un tel scandale. Nous avons cité le langage de Montmorency rappelant que la fonction d'un pontife n'est point de mettre les princes en guerre, mais de les réconcilier. Le conflit armé entre le Saint-Siège et le roi d'Espagne arrêta un moment le zèle des plus fidèles défenseurs de l'unité romaine. Au printemps de 1557, les Jésuites, liés par leurs origines à la monarchie espagnole, eurent beaucoup à souffrir de la guerre qui divisait leur prince naturel et leur chef spirituel. Ignace étant mort, ils voulurent réunir en Espagne la congrégation des profès pour élire un nouveau général. Au P. Lainez, qui l'informait de ce projet, Paul IV répondit avec colère : Allez en Espagne, si vous y tenez. Mais qu'y ferez-vous ? Voulez-vous épouser le schisme et l'hérésie du roi Philippe ? Quelle pitié ressentirent les soldats de la cause romaine devant un pape qui poursuivait de sa haine le prince le plus catholique du monde ![27] Aussi bien, dans l'attitude de ce pontife, qu'on avait connu vertueux avant son couronnement et qui s'était trouvé comme vicié par sa sainteté, les Protestants montraient le signe de la malédiction divine, justifiant leurs anathèmes et leur révolte. Des avis répandaient dans toute l'Europe le bruit que, pour mieux écraser la maison d'Autriche, Paul IV acceptait le concours de la flotte turque. Les agents du roi de France même donnaient crédit et force à ces nouvelles[28]. Nous avons vu que, de fait, le projet d'expédition du duc de Guise à Naples comportait l'intervention des Turcs. Enfin, depuis 1552, le concile général était suspendu[29]. Des voix, parfois sévères, rappelèrent au pontife enivré de politique son devoir spirituel. Le 3 novembre 1555, à l'heure où Paul IV déclarait sa haine contre les Espagnols et invoquait les Français, Girolamo Muzio lui écrivait de Pesaro : Quelle douleur a saisi mon âme lorsque, ces jours passés, j'ai vu Votre Sainteté s'occuper d'armes et de guerres temporelles, celui-là seul peut le comprendre qui est vraiment catholique et qui désire que, dans la sainte Eglise apostolique, on observe et respecte les armes spirituelles. Je craignais bien, en effet, que l'ennemi du genre humain, pour empêcher la sainte réforme de l'Eglise, ne trouvât ce moyen de confondre le sacré avec le profane, et qu'ainsi le vœu des âmes catholiques ne fût pas exaucé[30]. Dans le Sacré-Collège même, quelques hommes, peu nombreux, mais tenaces et énergiques, s'élevèrent avec fermeté contre la conduite du pape. Sous le pontificat précédent, Reginald Pole et Morone avaient exercé une influence salutaire : Paul IV leur donna peu d'égards, et le dernier fut même accusé d'hérésie. Mais deux autres cardinaux, l'Espagnol Saint-Jacques et le Français Tournon, apportèrent une audace rare dans leurs remontrances. Saint-Jacques s'efforça vainement d'empêcher la guerre entre Philippe II et le Saint-Siège, disputant le terrain aux fuorusciti et surtout au principal conseiller de Carafa, Silvestro Aldobrandini. Dans les premiers jours de septembre 1556, devant l'attitude menaçante du duc d'Albe, Saint-Jacques se rendit chez le pape et l'apostropha en ces termes : Comment Votre Sainteté ose-t-elle dire la messe avec l'esprit de haine dont elle est animée ? Votre confesseur ne peut pas vous donner l'absolution. Paul IV se prit à pleurer[31]. Du côté français, Tournon, dont on ne saurait trop louer l'intelligence et reconnaître le zèle, blâmait avec respect, mais fermement, les écarts du pontife : en même temps, il protégeait de toute sa sollicitude les intérêts religieux dont il avait la charge[32]. Parmi les catholiques français de son époque, ce cardinal fut un caractère éminent. Il faut, d'ailleurs, rendre justice aux intentions du pape lui-même. Il voulut sincèrement faire du bien. Dans son esprit sénile, ravagé par des violences folles, il y avait le germe de grands desseins. Il était animé d'un zèle véritable pour le salut de l'Eglise[33]. Mais ce zèle s'épuisait dans une activité brouillonne et anecdotique, frappant les coupables sans corriger le mal. Aux théologiens que lui avait présentés le cardinal de Lorraine, en 1555, et qui sollicitaient des remèdes pour sauver la religion, Paul IV répondait : Un concile est peu opportun : il n'en sort jamais que des difficultés et des longueurs. Mais il faut corriger peu à peu les erreurs et les abus, en exécutant les décrets du Saint-Siège[34]. Cette tactique dispersée favorisait évidemment l'autorité du pontife romain, que les conciles avaient souvent ébranlée. Mais, à vrai dire, en laissant l'œuvre de réforme suivre le gré des hommes et l'opportunité des rencontres, on préparait une action incohérente, inégale et partant injuste : cette méthode sans efficacité, qui laissait la porte ouverte à toutes les exceptions de la politique et du népotisme. Paul IV lui-même, plein de bonnes intentions, donna l'exemple le plus scandaleux des conséquences qu'entraînaient ses propres théories : l'histoire de son pontificat est fameux par les abus et les désordres temporels. Dans l'état où se trouvait alors l'Europe, seul, un concile général, dont l'autorité fût reconnue de tous les princes, pouvait imposer la réforme de l'Eglise. Le péché le plus grave des papes du seizième siècle, c'est d'avoir retardé et gêné, par peur, la réunion d'une assemblée œcuménique indépendante. Averti de la gravité du péril soit par sa propre expérience, soit par les plaintes des catholiques inquiets, Paul IV mit, dans sa lutte contre l'hérésie, la même fougue excessive et désordonnée que dans sa politique. Son zèle ajouta quelques noms au martyrologe protestant, mais ne put arrêter la diffusion d'une doctrine qui tirait sa force de nécessités profondes[35]. Créer des commissions ou des congrégations de cardinaux, c'était opposer un barrage puéril au mouvement qui soulevait la Chrétienté[36]. Jules III, semble-t-il, moins ardent mais plus fin, avait mieux compris le problème, et s'était appliqué, dans la dernière période de son pontificat, à fonder sur la réconciliation des dynasties une œuvre générale. Paul IV, devant l'échec de ses entreprises temporelles, après le désastre de Saint-Quentin, le départ du duc de Guise et la capitulation de Cavi, subit, comme son prédécesseur, une sorte de conversion : son activité devint alors exclusivement religieuse. Mais, au lieu de chercher un remède universel, il élargit et accentua les mesures de violence, créant ainsi des haines meurtrières. A partir de 1558, Rome est le foyer de la répression. Pendant cette année et la suivante, l'Inquisition, dont le pape préside les séances et augmente les moyens, reçoit une vigueur nouvelle. Tout le monde tremble dans la Ville éternelle : les prisons se remplissent ; on menace, on poursuit les cardinaux ; les bibliothèques sont expurgées[37]. Orthodoxes ou hérétiques, tous rendent leur compte, et Paul IV donne l'exemple du courage moral en frappant ses neveux mêmes. La méthode est toujours mauvaise, mais d'une force plus ample, impétueuse et terrible. Les coups retentissent dans toute l'Europe. Alors éclate, en France, l'incident décisif. La période 1556-1559 est la plus importante pour l'histoire politique de la Réforme française. C'est le moment où les protestants précisent leur doctrine, organisent leurs églises et leur parti, assument une responsabilité collective. En s'affirmant, ils s'opposent davantage à leurs adversaires. Les causes de ce phénomène de cristallisation ne pourront être étudiées qu'après qu'on aura dressé une carte précise et vivante des communautés réformées à la date de 1559[38]. Il n'y a lieu ici que d'observer l'attitude de la royauté en présence de ce mouvement. Système centralisé et traditionnel ayant pour objet de protéger et d'alimenter une cour qu'animaient seulement les rêves militaires ou les haines de factions, le gouvernement de Henri II était fermé par sa nature à toute tentative directe de réforme. Pour pénétrer dans ce corps résistant, il n'y avait d'autres moyens que l'infiltration lente ou la révolution soudaine. Il y fallait une habileté ou une force singulières, qui manquèrent, l'une et l'autre, aux chefs du protestantisme français. La conduite de ces hommes faibles fut la plus dangereuse qu'on pût imaginer. La persécution individuelle n'avait pas cessé, depuis le début du règne, contre les dissidents des classes inférieures. Mais on ne vit paraître les signes d'une répression systématique et générale qu'après l'achèvement de la guerre de Toscane, en 1555, lorsque les Guises eurent acquis la prépondérance au Conseil. La tradition commune attribue au cardinal de Lorraine l'initiative d'une vigilance plus sévère. Les documents, il est vrai, confirment et précisent cette opinion. Pendant son séjour à Rome, au mois de décembre 1555, Charles (le Lorraine jeta les fondements de la Contre-Réforme française. C'est un des traits singuliers de cet homme que le mélange, dans son esprit, de grands desseins politiques et de soucis religieux. Le 1er octobre 1555, il partait de Villers-Cotterêts avec l'intention de bouleverser l'Italie, il allait offrir à Paul IV une folle, aventure, la conquête de Naples, et il emmenait une troupe nombreuse d'évêques et de théologiens pour demander au pontife des remèdes contre l'hérésie. Le cardinal, assisté de ses théologiens, eut avec le pape, dans les premiers jours de décembre, des conférences remarquables. Les officieux annoncèrent au public qu'on y avait traité de la réforme des abus : il y fut parlé assurément de l'hérésie[39]. Ainsi s'explique que le cardinal de Tournon, dont les principes politiques étaient justement contraires à ceux de Lorraine, ait enfin consenti, après quelque résistance, à le suivre à Rome. Homme profondément religieux et plus que personne inquiet des périls qui menaçaient l'Eglise, Tournon se laissa entraîner sans doute par l'espoir de convertir le pape à ses idées de réforme. La trêve de Vaucelles fut, on l'a dit, une grave défaite pour les Guises. Pendant l'année 1556, qui offrit cependant au gouvernement royal les commodités de la paix, le mouvement contre l'hérésie se ralentit. Il est vrai qu'aussitôt après la suspension d'armes, le nonce Gualterio essaya d'orienter Henri II vers une répression générale des Luthériens[40]. Mais ce fut une tentative vaine et, au fond, de pure forme. Il est vrai encore que Carafa, venu à la cour pendant l'été de 1556, transmit au Roi le désir qu'avait Paul IV de voir établir l'Inquisition en France[41]. On ne peut prendre au sérieux le zèle de Carlo, et lui-même se souciait fort peu des hérétiques. D'ailleurs, possédés par la fureur des rivalités politiques, les courtisans n'avaient pas le temps de songer à la religion. Il faut tenir compte, enfin, de la résistance qu'avouait, quelques mois après, Henri II lui-même : Les Etats de mon royaume ne veullent recevoir, approuver ny observer ladite Inquisition, les troubles, divisions et autres inconvéniens pourroit apporter avec soy, et mesure en ce temps de guerre[42]. Ne pas diviser les forces morales de la nation en présence de l'ennemi, même pour cause de religion : c'est l'instinct du peuple, c'est la doctrine de Montmorency. Le cardinal de Lorraine n'avait point de ces craintes ni de ces scrupules. A la fin de 1556, les Guises regagnent l'esprit du Roi, François conduit en Italie une expédition de magnificence, la guerre se rallume partout ; bientôt Philippe II menacera la Picardie. Et, le 13 février 1557, quand le royaume plus que jamais a besoin de cohésion intérieure, Henri II, voyant les hérésies et fausses doctrines qui pullulent, écrit à Odet de Selve, son ambassadeur auprès de la Curie, la lettre fameuse où il demande lui-même au pape d'établir l'Inquisition en France[43]. Le 25 avril suivant, Paul IV donnait un bref conférant les fonctions de grands inquisiteurs clans le royaume aux cardinaux de Bourbon, de Châtillon et de Lorraine[44]. On a trouvé étrange la nomination de Châtillon. A vrai dire, le pape n'y avait mis aucune malice : suivant les conseils probables de l'ambassadeur, il avait désigné les trois cardinaux qui étaient membres du Conseil et résidaient ordinairement à la cour. Mais le seul inquisiteur actif fut Charles de Lorraine, et lorsque le pape se plaignit, un jour, que la répression restât inefficace, c'est ce cardinal qu'il accusa comme responsable[45]. Quinze jours avant la bataille de Saint-Quentin, le 24 juillet 1557, Henri II publiait à Compiègne deux édits : l'un portant règlement pour le pouvoir des inquisiteurs de la foy, l'autre qui ordonnait de châtier sans merci les persévérans en leurs mauvaises opinions contre la foy[46]. Après une vive résistance du Parlement de Paris, ces édits furent enregistrés le 15 janvier 1558 avec des réserves[47]. Pendant toute cette année 1557, le gouvernement, ébranlé par les terribles secousses de la guerre extérieure, ne cessa, pourtant, d'être attentif aux choses de la religion. Au mois de mai, Henri II avait publié des lettres sévères sur la résidence des archevêques, évêques, curés et autres ayant charge d'âmes[48]. Puis on poursuivait à Dijon des calvinistes, qui avaient attaché aux compites et lieux publicques de ladicte ville quelque figure contre l'honneur de Dieu, son sainct sacrement, et au contemnement de nostre religion ; le cardinal de Lorraine poussait avec énergie le zèle un peu lent des officiers de justice[49]. Après le désastre de Saint-Quentin, les Guises, maîtres absolus du pouvoir, en l'absence de Montmorency, entreprennent une lutte plus vigoureuse et plus large[50]. Les protestants accusèrent toujours le cardinal de Lorraine d'être leur plus grand ennemi. Il est vrai, on le verra mieux encore par la suite, qu'il fut l'auteur de la répression officielle. Mais cet homme ne voua pas, dès l'origine, aux hérétiques la haine foncière et violente que les historiens ont imaginée. De nature il était intelligent et capable de souplesse : il protégea fidèlement un Jean de Monluc, réputé partout libertin et sacramentaire. Son caractère, aigri par les rivalités de cour pendant les derniers mois de Henri II et sous le règne de François II, acquit dans les guerres civiles de méchantes inclinations. Auparavant, c'était seulement un esprit chimérique et ambitieux. Dès sa jeunesse et de plus en plus avec l'âge, il voulut jouer un rôle illustre, être un grand ministre, donner surtout à sa famille de cadets une couronne de maison souveraine. Cette volonté ardente guida sa conduite dans la politique intérieure comme dans la politique extérieure : il appliqua simultanément aux occasions diverses qui s'offrirent les moyens que lui suggérait une ambition unique. En même temps qu'il jetait le Roi dans l'aventure belliqueuse de 1557, il inspirait une reprise plus vigoureuse de la chasse aux hérétiques : les deux choses se tiennent. C'est que les Guises, soldats ou clercs, appartiennent à la tradition chevaleresque : ignorant la nation, parfaitement dépourvus des soucis de la politique bourgeoise, ils ne connaissent et ne servent que leurs deux chefs, l'un féodal le Roi, l'autre mystique le Pape. Dans leur attitude vis-à-vis des protestants, à l'origine, on ne trouve pas ces motifs de cupidité ou de rancune qui ont déshonoré quelques meneurs de la faction catholique. Sans doute ils furent des hommes de parti et cherchèrent dans la religion une arme contre leurs rivaux, comme le montrera l'histoire de d'Andelot ; mais ils ne poursuivirent pas des confiscations ou de basses vengeances. Leur catholicisme Faisait corps avec de grands desseins politiques. A suivre au jour le jour les sentiments du cardinal de Lorraine, tels que nous les livre la correspondance d'Alvarotti, on découvre les rêves immenses de cet esprit, rêves dont la fin naturelle est l'exaltation de la famille de Guise, mais qui dépassent, cependant, les petits intérêts et les profils mesquins. Les Lorrains se croyaient les descendants de Charlemagne, et ils aimaient qu'on le leur rappelât : ce trait, dans un siècle où plus que jamais on a lu les Chroniques, explique bien des choses. Toutes proportions gardées, l'esprit qui les anima ressemble à celui de Charles-Quint. Ils sont d'un type qui va disparaître, le type que représente éminemment, au seizième siècle, la noblesse espagnole et dont les Montmorency, serviteurs de la monarchie centralisée, se distinguent déjà Sous l'action des rivalités violentes, parmi les tristes incidents de la vie de cour, au milieu des guerres civiles, l'ambition des Guises se rétrécit et s'avilit. Mais, quoi qu'on puisse reprocher à ces hommes, ils ont été pour les protestants des adversaires résolus et francs. Comme champions de l'Église romaine, ils ne font pas mauvaise figure. Aussi bien, sous le règne de Henri II, la conduite du cardinal de Lorraine dans les affaires religieuses fut probablement inspirée par les Jésuites, dont il avait assumé la protection en 1550. Au déclin de la Renaissance païenne, la Curie, pleine de vices et de scandales, plus soucieuse encore de politique que de religion et toujours dominée par les besoins du népotisme, ne défend qu'avec peine les restes d'une grandeur qui s'émiette : Paul III, Jules III et Paul IV sont de pauvres chefs devant Luther et Calvin. En attendant l'œuvre vigoureuse de Borromée et de Pie V, c'est dans la Compagnie de Jésus qu'il faut chercher le noyau vivant du catholicisme, sa force de résistance et de combat. On ne peut bien connaître le rôle des Jésuites en France : la correspondance de Charles de Lorraine avec les Pères n'a pas été publiée. Ce rôle fut assurément efficace et décisif. En tout cas, les Guises et les Jésuites représentent ce qu'il y eut de plus noble dans l'opposition à la Réforme. On doit, en effet, prendre garde aux différences morales qui séparent les groupes catholiques et ne pas confondre les disciples d'Ignace avec les théologiens imbéciles de la Sorbonne, leurs rivaux Il serait aussi très injuste d'assimiler le rôle des Guises à celui des favoris rapaces. L'ennemie acharnée, implacable, des protestants, sous Henri II, fut Diane de Poitiers : femme dont l'histoire ne peut retrouver le charme, malgré les vains essais de quelques auteurs amoureux de nouveauté ou de romanesque. Une étude, qu'il serait facile de poursuivre, montrerait, dans la chronique quotidienne du règne, l'âpre calcul et la défiance vigilante de cette maîtresse vieillie. Par la terreur elle domina : dans la cour, dans la famille royale, personne n'osa jamais se révolter, parce qu'on la savait capable de tout pour défendre sa proie. La Reine, Madame Marguerite, Montmorency, les Guises, tous furent humbles devant elle jusqu'à la mort de son amant. Celui-ci disparu, les Guises, unis à Diane par le mariage du duc d'Aumale avec Louise de Brézé et par tant d'autres liens, pousseront la favorite dans l'ignominie : preuve accablante pour qui connaît l'histoire de Henri II. Sur la haine de Diane contre les protestants et son influence dans la répression, il y a un témoignage inattaquable, celui du nonce. Après la découverte des assemblées de la rue Saint-Jacques, quelque temps avant l'affaire d'Andelot, Lorenzo Lenti écrivait : Madame la duchesse de Valentinois favorise beaucoup dans cette cour la cause de la religion et de la sainte Église romaine : elle se montre acharnée contre tous les malsentants de la foi et met tout en œuvre pour qu'ils soient châtiés et punis selon leurs péchés[51]. Cette fureur s'explique par des motifs personnels. Hostile aux nouveautés, comme toutes les favorites, Diane craignait particulièrement les réformateurs qui chaque jour, au nom de la morale, attaquaient sa fortune. Très imprudents et forts d'un zèle trop naïf, les protestants accablaient d'anathèmes perfides la favorite : Anne Dubourg, dans la fameuse mercuriale de 1559, n'osera-t-il pas reprocher au Roi ses amours ? La Sénéchale, inquiète et vieillissante, n'était plus d'âge à dédaigner les médisances. Cherchant à couvrir son passé par une dévotion tardive, elle avait soif d'honorabilité. D'ailleurs, connaissant mieux que personne la nature du Roi, elle se sentait très menacée. Caractère droit, rigide et entier, Henri II n'eût pas hésité, dans un accès de rigorisme, à renvoyer celle qui ne le tenait plus que par l'habitude. Les pamphlets et pasquins, que divulguaient les protestants, risquaient de piquer, un jour ou l'autre, l'amour-propre d'un homme qui était fort religieux. A l'égard des hérétiques les sentiments du Roi lui-même n'avaient jamais varié : très solidement attaché aux traditions catholiques de sa famille et de son gouvernement, Henri II était, d'ailleurs, par sa nature, rebelle à toute nouveauté. Mais, à vrai dire, il n'avait pas dans son intelligence les moyens de distinguer telle doctrine de telle autre, et, à la longue, il eût parfaitement accepté des réformes présentées habilement. Jusqu'à l'année 1557, il ne porta que peu d'attention aux divers malsentans que le peuple appelait Luthériens et les théologiens sacramentaires. Il considéra l'hérésie comme un mal endémique, individuel et, pour ainsi dire, traditionnel, analogue aux crimes de droit commun. La première idée qu'il eut du protestantisme était beaucoup plus grossière que celle qu'avait conçue, à certains moments, le roi François, son père. C'est pourquoi, suivant son goût inné de l'ordre et de la discipline, Henri II n'avait jamais hésité à réprimer cruellement toute révolte religieuse chez les individus. Sous son règne, et dès les premières années, les lois et les instruments destinés à extirper l'hérésie étaient devenus nombreux, pour répondre aux manifestations plus fréquentes de la secte. Mais l'initiative des mesures appartenait aux protecteurs ordinaires de l'orthodoxie, au Parlement, à la Sorbonne, aux tribunaux ecclésiastiques, plutôt qu'au Roi lui-même. Celui-ci resta très longtemps ignorant des progrès de la Réforme protestante en France, et, bien sûr, il n'avait jamais considéré la nécessité d'appliquer toutes les forces de son gouvernement à la destruction de l'hérésie : la répression des malsentans n'était à ses yeux qu'un détail de la police intérieure. On découvre la nuance de sa pensée dans une petite anecdote. Au cours de l'été 1556, les théologiens de la Sorbonne se présentèrent à lui et, sous prétexte que les poursuites contre les protestants étaient insuffisantes, demandèrent à en être chargées. Il répondit que cette mission appartenait au Parlement de Paris. Cette Cour est infectée d'hérésie, déclarèrent les gens de la Sorbonne. — Que voulez-vous donc que je fasse, s'écria le Roi impatient, et quel parti dois-je prendre ? Faut-il que je vous mette à la place du Parlement et que je vous abandonne la direction de mon royaume ? [52] C'était l'ignorance du danger. Un homme naïf, mal informé de l'état de son royaume et peu disposé à s'en instruire, tout occupé de la guerre et de la politique extérieure, laissant pour le reste le maniement des affaires à ses conseillers, d'ailleurs esprit étroit, caractère raide et nature routinière, tel avait été Henri II jusqu'au jour où le désastre de Saint-Quentin l'éveilla brusquement. L'apparition soudaine des forces de l'hérésie devait provoquer en cette âme surprise une résistance farouche. Le nombre des protestants en France, dans les dernières années du règne de Henri II était très considérable, plus considérable qu'il ne fut après l'explosion de la guerre civile. Des témoignages d'origines diverses l'affirment. On ne peut, à vrai dire, obtenir aucun renseignement précis et sûr. Nos recherches glissent sur un terrain mouvant : l'extrême diversité des origines et des milieux, le secret de la propagande et des adhésions, la prudence de beaucoup de convertis, la peur des petites gens devant le bruit de la répression ou simplement leur appréhension d'être dénoncés comme rebelles, le manque même de prêches ou de réunions dans la plupart des localités rurales, tout cela rend insaisissable le réseau subtil de la Réforme française. Voyons les témoignages. Les lettres du ministre Macar adressées à Calvin pendant l'année 1558 affirment que dans toutes les parties du royaume le feu est allumé et que toute l'eau de la mer ne suffirait pas pour l'éteindre[53]. D'autre part, la cour de France, le Roi et les Guises, lorsqu'éclatèrent les incidents du Pré-aux-Clercs et l'affaire d'Andelot, furent informés que la moitié des sujets étaient Luthériens[54]. En mai 1559, le cardinal de Lorraine déclara même aux conseillers de Philippe II que l'hérésie avait gagné les deux tiers du royaume[55]. Ces opinions nous semblent fort exagérées : elles s'expliquent parce que les conseillers de Henri II considéraient comme hérétiques tous les mécontents, et de ceux-ci le nombre était immense. Des renseignements reçus à Milan en juin 1558, sans doute par l'organe des, marchands, sont plus vraisemblables : ils signalent à Paris un groupe compact de quatre mille Luthériens, et ils évaluent le nombre des hérétiques dans le royaume à quatre cent mille personnes, groupées principalement à Orléans et à Rouen[56]. Mais ces données, fondées seulement sur la connaissance de quelques villes de commerce, Paris, Orléans, Rouen, sont très incomplètes. Elles laissent de côté tout ce que nous savons du développement de la Réforme en Languedoc, en Provence, en Dauphiné, en Guyenne, dans les pays du Sud-Ouest et jusque dans les villages ruraux de l'Auvergne[57]. En Avignon même, cité pontificale et peuplée de clercs, une vingtaine d'hérétiques indigènes furent arrêtés, au début de 1558, hérétiques, écrivait le vice-légat, de la plus parfaite hérésie[58]. Il faut y ajouter les adhérents trouvés dans la noblesse, parmi les dames et les gentilshommes ruraux très indépendants[59], ainsi que chez les hommes de robe. Si l'on tient compte de ces observations et de celles qui vont suivre, il y a lieu de penser qu'un tiers des habitants du royaume s'était détaché de l'Église romaine. On était, d'ailleurs, mieux informé à l'étranger qu'à la cour de Henri II de cette situation religieuse. L'opinion de l'Europe considérait alors la France comme une des nations les plus infectées. Après les conférences de Péronne, en mai 1558, la duchesse douairière de Lorraine, Christine de Danemark, se séparant de son fils, le jeune Charles III, qui retournait à la cour du Très-Chrétien, lui adressait une inquiète et sévère exhortation pour le détourner des hérétiques, qu'il ne manquerait, pensait-elle, d'y rencontrer[60]. En dehors des suppositions qu'on peut faire touchant le nombre des protestants dans le royaume, il importe de préciser certains côtés du développement de la Réforme, pour expliquer l'attitude du Roi et comprendre la suite des événements politiques. Dès qu'il se fut aperçu de la situation religieuse de ses sujets, Henri II n'eut qu'une idée, pour y porter remède, celle de conclure la paix à tout prix : il lui parut très clairement, on en trouvera les preuves plus loin, que l'hérésie continuerait de progresser aussi longtemps que durerait la guerre. Cette opinion, d'où résulta finalement un désastre diplomatique, était fondée sur des faits précis : faits économiques et faits militaires. La diffusion soudaine de l'hérésie dans le peuple, à partir de 1558, fut la conséquence de la misère et de l'affluence plus nombreuse et plus libre des étrangers. Le Roi, nous l'avons dit et nous aurons l'occasion d'y revenir, saisit très vite le rapport qui existait entre la pauvreté de ses sujets et leur inclination à la révolte. Aussi bien les nouvelles que reçut la cour, au printemps de 1558, sur les mouvements de jacquerie en Normandie et en Languedoc durent éclairer le Conseil[61]. C'était un mal profond qu'on ne pouvait guérir qu'avec la paix. Plus pressante encore et plus difficile à résoudre, tant que durerait la guerre, était la question des étrangers. Marchands ou soldats, propagateurs actifs des doctrines luthériennes et de la pensée libre, les étrangers procuraient au Roi les moyens indispensables pour la lutte, de l'argent et des troupes. Sur la puissance des marchands et la liberté qu'ils savaient obtenir, il faut citer un fait vraiment significatif. On a vu qu'au mois de février 1558, les chefs des nations étrangères de Lyon étaient venus à la cour pour réclamer le paiement des intérêts que le Trésor leur devait. Le gouvernement royal, fort gêné devant ces personnages et contraint de les ménager par nécessité, leur accorda des privilèges. Or, parmi ces privilèges, les banquiers obtinrent pour tous les étrangers faisant commerce, dans le présent ou dans l'avenir, la permission générale de vivre selon leurs croyances religieuses et le droit de ne pas se soumettre à l'Inquisition : c'était ouvrir toute grande la porte du royaume à la propagande des Suisses et des Genevois[62]. Une concession si grave, dont les gens avertis furent effrayés, alors qu'à Paris on traquait sans pitié les pauvres chanteurs de psaumes de la rue Saint-Jacques, permet de saisir les motifs qui pousseront Henri II à la paix du Cateau-Cambrésis. Mais, à vrai dire, l'attention du Roi devait se fixer bientôt sur un danger plus menaçant : la majeure partie de son armée était composée de Luthériens et le nombre des hérétiques croissait de jour en jour parmi les soldats. Les Allemands et les Suisses, qui, après le désastre de Saint-Quentin, formèrent le gros des troupes royales, faisaient prêcher dans les camps par des ministres réformés, et beaucoup de Français assistaient aux réunions religieuses des dissidents[63]. Propagande qu'on ne pouvait arrêter, en temps de guerre et devant l'ennemi, puisque la garde du royaume était confiée à des étrangers. Éclairée par ces observations, la conduite de Henri II s'explique naturellement parmi les incidents complexes de l'année 1558. Trois jours après la bataille de Saint-Quentin, dit
Pasquier[64],
le 4 septembre, dit Crespin[65], en réalité le 5
septembre 1557, la police parisienne découvrit une
assemblée qui se faisoit en la rue Saint-Jacques vis-à-vis du Collège Du
Plessis, en laquelle y avoit une infinité de nobles tant hommes que femmes et
autres du menu peuple, faisans lors leur presche en la manière de Genève,
dont la plus grande partie fut prise, avec un grand scandale et esmotion
populaire[66]. Un long procès
s'ensuivit, dans lequel furent inculpées surtout les petites gens. Cet
incident révéla aux autorités l'importance du groupe des Réformés parisiens,
mais on ne voit pas que le gouvernement royal, trop occupé d'ailleurs par les
dangers de la guerre, ait pris d'abord des mesures exceptionnelles ni hâté l'instruction
judiciaire. C'est seulement au début de février 1558, après la victoire de
Calais, le renvoi des Etats-Généraux et la conclusion d'un accord financier
avec les marchands étrangers, que le Roi, poussé par le cardinal de Lorraine,
déclara qu'il ne se contentoit pas de sa court de
Parlement de Paris et fit tançer ses
conseillers comme nonchallans et tardifz[67]. La situation des protestants parisiens était fort critique, tant par la puissance de leurs adversaires que par leur propre faiblesse. Outre que les Guises étaient maîtres du Roi, en l'absence de Montmorency prisonnier de guerre, un légat du pape venait d'arriver à Paris, chargé à la fois de préparer des négociations de paix et d'exciter le zèle de Henri II contre l'hérésie. Parti de Rome le 21 novembre pour la Romagne, le cardinal Trivulzio, après avoir passé par Lyon le 18 décembre, était entré, le 30, à Paris, où on lui fit un accueil solennel le 3 janvier[68]. Contre les attaques du cardinal de Lorraine, du légat, de l'Inquisition et du Parlement, les Réformés se trouvaient sans défense, n'ayant aucun soutien politique à la cour. Pourtant, malgré les procédures dirigées contre ceux d'entre eux qui avaient été arrêtés, ils jouissaient encore d'une certaine tolérance, puisque leurs réunions, surveillées de près et souvent dénoncées, continuèrent, d'abord moins fréquentes, mais bientôt assez nombreuses et assez ouvertes pour provoquer l'inquiétude de la population parisienne[69]. Le ministre Nicolas des Gallars avait été remplacé, à la tête du troupeau, par un compatriote de Calvin, Jehan Macar, venu de Genève, d'où il était parti le 1er janvier 1558[70]. Ce nouveau pasteur, saint homme, semble-t-il, et plein de zèle mystique, mais naïf et dépourvu d'énergie, exerça tout de suite un apostolat très actif, et lui-même, au début de février, avouait à Calvin qu'il prêchait cinq fois par jour, dans les divers quartiers de la capitale[71]. En dépit de la persécution, le nombre des adhérents augmenta beaucoup, comme on le verra par l'incident du Pré-aux-Clercs. Il paraît donc que les protestants, si menacés et tout désarmés qu'ils fussent, ne furent pas très violemment molestés jusqu'au printemps : la répression n'était encore qu'une affaire de police. Mais ils devaient bientôt souffrir des fautes de leurs amis ou de leurs chefs. L'église réformée de Paris, privée jusqu'alors de soutien politique, vit prendre rang parmi ses membres, au début de mars 1558, Antoine de Bourbon, roi de Navarre et premier prince du sang : cette adhésion, qui donnait aux humbles dissidents un réconfort inattendu, fut en réalité, pour eux, un malheur. Les Bourbons, hommes séduisants, la plupart frivoles et débauchés, manquaient d'intelligence et de caractère : ils n'ont dû leur fortune qu'au sang des d'Albret. Dans sa génération, an milieu de personnalités puissantes et vives, Antoine représente un type extraordinaire de médiocrité. Changeant d'opinions à tout instant, maladroit avec insouciance, incapable de comprendre et d'exécuter, n'obéissant qu'aux fantaisies d'un cœur puéril et d'une ambition sans suite, il fut un triste chef dans le camp où le poussa Jeanne d'Albret. Le roi de Navarre et son épouse entretenaient avec Henri II des rapports excellents : le souverain n'appréciait pas très haut les mérites d'Antoine, mais il lui était attaché, ainsi qu'à Jeanne, par des souvenirs de jeunesse. La famille royale partageait cette affection, dont la solidité devait se maintenir jusque dans les circonstances les plus tragiques des guerres civiles. On savait depuis longtemps à la cour que les deux époux n'étaient pas très orthodoxes, ni surtout très amis du Saint-Siège : l'influence de Marguerite d'Angoulême, les vieilles disputes des d'Albret avec la Curie avaient produit des fruits dont on ne s'étonnait pas[72]. Au mois de février 1557, Antoine était venu en grande solennité à Paris, cordialement accueilli par le Roi et par Montmorency. Sous l'inspiration de ce dernier, on avait formé déjà le projet de marier Margot, la troisième fille de Henri II, au petit Béarnais, le futur Vert-Galant, — à peine sortis de nourrice l'un et l'autre[73]. Antoine était, en effet, un ami du Connétable, et par conséquent assez suspect aux Guises. Le roi de Navarre se trouvait loin de la cour lorsqu'advint le désastre de Saint-Quentin. Peu désireux de subir le gouvernement du cardinal de Lorraine et ne se sentant pas capable de lui résister, il se tint à l'écart pendant l'automne de 1557 et refusa l'invitation que lui fit Henri II de venir le rejoindre. Les Guises virent dans cette attitude, peut-être avec raison, une manœuvre pour retarder le mariage de Marie Stuart : les noces du Dauphin ne pouvaient être arrêtées ni célébrées en l'absence du premier prince du sang. Antoine, hostile à ce mariage qu'il considérait comme une mésalliance de la famille royale, se fit beaucoup prier et n'obéit qu'aux instances pressantes du souverain[74]. Il ne se priva pas, une fois arrivé, de proférer sur les Lorrains quelques mots blessants[75]. Il rentra à la cour le 7 mars 1558, et Jeanne d'Albret le rejoignit au début d'avril[76]. Les Guises, déjà piqués, eurent bientôt des raisons très précises de détester Navarre. Depuis quelques mois, on parlait à la cour d'un scandale dont Jacques de Savoie, duc de Nemours, était le héros. Ce jeune homme, grand séducteur de femmes, lié d'une amitié intime à François de Lorraine, exerçait une influence assez étrange sur la famille de celui-ci[77]. Nemours était candidat à la main de Lucrèce d'Este, seconde tille d'Hercule II et sœur de la duchesse de Guise. Nous avons vu que, passant par Ferrare, au printemps de 1557, il s'était efforcé vainement de conclure son affaire. Les Guises avaient fort à cœur ce projet et le poussaient avec une véritable passion. Hercule résistait : il n'avait point de goût pour un gentilhomme pauvre, auquel on reprochait, d'ailleurs, des péchés d'amour[78]. Jacques faisait plaider sa cause par ses patrons, qui ne s'en lassaient pas. Or, juste au moment le plus difficile, éclata le scandale dont fut victime une malheureuse jeune fille, Françoise de Rohan, que Nemours avait séduite et qui se trouvait enceinte. Anne d'Este, le duc de Guise, le cardinal de Lorraine, le Roi lui-même, auquel on avait représenté ce mariage comme un avantage pour la politique française, devinrent furieux. La coupable fut insultée et chassée. Pour connaître toute la grossièreté des gens de cette époque dans les questions sentimentales, il faut lire les dépêches qu'on adressa à la cour de Ferrare afin de sauver Nemours, en couvrant de boue sa maîtresse[79]. Antoine de Bourbon était cousin germain de Mlle de Rohan. Dès le début de l'affaire, poussé par Jeanne d'Albret qui se rappelait sans doute ses propres infortunes matrimoniales, il avait défendu la jeune fille et écrit au Roi pour la sauver du déshonneur. Venu à la cour, il répéta plus vivement ses instances et poussa les choses jusqu'au bout dans les premiers jours de mai 1558, il intentait un procès en séduction au duc de Nemours devant l'officialité de Paris[80]. Les Guises, si passionnés que fussent leurs sentiments dans cette affaire, supportèrent d'abord sans y répondre l'hostilité du roi de Navarre. Leur principal intérêt était de ne pas laisser troubler les noces du Dauphin François avec Marie Stuart. Mais, une fois célébré ce mariage le 24 avril, ils purent prendre l'offensive : Antoine leur en offrait les moyens par sa conduite religieuse. Dès son arrivée à la cour, au mois de mars, le roi de Navarre était entré en relations avec l'église réformée de la capitale. Les ministres, qui avaient fondé de grands espoirs sur sa venue, cherchèrent à le convertir entièrement et le prièrent de plaider la cause de la Réforme auprès de Henri II. Mais il se déroba. Séduit par les fêtes, ce danseur galant n'inclinait pas à prêcher d'exemple. Au surplus, on ne changera pas, disait-il, les opinions du Roi qui est décidément hostile à la restauration de l'ancienne doctrine. En vérité, les protestants ne pouvaient compter sur l'appui d'un homme qui ne s'était rapproché d'eux que par calcul d'ambition et pour obéir à sa femme. Incapable de toute suite, il ne savait pas lui-même qu'elles étaient ses affections ou ses haines. Il blessait les Guises sans y faire attention, se sentait menacé par eux, mais cédait à la moindre politesse de leur part[81]. Après l'arrivée de Jeanne d'Albret qui le rejoignit à Paris au début d'avril, Antoine consentit cependant à faire une démarche auprès du Parlement en faveur des accusés de la rue Saint Jacques : son zèle était, d'ailleurs, animé par des motifs que nous verrons plus loin. Mais il tremblait de peur[82]. Dans les premières semaines de mai, il entendit la messe chaque jour, en compagnie de sa femme ; puis, il se montra à cheval aux assemblées protestantes du Pré-aux-Clercs[83]. Le Roi et les Guises, suivant l'opinion publique et des indices trompeurs, regardaient Antoine comme beaucoup plus étroitement lié à la Réforme qu'il ne l'était en réalité. Dès le mois d'avril, à Rome même, on se plaignait que le prince fût Luthérien[84]. Henri II, informé qu'Antoine avait dans sa maison un prédicateur suspect, commença bientôt à s'en fâcher. Un incident se produisit à ce sujet, au début de mai. Poussé par les Guises, qui, Marie Stuart étant mariée, avaient les mains libres, le Roi déclara qu'il ne trouvait pas bon qu'on fît prêcher dans sa cour par d'autres prédicateurs que les siens. Antoine répondit qu'il avait toujours eu un prédicateur particulier. Le cardinal de Lorraine convoqua ce prédicateur pour éprouver son orthodoxie. Vexé, le roi de Navarre répliqua que, si le cardinal voulait voir son prédicateur, lui-même le lui conduirait. La chose en resta là[85]. Par sa légèreté et sa maladresse, Antoine de Bourbon compromettait la cause des protestants sans même essayer de la servir. La seule initiative qu'il prit, nous allons le voir, par calcul d'ambition, fut plus funeste encore à cette cause que son étourderie. D'ailleurs, il se moquait des accidents et de leurs victimes. Macar écrivait, le 22 mai, au lendemain de l'affaire du Pré-aux-Clercs et de l'arrestation de d'Andelot : Le roi de Navarre danse toute la journée avec des petites femmes ![86] La conduite de Bourbon aggrava une situation qui était déjà très mauvaise. Au début de l'année 1558, Calvin, mal informé, poussé d'ailleurs par un zèle trop mystique et trop logique, avait commis une grave erreur de politique. Il avait prié les princes protestants d'Allemagne, amis de la couronne de France, d'intervenir auprès de Henri II pour adoucir sa rigueur dans le procès de la rue Saint-Jacques. Cette démarche bien naturelle devait provoquer une catastrophe. Le défaut de scrupules qu'avaient montré le gouvernement de François Ier et davantage celui de Henri II, jusqu'à l'année 1557, en utilisant contre la maison d'Autriche les forces du protestantisme germanique et des hérétiques anglais, tandis que dans le royaume on exécutait brutalement les réformés, prouve à merveille que le Très-Chrétien et ses ministres n'accordèrent longtemps qu'une médiocre importance aux manifestations des dissidents français : la répression de ces derniers était, nous l'avons dit, une affaire de police. A vrai dire, en pratique, l'application d'un tel système, — encouragement aux protestants de l'extérieur, persécution à l'intérieur, — n'avait pas été sans de sérieuses difficultés. Les Réformes nationales, nées chacune de causes particulières sur un terrain différent, réalisaient des aspirations communes : il n'y avait jamais eu, entre elles, de cloison étanche, mais toujours au contraire une pénétration réciproque ; bientôt, pour toute sorte de raisons de théorie et de fait, s'était établie une fraternité internationale. De cette fraternité les protestants français, en plusieurs circonstances, avaient tiré une aide précieuse : déjà on avait vu les Luthériens d'Allemagne réclamer au Très-Chrétien, pour prix de leur secours financier ou militaire, plus de mansuétude à l'égard de leurs coreligionnaires régnicoles[87]. Mais, à la longue, il devait fatalement en résulter de graves inconvénients politiques. Par le fait même qu'il employait les protestants étrangers contre Charles-Quint leur prince naturel, le Roi acquérait de quoi alimenter sa propre défiance, le jour où, dans ses États, l'hérésie lui apparaîtrait comme une force collective, organisée et menaçante. Problème difficile que ne se posèrent même pas les chefs de la Réforme, parce qu'ils avaient espéré d'abord que la monarchie française accepterait leur doctrine. Quand les illusions furent dissipées, la pratique ancienne entraînait déjà des conséquences irrémédiables. Aussi bien les protestants français manquaient de sens politique : leur conduite, à cette heure grave de 45118, le prouve. Henri II avait été l'allié fervent des Luthériens d'Allemagne. Môme, au début du règne, on avait vu les Guises prôner cette politique, tant elle était naturelle, bien que, à vrai dire, Montmorency en ait été toujours le promoteur. En 1556, par un geste étonnant, le Roi avait offert un asile en France aux Calvinistes anglais rebelles à Marie Tudor : lui-même les avait reçus secrètement et les avait pourvus d'argent. Conduite très intéressée, qu'inspiraient la rancune du Très-Chrétien contre la reine d'Angleterre épouse de Philippe II et peut-être aussi l'espoir d'utiliser les rebelles pour la conquête de Calais[88]. Ce trait significatif, où paraissent en pleine lumière les motifs anciens de la politique française, fut le dernier péché de Henri II contre la communion romaine. Le désastre de Saint-Quentin ruina les ambitions du Roi et permit à son esprit d'apercevoir, sous les rêves écroulés, les germes de l'anarchie dans ses propres États. Dès lors se décide et peu à peu se précipite un revirement qui a pour cause une crainte nouvelle et comme internationale des progrès de l'hérésie. Mais la nécessité militaire faisait du gouvernement royal, nous l'avons dit, le prisonnier des protestants étrangers : forcé de ménager les soldats et les marchands Luthériens, sans qu'il pût même réprimer leur propagande, Henri II subit une contrainte morale dont il voulut bientôt se libérer à tout prix. La moindre tentative des Calvinistes français pour profiter de cette situation équivoque devait attirer sur eux la colère du Roi. Du point de vue moral, les démarches que firent alors les chefs de la Réforme s'expliquent et se justifient naturellement : ces hommes ne purent souffrir de voir persécuter et condamner les inculpés de la rue Saint-Jacques par un gouvernement qui tirait tant de secours des protestants étrangers[89]. Le 21 février 1558, Calvin écrivit de Genève aux princes protestants d'Allemagne pour les prier d'intervenir auprès de Henri II en faveur de l'église réformée de Paris. Théodore de Bèze et le roi de Navarre se mirent de même en rapport avec les princes[90]. Antoine de Bourbon poursuivait, dans cette affaire, des fins d'ambition personnelle : ses intrigues et celles de ses agents n'étaient pas excusables ; le ministre Macar dégagea sa responsabilité à ce sujet, mais sans énergie[91]. De fait, le 19 mars, le comte Palatin, le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg, le duc des Deux-Ponts et le duc de Wurtemberg adressèrent au roi de France une supplique qu'apportèrent des envoyés spéciaux[92]. Déjà le cardinal de Lorraine, averti de ce qu'on préparait. avait écrit au comte Palatin : Les protestants de Paris, disait-il suivant la formule ordinaire, ne méritent pas que les princes Luthériens interviennent en leur faveur, vu qu'ils sont tous Calvinistes, Zwingliens et Sacramentaires[93]. Henri II était alors fort inquiet. Le sort de son armée et de son royaume dépendait du plaisir des princes allemands : ceux-ci, sans même intervenir d'une façon positive, pouvaient, en fermant les passages du Rhin, arrêter tous les secours levés par les agents français dans les pays germaniques et en Suisse. Les Espagnols les y poussaient fortement. Menace d'autant plus grave qu'on annonçait de nouvelles revendications impériales sur les Trois-Evêchés. Cependant les protestants et surtout le roi de Navarre continuèrent de solliciter l'intervention des princes. Des espions informaient la cour de toutes ces négociations secrètes. Le 8 mai, deux envoyés apportèrent an Roi de nouvelles lettres d'Allemagne. Henri II y répondit le 21 mai, de Crécy : Je désire bien que vous entendiez que la plus grande partie de telz personnaiges — pour lesquelz vous estez, comme j'estime, importunéz et presséz ainsi souvent m'escrire — sont perturbateurs du repos publicq et ennemys de la tranquillité et union des chrestiens. Desquelz il ne se peut croire l'intention ne tendre à mauvaise fin[94]. Le Roi, emporté par ses propres sentiments et par ceux du cardinal de Lorraine, était devenu furieux. En quittant Paris, au début de mai, il avait dit : Veulent-ils donc m'enlever ma couronne de la tête ![95] Blaise de Monluc, qui fut dans cette crise l'homme de confiance de la cour[96], vint trouver Antoine de Bourbon : Vous avez grand tort, lui déclara-t-il, de fomenter ces choses, de tenir pratique avec les protestants d'Allemagne et de mettre ce royaume en division. Vous préparez votre perte et votre ruine totale, car le Roi ne souffrira jamais une chose qui porte si grand dommage à son âme, à son honneur et à ses biens ![97] Pour distinguer les influences complexes qui agirent alors sur l'esprit de Henri II, il faut connaître le jeu et les procédés de la diplomatie espagnole. Dès la fin de l'année 1557, par l'initiative de Montmorency et du maréchal de Saint-André, prisonniers en Flandre, et surtout' grâce aux démarches de la duchesse de Lorraine, Christine de Danemark, interprète déguisée des vœux de Philippe II, on avait essayé d'engager des négociations pour la paix. Mais le roi de France s'était montré rebelle à ces tentatives : il ne voulait pas traiter sous le coup d'une défaite, sachant du reste que les Espagnols émettaient des prétentions exorbitantes[98]. Seulement après la prise de Calais, qui sauvait sa réputation, il se montra mieux disposé. Le pape lui-même pressait vivement les princes catholiques de se réconcilier. Plus que personne Philippe II désirait la paix, mais il lui eût été pénible de se déclarer franchement. Aux prières des représentants du Saint-Siège, comme aux démarches de l'ambassadeur de Venise qui s'employait à la même tâche, il opposait des exigences insolentes avec des paroles injurieuses pour son adversaire[99]. Il se plaisait dans une attitude de mépris et de défiance. Le 19 mars 1558, Me Lactance Bencini, auditeur et dataire du cardinal Trivulzio, arrivait à Bruxelles, venant de Paris, avec des lettres de créance de son patron pour Carlo Carafa et l'évêque de Terracine, le premier légat, l'autre nonce à la cour espagnole. Il put parler à Ruy Gomez de Silva, l'un des principaux ministres du Catholique, et lui exposer l'objet de sa mission, qui était de préparer une conférence entre deux ou plusieurs personnes possédant la confiance des deux rois pour engager des négociations de paix. Mais, comme ni Carafa ni Terracine ne se trouvaient alors à Bruxelles, on déclara à Bencini qu'on ne pouvait l'entendre régulièrement, et on voulut même l'empêcher de retourner en France, sous prétexte qu'il était un espion[100]. Cet accueil, qui offensait non seulement Henri II, mais plus encore le cardinal Trivulzio, légat du Saint-Siège, illustre à merveille le caractère de Philippe. Cette conduite, très préméditée, était pour décourager tout essai de négociation directe de la part du roi de France. Déjà l'astucieuse et pénétrante diplomatie de Granvelle dessinait son plan avec précision et fermeté : n'accepter de pourparlers que par l'intermédiaire des prisonniers, Montmorency et Saint-André. Observateur attentif et psychologue subtil, le rusé Comtois connaissait par le menu les rivalités de la cour de Henri II : il espérait en tirer tout avantage. Aussi bien le duc de Savoie faisait des politesses au Connétable. A l'heure même où l'on traitait si brutalement l'auditeur Bencini, Ruy Gomez envoyait un personnage visiter Montmorency dans sa prison avec la communication suivante : Le roi Philippe est plein de bonnes intentions au sujet de la paix ; au surplus, vous savez qu'il vous a toujours aimé et estimé comme ministre sage, de longue et grande expérience. Veuillez donc mettre un peu clans une note écrite ce qu'il vous semble qu'on pourrait faire pour mener à bien l'œuvre si sainte de la paix. Le piège était d'une telle impudence que Montmorency se révolta : Je suis trop vieux, répondit-il, pour me laisser induire à m'occuper d'une chose qui, traitée sans l'assentiment de mon maître, me rendrait digne de la peine de mort[101]. Un échec ne pouvait décourager des gens sûrs de vaincre par cette méthode efficace. Depuis longtemps, n'annonçait-on pas que le Connétable viendrait en France soubz sa foy pour traicter la paix ?[102] Cependant, le cardinal de Lorraine ne désirait nullement le retour de Montmorency, son adversaire, même à titre de négociateur. Aussi, bien qu'il représentât, lui et toute sa famille, le parti de la guerre, s'efforça-t-il de prendre la direction des entretiens, s'il y avait lieu. Au mois d'avril, la duchesse de Lorraine, Christine de Danemark, ayant demandé instamment à voir son fils, qui se trouvait comme otage à la cour de France, il fut décidé que le cardinal accompagnerait l'enfant à cette entrevue. Profitant de l'occasion, Christine obtint qu'en même temps aurait lieu à Péronne une conférence entre Granvelle et le ministre français. Charles de Guise partit de Paris le 4 mai, avec le jeune duc de Lorraine[103]. Le cardinal emportait à Péronne des instructions de son maître, qui, par leur précision même, attestaient une bonne volonté certaine. A Granvelle, il proposa, touchant les querelles générales qui divisaient la maison de France et celle d'Autriche, deux moyens de solution : par le premier, Henri II consentirait à restituer les Etats de Savoie et de Piémont au duc Emmanuel-Philibert, à condition que, d'une façon ou d'une autre, le Milanais revînt aux Valois ; par le second, le Roi rendrait la Savoie en gardant le Piémont, mais sans réclamer la Lombardie, pourvu toutefois que Philippe II donnât 'une compensation à Emmanuel-Philibert pour décharger la politique française de l'hypothèque juridique qui pesait sur les territoires subalpins. Quant au reste, Henri II exigeait l'abandon par les Espagnols de toutes les places de Picardie qu'ils occupaient et qu'on ne parlât pas de Calais. A vrai dire, le cardinal se montra très cassant. Aux objections de Granvelle il répondit d'un ton sec : Si votre roi veut la paix, il l'aura par ces moyens, non autrement ![104] Henri II, on le voit, ne voulait céder ni Calais ni le Piémont, à moins que le roi d'Espagne ne consentit à échanger ce dernier Etat contre la Lombardie : conditions qui restèrent inébranlables jusqu'au mois de novembre 1558. Le Piémont était, de fait, patrimoine du Roi, Calais sa conquête personnelle. Sur la question du Piémont, les Espagnols, ce semble, n'eussent pas résisté autant qu'ils l'affirmèrent d'abord. Emmanuel-Philibert lui-même se plaignait alors vivement que ses protecteurs fussent disposés à faire bon marché de ses droits[105]. L'attitude de Lorraine, préméditée ou naturelle, mit les représentants de Philippe Il dans un état de vraie fureur : ils n'hésitèrent pas à le faire poursuivre par des cavaliers, qui manquèrent de le surprendre à Nelle, près de Roie[106]. Cet échec, d'où leur vanité sortait blessée, fit revenir les Espagnols au premier dessein qu'ils avaient formé, de n'engager la conversation que par l'intermédiaire des prisonniers français. Mais le plus grave fut ceci. Au moment de se séparer du
cardinal, les Espagnols lui avaient lancé une flèche empoisonnée : Vous ferez bien d'exhorter votre maitre à la paix, car,
lorsqu'il aura bien examiné chaque chose dans son Etat, il reconnaîtra qu'il
a plus de raisons de s'accorder avec le roi Philippe que non pas le roi
Philippe avec lui. — Pourquoi ?
demanda Lorraine. — Parce que le royaume de France
sera bientôt divisé. Le cardinal protesta que la France était le
royaume le plus uni du monde entier. Alors Ruy Gomez de Silva, comte de
Melito, — le favori de Philippe II, — offrit à Lorraine de lui montrer dans les vingt-quatre heures une lettre,
tombée aux mains du Roi catholique, par laquelle un des principaux
gentilshommes de la cour de France, écrivant à quelque prince protestant d'Allemagne,
l'avertissait des divisions du royaume, lui annonçait que d'ici quelques
jours il en aurait de vraies nouvelles et le priait d'être attentif à ce que
diraient et, feraient alors les protestants français. Très étonné,
Lorraine demanda le nom. — François d'Andelot,
répondirent les Espagnols, et la duchesse Christine, témoin de cette scène,
confirma l'exactitude de la révélation[107]. Granvelle
ajouta que l'amiral de Coligny, frère de d'Andelot et prisonnier depuis la
chute de Saint-Quentin, était très luthérien,
n'entendait jamais la messe et menait une vie détestable, de sorte que, si
ces seigneurs de Châtillon ne changeaient pas leur conduite, il faudrait les
ruiner complètement[108]. Le cardinal eut tort d'accepter une telle accusation sans avoir vu lui-même la preuve. Deux mois après, il reconnut qu'il avait été trompé par l'odieuse malhonnêteté des Espagnols : la lettre interceptée était une simple exhortation qu'adressait d'Andelot à son frère pour l'encourager à persévérer dans sa foi[109]. Mais pouvait-il résister aux affirmations catégoriques de tels personnages, parmi lesquels se trouvait Christine de Lorraine, sa parente ? A l'heure où il avait laissé le Roi pour venir à Péronne, le cardinal était tourmenté par de sérieuses inquiétudes : il connaissait le désir passionné qui brûlait son maître de revoir Montmorency[110] ; il savait qu'Antoine de Bourbon, hostile à la maison de Guise, tournait en dérision le mariage de Marie Stuart, intriguait chez les princes allemands, prenait part aux réunions des dissidents et défendait Mme de Rohan ; enfin il n'ignorait rien du développement de la secte à Paris et dans le royaume. Et le moyen s'offrait à lui, sans qu'il l'eût cherché, d'accabler ensemble Montmorency et ses neveux, le roi de Navarre, les protestants, tous ses ennemis. La nature voulait qu'il acceptât cette aubaine ; peut-être aussi bien crut-il faire son devoir, L'odieux mensonge des Espagnols eut des conséquences plus graves sans doute que celles qu'ils avaient espérées. Instruit par le cardinal de Lorraine, Henri II, qu'avaient effrayé et que menaçaient, encore tant de dangers, ressentit un frisson de terreur : toutes ses inquiétudes engendrèrent un sentiment unique, la haine de l'hérésie. Le cardinal rejoignit son maître, qui était alors à Montceaux, le 18 mai[111]. En l'absence du ministre qu'ils considéraient comme leur plus dur ennemi, les chefs de l'église réformée de Paris avaient cru bon de tenter un suprême effort pour émouvoir le Roi. Il semble qu'à ce moment les pasteurs perdirent tout à fait l'instinct de la prudence. Animés par la venue des courriers allemands qui apportaient la supplique des princes, inquiétés d'ailleurs par le bruit de nouvelles mesures judiciaires contre les Luthériens, grisés enfin par le succès étonnant de leur propagande, ils pensèrent que le souverain, soustrait pour quelques jours à l'influence du cardinal de Lorraine, céderait devant une manifestation pacifique, mais franche et solennelle[112]. On parlait déjà d'une expédition des princes catholiques contre Genève, si les conférences de Péronne aboutissaient à la paix : les protestants voulurent montrer qu'ils représentaient une force avec laquelle il fallait compter[113]. Ils n'apportaient dans ce dessein, on le verra précisément plus loin, aucune intention de rébellion. Aussi bien, Calvin avait décrit des instructions formelles pour empêcher que ses disciples ne donnassent occasion à des troubles : Les cendres des hommes pieux sont toujours fécondes, mais les actes violents sont inutiles et stériles[114]. A vrai dire, les chefs de l'Église parisienne se mirent sur une voie où il était difficile d'observer ce précepte : ils virent leur erreur trop tard. Hors des murs de l'abbaye de Saint-Germain de Paris, en descendant sur la rive gauche de la Seine, s'étendait une prairie, qu'on appelait le Pré-aux-Clercs parce qu'elle appartenait aux écoliers de l'Université : c'était en quelque sorte une promenade publique, où les habitants de la ville et du faubourg venaient prendre l'air le soir après souper. Le 13 mai, vers sept heures de l'après-midi, on vit réunie dans la prairie une assemblée de personnes de toutes classes et de toutes conditions, femmes, hommes, vieillards, jeunes gens, petits garçons et petites filles, gentilshommes, plébéiens et hommes de métiers, qui allaient en procession à grandes files, chantant des psaumes à haute voix en français, suivant la mode de Genève. Il y avait là trois ou quatre mille âmes, disent les uns, six à sept mille, affirment les autres. Une fois la nuit tombée, cette foule rentra dans la ville par la porte et la rue Saint-Jacques, en chantant toujours des psaumes et surtout le psaume Judicia tua, Domine, regi da. Des assemblées pareilles, assure un témoin, eurent lieu aux champs hors les portes Sainct-Antoyne et Sainct-Victor, composées de deux ou trois mille personnes. Le même spectacle se renouvela les jours suivants, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 mai, avec une assistance de plus en plus nombreuse ; le lundi 16, le roi de Navarre prit part à la procession et aux chants[115]. L'aspect de ces assemblées mérite d'être examiné de très près. Toutes les relations non protestantes attestent que les chanteurs étaient accompagnés d'hommes armés. Pour se protéger du peuple et de la police, écrit Giovanni Michiel, non seulement ils avaient autour d'eux beaucoup d'hommes munis d'arquebuses et d'autres armes couvertes, mais ils avaient plusieurs troupes d'hommes à cheval, composées la plupart de nobles et de serviteurs de grands seigneurs, qui, par groupes de 15 et 20, les entouraient devant, sur les côtés et derrière, pendant qu'ils marchaient et chantaient dans la prairie[116]. Alvarotti dit : Ils sont protégés par des hommes à cheval, de sorte qu'il y a grand péril qu'il ne survienne un jour quelque grave désordre. Et il ajoute dans une autre lettre : Le roi de Navarre s'est trouvé aux réunions du Pré-aux-Clercs à cheval avec grand nombre de ses serviteurs ou de ses suivants pour fomenter et protéger cette espèce de gens, de manière que ceux qui ont été envoyés par la justice pour rompre et châtier ces assemblées n'ont pu accomplir leur office[117]. Alvarotti tenait ce renseignement de Blaise de Monluc. Giovanni Dalmatio confirme le fait[118]. Or, Macar déclare, dans une lettre à Calvin, qu'on a accusé faussement les Luthériens de se réunir en armes : On a informé, écrit-il, le malheureux Roi qu'il y avait au Pré-aux-Clercs plus de huit cents hommes en armes, alors que nous, qui avons été présents, pouvons affirmer que tous, autant que nous avons pu voir, étaient sans armes, sauf les nobles portant comme d'habitude leur épée[119]. En imaginant la réalité, on trouve que ces textes ne se contredisent pas autant qu'il semble. Un fait est acquis : la présence d'un grand nombre de gentilshommes avec leurs épées, dont quelques-uns, Macar ne le nie pas, à cheval. Par leur appareil militaire et équestre, aussi bien sans doute que par leurs répugnances, les nobles furent amenés naturellement à se ranger en bordure de la foule, comme le constate Michiel. D'autre part, les ministres et Macar lui-même, pour remplir leurs fonctions, devaient se tenir au centre des fidèles : du milieu d'une foule d'environ quatre mille personnes, sans cesse grossissante, comment pouvaient-ils voir ce qui se passait à l'extérieur ? Au surplus, il est permis de supposer que Macar, craignant d'être blâmé par Calvin qui désapprouvait les réunions en armes, a naturellement atténué les choses dans sa lettre. Réduites les exagérations de part et d'autre, le spectacle n'en reste pas moins impressionnant. Une procession de quatre ou cinq mille personnes, entourée de gentilshommes et de cavaliers, chantant des psaumes en français à la mode de Genève et, parmi ces psaumes, le Judicia tua, Domine qui contenait une allusion directe au souverain, défilant le soir sur la promenade du Pré-aux-Clercs et la nuit, à la lumière des torches, dans les rues de la ville même : c'était de quoi émouvoir la populace, les bourgeois et les autorités. A la gravité du fait s'ajoute celle des circonstances, du lieu et du temps. Cette manifestation se produisit dans le quartier et le faubourg de la rive gauche peuplés d'écoliers, de clercs, de moines et de petites gens, sous les murs de l'abbaye Saint-Germain et de la Sorbonne : on comprend que les spectateurs aient trouvé la chose audacieuse et qu'ils aient soulevé une rumeur. De plus, les assemblées protestantes coïncidèrent avec les fêtes des Rogations et de l'Ascension, qui donnaient lieu à des cérémonies et à des processions catholiques, attirant hors de leurs maisons le clergé, les bourgeois et le peuple. Coïncidence voulue, puisque Macar écrivait le 16 mai : Depuis trois jours une grande multitude de personnes de tout genre s'est réunie au Pré-aux-Clercs après souper et a chanté à haute voix en se promenant les psaumes de David, jusqu'au milieu de la ville, comme si la prière des Luthériens répondait aux Rogations que célèbrent en ce moment les papistes[120]. La lettre du ministre réformé précise d'ailleurs nettement la préméditation et la nouveauté du fait : il s'agissait moins d'une cérémonie religieuse que d'une manifestation politique[121]. Enfin, il faut noter une circonstance qui explique l'affluence des gentilshommes et l'inquiétude des autorités : Paris était rempli de soldats et d'officiers faisant leurs préparatifs avant d'aller au siège de Thionville ; le 19 mai, François de Lorraine, Alphonse d'Este, Piero Strozzi et les autres capitaines partirent pour se rendre à l'armée de l'Est[122]. On peut supposer que les pasteurs avaient voulu, entre autres motifs, offrir à ceux de leurs fidèles qui allaient combattre le réconfort d'adieux en commun. Quoi qu'il en soit, les chefs de l'Eglise réformée, dont les intentions pacifiques ne semblent pas douteuses, entraînés par un zèle vraiment naïf et par la griserie du succès, prirent, à l'encontre des instructions de Calvin, une initiative très imprudente qui donnait aux protestants l'allure d'un parti politique. L'ingénuité de ces hommes mystiques apparaît dans l'étonnement et la douleur qu'ils montrèrent, après que des incidents inévitables se furent produits. Le premier soir, 13 mai, il n'y eut pas d'encombre. Mais le lendemain, la nouvelle s'en étant répandue dans la population parisienne, un très grand nombre de personnes, parmi lesquelles des grands seigneurs, vinrent voir ce spectacle singulier. Les témoins assistèrent, stupéfaits, à la procession luthérienne, où se mêlaient des gens si divers, un roy, disait-on, plusieurs ducs, comtes, barons et des dames, tous chantant. Le 15, troisième jour des réunions, l'autorité parisienne donna l'ordre exprès aux gardiens de fermer les portes de la ville à huit heures du soir et d'emporter les clefs. Pris à l'improviste, semble-t-il, par cette mesure, les protestants durent passer la nuit dehors ; les uns se logèrent dans les maisons du faubourg, les autres errèrent à travers les prés. Quand, au matin, on rouvrit les portes, il se présenta plus de dix mille personnes pour rentrer ; il est évident que la clôture avait surpris, non seulement les Luthériens, mais beaucoup de simples promeneurs, qui étaient sortis pour jouir d'une soirée de printemps. Les réunions n'en continuèrent pas moins les jours suivants, avec une assistance de plus en plus nombreuse. Macar, le 16 mai, avouait que la procession s'était grossie de gens, venus de partout, qu'il ne connaissait pas[123]. Cependant, la population, surtout les clercs et les moines, dans le quartier de l'Université et le faubourg Saint-Germain, se montraient indignés. L'évêque de Paris et la Sorbonne se plaignirent avec véhémence au Parlement, réclamant des mesures énergiques. Quelques conseillers, qui inclinaient vers la Réforme, opposèrent à cette demande des observations : il faut prendre garde, dirent-ils, de ne pas provoquer, la nuit, dans la ville, un tumulte sanglant. On passa outre, et, le 18 mai, fut publiée une ordonnance interdisant de chanter en groupe nombreux, à heure intempestive avec des armes. Alors, les ministres protestants, effrayés par la menace de l'autorité et l'excitation des catholiques, sentirent le péril et eurent conscience de leur devoir. Ils s'efforcèrent de persuader à leurs fidèles qu'il convenait de cesser ce rassemblement. Nous préférons périr, écrivait Macar, plutôt que d'exposer l'Evangile à la honte de laisser croire qu'il arme les hommes pour le tumulte. Mais il était trop tard : on n'apaise pas une foule rassemblée depuis six jours, grossie chaque fois d'adhérents nombreux, la plupart inconnus, et vibrant d'une passion collective. Les chefs furent débordés. Dans la soirée du 18 mai, il est vrai, la procession se déroula, silencieuse, sauf quelques voix tardives. Mais le lendemain, fête de l'Ascension et jour de repos, une multitude se joignit aux Luthériens et, l'un poussant l'autre, les chants recommencèrent. C'était violer l'ordonnance. La police intervint ; dans la bagarre, elle dut céder, tandis que la populace ameutée se divisait elle-même en deux camps[124]. Les protestants, malgré eux, se trouvaient par suite de leur imprudence hors la loi. Henri II, qui était à Montceaux-en-Brie avec sa Cour, avait reçu, dès le début de l'affaire, des informations troublantes sur le nombre, l'attitude et les intentions des protestants : on crut, un moment, qu'il s'agissait d'une émeute. Dieu veuille, disait Monluc à l'ambassadeur Alvarotti, que, à la fin, Sa Majesté ne soit pas forcée de réunir presque une armée pour déraciner cette mauvaise semence[125]. On répandait des nouvelles exagérées et tragiques. Ne disait-on pas que les Luthériens dans une rencontre avaient attaqué l'escorte du Dauphin et tué de ses serviteurs[126]. D'ailleurs, à Meaux, non loin du château où résidait la cour, les protestants chantaient également des psaumes en public[127]. Furieux et inquiet, le Roi ne sut d'abord que faire : il était incapable de prendre une résolution en l'absence du cardinal de Lorraine. Ainsi s'explique que les Réformés aient pu se réunir sept jours de suite au Pré-aux-Clercs, dans les conditions que nous avons vues, sans être gênés que par la police parisienne. Lorraine revint à la cour le 18 mai. Le 19, jour de l'Ascension, se produisit la bagarre. Le lendemain, 20, Henri Il donna ordre au cardinal de Sens, primat spirituel du royaume, qui se trouvait à Montceaux, de se rendre à Paris pour faire une enquête et punir sévèrement les coupables[128]. Le même jour, un édit fut publié clans la capitale qui interdisait sous peine de mort l'accès du Pré-aux-Clercs, et des gardes furent mises à toutes les portes de la ville. La police avait opéré déjà quelques arrestations dans la rue ; le 21, un certain nombre d'autres personnes furent appréhendées à leur domicile privé d'une façon secrète[129]. A vrai dire, cette répression, purement individuelle, parut bénigne et craintive ; les pasteurs eux-mêmes ne furent pas inquiétés et s'en étonnèrent. Le gouvernement royal se montra très faible. En pleine guerre extérieure, à la merci des princes, des soldats et des marchands luthériens, informé que de toutes parts l'hérésie pullulait et connaissant le trouble nerveux qui agitait la population parisienne depuis le désastre de Saint-Quentin, Henri II eut peur et n'osa pas sévir avec la cruauté dont il avait usé en d'autres cas. Mais, forcée de céder, sa haine en devint plus vive. Cette étrange affaire montre combien les ministres
protestants étaient mal informés et mal conseillés. Le 22 mai, Macar écrivait
à Calvin ces mots naïfs et douloureux : Nous nous
voyons en danger d'être bientôt traînés au supplice comme séditieux, alors
que nous ne nous étions proposé que d'obéir modestement à Dieu et au Roi[130]. On
s'étonnerait d'une telle bévue si l'on ne savait que les Réformés parisiens
furent guidés, à ce moment, par le roi de Navarre. Les incidents du Pré-aux-Clercs soulevèrent, dans le royaume et à l'étranger, une grosse rumeur. Mais l'opinion publique confondit bientôt ce scandale avec le bruit énorme que produisit à la cour, parmi les nobles et dans tous les palais de l'Europe catholique, l'arrestation de François de Châtillon, sieur d'Andelot, neveu de Montmorency. Rentré à la cour le 18 mai, le cardinal de Lorraine avait informé naturellement Henri II de ce qui s'était passé à Péronne. Justement des rapports de police accusaient François d'Andelot, qui résidait alors à Paris, d'être l'un des promoteurs de la manifestation du Pré-aux-Clercs. Le Roi lui fit porter aussitôt l'ordre de se rendre à Montceaux. D'Andelot, neveu de Montmorency, était le plus jeune de ces trois frères de Châtillon que le Connétable aimait autant que ses propres enfants. Il avait beaucoup souffert : fait prisonnier par les Espagnols, le 17 juillet 1554, au cours de la guerre de Parme, il était resté cinq ans captif à Milan et n'avait obtenu sa libération que le 1er août 4556, après d'infinis pourparlers au sujet de sa rançon[131]. Dans la longue réflexion de cette solitude, son esprit, influencé d'ailleurs par divers contacts et surtout par des lectures, avait adopté les doctrines de la Réforme. Il fut, semble-t-il, le premier hérétique des Châtillons. Revenu en France, il prit rang clans l'armée que son oncle conduisit au désastre de Saint-Quentin : il put échapper par miracle, le 10 août 1557, aux suites de la défaite, après avoir combattu vaillamment. Parmi les circonstances difficiles et dans la pénurie d'hommes auxquelles eut à remédier Henri II pour sauver son royaume, d'Andelot acquit naturellement et par ses qualités une place éminente. Montmorency et Coligny étant prisonniers des Espagnols, il se trouva, dans l'armée, le représentant de son illustre maison en face du duc de Guise. Le Roi lui confia l'intérim de la charge d'Amiral, en l'absence de son frère, et le nomma colonel de l'infanterie française. D'Andelot prit une grande part à la réorganisation des forces militaires, pendant l'hiver et le printemps de 1558. Au demeurant, c'était une nature un peu tendre, sensible et très sympathique : aimé des soldats et surtout des capitaines suisses et allemands, qu'offusquaient la sévérité ou le catholicisme du duc de Guise[132], il exerçait partout une influence personnelle, qui s'ajoutait au prestige de son nom et de ses charges. François était un protestant très sincère et très zélé. Nous savons qu'il adressait à son frère Coligny, prisonnier en Flandre, de pieuses exhortations, dont quelques-unes tombaient aux mains des Espagnols. On peut supposer qu'il répandit ses opinions parmi les gentilshommes de l'armée, dont un si grand nombre devaient bientôt s'avouer réformés. Au début d'avril 1558, d'Andelot était parti de la cour pour aller inspecter, en sa qualité d'Amiral, les côtes et les ports de l'Ouest et mobiliser la flotte contre les entreprises des Anglais[133]. A vrai dire, son voyage fut presque autant une tournée de propagande qu'une inspection militaire. Deux prédicateurs protestants, Carmel et Loiseleur, qui l'accompagnaient, firent des adeptes dans la vallée de la Loire et en Bretagne : même on apprit à la cour que l'un d'eux, prêchant à Angers, avait dit publiquement des choses scandaleuses[134]. Une fois rentré à Paris, d'Andelot assista-t-il aux assemblées du Pré-aux-Clercs ? Il paraît que non, puisque lui-même le nia[135]. En tout cas, des personnes affirmèrent au Roi qu'il s'y trouvait. A ces avis, s'ajouta la révélation que le cardinal de Lorraine apportait de Péronne. Le souverain dut s'émouvoir. François d'Andelot arriva le 19 mai au matin à Montceaux, et se présenta devant son maître[136]. La rencontre fut sans doute pénible pour l'un et l'autre. Henri II, dont l'affection allait chaque jour plus ardente vers Montmorency prisonnier en Flandre, aimait les neveux du Connétable ; il savait, au surplus, ce que d'Andelot avait souffert pour son service. On m'a rapporté, dit-il[137] au jeune colonel, que vous viviez mal et en dehors de la loi de Dieu. J'apprends que vous n'avez pas entendu la messe depuis la prise de Calais et que vous avez recueilli le prêcheur David expulsé de la cour du roi de Navarre. Êtes-vous, enfin, l'auteur de cette nouvelle musique du Pré-aux-Clercs ? D'Andelot répondit qu'on s'était trompé quant à ses rapports avec David et sa participation aux processions de Paris ; pour le reste, il déclara : Votre Majesté sait que je vis bien : ce n'est pas vivre contre le devoir que de chanter des psaumes de David et tenir un prédicateur dans sa maison. Il ajouta très franchement que sa conscience ne lui permettait pas d'assister à la messe : Dans les autres choses je n'ai jamais refusé à mon maître dévouement et respect. Le Roi commença de se fâcher : Le rapport que l'on m'a fait était donc vrai, dit-il. J'ai pourtant la prétention de vivre aussi bien et aussi chrétiennement qu'il est possible, et si je connaissais une voie meilleure que celle que je suis, je l'adopterais. Et comme il me paraît convenable que mes sujets vivent de la même manière que moi, je vous exhorte à le faire vous aussi. D'Andelot défendit une seconde fois ses idées. De nouveau, Henri II le pria de changer d'opinion et de revenir à la foi catholique. Mais, une troisième fois, François commença l'apologie de la Réforme. Alors, le Roi, perdant patience, lui cria : Vous êtes un obstiné ! et il le fit arrêter par ses gardes. Enfermé à l'évêché de Meaux, le prisonnier fut transféré plus tard au château de Melun[138]. De Meaux, aussitôt après son arrestation, il adressa une lettre à sa femme, qui était enceinte, pour la consoler et affirmer sa foi : Il m'est glorieux, écrivait-il, de souffrir pour une cause juste. Cette lettre remplit de joie la communauté protestante de Paris[139]. Examinées de près, les circonstances et les suites de
cette arrestation paraissent assez complexes. D'abord, la nouveauté du fait
comportait une gravité qui n'échappa à l'attention de personne. C'était la
première fois que Henri II, pour cause de religion, frappait un capitaine. La
noblesse de France jouissait encore au XVIe siècle, vis-à-vis du souverain,
d'une indépendance presque légale à laquelle il faut prendre garde : le
gentilhomme est toujours un vassal plu tôt qu'un sujet. A ceux qui lui reprochaient
sa faiblesse pendant les guerres civiles, Catherine de Médicis fit, un jour,
une réponse très juste : On ne peut pas gouverner la
France comme un petit État de l'Italie. Ce royaume est composé d'une grande
noblesse, qui a l'habitude de vivre très librement et sous des lois qu'il
n'est pas facile de changer[140]. Jusqu'à
l'arrestation de d'Andelot, on n'avait guère inquiété, pour cause d'hérésie,
que les personnes du peuple. Et, comme coup
d'essai, le Roi frappait un membre de cette illustre maison de Montmorency,
pure race de terroir, qui était le vrai chef
de la noblesse nationale ! D'instinct, les gentilshommes eurent un geste
de défense et de rébellion. Le 25 mai, Macar écrivait cette phrase si
nouvelle, si grave, où résonne déjà un bruit de guerre civile : Fremunt multi duces et milites et minantur se non
pugnaturos[141]. A l'émotion
des capitaines français s'ajoutait celle des soldats luthériens qui servaient
le Roi. Jusqu'alors dans les camps tous avaient joui de la liberté de
religion et de culte : allait-on leur interdire de vivre selon leur foi ?
Français, Allemands et Suisses, les vétérans des grandes guerres de
magnificence n'avaient pas le cœur aussi résigné que l'humble clientèle des
prêches urbains : de nature, d'origine, d'éducation et de métier, ils étaient
ombrageux, libres, ne connaissant d'autre frein que la discipline militaire ;
dans cette discipline n'entrait pas la soumission aux théologiens. Tous les
hommes portant l'épée, même les plus catholiques, se sentirent à ce moment
comme solidaires. Blaise de Monluc, à qui le Roi offrit la charge de colonel
de l'infanterie que possédait d'Andelot, refusa d'abord de l'accepter en aucune façon : il ne la prit finalement que pour
obéir et pendant l'absence du prisonnier[142]. L'arrestation
de d'Andelot fit paraître les signes avant-coureurs de la Réforme militante. Henri II lui-même se repentit de son acte. Il avait frappé dans un mouvement de colère et, semble-t-il, sans préméditation. Après coup, il éprouva de la peine, non certes pour avoir puni un hérétique, mais pour avoir blessé son père, son premier conseiller, qui souffrait dans une prison de Flandre. Le péché de d'Andelot, rendu public par le châtiment, devenait une tache sur l'honneur des Montmorency, à l'heure même où le Connétable ne pouvait défendre les siens. Nous verrons quelle rancune féroce Montmorency mettra dans sa vengeance contre les Guises qui avaient osé accuser son neveu. Le Roi, qui se détachait intimement des Lorrains chaque jour davantage et qui regrettait de n'avoir pas suivi jadis, après la trêve de Vaucelles, les conseils de son premier ministre, eut à cœur de consoler le vieillard. Il lui écrivit ce mot que nous avons déjà cité : Touchant Andelot, ne vous an fachés poynt, car tout ira bien[143]. Au surplus, il est remarquable que, sauf quelques confidents des Guises, personne, — et pas même l'accusé, — ne connut la vraie cause de l'arrestation de François de Châtillon. Le Roi, qui connaissait depuis longtemps, comme toute la cour, les tendances luthériennes du jeune capitaine, n'eût certainement pas frappé, s'il n'eût été affolé par la révélation de Péronne. Et la preuve, c'est que d'Andelot obtint sa liberté après qu'on eut reconnu le mensonge des Espagnols. Mais cette révélation, si lourde pour l'honneur des Montmorency, resta cachée, sans doute par la volonté de Henri II. Dans ces circonstances, il est facile d'expliquer la rétractation du prisonnier. D'Andelot, qui avait tenu devant la colère du Roi, ne résista pas longtemps à l'affection de son maître. Tout de suite, on voulut arranger l'affaire et obtenir du capitaine une adhésion plus ou moins explicite à la foi romaine. Sa femme enceinte mit bientôt au monde une fillette : par ce moyen on essaya d'attendrir le coupable. Soutenu par les exhortations de la communauté protestante, il resta ferme pendant tout le mois de juin[144]. Mais plus que de toute autre peine, ce soldat, énervé par les bruits lointains de la guerre, souffrait de ne pas combattre ; la rumeur glorieuse qui venait du siège de Thionville l'ébranlait dans sa prison : il se plaignait d'avoir cédé à d'autres, à Guise, l'honneur de la victoire qui lui était dû[145]. Au début de juillet, il adressait au Roi une humble supplique, demandant d'aller servir en cette guerre[146]. On sut alors la vérité sur l'odieux mensonge des Espagnols à Péronne. Un théologien, Ruzé, docteur en Sorbonne et confesseur de Henri II, vint visiter le prisonnier : pendant deux jours, quatre ou cinq bonnes heures, il s'efforça de le convertir[147]. D'ailleurs, le cardinal de Châtillon travaillait pour son frère. Finalement, le 7 juillet, on tira de celui-ci une déclaration ambiguë : Je serois bien marry que ma foy et religion fust telle comme peult-estre aulcuns ont voulu penser[148]. Mieux traité dès les premiers jours de juillet, d'Andelot fut libéré à la fin du mois[149]. On publia qu'il avait renoncé à ses erreurs. Lui-même éprouva du remords d'avoir faibli. Entre les instances de son frère et de sa femme qui le suppliaient de ne pas ruiner sa famille, et les douloureuses remontrances des Réformés, il souffrit cruellement[150]. D'Andelot, écrivait Macar à Calvin, cherche le moyen de satisfaire au monde et de ne pas déplaire à Dieu. Dans la matinée du 29 septembre 1558, au camp d'Amiens, eut lieu l'assemblée des chevaliers de Saint-Michel. Après la dégradation d'Octave Farnèse et de Paolo Giordano Orsini, le cardinal de Lorraine, chancelier de l'Ordre, prononça les paroles suivantes : Personne ne peut recevoir ni porter les insignes de cet ordre s'il n'est complètement chrétien et catholique. Peut-être quelqu'un s'étonnera-t-il que Monsieur d'Andelot en soit encore revêtu, après qu'il est tombé dans l'erreur. Sachez donc que deux confesseurs, qui ont reçu sa confession, ont fait foi qu'il était revenu à sa première religion, en acceptant la messe, la confession et en somme la vraie conduite chrétienne et catholique. C'est pourquoi Sa Majesté lui a laissé et lui laisse les insignes de l'Ordre et lui restitue ses États[151]. L'indulgence de Henri II à l'égard du neveu de Montmorency
ne doit pas tromper. La haine du Roi contre les dissidents en devint plus
implacable et plus meurtrière. Au lendemain de l'affaire du Pré-aux-Clercs et
de l'arrestation de d'Andelot, ce souverain de nature timide avait prononcé
un horrible serment : Je jure que si je peux régler
mes affaires extérieures, je ferai courir par les rues le sang et les têtes
de cette infâme canaille luthérienne ![152] Une fureur
sanglante l'avait envahi ; elle augmenta chaque jour davantage par un
mouvement personnel de ce caractère entier et rigide. Encore une fois, il
faut se garder d'attribuer aux Guises toute la responsabilité du fait : le
cardinal de Lorraine dirige le mécanisme du gouvernement, mais, dès l'été de
1558, la confiance intime du Roi lui échappe pour retourner, entière, vers
Montmorency prisonnier. Une seule personne de la cour agit alors sur la
pensée de Henri II, c'est Diane de Poitiers[153]. Autant que de
haine, le Roi fut pris de peur. Devant les armées espagnoles, il ne pouvait
songer à bouleverser son État pour détruire la secte.
Un éclair terrifiant lui avait révélé la diffusion de l'hérésie et montré
combien d'épées pouvaient au besoin défendre les dissidents. Il connaissait
aussi la misère financière, économique et sociale de son royaume. Sa volonté
se trouvait barrée par les circonstances. Dès lors il arrêta sa résolution
ajourner la répression, mais conclure la paix à tout prix, sauf l'honneur,
pour mieux châtier ensuite la canaille luthérienne.
Les protestants eurent une vision très précise de l'avenir. Macar écrivait à
Calvin le 17 août 1558 : Si le Roi fait la paix avec
son ennemi, et il la fera à n'importe quelle condition, il tournera toute sa
fureur contre nous : lui-même aujourd'hui ne s'en cache pas. Et un peu
plus tard : Si le Roi obtient la paix, il engagera,
comme il l'affirme, toute son âme et tous ses biens dans une guerre contre
les Luthériens pour détruire jusqu'à la racine et leur race et leur nom[154]. Dans cette
trêve forcée qu'il concédait aux protestants, Henri II mit quelque ruse. Il
se garda de provoquer les nobles et de renouveler la faute qu'il avait
commise en arrêtant d'Andelot. D'ailleurs, le chef politique de la Réforme
française, Antoine de Bourbon, s'offrait comme un jouet : ce triste bonhomme
courait le cotillon, au lieu de défendre la cause qu'il avait compromise.
Quelques jours après l'affaire du Pré-aux-Clercs, Henri II lui demanda en
riant s'il n'était pas vrai qu'il avait pris part aux processions
luthériennes : le roi de Navarre répondit qu'il y était allé comme les autres, pour voir, et il fit de grandes
bravades menaçant de ses représailles quiconque l'accuserait[155]. On amusa cet
enfant par des faveurs. Le 25 mai 1558, des lettres patentes accordaient à
Antoine le produit des amendes et confiscations dans les pays de Guyenne,
Angoumois, Poitou, ville et gouvernement de La Rochelle, — les provinces où
il y avait le plus de protestants[156] ! Puis, comme
sa petite ambition rêvait toujours de conquérir la Navarre espagnole, le
gouvernement parut s'intéresser à ces projets. Antoine fit de grandes
provisions d'armes et de deniers et partit de la cour au mois de juin[157]. Naturellement
son entreprise échoua. Il revint à Paris le 25 juillet, rappelé par le Roi
qui avait besoin de sa compagnie d'ordonnances[158]. Quelques jours
après, il se rendit à l'armée de Picardie. Henri II le surveilla d'assez près.
Au camp d'Amiens, vers le 15 septembre, éclata un incident. Deux soldats de
la compagnie du prince de Salerne, accusés de meurtre, s'étaient réfugiés au
quartier d'Antoine de Bourbon. Celui-ci, quand le prévôt de justice vint pour
les arrêter, s'y opposa : Je veux être respecté
comme un roi ! s'écria-t-il, ajoutant ces paroles très graves : Je me ferai respecter, dût-il en coûter la vie à mes cent
gentilshommes. Je sais bien qu'on raconte à Sa Majesté des choses pour me
nuire. Henri II, informé, lui fit porter l'ordre de ne pas se conduire de cette façon, sans quoi il
enverrait deux mille soldats pour mettre en pièces ses cent gentilshommes et
tout autre qui voudrait prendre sa défense[159]. C'est quelque
temps après que le duc de Saxe, qui servait dans l'armée royale, refusa le
collier de Saint-Michel qu'on lui offrait, de peur d'être obligé d'entendre
la messe[160]. Le Très-Chrétien prenait patience, espérant la paix. L'échec des conférences de Péronne avait montré aux Espagnols que le seul moyen de gagner était de faire agir les prisonniers de guerre. Au début de juin 1558, ils envoyèrent en France le maréchal de Saint-André. Celui-ci, après plus de deux mois, vers le 15 août, repartit, emportant l'adhésion de son maître et de quoi mectre en avant partiz si raisonnables que les deux Majestéz auroient occasion de se contenter et demeurer en bonne amitié[161]. Il vit le Connétable à Audenarde et le prince d'Orange à l'abbaye de Marchiennes : on fixa des conférences à Lille. Pendant le mois de septembre, les Espagnols, en des entretiens avec les deux prisonniers, purent tirer au clair toutes les faiblesses du roi de France[162]. Dès lors, la situation morale des adversaires est fixée. D'un côté, les Espagnols. Ayant obtenu que les négociations se traitent par les prisonniers, ils tiennent un avantage écrasant qu'ils vont exploiter de toutes manières. Le 1er septembre, dans le conseil de Philippe II, Granvelle, maître de ses moyens, avait défini la ligne à suivre : cela se réduisait à l'insolence et au chantage[163]. Le ministre comtois, bien mieux armé que les généraux espagnols, déploie la force astucieuse de sa diplomatie. En face d'un tel partenaire, les Français : ils offrent un front tout divisé. Au premier plan, deux négociateurs, Montmorency et Saint-André, qui sont plutôt des otages : le premier, homme de bon sens et d'expérience, et d'ailleurs profondément dévoué à son maître, perd toutes ces qualités par sa haine furieuse et sénile contre les Guises ; le second n'a qu'un désir, rentrer à la cour pour y reprendre son poste de favori. Henri II lui-même est déjà détaché de la politique extérieure : il ne voit plus que l'hérésie menaçante, la misère de ses sujets, la ruine de son trésor. Seule, la maison de Lorraine garde ses vigoureuses ambitions et le goût de l'aventure : le chef, François, a donné à ce règne toutes ses victoires, il entend ne pas les laisser perdre, sachant bien, d'ailleurs, que la paix paralysera sa famille qui n'est point apte à la politique bourgeoise. A cette heure, les Guises, par la nature même de leur race et de leur génie, oublient tout souci religieux pour défendre la guerre : ils ne peuvent vivre que des armes. Mais sur l'esprit du Roi leur influence est nulle. Une fois la partie perdue, ils retrouveront clans les discordes religieuses une occasion de combattre. Dans toute l'Europe, les esprits inquiets demandent la paix pour sauver la foi romaine[164]. A l'année 1558 commence vraiment la période des guerres de religion. Peu importe la gravité relative des incidents. Dès lors, le Roi a fait son choix ; au problème, posé soudain devant lui, il a donné une solution qui emporte des conséquences fatales. Ce problème domine toute l'histoire de France au XVIe siècle : le reste n'est qu'anecdote. Depuis l'avènement de François Pr, deux grandes rivalités existaient en Europe : celle de la maison d'Autriche et de la maison de France, celle de l'Eglise romaine et de la Réforme protestante. Il était naturel que ces deux conflits tendissent à se mêler. Charles-Quint par les événements et par sa nature put choisit', le premier : comme la Réforme s'était développée d'abord sur ses États, il prit parti contre elle avant tout autre et devint ainsi le représentant politique de l'orthodoxie. Cette position une fois acquise, il ne la quitta plus : les intérêts de sa monarchie aussi bien que son génie obstiné donnèrent à la politique espagnole une cohérence presque absolue, qui devait résister à tous les accidents du XVIe siècle par la force surprenante de ses principes. Devant la maison d'Autriche foncièrement anti-française et antiprotestante, la politique des Valois subit une évolution contraire, évolution commandée par les besoins de son existence même : de fait, jusqu'à l'année 1557, les rois de France combattent l'Espagne et soutiennent les protestants. Les politiques extérieures des deux dynasties s'opposent complètement et partant s'équilibrent. Mais à la politique française manquaient la cohérence intime et la solidité des principes ; son attitude n'était qu'un expédient. De là vint sa défaite. D'ailleurs, le développement tardif du protestantisme en France favorisa [insouciance des rois : ils jouèrent avec le feu sans prendre garde au danger, qui n'était pas apparent, jusqu'au jour où la Réforme, profitant des conditions économiques et militaires, gagna le tiers, la moitié du royaume. Alors, en 1558, Henri II vit le conflit qui existait depuis longtemps entre la tradition religieuse de son gouvernement et sa tradition politique. Un dilemme impérieux se posait : ou bien la royauté deviendrait protestante pour continuer une lutte assurément victorieuse contre la monarchie espagnole et catholique, ou bien elle céderait devant sa rivale pour sauver sa propre orthodoxie. Un an après le désastre de Saint-Quentin, Henri II était décidé à sacrifier sa politique et ses conquêtes à sa foi. Ce sacrifice ne fut ni sans grandeur ni sans mérite. Mais il entraînait des suites inévitables : à l'extérieur, la soumission à l'Espagne et, à l'intérieur, la guerre civile. Dans la chronique sanglante du temps des troubles, ce conflit entre la tradition politique et la tradition religieuse du gouvernement français restera le problème essentiel. Catherine de Médicis et Coligny se trouveront un jour face à face, dans une occasion décisive, représentants des deux systèmes ; et Coligny sera vaincu par un assassinat. Il serait vain de juger des hommes qui produisirent les événements sans se douter de leurs conséquences. Privés de vrais chefs l'un et l'autre, au début, le parti catholique et le parti protestant se sont heurtés par une fatalité purement matérielle : la tolérance mutuelle de deux confessions ne peut exister que dans une société fatiguée, où il y a un tiers parti de sceptiques. En 1558, aucun des deux camps ne voulait reculer ou rester immobile. La royauté seule pouvait donner l'avantage à l'un ou l'autre des adversaires, car leurs forces paraissent à peu près égales, si l'on ne tient compte que des militants. Les catholiques le comprirent de bonne heure. Toute leur politique, jusqu'à la fin des troubles, se réduit en somme à ce principe : garder le Roi et partant les moyens légaux. Les protestants, ce semble, ne virent que très tard qu'il importait de conquérir la personne du souverain. Et même, lorsque, pendant les guerres de religion, ils tentèrent d'enlever la cour, ce fut une manœuvre de guerre plutôt qu'un projet réfléchi. Pour expliquer cette faiblesse dans la conduite des dissidents, il faut observer les origines de la Réforme française : ces origines furent d'ordre religieux, intellectuel, économique, mais nullement d'ordre politique. Il est très remarquable que les protestants français, même après que la noblesse eut envahi leurs prêches, ne présentèrent jamais au gouvernement que des revendications religieuses ou cultuelles, si différentes de celles que soutenaient, par exemple, les Huguenots des Pays-Bas. Aux moyens du catholicisme, qui était alors un corps presque purement politique, le calvinisme français ne sut opposer qu'une résistance confessionnelle ou militaire : mi programme, au fonds, tout négatif. Seul, parmi les chefs huguenots, Coligny eut l'intuition large et pénétrante du rôle politique que devait jouer son parti. Mais, longtemps gêné par les Bourbons et surtout par Condé, il arriva trop tard. Il fit sur le roi Charles IX, en 1572, une expérience qui, tentée plus tôt, eût peut-être changé la fortune. On sait qu'elle aboutit à la Saint-Barthélemy. Le 13 juillet 1558, à Villers-Cotterêts où se trouvait la cour, arriva un héraut de Charles-Quint. Henri II, assisté des cardinaux et des chevaliers de Saint-Michel, le reçut dans la grande salle du château. Sire, dit le héraut, Charles d'Autriche, autrefois empereur, après s'être recommandé à votre bonne grâce, vous renvoie et restitue l'Ordre dont le Roi votre prédécesseur lui avait donné les insignes : il le fait pour le seul motif qu'il s'est dépouillé de tous les titres et honneurs de ce monde et qu'il veut consacrer le peu de temps qui lui reste à la vie religieuse[165]. Charles-Quint, génie réaliste jusque dans le renoncement, n'avait point voulu que la monarchie espagnole souffrît de sa conversion : il avait laissé son fils pour continuer sur le trône les péchés que lui-même allait expier à Yuste. Par l'abdication, il avait mis d'accord sa conscience et sa politique. Henri II, nature généreuse et entière, agit de manière plus logique : il porta ses scrupules religieux dans sa fonction publique, et, puisqu'il s'agissait de sacrifice, c'est le royaume qui le paya. |