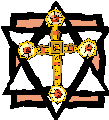MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XXXI - Raisons de la victoire du Christianisme.
|
C'EST par la nouvelle discipline de la vie qu'il
introduisait dans le monde que le christianisme a vaincu. Le monde avait
besoin d'une réforme morale ; la philosophie ne la donnait pas : les
religions établies, dans les pays grecs et latins, étaient frappées
d'incapacité pour l'amélioration des hommes. Entre toutes les institutions
religieuses du monde antique, le judaïsme seul éleva contre la corruption des
temps un cri de désespoir. Gloire éternelle et unique, qui doit faire oublier
bien des folies et des violences ! Les juifs sont les révolutionnaires du Ier
et du IIe siècle de notre ère. Respect à leur fièvre ! Possédés d'un haut
idéal de justice, convaincus que cet idéal doit se réaliser sur cette terre,
n'admettant pas ces atermoiements dont se contentent si facilement ceux qui
croient au paradis et à l'enfer, ils ont la soif du bien, et ils le
conçoivent sous la forme d'une petite vie synagogale, dont la vie chrétienne
n'est que la transformation ascétique. Des groupes peu nombreux d'humbles et
pieuses gens, menant entre eux une vie pure et attendant ensemble le grand
jour qui sera leur triomphe et inaugurera sur la terre le règne des saints,
voilà le christianisme naissant. Le bonheur dont on jouissait dans ces petits
cénacles devint une puissante attraction. Les populations se précipitèrent,
par une sorte de mouvement instinctif, dans une secte qui satisfaisait leurs
aspirations les plus intimes et ouvrait des espérances infinies. Les
exigences intellectuelles du temps étaient très faibles ; les besoins tendres
du coeur étaient très impérieux. Les esprits ne s'éclairaient pas, mais les moeurs
s'adoucissaient. On voulait une religion qui enseignât la piété, des mythes
qui offrissent de bons exemples, susceptibles d'être imités, une sorte de
morale en action, fournie par les dieux. On voulait une religion honnête ; or
le paganisme ne l'était pas. La prédication morale suppose le déisme ou le
monothéisme ; le polythéisme n'a jamais été un culte moralisateur. On voulait
surtout des assurances pour une vie ultérieure où fussent réparées les
injustices de celle-ci. La religion qui promet l'immortalité et assure qu'on
reverra un jour ceux qu'on a aimés l'emporte toujours. Ceux qui n'ont pas d'espérance
sont bien vite vaincus. Une foule de confréries, où ces croyances consolantes
étaient professées, attiraient de nombreux adeptes. Tels étaient les mystères
sabaziens et orphiques, en Macédoine ; en Thrace, les mystères de Dionysos.
Vers le IIe siècle, les symboles de Psyché prennent un sens funéraire et
deviennent une petite religion d'immortalité, que les chrétiens adoptent avec
empressement. Les idées sur l'autre vie, hélas ! comme tout ce qui est
affaire de goût et de sentiment, sont ce qui subit le plus facilement les
caprices de la mode. Les images qui, à cet égard, ont un moment contenté
notre soif passent bien vite ; en fait de rêves d'outre-tombe, on veut
toujours du nouveau ; car rien ne supporte longtemps l'examen. La religion établie ne donnait donc aucune satisfaction
aux besoins profonds du siècle. Le dieu antique n'est ni bon ni mauvais ;
c'est une force. Avec le temps, les aventures que l'on contait de ces
prétendues divinités étaient devenues immorales. Le culte aboutissait à
l'idolâtrie la plus grossière, parfois la plus ridicule. Il n'était pas rare que
des philosophes, en public, se livrassent à des attaques contre la religion
officielle, et cela aux applaudissements de leurs auditeurs. Le gouvernement,
en voulant s'en mêler, ne fit que tout abaisser. Les divinités de Quant aux divinités locales, elles se sauvèrent par le
culte des dieux Lares. Auguste avait introduit dans la religion un changement
des plus considérables en relevant et en réglant le culte des dieux Lares,
surtout des Lares de carrefour, et en permettant d'adjoindre aux deux Lares
consacrés par l'usage un troisième Lare, le Génie de l'empereur. Les Lares
gagnèrent à cette association l'épithète d'augustes (Lares augusti) et, comme les
dieux locaux durent pour la plupart leur maintien légal à leur titre de
Lares, presque tous furent aussi qualifiés d'augustes (numina augusta). Autour de ce
culte complexe, un clergé se forma, composé du flamine, sorte d'archevêque
représentant l'état, et des sévirs augustaux,
corporations d'ouvriers et de petits bourgeois, particulièrement attachées
aux Lares ou divinités locales. Mais le Génie de l'empereur écrasa
naturellement ses voisins ; la vraie religion de l'état fut le culte de Rome,
de l'empereur et de l'administration. Les Lares restèrent de très petits
personnages. Jéhovah, le seul dieu local qui résista obstinément à l'association
auguste, et qu'il fut impossible de transformer en un innocent fétiche de
carrefour, tua et la divinité d'Auguste et tous les autres dieux qui se
prêtèrent si facilement à devenir les parèdres de la tyrannie. La lutte dès
lors fut établie entre le judaïsme et le culte bizarrement amalgamé que Rome
prétendait imposer. Rome échouera en ce point, Rome donnera au monde le
gouvernement, la civilisation, le droit, l'art d'administrer ; mais elle ne
lui donnera pas la religion. La religion qui se répandra, en apparence malgré
Rome, en réalité grâce à elle, ne sera en rien la religion du Latium ou la
religion bâclée par Auguste ; ce sera la religion que tant de fois Rome avait
cru détruire, la religion de Jéhovah. Nous avons assisté aux nobles efforts
de la philosophie pour répondre aux exigences des âmes que la religion ne
satisfaisait plus. La philosophie avait tout vu, tout exprimé en un langage
exquis ; mais il fallait que cela se dît sous forme populaire, c'est-à-dire
religieuse. Les mouvements religieux ne se font que par des prêtres. La philosophie avait trop raison. La récompense qu'elle
offrait n'était pas assez tangible. Le pauvre, la personne sans instruction,
qui ne pouvaient approcher d'elle, étaient en réalité sans religion, sans
espérance. L'homme est né si médiocre, qu'il n'est bon que quand il rêve. Il
lui faut des illusions pour qu'il fasse ce qu'il devrait faire par amour du
bien. Cet esclave a besoin de crainte et de mensonges pour accomplir son
devoir. On n'obtient des sacrifices de la masse qu'en lui promettant qu'elle
sera payée de retour. L'abnégation du chrétien n'est, après tout, qu'un
calcul habile, un placement en vue du royaume de Dieu. La raison aura toujours peu de martyrs. On ne se dévoue
que pour ce qu'on croit ; or ce qu'on croit, c'est l'incertain, l'irrationnel
; on subit le raisonnable, on ne le croit pas. Voilà pourquoi la raison ne
pousse pas à l'action ; elle pousse plutôt à l'abstention. Aucune grande
révolution ne se produit dans l'humanité sans idées très arrêtées, sans préjugés,
sans dogmatisme. On n'est fort qu'à la condition de se tromper avec tout le
monde. Le stoïcisme, d'ailleurs, impliquait une erreur qui lui nuisit
beaucoup devant le peuple. à ses yeux, la vertu et le sentiment moral étaient
identiques. Le christianisme distingue ces deux choses. Jésus aime l'enfant
prodigue, la courtisane, âmes bonnes au fond, quoique pécheresses. Pour les
stoïciens, tous les péchés sont égaux ; le péché est irrémissible. Le
christianisme a des pardons pour tous les crimes. Plus on a péché, plus on
lui appartient. Constantin se fera chrétien parce qu'il croit que les
chrétiens seuls ont des expiations pour le meurtre d'un fils par son père. Le
succès qu'eurent, à partir du IIe siècle, les hideux tauroboles, d'où l'on
sortait couvert de sang, prouvent combien l'imagination du temps était
acharnée à trouver les moyens d'apaiser des dieux supposés irrités. Le
taurobole est, entre tous les rites païens, celui dont les chrétiens
redoutent le plus la concurrence ; il fut en quelque sorte le dernier effort
du paganisme expirant contre le mérite chaque jour plus triomphant du sang de
Jésus. On avait pu espérer un moment que les confréries de cultores deorum
donneraient au peuple l'aliment religieux dont il avait besoin. Le IIe siècle
vit leur éclat et leur décadence. Le caractère religieux s'y effaça peu à
peu. Dans certains pays, elles perdirent même leur destination funéraire et
devinrent des tontines, des caisses d'assurance et de retraite, des
associations de secours mutuels. Seuls, les collèges voués au culte des dieux
orientaux (pastophores, isiastes, dendrophores, religieux de Il est si doux de s'envisager comme une petite
aristocratie de la vérité, de croire que l'on possède, avec un groupe de
privilégiés, le trésor du bien ! L'orgueil y trouve sa part ; le juif, le
métuali de Syrie, humiliés, honnis de tous, sont au fond impertinents, dédaigneux
; aucun affront ne les atteint ; ils sont si fiers entre eux d'être le peuple
d'élite ! De nos jours, telle misérable association de spirites donne plus de
consolation à ses membres que la saine philosophie ; une foule de gens
trouvent le bonheur dans ces chimères, y attachent leur vie morale. à son
jour, l’abracadabra a procuré des jouissances religieuses, et, avec un peu de
bonne volonté, on y a pu trouver une sublime théologie. Le culte d'Isis eut ses entrées régulières en Grèce dès le
IVe siècle avant Jésus-Christ. Tout le monde grec et romain en fut à la
lettre envahi. Ce culte, tel que nous le voyons représenté dans les peintures
de Pompéi et d'Herculanum, avec ses prêtres tonsurés et imberbes, vêtus d'une
sorte d'aube, ressemblait fort à nos offices ; chaque matin, le sistre, comme
la cloche de nos paroisses, appelait les dévots à une sorte de messe
accompagnée de prône, de prières pour l'empereur et l'empire, d'aspersions
d'eau du Nil, d'Ite missa est. Le soir, avait lieu le salut ; on souhaitait
le bonsoir à la déesse ; on lui baisait les pieds. Il y avait des pompes
bizarres, des processions burlesques dans les rues, où les confrères
portaient leurs dieux sur leurs épaules. D'autres fois, ils mendiaient en un
accoutrement exotique, qui faisait rire les vrais Romains. Cela ressemblait
assez aux confréries de pénitents des pays méridionaux. Les isiastes avaient
la tête rasée ; ils étaient vêtus d'une tunique de lin, où ils voulaient être
ensevelis. Il s'y joignait des miracles en petit comité, des sermons, des
prises d'habit, des prières ardentes, des baptêmes, des confessions, des
pénitences sanglantes. Après l'initiation, on éprouvait une vive dévotion,
comme celle du Moyen âge envers Osiris, Sérapis, Anubis partagèrent la faveur d'Isis.
Sérapis, en particulier, identifié avec Jupiter, devint un des noms divins
qu'affectionnèrent le plus ceux qui aspiraient à un certain monothéisme et
surtout à des relations intimes avec le ciel. Le dieu égyptien a la présence
réelle ; on le voit sans cesse ; il se communique par des songes, par des
apparitions continues ; la religion entendue de la sorte est un perpétuel
baiser sacré entre le fidèle et sa divinité. C'étaient surtout les femmes qui
se portaient vers ces cultes étrangers. Le culte national les laissait
froides. Les courtisanes, notamment, étaient presque toutes dévotes à Isis et
à Sérapis ; les temples d'Isis passaient pour des lieux de rendez-vous
amoureux. Les idoles de ces sortes de chapelles étaient parées comme des
madones. Les femmes avaient une part au ministère ; elles portaient des
titres sacrés. Tout inspirait la dévotion et contribuait à l'excitation des
sens : pleurs, chants passionnés, danses au son de la flûte, représentations
commémoratives de la mort et de la résurrection d'un dieu. La discipline
morale, sans être sérieuse, en avait les apparences. Il y avait des jeûnes,
des austérités, des jours de continence. Ovide et Tibulle se plaignent du
tort que ces féries font à leurs plaisirs, d'un ton qui montre bien que la
déesse ne demandait à ces belles dévotes que des mortifications bien
limitées. Une foule d'autres dieux étaient accueillis sans
opposition, avec bienveillance même. Ses ressemblances avec le christianisme étaient si
frappantes, que saint Justin et Tertullien y voient un plagiat satanique. Le
mithriacisme avait le baptême, l'eucharistie, les agapes, la pénitence, les
expiations, les onctions. Ses chapelles ressemblaient fort à de petites
églises. Il créait un lien de fraternité entre les initiés. Nous l'avons dit
vingt fois, c'était là le grand besoin du temps. On voulait des congrégations
où l'on pût s'aimer, se soutenir, s'observer les uns les autres, des
confréries offrant un champ clos (car l'homme n'est pas parfait) à toute
sorte de petites poursuites vaniteuses, au développement inoffensif
d'enfantines ambitions de synagogues. à beaucoup d'autres égards, le
mithriacisme ressemblait à la franc-maçonnerie. Il y avait des grades, des
ordres d'initiation, portant des noms bizarres, des épreuves successives, un
jeûne de cinquante jours, des terreurs, des flagellations. Une vive piété se
développait à la suite de ces exercices. On croyait à l'immortalité des
initiés, à un paradis pour les âmes pures. Le mystère de la coupe, si
ressemblant à Les mystères étaient la forme ordinaire de ces cultes
exotiques et la cause principale de leurs succès. L'impression que laissaient
les initiations était très profonde, de même que la franc-maçonnerie de nos
jours, bien que tout à fait creuse, sert d'aliment à beaucoup d'âmes. C'était
une sorte de première communion : un jour, on avait été un être pur,
privilégié, présenté au public pieux comme un bienheureux, comme un saint,
couronne en tête, cierge à la main. Des spectacles étranges, des apparitions
de poupées gigantesques, des alternatives de lumière et de ténèbres, des
visions de l'autre vie que l'on croyait réelles, inspiraient une ferveur de
dévotion dont le souvenir ne s'effaçait plus. Il s'y mêlait plus d'un
sentiment équivoque et dont les mauvaises moeurs de l'antiquité abusaient.
Comme dans les confréries catholiques, on se croyait lié par un serment ; on
y tenait, même quand on n'y croyait guère ; car s'y attachait l'idée d'une
faveur spéciale, d'un caractère qui vous séparait du vulgaire. Tous ces
cultes orientaux disposaient de plus d'argent que ceux de l'Occident. Les
prêtres y avaient plus d'importance que dans le culte latin ; ils formaient
un clergé, avec des ordres divers, une milice sainte, retirée du monde, ayant
ses règles. Ces prêtres avaient un air grave et, comme on dirait maintenant,
ecclésiastique ; ils avaient la tonsure, des mitres, un costume à part. Une religion fondée, comme celle d'Apollonius de Tyane,
sur la croyance au voyage d'un Dieu sur la terre avait des chances
particulières de succès. L'humanité cherche l'idéal ; mais elle veut que
l'idéal soit une personne ; elle n'aime pas une abstraction. Un homme
incarnation de l'idéal, et dont la biographie pût servir de cadre à toutes
les aspirations du temps, voilà ce que demandait l'opinion religieuse.
L'évangile d'Apollonius de Tyane n'eut qu'un demi-succès ; celui de Jésus
réussit complètement. Les besoins d'imagination et de coeur qui travaillaient
les populations étaient justement ceux auxquels le christianisme donnait une
pleine satisfaction. Les objections que présente la croyance chrétienne à des
esprits amenés par la culture rationnelle à l'impossibilité d'admettre le surnaturel
n'existaient pas alors. En général, il est plus difficile d'empêcher l'homme
de croire que de le faire croire. Jamais siècle, d'ailleurs, ne fut plus
crédule que le IIe siècle. Tout le monde admettait les miracles les plus
absurdes ; la mythologie courante, ayant perdu son sens primitif, atteignait
les dernières limites de l'ineptie. La somme de sacrifices que le
christianisme demandait à la raison était moindre que celle que supposait le
paganisme. Se convertir au christianisme n'était donc pas un acte de
crédulité ; c'était presque un acte de bon sens relatif. Même au point de vue
du rationaliste, le christianisme pouvait être envisagé comme un progrès ; ce
fut l'homme religieusement éclairé qui l'adopta. Le fidèle aux anciens dieux
fut le paganus, le paysan, toujours
réfractaire au progrès, en arrière de son siècle ; comme un jour, au XXe
siècle peut-être, les derniers chrétiens seront à leur tour appelés pagani, des ruraux. Sur deux points essentiels, le culte des idoles et les
sacrifices sanglants, le christianisme répondait aux idées les plus avancées
du temps, comme l'on dirait aujourd'hui, et faisait une sorte de jonction
avec le stoïcisme. L'absence d'images, qui valait au culte chrétien, de la
part du peuple, l'accusation d'athéisme, plaisait aux bons esprits, révoltés
par l'idolâtrie officielle. Les sacrifices sanglants impliquaient aussi les
idées les plus offensantes pour la divinité. Les esséniens, les elkasaïtes,
les ébionites, les chrétiens de toute secte, héritiers en cela des anciens prophètes,
eurent sur ce point un admirable sentiment du progrès. La chair se vit exclue
même du festin pascal. Ainsi fut fondé le culte pur. Le côté inférieur de la
religion, ce sont les pratiques qui sont censées opérer d'elles-mêmes. Jésus,
par le rôle qu'on lui a prêté, sinon par son fait personnel, a marqué la fin
des pratiques. Pourquoi parler de sacrifices ? Celui de Jésus vaut tous les
autres. De pâque ? Jésus est le vrai agneau pascal. De Le christianisme avait donc une immense supériorité sur la
religion d'état que Rome patronnait et sur les différents cultes qu'elle
tolérait. Les païens le comprenaient vaguement. Alexandre Sévère ayant eu la
pensée d'élever un temple à Christ, on lui apporta de vieux textes sacrés
d'où il résultait que, s'il donnait suite à cette idée, tous se feraient
chrétiens, et que les autres temples seraient abandonnés. En vain Julien
essaiera d'appliquer au culte officiel l'organisation qui faisait la force de
l'églises ; le paganisme résistera à une transformation contraire à sa
nature. Le christianisme s'imposera et s'imposera tout entier à l'empire. La
religion que Rome répandra dans le monde sera justement celle qu'elle a le
plus vivement combattue, le judaïsme sous forme chrétienne. Loin qu'il faille
être surpris du succès du christianisme dans l'Empire romain, il faut bien
plutôt s'étonner que cette révolution ait été si lente à s'accomplir. Ce qui était profondément atteint par le christianisme,
c'étaient les maximes d'état, base de la politique romaine. Ces maximes se
défendirent énergiquement pendant cent cinquante ans, et retardèrent
l'avènement du culte désigné pour la victoire. Mais cet avènement était
inévitable. Méliton avait raison. Le christianisme était destiné à être la
religion de l'Empire romain. L'Occident se montrait encore bien réfractaire ;
l'Asie Mineure et La gloire de Rome, c'est d'avoir essayé de résoudre le
problème de la société humaine sans théocratie, sans dogme surnaturel. Le
judaïsme, le christianisme, l'islamisme, le bouddhisme sont, au contraire, de
grandes institutions embrassant la vie humaine tout entière sous forme de
religions révélées. Ces religions sont la société humaine elle-même ; rien n'existe
en dehors d'elles. Le triomphe du christianisme fut l'anéantissement de la
vie civile pour mille ans. L'église, c'est la commune si l'on veut, mais sous
forme religieuse. Pour être membre de cette commune-là, il ne suffit pas d'y
être né ; il faut professer un dogme métaphysique, et, si votre esprit se
refuse à croire ce dogme, tant pis pour vous. L'islamisme ne fit qu'appliquer
le même principe. La mosquée, comme la synagogue et l'église, est le centre
de toute vie. Le Moyen âge, règne du christianisme, de l'islamisme et du
bouddhisme, est bien l'ère de la théocratie. Le coup de génie de |