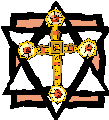MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XXIX - Le culte et la discipline.
|
L'HISTOIRE d'une religion n'est pas l'histoire d'une
théologie. Les subtilités sans valeur qu'on décore de ce nom sont le parasite
qui dévore les religions bien plutôt qu'elles n'en sont l'âme. Jésus n'eut
pas de théologie ; il eut le sentiment le plus vif qu'on ait eu des choses
divines et de la communion filiale de l'homme avec Dieu. Aussi
n'institua-t-il pas de culte proprement dit, en dehors de celui qu'il trouva
déjà établi par le judaïsme. La fraction du pain,
accompagnée d'actions de grâces, ou eucharistie, fut le seul rite un peu
symbolique qu'il adopta, et encore Jésus ne fit-il que lui donner de
l'importance et se l'approprier ; car la beraka (bénédiction), avant de
rompre le pain, a toujours été un usage juif. Quoi qu'il en soit, ce mystère
du pain et du vin, considérés comme étant le corps et le sang de Jésus, si
bien que ceux qui en mangent ou en boivent participent de Jésus, devint
l'élément générateur de tout un culte. L'ecclesia ou l'assemblée en fut la
base. Jamais le christianisme ne sortit de là. L'ecclesia, ayant pour objet
central la communion ou eucharistie, devint la messe ; or la messe a toujours
réduit le reste du culte chrétien au rang d'accessoire et de pratique
secondaire. On était loin, vers le temps de Marc-Aurèle, de la réunion
chrétienne primitive, pendant laquelle deux ou trois prophètes, souvent des
femmes, tombaient en extase, parlant en même temps et se demandant les uns
aux autres, après l'accès, quelles merveilles ils avaient dites. Cela ne se
voyait plus que chez les montanistes. Dans l'immense majorité des églises,
les anciens et l'évêque président l'assemblée, règlent les lectures, parlent
seuls. Les femmes sont assises à part, silencieuses et voilées. L'ordre règne
partout, grâce à un nombre considérable d'employés secondaires, ayant des
fonctions distinctes. Peu à peu le siège de l'episcopos
et les sièges des presbyteri constituent un
hémicycle central, un choeur. L'eucharistie exige une table, devant laquelle
le célébrant prononce les prières et les paroles mystérieuses. Bientôt on
établit un ambon pour les lectures et les sermons, puis un cancel de
séparation entre le presbyterium et le reste
de la salle. Deux réminiscences dominent tout cet enfantement de
l'architecture chrétienne : d'abord un vague souvenir du temple de Jérusalem,
dont une partie était accessible aux seuls prêtres ; puis une préoccupation
de la grande liturgie céleste par laquelle débute l'Apocalypse. L'influence
de ce livre sur la liturgie fut de premier ordre. On voulut faire sur terre
ce que les vingt-quatre vieillards et les chantres zoomorphes font devant le
trône de Dieu. Le service de l'église fut ainsi calqué sur celui du ciel.
L'usage de l'encens vint sans doute de la même inspiration. Les lampes et les
cierges étaient surtout employés dans les funérailles. Le grand acte liturgique du dimanche était un
chef-d'oeuvre de mysticité et d'entente des sentiments populaires. C'était
bien déjà la messe, mais la messe complète, non la messe aplatie, si j'ose le
dire, écrasée comme de nos jours ; c'était la messe vivante dans toutes ses
parties, chaque partie conservant la signification primitive qu'elle devait
plus tard si étrangement perdre. Ce mélange habilement composé de psaumes, de
cantiques, de prières, de lectures, de professions de foi, ce dialogue sacré
entre l'évêque et le peuple, préparaient les âmes à penser et à sentir en
commun. L'homélie de l'évêque, la lecture de la correspondance des évêques
étrangers et des églises persécutées, donnaient la vie et l'actualité à la
pacifique réunion. Puis venait la préface solennelle du mystère, annonce
pleine de gravité, rappel des âmes au recueillement ; puis le mystère
lui-même, un canon secret, des prières plus saintes encore que celles qui ont
précédé ; puis l'acte de fraternité suprême, la participation au même pain, à
la même coupe. Une sorte de silence solennel plane sur l'église en ce moment.
Puis, quand le mystère est fini, la vie renaît, les chants recommencent, les
actions de grâces se multiplient ; une longue prière embrasse tous les ordres
de l'église, toutes les situations de l'humanité, tous les pouvoirs établis.
Puis le président, après avoir échangé avec les fidèles de pieux souhaits,
congédie l'assemblée par la formule ordinaire dans les audiences judiciaires,
et les frères se séparent pleins d'édification pour plusieurs jours. Cette réunion du dimanche était en quelque sorte le noeud
de toute la vie chrétienne. Ce pain sacré était le lien universel de l'église
de Jésus. On l'envoyait aux absents à domicile, aux confesseurs en prison, et
d'une église à l'autre, surtout vers le temps de Pâques ; on le donnait aux
enfants ; c'était le grand signe de la communion et de la fraternité.
L'agape, ou repas du soir en commun, non distingué d'abord de la cène, s'en
séparait de plus en plus et dégénérait en abus. La cène, au contraire,
devenait essentiellement un office du matin. La distribution du pain et du
vin se faisait par les anciens et par les diacres. Les fidèles les recevaient
debout. Dans certains pays, surtout en Afrique, on croyait, à cause de la
prière : Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
devoir communier tous les jours. On emportait, pour cela, le dimanche, un
morceau de pain bénit, que l'on mangeait chez soi en famille, après la prière
du matin. On se plut, à l'imitation des mystères, à entourer cet
acte suprême d'un profond secret. Des précautions étaient prises pour que les
initiés seuls fussent présents dans l'église au moment où il se célébrait. Ce
fut presque l'unique faute que commit l'église naissante ; on crut, parce
qu'elle recherchait l'ombre, qu'elle en avait besoin, et cela, joint à bien
d'autres indices, fournit des apparences à l'accusation de magie. Le baiser
sacré était aussi une grande source d'édification et de dangers. Les sages
docteurs recommandaient de ne pas s'y prendre à deux fois, de ne pas ouvrir
les lèvres. On ne tarda pas, du reste, à supprimer le danger en introduisant
dans l'église la séparation des deux sexes. L'église n'avait rien du temple ; car on maintenait comme
un principe absolu que Dieu n'a pas besoin de temple, que son vrai temple,
c'est le coeur de l'homme juste. Elle n'avait sûrement aucune architecture
qui la fît reconnaître ; c'était cependant déjà un édifice à part ; on
l'appelait la maison du Seigneur, et les
sentiments les plus tendres de la piété chrétienne commençaient à s'y
attacher. Les réunions de nuit, justement parce qu'elles étaient interdites
par la loi, avaient un grand charme pour l'imagination. Au fond, quoique le
vrai chrétien eût les temples en aversion, l'église aspirait secrètement à
devenir temple ; elle le devint tout à fait au Moyen âge ; la chapelle et
l'église de nos jours sont bien plus près de ressembler aux temples anciens
qu'aux églises du IIe siècle. Une idée bientôt répandue contribua beaucoup à cette
transformation ; on se figura que l'eucharistie était un sacrifice,
puisqu'elle était le mémorial du sacrifice suprême accompli par Jésus. Cette
imagination remplissait une lacune que la religion nouvelle semblait offrir
aux yeux des gens superficiels, je veux dire le manque de sacrifices. De la
sorte, la table eucharistique devint un autel, et il fut question
d'offrandes, d'oblations. Ces oblations, c'étaient les espèces mêmes du pain
et du vin, que les fidèles aisés apportaient, pour n'être pas à la charge de
l'église et pour que le reste appartînt aux pauvres et aux servants du culte.
On voit combien une telle doctrine pouvait devenir féconde en malentendus. Le
Moyen âge, qui abusa si fort de la messe, en y exagérant l'idée de sacrifice,
devait arriver à de bien grandes étrangetés. De transformations en
transformations, on en vint à la messe basse, où un homme, dans un petit
réduit, avec un enfant qui tient la place du peuple, préside une assemblée à
lui seul, dialogue sans cesse avec des gens qui ne sont pas là, apostrophe
des auditeurs absents, s'adresse l'offrande à lui-même, se donne le baiser de
paix à lui seul. Le sabbat, à la fin du IIe siècle, est à peu près supprimé
chez les chrétiens. Y tenir paraît un signe de judaïsme, un mauvais signe.
Les premières générations chrétiennes célébraient le samedi et le dimanche,
l'un en souvenir de la création, l'autre en souvenir de la résurrection ;
puis tout se concentra sur le dimanche. Ce n'est pas qu'on envisageât
précisément ce second jour comme un jour de repos ; le sabbat était abrogé,
non transféré ; mais les solennités du dimanche et surtout l'idée que ce jour
devait être tout entier à la joie (il était défendu d'y jeûner, d'y prier à
genoux) ramenèrent l'abstention du travail servile. C'est bien plus tard
qu'on en vint à croire que le précepte du sabbat s'appliquait au dimanche.
Les premières règles à cet égard ne concernent que les esclaves, à qui, par
une pensée miséricordieuse, on veut assurer des jours fériés. Le jeudi et le
vendredi, dies stationum, furent consacrés au
jeûne, aux génuflexions et au souvenir de Le culte des martyrs prenait déjà une place si
considérable, que les païens et les juifs en faisaient une objection,
soutenant que les chrétiens révéraient plus les martyrs que le Christ
lui-même. On les ensevelissait en vue de la résurrection, et on y mettait des
raffinements de luxe qui contrastaient avec la simplicité des moeurs
chrétiennes, on adorait presque leurs os. à l'anniversaire de leur mort, on
se rendait à leur tombeau ; on lisait le récit de leur martyre ; on célébrait
le mystère eucharistique en souvenir d'eux. C'était l'extension de la
commémoration des défunts, pieuse coutume qui tenait une grande place dans la
vie chrétienne. Peu s'en fallait qu'on ne dît déjà la messe pour les morts.
Le jour de leur anniversaire, on faisait l'offrande pour eux, comme s'ils
vivaient encore ; on mêlait leur nom aux prières qui précédaient la
consécration ; on mangeait le pain en communion avec eux. Le culte des
saints, par lequel le paganisme se refit sa place dans l'église, les prières
pour les morts, source des plus grands abus du Moyen âge, tenaient ainsi à ce
qu'il y eut dans le christianisme primitif de plus élevé et de plus pur. Le chant ecclésiastique exista de très bonne heure et fut
une des expressions de la conscience chrétienne. Il s'appliquait à des hymnes,
dont la composition était libre, et dont nous avons un spécimen dans l'Hymne
à Christ de Clément d'Alexandrie. Le rythme était court et léger ; c'était
celui des chansons du temps, de celles, par exemple, que l'on prêtait à
Anacréon. Il n'avait rien de commun, en tout cas, avec le récitatif des
Psaumes. On en peut retrouver quelque écho dans la liturgie pascale de nos
églises, qui a particulièrement conservé son air archaïque, dans le Victimae paschali, dans l'O
filii et filiae et l'Alléluia
judéo-chrétien. Le carmen antelucanum dont
parle Pline, ou l'office in galli cantu, se
retrouve probablement dans l'Hymnum dicat turba fratrum, surtout dans la
strophe suivante, dont le son argentin nous redit presque l'air sur lequel
elle était chantée : Galli cantus, galli plausus Proximum sentit diem Et ante lucem nuntiemus Christum regem seculo. Le baptême avait complément remplacé la circoncision, dont
il ne fut, à l'origine chez les juifs, que le préliminaire. Il était
administré par une triple immersion, dans une pièce à part, près de l'église
; puis l'illuminé était introduit dans la réunion des fidèles. Le baptême
était suivi de l'imposition des mains, rite juif de l'ordination du rabbinat.
C'était ce qu'on appelait le baptême de l'Esprit ; sans lui, le baptême de
l'eau était incomplet. Le baptême n'était qu'une rupture avec le passé ;
c'était par l'imposition des mains qu'on devenait réellement chrétien. Il s'y
joignait des onctions d'huile, origine de ce qu'on appelle maintenant la
confirmation, et une sorte de profession de foi par demandes et par réponses.
Tout cela constituait le sceau définitif, la sphragis.
L'idée sacramentelle, l'ex opere operato, le
sacrement conçu comme une sorte d'opération magique, devenait ainsi une des
bases de la théologie chrétienne. Au IIIe siècle, une espèce de noviciat au
baptême, le catéchuménat, s'établit ; le fidèle n'arrive au seuil de l'église
qu'après avoir traversé des ordres successifs d'initiation. Le baptême des
enfants commence à paraître vers la fin du IIe siècle. Il trouvera jusqu'au
IVe siècle des adversaires décidés. La pénitence était déjà réglée à Rome vers le temps du
faux Hermas. Cette institution, qui supposait une société si fortement
organisée, prit des développements surprenants. C'est merveille qu'elle n'ait
pas fait éclater l'église naissante. Si quelque chose prouve combien l'église
était aimée et l'intensité de joie qu'on y trouvait, c'est de voir à quelles
rudes épreuves on se soumettait pour y rentrer et regagner parmi les saints
la place qu'on avait perdue. La confession ou l'aveu de la faute, déjà
pratiquée par les juifs, était la première condition de la pénitence
chrétienne. Jamais, on le voit, le matériel d'un culte ne fut plus
simple. Les vases de Le culte du coeur, en revanche, était le plus développé
qui fut jamais. Quoique la liberté des charismes primitifs eût déjà été bien
réduite par l'épiscopat, les dons spirituels, les miracles, l'inspiration
directe continuaient dans l'église et en faisaient la vie. Irénée voit en ces
facultés surnaturelles la marque même de l'église de Jésus. Les martyrs de
Lyon y participent encore. Tertullien se croit entouré de miracles
perpétuels. Ce n'est pas seulement chez les montanistes que l'on attribuait
le caractère surhumain aux actes les plus simples. La théopneustie et la
thaumaturgie, dans l'église entière, étaient à l'état permanent. On ne
parlait que de femmes spirites, qui faisaient des réponses et semblaient des
lyres résonnant sous un coup d'archet divin. La soror dont Tertullien nous a
gardé le souvenir émerveille l'église par ses visions. Comme les illuminées
de Corinthe du temps de saint Paul, elle mêle ses révélations aux solennités
de l'église ; elle lit dans les coeurs ; elle indique des remèdes ; elle voit
les âmes corporellement comme des petits êtres de forme humaine, aériens,
brillants, tendres et transparents. Des enfants extatiques passaient aussi
pour les interprètes que se choisissait parfois le Verbe divin. La médecine surnaturelle était le premier de ces dons, que
l'on considérait comme des héritages de Jésus. L'huile sainte en était
l'instrument. Les païens étaient fréquemment guéris par l'huile des
chrétiens. Quant à l'art de chasser les démons, tout le monde reconnaissait
que les exorcistes chrétiens avaient une grande supériorité ; de toutes
parts, on leur amenait des possédés pour qu'ils les délivrassent, absolument
comme la chose a lieu encore aujourd'hui en Orient. Il arrivait même que des
gens qui n'étaient pas chrétiens exorcisaient par le nom de Jésus. Quelques
chrétiens s'en indignaient ; mais la plupart s'en réjouissaient, voyant là un
hommage à la vérité. On ne s'arrêtait pas en si beau chemin. Comme les faux
dieux n'étaient que des démons, le pouvoir de chasser les démons impliquait
le pouvoir de démasquer les faux dieux. L'exorciste encourait ainsi l'accusation
de magie, qui rejaillissait sur l'église tout entière. L'église orthodoxe vit
le danger de ces dons spirituels, restes d'une puissante ébullition
primitive, que l'église devait discipliner, sous peine de n'être pas. Les
docteurs et les évêques sensés y étaient opposés ; car ces merveilles, qui
ravissaient l'absurde Tertullien, et auxquelles saint Cyprien attache encore
tant d'importance, donnaient lieu à de mauvais bruits, et il s'y mêlait des
bizarreries individuelles dont l'orthodoxie se défiait. Loin de les
encourager, l'église frappa les charismes de suspicion, et, au IIIe siècle,
sans disparaître, ils devinrent de plus en plus rares. Ce ne furent plus que
des faveurs exceptionnelles, dont les présomptueux seuls se crurent honorés.
L'extase fut condamnée. L'évêque devient dépositaire des charismes, ou plutôt
aux charismes succède le sacrement, lequel est administré par le clergé,
tandis que le charisme est une chose individuelle, une affaire entre l'homme
et Dieu. Les synodes héritèrent de la révélation permanente. Les premiers
synodes furent tenus en Asie Mineure contre les prophètes phrygiens ;
transporté à l'église, le principe de l'inspiration par l'Esprit devenait un
principe d'ordre et d'autorité. Le clergé était déjà un corps bien distinct du peuple. Une
grande église complète, à côté de l'évêque et des anciens, avait un certain
nombre de diacres et d'aides-diacres attachés à l'évêque et exécuteurs de ses
ordres. Elle possédait, en outre, une série de petits fonctionnaires,
anagnostes ou lecteurs, exorcistes, portiers, psaltes ou chantres, acolytes,
qui servaient au ministère de l'autel, remplissaient lés coupes d'eau et de
vin, portaient l'eucharistie aux malades. Les pauvres et les veuves nourris
par l'église, et qui y demeuraient plus ou moins, étaient considérés comme
gens d'église et inscrits sur ses matricules (matricularii).
Ils remplissaient les plus bas offices, comme de balayer, plus tard de sonner
les cloches, et vivaient avec les clercs du surplus des offrandes de pain et
de vin. Pour les ordres élevés du clergé, le célibat tendait de plus en plus
à s'établir ; au moins, les secondes noces étaient interdites. Les
montanistes arrivèrent vite à prétendre que les sacrements administrés par un
prêtre marié étaient nuls. La castration ne fut jamais qu'un excès de zèle,
bientôt condamné. Les soeurs compagnes des apôtres, dont l'existence était
établie par des textes notoires, se retrouvent dans ces sous-introduites,
sortes de diaconesses servantes, qui furent l'origine du concubinat avoué des
clercs au Moyen âge. Les rigoristes demandaient qu'elles fussent voilées,
pour prévenir les sentiments trop tendres que pouvait faire naître chez les
frères leur ministère de charité. Les sépultures deviennent, dès la fin du
IIe siècle, une annexe de l'église et l'objet d'une diaconie ecclésiastique.
Le mode de sépulture chrétienne fut toujours celui des juifs, l'inhumation,
consistant à déposer le corps enveloppé du suaire dans un sarcophage, en
forme d'auge, surmonté souvent d'un arcosolium. La crémation inspira toujours
aux fidèles une grande répugnance. Les mithriastes et les autres sectes
orientales partageaient les mêmes idées et pratiquaient, à Rome, ce qu'on
peut appeler le mode syrien de sépulture. La croyance grecque à l'immortalité
de l'âme conduisait à l'incinération ; la croyance orientale en la
résurrection amena l'enterrement. Beaucoup d'indices portent à chercher les
plus anciennes sépultures chrétiennes de Rome vers Saint-Sébastien, sur la
voie Appienne. Là se trouvent les cimetières juifs et mithriaques. On croyait
que les corps des apôtres Pierre et Paul avaient séjourné en cet endroit, et
c'était pour cela qu'on l'appelait Catatumbas,
aux Tombes. Vers le temps de Marc-Aurèle, un changement grave se
produisit. La question qui préoccupe les grandes villes modernes se posa
impérieusement. Autant le système de la crémation ménageait l'espace consacré
aux morts, autant l'inhumation à la façon juive, chrétienne, mithriaque,
immobilisait de surface. Il fallait être assez riche pour s'acheter, de son vivant,
un loculus dans le terrain le plus cher du
monde, à la porte de Rome. Quand de grandes masses de population d'une
certaine aisance voulurent être enterrées de la sorte, il fallut descendre
sous terre. On creusa d'abord à une certaine profondeur pour trouver des
couches de sable suffisamment consistantes ; là, on se mit à percer
horizontalement, quelquefois sur plusieurs étages, ces labyrinthes de
galeries dans les parois verticales desquelles on ouvrit les loculi. Les juifs, les sabaziens, les mithriastes,
les chrétiens adoptèrent simultanément ce genre de sépulture, qui convenait
bien à l'esprit congréganiste et au goût du mystère qui les distinguaient.
Mais, les chrétiens ayant continué ce genre de sépulture pendant tout le
IIIe, le IVe et une partie du Ve siècle, l'ensemble des catacombes des
environs de Rome est, pour sa presque totalité, un travail chrétien. Des
nécessités analogues à celles qui firent creuser autour de Rome ces vastes
hypogées en produisirent également à Naples, à Milan, à Syracuse, à
Alexandrie. Dès les premières années du IIIe siècle, nous voyons le pape
Zéphyrin confier à son diacre Calliste le soin de ces grands dépôts
mortuaires. C'est ce qu'on appelait des cimetières ou "dortoirs" ;
car on se figurait que les morts y dormaient en attendant le jour de la
résurrection. Plusieurs martyrs y furent enterrés. Dès lors, le respect qui
s'attachait aux corps des martyrs s'appliqua aux lieux mêmes où ils étaient
déposés. Les catacombes furent bientôt des lieux saints. L'organisation du
service des sépultures est complète sous Alexandre Sévère. Vers le temps de
Fabien et de Corneille ce service est une des principales préoccupations de
la piété romaine. Une femme dévouée nommée Lucine dépense autour des tombes
saintes sa fortune et son activité. Reposer auprès des martyrs ad sanctos, ad martyres,
fut une faveur. On vint annuellement célébrer les mystères sur ces tombeaux
sacrés. De là des cubicula, ou chambres
sépulcrales, qui, agrandies, devinrent des églises souterraines, où l'on se
réunit en temps de persécution. Au-dehors, on ajouta quelquefois des scholae
servant de triclinium pour les agapes. Des assemblées dans de telles
conditions avaient l'avantage qu'on pouvait les prendre pour funéraires, ce
qui les mettait sous la protection des lois. Le cimetière, qu'il fût
souterrain ou en plein air, devint ainsi un lieu essentiellement
ecclésiastique. Le fossor, en quelques
églises, fut un clerc de second ordre, comme l'anagnoste et le portier.
L'autorité romaine, qui portait dans les questions de sépulture une grande
tolérance, intervenait très rarement en ces souterrains ; elle admettait,
sauf aux moments de fureur persécutrice, que la propriété des areae consacrées appartenait à la communauté,
c'est-à-dire à l'évêque. L'entrée des cimetières était, du reste, presque
toujours masquée à l'extérieur par quelque sépulture de famille, dont le
droit était hors de contestation. Ainsi le principe des sépultures par confrérie l'emporta
tout à fait au IIIe siècle. Chaque secte se bâtit son couloir souterrain et
s'y enferma. La séparation des morts devint de droit commun. On fut classé
par religion dans le tombeau ; demeurer après sa mort avec ses confrères
devint un besoin. Jusque-là, la sépulture avait été une affaire individuelle
ou de famille ; maintenant, elle devient une affaire religieuse, collective ;
elle suppose une communauté d'opinions sur les choses divines. Ce n'est pas
une des moindres difficultés que le christianisme léguera à l'avenir. Par son origine première, le christianisme était aussi
contraire aux développements des arts plastiques que l'a été l'islam. Si le
christianisme fût resté juif, l'architecture seule s'y fût développée, ainsi
que cela est arrivé chez les musulmans ; l'église eût été, comme la mosquée,
une grande maison de prière, voilà tout. Mais les religions sont ce que les
font les races qui les adoptent. Transporté chez des peuples amis de l'art,
le christianisme devint une religion aussi artistique qu'il l'eût été peu
s'il fût resté entre les mains des judéo-chrétiens. Aussi sont-ce des
hérétiques qui fondent l'art chrétien. Nous avons vu les gnostiques entrer
dans cette voie avec une audace qui scandalisa les vrais croyants. Il était
trop tôt encore ; tout ce qui rappelait l'idolâtrie était suspect. Les
peintres qui se convertissaient étaient mal vus, comme ayant servi à
détourner vers de creuses images les hommages dus au Créateur. Les images de
Dieu et du Christ, j'entends les images isolées qui eussent pu sembler des
idoles, excitaient l'appréhension, et les carpocratiens, qui avaient des
bustes de Jésus et leur adressaient des honneurs païens, étaient tenus pour
des profanes. On observait à la lettre, au moins dans les églises, les
préceptes mosaïques contre les représentations figurées. L'idée de la laideur
de Jésus, subversive d'un art chrétien, était généralement répandue. Il y
avait des portraits peints de Jésus, de saint Pierre, de saint Paul ; mais on
voyait à cet usage des inconvénients. Le fait de la statue de l'hémorroïsse
paraît à Eusèbe avoir besoin d'excuse ; cette excuse, c'est que la femme qui
témoigna ainsi sa reconnaissance au Christ agit par un reste d'habitude
païenne et par une confusion d'idées pardonnable. Ailleurs, Eusèbe repousse
comme tout à fait profane le désir d'avoir des portraits de Jésus. Les arcosolia des tombeaux appelaient quelques peintures.
On les fit d'abord purement décoratives, dénuées de toute signification
religieuse : vignes, rinceaux de feuillage, vases, fruits, oiseaux. Puis on y
mêla des symboles chrétiens ; puis on y peignit quelques scènes simples,
empruntées à Toute cette petite peinture d'ornement, exclue encore des
églises et qu'on ne tolérait que parce qu'elle tirait peu à conséquence, n'a
rien absolument d'original. C'est bien à tort qu'on a vu dans ces essais
timides le principe d'un art nouveau. L'expression y est faible ; l'idée
chrétienne tout à fait absente ; la physionomie générale indécise. L'exécution
n'en est pas mauvaise ; on sent des artistes qui ont reçu une assez bonne
éducation d'atelier ; elle est bien supérieure, en tout cas, à celle qu'on
trouve dans la vraie peinture chrétienne qui naît plus tard. Mais quelle
différence dans l'expression ! Chez les artistes du VIIe, du VIIIe siècle, on
sent un puissant effort pour introduire dans les scènes représentées un
sentiment nouveau ; les moyens matériels leur manquent tout à fait. Les
artistes des catacombes, au contraire, sont des peintres du genre pompéien,
convertis pour des motifs parfaitement étrangers à l'art, et qui appliquent
leur savoir-faire à ce que comportent les lieux austères qu'ils décorent.
L'histoire évangélique ne fut traitée par les premiers peintres chrétiens que
partiellement et tardivement. C'est ici surtout que l'origine gnostique de
ces images se voit avec évidence. La vie de Jésus que présentent les
anciennes peintures chrétiennes est exactement celle que se figuraient les
gnostiques et les docètes, c'est-à-dire que L'art chrétien était né hérétique ; il en garda longtemps
la trace ; l'iconographie chrétienne se dégagea lentement des préjugés au
milieu desquels elle était née. Elle n'en sortit que pour subir la domination
des apocryphes, eux-mêmes plus ou moins nés sous une influence gnostique. De
là une situation longtemps fausse. Jusqu'en plein Moyen âge, des conciles,
des docteurs autorisés condamnent l'art ; l'art, de son côté, même rangé à
l'orthodoxie, se permet d'étranges licences. Ses sujets favoris sont
empruntés, pour la plupart, à des livres condamnés, si bien que les
représentations forcent les portes de l'église, quand le livre qui les
explique en est depuis longtemps expulsé. En Occident, au XIIIe siècle, l'art
s'émancipe tout à fait ; mais il n'en est pas de même dans le christianisme
oriental. L'église grecque et les églises orientales ne triomphent jamais
complètement de cette antipathie pour les images qui est portée à son comble
dans le judaïsme et l'islamisme. Elles condamnent la ronde bosse et se
renferment dans une imagerie hiératique d'où l'art sérieux aura beaucoup de
peine à sortir. On ne voit pas que, dans la vie privée, les chrétiens se
fissent scrupule de se servir des produits de l'industrie ordinaire qui ne
portaient aucune représentation choquante pour eux. Bientôt, cependant, il y
eut des fabricants chrétiens, qui, même sur les objets usuels, remplacèrent
les anciens ornements par des images appropriées au goût de la secte (bon
pasteur, colombe, poisson, navire, lyre, ancre). Une orfèvrerie, une verrerie
sacrée se formèrent, en particulier, pour les besoins de |