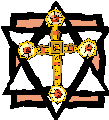MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XXIV - Écoles d'Alexandrie, d'Édesse.
|
BEAUCOUP de choses finissaient ; d'autres commençaient ;
l'école et les livres remplaçaient la tradition. Personne n'a plus la
prétention d'avoir vu ni les apôtres ni leurs disciples immédiats. Des
raisonnements comme celui que faisait Papias, il y a quarante ans, ce dédain
du livre et cette préférence avouée pour les gens qui savent d'original, ne
sont plus de mise. Hégésippe sera le dernier qui aura fait des voyages pour
étudier sur place la doctrine des églises. Irénée trouve ces inquisitions
inutiles. L'église est un vaste dépôt de vérité, où il n'y a qu'à puiser. Si
l'on excepte les barbares qui ne savent pas écrire, personne n'a plus besoin
de consulter la tradition orale. On se met donc résolument à écrire ; le docteur,
l'écrivain ecclésiastique remplacent le traditioniste ; l'époque créatrice
des origines est finie ; l'histoire ecclésiastique commence. Nous disons
ecclésiastique et non pas cléricale. Le docteur, en effet, à l'époque où nous
sommes, est très souvent laïque. Justin, Tatien, Athénagore, la plupart des
apologistes ne sont ni évêques ni diacres. Les docteurs de l'école
d'Alexandrie ont une place distincte en dehors de la hiérarchie cléricale.
L'institution du catéchuménat servit au développement de cette institution.
Des postulants, souvent gens instruits, préparés hors de l'église à
l'acceptation du baptême, réclamaient un enseignement à part, plus précis que
celui des fidèles. Origène est catéchiste et prédicateur avec la permission
de l'évêque de Césarée, sans avoir de rang défini dans le clergé. Saint
Jérôme gardera une situation analogue qui, déjà de son temps, est pleine de
difficultés. Il était naturel, en effet, que peu à peu l'église absorbât
l'enseignement ecclésiastique et que le docteur devînt membre du clergé,
subordonné à l'évêque. Nous avons vu qu'Alexandrie, par suite des disputes du
gnosticisme et peut-être à l'imitation du Musée, eut une église catéchétique
de lettres sacrées, distincte de l'église, et des docteurs ecclésiastiques
pour commenter rationnellement les écritures. Cette école, espèce
d'université chrétienne, s'apprêtait à devenir le centre du mouvement de
toute la théologie. Un jeune Sicilien converti, nommé Pantaenus, en était le
chef et allait porter dans l'enseignement sacré une largeur d'idées qu'aucune
chaire chrétienne n'avait connue jusque-là. Tout lui plaisait, les
philosophies, les hérésies, les religions les plus étranges. De tout, il
faisait son miel, gnostique dans le meilleur sens, mais éloigné des chimères
que le gnosticisme impliquait presque toujours. Dès lors se groupaient autour
de lui quelques adolescents à la fois lettrés et chrétiens, en particulier le
jeune converti Clément, âgé d'environ vingt ans, et Alexandre, futur évêque
de Jérusalem, qui eut, dans la première moitié du IIIe siècle, un rôle si
considérable. La vocation de Pantaenus était surtout l'enseignement oral ; sa
parole avait un charme extrême ; il laissa chez ses disciples, plus célèbres
que lui, un sentiment profond. Non moins favorable que Justin à la
philosophie, il concevait le christianisme comme le culte de tout ce qui est
beau. Heureux génie, brillant, lumineux, bienveillant pour tout, il fut à son
heure l'esprit le plus libéral et le plus ouvert que l'église eût possédé
jusque-là, et il marqua l'aurore d'un remarquable mouvement intellectuel,
supérieur peut-être à tous les essais de rationalisme qui se sont jamais
produits au sein du christianisme. Origène, à la date où nous nous arrêtons,
n'est pas né encore ; mais son père Léonide nourrit en son coeur cet ardent
idéalisme qui fera de lui un martyr et le premier maître du fils dont il
baisera la poitrine pendant son sommeil, comme le temple du Saint-Esprit. L'Orient païen n'inspirait pas toujours aux chrétiens la
même antipathie que L'Orient, de son côté, toujours enclin au syncrétisme, et
d'avance sympathique à tout ce qui porte le caractère de la spéculation
désintéressée, rendait au christianisme cette large tolérance. Que l'on
compare au patriotisme étroit d'un Celse, d'un Fronton, l'esprit ouvert d'un
penseur tel que Numénius d'Apamée ; quelle différence ! Sans être précisément
chrétien ni juif, Numénius admire Moïse et Philon. Il égale Philon à Platon ;
il appelle ce dernier un Moïse attique, il connaît jusqu'aux compositions
apocryphes sur Jammès et Mambré. à l'étude de Platon et de Pythagore, le
philosophe doit, selon lui, unir la connaissance des institutions des
brahmanes, des juifs, des mages, des égyptiens. Le résultat de l'enquête, on
peut en être sûr d'avance, sera que tous ces peuples sont d'accord avec
Platon. Comme Philon allégorise l'Ancien Testament, Numénius explique
symboliquement certains faits de la vie de Jésus-Christ. Il admet que la
philosophie grecque est originaire de l'Orient, et doit la vraie notion de
Dieu aux égyptiens, aux Hébreux ; il proclame cette philosophie insuffisante,
même en ses maîtres les plus vénérés. Justin et l'auteur de l'épître à
Diognète n'en disaient guère davantage. Numénius n'appartint pas cependant à
l'église ; la sympathie et l'admiration pour une doctrine n'entraîne pas chez
un éclectique l'adhésion formelle à cette doctrine. Numénius est un des
précurseurs du néoplatonisme, c'est par lui que l'influence de Philon et une
certaine connaissance du christianisme pénètrent dans l'école d'Alexandrie.
Ammonius Saccas, à l'heure où nous finissons cette histoire, fréquente
peut-être encore l'église, d'où la philosophie ne tardera pas à le faire
sortir. Clément, Ammonius, Origène, Plotin ! Quel siècle va s'ouvrir pour la
ville qui nourrit tous ces grands hommes, et devient de plus en plus la
capitale intellectuelle de l'Orient ! Le plus original parmi ces esprits mobiles et sincères que
la loi chrétienne charma, mais non d'une façon assez exclusive pour les
détacher de tout le reste et faire d'eux de simples membres de l'église, fut
Bardesane d'Édesse. C'était, si l'on peut s'exprimer ainsi, un homme du
monde, riche, aimable, libéral, instruit, bien posé à Un seul des traités de Bardesane trouva grâce auprès des
lecteurs orthodoxes ; ce fut un dialogue dans lequel il combattait la pire
erreur de l'Orient, l'erreur chaldéenne, le fatalisme astrologique. La forme
des entretiens socratiques plaisait à Bardesane. Il aimait à poser pour le
public environné de ses amis et discutant avec eux les plus hauts problèmes
de la philosophie. Un des disciples nommé Philippe rédigeait ou était censé
rédiger l'entretien. Dans le dialogue sur la fatalité, l'interlocuteur
principal de Bardesane est un certain Aoueid, entiché des erreurs de
l'astrologie. L'auteur oppose à ces erreurs un raisonnement vraiment
scientifique : Si l'homme est dominé par les milieux
et les circonstances, comment se fait-il que le même pays voie se produire
des développements humains tout à fait différents ? Si l'homme est dominé par
la race, comment se fait-il qu'une nation, changeant de religion, par exemple
se faisant chrétienne, devient toute différente de ce qu'elle était ?
Les détails intéressants que l'auteur donne sur les moeurs de pays inconnus
piquèrent la curiosité. Le dernier rédacteur du roman des Reconnaissances,
puis Eusèbe, puis saint Césaire en firent leur profit. Il est singulier
qu'étant en possession d'un pareil écrit, nous devions encore nous demander
ce que Bardesane pensa sur la question de l'influence des astres dans les
actes de l'homme et dans les événements de l'histoire. Le dialogue s'exprime
sur ce point avec toute la netteté que l'on peut désirer. Cependant saint
Éphrem, Diodore d'Antioche, combattent Bardesane comme ayant versé dans l'erreur
de ses maîtres de Chaldée. Par moments, son école apparaît comme une école
profane d'astronomie autant que de théologie. On y prétendait fixer par des
calculs la durée du monde à six mille ans. On admettait l'existence d'esprits
sidéraux résidant dans les sept planètes, surtout dans le soleil et la lune,
dont l'union mensuelle conserve le monde en lui donnant de nouvelles forces. Ce que Bardesane fut sans contestation, c'est le créateur
de la littérature syriaque chrétienne. Le syriaque était sa langue ;
quoiqu'il sût le grec, il n'écrivait pas en cet idiome. Le travail nécessaire
pour assouplir l'idiome araméen à l'expression d'idées philosophiques lui
appartient tout entier. Ses ouvrages, du reste, étaient traduits en grec par
ses disciples sous ses yeux. Lié avec la famille royale d'Édesse, ayant été,
à ce qu'il semble, élevé en la compagnie d'Abgar VIII bar Manou, qui fut un
fervent chrétien, il contribua puissamment à extirper les coutumes païennes,
et eut un rôle social et littéraire des plus importants. La poésie avait
toujours manqué à Bardesane laissa un fils, nommé Harmonius, qu'il envoya
faire ses études à Athènes, et qui continua l'école, en la faisant pencher
encore davantage du côté de l'hellénisme. À l'imitation de son père, il
exprima les idées les plus élevées de la philosophie grecque en hymnes
syriaques. Il résultait de tout cela une discipline trop distinguée eu égard
à la moyenne que comportait le christianisme. Il fallait, pour être membre
d'une telle église, de l'esprit, de l'instruction. Les bons Syriens en furent
effrayés. Le sort de Bardesane ressembla fort à celui de Paul de Samosate. On
le traita de charmeur dangereux, de femme séductrice, irrésistible dans le
secret. Ses hymnes, comme On n'oublia pas cependant son talent et les services qu'il
avait rendus. Le jour de sa naissance fut marqué, dans |