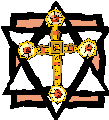MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XXI - Celse et Lucien.
|
L'OBSTINÉ conservateur qui, en passant près des cadavres
mutilés des martyrs de Lyon, se disait à lui-même : On
a été trop doux ; il faudra inventer à l'avenir des châtiments autrement
sévères ! n'était pas plus borné que les politiques qui, dans tous les
siècles, ont cru arrêter les mouvements religieux ou sociaux par les
supplices. Les mouvements religieux et sociaux se combattent par le temps et
le progrès de la raison. Le socialisme sectaire de Ce Celse était ami de Lucien et semble, au fond, avoir
partagé le scepticisme du grand rieur de Samosate. Ce fut à sa demande que
Lucien composa le spirituel essai sur Alexandre d'Abonotique, où la niaiserie
de croire au surnaturel est si bien exposée. Lucien, lui parlant coeur à
coeur, le présente comme un admirateur sans réserve de cette grande
philosophie libératrice, qui a sauvé l'homme des fantômes de la superstition,
qui le préserve de toutes les vaines croyances et de toutes les erreurs. Les
deux amis, exactement comme Lucrèce, tiennent Épicure pour un saint, un
héros, un bienfaiteur du genre humain, un génie divin, le seul qui ait vu la
vérité et osé la dire. Lucien, d'un autre côté, parle de son ami comme d'un
homme accompli ; il vante sa sagesse, sa justice, son amour de la vérité, la
douceur de ses moeurs, le charme de son commerce. Ses écrits lui paraissent
les plus utiles, les plus beaux du siècle, capables de dessiller les yeux de
tous ceux qui ont quelque raison. Celse, en effet, s'était donné pour
spécialité de rechercher les duperies auxquelles la pauvre humanité est
sujette. Il avait une forte antipathie pour les poètes et les introducteurs
de faux dieux, à la façon d'Alexandre d'Abonotique. Quant aux principes
généraux, il paraît avoir été moins ferme que Lucien. Il écrivit contre la
magie, plutôt pour dévoiler le charlatanisme des magiciens que pour montrer
la vanité absolue de leur art. Sa critique, en ce qui concerne le surnaturel,
est identique à celle des épicuriens ; mais il ne conclut pas. Il met sur le
même pied l'astrologie, la musique, l'histoire naturelle, la magie, la
divination. Il repousse la plupart des prestiges comme des impostures ; mais
il en admet quelques-uns. Il ne croit pas aux légendes du paganisme ; mais il
les trouve grandes merveilleuses, utiles aux hommes. Les prophètes, en
général, lui paraissent des charlatans, et pourtant il ne traite pas de
rêverie pure l'art de prédire l'avenir. Il est éclectique, déiste, ou, si
l'on veut, platonicien. Sa religion ressemble beaucoup à celle de Marc
Aurèle, de Maxime de Tyr, à ce que sera plus tard celle de l'empereur Julien. Dieu, l'ordre universel, délègue son pouvoir à des dieux
particuliers, sorte de démons ou de ministres, auxquels s'adresse le culte du
polythéisme. Ce culte est légitime ou du moins fort acceptable, quand on ne
le porte pas à l'excès. Il devient de devoir strict, quand il est religion
nationale, chacun ayant pour devoir d'adorer le divin selon la forme qui lui
a été transmise par ses ancêtres. Le vrai culte, c'est de tenir toujours sa
pensée élevée vers Dieu, père commun de tous les hommes. La piété intérieure
est l'essentiel ; les sacrifices n'en sont que le signe. Quant aux adorations
que l'on rend aux démons, ce sont là des obligations de peu de conséquence,
auxquelles on satisfait avec un mouvement de la main et qu'on est bien bon de
traiter en chose sérieuse. Les démons n'ont besoin de rien, et il ne faut pas
trop se complaire dans la magie ni les opérations magiques ; mais il ne faut
pas non plus être ingrat, et d'ailleurs toute piété est salutaire. Servir les
dieux inférieurs, c'est être agréable au grand Dieu dont ils relèvent. Les
chrétiens accordent bien des honneurs outrés à un fils de Dieu apparu
récemment dans le monde ! Comme Maxime de Tyr, Celse a une philosophie de la
religion qui lui permet d'admettre tous les cultes. Il admettrait le
christianisme sur le même pied que les autres croyances, si le christianisme
n'avait qu'une prétention limitée à la vérité. Ce que Celse est éminemment, c'est un sujet dévoué de
l'empereur, un patriote. On le suppose Romain ou Italien ; il est certain que
Lucien, tout loyal qu'il est, n'a pas une sympathie aussi prononcée pour
l'empire. Le raisonnement fondamental de Celse est celui-ci : La religion
romaine a été un phénomène concomitant de la grandeur romaine ; donc elle est
vraie. Comme les gnostiques, Celse croit que chaque nation a ses dieux qui la
protègent tant qu'elle les adore ainsi qu'ils veulent être adorés. Abandonner
ses dieux est, pour une nation, l'équivalent d'un suicide. Celse est ainsi
l'inverse en tout d'un Tatien, ennemi acharné de l'hellénisme et de la
société romaine. Tatien sacrifie entièrement la civilisation hellénique au
judaïsme et au christianisme. Celse attribue tout ce qu'il y a de bon chez
les juifs et chez les chrétiens à des emprunts faits aux Hellènes. Platon et
Épictète sont pour lui les deux pôles de la sagesse. S'il n'a pas connu Marc
Aurèle, il l'a sûrement aimé et admiré. D'un tel point de vue, il ne pouvait
envisager le christianisme que comme un mal ; mais il ne s'arrête pas aux
calomnies ; il reconnaît que les moeurs des sectaires sont douces et bien
réglées ; ce sont les motifs de crédibilité de la secte qu'il veut discuter.
Celse fit à ce sujet une véritable enquête, lut les livres des chrétiens et
des juifs, causa avec eux. Le résultat de ses recherches fut un ouvrage
intitulé Discours véritable, qui, naturellement, n'est pas venu jusqu'à nous,
mais qu'il est possible de reconstituer avec les citations et les analyses
qu'en a données Origène. Il est hors de doute que Celse a connu mieux qu'aucun
autre écrivain païen le christianisme et les livres qui lui servaient de
base. Origène, malgré sa remarquable instruction chrétienne, s'étonne d'avoir
tant de choses à apprendre de lui. Pour l'érudition, Celse est un docteur
chrétien. Ses voyages en Palestine, en Phénicie, en Égypte lui ont ouvert
l'esprit sur les matières d'histoire religieuse. Il a lu attentivement les
traductions grecques de C'est surtout en exégèse que Celse nous étonne par sa
pénétration. Voltaire n'a pas mieux triomphé de l'histoire biblique, des
impossibilités de Juifs et chrétiens me font
l'effet d'une troupe de chauves-souris, ou de fourmis sortant de leur trou,
ou de grenouilles établies près d'un marais, ou de vers tenant séance dans
les coins d'un bourbier..., et se disant
entre eux : C'est à nous que Dieu révèle et annonce d'avance toute chose ; il
n'a aucun souci du reste du monde ; il laisse les cieux et la terre rouler à
leur guise pour ne s'occuper que de nous. Nous sommes les seuls êtres avec
lesquels il communique par des messagers, les seuls avec lesquels il désire
lier société ; car il nous a faits semblables à lui. Tout nous est
subordonné, la terre, l'eau, l'air et les astres ; tout a été fait pour nous
et destiné à notre service, et c'est parce qu'il est arrivé à certains
d'entre nous de pécher que Dieu lui-même viendra ou enverra son propre fils
pour brûler les méchants et nous faire jouir avec lui de la vie éternelle. La discussion de la vie de Jésus est conduite exactement
selon la méthode de Reimarus ou de Strauss. Les impossibilités du récit
évangélique, si on le prend comme de l'histoire, n'ont jamais mieux été
montrées. L'apparition de Dieu en Jésus semble à notre philosophe messéante
et inutile. Les miracles évangéliques sont mesquins ; les magiciens ambulants
en font autant, sans que pour cela on les regarde comme fils de Dieu. La vie
de Jésus est celle d'un misérable poète, haï de Dieu. Son caractère est
irritable ; sa manière de parler, tranchante, indique un homme qui est
impuissant à persuader ; elle ne convient pas à un Dieu, pas même à un homme
de sens. Jésus aurait dû être beau, fort, majestueux, éloquent. Or ses
disciples avouent qu'il était petit, laid et sans noblesse. Pourquoi, si Dieu
voulait sauver le genre humain, n'a-t-il dépêché son fils qu'à un coin du
monde ? Il aurait dû mettre son esprit dans plusieurs corps et mander ces
envoyés célestes de divers côtés, puisqu'il savait que l'envoyé destiné aux
juifs serait mis à mort. Pourquoi aussi deux révélations opposées, celle de
Moïse et celle de Jésus ? Jésus est, dit-on, ressuscité ? On débite cela
d'une foule d'autres, Zamolxis, Pythagore, Rhampsinit. Il faudrait peut-être examiner
d'abord si jamais homme réellement mort est ressuscité avec le même corps.
Pourquoi traiter les aventures des autres de fables sans vraisemblance, comme
si l'issue de votre tragédie avait bien meilleur air et était plus croyable,
avec le cri que votre Jésus jeta du haut du poteau en expirant, le tremblement
de terre et les ténèbres ? Vivant, il n'avait rien pu faire pour lui-même ;
mort, dites-vous, il ressuscita et montra les marques de son supplice, les
trous de ses mains. Mais qui a vu tout cela ? Une femme à l'esprit malade,
comme vous l'avouez vous-mêmes, ou tout autre endiablé de la même sorte, soit
que le prétendu témoin ait rêvé ce que lui suggérait son esprit troublé, soit
que son imagination abusée ait donné un corps à ses désirs, ce qui arrive si
souvent, soit plutôt qu'il ait voulu frapper l'esprit des hommes par un récit
merveilleux et, à l'aide de cette imposture, fournir matière aux charlatans...
à son tombeau se présentent, ceux-ci disent un ange,
ceux-là disent deux anges, pour annoncer aux femmes qu'il est ressuscité ;
car le fils de Dieu, à ce qu'il paraît, n'avait pas la force d'ouvrir seul
son tombeau ; il avait besoin que quelqu'un vînt déplacer la pierre...
Si Jésus voulait faire éclater réellement sa vertu
divine, il fallait qu'il se montrât à ses ennemis, au juge qui l'avait
condamné, à tout le monde. Car, puisqu'il était mort et, de plus, dieu, comme
vous le prétendez, il n'avait plus rien à craindre de personne ; et ce
n'était pas apparemment pour qu'il restât caché qu'il avait été envoyé. Au
besoin même, pour mettre sa divinité en pleine lumière, il aurait dû
disparaître tout d'un coup de dessus la croix... De son vivant, il se
prodigue ; mort, il ne se fait voir en cachette qu'à une femmelette et à des
comparses. Son supplice a eu d'innombrables témoins ; sa résurrection n'en a
qu'un seul. C'est le contraire qui aurait dû avoir lieu. Si vous aviez si fort envie de
faire du neuf, combien il aurait mieux valu choisir pour le déifier quelqu'un
de ceux qui sont morts virilement et qui sont dignes du mythe divin ! Si vous
répugniez à prendre Héraclès, Asclépios ou quelqu'un des anciens héros qui
déjà sont honorés d'un culte, vous aviez Orphée, homme inspiré, nul ne le
conteste, et qui périt de mort violente. Peut-être direz-vous qu'il n'était
plus à prendre. Soit ; mais alors vous aviez Anaxarque, qui, jeté un jour
dans un mortier, comme on l'y pilait cruellement, se jouait de son bourreau. Pilez, pilez, disait-il, l'étui
d'Anaxarque ; car, pour lui-même, vous
ne le toucherez pas ! Parole pleine d'un esprit divin. Ici encore,
dira-t-on, vous avez été prévenus... Eh bien, alors, que ne preniez-vous
Épictète ? Comme son maître lui tordait la jambe, lui, calme et souriant : Vous allez la casser, disait-il ; et
la jambe en effet s'étant brisée : Je
vous disais que vous alliez la casser ! Qu'est-ce que votre dieu a dit de
pareil dans les tourments ? Et Dans ses jugements sur l'église, telle qu'elle existait de
son temps, Celse se montre singulièrement malveillant. À part quelques hommes
honnêtes et doux, l'église lui apparaît comme un amas de sectaires s'injuriant
les uns les autres. Il y a une nouvelle race d'hommes, nés d'hier, sans
patrie, ni traditions antiques, ligués contre les institutions civiles et
religieuses, poursuivis par la justice, notés d'infamie, se faisant gloire de
l'exécration commune. Leurs réunions sont clandestines et illicites ; ils s'y
engagent par serment à violer les lois et à tout souffrir pour une doctrine
barbare, qui aurait, en tout cas, besoin d'être perfectionnée et épurée par
la raison grecque. Doctrine secrète et dangereuse ! Le courage qu'ils mettent
à la soutenir est louable ; il est bien de mourir pour ne pas abjurer ou
feindre d'abjurer la foi qu'on a embrassée. Mais encore faut-il que la foi
soit fondée en raison et n'ait pas pour base unique un parti pris de ne rien
examiner. Les chrétiens, d'ailleurs, n'ont pas inventé le martyre ; chaque
croyance a donné des exemples de conviction ardente. Ils se raillent des
dieux impuissants, qui ne savent pas venger leurs injures. Mais le dieu
suprême des chrétiens a-t-il vengé son fils crucifié ? Leur outrecuidance à
trancher des questions où les plus sages hésitent est le fait de gens qui ne
visent qu'à séduire les simples. Tout ce qu'ils ont de bon, Platon et les
philosophes l'ont mieux dit avant eux. Les écritures ne sont qu'une traduction,
en style grossier, de ce que les philosophes, et particulièrement Platon, ont
dit en un style excellent. Celse est frappé des divisions du christianisme, des
anathèmes que les diverses églises s'adressent réciproquement. À Rome, où,
selon l'opinion la plus vraisemblable, le livre fut écrit, toutes les sectes
florissaient. Celse connut les marcionites, les gnostiques. Il vit bien,
cependant, qu'au milieu de ce dédale de sectes, il y avait l'église
orthodoxe, la grande Église, qui n'avait
d'autre nom que celui de chrétienne. Les extravagances montanistes, les
impostures sibyllines, ne lui inspirent naturellement que du mépris.
Certainement, s'il avait mieux connu l'épiscopat lettré d'Asie, des hommes
comme Méliton, par exemple, qui rêvaient des concordats entre le
christianisme et l'empire, son jugement eût été moins sévère. Ce qui le
blesse, c'est l'extrême bassesse sociale des chrétiens et le peu
d'intelligence du milieu où ils exercent leur propagande. Ceux qu'ils veulent
gagner sont des niais, des esclaves, des femmes, des enfants. Comme les
charlatans, ils évitent autant qu'ils peuvent les honnêtes gens qui ne se
laissent pas tromper, pour prendre dans leurs filets les ignorants et les
sots, pâture ordinaire des fourbes. Quel mal y a-t-il donc à être
bien élevé, à aimer les belles connaissances, à être sage et à passer pour
tel ? Est-ce là un obstacle à la connaissance de Dieu ? Ne sont-ce pas plutôt
des secours pour atteindre la vérité ? Que font les coureurs de foire, les
bateleurs ? S'adressent-ils aux hommes de sens, pour leur réciter leurs
boniments ? Non ; mais, s'ils aperçoivent quelque part un groupe d'enfants,
de portefaix ou de gens grossiers, c'est là qu'ils étalent leur industrie et
se font admirer. Il en est de même dans l'intérieur des familles. Voici des
cardeurs de laine, des cordonniers, des foulons, des gens de la dernière
ignorance et tout à fait dénués d'éducation. Devant les maîtres, hommes
d'expérience et de jugement, ils n'osent ouvrir la bouche ; mais
surprennent-ils en particulier les enfants de la maison ou des femmes qui
n'ont pas plus de raison qu'eux-mêmes, ils se mettent à débiter des
merveilles. C'est eux seuls qu'il faut croire ; le père, les précepteurs,
sont des fous qui ignorent le vrai bien et sont incapables de l'enseigner.
Ces prôneurs savent seuls comment on doit vivre ; les enfants se trouveront
bien de les suivre, et, par eux, le bonheur viendra sur toute la famille. Si,
pendant qu'ils pérorent, survient quelque personne sérieuse, un des
précepteurs ou le père lui-même, les plus timides se taisent ; les effrontés
ne laissent pas d'exciter les enfants à secouer le joug, insinuant à mi-voix
qu'ils ne veulent rien leur apprendre devant leur père ou leur précepteur,
pour ne pas s'exposer à la brutalité de ces gens corrompus, qui les feraient
châtier. Ceux qui tiennent à savoir la vérité n'ont qu'à planter là père et
précepteurs, à venir avec les femmes et la marmaille dans le gynécée, ou dans
l'échoppe du cordonnier, ou dans la boutique du foulon, afin d'y apprendre
l'absolu. Voilà comment ils s'y prennent pour gagner des adeptes... Quiconque
est pécheur, quiconque est sans intelligence, quiconque est faible d'esprit,
en un mot quiconque est misérable, qu'il approche, le royaume de Dieu est
pour lui. On conçoit combien un pareil
renversement de l'autorité de la famille dans l'éducation devait être odieux
à un homme qui exerçait peut-être les fonctions de précepteur. L'idée toute
chrétienne que Dieu a été envoyé pour sauver les pécheurs révolte Celse. Il
ne veut que la justice. Le privilège de l'enfant prodigue est pour lui
incompréhensible. Quel mal y a-t-il à être exempt de péché ? Que l'injuste,
dit-on, s'abaisse dans le sentiment de sa misère, et Dieu le recevra. Mais,
si le juste, confiant en sa vertu, lève les yeux vers Dieu, quoi ! sera-t-il
rejeté ? Les magistrats consciencieux ne souffrent pas que les accusés se
répandent en lamentations, de peur d'être entraînés à sacrifier la justice à
la pitié. Dieu, dans ses jugements, serait donc accessible à la flatterie ?
Pourquoi une telle préférence pour les pécheurs ?... Ces théories ne
viennent-elles pas du désir d'attirer autour de soi une plus nombreuse
clientèle ? Dira-t-on que l'on se propose, par cette indulgence, d'améliorer
les méchants ? Quelle illusion ! On ne change pas la nature des gens ; les
mauvais ne s'amendent ni par la force, ni par la douceur. Dieu ne serait-il
pas injuste s'il se montrait complaisant pour les méchants, qui savent l'art
de le toucher, et s'il délaissait les bons, qui n'ont pas ce talent ?
Celse ne veut pas de prime accordée à la fausse humilité, à l'importunité,
aux basses prières. Son Dieu est le dieu des âmes fières et droites, non le
dieu du pardon, le consolateur des affligés, le patron des misérables. Il
voit évidemment un grand danger au point de vue de la politique, et aussi au
point de vue de sa profession d'homme d'instruction publique, à laisser dire
que, pour être cher à Dieu, il est bon d'avoir été coupable et que les
humbles, les pauvres, les esprits sans culture, ont pour cela des avantages
spéciaux. Écoutez leurs professeurs : Les sages, disent-ils, repoussent notre enseignement, égarés et
empêchés qu'ils sont par leur sagesse. Quel homme de jugement, en effet,
peut se laisser prendre à une doctrine aussi ridicule ? Il suffit de regarder
la foule qui l'embrasse pour la mépriser. Leurs maîtres ne cherchent et ne
trouvent pour disciples que des hommes sans intelligence et d'un esprit
épais. Ces maîtres ressemblent assez aux empiriques qui promettent de rendre
la santé à un malade, à condition qu'on n'appellera pas les médecins savants,
de peur que ceux-ci ne dévoilent leur ignorance. Ils s'efforcent de rendre la
science suspecte : Laissez-moi faire,
disent-ils ; je vous sauverai, moi seul
; les médecins ordinaires tuent ceux qu'ils se vantent de guérir. On
dirait des gens ivres, qui, entre eux, accuseraient les hommes sobres d'être
pris de vin, ou des myopes qui voudraient persuader à des myopes comme eux
que ceux qui ont de bons yeux n'y voient goutte. C'est surtout comme patriote et ami de l'état que Celse se
montre l'ennemi du christianisme. L'idée d'une religion absolue, sans
distinction de nations, lui paraît une chimère. Toute religion est, à ses
yeux, nationale ; la religion n'a de raison d'être que comme nationale. Il
n'aime certes pas le judaïsme ; il le trouve plein d'orgueil et de
prétentions mal fondées, inférieur en tout à l'hellénisme ; mais, en tant que
religion nationale des juifs, le judaïsme a ses droits. Les juifs doivent
conserver les coutumes et les croyances de leurs pères, comme font les autres
peuples, bien que les Puissances auxquelles a été confiée Refusent-ils d'observer les
cérémonies publiques et de rendre hommage à ceux qui y président ; alors
qu'ils renoncent aussi à prendre la robe virile, à se marier, à devenir
pères, à remplir les fonctions de la vie, qu'ils s'en aillent tous ensemble
loin d'ici, sans laisser la moindre semence d'eux-mêmes, et que la terre soit
débarrassée de cette engeance. Mais, s'ils veulent se marier, avoir des
enfants, manger des fruits de la terre, participer aux choses de la vie, à
ses biens comme à ses maux, il faut qu'ils rendent à ceux qui sont chargés de
tout administrer les honneurs qui conviennent... Nous devons continuellement, et dans nos paroles et dans
nos actions, et même quand nous ne parlons ni n'agissons, tenir notre âme
tendue vers Dieu. Cela posé, quel mal y a-t-il à rechercher la bienveillance
de ceux qui ont reçu de Dieu leur pouvoir, et en particulier celle des rois
et des puissants de la terre ? Ce n'est pas, en effet, sans l'intervention
d'une force divine qu'ils ont été élevés au rang qu'ils occupent. En bonne logique, Celse avait tort. Il ne se borne pas à
demander aux chrétiens la confraternité politique ; il veut aussi la
confraternité religieuse. Il ne se borne pas à leur dire : Gardez vos croyances ; servez avec nous la même patrie,
laquelle ne vous demande rien de contraire à vos principes. Non, il
veut que les chrétiens prennent part à des cérémonies opposées à leurs idées.
Il leur fait de mauvais raisonnements, pour leur montrer que le culte
polythéiste ne doit pas les choquer. Sans doute, dit-il, si l'on voulait obliger un homme pieux à commettre quelque
action impie ou à prononcer quelque parole honteuse, il aurait raison
d'endurer tous les supplices plutôt que de le faire ; mais il n'en est pas de
même quand on vous commande de célébrer le Soleil ou de chanter un bel hymne
en l'honneur d'Athéné. Ce sont là des formes de la piété, et il ne peut y
avoir trop de piété. Vous admettez les anges ; pourquoi n'admettez-vous pas
les démons ou dieux secondaires ? Si les idoles ne sont rien, quel mal y
a-t-il à prendre part aux fêtes publiques ? S'il y a des démons, ministres du
Dieu tout-puissant, ne faut-il pas que les hommes pieux leur rendent hommage
? Vous paraîtrez, en effet, d'autant plus honorer le grand Dieu que vous
aurez mieux glorifié ces divinités secondaires. En s'appliquant ainsi à toute
chose, la piété devient plus parfaite. À quoi les chrétiens avaient
droit de répondre : Cela regarde notre conscience ;
l'état n'a pas à raisonner avec nous sur ce point. Parlez-nous de devoirs
civils et militaires, qui n'aient aucun caractère religieux, et nous les
remplirons. En d'autres termes, rien de ce qui tient à l'état ne doit
avoir de caractère religieux. Cette solution nous paraît très simple ; mais
comment reprocher aux politiques du IIe siècle de ne l'avoir pas mise en
pratique, quand, de nos jours, on y trouve tant de difficultés ? Plus admissible assurément est le raisonnement de notre
auteur en ce qui regarde le serment au nom de l'empereur. C'était là une
simple adhésion à l'ordre établi, ordre qui n'était lui-même que la défense
de la civilisation contre la barbarie, et sans lequel le christianisme eût
été balayé comme tout le reste. Mais Celse nous paraît manquer de générosité,
quand il mêle la menace au raisonnement. Vous ne
prétendez pas sans doute, dit-il, que les
Romains abandonnent, pour embrasser vos croyances, leurs traditions
religieuses et civiles, qu'ils laissent là leurs dieux pour se mettre sous la
protection de votre Très-Haut, qui n'a pas su défendre son peuple ? Les juifs
ne possèdent plus une motte de terre, et vous, traqués de toutes parts,
errants, vagabonds, réduits à un petit nombre, on vous cherche pour en finir
avec vous. Ce qu'il y a de singulier, en effet, c'est que, après
avoir combattu à mort le christianisme, Celse, par moments, s'en trouve fort
rapproché. On voit qu'au fond le polythéisme n'est pour lui qu'un embarras,
et qu'il envie à l'église son Dieu unique. L'idée qu'un jour le christianisme
sera la religion de l'empire et de l'empereur miroite à ses yeux comme aux
yeux de Méliton. Mais il se détourne avec horreur d'une telle perspective. Ce
serait la pire manière de mourir. Un pouvoir éclairé
et plus prévoyant, leur dit-il, vous détruira
de fond en comble, plutôt que de périr lui-même par vous. Puis son
patriotisme et son bon sens lui montrent l'impossibilité d'une telle
politique religieuse. Le livre, qui avait commencé par les réfutations les
plus aigres, finit par des propositions de conciliation. L'état court les
plus grands périls ; il s'agit de sauver la civilisation ; les barbares
débordent de tous les côtés ; on enrôle les gladiateurs, les esclaves. Le
christianisme perdra autant que la société établie au triomphe des barbares.
L'accord est donc facile. Soutenez l'empereur de toutes
vos forces, partagez avec lui la défense du droit ; combattez pour lui, si
les circonstances l'exigent ; aidez-le dans le commandement de ses armées.
Pour cela, cessez de vous dérober aux devoirs civils et au service militaire
; prenez votre part des fonctions publiques, s'il le faut pour le salut des
lois et la cause de la piété. Cela était facile à dire. Celse oubliait que ceux qu'il
voulait rallier, il les avait tout à l'heure menacés des plus cruels
supplices. Il oubliait surtout qu'en maintenant le culte établi, il demandait
aux chrétiens d'admettre des absurdités plus fortes que celles qu'il
combattait chez eux. Cet appel au patriotisme ne pouvait donc être entendu.
Tertullien dira fièrement : Pour détruire votre
empire, nous n'aurions qu'à nous retirer. Sans nous, il n'y aurait que
l'inertie et la mort. L'abstention a toujours été la vengeance des
conservateurs vaincus. Les conservateurs savent qu'ils sont le sel de la
terre ; que, sans eux, il n'y a pas de société possible ; que des fonctions
de première importance ne peuvent s'accomplir en dehors d'eux. Il est donc
naturel que, dans leurs moments de dépit, ils disent simplement : Passez-vous de nous. À vrai dire, personne dans le
monde romain, au temps dont nous parlons, n'était préparé à la liberté. Le
principe de la religion d'état était celui de presque tous. Le plan des
chrétiens est déjà de devenir la religion de l'empire. Méliton montre à Marc
Aurèle l'établissement du culte révélé comme le plus bel emploi de son
autorité. Le livre de Celse fut très peu lu au temps de son
apparition. Il s'écoula près de soixante-dix ans avant que le christianisme
s'aperçût de son existence. Ce fut Ambroise, cet Alexandrin bibliophile et
savant, le fauteur des études d'Origène, qui découvrit le livre impie, le
lut, l'envoya à son ami et le pria de le réfuter. L'effet du livre fut donc
très peu étendu. Au IVe siècle, Hiéroclès et Julien s'en servirent et le
copièrent presque ; mais il était trop tard. Celse n'enleva probablement pas
un seul disciple à Jésus. Il avait raison au point de vue du bon sens naturel
; mais le simple bon sens, quand il se trouve en opposition avec les besoins
du mysticisme, est bien peu écouté. Le sol n'avait pas été préparé par un bon
ministère de l'instruction publique. Il faut se rappeler que l'empereur
n'était pas lui-même exempt de toute attache au surnaturel ; les meilleurs
esprits du siècle admettaient les songes médicaux et les guérisons
miraculeuses dans les temples des dieux. Le nombre des rationalistes purs, si
considérable au Ier siècle, est maintenant très restreint. Les esprits qui,
comme le Caecilius de Minicius
Felix, avouent une sorte d'athéisme, n'en tiennent que plus énergiquement
pour le culte établi. Dans la seconde moitié du IIe siècle, nous ne voyons
réellement qu'un seul homme qui, étant supérieur à toute superstition, eût
bien le droit de sourire de toutes les folies humaines et de les prendre
également en pitié. Cet homme, l'esprit à la fois le plus solide et le plus
charmant de son temps, c'est Lucien. Ici plus d'équivoque. Lucien rejette absolument le
surnaturel. Celse admet toutes les religions ; Lucien les nie toutes. Celse
se croit consciencieusement obligé d'étudier le christianisme dans ses
sources ; Lucien, qui sait d'avance à quoi s'en tenir, n'en prend qu'une
notion très superficielle. Son idéal est Démonax, qui, à l'inverse de Celse,
ne fait pas de sacrifices, ne s'initie à aucun mystère, n'a d'autre religion
qu'une gaieté et une bienveillance universelles. Cette entière différence dans le point de départ fait que
Lucien est bien moins éloigné des chrétiens que ne l'est Celse. Lui qui
aurait mieux que personne le droit d'être sévère pour le surnaturel des
nouveaux sectaires, car il n'admet aucun surnaturel, se montre, au contraire,
par moments, assez indulgent pour eux. Comme les chrétiens, Lucien est un
démolisseur du paganisme, un sujet résigné, mais non affectionné de Rome.
Jamais, chez lui, une inquiétude patriotique, un de ces soucis d'homme d'état
qui dévorent son ami Celse. Son rire est le même que celui des Pères, son
diasyrmos fait chorus avec celui d'Hermias. Il parle de l'immoralité des
dieux, des contradictions des philosophes, presque comme Tatien. Sa ville
idéale ressemble singulièrement à une église. Les chrétiens et lui sont
alliés dans la même guerre, la guerre contre les superstitions locales,
contre les poètes, les oracles, les thaumaturges. Le côté chimérique et utopiste des chrétiens ne pouvait
que lui déplaire. Il semble bien qu'il a pensé plusieurs fois à eux en
traçant dans les Fugitifs cette peinture d'un monde de bohémiens, impudents,
ignorants, insolents, levant des tributs véritables sous prétexte d'aumône,
austères en paroles, au fond débauchés, séducteurs de femmes, ennemis des
Muses, gens au visage pâle et à la tête rasée, partisans des orgies infâmes.
La peinture est moins sombre, mais l'allusion est peut-être plus dédaigneuse
dans Pérégrinus. Certes, Lucien ne
voit pas, comme Celse, un danger pour l'état dans ces niais sectaires, qu'il
nous montre vivant en frères et animés les uns pour les autres de la plus
ardente charité. Ce n'est pas lui qui demandera qu'on les persécute. Il y a
tant de fous dans le monde ! Ceux-ci ne sont pas, à beaucoup près, les plus
malfaisants. Lucien se faisait assurément une étrange idée du sophiste crucifié qui introduisit ces nouveaux mystères et
réussit à persuader à ses adeptes de n'adorer que lui. Il a pitié de
tant de crédulité. Comment des malheureux qui se sont mis en tête qu'ils
seront immortels ne seraient-ils pas exposés à toutes les aberrations ? Le
cynique qui se vaporise à Olympie, le martyr chrétien qui cherche la mort
pour être avec Christ, lui paraissent des fous du même ordre. Devant ces
morts pompeuses, recherchées volontairement, sa réflexion est celle d'Arrius
Antoninus : Si vous tenez tant à vous griller,
faites-le chez vous, à votre aise et sans cette ostentation théâtrale.
Ce soin de recueillir les restes du martyr, de lui élever des autels, cette
prétention d'obtenir de lui des miracles de guérison, d'ériger son bûcher en
un sanctuaire de prophétie, autant de folies communes à tous les sectaires.
Lucien est d'avis qu'on se contente d'en rire, quand la friponnerie ne s'y
mêle pas. Il n'en veut aux victimes que parce qu'elles provoquent les
bourreaux. Il fut la première apparition de cette forme du génie humain dont
Voltaire a été la complète incarnation, et qui, à beaucoup d'égards, est la
vérité. L'homme étant incapable de résoudre sérieusement aucun des problèmes
métaphysiques qu'il a l'imprudence de soulever, que doit faire le sage au
milieu de la guerre des religions et des systèmes ? S'abstenir, sourire,
prêcher la tolérance, l'humanité, la bienfaisance sans prétention, la gaieté.
Le mal, c'est l'hypocrisie, le fanatisme, la superstition. Substituer une
superstition à une superstition, c'est rendre un médiocre service à la pauvre
humanité. Le remède radical est celui d'Épicure, qui tranche du même coup la
religion, et son objet, et les maux qu'elle entraîne. Lucien nous apparaît
ainsi comme un sage égaré dans un monde de fous. Il ne hait rien, il rit de
tout, excepté de la sérieuse vertu. Mais, au temps où nous arrêtons cette histoire, les hommes
de ce genre deviennent rares ; on pourrait les compter. Le très spirituel
Apulée de Madaure est, ou du moins affecte d'être très opposé aux esprits
forts. Il a été revêtu d'un sacerdoce. Il déteste les chrétiens comme impies.
Il repousse l'accusation de magie, non comme chimérique, mais comme un fait
non fondé ; tout est rempli, pour lui, de dieux et de démons. Le libre
penseur était de la sorte un être isolé, mal vu, obligé de dissimuler. On se
redisait avec terreur l'histoire d'un certain Euphronius, épicurien endurci,
qui tomba malade et que ses parents portèrent dans un temple d'Esculape. Là,
un oracle divin lui signifia cette recette : Brûler
les livres d'Épicure, en pétrir les cendres avec de la cire humide, s'enduire
le ventre avec ce liniment et envelopper le tout de bandages. On
contait aussi l'histoire d'un coq de Tanagre, qui, blessé à la patte, se mit
parmi ceux qui chantaient un hymne à Esculape, les accompagnant de son chant
et montrant au dieu sa patte malade. Une révélation s'étant faite pour amener
sa guérison, on vit le coq battant des ailes,
allongeant le pas, dressant le cou et agitant sa crête, proclamer La défaite du bon sens était accomplie. Les fines railleries de Lucien, les justes critiques de Celse, ne pèseront que comme des protestations impuissantes. Dans une génération, l'homme, en entrant dans la vie, n'aura plus que le choix de la superstition, et bientôt ce choix même, il ne l'aura plus. |