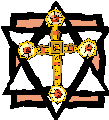MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XIII - Dernière recrudescence de millénarisme et de prophétisme - Les Montanistes.
|
LE GRAND JOUR, malgré les affirmations de Jésus et des
prophètes inspirés de lui, refusait de venir. Le Christ tardait à se montrer
; la piété ardente des premiers jours, qui avait eu pour mobile la croyance à
cette prochaine apparition, s'était refroidie chez plusieurs. C'est sur la
terre telle qu'elle est, au sein même de cette société romaine, si corrompue,
mais si préoccupée de réforme et de progrès, qu'on songeait maintenant à
fonder le royaume de Dieu. Les moeurs chrétiennes, du moment qu'elles aspiraient
à devenir celles d'une société complète, devaient se relâcher en plusieurs
points de leur sévérité primitive. On ne se faisait plus chrétien, comme dans
les premiers temps, sous le coup d'une forte impression personnelle ;
plusieurs naissaient chrétiens. Le contraste devenait chaque jour moins
tranché entre l'église et le monde environnant. Il était inévitable que des
rigoristes trouvassent qu'on s'enfonçait dans la fange de la plus dangereuse
mondanité, et qu'il s'élevât un parti de piétistes pour combattre la tiédeur
générale, pour continuer les dons surnaturels de l'église apostolique, et
préparer l'humanité, par un redoublement d'austérités, aux épreuves des
derniers jours. Déjà nous avons vu le pieux auteur d'Hermas pleurer sur la
décadence de son temps et appeler de ses voeux une réforme qui fît de
l'église un couvent de saints et de saintes. Il y avait, en effet, quelque
chose de peu conséquent dans l'espèce de quiétude où s'endormait l'église
orthodoxe, dans cette morale tranquille à laquelle se réduisait de plus en
plus l'oeuvre de Jésus. On négligeait les prédictions si précises du
fondateur sur la fin du monde présent et sur le règne messianique qui devait
venir ensuite. L'apparition prochaine dans les nues était presque oubliée. Le
désir du martyre, le goût du célibat, suites d'une telle croyance,
s'affaiblissaient. On acceptait des relations avec un monde impur, condamné à
bientôt finir ; on pactisait avec la persécution, et l'on cherchait à y
échapper à prix d'argent. Il était inévitable que les idées qui avaient formé
le fond du christianisme naissant reparussent de temps en temps, au milieu de
cet affaissement général, avec ce qu'elles avaient de sévère et d'effrayant.
Le fanatisme, que mitigeait le bon sens orthodoxe, faisait des espèces d'éruptions,
comme un volcan comprimé. Le plus remarquable de ces retours fort naturels vers
l'esprit apostolique fut celui qui se produisit en Phrygie, sous Marc Aurèle.
Ce fut quelque chose de tout à fait analogue à ce que nous voyons se passer
de notre temps, en Angleterre et en Amérique, chez les irvingiens et les
saints des derniers jours. Des esprits simples et exaltés se crurent appelés
à renouveler les prodiges de l'inspiration individuelle, en dehors des
chaînes déjà lourdes de l'église et de l'épiscopat. Une doctrine depuis
longtemps répandue en Asie Mineure, celle d'un Paraclet, qui devait venir
compléter l'oeuvre de Jésus, ou, pour mieux dire, reprendre l'enseignement de
Jésus, le rétablir dans sa vérité, le purger des altérations que les apôtres
et les évêques y avaient introduites, une telle doctrine, dis-je, ouvrait la
porte à toutes les innovations. L'église des saints était conçue comme
toujours progressive et comme destinée à parcourir des degrés successifs de
perfection. Le prophétisme passait pour la chose du monde la plus naturelle.
Les sibyllistes, les prophètes de toute origine couraient les rues, et,
malgré leurs grossiers artifices, trouvaient créance et accueil. Quelques petites villes des plus tristes cantons de Sans doute l'imitation des prophètes juifs et de ceux
qu'avait produits la loi nouvelle, au début de l'âge apostolique, fut
l'élément principal de cette renaissance du prophétisme. Il s'y mêla
peut-être aussi un élément orgiastique et corybantique, propre au pays, et
tout à fait en dehors des habitudes réglées de la prophétie ecclésiastique,
déjà assujettie à une tradition. Tout ce monde crédule était de race
phrygienne, parlait phrygien. Dans les parties les plus orthodoxes du
christianisme, d'ailleurs, le miraculeux passait pour une chose toute simple.
La révélation n'était pas close ; elle était la vie de l'église. Les dons
spirituels, les charismes apostoliques se continuaient dans beaucoup de
communautés ; on les alléguait en preuve de la vérité. On citait Agab, Judas,
Silas, les filles de Philippe, Ammias de Philadelphie, Quadratus comme ayant
été favorisés de l'esprit prophétique. On admettait même en principe que le
charisme prophétique durerait dans l'église par une succession non
interrompue jusqu'à la venue du Christ. La croyance au Paraclet, conçu comme
une source d'inspiration permanente pour les fidèles, entretenait ces idées.
Qui ne voit combien une telle croyance était pleine de danger ? Aussi
l'esprit de sagesse qui dirigeait l'église tendait-il à subordonner de plus
en plus l'exercice des dons surnaturels à l'autorité du presbytérat. Les
évêques s'attribuaient le discernement des esprits, le droit d'approuver les
uns, d'exorciser les autres. Cette fois, c'était un prophétisme tout à fait
populaire qui s'élevait sans la permission du clergé, et voulait gouverner
l'église en dehors de la hiérarchie. La question de l'autorité ecclésiastique
et de l'inspiration individuelle, qui remplit toute l'histoire de l'église,
surtout depuis le XVIe siècle, se posait dès lors avec netteté. Entre le
fidèle et Dieu, y a-t-il ou n'y a-t-il pas un intermédiaire ? Montanus
répondait non, sans hésiter. L'homme, disait le Paraclet dans un oracle de
Montanus, est
la lyre, et moi, je vole comme l'archet ; l'homme dort, et moi, je veille. Montanus justifiait sans doute par quelque supériorité
cette prétention d'être l'élu de l'Esprit. Nous croyons volontiers ses
adversaires quand ils nous disent que c'était un croyant de fraîche date ;
nous admettons même que le désir de primauté ne fut pas étranger à ses
singularités. Quant aux débauches et à la fin honteuse qu'on lui attribue, ce
sont là les calomnies ordinaires, qui ne manquent jamais sous la plume des
écrivains orthodoxes, quand il s'agit de noircir les dissidents. L'admiration
qu'il excita en Phrygie fut extraordinaire. Tel de ses disciples prétendait
avoir plus appris dans ses livres que dans Montanus, comme tous les prophètes de l'alliance nouvelle,
était plein de malédictions contre le siècle et contre l'Empire romain. Même
le Voyant de 69 était dépassé. Jamais la haine du monde et le désir de voir
s'anéantir la société païenne n'avaient été exprimés avec une aussi naïve
furie. Le sujet unique des prophéties phrygiennes était le prochain jugement
de Dieu, la punition des persécuteurs, la destruction du monde profane, le
règne de mille ans et ses délices. Le martyre était recommandé comme la plus
haute perfection ; mourir dans son lit passait pour indigne d'un chrétien.
Les encratites, condamnant les rapports sexuels, en reconnaissaient au moins
l'importance au point de vue de la nature ; Montanus ne prenait même pas la
peine d'interdire un acte devenu absolument insignifiant, du moment que
l'humanité en était à son dernier soir. La porte se trouvait ainsi ouverte à
la débauche, en même temps que fermée aux devoirs les plus doux. À côté de Montanus paraissent deux femmes, l'une appelée
tantôt Prisca, tantôt Priscille, tantôt Quintille, et l'autre, Maximille. Ces
deux femmes, qui, à ce qu'il paraît, avaient dû quitter l'état de mariage
pour embrasser la carrière prophétique, entrèrent dans leur rôle avec une
hardiesse extrême et un complet mépris de la hiérarchie. Malgré les sages
interdictions de Paul contre la participation des femmes aux exercices
prophétiques et extatiques de l'église, Priscille et Maximille ne reculèrent
pas devant l'éclat d'un ministère public. Il semble que l'inspiration
individuelle ait eu, cette fois comme d'ordinaire, pour compagnes la licence
et l'audace. Priscille a des traits qui la rapprochent de sainte Catherine de
Sienne et de Marie Alacoque. Un jour, à Pépuze, elle s'endormit et vit le
Christ venir vers elle, vêtu d'une robe éclatante et ayant l'apparence d'une
femme. Christ s'endormit à côté d'elle, et, dans cet embrassement mystérieux,
lui inocula toute sagesse. Il lui révéla en particulier la sainteté de la
ville de Pépuze. Ce lieu privilégié était l'endroit où Ce n'était pas seulement la prophétie, c'étaient toutes
les fonctions du clergé que cette chrétienté bizarre prétendait attribuer aux
femmes. Le presbytérat, l'épiscopat, les charges de l'église à tous les
degrés leur étaient dévolus. Pour justifier cette prétention, on alléguait
Marie, soeur de Moïse, les quatre filles de Philippe, et même Ève, pour
laquelle on plaidait les circonstances atténuantes et dont on faisait une
sainte. Ce qu'il y avait de plus étrange dans le culte de la secte était la
cérémonie des pleureuses ou vierges lampadophores, qui rappelle à beaucoup
d'égards les "réveils" protestants d'Amérique. Sept vierges portant
des flambeaux, vêtues de blanc, entraient dans l'église, poussant des
gémissements de pénitence, versant des torrents de larmes et déplorant par
des gestes expressifs la misère de la vie humaine. Puis commençaient les
scènes d'illuminisme. Au milieu du peuple, les vierges étaient prises
d'enthousiasme, prêchaient, prophétisaient, tombaient en extase. Les
assistants éclataient en sanglots et sortaient pénétrés de componction.
L'entraînement que ces femmes exercèrent sur les foules et même sur une
partie du clergé fut extraordinaire. On allait jusqu'à préférer les prophétesses
de Pépuze aux apôtres et même à Christ. Les plus modérés voyaient en elles
ces prophètes prédits par Jésus comme devant achever son oeuvre. Toute l'Asie
Mineure fut troublée. Des pays voisins, on venait pour voir ces phénomènes
extatiques et pour se faire une opinion sur le prophétisme nouveau. L'émotion
fut d'autant plus grande que personne ne rejetait a priori la possibilité de
la prophétie. Il s'agissait seulement de savoir si celle-ci était réelle. Les
églises les plus lointaines, celles de Lyon, de Vienne, écrivirent en Asie
pour être informées. Plusieurs évêques, en particulier Aelius Publius Julius,
de Debeltus, et Sotas, d'Anchiale en Thrace, vinrent pour être témoins. Toute
la chrétienté fut mise en mouvement par ces miracles, qui semblaient ramener
le christianisme de cent trente ans en arrière, aux jours de sa première
apparition. La plupart des évêques, Apollinaire d'Hiérapolis, Zotique
de Comane, Julien d'Apamée, Miltiade, le célèbre écrivain ecclésiastique, un
certain Aurélius de Cyrène, qualifié martyr
de son vivant, les deux évêques de Thrace, refusèrent de prendre au sérieux
les illuminés de Pépuze. Presque tous déclarèrent la prophétie individuelle
subversive de l'église et traitèrent Priscille de possédée. Quelques évêques
orthodoxes, en particulier Sotas d'Anchiale et Zotique de Comane, voulurent
même l'exorciser ; mais les Phrygiens les en empêchèrent. Quelques notables,
d'ailleurs, comme Thémison, Théodote, Alcibiade, Proclus, cédèrent à
l'enthousiasme général et se mirent à prophétiser à leur tour. Théodote,
surtout, fut comme le chef de la secte après Montanus et son principal
zélateur. Quant aux simples gens, ils étaient tous ravis. Les sombres oracles
des prophétesses étaient colportés au loin et commentés. Une véritable église
se forma autour d'elles. Tous les dons de l'âge apostolique, en particulier
la glossolalie et les extases, se renouvelèrent. On se laissait aller trop
facilement à ce raisonnement dangereux : Pourquoi ce qui a eu lieu n'aurait-il pas lieu encore ? La
génération actuelle n'est pas plus déshéritée que les autres. Le Paraclet,
représentant du Christ, n'est-il pas une source éternelle de révélation ?
D'innombrables petits livres répandaient au loin ces chimères. Les bonnes
gens qui les lisaient trouvaient cela plus beau que Une vie de haut ascétisme était la conséquence de cette
foi brûlante en la venue prochaine de Dieu sur la terre. Les prières des
saints de Phrygie étaient continuelles. Ils y portaient de l'affectation, un
air triste et une sorte de bigoterie. Leur habitude d'avoir en priant le bout
de l'index appuyé contre le nez, pour se donner l'air contrit, leur valut le
sobriquet de nez chevillés (en phrygien,
tascodrugites). Jeûnes, austérités, xérophagie rigoureuse, abstinence de vin,
réprobation absolue du mariage, telle était la morale que devaient
logiquement s'imposer de pieuses gens en retraite dans l'espérance du dernier
jour. Même pour la cène, ils ne se servaient, comme certains ébionites, que
de pain et d'eau, de fromage, de sel. Les disciplines austères sont toujours
contagieuses dans les foules, incapables de haute spiritualité ; car elles
rendent le salut certain à bon marché, et elles sont faciles à pratiquer pour
les simples, qui n'ont que leur bonne volonté. De toutes parts, ces pratiques
se répandirent ; elles pénétrèrent jusque dans les Gaules avec les Asiates,
qui remontaient en nombre si considérable la vallée du Rhône ; un des martyrs
de Lyon, en 177, s'y montrait attaché jusque dans sa prison, et il fallut le
bon sens gaulois ou, comme on crut alors, une révélation directe de Dieu pour
l'y faire renoncer. Ce qu'il y avait de plus fâcheux, en effet, dans les excès
de zèle de ces ardents ascètes, c'est qu'ils se montraient intraitables
contre tous ceux qui ne partageaient pas leurs simagrées. Ils ne parlaient
que du relâchement général. Comme les flagellants du Moyen âge, ils
trouvaient dans leurs pratiques extérieures un motif de fol orgueil et de
révolte contre le clergé. Ils osaient dire que, depuis Jésus, au moins depuis
les apôtres, l'église avait perdu son temps, et qu'il ne fallait plus
attendre une heure pour sanctifier l'humanité et la préparer au règne
messianique. L'église de tout le monde, selon eux, ne valait pas mieux que la
société païenne. Il s'agissait de former dans l'église générale une église
spirituelle, un noyau de saints, dont Pépuze serait le centre. Ces élus se
montraient hautains pour les simples fidèles. Thémison déclarait que l'église
catholique avait perdu toute sa gloire et obéissait à Satan. Une église de
saints, voilà leur idéal, bien peu différent de celui de pseudo-Hermas. Qui
n'est pas saint n'est pas de l'église. L'église, disaient-ils, c'est la totalité des saints, non le nombre
des évêques. Rien n'était plus loin, on le voit, de l'idée de catholicité
qui tendait à prévaloir et dont l'essence consistait à tenir les portes
ouvertes à tous. Les catholiques prenaient l'église telle qu'elle était, avec
ses imperfections ; on pouvait, d'après eux, être pécheur sans cesser d'être
chrétien. Pour les montanistes, ces deux termes étaient inconciliables.
L'église doit être aussi chaste qu'une vierge ; le pécheur en est exclu par
son péché même et perd dès lors toute espérance d'y entrer. L'absolution de
l'église est sans valeur. Les choses saintes doivent être administrées par
les saints. Les évêques n'ont aucun privilège en ce qui concerne les dons
spirituels. Seuls, les prophètes, organes de l'Esprit, peuvent assurer que
Dieu pardonne. Grâce aux manifestations extraordinaires d'un piétisme
extérieur et peu discret, Pépuze et Tymium devenaient, en effet, des espèces
de villes saintes. On les appelait Jérusalem et les sectaires voulaient
qu'elles fussent le centre du monde. On y venait de toutes parts, et
plusieurs soutenaient que, conformément à la prédiction de Priscille, Les orthodoxes, et surtout le clergé, cherchaient naturellement à prouver que l'attrait qui attachait ces puritains aux choses éternelles ne les détachait pas tout à fait de la terre. La secte avait une caisse centrale de propagande. Des quêteurs allaient de tous les côtés provoquer les offrandes. Les prédicateurs touchaient un salaire ; les prophétesses, en retour des séances qu'elles donnaient ou des audiences qu'elles accordaient, recevaient de l'argent, des habits, des cadeaux précieux. On voit quelle prise cela donnait contre les prétendus saints. Ils avaient leurs confesseurs et leurs martyrs, et c'était ce qui attristait le plus les orthodoxes ; car ceux-ci eussent voulu que le martyre fût le critérium de la vraie église. Aussi n'épargnait-on pas les médisances pour diminuer le mérite de ces martyrs sectaires. Thémison, ayant été arrêté, échappa, disait-on, aux poursuites à prix d'argent. Un certain Alexandre fut aussi emprisonné ; les orthodoxes n'eurent de repos que quand ils l'eurent présenté comme un voleur qui méritait parfaitement son sort et avait un dossier judiciaire dans les archives de la province d'Asie. |