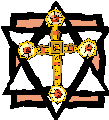MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
XI - Les grands évêques de Grèce et d'Asie - Méliton.
|
À CÔTÉ d'excès moraux, fruit d'un sentiment mal réglé, et
d'une exubérante production de légendes, filles de l'imagination orientale,
il y avait heureusement l'épiscopat. C'était surtout dans les régions
purement grecques de l'église que cette belle institution florissait. Opposé
à toutes les aberrations, classique en quelque sorte et moyen dans ses
tendances, plus préoccupé de la voie humble des simples fidèles que des
prétentions transcendantes des ascètes et des spéculatifs, l'épiscopat
devenait de plus en plus l'église elle-même et sauvait l'oeuvre de Jésus de
l'inévitable naufrage qu'elle eût subi entre les mains des gnostiques, des
montanistes et même des judaïsants. Ce qui doublait la force de l'épiscopat,
c'est que cette espèce d'oligarchie fédérative avait un centre ; ce centre
était Rome. Anicet avait vu, pendant les dix ou douze ans de sa présidence,
presque tout le mouvement du christianisme venir se concentrer autour de lui.
Son successeur, Soter (probablement un juif converti, qui traduisit en grec
son nom de Jésus), vit ce mouvement grandir encore. La vaste correspondance
qui s'était depuis longtemps établie entre Rome et les églises prit une
extension plus considérable que jamais. Un tribunal central des controverses
tendait visiblement à s'établir. C'était aujourd'hui le dimanche, écrit-il, et nous avons lu
votre lettre, et nous la gardons pour la lire encore, quand nous voudrons
entendre de salutaires avertissements, comme nous faisons pour celle que
Clément nous a déjà écrite. Par votre exhortation, vous avez resserré le lien
entre deux plantations, remontant l'une et l'autre à Pierre et Paul, je veux
dire l'église de Rome et celle de Corinthe. Ces deux apôtres, en effet, sont
aussi venus dans notre Corinthe et nous ont enseignés en commun, puis ont
fait voile ensemble vers l'Italie, pour y enseigner de concert et souffrir le
martyre vers le même temps. L'église de Corinthe cédait à la tendance de toutes les
églises ; elle voulait, comme l'église de Rome, avoir eu pour fondateurs les
deux apôtres dont l'union passait pour la base du christianisme. Elle
prétendait que Pierre et Paul, après avoir passé à Corinthe le moment le plus
brillant de leur vie apostolique, en étaient partis ensemble pour l'Italie.
Le peu d'accord qui régnait sur l'histoire des apôtres rendait possibles de
pareilles suppositions, contraires à toute vraisemblance et à toute vérité. Les écrits de Denys passaient pour des chefs-d'oeuvre de
talent littéraire et de zèle. Il y combattait énergiquement Marcion. Dans une
lettre à une pieuse soeur nommée Chrysophora, il traçait de main de maître
les devoirs de la vie consacrée à Dieu. Il n'en fut pas moins opposé aux
grossières exagérations du montanisme. Dans sa lettre aux Amastriens, il les
instruisait au long sur le mariage et la virginité, et leur commandait de
recevoir avec douceur tous ceux qui voudraient faire pénitence, soit qu'ils
fussent tombés dans l'hérésie, soit qu'ils eussent commis toute autre faute.
Palma, évêque d'Amastris, accepta pleinement le droit que se donnait Denys
d'enseigner ses fidèles. Denys ne trouva quelque résistance à son goût pour
les admonestations que chez l'évêque de Cnosse, Pinytus, rigoriste exalté.
Denys l'engageait à considérer la faiblesse de certaines personnes et à ne
pas imposer généralement aux fidèles le fardeau trop pesant de la chasteté.
Pinytus, qui avait de l'éloquence et qui passait pour une des lumières de
l'église, répondit en témoignant à Denys beaucoup d'estime et de respect ;
mais, à son tour, il lui conseilla de donner à son peuple une nourriture plus
solide et une instruction plus forte, de peur que, toujours entretenus avec le
lait de la condescendance, ils ne vinssent insensiblement à vieillir sans
être jamais sortis en esprit de la faiblesse de l'enfance. La lettre de
Pinytus fut fort admirée et tenue pour un modèle d'ardeur épiscopale. On
admit que la vigueur du zèle, quand elle s'exprime avec charité, a des droits
égaux à ceux de la prudence et de la douceur. Denys était fort opposé aux
spéculations des sectes. Ami de la paix et de l'unité, il repoussait tout ce
qui divise. Les hérésies avaient en lui un adversaire décidé. Son autorité
était telle que les hérétiques, les apôtres du diable,
comme il les appelle, falsifièrent ses lettres et y répandirent l'ivraie,
ajoutant ou retranchant ce qui leur plaisait. Quoi de surprenant, disait Denys
à ce sujet, si
certains ont eu l'audace de falsifier les écritures du Seigneur, puisqu'ils
ont osé porter la main sur des écritures qui n'avaient pas le même caractère
sacré ? L'église d'Athènes, toujours caractérisée par une sorte de
légèreté frivole, était loin d'avoir une base aussi assurée que celle de
Corinthe. Il s'y passait des choses qui n'arrivaient point ailleurs. L'évêque
Publius avait souffert courageusement le martyre ; puis il y avait eu une
apostasie presque générale, une sorte d'abandon de la religion. Un certain
Quadratus, distinct sans doute de l'apologiste, reconstitua l'église, et il y
eut comme un réveil de la foi. Denys écrivit à cette église volage non sans
quelque amertume, essayant de la ramener à la pureté de la croyance et à la
sévérité de la vie évangélique. L'église d'Athènes, comme celle de Corinthe,
avait sa légende. Elle s'était rattachée à ce Denys dit Aréopagite, dont il
est parlé dans les Actes et elle en avait fait le premier évêque d'Athènes,
tant l'épiscopat était déjà devenu la forme sans laquelle on ne concevait pas
l'existence d'une communauté chrétienne. L'Asie proconsulaire continuait d'être la première
province du mouvement chrétien. La grande bataille, les grandes persécutions,
les grands martyrs étaient là. Presque tous les évêques des villes
considérables étaient des hommes saints, éloquents, relativement sensés,
ayant reçu une bonne éducation hellénique et, si l'on peut s'exprimer ainsi,
de très habiles politiques religieux. Les évêchés étaient fort multipliés ;
mais quelques familles importantes avaient une sorte de privilège sur
l'épiscopat des petites villes. Polycrate d'Éphèse, qui, dans trente ans,
défendra si énergiquement contre l'évêque de Rome les traditions des églises
d'Asie, fut le huitième évêque de sa famille. Les évêques des grandes villes
avaient une primauté sur les autres ; ils étaient les présidents des réunions
provinciales d'évêques. L'archevêque commence à poindre, quoique le mot, si
on l'eût hasardé, eût sans doute été repoussé avec horreur. Méliton, évêque de Sardes, avait, au milieu de ces
pasteurs éminents, une sorte de supériorité incontestée. On lui accordait
unanimement le don de prophétie, et on croyait qu'il se conduisait en tout
par la lumière du Saint-Esprit. Ses écrits se succédaient d'année en année au
milieu de l'admiration universelle. Sa critique était celle du temps ; au
moins apportait-il un soin extrême à ce que sa foi fût raisonnable et
conséquente avec elle- même. à beaucoup d'égards, il rappelle Origène ; mais
il n'avait pas pour s'instruire les facilités que présentèrent à ce dernier
les écoles d'Alexandrie, de Césarée, de Tyr. Le médiocre souci qu'avaient les chrétiens de saint Paul
d'étudier l'Ancien Testament, et l'affaiblissement du judaïsme dans les
régions de l'Asie éloignées d'Éphèse, faisaient qu'il était difficile de se
procurer en ce pays des notions certaines sur les livres bibliques. On n'en
savait exactement ni le nombre ni l'ordre. Méliton, poussé par sa propre
curiosité et, à ce qu'il paraît, par les instances d'un certain Onésime, fit
un voyage en Palestine pour s'informer du véritable état du Canon. Il en
rapporta un catalogue des livres reçus universellement ; c'était purement et
simplement le canon juif, composé de vingt-deux livres, à l'exclusion
d'Esther. Les apocryphes, comme le Livre d'Henoch, l'Apocalypse d'Esdras,
Judith, Tobie, etc.., qui n'étaient pas reçus par les juifs, étaient
également exclus de la liste de Méliton. Sans être hébraïsant, Méliton se fit
le commentateur attentif de ces écrits sacrés. à la prière d'Onésime, il
réunit en six livres les passages du Pentateuque et des Prophètes qui
regardaient Jésus-Christ et les autres articles de la foi chrétienne. Il
travaillait sur les versions grecques, qu'il comparait avec le plus de
diligence possible. L'exégèse des Orientaux lui était familière ; il la
discutait de point en point. Comme l'auteur de ce qu'on appelle l'épître de
Barnabé, il paraît avoir eu une tendance marquée vers les explications
allégoriques et mystiques, et il n'est pas impossible que son ouvrage perdu,
intitulé Parmi les écrits du Nouveau Testament, Méliton ne paraît
avoir commenté que l'Apocalypse. Il en aimait les sombres images ; car nous
le voyons lui-même annoncer que la conflagration finale est proche, qu'après
le déluge de vent et le déluge d'eau, viendra le déluge de feu, qui consumera
la terre, les idoles et les idolâtres ; les justes seuls seront sauvés comme
ils le furent jadis dans l'arche. Ces croyances bizarres n'empêchaient pas
Méliton d'être, à sa manière, un esprit cultivé. Familier avec l'étude de la
philosophie, il chercha, dans une série d'ouvrages qui malheureusement se
sont presque tous perdus, à expliquer par la psychologie rationnelle les
mystères du dogme chrétien. Il écrivit, de plus, quelques traités où la
préoccupation du montanisme paraît dominer, sans qu'il soit possible de dire
s'il en était l'adversaire ou s'il y était en partie favorable. Tels furent
ses livres sur Un de ses traités, celui qu'il intitula de Si le souverain, en effet, n'agit pas injustement envers
ses sujets, et si ses sujets n'agissent pas injustement envers lui, ni les
uns envers les autres, il est clair que tout le pays vit en paix, et il en
résulte de grands biens ; car, de la sorte, le nom de Dieu est loué entre
tous. Le premier devoir du souverain, ce qui le rend le plus agréable à Dieu,
est donc de délivrer de l'erreur le peuple qui lui est soumis. Tous les maux,
en effet, viennent de l'erreur, et l'erreur capitale est de méconnaître Dieu
et d'adorer à sa place ce qui n'est pas Dieu. On voit combien Méliton est peu éloigné des dangereux
principes qui domineront à la fin du IVe siècle et feront l'empire chrétien.
Le souverain érigé en protecteur de la vérité, employant tous les moyens pour
faire triompher la vérité, voilà l'idéal que l'on rêve. Nous retrouverons les
mêmes idées dans l'Apologie adressée à Marc Aurèle. L'intolérance dogmatique,
l'idée qu'on est coupable et désagréable à Dieu en ignorant certains dogmes
est franchement avouée. Méliton n'admet aucune excuse pour l'idolâtrie. Et
ceux qui disent que l'honneur rendu aux idoles se rapporte à la personne
qu'elles représentent, et ceux qui se contentent de dire : C'est le culte de nos pères, sont
également coupables. Eh quoi ! ceux à qui leurs pères ont laissé la pauvreté
s'interdisent-ils de s'enrichir ? Ceux que leurs parents n'ont pas instruits
se condamnent-ils à ignorer ce que leurs pères ignoraient ? Les fils
d'aveugles ne refusent pas de voir, ni les fils des boiteux de marcher...
Avant d'imiter ton père, cherche s'il a été dans la bonne voie. S'il a été
dans la mauvaise, prends la bonne, pour que tes fils t'y suivent à leur tour.
Pleure sur ton père, qui s'est engagé dans la voie du mal, pendant que ta
tristesse peut le sauver encore. Quant à tes fils, dis-leur : Il y a un Dieu, père de toute chose, qui n'a pas commencé,
qui n'a pas été créé, qui fait tout subsister par sa volonté. Nous verrons bientôt la part que prit Méliton à la
controverse de Claudius Apollinaris, ou Apollinaire, maintenait l'éclat
de l'église d'Hiérapolis, et, comme Méliton, joignait la culture littéraire
et philosophique à la sainteté. Son style passa pour excellent, et sa
doctrine pour la plus pure. Par son éloignement du judéo-christianisme et son
goût pour l'évangile de Jean, il appartenait au parti du mouvement plus qu'à celui
de la tradition. Comme ce fut le mouvement qui triompha, ses adversaires ne
furent dès lors que des arriérés. Nous le verrons, presque en même temps que
Méliton, présenter une Apologie à Marc Aurèle. Il écrivit cinq livres
adressés aux païens, deux contre les juifs, deux sur Miltiade, comme Apollinaire, grand adversaire des
montanistes, fut aussi un écrivain fécond. Il composa deux livres contre les
païens, deux livres contre les juifs, sans oublier une Apologie adressée aux
autorités romaines. Musanus combattit les encratites, disciples de Tatien.
Modestus s'appliqua surtout à dévoiler les ruses et les erreurs de Marcion.
Polycrate, qui, plus tard, devait présider en quelque sorte à l'église
d'Asie, brillait déjà par ses écrits. Une foule de livres se produisaient de
tous les côtés. Jamais peut-être le christianisme n'a plus écrit que durant
le IIe siècle en Asie. La culture littéraire était extrêmement répandue dans
cette province ; l'art d'écrire y était fort commun, et le christianisme en
profitait. La littérature des Pères de l'église commençait. Les siècles
suivants ne dépassèrent pas ces premiers essais de l'éloquence chrétienne ;
mais, au point de vue de l'orthodoxie, les livres de ces Pères du IIe siècle
offraient plus d'une pierre d'achoppement. La lecture en devint suspecte ; on
les copia de moins en moins, et ainsi presque tous ces beaux écrits
disparurent, pour faire place aux écrivains classiques, postérieurs au
concile de Nicée, bien moins originaux que ceux du IIe siècle. Un certain Papirius, dont on ignore le siège épiscopal, était extrêmement estimé. Thraséas, évêque d'Euménie, dans la région du haut Méandre, eut la gloire la plus enviée, celle du martyre. Il souffrit probablement à Smyrne, puisque c'est là qu'on honorait son tombeau. Sagaris, évêque de Laodicée sur le Lycus, eut le même honneur sous le proconsulat de L. Sergius Paullus vers l'année 165. Laodicée conserva précieusement ses restes. Son nom resta d'autant plus fixé dans le souvenir des églises, que sa mort fut l'occasion d'un épisode important se rattachant à l'une des plus graves questions du temps. |