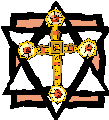MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
V - Grandeur croissante de l'Église de Rome - Écrits pseudo-Clémentins.
|
ROME devenait chaque jour de plus en plus la capitale du christianisme et remplaçait Jérusalem comme centre religieux de l'humanité. Civitas sacro-sancta ! Cette ville extraordinaire était au point culminant de sa grandeur ; rien ne permettait de prévoir les événements qui, au IIIe siècle, devaient la faire déchoir et la réduire à n'être plus que la capitale de l'Occident. Le grec y était encore au moins aussi employé que le latin, et la grande scission de l'Orient ne se laissait pas deviner. Le grec était exclusivement la langue de l'église ; la liturgie, la prédication, la propagande se faisaient en grec. Anicet présidait l'église avec une haute autorité. On le
consultait de tout le monde chrétien. On admettait pleinement que l'église de
Rome avait été fondée par Pierre ; on croyait que cet apôtre avait transmis à
son église la primauté dont Jésus l'avait revêtu ; on appliquait à cette
église les fortes paroles par lesquelles on croyait que Jésus avait conféré à
Céphas la place de pierre angulaire dans l'édifice qu'il voulait bâtir. Par
un tour de force sans égal, l'église de Rome avait réussi à rester en même
temps l'église de Paul. Pierre et Paul réconciliés, voilà le chef-d’œuvre qui
fondait la suprématie ecclésiastique de Rome dans l'avenir. Une nouvelle
dualité mythique remplaçait celle de Romulus et de Rémus. Nous avons déjà vu
la question de Parmi les Orientaux qui vinrent à Rome sous Anicet, il
faut placer un juif converti nommé Joseph ou Hégésippe, originaire sans doute
de Palestine. Il avait reçu une éducation rabbinique soignée, savait l'hébreu
et le syriaque, était très versé dans les traditions non écrites des juifs ;
mais la critique lui manquait. Comme la plupart des juifs convertis, il se
servait de l'évangile des Hébreux. Le zèle pour la pureté de la foi le porta
aux longs voyages et à une sorte d'apostolat. Il allait d'église en église,
conférant avec les évêques, s'informant de leur foi, dressant la succession
de pasteurs par laquelle ils se rattachaient aux apôtres. L'accord dogmatique
qu'il trouva entre les évêques le remplit de joie. Toutes ces petites églises
des bords de Une cause matérielle contribuait beaucoup à la prééminence
que toutes les églises reconnaissaient à l'église de Rome. Cette église était
extrêmement riche ; ses biens, habilement administrés, servaient de fonds de
secours et de propagande aux autres églises. Les confesseurs condamnés aux
mines recevaient d'elle un subside. Le trésor commun du christianisme était
en quelque sorte à Rome. La collecte du dimanche, pratique constante dans
l'église romaine, était déjà probablement établie. Un merveilleux esprit de
direction animait cette petite communauté, où Le nom de Clément fut le garant fictif que choisirent les faussaires pour servir de couverture à leurs pieux desseins. La grande réputation qu'avait laissée le vieux pasteur romain, le droit qu'on lui reconnaissait de donner en quelque sorte son apostille aux livres qui méritaient de circuler, le recommandaient pour ce rôle. Sur la base des Cerygmata et des Periodi de Pierre, un auteur inconnu, né païen et entré dans le christianisme par la porte esséno-ébionite, bâtit un roman dont Clément fut censé être à la fois l'auteur et le héros. Ce précieux écrit, intitulé Les Reconnaissances, à cause des surprises du dénouement, nous est parvenu dans deux rédactions assez différentes l'une de l'autre, et dont probablement ni l'une ni l'autre n'est primitive. Toutes deux paraissent provenir d'un écrit perdu, qui fit, vers le temps où nous sommes, sa première apparition. L'auteur part de l'hypothèse que Clément fut le successeur immédiat de Pierre dans la présidence de l'église de Rome et reçut du prince des apôtres l'ordination épiscopale. De même que les Cerygmata étaient dédiés à Jacques, de même le nouveau roman porte en tête une épître où Clément fait part à Jacques, évêque des évêques et chef de la sainte église des Hébreux à Jérusalem, de la mort violente de Pierre, et raconte comment cet apôtre, le premier de tous, le vrai compagnon, le vrai ami de Jésus, constitué par Jésus base unique de l'église, l'a établi, lui Clément, comme son successeur dans l'épiscopat de Rome, et lui a recommandé d'écrire en abrégé et d'adresser à Jacques le récit de leurs voyages et de leurs prédications en commun. L'ouvrage ne parle pas du séjour de Pierre à Rome ni des circonstances de sa mort. Ces derniers récits formaient sans doute le fond d'un second ouvrage qui servait de suite à celui qui nous a été conservé. L'esprit ébionite, hostile à Paul, qui faisait le fond des premiers Cerygmata, est ici fort effacé. Paul n'est pas nommé dans tout l'ouvrage. Ce n'est sûrement pas sans raison que l'auteur affecte de ne connaître en fait d'apôtres que les douze présidés par Pierre et Jacques, et qu'il attribue à Pierre seul l'honneur d'avoir répandu le christianisme dans le monde païen. En une foule d'endroits, les injures des judéo-chrétiens se laissent encore entrevoir ; mais tout est dit à demi-mot ; un disciple de Paul pouvait presque lire le livre sans être choqué. Peu à peu, en effet, cette histoire calomnieuse des luttes apostoliques, inventée par une école haineuse, mais qui avait des parties faites pour plaire à tous les chrétiens, perdit sa couleur sectaire, devint presque catholique et se fit adopter de la plupart des fidèles. Les allusions contre saint Paul étaient devenues assez obscures. Simon le Magicien restait chargé de tout l'odieux du récit ; on oubliait les allusions que son nom avait servi à voiler, on ne voyait plus en lui qu'un dédoublement de Néron dans le rôle infernal de l'Antéchrist. L'ouvrage est composé selon toutes les règles du roman antique. Rien n'y manque : voyages, épisodes d'amour, naufrages, jumeaux qui se ressemblent, gens pris par les pirates, reconnaissances de personnes qu'une longue série d'aventures avaient séparées. Clément, par suite d'une confusion qui se produisit dès une époque fort ancienne, est considéré comme appartenant à la famille impériale. Mattidie, sa mère, est une dame romaine parfaitement chaste, mariée au noble Faustus. Poursuivie d'un amour criminel par son beau-frère, voulant à la fois sauver son honneur et la réputation de sa famille, elle quitte Rome, avec la permission de son mari, et part pour Athènes afin d'y faire élever ses fils, Faustin et Faustinien. Au bout de quatre ans, ne recevant pas de leurs nouvelles, Faustus s'embarque avec son troisième fils, Clément, pour aller à la recherche de sa femme et de ses deux fils. à travers mille aventures, le père, la mère les trois fils se retrouvent. Ils n'étaient pas d'abord chrétiens, mais tous méritaient de l'être, tous le deviennent. Païens, ils avaient eu des mœurs honnêtes ; or la chasteté a ce privilège que Dieu se doit à lui-même de sauver ceux qui la pratiquent par instinct naturel. Si ce n'était une règle absolue qu'on ne peut être sauvé sans le baptême, les païens chastes seraient sauvés. Les infidèles qui se convertissent sont ceux qui l'ont mérité par leurs mœurs réglées. Clément, en effet, rencontre les apôtres Pierre et Barnabé, se fait leur compagnon, nous raconte leurs prédications, leurs luttes contre Simon, et devient pour tous les membres de sa famille l'occasion d'une conversion à laquelle ils étaient si bien préparés. Ce cadre romanesque n'est qu'un prétexte pour faire l'apologie de la religion chrétienne, et montrer combien elle est supérieure aux opinions philosophiques et théurgiques du temps. Saint Pierre n'est plus l'apôtre galiléen que nous connaissons par les Actes et les lettres de Paul ; c'est un polémiste habile, un philosophe, un maître homme, qui met toutes les roueries du métier de sophiste au service de la vérité. La vie ascétique qu'il mène, sa rigoureuse xérophagie rappellent les esséniens. Sa femme voyage avec lui comme une diaconesse. Les idées que l'on se faisait de l'état social au milieu duquel vécurent Jésus et ses apôtres étaient déjà tout à fait erronées. Les données les plus simples de la chronologie apostolique étaient méconnues. Il faut dire, à la louange de l'auteur, que, si sa
confiance dans la crédulité du public est bien naïve, il a du moins une foi
dans la discussion qui fait honneur à sa tolérance. Il admet très bien qu'on
peut se tromper innocemment. Parmi les personnages du roman, Simon le
Magicien seul est tout à fait sacrifié. Ses disciples Apion et Anubion
représentent, le premier, l'effort pour tirer de la mythologie quelque chose
de religieux ; le second, la sincérité égarée, qui sera un jour récompensée
par la connaissance de la vérité. Simon et Pierre disputent de métaphysique ;
Clément et Apion disputent de morale. Une touchante nuance de sympathie et de
pitié pour les errants répand le charme sur ces pages, qu'on sent écrites par
quelqu'un qui a traversé les angoisses du scepticisme et sait mieux que
personne ce qu'on peut souffrir et acquérir de mérites en cherchant la
vérité. Clément, comme Justin de Néropolis, a essayé de toutes les
philosophies ; les hauts problèmes de l'immortalité de l'âme, des récompenses
et des peines futures, de
Le système de réfutation du paganisme qui fera la base de l'argumentation de tous les Pères se trouve déjà complet dans pseudo-Clément. Le sens primitif de la mythologie était perdu chez tout le monde ; les vieux mythes physiques, devenus des historiettes messéantes, n'offraient plus aucun aliment pour les âmes. Il était facile de montrer que les dieux de l'Olympe ont donné de très mauvais exemples et qu'en les imitant on serait un scélérat. Apion cherche vainement à s'échapper par les explications symboliques. Clément établit sans peine l'absolue impuissance du polythéisme à produire une morale sérieuse. Clément a d'invincibles besoins de coeur : honnête, pieux, candide, il veut une religion qui satisfasse sa vive sensibilité. Un moment les deux adversaires se rappellent des souvenirs de jeunesse, dont ils se font maintenant des armes de combat. Apion avait été autrefois l'hôte du père de Clément. Voyant un jour ce dernier triste et malade des tourments qu'il se donnait pour chercher le vrai, Apion, qui avait des prétentions médicales, lui demanda ce qu'il avait : Le mal des jeunes !... j'ai mal à l'âme, lui répondit Clément. Apion crut qu'il s'agissait d'amour, lui fit les ouvertures les plus inconvenantes et composa pour lui une pièce de littérature érotique, que Clément fait intervenir dans le débat avec plus de malice que d'à-propos. La philosophie du livre est le déisme considéré comme un fruit de la révélation, non de la raison. L'auteur parle de Dieu, de sa nature, de ses attributs, de sa providence, du mal considéré comme épreuve et comme source de mérite pour l'homme, à la façon de Cicéron ou d'épictète. Esprit lucide et droit, opposé aux aberrations montanistes et au quasi-polythéisme des gnostiques, l'auteur du roman pseudo-clémentin est un strict monothéiste, ou, comme on disait alors, un monarchien. Dieu est l'être dont l'essence ne convient qu'à lui seul. Le Fils lui est par nature inférieur. Ces idées, fort analogues à celles de pseudo-Hermas, furent longtemps la base de la théologie romaine. Loin que ce fussent là des pensées révolutionnaires, c'étaient à Rome les théories conservatrices. C'était au fond la théologie des nazaréens et des ébionites, ou plutôt de Philon et des esséniens, développée dans le sens du gnosticisme. Le monde est le théâtre de la lutte du bien et du mal. Le bien gagne toujours un peu sur le mal et finira par l'emporter. Les triomphes partiels du bien s'opèrent au moyen de l'apparition de prophètes successifs, Adam, Abel, Hénoch, Noé, Abraham, Moïse ; ou plutôt un seul prophète, Adam immortel et impeccable, l'homme-type par excellence, la parfaite image de Dieu, le Christ, toujours vivant, toujours changeant de forme et de nom, parcourt sans cesse le monde et remplit l'histoire, prêchant éternellement la même loi du même Esprit saint. La vraie loi de Moïse avait presque réalisé l'idéal de la religion absolue. Mais Moïse n'écrivit rien, et ses institutions furent altérées par ses successeurs. Les sacrifices furent une victoire du paganisme sur la loi pure. Une foule d'erreurs se sont glissées dans l'Ancien Testament. David, avec sa harpe et ses guerres sanglantes, est un prophète déjà bien inférieur. Les autres prophètes furent moins encore de parfaits Adam-Christ. La philosophie grecque, de son côté, est un tissu de chimères, une vraie logomachie. L'esprit prophétique, qui n'est autre chose que l'Esprit saint manifesté, l'homme primitif, Adam tel que Dieu l'avait fait, est apparu alors en un dernier Christ, en Jésus, qui est Moïse lui-même ; si bien qu'entre l'un et l'autre il n'y a point de lutte ni de rivalité. Croire en l'un, c'est croire en l'autre, c'est croire en Dieu. Le chrétien, pour être chrétien, ne cesse pas d'être juif (Clément se donne toujours ce dernier nom ; lui et toute sa famille se font juifs). Le juif qui connaît Moïse et ne connaît pas Jésus ne sera pas condamné s'il pratique bien ce qu'il connaît et ne hait pas ce qu'il ignore. Le chrétien païen d'origine, qui connaît Jésus et ne connaît pas Moïse, ne sera pas condamné s'il observe la loi de Jésus et ne hait pas la loi qui ne lui est point parvenue. La révélation, du reste, n'est que le rayon par lequel des vérités cachées dans le cœur de tous les hommes deviennent visibles pour chacun d'eux ; connaître ainsi, ce n'est pas apprendre, c'est comprendre. La relation de Jésus avec Dieu a été celle de tous les autres prophètes. Il a été l'instrument de l'Esprit, voilà tout. L'Adam idéal, qui se trouve plus ou moins obscurci chez tout homme venant en ce monde, est, chez les prophètes, colonnes du monde, à l'état de claire connaissance et de pleine possession. Notre-Seigneur, dit Pierre, n'a jamais dit qu'il y eût d'autre Dieu que celui qui a créé toute chose, et ne s'est pas proclamé Dieu ; il a seulement, avec raison, déclaré heureux celui qui l'avait proclamé fils du Dieu qui a tout créé. - Mais ne te semble-t-il pas, dit Simon, que celui qui provient de Dieu est Dieu ? - Comment cela pourrait-il être ? répond Pierre. L'essence du Père est de n'avoir pas été engendré ; l'essence du Fils est d'avoir été engendré ; or, ce qui a été engendré ne saurait se comparer à ce qui n'a pas été engendré ou à ce qui s'engendre soi-même. Celui qui n'est pas en tout identique à un autre être ne peut avoir les mêmes appellations communes avec lui. Jamais l'auteur ne parle de la mort de Jésus et ne laisse croire qu'il attache une importance théologique à cette mort. Jésus est donc un prophète, le dernier des prophètes, celui que Moïse avait annoncé comme devant venir après lui. Sa religion n'est qu'une épuration de celle de Moïse, un choix entre des traditions dont les unes étaient bonnes, les autres mauvaises. Sa religion est parfaite ; elle convient aux juifs et aux Hellènes, aux hommes instruits et aux barbares ; elle satisfait également le cœur et l'esprit. Elle se continue dans le temps par les douze apôtres, dont le chef est Pierre, et par ceux qui tiennent d'eux leurs pouvoirs. L'appel à des songes, à des visions privées, est le fait de présomptueux. Mélange bizarre d'ébionisme et de libéralisme philosophique, de catholicisme étroit et d'hérésie, d'amour exalté pour Jésus et de crainte qu'on n'exagère son rôle, d'instruction profane et de théosophie chimérique, de rationalisme et de foi, le livre ne pouvait satisfaire longtemps l'orthodoxie ; mais il convenait à une époque de syncrétisme, où les points divers de la foi chrétienne étaient mal définis. Il a fallu les prodiges de sagacité de la critique moderne pour reconnaître encore la satire de Paul derrière le masque de Simon le Magicien. Le livre est, en somme, un livre de conciliation. C'est l’œuvre d'un ébionite modéré, d'un esprit éclectique, opposé en même temps aux jugements injustes des gnostiques et de Marcion contre le judaïsme et à la prophétie féminine des disciples de Montan. La circoncision n'est pas commandée ; cependant le circoncis a un rang supérieur à celui de l'incirconcis. Jésus vaut Moïse ; Moïse vaut Jésus. La perfection est de voir que tous deux ne font qu'un, que la nouvelle loi est l'antique, et l'antique la nouvelle. Ceux qui ont l'une peuvent se passer de l'autre. Que chacun reste chez soi et ne haïsse pas les autres. C'était, on le voit, l'absolue négation de la doctrine de Paul. Jésus est pour notre théologien un restaurateur plutôt qu'un novateur. Dans l’œuvre même de cette restauration, Jésus n'est que l'interprète d'une tradition de sages, qui, au milieu de la corruption générale, n'avaient jamais perdu le vrai sens de la loi de Moïse, laquelle n'est elle-même que la religion d'Adam la religion primitive de l'humanité. Selon pseudo-Clément, Jésus, c'est Adam lui-même. Selon saint Paul, Jésus est un second Adam, en tout l'opposé du premier. L'idée de la chute d'Adam, base de la théologie de saint Paul, est ici presque effacée. Par un côté surtout, l'auteur ébionite se montre plus sensé que Paul. Paul ne cessa toujours de protester que l'homme ne doit à aucun mérite personnel son élection et sa vocation chrétienne. L'ébionite, plus libéral, croit que le païen honnête prépare sa conversion par ses vertus. Il est loin de penser que tous les actes des infidèles sont des péchés. Les mérites de Jésus n'ont pas, à ses yeux, le rôle transcendant qu'ils ont dans le système de Paul. Jésus met l'homme en rapport avec Dieu ; mais il ne se substitue pas à Dieu. Le roman pseudo-clémentin se sépare nettement des écrits vraiment authentiques de la première inspiration chrétienne par sa prolixité, sa rhétorique, sa philosophie abstraite, empruntée, pour la plus grande partie, aux écoles grecques. Ce n'est plus ici un livre sémitique, sans nuance, comme les écrits purement judéo-chrétiens. Grand admirateur du judaïsme, l'auteur a l'esprit gréco-italien, l'esprit politique, préoccupé avant tout de la nécessité sociale, de la morale du peuple. Sa culture est tout hellénique ; de l'hellénisme, il ne repousse qu'une seule chose, la religion. L'auteur se montre à tous égards bien supérieur à saint Justin. Une fraction considérable de l'église adopta l'ouvrage et lui fit une place à côté des livres les plus révérés de l'âge apostolique, sur les confins du Nouveau Testament. Les grosses erreurs qu'on y lisait sur la divinité de Jésus-Christ et sur les livres saints s'opposèrent à ce qu'il y restât ; mais on continua de le lire ; les orthodoxes répondaient à tout en disant que Clément avait écrit son livre sans tache, qu'ensuite des hérétiques l'avaient altéré. On en fit des extraits, où les passages malsonnants étaient omis, et auxquels on attribua volontiers la théopneustie. Nous avons vu et nous verrons bien d'autres exemples de romans inventés par les hérétiques forçant ainsi les portes de l'église orthodoxe et se faisant accepter d'elle, parce qu'ils étaient édifiants et susceptibles de fournir un aliment à la piété. Le fait est que cette littérature ébionite, malgré sa naïveté un peu enfantine, avait au plus haut degré l'onction chrétienne. Le ton était celui d'une prédication émue ; le caractère en était essentiellement ecclésiastique et pastoral. Pseudo-Clément est un partisan de la hiérarchie au moins aussi exalté que pseudo-Ignace. La communauté se résume en son chef ; le clergé est l'indispensable médiateur entre Dieu et le troupeau. Il faut deviner l'évêque à demi-mot, ne pas attendre qu'il vous dise : Tel homme est mon ennemi, pour fuir cet homme. être ami de quelqu'un que l'évêque n'aime pas, parler à quelqu'un qu'il évite, c'est se mettre hors de l'église, se placer au rang de ses pires ennemis. La charge de l'évêque est si difficile ! Chacun doit travailler à la lui faciliter ; les diacres sont les yeux de l'évêque, ils doivent tout surveiller, tout savoir pour lui. Une sorte d'espionnage est recommandé ; ce qu'on peut appeler l'esprit clérical n'a jamais été exprimé en traits plus forts. Les abstinences et les pratiques esséniennes étaient placées très haut. La pureté des mœurs était la principale préoccupation de ces bons sectaires. L'adultère, à leurs yeux, est pire que l'homicide. La femme chaste est la plus belle chose du monde, le plus parfait souvenir de la création primitive de Dieu. La femme pieuse, qui ne trouve son plaisir qu'avec les saints, est l'ornement, le parfum et l'exemple de l'église ; elle aide les chastes à être chastes ; elle charme Dieu lui-même. Dieu l'aime, la désire, se la garde ; elle est son enfant, la fiancée du Fils de Dieu, vêtue qu'elle est de lumière sainte. Ces mystiques images ne font pas de l'auteur un partisan de la virginité. Il est trop juif pour cela. Il veut que les prêtres marient les jeunes gens de bonne heure, fassent marier même les vieillards. La femme chrétienne aime son mari, le couvre de caresses, le flatte, le sert, cherche à lui plaire, lui obéit en tout ce qui n'est pas une désobéissance à Dieu. être aimé d'un autre que son mari est pour elle une vive peine. Oh ! combien fou est le mari qui cherche à séparer sa femme de la crainte de Dieu ! La grande source de la chasteté, c'est l'église. C'est là que la femme apprend ses devoirs et entend parler de ce jugement de Dieu qui punit un moment de plaisir d'un supplice éternel. Le mari devrait forcer sa femme d'aller à de tels sermons, s'il n'y réussissait par les caresses. Mais ce qu'il y a de mieux, ajoute l'auteur s'adressant au mari, c'est que tu y viennes toi-même, la conduisant par la main, pour que, toi aussi, tu sois chaste et puisses connaître le bonheur du mariage respectable. Devenir père, aimer tes enfants, être aimé d'eux, tout cela est à ta disposition, si tu le désires. Celui qui veut avoir une femme chaste vit chastement, lui rend le devoir conjugal, mange avec elle, vit avec elle, vient avec elle au prêche sanctifiant, ne l'attriste pas, ne la querelle pas sans raison, cherche à lui plaire, lui procure tous les agréments qu'il peut, et supplée à ceux qu'il ne peut lui donner par ses caresses. Ces caresses, du reste, la femme chaste ne les attend pas pour remplir ses devoirs. Elle tient son mari pour son maître. Est-il pauvre, elle supporte sa pauvreté ; elle a faim avec lui, s'il a faim ; émigre-t-il, elle émigre ; elle le console quand il est triste ; quand même elle aurait une dot supérieure à l'avoir de son mari, elle prend l'attitude subalterne de quelqu'un qui n'a rien. Le mari, de son côté, s'il a une femme pauvre, doit considérer sa sagesse comme une ample dot. La femme sage est sobre sur le boire et le manger ; ... elle ne reste jamais seule avec des jeunes gens, elle se défie même des vieillards, elle évite les rires désordonnés, ... elle se plaît aux discours graves, elle fuit ceux qui n'ont pas trait à la bienséance. La bonne Mattidie, mère de Clément, est un exemple de la mise en pratique de ces pieuses maximes. Païenne, elle sacrifie tout à la chasteté ; la chasteté la préserve des plus grands périls et lui vaut la connaissance de la vraie religion. La prédication chrétienne se développait, se mêlait au culte. Le sermon était la partie essentielle de la réunion sacrée. L'église devenait la mère de toute édification et de toute consolation. Les règles sur la discipline ecclésiastique se multipliaient déjà. Pour leur donner de l'autorité, on les rapportait aux apôtres, et, comme Clément était censé le meilleur garant quand il s'agissait de traditions apostoliques, puisqu'il avait été dans des relations intimes avec Pierre et Barnabé, ce fut encore sous le nom de ce vénéré pasteur que l'on vit éclore toute une littérature apocryphe de Constitutions censées établies par le collège des Douze. Le noyau de cette compilation apocryphe, première base d'un recueil de canons ecclésiastiques, s'est conservé à peu près sans mélange chez les Syriens. Chez les Grecs, le recueil, grossi avec le temps, s'altéra sensiblement et devint presque méconnaissable. On le cita comme faisant partie des écritures sacrées, quoique toujours certaines réserves en aient rendu douteuse la canonicité. De bonne heure, on s'accorda la liberté de donner à ce recueil de dires prétendus apostoliques la forme qu'on jugea la plus propre à frapper les fidèles et à leur imposer ; toujours le nom de Clément fut inscrit en tête de ces rédactions diverses, qui offrent, du reste, avec le roman des Reconnaissances les traits de la plus étroite parenté. Toute la littérature pseudo-clémentine du IIe siècle présente ainsi le caractère d'une parfaite unité. Ce qui la caractérise au plus haut degré, c'est l'esprit
d'organisation pratique. Déjà, dans l'épître supposée de Clément à Jacques,
qui sert de préface aux Reconnaissances, Pierre, avant de mourir, tient un
long discours sur l'épiscopat, ses devoirs, ses difficultés, son excellence,
sur les prêtres, les diacres, les catéchistes, qui est comme une édition
nouvelle des épîtres à Tite et à Timothée. Les Constitutions apostoliques
furent une sorte de codification, successivement agrandie, de ces préceptes
pastoraux. Ce que Rome fonda, ce n'est pas le dogme ; peu d'églises furent
plus stériles en spéculations, moins pures sous le rapport de la doctrine :
l'ébionisme, le montanisme, l'artémonisme, y eurent tour à tour la majorité.
Ce que Rome fit, c'est la discipline, c'est le catholicisme. à Rome,
probablement le mot d'église catholique fut écrit pour la première
fois. évêque, prêtre, laïque, tous ces mots prennent dans cette église
hiérarchique un sens déterminé. L'église est un navire où chaque dignitaire a
sa fonction pour le salut des passagers. La morale était sévère et sent déjà
le cloître. Le simple goût de la richesse est condamné. La parure des femmes
n'est qu'une invitation à pécher. La femme est responsable des péchés de
pensée qu'elle fait commettre. Sûrement, si elle repousse les avances, le mal
est moindre ; mais n'est-ce rien d'être cause de la perdition des autres ?
Vivre modestement occupé de son métier, aller son chemin, sans se mêler aux
commérages de la rue, bien élever ses enfants, leur administrer de fréquentes
corrections, leur interdire les dîners par écot avec les personnes de leur
âge, les marier de bonne heure, ne pas lire les livres païens ( L'église, en effet, absorbait tout ; la société civile était avilie et méprisée. à l'empereur on doit le cens et les salutations officielles, voilà tout. Le chrétien ainsi formé ne peut vivre qu'avec des chrétiens. Il était recommandé d'attirer les païens par le charme de manières aimables, quand on pouvait espérer qu'ils se convertiraient. Mais, en dehors de cette espérance, les relations avec les infidèles étaient entourées de telles précautions et impliquaient tant de mépris, qu'elles devaient être bien rares. Une société mixte de païens et de chrétiens sera impossible. Il est défendu de prendre part aux réjouissances des païens, de manger et de se divertir avec eux, d'assister à leurs spectacles, à leurs jeux, à toutes les grandes réunions profanes. Même les marchés publics sont interdits, sauf en ce qui concerne l'achat des choses nécessaires. Au contraire, les chrétiens doivent autant que possible manger ensemble, vivre ensemble, former une petite coterie de saints. Au IIIe siècle, cet esprit de réclusion portera ses conséquences. La société romaine mourra d'épuisement ; une cause cachée lui soutirera la vie. Quand une partie considérable d'un état fait bande à part et cesse de travailler à l’œuvre commune, cet état est bien près de mourir. L'assistance mutuelle était la fonction capitale dans cette société de pauvres, administrée par ses évêques, ses diacres et ses veuves. La situation du riche, au milieu de petits bourgeois et de petits marchands honnêtes, jugeant leurs affaires entre eux, scrupuleux sur leurs poids et leurs mesures, était difficile, embarrassée. La vie chrétienne n'était pas faite pour lui. Un frère mourait-il, laissant des orphelins et des orphelines, un autre frère adoptait les orphelins, mariait l'orpheline à son fils, si l'âge s'accordait. Cela paraissait tout simple. Les riches se prêtaient difficilement à un système aussi fraternel ; on les menaçait alors de se voir arracher les biens dont ils ne savaient pas faire un bon usage ; on leur appliquait le dicton : Ce que les saints n'ont pas mangé, les Assyriens le mangent. L'argent des pauvres passait pour chose sacrée ; ceux qui étaient dans l'aisance payaient une cotisation aussi forte que possible ; c'est ce qu'on appelait les contributions du Seigneur. On poussait la délicatesse jusqu'à ne pas accepter dans la caisse de l'église l'argent de tout le monde. On repoussait l'offrande des cabaretiers et des gens qui pratiquaient des métiers infâmes, surtout celle des excommuniés, qui cherchaient par leurs générosités à rentrer en grâce. Ce sont ceux-là qui donnent, disaient quelques-uns, et, si nous refusons leurs aumônes, comment ferons-nous pour assister nos veuves, pour nourrir les pauvres du peuple ? - Mieux vaut mourir de faim, répondait l'ébion fanatique, que d'avoir de l'obligation aux ennemis de Dieu pour des dons qui sont un affront aux yeux de ses amis. Les bonnes offrandes sont celles que l'ouvrier prend sur le fruit de son travail. Quand le prêtre est forcé de recevoir l'argent des impies, qu'il l'emploie à acheter le bois, le charbon, pour que la veuve et l'orphelin ne soient pas condamnés à vivre d'un argent souillé. Les présents des impies sont ainsi la pâture du feu, non la nourriture des fidèles. On voit quelle chaîne étroite enserrait la vie chrétienne. Un tel abîme séparait, dans l'esprit de ces bons sectaires, le bien et le mal, que la conception d'une société libérale, où chacun agit à sa guise, sous la tutelle des lois civiles, sans rendre de compte à personne ni exercer de surveillance sur personne, leur eût paru le comble de l'impiété. |