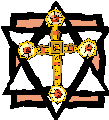MARC-AURÈLE OU LA FIN DU
IV - Persécution contre les Chrétiens.
|
L'empereur avait pour principe de maintenir les anciennes maximes romaines dans leur intégrité. C'était plus qu'il n'en fallait pour que le nouveau règne fût peu favorable à l'église. La tradition romaine est un dogme pour Marc Aurèle ; il s'excite à la vertu comme homme, comme Romain. Les préjugés du stoïcien se doublèrent ainsi de ceux du patriote, et il fut écrit que le meilleur des hommes commettrait la plus lourde des fautes, par excès de sérieux, d'application et d'esprit conservateur. Ah ! s'il avait eu quelque chose de l'étourderie d'Adrien, du rire de Lucien ! Marc Aurèle connut certainement beaucoup de chrétiens. Il en avait parmi ses domestiques, près de lui ; il conçut pour eux peu d'estime. Le genre de surnaturel qui faisait le fond du christianisme lui était antipathique, et il avait contre les juifs les sentiments de tous les Romains. Il semble bien qu'aucune rédaction des textes évangéliques ne passa sous ses yeux ; le nom de Jésus lui fut peut-être inconnu ; ce qui le frappa comme stoïcien, ce fut le courage des martyrs. Mais un trait le choqua, ce fut leur air de triomphe, leur façon d'aller spontanément au-devant de la mort. Cette bravade contre la loi lui parut mauvaise ; comme chef d'état, il y vit un danger. Le stoïcisme, d'ailleurs, enseignait non pas à chercher la mort, mais à la supporter. Épictète n'avait-il pas présenté l'héroïsme des Galiléens comme l'effet d'un fanatisme endurci ? Ælius Aristide s'exprime à peu près de la même manière. Ces morts voulues parurent à l'auguste moraliste des affectations aussi peu raisonnables que le suicide théâtral de Pérégrinus. On trouva cette note dans son carnet de pensées : Disposition de l'âme toujours prête à se séparer du corps, soit pour s'éteindre, soit pour se disperser, soit pour persister. Quand je dis prête, j'entends que ce soit par l'effet d'un jugement propre, non par pure opposition, comme chez les chrétiens ; il faut que ce soit un acte réfléchi, grave, capable de persuader les autres, sans mélange de faste tragique. Il avait raison ; mais le vrai libéral doit tout refuser aux fanatiques, même le plaisir d'être martyrs. Marc Aurèle ne changea rien aux règles établies contre les chrétiens. Les persécutions étaient la conséquence des principes fondamentaux de l'empire en fait d'association. Marc Aurèle, loin d'exagérer la législation antérieure, l'atténua de toutes ses forces, et une des gloires de son règne est l'extension qu'il donna aux droits des collèges. Son rescrit prononçant la déportation contre les agitations superstitieuses s'appliquait bien plus aux prophéties politiques ou aux escrocs qui exploitaient la crédulité publique qu'à des cultes établis. Cependant il n'alla pas jusqu'à la racine ; il n'abolit pas complètement les lois contre les collegia illicita, et il en résulta dans les provinces quelques applications infiniment regrettables. Le reproche qu'on peut lui faire est celui-là même qu'on pourrait adresser aux souverains de nos jours qui ne suppriment pas d'un trait de plume toutes les lois restrictives des libertés de réunion, d'association, de la presse. à la distance où nous sommes, nous voyons bien que Marc Aurèle, en étant plus complètement libéral, eût été plus sage. Peut-être le christianisme, laissé libre, eût-il développé d'une façon moins désastreuse le principe théocratique et absolu qui était en lui. Mais on ne saurait reprocher à un homme d'état de n'avoir pas provoqué une révolution radicale en prévision des événements qui doivent arriver plusieurs siècles après lui. Trajan, Adrien, Marc Aurèle ne pouvaient connaître des principes d'histoire générale et d'économie politique qui n'ont été aperçus qu'au XIXe siècle et que nos dernières révolutions pouvaient seules révéler. En tout cas, dans l'application, la mansuétude du bon empereur fut à l'abri de tout reproche. On n'a pas, à cet égard, le droit d'être plus difficile que Tertullien, qui fut, dans son enfance et sa jeunesse, le témoin oculaire de cette lutte funeste. Consultez vos annales, dit-il aux magistrats romains, vous y verrez que les princes qui ont sévi contre nous sont de ceux qu'on tient à honneur d'avoir eu pour persécuteurs. Au contraire, de tous les princes qui ont connu les lois divines et humaines, nommez-en un seul qui ait persécuté les chrétiens. Nous pouvons même en citer un qui s'est déclaré leur protecteur, le sage Marc Aurèle. S'il ne révoqua pas ouvertement les édits contre nos frères, il en détruisit l'effet par les peines sévères qu'il établit contre leurs accusateurs. Le torrent de l'admiration universelle entraîna les chrétiens eux-mêmes. Grand et bon, tels sont les deux mots par lesquels un chrétien du IIIe siècle résume le caractère de ce doux persécuteur. Il faut se rappeler que l'Empire romain était dix ou douze
fois grand comme Tous les pasteurs, tous les hommes graves détournaient les fidèles d'aller s'offrir eux-mêmes au martyre ; mais on ne pouvait commander à un fanatisme qui voyait dans la condamnation le plus beau des triomphes et dans les supplices une manière de volupté. En Asie, cette soif de la mort était contagieuse et produisait des phénomènes analogues à ceux qui, plus tard, se développèrent sur une grande échelle chez les circoncellions d'Afrique. Un jour le proconsul d'Asie, Arrius Antoninus, ayant ordonné de rigoureuses poursuites contre quelques chrétiens, vit tous les fidèles de la ville se présenter en masse à la barre de son tribunal, réclamant le sort de leurs coreligionnaires élus pour le martyre ; Arrius Antoninus, furieux, en fit conduire un petit nombre au supplice et renvoya les autres en leur disant : Allez-vous-en, misérables ! Si vous tenez tant à mourir, vous avez des précipices, vous avez des cordes. Quand, au sein d'un grand état, une faction a des intérêts
opposés à ceux de tout le reste, la haine est inévitable. Or, les chrétiens
désiraient, au fond, que tout allât pour le plus mal. Loin de faire cause
commune avec les bons citoyens et de chercher à conjurer les dangers de la
patrie, les chrétiens en triomphaient. Les montanistes,
D'atroces calomnies, des railleries sanglantes, étaient la revanche que prenaient les païens. La plus abominable des calomnies était l'accusation d'adorer les prêtres par des baisers infâmes. L'attitude du pénitent dans la confession put donner lieu à cet ignoble bruit. D'odieuses caricatures circulaient dans le public, s'étalaient sur les murs. L'absurde fable selon laquelle les juifs adoraient un âne faisait croire qu'il en était de même des chrétiens. Ici, c'était l'image d'un crucifié à tête d'âne recevant l'adoration d'un gamin ébouriffé. Ailleurs, c'était un personnage à longue toge et à longues oreilles, le pied fendu en sabot, tenant un livre d'un air béat, avec cette épigraphe : DEVS CHRISTIANORVM ONOKOITHC. Un juif apostat, devenu valet d'amphithéâtre, en fit une grande caricature peinte, à Carthage, dans les dernières années du IIe siècle. Un mystérieux coq, ayant pour bec un phallus et pour inscription COTHP KOCMOY, peut aussi se rapporter aux croyances chrétiennes. Le goût des catéchistes pour les femmes et les enfants donnait lieu à mille plaisanteries. Opposée à la sécheresse du paganisme, l'église faisait l'effet d'un conventicule d'efféminés. Le sentiment tendre de tous pour tous, entretenu par l'aspasmos et exalté par le martyre, créait une sorte d'atmosphère de mollesse, pleine d'attrait pour les âmes douces et de danger pour certaines autres. Ce mouvement de bonnes femmes affairées autour de l'église, l'habitude de s'appeler frères et sœurs, ce respect pour l'évêque, amenant à s'agenouiller fréquemment devant lui, avaient quelque chose de choquant et provoquaient des interprétations ineptes. Le grave précepteur qui se voyait enlever ses élèves par cet attrait féminin en concevait une haine profonde, et croyait servir l'état en cherchant à se venger. Les enfants, en effet, se laissaient facilement entraîner aux paroles de mysticité tendre qui leur arrivaient furtivement, et parfois cela leur attirait, de la part de leurs parents, de sévères punitions. Ainsi la persécution atteignait un degré de vivacité qu'elle n'avait pas encore eu jusque-là. La distinction du simple fait d'être chrétien et des crimes connexes au nom fut oubliée. Dire : Je suis chrétien, ce fut signer un aveu dont la conséquence pouvait être un arrêt de mort. La terreur devint l'état habituel de la vie chrétienne. Les dénonciations venaient de tous les côtés, surtout des esclaves, des juifs, des maris païens. La police, connaissant les lieux et les jours où se tenaient les réunions, faisait dans la salle des irruptions subites. L'interrogatoire des inculpés fournissait aux fanatiques des occasions de briller. Les Actes de ces procédures furent recueillis par les fidèles comme des pièces triomphales ; on les étala ; on les lut avidement ; on en fit un genre de littérature. La comparution devant le juge devint une préoccupation, on s'y prépara avec coquetterie. La lecture de ces pièces, où toujours le beau rôle appartenait à l'accusé, exaltait les imaginations, provoquait des imitateurs, inspirait la haine de la société civile et d'un état de choses où les bons pouvaient être ainsi traités. Les horribles supplices du droit romain étaient appliqués dans toute leur rigueur. Le chrétien, comme humilior et même comme infâme, était puni par la croix, les bêtes, le feu, les verges. La mort était quelquefois remplacée par la condamnation aux mines et la déportation en Sardaigne. Cruel adoucissement ! Dans l'application de la question, les juges portaient un complet arbitraire et parfois une véritable perversion d'idées. C'est là un désolant spectacle. Nul n'en souffre plus que
le véritable ami de la philosophie. Mais qu'y faire ? On ne peut être à la
fois deux choses contradictoires. Marc Aurèle était romain ; quand il
persécutait, il agissait en Romain. Dans soixante ans, un empereur aussi bon
de cœur, mais moins éclairé d'esprit que Marc Aurèle, Alexandre Sévère,
remplira, sans égard pour aucune des maximes romaines, le programme du vrai
libéralisme ; il accordera la liberté complète de conscience, retirera les
lois restrictives de la liberté d'association. Nous l'approuvons entièrement.
Mais Alexandre Sévère fit cela parce qu'il était syrien, étranger à la
tradition impériale. Il échoua, du reste, complètement dans son entreprise.
Tous les grands restaurateurs de la chose romaine qui paraîtront après lui,
Dèce, Aurélien, Dioclétien, reviendront aux principes établis et suivis par
Trajan, Antonin, Marc Aurèle. L'entière paix de conscience de ces grands
hommes ne doit donc pas nous surprendre ; c'est évidemment avec une absolue
sérénité de cœur que Marc, en particulier, dédia au Capitole un temple à sa
déesse favorite, à |